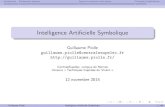Conscience artificielle
description
Transcript of Conscience artificielle

Biologie et conscience, CNAM 2002 1
Conscience artificielle
Alain Cardon
LIH Université du Havre
LIP6 Université Paris VI

Biologie et conscience, CNAM 2002 2
Plan
• Le problème
• Quelques principes
• Le système générateur d’émotions
• L’élément minimal de conception
• La pensée artificielle
• Conclusion

Biologie et conscience, CNAM 2002 3
Artificiel, pour un informaticien
• Analyser la question (le problème).
• Concevoir un système.
• Construire et mettre en expérimentation.
• Boucler sur l’analyse.

Biologie et conscience, CNAM 2002 4
Énoncé du problème
• Concevoir, à l’aide d’entités informatiques, un système qui génère des émotions et des faits de conscience, c’est-à-dire qui produit pour lui-même de la signification à propos de choses venues de son environnement, dont il a le souci à un certain moment, et qui se sert de mémoire pour produire des représentations élaborées.

Biologie et conscience, CNAM 2002 5
Mais des questions préalables
• Qu’est-ce, précisément, que penser artificiellement ?
• Est-ce seulement le raisonnement par l’entendement, la déduction, le logos ?
• Quel est le rapport entre l’objet pensé, la chose pensée, et un Soi pensant ?
• Peut-on ramener le fait de penser à la production d’un certain système ?

Biologie et conscience, CNAM 2002 6
La voie systémique
• Il est ici question de pensées artificielles et de conscience artificielle.
• La relation avec la pensée et la conscience dans le vivant est une réflexion indispensable, mais il y a des différences radicales.

Biologie et conscience, CNAM 2002 7
Eléments de conception
• Disposer d’un corps : robot multi-capteurs et multi-effecteurs.
• Disposer d’un « système émotionnel »: architecture logicielle couplée au corps
• Disposer d’un « système générateur de pensées »: architecture logicielle couplée à la précédente.
• Puis poser les hypothèses de faisabilité ...

Biologie et conscience, CNAM 2002 8
Distinctions conceptuelles
• Réactivité - adaptativité
• Émotion - sensation
• Structure - organisation
• Pensée - formulation langagière
• Mouvement - comportement motivé
• Réaction - intentionnalité

Biologie et conscience, CNAM 2002 9
Les éléments de conception• S’appuyer sur la corporéité d’un robot.
• Concevoir une architecture logicielle pour un système générant des émotions :– Qu’est-ce qu’une émotion pour une
architecture logicielle ?
• Concevoir le système générant des pensées comme une certaine extension : – Qu’est-ce qui amène à penser dans une
architecture logicielle ?

Biologie et conscience, CNAM 2002 10
Capteurs
Effecteurs
Système générateur d ’émotions
Système générateurde pensées

Biologie et conscience, CNAM 2002 11
Le système générateur d ’émotions

Biologie et conscience, CNAM 2002 12
A la recherche de l’élément de base pour la conception
• Le corps matériel étant considéré comme disponible (robot), quel est le bon élément de base de l’architecture logicielle du système générateur d’émotions ?
• Il faudra s’appuyer sur une architecture très plastique faite d’entités autonomes, communicantes et fortement agrégatives.

Biologie et conscience, CNAM 2002 13
Choix de l’élément de base
• Agent aspectuel : entité active, proactive, communicante, évolutive, prenant éventuellement des informations capteurs et en envoyant aux effecteurs.
• Un agent aspectuel représente un caractère symbolique et est une action effective.
Organisation d‘agents aspectuels

Biologie et conscience, CNAM 2002 14
L ’agent aspectuel
Communications
Connaissances
Actions
Comportement

Biologie et conscience, CNAM 2002 15
Et puis !
• En quoi une organisation d’agents peut-elle représenter des caractères d’une émotion ?
• Il faut représenter des processus et non seulement des effets, des résultats,
• Il faut représenter une fonction se calculant et non seulement le résultat de la fonction.

Biologie et conscience, CNAM 2002 16
Le composant de base
• Représenter à la fois les agents et les actions organisationnelles des agents : disposer d’une structure d’auto-observation des calculs en cours.
• Assurer un fort couplage entre l’organisation des agents et la structure d’auto-observation.

Biologie et conscience, CNAM 2002 17
Morphologie de paysage d’agents !
• L’auto-contrôle d’une organisation d’agents est assuré par une autre organisation d’agents, les agents de morphologie analysant in-line les caractères organisationnels de la première.

Biologie et conscience, CNAM 2002 18
Caractères morphologiques
• Considérer tout agent aspectuel comme soumis à des forces internes et externes :– Vitesse de développement de l’agent : vélocité– Activité et développement social de l’agent par
rapport à son contexte : facilité – Intensité et domination de l’agent par rapport
aux autres : suprématie
Saillance = combinaison linéaire de ces trois caractères

Biologie et conscience, CNAM 2002 19
Les dimensions de l’espace morphologique
Aspect externe Suprématiede l'agent Indépendance
PersistanceAspect interne Facilité
de l'agent VélocitéEtat
organisationnelIntensité du flux interne d'activation
de l'agent ComplexificationFréquence communicationnelle
Ecart organisationnelOuverture du
systèmeTransport d'information

Biologie et conscience, CNAM 2002 20

Biologie et conscience, CNAM 2002 21

Biologie et conscience, CNAM 2002 22

Biologie et conscience, CNAM 2002 23
Agentsd'interface
Agentsaspectuels
Agents demorphologie
Agents d'évocation
Système d'expression ducomportement

Biologie et conscience, CNAM 2002 24
La carte émotionnelle artificielle
• C’est un élément complexe composé :– d’une organisation d’agents aspectuels,– d’une organisation morphologique,– d’un processus de couplage fort entre les deux
organisations appelé processus miroir.
• Cet élément est adaptatif, auto-contrôlé, centré sur un rôle (une fonctionnalité), coopératif, synchronisable avec d’autres cartes.

Biologie et conscience, CNAM 2002 25
La structure génératrice des émotions
• Capteurs - effecteurs
• Éléments d’interface (agents spécifiques)
• Ensemble de cartes émotionnelles synchronisables par des agents de synchronisation.

Biologie et conscience, CNAM 2002 26
Le système générateur de pensées

Biologie et conscience, CNAM 2002 27
• Architecture inspirée de celle des cartes émotionnelles
• MAIS …. il y a aura beaucoup plus.

Biologie et conscience, CNAM 2002 28
Les questions
• Qu’est-ce qui peut conduire à penser ?– Il faut doter le système d ’une capacité à
vouloir penser.
• Comment se représente la pensée ?– Il faut trouver ce qu’est un état de pensée
artificielle
• Comment se représente et agit la mémoire ?– Il faut construire une mémoire incrémentielle
et sélective

Biologie et conscience, CNAM 2002 29
Encore des questions
• Quel est le lien entre la structure représentant des émotions et celle générant des pensées ?– Il faut définir des entités de couplage
• Comment se génère le langage et comment se représentent les mots ?– Il faut engendrer des mots à partir de formes de
pensées artificielles

Biologie et conscience, CNAM 2002 30
Le système
• Une architecture :– Basée sur la notion de composant adaptatif :
proactif, auto-observateur, évolutif– Formée d ’un ensemble de tels composants
synchronisés par des agents particuliers– Construite en co-construction avec le corps du
robot.

Biologie et conscience, CNAM 2002 31
Interface
Aspectuels
Morphologiques
Analyse
Carte corporelle Structure de signification
Éléments d ’anticipation
Synchroniseur
Eléments de mémoire

Biologie et conscience, CNAM 2002 32
Catégories générales du système
• Système « partiellement de Turing »• Etat fluctuant : sensations perçues• Notion de scène latente et de scène
signifiante: pensée et signification• Sensation de son organisation (sentiment de
soi)• Prégnances : pulsions, motivations, tendances

Biologie et conscience, CNAM 2002 33
Construire ?
• Il faut un robot spécifique.
• Il faut une grappe de processeurs (grappe de grappes) avec réseau très haut débit.
• Il faut calibrer les cartes émotionnelles et les structures de signification au cadre calculable.
• …..

Biologie et conscience, CNAM 2002 34
Points novateurs de l ’étude
• Calculabilité : représentation de l’acte de penser sous une forme calculable a posteriori (systèmes très complexes).
• Définition d’un système distribué auto-contrôlé, agissant intentionnellement, adaptatif, évolutif.
• Nouvelle méthode d’agentification basée sur la co-définition corps - éléments logiciels.

Biologie et conscience, CNAM 2002 35
Conclusion
• Travail typiquement pluridisciplinaire.
• La pensée artificielle ouvre sur des systèmes non strictement contrôlables, ne résolvant pas seulement des problèmes bien posés …
• Différences très grandes avec la pensée humaine.