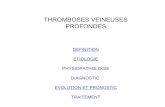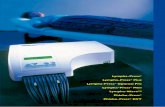Thérapeutiques endovasculaires des pathologies veineuses || Traitement endovasculaire du syndrome...
Transcript of Thérapeutiques endovasculaires des pathologies veineuses || Traitement endovasculaire du syndrome...

Traitement endovasculaire du syndrome
post-thrombotique des membres inferieurs 14
T. Martinellil, F. Thony2, J.-P. Beregi3
Introduction
Le syndrome post-thrombotique ou post-phlebitique (SPP) des membres inferieurs, secondaire a une thrombose veineuse profonde (TVP) chronique regroupe les manifestations cliniques en rapport avec une obstruction et/ou une insuffisance veineuse. Il peut grever I' avenir fonctionne! d' un membre et modifier totalement la vie d' un patient.
Generalites
La prevalence du SPP apres une TVP aigue est estimee entre 20 et 50 % se!on les series [1-3] malgre un traitement medical bien conduit. Elle atteint 77 % pour certains auteurs [4] apres une TVP proximale. Compte tenu de la frequence de la maladie thrombo-embolique, le SPP represente un probleme de sante publique de grande ampleur. Il serait ainsi a I' origine d' une consommation medicale pouvant atteindre 1 % des depenses de sante. Il altere la qualite de vie comme la productivite [5, 6] et genere de nombreux frais directs
1. Centre hospitalier de Valence
179, boulevard du Marechal Juin 26000 Valence
2. Clinique universitaire de radiologie et imagerie medicale
CHU BP217 38043 Grenoble Cedex 09
3. H6pital Caremeau, CHU de Nfmes
Service de radiologie
30000 Nfmes
comme indirects [7]. Lorsque I' obstruction touche les veines iliaques, elle est a I' origine d' un SPP potentiellement severe du fait de la faible compensation par la collateralite [8]. Or, seulement 14 a 24 % des thromboses de veines iliaques [9, 10] sont repermeabilisees, au moins partiellement, apres une TVP traitee par anticoagulants seuls.
Les patients ayant une TVP chronique ont anssi un risque augmente de recidive de maladie thrombo-embolique (hazard ratio de 2,4 dans I' etude de Prandoni [11]) et Hull dans une meta-analyse de 11 etudes [12] a observe que la thrombose residuelle etait un facteur fortement predictif de nouve! evenement thrombo-embolique.
Le traitement de ces SPP commence par la prevention, incluant un traitement anticoagulant bien conduit, I' utilisation de bas de contention et le traitement endovasculaire des TVP proximales aigues (voir le chapitre correspondant). La compression veineuse reduit d' environ 50 % le risque de SPP apres un episode de TVP [13].
Lorsqu' un SPP s' est installe, il est possible de proposer un traitement, le plns souvent endovasculaire. Ce traitement s' interesse essentiellement a I' obstruction veinense de I' etage femoro-iliaque et cave inferieur. Il a pour objectif d' amender la symptomatologie du SPP, de diminuer le risque de recidive thrombotique et de proteger le systeme veineux profond d'une evolution pejorative en rapport avec l'hyperpression veineuse et I' ischemie tissulaire.
M. Greiner, Thérapeutiques endovasculaires des pathologies veineuses© Springer-Verlag France, Paris 2013

186
Physiopathologie
Le developpement d' un thrombus dans une veine induit une stase veineuse respousable d' une ischemie endotheliale, point de depart de I' inflammation. Cette inflammation passe par I' activation des leucocytes et leur adherence a I' endothelium [14]. L inflammation et I' adherence cellulaire permettent une colonisation du thrombus residuel par des cellules granulomateuses puis son orgauisation tissulaire [15].
Le thrombus lui-meme evolue parallelement vers la thrombolyse, ou, s' il persiste, vers la retraction par polymerisation de la fibrine.
Retraction du thrombus, adherence a la paroi et colonisation cellulaire induisent une fibrose veineuse retractile et des synechies, une perte des proprietes d' elasticite et de contractilite de la veine aiusi qu' une destruction des valves.
La chronologie de cette cicatrisation veineuse, et plus particulierement le temps necessaire a la disparition totale du caillot, varie de plusieurs semaines a plusieurs mois, expliquant I' efficacite inconstante mais decroissante de la fibrinolyse in situ au fil du temps. C' est aussi pour cette raison que le traitement des thromboses veineuses chroniques, qui se base sur I' angioplastie et non sur la thrombolyse pharmacomecauique, ne sera envisage qu' apres 6 a 12 mois d' evolution, quand le caillot a totalement disparu.
L insuffisance veineuse au cours du SPP est en rapport avec les lesions valvulaires dues a la reaction inflammatoire induite par la thrombose veineuse aigue. Elle peut aussi en partie etre liee a, ou aggravee, par la distension veineuse en rapport avec une hyperpression en amont d' un syndrome obstructif. Cette part de I' insuffisance veineuse est potentiellement reversible apres traitement de I' obstruction. L obstruction au cours du SPP est secondaire a I' absence de repermeabilisation, partielle ou totale de la veine thrombosee et le defaut de developpement des collaterales de drainage. Obstruction et insuffisance veineuse augmentent la pression veineuse d' amont, ralentissent le flux sanguin et induisent par ce biais une ischemie tissulaire, I' ensemble etant responsable des cedemes, de la claudication veineuse et des remaniements cutanes (sclerose, pigmentation et ulceres).
Semiologie clinique
Le SPP apparait le plus souvent dans les deux premieres annees suivant la thrombose aigue, apres une phase d' amelioration clinique variable en rapport avec la thrombolyse physiologique ou la fibrose veineuse et le developpement des collaterales.
Le SPP recouvre une semiologie vaste, secondaire a deux alterations structurelles et fonctionnelles vasculaires : I' insuffisance et I' obstruction veineuses.
T. Martinelli, F. Thony, J.·P. Beregi
L obstruction veineuse est responsable d' une symptomatologie preponderante a I' effort (claudication veineuse du mollet, jambe lourde, fatigabilite du membre et cedeme) et particulierement lors de la marche en montee. L insuffisance veineuse est responsable d' une symptomatologie au repos en position assise ou debout, et en fin de journee (cedeme, impatiences, douleurs), avec amelioration au repos et par la surelevation des membres inferieurs.
Ces deux processus pathologiques sont associes dans 55 % des SPP ; en general, la symptomatologie est plus severe lorsqu'ils sont associes [16]. Les formes les plus graves comportent des signes cutanes : sclerose cutanee, pigmentation et ulceres associes aux telangiectasies, varicosites et varices.
Acette symptomatologie veineuse des membres inferieurs peut s' ajouter un syndrome de congestion pelvienne dil au developpement de varices sur le systeme veineux de derivation. Il associe, a differents degres, pesanteur pelvienne, dysmenorrhees, dyspareunie, symptOmes souvent variables au cours du cycle menstruel.
Exploration d'un syndrome post-phlebitique
Bilan clinique
Lexploration d'un syndrome post-phlebitique commence par un bilan clinique qui evalue sa severite d' apres les signes fonctionnels rapportes par le patient et les signes cliniques objectifs : telangiectasies, varices, cedeme du membre, pigmentation/eczema, lipodermatosclerose/atrophie blanche, ulcere veineux cicatrise, ulcere veineux actif. Plusieurs classifications ont ete proposees pour coter la severite des symptomes, ce qui permet d' evaluer le retentissement du SPP et de suivre objectivement I' amelioration apres traitement. La classification CEAP [17] (tableau I) a pour interet son exhaustivite en pathologie veineuse mais n' est pas specifique du SPP et ne prend pas en compte les signes fonctionnels. La classification de Villalta est plus specifique et inclut les signes fonctionnels. Elle a ete recemment adoptee par The International Society on Thrombosis and Haemostasis [18, 19] (tableau II). D' usage plus facile que la classification CEAP, elle pourrait permettre un support fiable pour I' evaluation clinique des SPP en pratique quotidienne comme en recherche. Afin de pouvoir comparer les resultats des therapeutiques veineuses, I' American Venous Forum a etabli le Venous Clinical Severity Score (VCSS) [20] qui prend notamment en compte la douleur et I' utilisation du traitement par compression en plus des signes cliniques objectifs (tableau III). Enfin les questionnaires de qualite de vie peuvent aussi elre utilises comme

14 Traitement endovasculaire du syndrome post-thrombotique des membres inferieurs 187
Tableau 1- Classification CEAP (Clinique, Etiologique, Anatomique, Physiopathologique) 2004.
Classification c1inique -:C~O,-_________________ ~P-;-;as""-,d .... e?signe visible ou ~ ble de maladie veineuse -:C~1c-__________________ ~TeC'"' I";"""an ,g iectasies ou veines reticulaires ~C~2~ ________________ ~~~ar~~~es(>3mm),-___________ _ Q ~~
C4 ______ -:Co-:4:;:oa ____________ -:-:'Pigmentation et/ou eczema
C4b Lipodermatosclerose eVou alro hie blanche C5 C6
S
Ulcere veineux cicatrise Ulcere veineux actif Symptomatique (douleur, constriction, irritation cutanee, lourdeur, crampes musculaires el egalemenl d'autres plaintes en
________________________ ra,ll(J<lrt avec une clys/onction veineuse), _______ _ A Asymptomatique
Clas i fication etiologique -:E="c _________________ -:Co=0ngenital ~~ ___________________ 7~~im~a~ir~e ~ou~p~~~~if~~~~-----____ _ -:E="s'-_________________ ~S:--"ec .... o-:::ndc;:a"'?ire (posI-thrombotig,;ue;h _________ _ ..:E::;.n:-. __________________ -'--P,..as:..:d .. 'e..,·ti...,ol ... o,gie veineuse identifiee
Classification anatomique As
Apr An
Cla
Veines supe ... rfi ... lci ... el .... le ... s __ _ Veines erforantes Veines pr%ndes Pas de localisation veineuse idenlifiee
Reflux Po Cllstruction Pr,o Reflux et obstruction
-'Prn'--:-_________________ -'--P.:::as:..:d:.:e:J:p:.:.:hJ~s .... io:r...:::at:.::ho=log""ie:...:v..::cei::.!ne=.:u",s::..e "'ide"'n""li""fie .... ' e'-____ _ Elabonie Veinessu
2 3 4 5
rficielles
Veines profondes 6 7 8
9
Veines reliculares / telangiectasies Grande veine hene au-<lessus du g~enC!.::0~u __________________ _ Grande veine sa heme en dessous du enou Petite veine sapheme Veine non saphime
Veine cave inferieure Veine iliaque commune Veine iliaque interne
Veine iliaque externe
10 Veine pelvienne : gonadique, du ligament large, autres
11 Veine femorale commune _1"'2 ______ Y,~e"'in=e (:lrofonde de cuisse
13 Veine femorale 14 Veine popl~ee 15 Crurales : tibiale anterieure, tibiale poste
rieure, ou fibulares (toutes doubles)
16
Veines erforantes 17 18
Musculaire : gastrochnemiennes, soleaires, Butres
A la cuisse Aumollet

188 T. Martinelli, F. Thony, J.·P. Beregi
Tableau 11- Classification de Villalta (score de gravite de syndrome post-phlebitique).
S m ptomes rapportes par le patient Lourdeur Douleur Crampes Prurit Paresthesies
Signes cliniques evalues par le clinicien CEdeme pretilial Induration cutanee Hyperpigmentation Ectasie veineuse Rougeur Douleur a la compression du mollet Ulcere
Chaque symptome eomme ehaque s~ ne dinique est cote 0 = absent, 1 =Iaible, 2 = modere, 3 = severe. Lapresence d'ulcere est eotee 0 (absence) ou 1 (presence). Le SPP est cote comme absent (0-4), leger (5-9), modere (1 0-14) ou sevilre (<! 15).
Tableau 111- Oassification VCSS (score de severite clinique, 2010).
Symptomes Douleurs
ou autres in co nforts ( strictions, latigue, pesanteurs, brOlures) presumes d'ongine veineuse
Veines vanqueuses (<! 3 mm en position debout)
Absent = 0 Leger = 1
Aucune
Aucune
Occasionnellement, ne l im ~ant pas I'act iv~e
et ne necessitant pas d'anta~ iques
Quelques, eparses
Mcxlere = 2 Quotidiennement, lim~ant
moderement I 'act iv~e et necess~ant Ia prise ponetuelle d'antalgiques
Lim~ees a la jambe ou ä la euisse
Severe = 3
Quot id ien nement, lim ita nt les act iv~es de faliOn importante ou necessila nt la prise reguliere d'anta ~iques
Alle ig na nt la c uisse et le mollet
CEdeme veineux (presume d'or igine veineuse)
Aucune Limite au pied et ä la S'etendant a u-dessus de ehevi lle la cheville mais sous le
S'etendant jusqu 'au genou et au-dessus
Pigmentation cutanee presumee d'or~ ine veineuse
N'incl ut pas la pigmentation locale le long des veines va· Aucune r iqueuses ou Ia pigmentation due ä d'autres affeetions ehro· niques
Inflammation
Plus qu'une simple p~menta· Aucune tion recente (eezema veineux, erytheme, eellulite, dermite)
Induration
Modification secondaire de la peau et du tissu sous-cutane presumee d'origine veineuse (cedeme ehronique avec fi· brose, hypodennile). I nelus I'atrophie b lanehe etla Ipoder· matosclerose
Nombre d'ulceres actifs
Aucune
o Duree d'activite des uleeres Aucune (pour le plus vieux)
Ta ille des ulceres actifs (dia· Aucun metre du plus g ran d)
T ra itement compressif Non utilise
Limitee ä la region perimalleolaire
Limitee a la region perimalleolaire
Limitee a la region perimalleolaire
< 3 mois
<2cm
Usage intermillent
genou
Diffuse sur le tiers inlerieur Distrilution plus large au· dessus du tiers inferieur d e
de la jambe la jambe
Diffuse s ur le tiers inferieur Distrilution plus large au· dessus du tiers inferieur d e
de la jambe la jambe
Diffuse sur le tiers inferieur Distrilution plus large au· dessus du tiers inferieur d e
de la jambe la jambe
2 3 ou plus
3 mois· l an > 1 an
2-6cm >6cm
La plupart du temps Continuellement

14 Traitement endovasculaire du syndrome post-thrombotique des membres inferieurs 189
le CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency Quality of Life Phlebographie Questionnaire) [21] qui est adapte aux pathologies vei- La phlebographie objective le site d'obstruction, sa seveneuses chroniques. rite, son etendue et le reseau de collaterales. Elle constitue
Investigations paracliniques
Lorsque le SPP est diagnostique et quantifie par I' intenogatoire et I' examen clinique, des investigations sont necessaires pour dresser un bilan morphologique et hemodynamique. Le bilan morphologique etablit une cartographie des segments veineux profonds et superficieIs presentant des sequelles obstructives, precise I' etat des valvules veinenses et analyse les voies de derivation veineuse. Le bilan hemodynamique recherche une insuffisance veineuse fonctiounelle en position debout et identifie les zones d' obstruction et leur severite. A la difference de la pathologie arterielle, il n' existe a I' heure actuelle aucun test fiable pour determiner le siege et la severite de I' obstruction veinense [22].
Echo-Doppler L echo-Doppler est indispensable car il permet une approche morphologique et hemodynamique. Il identifie les sites d' obstruction, recherche une insuffisance veineuse associee et realise une cartographie des lesions. Cet examen doit preciser I' etat du systeme veineux profond mais aussi superfieie!. Il est anssi utile pour choisir I' eventuelle voie d' abord therapeutique en precisant notamment I' etat des veines femorales communes.
Imagerie en coupes (lRM, TOM) Limagerie en coupes (IRM, TDM) est importante en cas d' obstruction iliaque depistee par I' echo-Doppler pour objectiver une compression extrinseque sous-jacente. En effet, si un syndrome de Cockett (ou May-Thurner) peut etre a I' origine d' un obstacle au retour veineux, les tumeurs malignes, benignes, une fibrose retroperitoneale et les anomalies congenitales du systeme veineux cave iuferieur constituent aussi des etiologies arechercher. Au cours de I' examen TDM ou IRM, une phlebographie peut etre obtenue par injection directe dans une veine du pied. Celle-ci etablit une cartographie des sequelles post-thrombotiques et des neocircuits veineux.
Plethysmographie La plethysmographie permet de preciser le fonctionnement de la pompe veino-mnsculaire au mollet et d' evaluer les reflux superficieIs et profonds. Elle peut etre utile dans I' evaluation initiale mais sa disponibilite reste limitee a I' heure actuelle.
Dans le cadre de I' evaluation de la plainte fonctiounelle, un test de Strandness veineux peut aider a etayer I' indication therapeutique en evaluant la severite de la claudication.
le premier temps de tout traitement, qu' il soit endovasculaire ou chirurgieal, si une phJebographie de bonne qualite n' a pas ete obtenue par scauner ou IRM. On pouna lui associer une prise de pression veinense intraluminale, notamment a I' etage iliaque et cave inferieur, afin de rechereher un gradient de pression.
Echographie intravasculaire Pour certains auteurs, I' echographie intravasculaire est superieure a la phlebographie pour determiner le degre de stenose, sa longueur et guider la pose du stent [23]. Cependant elle est a I' origine d' un sureout tres important necessitant plns de preuves scientifiques pour en recommander I' usage systematique.
Bilan de I'hemostase Une thrombophilie est recherchee de maniere systematique. Sa decouverte peut amener a ponderer I' indication d' un traitement endovasculaire ou chirurgical compte tenu du risque de thrombose precoce et imposera apres desobstruction un traitement anticoagulant efficace et rigourensement suivi. Cependant, Kearon [24] a montre que les facteurs de thrombophilie en dehors d' une hyperhomocysteinemie n' etaient pas associes a une majoration du risque de recidive d' un episode thrombo-embolique sous traitement anticoagulant.
Traitement endovasculaire du SPP (figs 1 et 2)
Le traitement endovasculaire consiste essentiellement en un traitement des lesions obstructives a I' etage femoral commun, iliaque et parfois cave inferieur. Lorsque les segments veineux en amont de la veine femorale commune sont pathologiques, I' etendue des lesions est souvent importante et associe obstruction et destruction des valves. Le traitement des lesions obstructives a ce niveau n' a pas encore fait la preuve de son efficacite.
Le traitement de I' obstruction est actuellement endovasculaire [25], plutöt que chirurgica!. La chirurgie ne se discute qu' en cas d' impossibilite de traitement endovasculaire, d' echec de celui-ci et pour le traitement des insuffisances veineuses realise dans des centres tres specialises.
Indication du traitement
La decision d' un traitement endovasculaire tiendra compte de la severite de la pathologie veineuse (claudication, douleurs, cedeme, atteintes cutanees), de I' etendue des lesions,

190 T. Martinelli, F. Thony, J.·P. Beregi
Fig.l - Patiente de 24 ans, aux antecedents de thrombose veineuse profonde idiopathique poplitee et femoro-iliaque gauche SUIvenue un an auparavant, sans thrombophilie retrouvee. La patiente presente une claudication veineuse residuelle avec un perimetre de marche a 150 metres (authentifie par Strandness veineux) et un cedeme residuel de cuisse necessitant une contention de classe III. a. Phlebo-IRM avec injection bi-pedieuse de gadolinium, de face et en obliques anterieurs droit et gauche a 30° Occlusion iliaque etendue avec drainage par des collaterales parietales posterieures, sus-pubiennes et ovariques. b. Phlebographie par injection dans 1a veine femorale commune gauche. Absence d'axe veineux iliaque gauche et drainage par les collaterales precedemment decrites. c. Angioplastie progressive au ballon de 5 mm de diametre. Constriction du ballon au niveau de la veine iliaque commune gauche traduisant la presence de synechies en rapport avec un syndrome de Cockett ou des sequelles de thrombose. d. Contr6le angiographique apres angioplastie au ballon de 5 mm. Restitution d'un chenal circulant de faible diametre. Occlusion complete de la veine iliaque commune avec image de compression extrinseque traduisant la presence d'un syndrome de Cockett. e. Angioplastie etagee au ballon de 10 mm.

14 Traitement endovasculaire du syndrome post-thrombotique des membres inferieurs 191
de la difficulte et des risques de la desobstruction. Il faut cependant garder en memoire que I' objectif n' est pas seulement une amelioration clinique mais aussi la preservation du systeme veineux a long terme et la diminution du risque de thrombose recidivante, tout particulierement chez le sujet jeune. Dans les stades les plus severes, en relation avec des lesions obstructives etendues et une insuffisance veineuse, le traitement de I' obstruction veinense a I' etage iliaque peut suffire a ameliorer considerablement le SPP si I' obstacle Mmodynarnique predomine a ce niveau [26].
En pratique, un traitement pour une thrombose veineuse chronique n' est envisage qu' apres 6 a 12 mois d' evolution, lorsque la recuperation clinique est insuffisante, traduisant I' absence ou I' insuffisance de thrombolyse et de developpement de collaterales de derivation.
f. Phlebographie iliaque droite POUf preciser la topographie de la convergence veineuse avant mise en place des endoprotheses. g. Cliche de contr61e durant l' angioplastie complementaire, apres deploiement de deux endoprotheses en nitinol. h. Phlebographie de contr61e apres desobstruction. Bonne permeabilite du chenal endoprothetique avec disparition des collaterales de drainage temoignant de la restitution d'une hemodynamique satisfaisante. Image d'extravasation de produit de contraste au niveau de l' aine due au retrait de l'introducteur durant l'injection. Patiente asymptomatique a 3 ans de l'inteIVentioll.
Preparation du patient
Il est conseille d' envisager un traitement endovasculaire sous analgesie ponssee car I' angioplastie de veines fi breuses et retractiles peut etre tres algique. Si cela n' est pas possible, il faut au moment de I' angioplastie prevenir les douleurs, par exemple par inhalation de protoxyde d' azote et administration de morphiniques IV.
Realisation technique
l' abord veineux est femoral commun homolateral, lorsque la veine est permeable, puis un introducteur de 8 a 10 Fr est mis en place. Si la veine femorale commune est occlnse, I' abord peut elre controlateral a la lesion, homolateral sousjacent (femorale superficielle, saphene interne ou poplitee) ou jugulaire interne. Pour les acces veineux difficiles, la ponction est realisee sons contröle echographique. Lorsque la recanalisation veinense est laborieuse, un abord double Gugulaire et femoral) peut etre requis. Apres une phlebographie de reperage, la portion stenosee ou occluse est franchie a I' aide d'un gnide hydrophile 0,035 et d'un catMter diagnostic 4 ou 5 Fr. En raison de la facilite d' effraction parietale, la recanalisation veineuse doit etre delicate. La recanalisation retrograde est plus longue car le guide a tendance a

192
prendre le trajet de nombreuses collaterales. Une phlebographie de contröle doit alors verifier que le segment recanalise correspond a I' axe iliaque natif et non ades collaterales, et preciser les limites superieure et inferieure de I' occlusion.
T. Martinelli, F. Thony, J.-P. Beregi
b Fig.2 - Homme de 63 ans, ayant presente une thrombophlebite du membre inferieur gauche un an auparavant, au cours d'une reeducation POUf prothese de hanche. Persistance cl'un syndrome post-phlebitique important et invalidant, avec une claudication a 100 metres 10rs de la marche en montee. CEdeme de tout le membre, varices superficielles et hypodermite jambiere cl'aggravation progressive malgre le traitement anticoagulant et la contention. a. Phlebo-scanner avec injection bi-pedieuse de produit de contraste, reconstruction 3DVRf (diehe du a l' obligeance du Dr A. Marie). Occlusion veineuse profonde depuis la veine femorale superficielle jusqu' a la veine iliaque commune gauche, occlusion de la veine grande saphene gauche. Collateralite tres peu developpee. b. Phlebographie ilio-cave droite avant recanalisation, par abord jugulaire interne. Meplat sur le bord gauche de la veine, permettant de reperer l'abouchement de la veine iliaque gauche qui est occluse.
On realise ensuite une angioplastie au ballon du se gment pathologique, suivie de la pose d' endoprothese(s) sur I' ensemble du segment recanalise. Lorsque la veine est tres atresique, il est preferable de realiser des angioplasties progressives avec des ballons de diametre croissant afin d' eviter une rupture veineuse. Une angioplastie haute pression peut etre utilisee en cas de stenose fibreuse resistante. La mise en place d' endoprothese(s) sur I' ensemble du segment pathologique est necessaire afin d' eviter un collapsus veineux qui expose a une occlusion aigue ou a la formation de nouvelles synechies. Il est cependant parfois difficile de faire la part entre un segment veineux pathologique et un segment veineux spasme ou collabe par insuffisance de debit. Daus ces deux dernieres configurations, I' absence de recuperation

14 Traitement endovasculaire du syndrome post-thrombotique des membres inferieurs 193
c
d' un calibre et d' un flux corrects apres une angioplastie a faible pression doit faire discuter la pose d' une endoprothese afin de restituer un calibre satisfaisant et un flux a bon debit, seuls garants d' un taux de permeabilite immediate et a long terme satisfaisant.
Lorsque I' obstruction veineuse s' etend vers I' amont en veine femorale, il est le plus souvent necessaire d' equiper la veine femorale commune d' endoprothese. Ceci peut etre realise sans arriere-pensee en privilegiant I' utilisation d' un stent soupie. Neglen [27] a recemment montre que le stenting sous-inguinal de la veine femorale commune n' est pas un facteur de restenose. Celle-ci serait plutöt liee a I' etiologie de I' obstruction, I' origine post-thrombotique representant un facteur de risque. Lorsqu' il persiste des synechies veineuses en amont, dans les veines femorales profonde etJou superfi-
d Fig.2suite-c. Phlebographie femorale apres recanalisation, par injection dans la veine femorale commune. Opacification descendante d'une veine femorale superficielle greJe, avec multiples synechies et perte des reliefs valvulaires. Drainage par des collaterales pelviennes tres peu developpees. d. Cliche de contr61e au cours de l' angioplastie de synechies femorales superficielles.
cielle, elles peuvent etre respectees si le flux est satisfaisant ou dilatees simplement si le debit veineux est faible. Il est en revanche actuellement deconseille (en I' absence de donnees scientifiques) d' etendre la mise en place d' endoprotheses au niveau femoral superficiel, voire poplite.
En cas de traitement d' une obstruction iliaque commune par I' artere iliaque primitive droite, le stent doit deborder dans la veine cave inferieure. Un debord large doune I' assurance d' une reouverture totale de la zone de compression mais presente le risque d' une stenose de la veine cave inferieure et d' une obstruction du flux veineux controlateral. Ces risques restent faibles, atteignant 1 % dans la serie de Neglen [28]. Il est preferable de privilegier a ce niveau I' utilisation de stents ayant une bonne force d' expansion radiale (stent en uitinol a force d' expansion elevee).

194
e
Fig.2suite-e. Phlebographie de contr61e apres deploiement cl' endoprotheses depuis la terminaison de la veine femorale superficielle jusqu'a la veine iliaque commune gauche. Chenal vasculaire de diametre large et regulier, sans opacification de collaterales de drainage. f. Phlebographie de contr61e a l' etage femoral: l' extremite du stent est situee en veine femorale superficielle. La veine en amant conseIVe un calibre tres irregulier, mais les collaterales ont disparu et le ftux veineux est rapide. Disparition de la claudication a la marche, regression importante de l'cedeme a 6 mais de l'inteIVention.
Choix des endoprotheses
L endoprothese ideale doit avoir une force d' expansion suffisante pour maintenir la veine ouverte, notamment en regard d' une compression extrinseque, mais elle doit avoir une grande souplesse axiale et longitudinale pour s' adapter aux mouvements de la veine en particulier au niveau du pli de I' aine. Enfin, des mailIes larges sont a privilegier en cas de couverture de collaterales fonctionnelles. L utilisation d' endoprotheses autoexpansibles est donc de regle. Les stents en acier (Wallstent'l) sont les plns utilises enAmerique du Nord, ce qui explique leur representation importante dans la litterature. Les stents en uitinol presentent pour avantages une grande souplesse axiale comme longitudinale, ainsi qu' une longueur fixe et une meilleure force d' expansion [29]. Le calibre est couramment compris entre 10 et 14 mm, adapte a celui de la veine ; il est d' au moins 12 mm pour une veine iliaque primitive. Lorsque plusieurs endoprotheses sont uti-
T. Martinelli, F. Thony, J.-P. Beregi
f
lisees, un chevauchement d' au moins 1 cm permet de preveuir une decoaptation avec eventuelle restenose inter-stent. L utilisation de stents couverts n' a pas a ce jour apporte la preuve d' une superiorite.
Traitements complementaires
Traitement anticoagulant peret postoperatoire
Un bolus d'heparine (5 000 UI en moyeune) est admiuistre au debut de la desobstruction afin d' eviter une thrombose in
situ durant ou au decours immediat du geste. n n' existe pas a I' heure actuelle de consensns sur le traite
ment anticoagulant postoperatoire. Les patients etant en regle generale sons traitementAVK, celui-ci peut etre poursuivi de

14 Traitement endovasculaire du syndrome post-thrombotique des membres inferieurs 195
3 mois a 1 an [30, 31] puis arrete si I' hemodynamique du systeme veineux profond est satisfaisante ou poursuivi s' il persiste un syndrome obstructif poplite et femoral, etJ ou une insuffisance veineuse marquee, ou une thrombophilie.
Un traitement par anti-agregant plaquettaire a vie est de regle pour certaius [30, 32], inutile pour d' autres [31,33,34].
Contention veineuse
Afin de diminuer le risque de thrombose precoce, on recommandera une deambulation rapide (6 a 12 heures apres I' intervention) et la reprise immediate des bas de contention. A distance, en fonction des lesions residuelles et de I' amelioration clinique, ils pourront etre eventuellement euleves.
Traitement du reflux
Actuellement, le traitement du reflux profond reste chirurgical par recoustruction interne ou externe de la competence valvulaire. Conformement aux recommandatious de I'UlP, le traitement interesse en premier lieu le reseau superficie! en cas de coexistence de reflux superficie! et profond. Ce deruier n' est traite qu' en cas d' echec du traitement du reseau superficie! [25].
Depuis les annees 1990, plusieurs valves implantables par voie endovasculaire ont ete deve!oppees : valves synthetiques ou biologiques presentant une ou plusieurs valvules, montees sur un stent en general auto-expansible. Elles restent encore experimentales [35]. Le risque principal est la thrombose precoce de ces materie!s.
Resultats
Le taux de reussite technique est superieur a 90 % daus les equipes entrainees [28, 31, 32, 34]. Les chances de succes dependent de la longueur du segment occlus, de la persistance d' une veine anatomiquement individualisable et du calibre (superieures en veine iliaque commune).
Le taux de complications est faible, inferieur a 10 %. La mortalite rapportee est nulle. Les complications, autres que la rethrombose, sont essentiellement des hematomes au point de ponction ou retroperitoneaux « 1 %). Des faux anevrysmes au point de ponction ou des fistules arterioveineuses ont ete egalement decrits [28, 32]. Le risque de rupture veineuse est exceptionnel. Le risque d' embolie pulmonaire est inexistant si le traitement est realise apres six mois d' evolution.
L efficacite sur la symptomatologie est siguificative puisque la disparition totale des douleurs survient dans 62 % des cas et la guerison des ulceres daus 58 % des cas pour Neglen [28]. Dans d' autres series, I' amelioration des symptOmes survient daus 75 % [34] a 100 % des cas [30]. On
peut esperer une amelioration clinique complete si I' obstruction veineuse est pure et localisee (TVP chronique femoroiliaque avec integrite du systeme veineux sural, poplite et femoral superficie!) mais elle ne sera que partielle s' il existe une atteinte d' amont. Cependant, Raju a recemment montre daus une etude de 528 membres inferieurs presentant un syndrome obstructif associe a un reflux du reseau veineux profond que le traitement par stenting d' une obstruction iliaque snffit chez la majorite des patients presentant un SPP mixte [26]. L amelioration des douleurs et des <rdemes a cinq ans a ete obtenue daus 78 % et 55 % respectivement avec un amendement complet dans 71 % et 36 % alors qu' aucun traitement specifique du reflux n' a ete associe.
Dans les series incluant des traitements d' obstructious veineuses simples (syndromes de Cockett) et d' obstructious sequellaires de TVP, les taux a deux ans de permeabilite primaire varient de 67 a 78 % [28, 34, 36] et les taux de permeabilite secondaire de 79 a 95 % [28, 34, 36]. Les resultats sont inferieurs pour le traitement des sequelles de TVP Neglen, daus une large serie de 982 patients, retrouve des taux de permeabilite primaire et secondaire a trois ans respectivement de 57 % et 86 % [28] pour les patients ayant un SPP Dans des series recentes mais de taille plus modeste, on retrouve des valeurs du meme ordre avec un taux de permeabilite primaire et secondairea un an de 61 % et 81 % [37] atteignant plus de 90 % pour certains [31].
Conclusion
Le SPP est une pathologie frequente et invalidante, atteignant une population souvent jeune et active, avec une esperance de vie longue.
Le traitement endovasculaire est encore mal connu et peu utilise alors que son efficacite est elevee, sa morbidite faible et les taux de permeabilite a long terme eleves. La technique, bien que proche de I' angioplastie-stenting arterie! est plus difficile, notamment en cas de recanalisation, et necessite perseverance voire obstination. La desobstruction une fois realisee est completee par la contention, I' heparinotherapie et le lever rapide afin de lutter contre la thrombose precoce.
Il est important de suivre les patients apres une thrombose veineuse aigue proximale afin de pouvoir leur proposer en cas de SPP sequellaire invalidant une desobstruction veineuse percutanee.
References
1. Kalm SR, Shrier I, Julian JA et al. (2008) Determinants and time course of the postthrombotic syndrome after acute deep venous thrombosis. Arm Intern Med 149: 698-707
2. Tick LW, Doggen CJM, Rosendaal FR et al. (2010) Predictors of the post-thrombotic syndrome with non-invasive venous examinations in patients 6 weeks after a first episode of deep vein thrombosis. J Thromb Haemost 8: 2685-92

196
3. Prandoni P, Kahn SR (2009) Post-thrombotic syndrome: prevalence, prognostication and need for progress. Br J Haematol 145: 286-95
4. Haenen JH, Wollersheim H, Janssen MC et al. (2001) Evolution of deep venous thrombosis: a 2-year follow-up using duplex ultrasound scan and strain-gauge plethysmography. J Vasc Surg 34: 649-55
5. van Korlaar IM, Vossen CY, Rosendaal FR et al. (2004) The impact of venous thrombosis on quality of life. Thromb Res 114: 11-8
6. Kahn SR, Shbaklo H, Lamping DL et al. (2008) Determinants of health-related quality of life during the 2 years following deep vein thrombosis. J Thromb Haemost 6: 1105-12
7. Ashrani AA, Heit JA (2009) Incidence and cost burden of postthrombotic syndrome. J Thromb Thrombolysis 28: 465-76
8. Meissner MH, Eklof B, Smith PC et al. (2007) Secondary chronic venous disorders. J Vasc Surg 46 Suppl S: 68S-83S
9. Akesson H, Brudin L, Dahlstrom JA et al. (1990) Venousfunction assessed during a 5 year period after acute ilio-femoral venous thrombosis treated with anticoagulation. Eur J Vasc Surg 4: 43-8
10. Johnson BF, Manzo RA, Bergelin RO et al. (1995) Relationship between changes in the deep venous system and the development of the postthrombotic syndrome after an acute episode of lower limb deep vein thrombosis: a one- to six-year follow-up. J Vasc Surg 21: 307-12; discussion313
11. Prandoni P, Lensing AW, Prins MH et al. (2002) Residual venous thrombosis as a predictive factor of recurrent venous thromboembolism. Arm Intern Med 137: 955-60
12. Hull RD, Marder V J, Mah AF et al. (2005) Quantitative assessment of thrombus burden predicts the outcome of treatment for venous thrombosis: a systematic review. Am J Med 118: 456-64
13. Kolbach DN, Sandbrink MW, Hamulyak K et al. (2004) Nonpharmaceutical measures for prevention of post-thrombotic syndrome. Cochrane Database Syst Rev: CD004174
14. Lopez JA, Chen J (2009) Pathophysiology of venous thrombosis. Thromb Res 123 Supp14: S30-4
15. Line BR (2001) Pathophysiology and diagnosis of deep venous thrombosis. Semin Nucl Med 31: 90-101
16. Johnson BF, Manzo RA, Bergelin RO et al. (1996) The site of residual abnormalities in the leg veins in long-term follow-up after deep vein thrombosis and their relationship to the deve-1 opm ent of the post -throm boti c syndrom e. Int Angi 01 15: 14-9
17. Eklof B, Rutherford RB, Bergan JJ et al. (2004) Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: consensus statement. J Vasc Surg 40: 1248-52
18. Kahn SR, Partsch H, Vedantham S et al. (2009) Definition of post-thrombotic syndrome of the leg for use in clinical investigations: a recommendation for standardization. J Thromb Haemost 7: 879-83
19. Villalta S, Bagatella p Piccioli A et al. (1994) Assessment of validity and reproducibility of a c1inical scale for the postthrombotic syndrome (abstract). Haemostasis 24: 158a
20. Vasquez MA, Rabe E, Mc Lafferty RB et al. (2010) Revision of the venous clinical severity score: Venous outcomes consensus statement: Special communication of the American
T. Martinelli, F. Thony, J.·P. Beregi
Venous Forum Ad Hoc Outcomes Working Group. J Vasc Surg 52: 1387-96
21. Launois R, Reboul-Marty J, Henry B (1996) Construction and validation of a quality of life questiormaire in chronic lower limb venous insufficiency (CIVIQ). Qual Life Res 5: 539-54
22. Neglen p Raju S (2002) Proximal lower extremity chronic venous outflow obstruction: recognition and treatment. Semin Vasc Surg 15: 57-64
23. Neglen p Raju S (2002) Intravascular ultrasound scan evaluation of the obstructed vein. J Vasc Surg 35: 694-700
24. Kearon C, Julian JA, Kovacs MJ et al. (2008) Influence of thrombophilia on risk of recurrent venous thromboembolism while on warfarin: results from a randomized trial. Blood 112: 4432-6
25. Lurie F, Kistner R, Perrin M et al. (2010) Invasive treatment of deep venous disease. A UIP consensus. IntAngio129: 199-204
26. Raju S, Darcey R, Neglen P (2010) Unexpected major role for venous stenting in deep reflux disease. J Vasc Surg 51: 401-8; discussion 408
27. Neglen p Tackett TP, Jr, Raju S (2008) Venous stenting across the inguinal ligament. J Vasc Surg 48: 1255-61
28. Neglen P, Hollis KC, Olivier J et al. (2007) Stenting of the venous outflow in chronic venous disease: long-term stent-related outcome, clinical, and hemodynamic result. J Vasc Surg 46: 979-90
29. Duda SH, Wiskirchen J, Tepe G et al. (2000) Physical properlies of endovascular stents: an experimental comparison. J Vasc Interv Radiol11: 645-54
30. Delis KT, Bjarnason H, Wermberg PW et al. (2007) Successful iliac vein and inferior vena cava stenting ameliorates venous claudication and improves venous outfiow, calf musc1e pump function, and c1inical status in post-thrombotic syndrome. Arm Surg 245: 130-9
31. Rosales A, Sandbcek G, Jorgensen JJ (2010) Stenting for chronic post-thrombotic vena cava and iliofemoral venous occ1usions: mid-term patency and clinical outcome. Eur J Vasc Endovasc Surg 40: 234-40
32. Neglen P, Raju S (2000) Balloon dilation and stenting of chronic iliac vein obstruction: technical aspects and early c1inical outcome. J Endovasc Ther 7: 79-91
33. Gutzeit A, Zollikofer CL, Dettling-Pizzolato M et al. (2011) Endovascular stent treatment for symptomatic benign iliofemoral venous occ1usive disease: long-term results 1987-2009. Cardiovasc Intervent Radio134: 542-9
34. Kälbel T, Lindh M, Akesson Met al. (2009) Chronic iliac vein occ1usion: midterm results of endovascular recanalization. J Endovasc Ther 16: 483-91
35. Pavcnik D, Uchida B, Kaufman J et al. (2008) Percutaneous management of chronic deep venous reflux: review of experimental work and early clinical experience with bioprosthetic valve. Vasc Med 13: 75-84.
36. Titus JM, Moise MA, Bena J et al. (2011) Iliofemoral stenting for venous occlusive disease. J Vasc Surg 53: 706-712
37. Wahlgren CM, Wahlberg E, Olofsson P (2010) Endovascular treatment in postthrombotic syndrome. Vasc Endovascular Surg 44: 356-60