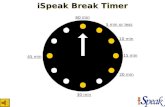Www Legislation Cnav Fr Textes Cr Min TLR CR MIN 2008245 220
Transcript of Www Legislation Cnav Fr Textes Cr Min TLR CR MIN 2008245 220

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
Circulaire 2008/245 du 22 juillet 2008
Minist� re du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarit�Minist� re de l'agriculture et de la p�che
Minist� re de la sant� , de la jeunesse, des sports et de la vie associativeMinist� re du budget, des comptes publics et de la fonction publique
DestinatairesMonsieur le ministre de l'agriculture et de la p�che,Secr�tariat g�n�ralMesdames et Messieurs les pr�fets de r�gion, directions r�gionales des affaires sanitaires et sociales, direction r�gionale etd�partementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarit� et de la sant�, directions de la sant� et du d�veloppementsocialMonsieur le directeur g�n�ral de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salari�sMonsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familialesMonsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesseMonsieur le directeur g�n�ral de la Caisse nationale du r�gime social des ind�pendants
ObjetModalit�s de contr�le de la condition de r�sidence pour le b�n�fice de certaines prestations sociales.
Date d'applicationImm�diate
R�sum�La pr�sente circulaire a pour objet de pr�ciser les conditions d'application par les organismes de s�curit� sociale de la condition der�sidence en France telle que d�finie � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale. Ce contr�le op�r�, au moins une fois par an, encours de service de la prestation doit conduire l'organisme � v�rifier la pr�sence stable et effective en France du b�n�ficiaire de laprestation.
Mots-cl�scontr�le des conditions de service des prestations sociales ; d�finition de la notion de r�sidence, d�termination du champ d'applicationpersonnel et mat�riel- proc�dure
Textes de r�f�renceArticles L.111-1, L.380-1, L.512-1, L.815-1, L.815-24 et L.861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations pr�vu par l'article L.161-8 etR.115-6, R.161-1.
Textes abrog�sN�ant

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
L'article L.111-1 du code de la s�curit� sociale subordonne le b�n�fice des prestations de s�curit� sociale � toute personne qui soitexerce une activit� professionnelle au titre de laquelle elle acquitte des cotisations de s�curit� sociale, soit r�side de mani�re stable eteffective en France.
Tant le contr�le de l'exercice d'une activit� professionnelle donnant lieu � versement de cotisations que le contr�le de la condition der�sidence en France constituent un objectif prioritaire assign� aux organismes de s�curit� sociale. En effet, ce contr�le doit permettre des'assurer que les personnes b�n�ficiaires des prestations contribuent au financement du syst�me de s�curit� sociale ou sont en droit deb�n�ficier de prestations financ�es par la solidarit� nationale.
La pr�sente circulaire a pour objet de pr�ciser les modalit�s de contr�le de la condition de r�sidence telle que d�finie par le nouvel articleR.115-6 du code de la s�curit� sociale et de fournir des �l�ments relatifs aux crit�res et aux modalit�s de ce contr�le.
1 - La condition de r�sidence d� finie � l'article R.115-6 du Code de la S�curit� Sociale doit permettre le contr� le du service desprestations
L'article 1er du d�cret n� 2007-354 du 14 mars 2007 dispose :
" Art. R. 115-6. - Pour b�n�ficier du service des prestations en application du troisi�me alin�a de l'article L.111-1 et des articles L. 380-1, L.512-1, L.815-1, L.815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations pr�vu par l'article L.161-8, sont consid�r�es commer�sidant en France les personnes qui ont sur le territoire m�tropolitain ou dans un d�partement d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leurs�jour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurancesmaladie et maternit�. "
Aux termes de ces dispositions, un organisme ne peut servir ou continuer � servir la prestation que si la condition de r�sider en France ausens de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale demeure remplie. Un contr�le r�gulier et permanent de cette condition est doncindispensable.
Il convient au pr�alable de pr�ciser que le d�cret n� 2007-354 du 14 mars 2007 n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause lesconditions dans lesquelles la r�sidence �tait appr�ci�e lors du d�p�t de la premi�re demande du droit aux prestations.
Il vous appartient donc de continuer � contr�ler, au moment de l'instruction d'une demande de prestations, que la personne pr�sente despi�ces justificatives qui attestent qu'elle r�side ou va r�sider de mani�re stable et effective en France.
En cons�quence, les CPAM doivent continuer � contr�ler la condition de dur�e pr�alable de r�sidence en France d'une dur�e de troismois pour le b�n�fice de la CMU et la CMU-C en application des articles L.380-1 et L.861-1 du code de la s�curit� sociale.
Les organismes relevant de la branche famille doivent continuer � s'assurer lors du d�p�t d'une premi�re demande que la personner�side en France et que cette r�sidence aura un caract�re effectif et stable notamment la condition de dur�e de r�sidence pr�alable detrois mois pour l'ouverture du droit � l'API des ressortissants communautaires.
Les organismes de la branche vieillesse doivent quant � eux continuer � contr�ler, lors de l'instruction du dossier de demande d'allocation desolidarit� aux personnes �g�es, que le demandeur r�side effectivement en France et que cette r�sidence aura un caract�re effectif et

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
stable.
La condition de r�sidence telle que d�finie � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale est applicable au contr�le du service de laprestation. Il s'agit donc de v�rifier que la personne � qui une prestation a d�j� �t� attribu�e peut toujours continuer � la percevoir d�slors qu'elle r�side de mani�re stable et effective en France.
En effet, le droit aux prestations ne peut �tre ouvert qu'aux personnes qui r�sident en France. Par exemple, il convient de rappeler que lapersonne qui adresserait par courrier une demande de prestation alors qu'elle r�side � l'�tranger ou le touriste qui vient s�journer pour uncourt s�jour en France ne peuvent pr�tendre au b�n�fice de prestations sociales dont l'objet est de subvenir aux besoins des personnesr�sidant en France.
En tout �tat de cause, les organismes de s�curit� sociale doivent informer de mani�re expresse le demandeur que le service de certainesprestations peut �tre supprim� s'il ne r�side pas en France au sens de l'article R.115-6 et que d�s lors si d�s la premi�re ann�e deversement des prestations, il est constat� que la personne ne r�pond pas aux conditions pos�es, elle peut encourir, au-del� duremboursement des prestations ind�ment vers�es, des p�nalit�s et sanctions pour fausse d�claration ou pour fraude.
2 - Les prestations dont le service est subordonn� � un contr� le de la condition de r�sidence d� finie � l'article R.115-6
La condition de r�sidence pr�vue � l'article L.111-1 du code de la s�curit� sociale concerne l'ensemble des b�n�ficiaires desprestations de s�curit� sociale mentionn�es au premier alin�a de l'article R.115-6 du m�me code, qu'il s'agisse de nationaux ou depersonnes de nationalit� �trang�re majeures.
21 - Les prestations sociales servies exclusivement sur le fondement d'une r�sidence en France telle que d� finie � l'article R.115-6
Il s'agit :
- des prestations servies en application de l'article L. 861-3 du code de la s�curit� sociale (protection compl�mentaire en mati�re de sant�,dite CMU compl�mentaire) ;- des prestations en nature et en esp�ces des assurances maladie et maternit� servies en application des articles L.161-8, et suivants ducode de la s�curit� sociale ;- des prestations familiales servies en application de l'article L. 512-1 du code de la s�curit� sociale, y compris l'API ;- de la prestation de solidarit� servie au titre de l'assurance vieillesse (allocation de solidarit� aux personnes �g�es servie en application del'article L.815-1 du code de la s�curit� sociale) ;- de la prestation de solidarit� servie au titre de l'invalidit� (allocation suppl�mentaire d'invalidit� servie en application de l'article L.815-24 ducode de la s�curit� sociale).
22 - Les prestations servies sur le fondement, selon les cas, soit de l'exercice d'une activit� professionnelle soit � une r�sidence enFrance
Les prestations en nature des assurances maladie et maternit� peuvent �tre servies :
- soit en application d'une activit� professionnelle donnant lieu � cotisation ou en raison du b�n�fice d'une pension de vieillesse ; dans cette

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
hypoth�se, la condition de r�sidence n'est pas applicable et n'a donc pas � faire l'objet d'un contr�le en application de l'article R.115-6 ;
- soit en application de l'article L.380-1 du code de la s�curit� sociale (CMU de base) ; dans cette hypoth�se, il convient de faire application dela condition de r�sidence d�finie � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale pour le contr�le du service de ces prestations.
3 - Les prestations non soumises aux dispositions de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale
Il s'agit de prestations sociales qui ne peuvent �tre servies que sur le fondement d'une activit� professionnelle ou de prestations qui rel�ventd'une condition de r�sidence d�finie par des dispositions sp�cifiques
31 - Les prestations de s�curit� sociale servies exclusivement sur le fondement d'une activit� professionnelle
Il s'agit :
- des prestations en nature et en esp�ces au titre des accidents du travail et maladie professionnelle ;
- des prestations en nature des assurances maladie et maternit� servies aux b�n�ficiaires d'une pension d'invalidit�, d'une pension devieillesse substitu�e � une pension d'invalidit� ou d'une pension de r�version ainsi qu'� leurs �ventuels ayants droit ;
- des pensions contributives d'assurance vieillesse.
32 - Les prestations sociales relevant d'une condition de r�sidence d� finie par des dispositions sp�cifiques
Les dispositions de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale ne sont pas applicables :
- aux aides personnelles au logement. Les dispositions des articles R.831-1 et D.542-1 du code de la s�curit� sociale pr�voient une conditiond'occupation du logement d'une dur�e au moins �gale � 8 mois. Les CAF doivent donc continuer � contr�ler de mani�re sp�cifique cettecondition qui diff�re de celle pr�vue � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale.
- � l'allocation aux adultes handicap�s (AAH) et au revenu minimum d'insertion (RMI) dont le service est �galement subordonn� � unecondition de r�sidence d�finie et contr�l�e en application des articles R. 821-1 du code de la s�curit� sociale et R. 262-2-1 du code del'action sociale et des familles.
- Les dispositions de l'article R.115-6 ne sont pas non plus applicables � l'Aide M�dicale d'Etat.
4 - Les personnes vis�es par la condition de r�sidence d� finie � l'article R.115-6
41 - Les personnes vis�es par le contr� le de la condition de r�sidence
La condition de r�sidence en France d�finie � l'article R. 115-6 du code de la s�curit� sociale s'applique � toute personne quib�n�ficiant de prestations mentionn�es au point 2 se pr�vaut de la qualit� d'assur� social, d'ayant droit ou d'allocataire.
S'agissant de l'ASPA, lorsque l'allocation est servie :

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
- � un seul membre du couple, en compl�ment de la pension, lui seul doit justifier de sa r�sidence en France ;- uniquement en compl�ment de la majoration pour conjoint � charge, seul le conjoint � charge devra justifier de sa r�sidence en France ;- en compl�ment de la pension et de la majoration pour conjoint � charge, les deux allocataires doivent justifier de leur r�sidence.
42 - Les personnes non vis�es par le contr� le de la condition de r�sidence
421 - Situation des ayants droit mineurs au regard du service des prestations en nature de l'assurance maladie.
La deuxi�me phrase du premier alin�a de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale pr�voit que la condition de r�sidencementionn�e au m�me article n'est pas applicable aux ayants droit mineurs de l'assur� social pour le service des prestations en nature desassurances maladie et maternit�.
Les organismes d'assurance maladie devront donc v�rifier la r�sidence habituelle et effective en France des seuls assur�s sociaux(fran�ais ou �trangers en situation r�guli�re) et de leurs �ventuels ayants droit majeurs.
Il ne sera donc demand� aucune pi�ce justificative de la r�sidence en France concernant les ayants droit mineurs � charge de l'assur�(certificat de scolarit� notamment).
422 - Condition de r�sidence applicable aux enfants pour les services des prestations familiales
Les enfants � charge restent soumis � la condition de r�sidence d�finie � l'article R. 512-1, qui pr�voit que l'enfant est consid�r�comme r�sidant en France lorsqu'il "vit de fa�on permanente en France m�tropolitaine", c'est-�-dire pendant l'ann�e enti�re. Un certainnombre d'exceptions � cette r�gle existe, afin de permettre les vacances � l'�tranger, les �changes scolaires ou linguistiques et le cas desenfants frontaliers scolaris�s dans un �tablissement �tranger.
En revanche, la condition de r�sidence pour les allocataires des prestations familiales doit �tre appr�ci�e conform�ment � l'article R.115-6.
5 - La d� finition de la condition de r�sidence mentionn�e � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale
La condition de r�sidence mentionn�e � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale peut �tre remplie selon deux modalit�sdiff�rentes :
- soit avoir son foyer permanent sur le territoire m�tropolitain ou dans un d�partement d'outremer,- soit avoir le lieu de son s�jour principal en France m�tropolitaine ou dans un DOM.
En cons�quence, si l'une des notions n'est pas constat�e, il vous appartient de v�rifier la seconde notion notamment en demandant aub�n�ficiaire d'apporter tous les �l�ments attestant qu'il remplit effectivement les conditions pos�es par cette seconde notion.
Les notions de foyer et de s�jour principal en France sont emprunt�es aux crit�res retenus par l'article 4B du code g�n�ral des imp�ts,sans pour autant y renvoyer explicitement.

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
51 - Premi� re modalit� : le constat d'un foyer permanent en France m� tropolitaine ou dans un d�partement d'Outre-mer
L'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale fait appel � la notion de foyer tel que d�fini par le droit fiscal. Cette notion de foyer auniquement pour objet d'appr�cier le respect par un assur� de la condition de r�sidence. Elle ne modifie nullement la d�finition du foyer quitend notamment � appr�cier pour certaines prestations, le nombre de b�n�ficiaires ou � calculer le niveau des ressources exig�es pourle b�n�fice de certaines prestations.
Le foyer s'entend du lieu o� les personnes habitent normalement, c'est-�-dire du lieu de leur r�sidence habituelle, � condition que cetter�sidence sur le territoire m�tropolitain ou dans un DOM ait un caract�re permanent. Le foyer est une notion objective et concr�te qui doit�tre appr�hend�e � partir d'un faisceau d'indices de toute nature �conomique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de lapr�sence permanente et continue en France.
Ce foyer doit avoir en outre, un caract�re permanent. L'exigence de la permanence de ce foyer en France permet de distinguer ceux pour qui leterritoire fran�ais constitue le lieu habituel de r�sidence de ceux qui, m�me pour des dur�es pouvant parfois �tre importantes, nes�journent que temporairement ou ponctuellement en France, ne s'installent pas durablement en France et gardent leur domicile principal �l'�tranger.
A cet �gard, doivent constituer des indices permettant la qualification d'un foyer permanent en France, la personne qui exerce une activit�professionnelle exclusivement en France, d�clare fiscalement ses revenus en France, dont les enfants fr�quentent avec assiduit� un�tablissement scolaire en France ou a un engagement reconnu et stable dans des activit�s associatives de toute nature.
Pour les ressortissants �trangers, la preuve d'une condition de r�sidence effective et stable en France pourra �tre apport�e notamment parla production d'un titre de s�jour d'une dur�e sup�rieure � un an accompagn� du passeport. Les ressortissants �trangers, d�tenteurs detitres de s�jour d'une dur�e inf�rieure � un an devront �galement apporter, par tous moyens, des �l�ments justifiant de la stabilit� deleur r�sidence en France.
La r�sidence en France demeure le foyer de l'assur� social m�me s'il est amen�, en raison des n�cessit�s de sa profession, �s�journer ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie de l'ann�e, d�s lors que, normalement, la famille continue d'y habiter etque tous ses membres s'y retrouvent.
La composition du foyer : il s'agit d'un m�nage, au sens �conomique du terme, qui peut �tre compos� d'une ou plusieurs personnes.
52 - Seconde modalit� : lieu du s� jour principal en France m� tropolitaine ou dans un d�partement d'Outre-mer
Le troisi�me alin�a de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale pr�voit que la condition de s�jour principal est �galement satisfaitelorsque les b�n�ficiaires sont effectivement pr�sents � titre principal sur le territoire m�tropolitain ou dans un d�partement d'outre mer.
La notion de s�jour principal s'analyse comme une pr�sence effective de plus de six mois soit plus de 180 jours. Pour la computation de cettedur�e de 180 jours, les organismes doivent appr�cier cette dur�e sur l'ann�e civile pr�c�dente pour les prestations servies au cours del'ann�e civile.
Toutefois, afin de ne pas supprimer le b�n�fice de la prestation pour un assur� ou allocataire qui totaliserait une pr�sence de plus 180 jours

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
sur deux ann�es calendaires, cette dur�e peut �galement s'appr�cier de date � date, sur une p�riode continue de 12 mois qui peut �trecommune � deux ann�es calendaires pour les prestations servies sur les douze derniers mois. Par exemple, l'ann�e consid�r�e peuts'�tendre du 1er mai d'une ann�e au 30 avril de l'ann�e suivante, si le droit a �t� ouvert en cours d'ann�e.
La dur�e des six mois doit �tre appr�ci�e sur la dur�e totale de r�sidence et doit �tre retenue y compris en cas d'une pr�sence "fractionn�e " en France au cours de l'ann�e civile. Par exemple, la pr�sence en France peut avoir lieu du 1er janvier de l'ann�e n au 31 marsde la m�me ann�e et ensuite du 17 septembre de la m�me ann�e au 21 d�cembre.
En cas de constat d'une dur�e de pr�sence en France l�g�rement inf�rieure au seuil de six mois, il est recommand� avant de supprimerle droit aux prestations de proc�der � un examen attentif, notamment sur les ann�es pr�c�dentes de la situation du demandeur afin des'assurer que cette dur�e traduit effectivement une absence prolong�e du territoire fran�ais et non un simple �loignement du territoire pourdes circonstances conjoncturelles.
De mani�re g�n�rale, si le contr�le de la r�sidence effective et stable en France est un objectif important, il convient d'exercer ce contr�leavec discernement en prenant syst�matiquement en compte la situation individuelle de chaque assur�.
L'ensemble des �l�ments fournis par la personne contr�l�e ou que vous aurez pu recueillir notamment dans le cadre d'�changesd'informations avec des tiers (organismes de s�curit� sociale, administration fiscale, autres organismes en application des articles L.114-19et suivants du code de la s�curit� sociale) doivent vous conduire � la conviction que, r�sidant de mani�re effective et stable en France, lapersonne peut pr�tendre au b�n�fice des prestations de s�curit� sociale.
Des �l�ments compl�mentaires sous forme de questions/r�ponses en cours d'�laboration vous seront tr�s prochainement transmis afinde vous apporter quelques pr�cisions sur les modalit�s pratiques de ce contr�le.
Pour les Ministres et par d�l�gation,
Directeur de la s�curit� socialeDominique Libault

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API