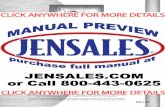TD94-23
-
Upload
george-andrei-necula -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
description
Transcript of TD94-23
-
\.
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKARtc.~*~.tc
ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINEVETERINAIRES
E.I.S.M.V.
ANNEE 1994
~W/lRipfiMfLGDslfArIDfr/.1INFEcrIEUSES MAJEURES DES POULETS DE CHAIR 1~. (MAlADIE DE GUMBORO, MALADIE DE NEWCASTLE,. ~
BRONCHITE INFECfIEUSE ET MYCOPLASMOSES) ~ J!~/~J~~J!~~!!!~N~/~N!!!~!L.
immPrsente et soutenue publiquement le 28 Juillet 1994
devant la Facult de Mdecine et de Pharmacie de Dakar
POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR VETRINAIRE(DIPLOME D'ETAT)
par
Batas1l.om M'BAUn en 1966 Pessar (TOGO)
PRESIDENT DU JURY: M. Doudou BA Professesur. la Facult deMdecine et de Pharmacie de Dakar
DIRECTEUR ET -RAPPORTEUR DE THESE: M. Justin Ayayi AKAKPO Professeur l'E.I.S.M.V. de Dakar
MEMBRES: M. Malang SEYDI Professeur l'E.I.S.M.V. de Dakar
M. Moussa Fafa CISSE Maitre de confrences agrg laFacult de Mdecine et dePharmacie de Dakar
-
\\
\\
~
ECOLE INT~ETATSDES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRESDE DAKAR
; .BP 5077 -,Tel 23 05 45 Ta':copic 25 42 83 Tacx 51 403 INTERVET SC
LISTE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
1 - PERSONNEL A PLEIN TEMPS
1. ANA TOl\tlIE HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE
RADE MBAHINTA Moniteur
Kondi
Clment
AGBA Matre de Confrence
2. CHIRURGIE REPRODUCTION
Papa El Hassane
Awana
Mamadou
3. ECONOMIE GESTION
DIOP
ALI
SEYE
Matre de Confrence
Moniteur
Moniteur
Cheikh
Hlne
LY Matre-assistant
FOUCHER Assistante
4. HYGIENE ET INDUSTRIE DES DENREES ALIMENTAIRES
D'ORIGINE ANIMALE(HIDAOA)
Malang
Penda (Mlle)Adama Abdoulaye
SEYDl
SYLLA
THIAM
Protesseur
Moniteur
Docteur Vtrinaire
-
\\
\\
,'.:.;.;.;.;. :';'." ...... :.:.:.;.:.;.;.;.;.;.;.; ;::::::::;:;:::::::: .;.::;:;:;:::::;:;:.', ./.;.:.::..;:;:;:;:;::.::::;:::::::.:;:;:;::=:=:::>: :;:;:;:::;::.::;:::::::::;:::;::::;:;:;:;:;:;:;:;::::: ;.;.:.; ;.;.;.:::W:::::::@:::::::$QPT~J:::::::::;::'::::::t;::::~:: :::::::~:::tQ'Ai\i:::::::(: SEDIMA}(: :"SENTENAC/":.:SETUNAi?: '::::::AmrREi:::::::::::::::~Production 1992 (en kg) 3011 16032 6090 719 17350Pourcent jtotal estim 7 % 37% 14% 2% 40%
Source: Direction de l'levage, Dakar [60]
Ces socits fournissent 60 % du march estim. Le reste est fabriqu parde petites socits ou des leveurs indpendants et la SENDIS dont laproduction en 1992 n'est pas connue.
b. Approvisionnement en poussins d'un jour
Les poussins d'un jour mis la disposition des leveurs proviennent lafois de la production locale et des importations. Le nombre de poussins mis enplace varie au cours d'une mme anne mais aussi d'une anne l'autre.
-
~ Evolution de la production locale et des importations despoussins d'un jour selon les socits depuis trois ans (1991, 1992,1993)
Cette volution est rsume dans les tableaux II. III. IV des pages 23.24.25
Tableau D : Production locale et importations des poussins d'un jour en 1991.
.. ;~:;:t\ ..;:;:::>::: ;>:::;:ff:{:}:; :;:; :::: :::::::::::\/fiij~~jjt/::::::::::::::::::::::::::: ::;';';':"::;:: }~; ~:;:: ::;:::::::;:;:;:::;:: :::::rf~t :::::=;:; ::- ::::::;:;:;:;::;::::; :::::;:;:::. ::::=r::;:;:;::::: ::::::;::;. :.:.:.:.:.:.::;:;::::::.':::::::I::i:::::::::::::::i::,:j:j:j::,:,i;:;::.:{otisNs'C~::::::: :::::,:}:::::.:..::.i::::::}::~ti$fiil~8~~::"i::::.'.:::::::::::::::::.:.:
\\
\\
i ."
Socits Production Importations TOTAL Production ~mportations TOTAL
locale locale
SEDIMA
CAM
CAMAF
SENDIS
SOSODEL
ALlZEL
TOTAL
POURCEN-
0 1221.360 1221360 0 151890 151890
891 102 40500 931602 166 505 5100 171605
781615 147600 929215 0 124540 124540
0 361896 361896 0 67377 67377
0 64000 64000 0 250 250
0 0 0 0 27600 27600
1672 717 1835356 3508073 166 505 376665 543 262
TAGE (%) 48 % 52% 100 % 31 % 69 % 100%
Source: Direction de l'levage (Centre National d'Aviculture de MEAO) [61].
L'analyse de ce tableau montre qu'en 1991, la production locale despoussins d'un jour tait infrieure aux importations. Ceci peut s'expliquer parplusieurs raisons :
- les deux couvoirs prsents taient de cration rcente (couvoir ducomplexe Avicole de MEAO cre vers fin 1989 [2J et celui de Sangalkamcre en 1990) et leurs productions sont encore en phase de croissance :
-
\~- les faibles importations du complexe AvicQ!e de MBAO (CAM) s'inscrivent
dans leur programme de diminuer les ,.i~rtations au profit de laproduction locale.
Tableau DI : Production locale et importations des poussins d'un jour en 1992
:::\tt~~.. ?:;;;:;:;::; :::?(~:~ ::;:.:: :::;: ::}!:::::~:f::.:::::;;;:;:::::; :::::::~)~~r '::::::;::::::~fIift~f}:::::::::::"'" ;.:.;.:.:.;.;.;.:.;.;.;.;.;. :::.;::.:::~:;::::::::::::{:::~ :;fr}:::;::;::::;~;: ....:::::::::::::::::::::: :;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :-;:;.::::::::::::::::::,.:::::::::::;:::::;:::,,'~ussiNsHAilt;;:::::::::::::;:'::::::::::::::,:::':::::I:'.:.I!:1::.j":.:'::::':';:::::::mS~mS':'*P~f~!:I'::.:"!:::':::';":.:'::::::j.::Socits Production Importations TOTAL Production mportations TOTAL
SEDIMA
CAM
CAMAF
SENDIS
SOSEDEL
TOTAL
POURCEN-
locale
875146
1 095721
874241
o
o
2845108
locale
432 656 1 307 802 0
o 1095721 368 749
273200 1 147441 0
395981 395981 0
63 000 63 000 0
1 164 837 4009945 368 749
129417
o
89450
73458
1500
293 825
129417
368 749
89450
73458
1 50)
662574
TAGE (%) 71 % 29% 100% 55.66% 44.34% 100%
Source: Direction de l'levage (Centre National d'Aviculture de MBAO) [6).]
Le tableau III montre :
une augmentation de la production totale des poussins (importations +production locale) d'environ 12.5 % par rapport 1991 :une part croissante de la production locale (poussins ns au Sngal)qui. pour la premire fois est devenue majoritaire (71 % pour lespoussins de chair et 55.66 % pour les poussins destins la ponte).
Cela peut s'expliquer par la cration du couvoir de SEDIMA en Fvrier1992. mais aussi par l'augmentation des productions locales des couvoirs duComplexe Avicole de MBAO et de Sangalkam (CAMAF).
-
,, ,,
Tableau IV: Production locale et importations des poussins d'un Jour en 1993.
Socits Production Importations TOTAL Production mportations TOTAL
locale locale
SEDIMA 1269004 125235 1394239 0 58190 58190
CAM 1211697 12000 1223 697 309002 0 309002
CAMAF 655296 95300 750926 0 32600 32600
SENDIS 0 262470 262470 0 69040 69040
SOSEDEL 0 18000 18000 0 2000 2 (X)()
TOTAL 3136327 513005 3649332 309002 161830 470832
POURCEN-
TAGE (%) 86% 14% 100% 66% 34% 100%Source: Direction de l'levage (Centre National d'Aviculture de MEAO) [611.
La production locale des poussins de chair connat une augmentation de16 % par rapport l'anne 1992 alors que la production totale a enregistr unebaisse d'environ 500 000 sujets (Tableau IV). Ceci peut s'expliquer par diversesraisons :
beaucoup d'aviculteurs profanes ont d abandonner;les grves des aroports survenus en France en Octobre et Novembre1993 ont beaucoup Jou sur la mise en place pour les ftes de fin d'anne: 813 878 poussins en 1992 contre 688 085 en 1993 [611 ;la mvente des poussins et des poulets aprs le tamkharit a entrandurant les mois d'Aot et Septembre une diminution des incubations.Ainsi. l'hivernage aidant. les mises en place ont connu un ralentissement.
Les mises en place des poussins ponte ont connu galement une baisse parrapport l'anne 1992.
~ variations mensuelles de la production locale et des importations despoussins d'un jour en 1993
Elle est rsume dans le tableau V, P. 26 et la figure N 1, P. 27
-
Tableau V : Variations mensuelles de la production locale el des importations des poussins d'un jour en 1993.
~
E-JI
,j /1'- ,/ JAtMm FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUUET Aa.rT SEPTEM rFl: f'DIEM. M- TOTAUX
/ BRE BRE BFI:
CHAIR 390748 426036 322504 307434 359620 209074 222845 216683 194421 306784 393299 299984 3649332
Pa\ITE 24165 48253 41181 45533 33974 39121 44807 23920 60382 13005 46025 50466 470832
/."/
//./
/-
Source: Direclion de l'levage (Cenlre Nalional d'Avicullure de MBAO) (61 ]
-
\.
\\
\\
\
l '"
\.
450000 lUl 400000.~ 350000 1/::::l 300000oc. 2500004)
: 200000 t. 150000 t
~ 1~~~~~ 1 ..o ! . . 1 1 '. 1 1
a: a: en ::! - z ~ ~ e.-: .w w a: a: - w ~ ~ ~ > u> ~ > ~ ~ ~ 0 ~ u 0 w~ ~ ~ '5 ~ 0 z 0, ~ ,
--- Chair
Ponte
Figure N 1 Variations mensuelles de la production locale depoussins d'un jour et des importations en 1993
-
\\
On note:
une production de poussins de chair prsentant des ma?ma un mois un mois et demi avant les principales ftes (ftes de fin id~anne. Korit)
\,.
ce qui est connu :
une chute remarquable de production de poussins destins la pontependant le mois d'Octobre. due la grve des aroports.
Ces chiffres fournis par les principales socits peuvent tre revus enhausse du fait des importations faites par des leveurs indpendants.
On constate donc une mise en place importance des poussins d'un jour.cependant leur rentabilit dpend essentiellement de la conduite des levages.
U.2.2.3. Conduite des levages modernes
Elle ne montre pas de grandes variations suivant les exploitations. lesmises en place passent toujours par un stade de poussinire.
L'alimentation et l'abreuvement sont en gnral bien assurs sauf quelqueslevages o l'eau en provenance des puits est parfois malsaine et l'alimentationinsuffisante. ce qui n'est pas sans incidence sur l'tat sanitaire des oiseaux quisont cibles de nombreuses maladies avec souvent un retard de croissance trsmarqu.
Les problmes environnementaux sont dans la plupart des cas bienmatriss par l'utilisation des rideaux. en sac de rcupration permettant demoduler l'aration ou l'ensoleillement.
L'application relle des mesures de prophylaxie par les tacherons constitueun srieux problme. les recommandations visant viter tout contact entresujets de lots diffrents ne sont pas toujours respectes. De plus. lors desvaccinations. les rgles qui guident celles-ci ne sont pas appliques dans leurtotalit d'o des cas d'chec de vaccinations.
-
\\
On assiste de plus e~Jlus une rduction de la dure d'levage despoulets de chair. (en moyenh~S jours) : alors que les pondeuses sont engnral conserves en production jusqu' 18 mois d'ge. A leur rfonne. elles
,
sont vendues pour leur chair.
Avant l'installation de toute nouvelle bande une priode de vide sanitaireest observe aprs nettoyage et dsinfection des locaux l'aide du fonnolhabituellement.
Les problmes pathologiques sont rencontrs le plus souvent dansquelques levages insuffisamment quips en matriel d'levage et o les rglesde conduite sont trs peu respectes. D'o la ncessit du renforcement desactivits des structures de formation et d'encadrement pour une plus grandesensibilisation des aviculteurs.
U.2.2.4. Structures d'encadrement et de recherche
Panni elles. on peut citer:
-:r Le Centre National d~iculture(CNA)
Cre vers les annes 60. le Centre National d'Aviculture de M'bao a pourvocation la formation et le suivi-encadrement des exploitations avicoles: le voletproduction tant privatis.
Le CNA en assurant la formation des leveurs individuels. participe lacration des groupements fminins dont le rle est de grer des bandes de 200 SOO poulets de chair par groupement [2].
-:r Le Laboratoire National de l'Elevage et de Recherches Vtrinaires(L.N.E.R. VJ
De part son anciennet et sa capacit de production. le L.N.E.RV se trouveaujourd'hui parmi les tablissements de Recherches Vtrinaires etZootechniques les plus importants d'Afrique.
-
Dans le domaine de protection du Cheptel aviaire. le laboratoire produitdes vaccins non seulement pour le Sngal, mais aussi pour bon nombre de paysd'Afrique Occidentale.
n.2.2.5. Productions de viande de volaille
3 649 332 poussins de chair ont t mis en place en 1993 : si le tauxmoyen de mortalit est estim 7 % jusqu' la finition on aura donc : 3 393 878poulets abattus.
Le poids moyen l'abattage tant estim 1.2 kg. la production totale deviande de poulets de chair du secteur moderne est de
4 072654.5 kgsoit 4072.7 tonnes.
Il faut signaler galement qu'en 1993. les importations de viande devolailles se sont leves 607 234 tonnes [60] :
Nous pouvons donc dire qu'il existe deux types d'aviculture:
l'aviculture traditionnelle. pratique essentiellement en milieu rural :et l'aviculture moderne concentre en milieu priurbain. Elle constitue90 % des activits avicoles de la rgion de Dakar.
Contrairement l'aviculture traditionnelle o la volaille met beaucoup detemps pour parvenir au stade de consommation. les poulets de chair du secteurmoderne ont un cycle court, environ 45 Jours et les possibilits d'entretenirplusieurs bandes font que les productions de ce secteur sont rgulirementimportantes d'o la ncessit de trouver dbouchs pour l'coulement desproduits avicoles.
-
\\\
D.3. COMMERCIALISATION ET CIRCUITS COMMERCIAUX
La commercialisation est un lment important en production avicole. E~esuppose une organisation du march avec possibilit pour les aviculteurs d~
'-
pouvoirs planifier leurs productions et ensuite de trouver des dbouchs srs quipermettront un coulement rgulier de leurs produits.
Les structures de commercialisation sont diffrentes selon qu'on est enlevage traditionnel ou moderne.
Dans le secteur traditionnel. on rencontre des individus vendant lespoulets des prix qui se discutent.
Au niveau de la ferme. c'est l'leveur lui-mme qui cherche ses dbouchset les prix sont fixs d'avance: ce circuit comme on peut le deviner. est un
i
circuit court. Toutefois. il peut. rappelons le. passer entre les mains desintermdiaires.
Ce circuit peut se schmatiser ainsi
Producteurs des fermes priurbaines
IntermdIaires possIbles__co_ns_o_mm__a_te_u_r_s__I.......---L..----------....J
Ainsi, si les intermdiaires rgnent en matres absolus au niveau du circuittraditionnel, fait remarquer DIOP [26]. au niveau du circuit moderne. ils seheurtent la volont des aviculteurs de prendre eux-mmes toutes les oprationscommerciales. Mais cette situation peut tre prcaire quand on sait que lasituation dans les marchs peut faire reculer les producteurs devant lesengagements qu'ils ont pris de vendre eux-mmes leurs produits.
-
\\
\\
D.4.IMPORTANCE DE L'AVICULTURE
L'aviculture joue un rle socio-conomique et reprsente une source de; ,protines animales rapidement disponibles. "
D.4.1. Importance socio-conomique
La volaille procure des revenus aussi bien l'leveur qu' l'Etat.
Dans la rgion de Dakar. bien que l'levage traditionnel soit faible moins de10 %. ce secteur reste tout de mme le plus important l'chelle nationalesurtout en milieu rural o la vente des produits d'levage procure des revenusmontaires non ngligeables aux leveurs. ce qui leur permet de faire face certaines dpenses familiales. La volaille reprsente souvent un revenu de contre-saison par "rapport aux rcoltes.
L'importance du march de consommation. l'installation quasi totale desunits de fabrique d'aliments font de la rgion de Dakar un grand centred'aviculture moderne dont les effectifs ne cessent de crotre. Les aviculteursmodernes cherchent rentabiliser au maximum leurs levages qui constituentparfois leur principale source de revenus. lorsque ces levages ont t bienconduits. De plus. partir des taxes qu'ils versent l'Etat. l'levage modernedevient de plus en plus une importante source de revenus. Il faut signalercependant que la consommation de la viande de volailles est faible dans la famillesngalaise. cette viande rentrant trs peu dans les habitudes culinaires [26].
D.4.2. Importance nutritionnelle
Parrr les produits d'origine animale qui rpondent mieux la satisfactiondes besoins protiniques de l'homme. la volaille et les ufs viennent au premierrang. La viande de volaille est trs riche en protines soit 25.2 % contre 18 % deprotines pour la viande de bufs: son cficient d'utilisation digestive (C.U.Dlest de plus trs lev. 90 95 % alors qu'il n'est que de 70 % pour la viande debuf.
Comme on le voit. les volailles jouent un rle trs important.malheureusement leur levage est confront de nombreuses contraintes.
-
\\\
----
Les contraintes sont de nature techniques et conomiques. sanitaires et'-
pathologiques.
IU.I .. CONTRAINTES TECHNIQUES ET CONOMIQUES
Elle prennent aujourd'hui de plus en plus d'importance. eu gard au tauxde croissance des effectifs surtout dans le secteur moderne.
m.l.l. Problmes alimentaires
Dans le domaine d'alimentation. il existe une srieuse concurrencehomme-animal dans la mesure o les volailles sont de grand7s consommatricesdes produits craliers. lesquels constituent galement la base de l'alimentationhumaine. C'est dire entre autres. que la jeune industrie de l'aliment de volailleest confronte en permanence un problme d'approvisionnement en crales.En effet une proportion importante des matires premires entrant dans lafabrication de l'aliment de volaille est importe notamment les crales (mais.sorgho).
Aussi ne peut-il pas y avoir d'aviculture intense sans agriculture intensepermettant de briser l'conomie de subsistance. Ceci permettrait certainementau paysan sngalais de mieux s'occuper de l'alimentation de sa volaille et fournirsuffisamment de crales l'industrie d'aliment de volaille. laquelle est baseexclusivement Dakar.
m.1.2. Contraintes Ues l'approvisionnement en poussins d'un jour
Si le problme ne se pose pas avec beaucoup d'acuit dans le secteurtraditionnel o chaque structure possde ses reproducteurs. la production depoussins d'un jour ou leur importation constituent une contrainte majeure pourl'aviculture moderne.
-
\\
\\
(
Dans la production de poussins d'un jour, le choix des reprodhyteurs estun lment important considrer. Ce choix doit porter sur des reprOducteurssains issus des levages indemnes de maladies rputes lgalement contagieuses
1et sous contrle d'un vtrinaire agre. De plus ces reproducteurs doivent avoirdes performances garanties et tre assez rustiques pour pouvoir s'adapter auclimat tropical et convaincre les leveurs. L'entretien rgulier des incubateurs etle choix des- ufs permettraient galement d'viter les maladies transmissibles(salmonelloses) et d'avoir des poussins vigoureux et viables.
Il se pose galement un problme en cas d'importations de poussins d'unjour, qui parait peut tre le plus important car certains exportateurs expdientdes invendus donnant des lots htrognes. Par ailleurs, il est plus coteux etrisqu de faire voyager des poussins que des ufs [2]. C'est peut tre ce problmequi justifie la baisse des importations de poussins d'un jour au profit de laproduction locale qui heureusement est devenue majoritaire depuis 1992.
m.1.3. Problmes de commercialisation
Ce sont des problmes d'coulement des produits avicoles ds, d'une part une production non organise. l'absence d'abattoirs de volailles et d'autre part la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Il faut noter galementd'autres problmes comme la concurrence des autres protines animales quisont souvent moins chres que la viande de volailles. Cette situation s'estaggrave aprs la dvaluation du Franc CFA. qui a entran une hausse gnralisedes prix dont le prix du poulet de chair sur pieds qui est pass de 1000 F avantla dvaluation 1400 F suite l'augmentation des prix des intrants avicoles.
m.l.4. Problmes de suivis sanitaires et contraintes nes la vaccination
L'absence de suivi sanitaire rgulier est en fait due une insufTisance depersonnel qualifi et de techniciens d'levage. La plupart des levages modernessont aux mains des personnes qui ignorent encore l'intrt du respect desmesures sanitaires et des normes d'levage. Ce problme est en voie dersolution avec le programme de formation en gestion technique et financiredes leveurs mis en place par le Centre National d'Aviculture [27] et le projet decration du PRODEC (Projet de Dveloppement des Espces Cycle Court) dontles principaux volets sont:
-
- formation - encadrement :- assistance technique pour l'aviculture.
\\
\\
~~
,L'--::--
\.
L'aviculture traditionnelle est laisse pour compte et les quelqJ~soprations d'amlioration n'ont pas eu de suivi ncessaire.
Dans la lutte contre les principales maladies. il faudrait signaler que deschecs de vaccination ont t observs. Ces checs sont certainement lis auxdifficults de conservation et au non respect des normes d'utilisation des vaccins.Ceci n'est pas sans incidence sur l'tat sanitaire des oiseaux exposs denombreuses maladies.
m.2. Contraintes sanitaires et pathologiques
Elles sopt reprsentes par les facteurs de risque dans les poulaillers et lesprincipales maladies qui menacent l'aviculture moderne.
m.2.1. Facteurs de risque dans les poulaillers
Ils sont trs nombreux et peuvent agir individuellement ou en synergie.
a. Facteurs physiques
Ces facteurs sont directement lis aux conditions climatiques et peuventavoir un impact sur l'tat de sant et les performances des volailles. Parmi cesfacteurs on peut citer:
~ La temprature
C'est un facteur de stress aussi bien chez le poussin que chez le pouletadulte [46]. L'oiseau en ragissant l'agression thermique. s'puise et s'exposedavantage aux maladies. Par ailleurs des expriences menes aux USA [22] ontmontr que la gravit de certaines maladies est augmente en prsence d'unetemprature leve.
-
"'Cl' L'humidit
Elle permet un dveloppement optimum des agents infectieux et il a tdmontr que des poulets soumis un environnement forte humidit sont plusreceptifs la maladie de Newcastle [12]. Elle favorise galement ledveloppement de nombreux parasites et champignons.
'Cl' La ventilation
Son rle est bien connu en aviculture. car elle permet le renouvellementde l'air du poulailler. C'est d'ailleurs l'lment important qui est recherch dansl'orientation et la conception des btiments. Tout en vitant les grands vents. lespoussires (sources d'agents pathognes). la construction d'un btiment doitpermettre une bonne ventilation qui va assurer un renouvellement continu del'air. C'est pourquoi il est conseill en priode,. chaude d'installer des ventilateursdans les poulaillers. Une bonne ventilation permet de minimiser les effets de latemprature et de l'humidit [33].
b. Facteurs chimiques
Qu'ils soient d'origine exognes (gaz des usines ou des vhicules) ouendogne (gaz provenant des animaux eux-mmes ou rsultant des conditions dupoulailler). les polluants chimiques peuvent avoir un effet toxique ou corrosifchez les oiseaux. Ils favorisent avec les facteurs physiques l'apparition etl'volution de nombreuses maladies.
m.2.2. Principales maladies frappant l'levage des volallles
Le diagnostic clinique des maladies aviaires devient de plus en plusdifficile car l'on assiste de plus en plus l'apparition de complexes pathologiquesplutt qu' des entits bien dfinies. Les mortalits et les pertes de poidsprovoques par ces maladies augmentent alors que le nombre de sujets prsentspour le diagnostic est faible [68]. Pour cette raison. l'optimisme sur l'tatsanitaire doit tre mesur mme si ces dernires annes. la liste des maladiesinfectieuses hautement contagieuses diagnostiques au L.N.E.R.V n'est pas longue.
-
a. Maladies Infectieuses
\\
\\
~~
'~L'Cc maladies bactriennes et mycoplasmique :
- Cholra aviaire {Pasteurella multoiddJ :- Colibacillose (Eschrichia Coli et autres Coli Bacilles) :- Salmonelloses aviaires (Salmonella pullorum gallinarum) :
mycoplasmoses (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae etautres mycoplasmes).
'Cc maladie virales
- maladie de Gumbora (Bimavirus) :- maladie de Newcastle ou Pseudopeste aviaire (paramyxovirus):- variole aviaire (Poxvirus) :- Leucoses aviaires (Avian Leucosis Virus ALV) :- Bronchites infectieuse (Coronavirus).
b. MaladIes parasitaires
Cccidiose aviaire (Emeria tenella. E. necactric, E. maxima.E. brunetti, E. praecox, E. mitris. E. mivati) :
- Ascaridiose (Ascaridia. Capillaria. Heterakis) :- Tn1asis (RaiUetina. Hymenolopis. choantnaia) :
c. Maladies nutritionnelles
- Carences associes :- Avitaminose A ;- Avitaminose B :- Avitominose K :- Avitaminose E.
-
\\
d. Autres maladies
- Cannibalisme:- Emphysme sous-cutan :- Goutte aviaire:- Stress:- Pica:
Picage.
Bien que les maladies parasitaires soient les plus frquentes. sans aucundoute cause du manque d'hygine et de la mauvaise alimentation [38]. il fautremarquer que les maladies infectieuses (bactriennes et virales) sont les plusredoutables. puisque leurs pronostics mdical et conomique sont des pluscatastrophiques.
Dans ce contexte. l'enqute srologique de ces principales entitsredoutables apparat comme le dernier recours pour connatre les dominantespathologiques. leur importance et le niveau d'efficacit des plans de prophylaxieafin d'envisager des actions. mener pour une lutte plus rentable; c'est ce quifera l'objet de notre deuxime partie.
-
\\
\\
1..
L'-'-
lOJJETflKUlEWlJE lPllJB.1fUJE ~N@U~ ~~@~@~g@U ~U~
ILJE~ IlJFJFJE(C~g({J)1N~MgC~({J)g1N1N~ MllgJEU~~JJJ)~ JP(fJ)UILJE~~ l/l)JE ClBlllg~ JEN
JEILJEVIl~JE M (f}) JJJ)JEl&1NJE
-
\\\
oZ
-
(.)'Q)Cl
-
-
c:::co,
,1-
>'Q)I.L.
';::>
o Pools de srums positifs
Pools de srums prob.infects
Figure N 5. Variations mensuelles des pools de srums d'oiseaux: positifset trs probablement infects
L'infection semble augmenter de Mai Dcembre avec une chute enFVTier puis croit nouveau Jusqu'en AVTii. Cependant que l'activit du virussauvage est perceptible en Dcembre. Janvier. Fvrier. Avril et Mal.
-
\\
\\
D.2.2.4. Rsultats en fonction de l'tat de sant (.l..
Tableau xm : Rsultats des pools de srums positifs ~nction de l'tat desant. i
: (Etfdffi :} '\:Nbr}:(le .:.. ~~fl.:::;::~~r!9~:.P9n~:9!::% .:: '}(Po'fhtg:} (%l',:}}ii.lifPJI:!~~~II_fli.'fJ_~Lots 52 1-4 22 27 42,30,1351,920,13clinique-ment sains
5-6 5 9,620,09Lotsmalades
48 1 - 4 29 34 60,420,14 70,83013
5-6 5 10,41 0,09
Le lot des malades semble plus infect que le lot non malade (Tableau XIII)
Tableau XIV : Rsultats compars des deux: tests en fonction de l'tat de sant
2,14SI
17 32,70,13
:ii:ilili~.f'ili.I!II:!~ioiO~Si:.!tll~:.f;.~s;:.i.i.f. i.I.I.:i.p.i.l.!.i:,-.).,.i.!.i,.rl.:,.:i.i:Cei.!:!.r:..!.i...i.j:r.:.,..i.i.i..).i.f.i.i.i.~.ij.I..i.I.I.!. 1'111.1..1.1
:;::::::;:;:::::::::::;::::::::::::::::::::::;;.;.:;
Lots 52cliniquement sainsLots 48cliniquement sains
34 70,830,13 21 43,750,14 2,075\
D'une faon gnrale. l'ELISA dtecte un nombre de srumssignificativement suprieur celui dcel par l'IHA comme le montre letableau XIV.
-
\,
\\
D.2.2.S. Rsultats en fonction de l'ge
Tableau XV: taux de positivit en fonction de l'ge; ,
"
1-3 8 1-4 3 35 - 6
4-6 45 1-4 21 245 - 6 3
Plus de 7 4 7 1 - 4 2 7 3 45 - 6 7
37,5O,4
46,67O,56,66O,0757,44O,1414,9O,1
53,33O,15
72,34O 13
Sur -le tableau XV l'infection semble augmenter avec l'ge.
Tableau XVI : Rsultats compars des deux tests en fonction de l'ge
1 - 3 8 3 37,5O,4 1,9SI
46 45 24 53,33O,15 1 1 24,44O,13 2,8SI
Plus de 7 47 34 72,34O,13 27 57,45O,14 1 ,5NSI
Il existe une diffrence significative entre les rsultats de L'ELISA et del'IHA en faveur de l'ELISA dans la tranche d'ge de 4 6 semaines (Tableau XVI).
-
U.2.3. Bronchite Infectieuse
U.2.3.1. Rsultats d'ensemble
Tableau XVU : Rsultats d'ensemble en ELISA et en lHA
\::::::::::::::j::'uI::::::{::it: ::::i::::::Nbi~:::d:::J6S:q::::i::::i.:.:i::int~:i:4~: .:.:'.:.:.:.:i.i.p:..::'...:':.:.:o.:...:.:.,.:.,..:o,.,.:'.,.:..::.,I.:.:..$:.,.:.:.:i.:i.:::.:.i::..::.:::.:.:::i.::.:..:::.::,.:.:.,.R!.;l-h.:::~.:::.:!.::.::::::.::i:.i.i:::.:..::.::.:::.:::.::.:{:.:':..:..,....:::i.:::..:i::.:i...:.:s.::::..:l.:.;o.:/1:.:::0..,@.~m::I~:e::::::!,!" ..::..:.!.:..:!.::::.:!.::.:.. :.::.:a::::.::.\:::,.:.::.ill:.iilll:,,:.:'..'..,:t.::=.:e\s\tiie:::::::s:::::::: :':::}}.':::':::'::":'::::::::':}}::::}}:.:'::',...::".... :.:.::: ........" .. :" ....:........:.. :'.. ,: c : :.. '~I : :. }~CAUUA~ ..:d.sririsjj6sitifs:::::!:!:::::!:::.:.:::.::.:::.:C%J :..:.:..:.::"!:::::;::.::.:;::.::!.:::;:.:.:,';..::::.:.::
ELISA
IHA
100
78
51
20
51 .. 0,1
25,6'' 0,1
Tous les pools de srums n'ont / pas pu tre traits en lHA du fait del'puisement des ractifs.
Ainsi, 78 des 100 pools de srums tests en ELISA ont t traits en lHA..51 se son rvls positifs soit 51 % en ELISA contre 20 positifs soit 25.6 % enlHA .
-
\\
\\
\
,.
~U.2.3.2. Rsultats en fonction des zon~ ,""LL
70 T1
160 .L1
50 +40
?fi30
20
KM MLK SGK OKR MS-RFZones
1
~ Elevages positifs (%)1
Figure N6 Pourcentage des srums positifs par zone
L'infection semble tre prsente dans toutes les zones avec un tauxrelativement faible SGK.
-
\\
\\.
. (U.2.3.3. Rsultts en fonction de la saison
-L .Li
-c::lo
c::::l-,
1CoQlen
-(Jo>oZ
(J'(1)o
>c::cu-,
>'(1)lJ..
TI Elevages positifs (%)
Figure N"7. Variations menseulles du taux d'infection
L'infection semble diminuer d'Avril Juillet puis augmente Jusqu'enDcembre avec un flchissement en Fvrier..
ID
-
U.2.3.4. Rsultats selon l'tat de sant
Tableau XVUI : Taux: de positivit en fonction de l'tat de sant
Lots clinique-ment sainsLots malades
52
48
23
28
44.23O.13
58.33O.14
1,4
NSI
Le taux: d'infection parat plus lev dans le lot des malades
Tableau XIX : Comparaison des rsultats des deux: textes en fonction de l'tat desant
lotscliniquementsainsLotsmalades
J121}Hr..',:,,',:,i,.,:,i.',i,.:::)~:r~t~\~~~! ::::::::"
52
48 28
1,98SI
Le nombre de srums positifs dcel en ELISA est significativement plusimportant que celui dtect en lHA.
-
\\\
> CIl '~ta
'3 lD ':J lD U 0 '(1) c: '(1) ~:2 0 en 0 Z Cl ta U. ta >.,:J ., :2 .,
.1 0 % Elev. positifs M,1 gallisepticum
1
Figure N09. Variations menseulles du taux d'infection aux deux esp~cesde mycoplasmes
Pour les deux espces de Mycoplasmes l'infection est perceptible du moisd'Octobre au mois de Fvrier avec un pic en Janvier. Le taux d'infection paraitabsent en Mars pour raparaitre en Avril.
-
\\
\\
U.2.4.4. Rsultats selon l'tat de sant
-
IU.l. MATERIEL ANIMAL, ZONE D'INVESTIGATION.
Le poulet de chair du secteur moderne a t choisi pour deux raisons :
- les pertes conomiques provoques par les maladies envisages sont trsimportantes chez les oiseaux. objet de la spculation chair.
La maladie de Gumboro. la Pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle), laBronchite Infectieuse et la Mycoplasmose sont responsables des mortalits. desretards de croissance comme l'ont montr de nombreux travaux [4).]. [47]. [49].[53].
La prsence des lots homognes (~me ge. mme race) facilite lesinvestigations et les prlvements. Ainsi nous avons relev l'ge de toutes lesbandes au moment des prvlements.
La rgion de Dakar a t choisie du fait de la proportion considrable deslevages de poulets de chair (plus de 90 % du secteur moderne du pays. Lesinvestigations ont t faites dans les trois dpartements de la rgion de Dakarselon nos possibilits.
Les secteurs de KM et MLK, dans le dpartement de Pikine. sont deszones de forte concentration de fermes avicoles qui sont le plus souvent prochesles unes des autres. De ce fait. ces zones ont t les plus concernes par nosrecherches. Dans la zone de SGK, l'loignement des levages les uns par rapportaux autres a limit nos investigations.
Sur le terrain. le manque de spcificit des signes cliniques. la prsencedes infections mixtes [18]. [44] et des formes inapparentes [51. [70] montrel'intrt du diagnostic srologique.
-
\\
\\
im.2. METH~DESSEROLOGIQUES
,LEn ce qui concerne l'chantillonnage. nous avions voulu effectu au moins
5 prlvements :par bande homogne comme l'a indiqu BENNEJEAN [8]. Maisdevant la rticene des leveurs autoriser des prises de sang. ce nombre deprlvements par lot n'a pu tre atteint. Les rsultats des prlvementsprsents dans le tableau VI. P. 47 traduisent en fait les ralits contraignantesdu terrain. Malgr le faible chantillonnage les rsultats srologiques que nousavons obtenus concordent avec ceux des travaux d'autres auteurs [10). [251. [41).
Il convient de signaler que dans la plupart des fermes visites. la taille deseffectifs variait entre 200 500 sujets par bande homogne. Les srumsindividuels ont t mlangs parties gales pour constituer des pools desrums. Un des principaux problmes avec le mlange des srums est que lesrsultats des tests peuvent tre positifs (l'anticorps est dtect) mme si 50 %des srums individuels dans le mlange sont ngatifs [31). Le test des srumsindividuels donnerait donc une information plus prcise sur la prvalence enanticorps dans le cheptel. Mais cela aurait ncessit beaucoup de matrtel quenous n'aurions pu nous procurer.
Notre objectif tant une enqute sro-pidmiologique partir d'undiagnostic de groupe. l'analyse des pools de srums nous a donc semble lasolution la plus approprie condition que le mlange des srums individuelsd'un lot homogne soit fait proportions gales [8).
Donc si notre mthode de travail reste sujette des critiques. nous avonsessay de l'adapter au maximum aux ralits du terrain. Le sondage srologique at mis en oeuvre dans le but de mettre en vidence des traces d'anticorpstmoins d'une infection par un germe sauvage ou par une vaccination.
Notre objectif tait de faire deux tests (ELISA et IHA ou prcipitation enmilieu glos) par maladie: mais compte-tenu de l'absence de certains ractifs.nous nous sommes limits aux techniques d'ELISA (KIT "IMMUNOCOMBTM"), etl'Inhibition de l'Hmagglutination (pour la maladie de Newcastle et la BronchiteInfectieuse) .
-
\\
\\
~L'ELISA est une technique couramment utilise en pathologie avi~ire pour
la dtection des anticorps spcifiques [64J. Nous l'avons utilis pour to~ lesmaladies cause de ces multiples avantages: large utilisation. prcocit. grandesensibilit [66]. C'est une technique simple. rapide. fiable. automatisable [51)'.
Le Kit ELISA (ELISA en phase solide. en plus des mmes avantages. estplus pratique que l'ELISA couramment utilis au laboratoire. RIVETZ et Coll.[52J ont dvelopp le Kit ELISA (Immuno-peigne). trs pratique pour l'emploisur le terrain sans besoin d'quipement spcial. Ils ont montr unecorrespondance entre les rsultats du test Immuno-peigne (KIT ELISA). laneutralisation du virus et les rsultats du test d'IHA
Plus tard. ces observations ont t confirmes par TIIAYER et Coll. [67J en1987. Les "COMBSCORE" (KIT ELISA) sont proportionnels aux titres de l'ELISAcouramment utilis au laboratoire. ces deux ractions tant plus sensibles quel'IHA.
Ces observations montrent que le Kit ELISA. mme si notre choix a tguid par son ct pratique. possde les mmes caractristiques que latechnique courante d'ELISA. Ce test possde cependant un inconvnient li safaible spcificit par rapport la technique d'IHA.
L'IHA est une raction de choix pour les virus hmagglutinants commel'ont montr HIRST EN 1914. 1942 et BEACH en 1943 cits par LESBOUYRIES[40J. C'est une technique rapide. sensible mais surtout. elle est caractrise parsa grande spcifit [36J. [66J. Son inconvnient est qu'elle est limite aux virushmaglutinants. Elle ncessite par ailleurs un traitement des srums pourliminer les inhibiteurs non spcifiques. Du fait de ces limites. la raction d'IHAn'a pu tre utilise que pour la maladie de Newcastle et la Bronchite Infectieuse.
Comme nous l'avons signal. l'absence des ractifs ne nous a pas permis defaire le test d'immuno-prcipitation pour la maladie de Gumboro. Toutefois. lestravaux de DEWIT et Coll. [24J ont montr que les tests d'immuno-prcipitationet d'IHA sont moins sensibles et moins prcoces que le test d'ELISA.
-
Dans ces conditions. nous pouvons dire que nos rsultats srologiquesobtenus essentiellement par l'ELISA peuvent tre pris en considration. Quelleque soit la mthode srologique utilise. il se pose un problme d'interfrenceentre les anticorps post-vaccinaux et post-infectieux dans les levages vaccins.
L'tude de la cintique des anticorps nous a permis de flXer les seuils depositivit des ractions comme nous l'avons vu dans le chapitre prcdent. Parailleurs, les diagnostics clinique, ncropsique et microbiologique devraient treassocis au sro-diagnostic afin de parvenir un diagnostic de certitude.
Ill.3. DISCUSSION DES RESULTATS
m.3.1. Rsultats des investigations sur le terrain
Les informations recueillies sur le terrain nous ont permis de cerner lesproblmes de l'aviculture moderne dans la rgion de Dakar. A priori, la prioded'investigations peut tre considre comme insuffisante pour tirer desconclusions sur les pathologies envisages. surtout lorsqu'on sait que certainesmaladies aviaires ont un caractre saisonnier.
Il nous tait impossible d'tendre nos recherches au-del de cette dure.Pour pallier cette insuffisance, nous avons men une enqute bibliographique.Malgr ces limites un certain nombre de conclusions peuvent tre tires. Nousavons pu constater en effet que les maladies parasitaires prennent le pas sur lesautres maladies. qu'elles soient infectieuses. nutritionnelles ou d'origine diverse.
Elles ont t signales dans tou tes les zones visites des proportionsvariables. le chef de flle est la coccidiose, sans aucun doute cause du manqued'hygine et de la mauvaise alimentation. Des signes cliniques relats par certainsleveurs et ceux qu'on a observs rappellent parfois la maladie de Gumboro. Maisl'existence des formes subaigus non classiques [71] ou inapparentes [70] ne nousa pas permis de poser un diagnostic exacte de maladie de Gumboro d'o l'intrtdu diagnostic srologique. Des signes respiratoires taient prsents dans bonnombre d'levages. Devant la complexit des affections respiratoires, nous avonseu des difficults diffrencier la Bronchite Infectieuse de la Mycoplasmose oudes autres maladies respiratoires
-
\\
\\
"Sans l'aide de laboratoi~t. le praticien ne peut parvenir un rsultatcertain que s'il a une solide exp~~e des affections respiratoires aviaires et s'ilrencontre des fonnes caractristiques" signalaient BRION et Coll. [11].
iEn tout tat de cause. les princ1pales maladies infectieuses existent l'tat
enzootique avec des flambes pizootiques certains priodes de l'anne. C'estainsi que les maladies respiratoires. apparaissent surtout en priode froide(Novembre Fvrier). L'closion de la maladie de Gumboro est favoris par lesgrands vents de Mars-Avril et la saison des pluies (Aot-Septembre).
m.3.2. Rsultats de la srologique
m.3.2.1. Maladie de Gumboro
Dans la plupart des levages visits. la vaccination contre la maladie deGumboro intervient entre les 7e et 15e jour d'ge avec des vaccins vivantsattnus. Le rappel est rare.
Des travaux antrieurs [18]. [43] ont montr que le taux des anticorps post-vaccinaux est faible par rapport celui des anticorps post-infectieux quipersistent pendant plus longtemps. Par ailleurs. le taux d'anticorps maternelschute rgulirement pour s'annuler au bout de 3 semaines d'ge malgr lavaccination du 7e jour dont la sroconversion est trs lente. C'est donc unepriode favorable pour les enqutes srologiques.
a. Rsultat d'ensemble
L'interprtation des rsultats obtenus dpend de l'origine des anticorps(post vaccinale ou post-infectieuse). Chez les sujets vaccins avec des vaccinsvivants attnus. on peut obtenir. 2 3 semaines aprs, un "COMBSCORE" allantde 1 4, ce qui tmoigne d'une bonne prise vaccinale.
Lors d'infection par un virus sauvage. une semaine aprs passage du virus. ily a une augmentation subite du taux d'anticorps avec des "COMBSCORE" levsde 5 6.
-
\\\
(Le tableau VII. P. 48 montre la prsence de trois grouP
-
\\\
(l
'~L
\.
b. Rsultats en fonction des zones
Nous n'avons pas eu de documents sur les taux d'infection de la maladie deiGumboro dans les diffrentes zones de la rgion de Dakar pour qu'on puisse lesomparer nos rsultats. Les pourcentages levs des levages suspects deszones de KM et MLK (Figure N2. P. 49 ). seraient probablement en relation avecla forte concentration des fermes avicoles et des rgles d'hygine dfectueuses.
c. Rsultats en fonction de la saison
La maladie de Gumboro apparat avec une frquence gale quelle que soit lasaison [17]. Les fiches de consultations des annes 1975. 1976. et 1977. reprisespar DIALLO [25] ont montr l'existence de la maladie sur toute l'anne avec deuxsommets. l'un situ en Avril et Mai. l'autre aux mois de Juillet. Aot.
La figure N3. P. 51) montre une srologie positive quel que soit le moisce qui serait en accord avec les observations prcdentes [17], [25].
Cependant. les pools de srums provenant des lots suspects de la maladiede Gumboro ne sont dcels qu'en Avril ce qui est en accord avec lesobservations de DIALLO [25] ; mais aussi aux mois de Dcembre et Janvier. ce quidiffre de ces observations.
Deux cas de figures peuvent donc tre voqus:
- Soit notre chantillonnage tait trop faible pour qu'on puisse mettre envidence une quelconque infection. ou bien nous sommes intervenus unmoment o l'infection y tait mais le niveau d'anticorps n'avait pas encoreatteint le seuil de suspicion retenu (COMBSCORE ~ 5).
- Dans tous les cas. le mois d'Avril reste le mois o le taux d'infection est leplus lev. En effet. le mois d'Avril correspond la priode de grandescheresse et de grands vents (Harmattan) qui constituent un facteur destress et favorisent la diffusion du virus dans les levages.
-
\\
\(
Des tudes faites em Cte- d'Ivoire [l81 ont montr le rle des grandseffectifs dans l'apparition de-~maladiede Gumboro. Ainsi la prsence probablede l'infection aux mois de, Dcembre et Janvier peut s'expliquer parl'augmentation des effectifs dahs les poulaillers afin de rpondre la demande
"-
pendant ces priodes de ftes.
N'oublions pas le rle d'une hygine dfectueuse dans l'closion desmaladies. En effet pendant les priodes de ftes. on voit natre des leveursoccasionnels. peu infonns des rgles d'hygine et de conduite des levages depoulets de chair.
Le transport des poulets de chair vivants pendant les moments de ftespourrait galement favoriser la diffusion et l'closion de la maladie. A ces facteurss'ajouterait l'effet du stress d au froid de Dcembre et Janvier.
d. Rsultats selon l'tat de sant
Nous avons distingu deux groupes en fonction de l'tat de sant:
les lots cliniquement sains sont ceux dans lesquels les sujets nemanifestaient pas des signes de souffrance au moment de nos visites :mme si ces lots ont entre temps t victimes d'une maladie :les lots malades sont des lots dans lesquels nous avons observs desoiseaux souffrants avec des signes cliniques quelle qu'en soit l'tiologie.
La prsence des pools de srums suspects dans les lots cliniquement sains[6/52) soit 11,53 % (tableau IX. P. 52.) ne doit donc pas tre surprenante. Lamise en vidence des anticorps spcifiques permettrait: de dtecter les formesinapparentes et de prciser si la mortalit anormale d'un lot ou les mauvaisesperformances sont en rapport avec la maladie de Gumboro.
Le faible taux de positivit dans les lots cliniquement sains paraitcontradictoire dans la mesure o dans les lots dits sains. les sujets sont supposstre immuniss.
-
\En ralit, sur le terrain on constate que l'application de la vaccinationdpend surtout des risques dans les levages. C'est ainsi que la plupart desleveurs font une seule injection sans rappel. Certains affirment mme que laseule vaccination qu'ils pratiquent rgulirement est la vaccination contre lamaladie de Newcastle, uniquement au premier jour.
e. Rsultats en fonction de l'ge
HITCHNER [32], CULLEN et Coll. [20] ont remarqu que les poussinspeuvent tre porteurs d'anticorps maternels qui leur confre une protectionnaturelle jusqu' 2 3 semaines d'ge.
BERTHE [10] constate que les sujets d' 1 mois ne sont pas infects.
Nos rsultats sont en accord avec ces observations comme le montre letableaux X. P.53. La srologie positive observe dans la tranche d'ge de 1 3semaines serait probablement due la prsence des anticorps d'originematernelle. Le niveau d'anticorps vaccinaux est trs faible chez les sujets gs de4 5 semaines [18].
MAIRE et Coll. [41] dmontrent que la priode la plus favorable pour larecherche des anticorps prcipitants est la fin d'engraissement ou l'abattage:ce que confirment nos rsultats. Les pools de srums provenant des bandes deplus de 7 semaines d'ge ont montr 85.11 % de rsultats positifs contre26,66 % chez les sujets de 4 6 semaines et 37,5 % dans le groupe de 1 3semaines d'ge (Tableau X. P.53). Le faible taux d'anticorps observ chez lesjeunes sujets peut tre d au pouvoir neutralisant des anticorps maternels quiempchent la monte de l'immunit vaccinale. Ceci justifie le rappel de lavaccination partir de la troisime semaine lorsque le taux d'anticorps maternelsaurait atteint un niveau suffisamment faible. En outre. plus l'oiseau est g, mieuxil s'immunise.
\\
j ,
"
-
m.3.2.2.. Maladie de Newcastlea. Rsultats d'ensemble
La vaccination contre la maladie de Newcastle est rgulirement pratiqueavec les vaccins vivants attnus. La premire injection a lieu au 1er jour d'geavec la souche Hitchener BI (vaccin HBl). Le rappel intervient entre le 1ge et le25e jour d'ge avec les vaccins HB 1 ou La Sota.
Le titre des anticorps d'infection sauvage reste nettement plus leve quecelui des anticorps vaccinaux [5]. DENNIS et ALEXANDER [23]. STONE et Coll[65] signalent que la primo-vaccination avec les vaccins vivants attnus donnedes titres de 80 320 en IHA. Le rappel fait augmenter considrablement cetitre.
Dans ces conditions nous pouvons dire que les anticorps des pools de/
srums dont le titre est compris entre 80 et 640. peuvent tre ceuxapparaissant aprs vaccination. ce qui est vraisemblable ou aprs infection ce quin'est pas exclu. Des titres trs levs ~ 1280 peuvent tmoigner de la prsenced'un virus sauvage (Tableau XI. P.53).
La diffrence entre les rsultats des tests d'ELISA et d'IHA eststatistiquement significative en faveur de l'ELISA (3.25 > 1,96). Ceci tmoignede la grande sensibilit de la raction d'ELISA comme l'ont montr de nombreuxtravaux antrieurs [7], [52]. [66], [67]. Cette diffrence serait galement lie lagrande spcifit de l'IHA qui est srotypes spcifiques [36].
b. Rsultats en fonction des zones
Le taux d'infection relativement lev dans les zones de KM et MLK(Figure N4. P. 54) serait d des rgles d'hygine dfectueuses mais aussi auvirus circulant de la maladie de Gumboro [30]. lequel la facult d'inhiberl'immunit active du fait de son pouvoir immuno-dpresseur.
-
c. Rsultats en fonction de la saison
\!
\\
(~\~L
La maladie de Newcastle ne prsente pas de c~ractre saisonnier. elle sviten toutes saisons. Elle prsente nanmoins un regain Ide vitalit pendant la saison
"sche et froide en particulier de Dcembre Fvrier (grande peste) et Aot.Septembre (petite peste) [691. EL KOHEN [291 au Maroc signale que bien que lamaladie de Newcastle soit prsente en toute saison. elle prsente deux: sommetspendant son volution : un pic en hiver (priode froide) et un autre pic enautomne (saison des pluies).
Les lots suspects de la maladie de Newcastle sont dcels de maniredisperse avec un pic trs net en Dcembre (priode sche et froide) comme lemontre la figure N5. P.56.
L'absence des lots probablement infects pendant certains mois nous meten dsaccord avec les observations prcdentes [29]. [69] : sans doute cause dela faiblesse de notre chantillon. ou bien pendant le prlvement. le niveaud'anticorps n'avait pas atteint le seuil de suspicion retenu ("COMBSCORE" ~ 5).Dans tous les cas. une srologie positive a t observe pendant tous les mois oles prlvements ont t effectus XIII. P. 57.
d. Rsultats selon l'tat de sant
Les pools de srums suspects sont observs aussi bien dans les lotscliniquement sains (9.62 %) que dans les lots malades (10,41 %) comme lemontre le tableau N 12 P. 26).
Soit la maladie aurait svi sous sa forme classique dans les levages ditssains. ou bien pendant notre intervention. elle tait prsente sous formeinapparente avec comme consquence des retards de croissance et desmauvaises performances en fin d'engraissement d'o la ncessit d'un dpistagesrologique rgulier.
-
\e. Rsultats en fonction de l'ge
BARTE cit par LESBOUYRIES [401touche les sujets de tous ges.
\\
(~
-
\\\
61 pools d~rums. soit 61 % sont reconnus positifs par les deux tests quidonnent des rsuI,~divergentpour 25 pools de srums soit 25 %. En effet 23pools de srums sont reconnus positifs en ELISA et ngatif en lHA : alors queseuls 2 sont positifs ~n lHA et ngatifs en ELISA. Ceci montre que l'ELISA estplus sensible que l'II-tA. Cependant la concordance entre les deux tests estrelativement leve puisqu'elle atteint 75 %.
Ainsi les tests d'ELISA et d'IHA sont tous performants et de ce fait peuventtre utiliss l'un ou l'autre dans les contrles de vaccination ou dans le dpistagedes infections dans les levages non vaccins. Dans le cadre des enqutes sro-pidmiologiques dans les levages vaccins. il serait prfrable d'utiliser latechnique d'ELISA. Le nombre de pools de srums fortement positifs en lHA esttrs faible. soit 2 comme le montre le tableau XI. P.53 avec une diffrencestatistiquement significative en faveur de l'ELISA (2,4 > 1.96).
m.3.2.3. Bronchite Infectieuse
Les leveurs ne font pas la vaccination contre la Bronchite Infectieuse dansla rgion de Dakar chez les poulets de chair. Toutefois certains en font chez lespondeuses avec des vaccins vivants attnus (H 120. H52) dans les deux premiersmois d'ge. Toutes traces d'anticorps dceles chez les poulets de chair seraitdonc a priori en relation avec le passage d'un virus sauvage.
a. Rsultats d'ensemble
"Sans l'aide de laboratoire. le praticien ne peut parvenir un rsultatcertain. que s'il a une solide exprience des aITections respiratoires aviaires et s'ilrencontre des formes caractristiques" disaient BRION et Coll. [Il], N'ayant pasrencontr ces formes caractristiques, LES BOUYRIES [401 a l'impression de nepas connatre la Bronchite Infectieuse.
La Bronchite Infectieuse est en effet ignore sur le terrain au Sngal. Lesleveurs et mme certains techniciens pensent que cette maladie n'a desrpercussions que sur la ponte. Les faibles mortalits des formes respiratoires. lemanque de spcificit des signes cliniques sont peut lre des raisons quijustifient cette attitude.
-
-\\,
\\
L'vidence srologique que nous avons rvle esf\..donc une informationtrs importante. en l'absence de toute vaccination. La fort~~valenceen EUSA{51 %) comme le montre le tableau XVII. P.59 est une preuve que cette maladiesvit chez les poulets de chair dans la rgion de Dakar. ~es anticorps ainsidcels tmoignent de la circulation active du virus sauvage. '-
Il semble que certaines souches des vaccins vivants attnus H 120. H52 dela Bronchite Infectieuse peuvent passez chez les poulets de chair non vaccinssitus dans le voisinage des poussins vaccins et destins la ponte. La soucheH52 serait trs virulente et pourrait provoquer des phnomnes respiratoires sielle passait chez ces poulets de chair non vaccins. Dans ces conditions, lesanticorps dtects pourraient provenir galement de ces souches vaccinales. ceque ne peut prouver l'EUSA puisqu'elle n'est pas srotypes-spcifiques.
La grande spcificit de l'IHA dmontr par KING et HOPKINS [36] peut1 confrrmer l'existence d'une souche sauvage [Mass 41] que nous avons utilise
comme antigne, dans les levages de poulets de chair. Cependant certainstravaux antrieurs [3]. [4] ont montr que l'IHA avec antigne Mass 41 avait servi la dtection des anticorps apparaissant aprs vaccination avec la soucheHollande. A la suite des infections additionnelles, il apparat des ractionscroises entre diffrentes souches. C'est une preuve des complexits associes la spcifit de la raction d'IHA dans les diagnostics srologiques.
b. Rsultats en fonction des zones
L'infection semble tre prsente dans toutes les zones (Figure N6. P. 60)avec un taux relativement faible SGK, sans doute cause de l'loignement deslevages les uns par rapport aux autres. La Bronchite Infectieuse est trscontagieuse. le passage du virus d'un poulailler l'autre est favoris par leurproximit: C'est probablement la cause du taux de possitivit lev dans lessecteurs de KM et MLK.
c. Rsultats en fonction de la saison
L'importance du froid [49], des vents et des poussires n'est plus dmontrer dans la dissmination des alTections respiratoires.
-
,.
Ainsi les fortes prvalences des mois de Novembre, Dcembre (priodefroide) et Avril, Mai (priode des grands vents avec poussires : Hannattan)comme le montre la figure N7. P. 61sont probablement dues au stress provoqupar ces diffrents facteurs.
Le virus circulant de la maladie de Gumboro en Avril pourrait galementexpliquer la prvalence leve de la Bronchite Infectieuse dans ce mois. Lesfaibles prvalences de Janvier et Fvrier, les mois les plus froids de l'annepeuvent avoir une explication dans le faible chantillonnage ou la courte priodeentre l'infection et l'excution des prlvements. Dans tous les cas, il apparatque la Bronchite Infectieuse prsente un "bruit de fond" quel que soit le mois oles prlvements sont effectus, moins que les anticorps dcels ne soientinduits par le passage des souches vaccinales partir des levages de pondeusessitus dans le voisinage.
d. Rsultants selon l'tat de sant
La prsence des formes inapparentes, l'apparition des anticorps chez lessujets guris de la Bronchite Infectieuse peuvent tre des raisons qui justifientque la srologie soit positive dans les pools de srums issus des lots cliniquementsains comme l'indique le tableau XVIII. P. 62. La diffrence entre les rsultats desdeux groupes n'est pas statistiquement significative (l,4 < 1,96). C'est la preuveque le signes cliniques observs dans les levages malades ne sont pas tous lis la Bronchite Infectieuse.
e. Rsultats en fonction de l'ge
Les pourcentages les plus levs sont observs dans les bandes de plus de7 semaines d'ge (tableau XX. P. 63). Les sujets paraissent infects quel que soitl'ge. Toutefois, les anticorps mis en vidence dans les bandes de 1 3 semainesd'ge peuvent tre d'origine maternelle [6], [49].
La capacit de l'ELISA dtecter les anticorps chez les jeunes par rapportau test d'IHA est encore mise en vidence dans la Bronchite Infectieuse (TableauXXI. P.63).
-
La concordance d'ensemble entre les deux tests est cependant leve(82.05 %) comme le montre le tableau XXVII. Ainsi dans le dpistage de laBronchite Infectieuse. on peut se satisfaire de l'un ou de l'autre test.
Tableau XXVII : Analyse de la concordance d'ensemble entre l'ELISA et l'IHA.
.,.,',.'.:,.,.,' ,c,:.:.:..: ...,.:,.,e..,.,.,.,.,.,.,e",.,:,:,:.,:l,:,:,:,.'.,u,.','.:,.,.,.. ',.....e,.....:::::,..,: ,:.,.:,..:.:,...:,.,: :..:*:'..'',.:.~.. '.:.'.:.'.~.'.:..'~.,.s."..... .:.:~~.,."r,".,..'. .. p,',.,',.',',."I,l.,.,,):.:.'.,.Q.,.'.'.'.',.,.l.li~~~::.: "":.'.':"'.:":"""'"'.'.".".,N.". :,:,.,.', .. ,o,',.,.,.....,.ro,.,.,.,.,.,.,:,.,:,b.",:.,.,.,:,.::.r,..S.~ ..'d.,.r"'.....u~.'..:m:.Rse.,O,.,.,..,.,..,.,~,..,.,.:~,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,p..,.,..e.",,..,..,.:....,,:.'., '.,.......'..: :.PQijl,;~ntag'.:m.::(%)().: ..:::..::....,:.,...,..,..., .,..,.,..., .,...,J., ...,.,:.....,.,:..,:., .. :., .., ., .., .,..,: ., .., ., .:' .,...'.:......:'.::.:.::.::..::.:..:.,:..:'.::..:.::...,'..,....,'.,...,..,...,..,...,...,..:...,...,.,..' ...,'...,.,.,'...,...,...,....,...,...,..,'...,..,..:..,..,.....,.,.,..:.,....,..:.,..;..,.:.,....,.;..,'...,.,.,:....,...,:....:..,: ...,..,...,: ..,'...,...,..:.:.:..,'.:':...,.,...,:.,....,..,....,:..,'...,.,',...,..,..:.:.,....,..,....,..,' ...,: ..,...,...,...,..,....,..,::::::,.::::.::::.::::::'::::::;:.:::::".:.::.,.,:::,:.:::.:.:'::) I'::'...::)::: ::::::'.:':...:::.:2:::::::::::'.::::.: :...
finale+
ELISA+
+
IHA
++
1 31 9 33
45
16,66O,OS 42,31O,1124,36O,11,3O,02
57,69O,1
m.3.2.4. Mycoplasmose
LISSOT cit par BERTHE [l0] signale qu'en levage industriel, un taux depositiv suprieur 30 % permet d'affirmer qu'un troupeau est infect par unmycoplasme. Sur la figure N8 P.65). nous pouvons dire que la zone de MLK estinfecte par les deux espces de mycoplasmes (MG : 33.33 % et MS : 33.33 % )alors que seule l'infection MS (30,4 %) semble exister KM.
Selon COTIERAU [19]. "une srologie ngative vis--vis des mycoplasmespathognes ne permet pas d'affirmer l'absence de ces micro-organismes. unesrologie positive ne permet pas non plus de conclure la prsence d'unemaladie respiratoire mycoplasmes". Il serait plus sr de coupler cette mthodeaux mthodes microbiologiques de culture de mycosplasmes.
Les mycoplasmes interviennent dans les affections respiratoires. seuls ouen association avec d'autres germes. Leur expression clinique est sous l'influencede nombreux facteurs favorisants dont le froid [49].
L'effet du stress d au froid est vident en Janvier o il apparat un picpour les deux espces de mycoplasmes (Figure N9 P. 66).
~....~
\\
\
\\
-
Le tableau XXIV P.67} donne les rsultats en fonction de l'ge. 11 semble sedgager une tendance qui voudrait que les vola1lles restent indemnes jusqu' 3semaines d'ge. comme l'avait observ BERniE [10] au Burkina Faso. C'est aprscet ge que se manifeste une srologie positive. Deux ventualits pourraientexpliquer ce fait:
la faiblesse de notre chantillon qui ne permet pas de mettre envidence une influence quelconque de l'ge :une relation existant entre le taux d'infection et les conditions d'levage.Les volailles pourraient tre saines leur arrive dans les poulaillers.
Elles s'infecteraient alors progressivement. Cette hypothse nous paratvraisemblable eu gard aux observations faites dans les fermes. les poussinsfaisant l'objet d'un soin particulier la rception et au dmarrage.
Aprs il Y a un relchement qui entrane leur contamination. Dans lesexploitations cohabitent parfois adultes et jeunes. Ce sont les mmes personnesqui vont d'un btiment l'autre sans aucune prcaution.
En conclusion. nous constatons que toutes les maladies tudies existentdans les levages de poulets de chair Dakar. Elles apparaissent avec desfrquences variables selon les zones. la saison et l'ge. il nous semble alorsncessaire de connatre l'importance conomique de ces maladies afin que desmesures de lutte appropries soient prises.
, !
~.,')
(
\\
\\
-
:':'::':::'j"U::MPP~~:p~'m~:Q~~RI;q:J.IT~~.?:JB$e~~"\:::,:}",,
IV. 1. IMPORTANCE ECONOMIQUEIV.I.I. Maladie de Gumboro
La maladie de Gumboro est une maladie contagieuse due un Bimavirus. Lacontagiosit est insidieuse. voluant de faon peu uniforme dans un levage. Lacontamination de btiment btiment ne semble pas de rgle [41]. Dans unbtiment infect. le virus persiste pendant longtemps. BENTON et Coll [9] ontsignal un dlai de 122 jours aprs le dpart des oiseaux malades.
Ces observations ne peuvent tre spares de l'importance conomique decette maladie qui a fait l'objet de nombreuses recherches. Ainsi MAIRE et Coll[41] ont prouv que la maladie de Gumboro peut provoquer dans un cheptel unemortalit double ou triple par rapport celle observe dans un troupeauindemne. soit un taux de mortalit de 13.3 %.
Des travaux raliss au Sngal [53] dans les annes 75. au dbut de lamaladie de Gumboro ont rvl des taux de mortalit de 47,29 %. En Cte-d'Ivoire [18]. on a enregistr des taux de mortalits allant jusqu' 50 %. Outre lespertes par mortalit. la maladie se traduit par une augmentation de l'indice deconsommation [16] avec perte de poids l'abattage. Ces observations montrentque le~ pertes conomiques provoques par la maladie de Gumboro ne sont pasngligeables.
Dans la rgion de Dakar. 20 25 % des levages sont trs probablementinfects notamment dans les zones de forte concentration de fermes avicoles(KM. MLK). Il apparat donc utile que des mesures de lutte soient renforces.
1V.1.2. Maladie de Newcastle
Nous n'avons pas eu des estimations des pertes conomiques dues lamaladie de Newcastle. Toutefois il faut savoir que c'est une maladie trsmeurtrire sous ses formes pizootiques aigu et suraigu classiqves.
. 1
\\
\\
-
Les formes subaigus et chroniques sont le fait des souches msognes etlentognes : elles se traduisent essentiellement par des signes respiratoires. Les
-pertes conomiques sont lies d'une part aux mortalits, 80 100 % dans lesfoyers aigus et suraigu.s, et environ 10 % dans les formes subcliniques : D'autre
lIIf)art aux retards de croissance et mauvais indices de consommation.
IV.l.3. Bronchite Infectieuse
C'est une maladie ignore dans la rgion de Dakar en levage de pouletsde chair, peut tre cause des difficults de diagnostic des maladiesrespiratoires [lI], [40].
Bien que les formes respiratoires de la Bronchite Infectieuse entranentlICle faibles mortalits (moins de 10 % de mortalits sans complications). ellessont responsables des retards de croissance. des mauvais indices de
.consommation avec une perte de poids de 7 8 % en fin de croissance [18]. Destudes faites en Australie [49] ont montr que les souches tropisme rnalpeuvent provoquer des mortalits allant jusqu' 54 % en priode froide (I6,C).Avec 25 60 % des levages affects dans la rgion de Dakar (figure N6 P.60).Les mesures de lutte contre la Bronchite Infectieuse s'avrent indispensables
,\>our limiter les pertes chez les poulets de chair.
IV.1.4. Mycoplasmose
Il Les mycoplasmes (MG. MS) sont impliqus dans la maladie respiratoirechronique. le plus souvent en association avec d'autre agents bactriens ou viraux(virus de la maladie de Newcastle. virus de la Bronchite Infectieuse, EcherichiaColi). Les pertes sont lies des mortalits pouvant aller jusqu' 10 % ducheptel, et des chutes de productivit (croissance).
En dfinitive. ces observations nous permettent d'attirer l'attention sur les'Pertes conomiques que ces diffrentes maladies peuvent occasionner enaviculture moderne aggraves surtout par une hygine dfectueuse, pparce.manipule par des mains peu averties. Ces tudes ont de quoi inquiter etpeuvent justifier l'tablissement des mesures de lutte contre ces maladies.
1
"
\\
-
1V.2. LUTTE CONTRE LES MALADIES AVIAIRES DOMINANTES (MALADIES DEGUMBORO, NEWCASTLE, BRONCWTE INFECTIEUSE ET MYCOPLASMOSE)1V.2.1. M~thodesg~n~ralesde lutte
IV.2.1.1.. Traitement
a. Maladies virales
Le traitement de maladies virales comme la Gumboro. la maladie deNewcastle et la Bronchite Infectieuse est illusoire et sans effet [17]. [48].Cependant un traitement anti-infectieux peut permettre de lutter contre lescomplications bactriennes et par consquent diminuer les pertes conomiques.Les bactries de surinfection les plus frquentes sont les colibacilles (E. Coli). Lesmpycoplasmes sont galement le plus souvent associs aux maladies virales.
b. Mycoplasmose
SAURAT et LAUDE. cits par LES BOUYRIES [40] ont obtenu contre lamycoplasmose exprimentale des rsultats encourageants l'aide la spiramycineseule ou associe la chlorttracycline des doses relativement fortes etprolonges.
Les mmes rsultats ont t obtenus en Cte d'Ivoire [18] sur despondeuses avec ces mdicaments et d'autres antibiotiques de la famille desmacrolides comme la lyncomycine. la tylosine. la tiamuline et l'enroflocine. Cetraitment n'est malheureusement pas strilisant. Les antibiogrammes ont montrque 100 % des souches d'E. Coli et les germes associs aux mycoplasmes taientsensibles l'enroflocine. Mais chez les poulets de chair. certains de cestraitements s'avrent trop coteux: le choix des antibiotiques devra donc entenir compte.
L'administration des substances antimycoplasmiques ne peut de toutesfaons pas rsoudre tous les problmes pathologiques si les rgles les plusvidentes de l'hygine et de prohylaxie ne sont pas respectes.
\\
\
-
IV.2.1.2. Prophylaxie
Les mesures de prophylaxie doivent tenir compte des caractristiquesphysico-chimiques de l'agent pathogne. de la prsence chez les jeunes animauxd'anticorps maternels assurant certes une protection. mais pouvant nuir lamise en place de l'immunit active.
La prophylaxie peut tre sanitaire ou mdicale.
a. Prophylaxie sanitaire
Elle consiste soit empcher la pntration des germes pathognes dansles levages sains (prophylaxie sanitaire dfensive). soit dtruire les agentspathognes en milieu infect (prophylaxie sanitaire offensive) En levage sain. ilfaut cloisonner les animaux par groupes d'ge tout en respectant le vide sanitaireentre deux bandes (environ 2 semaines). N'importer que les animaux provenantd'levages sains. En levage contamin. isoler les malades. utiliser un personnelet du matriel destins aux effectifs malades. dtruire les cadavres et luttercontre les insectes.
MARIS et RIBOUCHON [42] ont montr qu'un bon nettoyage augmentel'efficacit de la dsinfection. Ainsi il faut assurer dans les levages unedsinfection minitieuse des locaux. du matriel aprs un bon nettoyage.
Le traitement des reproducteurs est une phase non moins importante caril empcherait la transmission intravitelline de certains germes comme l'avaitsignal COTIEREAU [19] : "les modalits des mesures dfensives gnralesvisent empcher la cration de nouveaux foyers de maladie et assurer uncontrle permanent des exploitations productrices d'oeufs et de poussinsdestins au repeuplement des levages".
Aussi est-il important de constater que dans l'radication de certainesmaladies comme la maladie respiratoire chronique dont l'agent dterminant estle mycoplasme. il faut effectuer un traitement des oeufs couver par lesantibiotiques comme la Tylosine (injection dans la chambre air ou trempage).liminer les sujets positifs lors des contrles srologiques.
-=-:'II~
-
Il faut cependant admettre que ces mesures sont difficilement applicablesau Sngal comme partout ailleurs dans les pays en dveloppement : ellesseraient de nos jours trs coteuses et les mesures d'isolement des levagessouvent_impossibles obtenir.
Devant les limites de la prophylaxie sanitaire dans nos rgions. 11 estindispensable de coupler ces mesures sanitaires celles de la prophylaxiemdicale.
b. Prophylaxie mdicale
C'est l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour renforcer les capacits dedfense de l'organisme sensible. On fait appel la vaccination. Sur le march. ontrouve de vaccins germes inactivs et des vaccins germes vivants attnus.
~ les vaccins gennes inactivs
Malgr la difficult de leur emploi ncessitant une manipulationindividuelle des oiseaux pour injecter chaque dose. les vaccins inactivsprsentent des avantages lis leur scurit (germes tus) et leur qualitimmunogne.
L'immunit confre est plus intense et plus durable que celle confrepar les vaccins vivants attnus. Ils sont surtout utiliss chez les pondeuses.
* les l1CICIdns germes vivants
Autrefois. l'on utilisait les vaccins germes pleinement virulents. commel'ont fait EDGAR et CHO [28] partir des suspensions de la bourse cloacale despoulets infects par le virus de la maladie de Gumboro Cette mthode estmalheureusement dangereuse car les ractions sont parfois violentes voiremortelles mme si une protection tait confre aux animaux traits.
\\
\\
-
Elle contribue par ailleurs la diITusion du virus.
C'est ainsi qu' l'heure actuelle. ces vaccins sont abandonns au profit desvaccins gennes attnus. L'attnuation peut se faire sur oeufs embryonns. sursouriceaux ou sur cultures cellulaires. Ces vaccins trs fragiles sont prsentssous forme lyophyliss. Ils sont utiliss aussi bien chez les poulets de chair quechez les pondeuses. Ils sont en effet trs pratiques par leur moded'administration (vaccination collective par les voies naturelles) et sont de plustrs conomiques. Ils pennettent l'immunisation rapide et prcoce des poussins.
Les souches vaccinales peuvent se multiplier et se diffuser partir dessujets vaccins. C'est le cas des souches H120. H52 de la Bronchite Infecftieuse.La Sota de la maladie de Newcastle [41]. Ceci est intressant en cas d'levage enbande unique (mme ge. mme provenance) dans ce cas la diffusibilit est tout fait bnfique. car la vaccination va se faire par contact entre oiseaux. (Il seraitcependant illusoire de tabler sur ce phnomne pour tenter de vacciner un lotentier en ne vaccinant qu'une petite partie de ce lot). Dans le cas contraire, etc'est le cas en Afrique, cela peut entraner des inconvnients. Par exemple lasouche H52 de la Bronchite Infectieuse peut provoquer des problmesrespiratoires ches les poussins non primo-vaccins avec la souche H120.
* les programmes de vaccination
L'laboration d'un programme de vaccination dpend surtout du pouvoirneutralisant des anticorps maternels et leur capacit inhiber l'iIT,lmunit active.Ainsi dans la maladie de Gumboro l'interfrence entre les anticorps maternels etles anticorps post-vaccinaux est trs marque [32], [72]. Il faudrait donc tenircompte de l'tat immunitaire des poules reproductrices dans les programmes devaccination des poussins. Les anticorps maternels assurent une protectiontemporaire jusqu' deux trois semaines d'ge. Cependant dans les zones hautrisque. la protection confre par les anticorps maternels n'est pas suffisantepour lutter contre l'infection par une souche virulente [72], [73] ce qui justifie lavaccination contre la maladie de Gumboro en bas ges: 1 2 semaines avecrappel partir de la troisime semaine comme l'ont prconiss maintes auteurs[15], [l8], [50], [62], [63] .
. !
\\
\
\\
-
Par contre la vaccination au premier jour est pleinement justifie dans lamaladie de Newcastle et la Bronchite Infectieuse avec une seconde injection latroisime semaine.
Dans les cas. la vaccination ne peut donner de bons rsultats que.orsqu'elle est faite dans de bonnes conditions d'hygine associes unjparasitage rgulier des oiseaux.
IV.2.2. Moyens de lutte dans la rgion de Dakar
Les mesures de lutte mises en oeuvre pour lutter contre les principalesnaladies aviaires sont essentiellement prophylactiques. mme si dans certaines::irconstances. on tente un traitement.
IV.2.2.1.~teDDent
Le traitement comme on l'a signal est illusoire pour les maladies virales.)ans la plupart des cas. les aviculteurs mettent leurs oiseaux sous antibiothrapie;x>ur lutter contre les germes de surinfection.
Le traitement antlparasitaire est intgr aux programmes de vaccination::ertains leveurs le font rgulirement.
IV.2.2.2. Prophylaxie
La prophylaxie mdicale prend nettement le pas sur le prophylaxie;anitaire. cette dernire tant la plupart du temps archaque. parce que les
~leveurs ignorent ses fondements.
a. Prophymaxie sanitaire
En levage sain comme en levage contamin. la prophylaxie sanitaire esta mme. le vide sanitaire est trs peu respect. la rpartition des oiseaux selones normes de conduite fait parfois dfaut.
,
".
\\
\\
-
La dsinfection des locaux aprs passage d'une maladie est pratique par[uelques rares leveurs. Les cadavres ne sont pas souvent enfouis. Cette faon deaire peut s'expliquer par deux raisons : le souci de faire des bnfices et lenanque d'ducation surt~ut. li une mauvaise organisation.
Il faut signaler l'origine diverse des importations. ce qui rend difficile les:ontrles par les semees vtrinaires.
Ainsi la prophylaxie sanitaire est rduite sa plus simple expression.
Il semble en dernire analyse que l'aviculteur sngalais soit obnibul par~ gain facile d'argent et veuille rduire au minimum les dpenses l'achat des10usslns et des aliments.
b. Prophylaxie mdicale
Elle correspond l'usage des vacins pour prvenir les maladies.
Malheureusement. la vaccination contre certaines maladies comme la~ronchite Infectieuse et la Mycoplasmose fait dfaut en levage de poulets dehar dans la rgion de Dakar.
Mme s'il n'existe qu'un seul vaccin inactiv (GALLIMUNEND) contre!fycoplasma gallisepticum. il faut reconnatre l'abondance sur le march desaccins vivants attnus qui peuvent tre utiliss chez les poulets de chair contre3. Bronchite Infectieuse.
Nous pensons donc que les aviculteurs devraient uniformiser la vaccinationontre la Bronchite Infectieuse en la pratiquant la fois chez les pondeuses ethez les poulets de chair. Ceci contribuerait prvenir cette maladie qu'elle soitl'origine sauvage ou vaccinale (souche H52 par exemple).
Les leveurs de poulets de chair de la rgion de Dakar font une prophylaxieIldicale contre la maladie de Gumboro et la maladie de Newcastle.
,
\\
\
,\
-
\\
-:c Maladie de Gumboro
La ncessit de la vaccination contre la maladie de Gumboro a t ressentietrs tt peu aprs son apparition au Sngal 153]. Au dbut. l'on utilisait le vacci~BURSA VACND . mais ce vaccin a t abandonn cause de son pouvoirpathogne rsiduel lev. Aujourd'hui. il y a sur le march les vaccins TAD.GUMBORAL crND. BUR706. Tous sont des vaccins vivants attnus.
-:c Maladie de Newcastle
Les vaccins utiliss sont:
Vaccin HB I (PESTOSND ) en primovaccination ( I jour d'ge) ou enrappel partir de la 3e semaine.
Vaccin La Sota (SOTASECND ) en rappel partir de la 3e semaine.
Comme nous l'avons signal. la Bronchite Infectieuse et la Mycoplasmosene font pas l'objet de vaccination dans la rgion de Dakar en levage de pouletsde chair. bien que des vaccins contre la Bronchite Infectieuse soient sur lemarch et servent vacciner des poules pondeuses.
C'est le cas des vaccins HI20 utilis en primovaccination (l jour d'ge) eten rappel (3 5 semaines plus tard) et H52 en rappel vers la IOe semaine d'ge.Mme si la vaccination contre les maladies de Gumboro et de Newcastle esteffective. le taux: de protection dans les levages Dakar parat faible sans doute cause des rgles d'hygine dfectueuses. mais aussi l'absence de rappels danscertaines maladies comme la maladie de Gumboro.
Ainsi le respect scrupuleux des rgles d'hygine et des rappels rgulierspourraient donner des rsultats plus satisfaisants. Aussi serait-il intressantd'envisager la vaccination contre la Bronchite Infectieuse chez les poulets dechair. Avec une antibioprvention bien conduite. l'aviculture moderne sngalaisepourrait tre bien plus rentable. Paralllement des perspectives d'avenir peuventtre envisages en vue de l'radication totale des diffrentes maladies aviaires.
-
IV.S. PERSPECTIVES D'AVENIR1V.3.1. Actions Amener au niveau de la production
Ces actions passent par l'ducation des l~veurs qui apparat comme labase de la matrise des problmes de l'aviculture industrielle aussi bien auSngal que partout ailleurs dans les pays en dveloppement. Il faut doncorganiser la formation des leveurs. A dfaut. mener des campagnes desensibilisation en utilisant toutes les mthodes audiovisuelles.
Assurer un dveloppement et une implantation contrls des fermesavicoles. Organiser la production et la commercialisation des produits avicoles.Par ailleurs. la meilleure solution pour augmenter la production serait l'entretiensur place des reproducteurs en vue de la production des oeufs embryonns et despoussins d'un jour. Il faudrait galement pour une meilleure gestion desproductions avicoles. crer un abattoir de volailles avec une chaine de froid pourla conservation.
1V.3.2. Actions sanitaires et mdicales
Assurer un controle sanitaire des importations (oeufs. poussins d'un jour).Ceci n'est possible que lorsqu'il y a organisation des importations qui devraienttre exclusivement assures par des structures bien connues et dotes d'uneautorisation officielle. Les particuliers devraient tre carts des importations.Dans tous les cas. il faudrait diminuer les importations au profit de la productionlocale. Lorsqu'elle, s'avre ncessaire. il faut surtout importer les oeufs couver audtriment des poussins d'un jour dont les pertes conomiques paraissent plusimportantes et les contrles sanitaires plus difficiles. Crer une structurenationale qui sera la seule autorise assurer les importations et le contrle desvaccins.
Elle pourrait galement tre charge du contrle de l'tat sanitaire et duniveau immunitaire des reproducteurs au niveau des couvoirs. Avec desporgrammes d'information et de sensibilisation. de surveillance pidmiologiqueet de lutte. on pourra constater dans l'avenir une rgression considrable voireradication des diffrentes maladies aviaires.
!
., \\
\\
-
COJNCJLUSJJOJN GENERAJLE
, !
.,
\\
\
\\
-
,"
"
Dans la recherche de l'autosuffisance allmenta1re en protines d'origineanimale des populations. le Sngal comme de nombreux pays en dveloppementa vu la ncessit de mettre un accent particulier sur l'exploitation des espces cycle court. Ainsi l'aviculture moderne dont celle des poulets de chair a connuces dernires annes une croissance considrable dans les zones urbaines etpri-urbaines. et particulirement dans la rgion de Dakar.
Cependant. les espoirs fonds sur une telle spculation sont remis encause par des problmes d'alimentation mais aussi de pathologies parmilesquelles la pathologie infectieuse n'est pas des moindres. pour obtenir demeilleurs rsultats. il faut que ces freins soient levs.
C'est dans cette optique que s'inscrit ce travail qui nous a permis de faireune tude sro-pidmiologique sur les dominantes pathologiques infectieusesaviaires (maladie de Gumboro. maladie de Newcastle. Bronchite Infectieuse etMycoplasmose) en levage moderne de poulets de chair dans la rgion de Dakar.
282 srums individuels ont t rcolts dans 65 levages et rpartis en100 pools de srums en fonction de l'ge. Pour chaque levage les srumsindividuels d'une bande homogne (sujets de mme ge) ont t mlangs parties gales pour constituer un pool de srums.
100 pools de srums ont t constitus et traits par la technique d'ELISAen phase solide (KIT IMMUNOCOMB TM) pour toutes les maladies envisages eten IliA pour la maladie de Newcastle. 78 des 100 pools de srums ont t soumis la rdaction d'IliA pour la Bronchite Infectieuse.
Dans ces conditions exprimentales. les rsultats obtenus donnent uneprvalence globale en ELISA de 55 % en Gumboro. 61 % en Newcastle. 51 % enBronchite Infectieuse. 16 % en MG et 18 % en MS. Les prvalences varient selonles zones. la saison. l'tat de sant et l'ge des oiseaux. Les seuils de positiv quenous nous sommes flXs dans l'interprtation des rsultats des maladies contreslesquelles la vaccination est ralise. nous permettent oe distinguer les anticorpsvaccinaux et les anticorps d'infection sauvage.
\
\
-
Ainsi, l'infection par le virus sauvage de la maladie de Gumboro sembleprobable dans 12 % des pools de srums. Les zones de Keur Massar et Malikaparaissent plus infectes. suivies de celle de sangalkam. Les secteurs de Dakar etM'bao. Rufisque sont marqus par l'absence d'anticorps tmoins d'une suspicionde maladie de Gumboro. Les variations mensuelles montrent que le virus sauvagede la maladie de Gumboro semble avoir une plus grande activit en Dcembre.Janvier mais surtout en Avril. Sur le plan sanitaire. l'infection semble prsenteaussi bien dans les lots cliniquement sains que dans les lots malades dont lasroprvalence est plus leve. Le taux de positiv est nettement plus lev chezles sujets en fin de croissance (plus de 7 semaines d'ge) alors qu'il parat trsfaible dans la tranche d'ge de 4-6 semaines. Par ailleurs. les pools de srumsissus des bandes ges de moins de 3 semaines montrent des taux d'anticorpstrs faibles qui ne permettent pas une suspicion de maladie de Gumboro.
Dans le domaine de la maladie de Newcastle. 10 % des pools de srumssont suspects d'infection sauvage en ELISA. proportion qui n'est que de 2 % surles 38 % des pools de srums positifs en IHA. Seule la zone de M'bao. Rufisquene semble pas tre affecte par la maladie de Newcastle. La prvalence apparatde faon irrgulire dans le temps avec un pic trs perceptible en Dcembre(priode froide). Le taux d'anticorps semble s'lever avec l'ge alors quel'infection par un virus sauvage semble absente chez les jeunes sujets de moins de3 semaines.
Dans la Bronchite Infectieuse. une prvalence de 51 % a t observe enELISA contre 25.6 % en lHA. Toutes les zones paraissent infectes par le virus
Ide la Bronchite Infectieuse: cependant les zones de Keur Massar. Malika etDakar semblent les plus touches (prvalences suprieures 50 %). L'infectionsemble prsente quel que soit le mois avec deux pics : un premier en Novembre-Dcembre et un deuxime pic en Avril-Mai. La sroconversion parat plus leveschez les bandes de plus de 7 semaines d'ge.
Dans le cadre de la Mycoplasmose : Mycoplasma gallisepticum etMycoplasma synoviae. les prvalences ne montrent pas de diffrence significativesur le plan statistique (0.38< 1.96) entre les deux espces soit respectivement16% et 18 %.
\\
\
\
\'
-
Quelle que soit l'espce de Mycoplasmes. l'infection semble se l1m1ter auxsecteurs de Keur Massar. Malika et Sangalkam avec un taux plus lev (suprieur 30 %) dans les deux premiers secteurs. Alors que l'activit des deux espces demycoplasmes semble concomitante. seule l'infection Mycoplasma synoviale estperceptible en Dcembre. Pour les deux espces de mycoplasmes. lesprvalences sont plus leves dans les bandes malades que dans les bandescliniquement saines.
Aucune trace srologique n'a t dcele dans les pools de srums issusdes lots gs de moins de 3 semaines. La prvalence semble augmenter avec l'gequelle que soit l'espce de mycoplasmes. En l'absence de toute vaccination.l'vidence srologique ainsi rvle en Bronchite Infectieuse et enMycoplasmose tmoigne de la circulation de ces microbes dans les levages.
Par ailleurs. une comparaison a t faite entre les rsultats obtenus enELISA (KIT IMMUNOCOMB TM) et ceux fournis par l'IHA dans la maladie deNewcastle et la Bronchite Infectieuse. Cette comparaison fait ressortir uneconcordance de 75 % et 82.05 % respectivement dans le diagnostic de lamaladie de Newcastle et de la Bronchite Infectieuse.
Les deux techniques peuvent donc tre utilises pour le diagnosticsrologique de ces maladies aviaires. Toutefois. le test d'ELISA s'est montr d'unefaon significative plus sensible que l'IHA. De plus la capacit du test d'IHA dtecter les anticorps en bas ges est trs faible par rapport l'ELISA.
Ce travail. mme s'il parait peu approfondi. nous a pennis de donner uneide globale de la sroprvalence des diffrentes maladies tudies en levagede poulets de chair dans la rgion de Dakar.
Dans la mme lance. nous souhaitons qu' l'avenir. des tudessrologiques associes au diagnostic microbiologique et largis d'autresmaladies aviaires soient effectus. Ces tudes devraient galement permettred'valuer les incidences conomiques de ces entits pathologiques en levageavicole moderne afin que des moyens de lutte appropris soient envisags.
.~ ...)
\\
\
-
lBJIlBJLJI ((})GRAJPJBlJIJE
"
-
1. AFRIQUE AGRICULTUREDossier avicultureAfrique Agriculture. 1989. 167 : 14-32
2. AFRIQUE AGRICULTIJREDossier AvicultureAfrique Agriculture. 1990. 176 : 9-33
3. ALEXANDER (D.J.). BRACEWELL (C.D.). GOUGH (RE.)Preliminary evaluation of the haemagglutination and haemagglutinationinhibition tests for avian Infectious Bronchites Virus.Av. Path.. 1976.5: 125-134
4. ALEXANDER (D.J.)Exprimental evaluation of the heamagglutination-inhibition test foravian Infections Bronchites Virus Proc conf. on Avian Adenorvirus andInfections Bronchitis.Central veto Laboratory. weybridge. 1977 : 5-12.
5. ALEXANDER (D.J.)Newcastle DiseaseCentral vet. Laboratory. PANVACAddis Ababa. 1991
6. ANDRADE (L.F.), VILLEGAS (P.). FLETCHER (O.J.)Vaccination of Day-old broilers against Infectious Bronchitis : Effect ofvaccine strain and route of administration.Av. Dis.. 1982. 27 (I) : 178-187.
7. ANSARI (AA). TAYLOR (RF.). CHANG (T.S.)Application of Enzyme-linked Immunosorbent Assay for detectingantibody to Mycoplasma gallisepticwn infectious in poultry.Av. Dis.. 1982. 27 (1) : 21-34
~...)
\\
\
\
-
8. BENNEJEAN (G.)Bronchite Infectieuse Aviaire (397-402)In : Diagnostic sro-immulogique des viroses humaines et animales.Paris : Maloine. 1974 : 581 p.
9. BENTON (W.J.). COVER (M.S.), ROSENBERGER (J.K.)Studies on the transmission on the Infections Bursal Agent (IBA) ofchickens.Av. Dis.. 1967. 11 : 430-438.
10. BERTI-IE (D.)Epidmiologie et prophylaxie des maladies Infectieuses aviairesmajeurs: Bilan et perspectivesThse Doct. Vt.. Dakar. 1987 N 4
11. BRION (A). FONTAINE (M.). FONTAINE (M.P.)Bronchite infectieuseRec. Md. Vt.. 1959. 135 : 435
12. BRUGERE-PICOUX (J.). SAVAD (D.)Environnement. stress et pathologie respiratoire chez les volaillesNotel: Facteurs physiquesRv. Md. Vt.. 1987. 138 (4) : 333-340.
13. BYGRAVE (AC.). FARAGHER (J.T.)Mortality associated with Gumboro diseaseVeto Rec.. 1970. 86 : 758-759
14. CHU (H.P.). RIZK (J.)The effect of maternaI immunity. age at vaccination and doses of livevaccines on immune response to newcastle Disease.Proc of Int. symp. on immunity to infection of the respirayory system inMan and AnimaIs. 1975 : 451.
"
. 1
\\
\\
-
\\
\\
15. COMPLEXE AVICOLE DE M'BAOProgramme de vaccination des poulets de chairCAM, Dakar. 1994
16. CONSTANTIN (A)La maladie de Gumboro ou bursite infectieuse du poulet et le vaccinPBG 98, Vaccin Gumboro Nobilis.Bull. Techn. Av. Nobilis, 1976 (1) : 12-13.
17. COS GROVE (AS.)An apparently new disease of chickens avian nephrosisAv. Dis, 1962, 6 : 385-389
18. COTE D'IVOIRE/Ministre de l'AgIiculture et des Ressources AnimalesDirection des Services Vtrinaires.La pathologie infectieuse et parasitaire en levage aviaire industriel enCte d'Ivoire.MARA. Abidjan, 1991
19. COTTEREAU (P.)Mycoplasmose respiratoire des volailles Epizootiologie, diagnostic,prophylaxieBull. Off. Int. Epiz., 1969, 72 : 293-322
20. CULLEN (G.A.), WYETH (P.J.)Quantitation of antibodies to Infectious Bursal DiseaseVeto Rec., 1975,97 : 315
21. DAVELAAR (F.G.), KOUWENHOVEN (B.)Influence of maternel antibodies on vaccination of chicks at differentages against Infectious BronchitisAv. Path., 1977.6: 41-51
-
22. DENNIS (M.J.)The efTects of temprature and humidity on sorne animal diseasesBrit. Veto J .. 1986. 142 (6) : 472485.
23. DENNIS (J.). ALEXANDERNewcastle DiseaseA Laboratory manual for the isolation and identification of avianpathogens.Am. Ass. of Av. Path. 3rd ed. 1989 : 114-120
24. DE WIT (J.J.). DAVELAAR (F.G.). BRAUNIUS (W.W.)Comparison of the Enzyme Linked Immunosorbent Assay. theHaemagglutination Inhibition test and the Agar Gel Precipitation testfor detection of antibodies against Infectious Bronchitis and NewcastleDisease in Commercial broUer.Av. Path.. 1992.21 : 651-658.
25. DIALLO (Y.H.)Contribution l'tude de la maladie de Gumboro au SngalThse Doct. Vt.. Dakar. 1978. N 5
26. DIOP (A)Le poulet de chair au Sngal : Production. commercialisation.perspectives de dveloppement.Thse Doct. Vt.. Dakar. 1982. N 8
27. DIOP (M.N.)La maladie de Marek au Sngal (A propos de l'observation despremiers cas dans la rgion de DakarrThse Doct. Vt.. Dakar. 1991. N 34
28. EDGAR (S.A.). CHO (Y.)Avian nephroris (Gumboro disease) and its control by immunizationPoult. sci.. 1965. 44 : 13-66