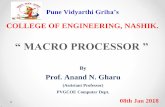Sur l'hypothèse de rationalité en théorie macro … l hypothese de rationalite en theorie... ·...
-
Upload
dangnguyet -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Sur l'hypothèse de rationalité en théorie macro … l hypothese de rationalite en theorie... ·...
Monsieur Edmond Malinvaud
Sur l'hypothèse de rationalité en théorie macro-économique.In: Revue économique. Volume 46, n°3, 1995. pp. 523-536.
AbstractToday the purpose no longer is to present justifications for the hypothesis but rather to study how it is used and how it might haveto be amended Rationality always followed by auxiliary assumptions proves to be inexact Knowing it most macroeconomists arein principle ready to revise their hypotheses if they see how to do it usefully and realisti cally Such stand is scientifically correctUp to now it did not lead to recommend paradigm- shift but to look for pragmatic solutions to inexactitudes For those solutions aswell as for the important aggregation problem what is learned from observation has to be taken into account from the firstspecification of the model
RésuméIl ne s'agit plus aujourd'hui de justifier l'hypothèse mais d'examiner comment elle est employée et doit être éventuellementamendée. La rationalité, toujours accompagnée de suppositions secondaires, s'avère inexacte. Face à ce constat, les macro-économistes dans leur majorité sont prêts en principe à modifier leurs hypothèses s'ils voient comment le faire de façon utile etréaliste. Une telle atti-tude est scientifiquement correcte. Jusqu'à présent, elle ne conduit pas à recom-mander un changementde paradigme mais à trouver des solutions pragmatiques aux inexactitudes. Pour ces solutions, comme pour le traitementessentiel de l'agrégation, les enseignements de l'observation doivent être pris en compte dès la première élaboration du modèle.
Citer ce document / Cite this document :
Malinvaud Edmond. Sur l'hypothèse de rationalité en théorie macro-économique. In: Revue économique. Volume 46, n°3, 1995.pp. 523-536.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1995_num_46_3_409658
Sur l'hypothèse de rationalité
en théorie macro-économique
Edmond Malinvaud*
// ne s'agit plus aujourd'hui de justifier l'hypothèse mais d'examiner comment elle est employée et doit être éventuellement amendée. La rationalité, toujours accompagnée de suppositions secondaires, s'avère inexacte. Face à ce constat, les macro-économistes dans leur majorité sont prêts en principe à modifier leurs hypothèses s'ils voient comment le faire de façon utile et réaliste. Une telle attitude est scientifiquement correcte. Jusqu'à présent, elle ne conduit pas à recommander un changement de paradigme mais à trouver des solutions pragmatiques aux inexactitudes. Pour ces solutions, comme pour le traitement essentiel de l'agrégation, les enseignements de l'observation doivent être pris en compte dès la première élaboration du modèle.
Classement JEL : B41
INTRODUCTION
La réflexion va porter ici sur un sujet ancien, mais qu'il convient de ne plus aborder aujourd'hui comme on le faisait autrefois. Pour illustrer le contraste, l'analogie à un rêve servira d'introduction.
E s'agit de deux conversations à propos d'un même couple, deux conversations à quarante ans de distance, mais que le rêve aurait rapprochées. Désignons les deux personnes en cause par leurs initiales : lui AR, elle RM. En 1960, la conversation roule sur le fait de savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre ; certains les voient destinés à s'unir et vantent les chances d'un futur foyer prospère ; d'autres prétendent que leurs caractères sont tellement antinomiques que ce serait folie ; d'autres, enfin, disent que la discussion est vaine, les choses étant déjà trop avancées. En l'an 2000, la conversation est un échange de nouvelles sur le couple uni depuis près de quarante ans ; à ceux qui l'avait perdu de vue, on raconte les joies et les difficultés de la vie commune, y compris la naissance, l'éducation et l'émancipation des enfants ; certains se demandent encore comment AR et RM ont pu ainsi former un foyer, avec tous les problèmes que leurs différences de caractère ont suscités ; d'autres essaient de montrer qu'ils ont profité de ces différences et qu'ils ont su trouver des compromis, certes boiteux mais viables ; bien sûr, il y a périodiquement des tensions ; les nouvelles, à cet égard, vont bon train ; mais personne ne parle de séparation.
Eh bien, ce rêve est révélateur du changement de perspective qui convient à notre sujet ! Pensez que lui, AR, est l'axiome de rationalité ; elle, RM, la recher-
* CREST-INSEE, 15 boulevard Gabriel-Péri, 92245 Malakoff Cedex.
523
Revue économique — vol. 46, n° 3, mai 1995, p. 523-536.
Revue économique
ehe macro-économique. Si cette communication s'était placée en 1960, j'aurais fait un plaidoyer pour que l'hypothèse de rationalité féconde la recherche macro-économique et je me serais efforcé de répondre de façon persuasive aux plaidoyers adverses faisant état de l' antinomie des caractères. Mais nous approchons de l'an 2000. Depuis longtemps, on a vu que la recherche ne pouvait pas se passer de l'hypothèse, mais aussi que celle-ci semait parfois le doute sur la validité des analyses et amenait avec elle une kyrielle d'hypothèses secondaires qui sont autant de sources de problèmes. Traiter aujourd'hui de l'axiome de rationalité, ce doit être se pencher sur l'aventure que vit de son fait la recherche macro-économique, avec tous les compromis que cette aventure comporte ; ce doit être, au fond, adopter une attitude plus proche de celle, positive, d'un historien que de celle, normative, d'un maître en méthodologie.
Cette perspective et cette attitude facilitent l'ouverture d'esprit, qui elle aussi convient au sujet. On n'utilise plus aujourd'hui en macro-économie l'hypothèse de rationalité exactement comme on le faisait autrefois. C'est bien naturel, puisque les problèmes se sont renouvelés et accessoirement aussi, puisqu'il a fallu accepter des compromis qui gagnent à être révisés à la lumière de l'expérience. Une évolution se manifestera encore dans l'avenir. Nous devons être prêts à la comprendre et à l'accepter. Je n'ai donc aucune gêne à imaginer que, dans dix ou vingt ans, cette communication puisse apparaître datée et qu'un autre économiste ait alors à procéder à une correction radicale de mes thèses1.
L'exposé va suivre un parcours un peu tortueux. Sans y insister, compte tenu de la perspective adoptée mais dans un souci de clarté, il rappellera d'abord pourquoi l'hypothèse a été acceptée (section 2) ; puis il cherchera à serrer de plus près sa définition (section 3) et à caractériser les hypothèses secondaires qui souvent l'accompagnent (section 4). On sait de mieux en mieux en quoi l'hypothèse est inexacte (section 5). L'inconfort qui en résulte n'est pas un désastre méthodologique (section 6) et il serait très prématuré de parler de renouvellement de paradigme (section 7). Des solutions pragmatiques sont possibles afin d'éviter les erreurs dont la source est bien identifiée (section 8). L'exposé se terminera en considérant fort naturellement le cas des anticipations rationnelles (section 9) et, d'une façon sans doute moins conventionnelle, en parlant des surprises de l'agrégation (section 10).
POURQUOI L'HYPOTHÈSE ?
Introduire une hypothèse dans une recherche scientifique, c'est restreindre le champ exploré par cette recherche, cela afin d'éviter des investigations inutiles
1. Ce texte peut d'ailleurs apparaître comme une actualisation des passages correspondants de mon cours de 1988 au Collège de France (publié dans Malinvaud [1991], un livre désigné par Voies dans les références qui suivront). L'actualisation doit peu au recul, qui m'aiderait à trouver des formulations plus heureuses de mes thèses, ou à la différence de contexte, qui me permettrait d'éviter les lourdeurs d'une présentation visant une audience de non spécialistes. Elle provient surtout de ceux des progrès récents de la recherche et de la réflexion qui ont attiré mon attention depuis cinq ans.
524
Edmond Malinvaud
et d'aboutir à des résultats mieux déterminés, quoique évidemment avec le risque de choisir une mauvaise voie, c'est-à-dire de se tromper. Or les résultats de la recherche macro-économique seraient beaucoup trop pauvres en l'absence d'hypothèses restrictives provenant de la connaissance des réalités micro-économiques. Cette connaissance elle-même tire parti de l'hypothèse de rationalité. Remémorons-nous les deux étapes de la justification ainsi donnée.
On a souvent eu la tentation d'établir la théorie macro-économique uniquement à partir de l'observation statistique des évolutions globales, sans aucune référence micro-économique.
Mais, outre que le monde économique ainsi observé obéit à des lois qui risquent de varier quelque peu à travers l'espace et le temps, les données disponibles ne proviennent pas d'expériences de laboratoire ; elles traduisent une réalité soumise à des influences diverses, complexes et incomplètement repérées. Il n'est donc pas surprenant que la recherche inductive, à partir de la seule histoire ou de la seule analyse des données, aboutisse à fort peu de conclusions générales.
Mais par rapport à ses collègues chercheurs des sciences de la nature, le macro-économiste a un avantage, celui de savoir comment l'activité économique est le fait de ménages, d'entreprises et d'organismes opérant à l'intérieur d'un cadre institutionnel connu. Cette connaissance directe, de nature microéconomique, est évidemment pertinente pour la compréhension de la croissance, du chômage ou de l'inflation. Il faut savoir l'exploiter correctement au niveau macro-économique1. En d'autres termes, la recherche doit tirer parti de références micro-économiques (Voies, p. 26-30).
Ces références concernent surtout les lois régissant le comportement des agents qui opèrent dans les économies de marché. Or les analyses un tant soit peu formalisées du comportement d'un agent suivent quasiment toutes la même démarche : elles explicitent les contraintes qui limitent l'autonomie de l'agent ainsi que les informations dont il dispose ; elles représentent l'objectif de l'agent ; enfin, elles posent l'hypothèse de rationalité : l'agent prend les décisions qui lui permettent d'atteindre au mieux son objectif.
L'objectif est quasiment toujours équivalent à la maximisation d'une fonction à valeurs réelles, une « utilité » ou un « profit », dépendant de variables dont les unes jc,- s'imposent à l'agent et les autres v, caractérisent ses décisions. La rationalité se traduit alors par le choix des valeurs des vy- qui maximisent la fonction. Les lois de comportement expriment comment ces valeurs optimales des yj varient en fonction des Xj (Voies, p. 106-108).
Les lois de comportement les plus simples ont été étudiées systématiquement dans la théorie micro-économique des prix et de l'allocation des ressources, par exemple pour construire le modèle d'équilibre général de concurrence parfaite.
1. Ainsi se trouve justifié le recours à au moins une forme faible de 1'« individualisme méthodologique », selon lequel l'explication des interactions (économiques ou sociales) doit se faire en termes de comportements individuels. (Ajouter à cette définition l'adverbe « uniquement » conduirait à l'individualisme méthodologique absolu, dont on ne trouve pas d'exemples en macroéconomie.) S'il faut aller chercher des éléments d'explication dans les comportements individuels ce n'est pas par dogmatisme philosophique, mais plutôt parce que, faute de cela, on ne réussirait pas à expliquer.
525
Revue économique
II arrive ainsi qu'une recherche macro-économique sur un thème particulier puisse directement emprunter à cette théorie certaines des références micro-économiques dont elle a besoin, voire toutes ces références. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Les macro-économistes ont souvent à travailler eux-mêmes sur les éléments micro-économiques de leurs systèmes. Un exemple suffira à le rappeler.
Le comportement d'épargne des ménages a d'abord paru résulter assez directement des lois de demande obtenues dans la théorie du consommateur achetant sur des marchés concurrentiels, la distinction entre effet de substitution et effet de revenu étant même éclairante pour faire apparaître comment l'épargne est susceptible de dépendre du taux d'intérêt. Mais, au fur et à mesure que le sujet était approfondi, il a fallu construire tout un appareil analytique à finalité macroéconomique : incorporer les contraintes de liquidité, caractériser la relation entre profil de l'épargne et profil des gains au cours du cycle de vie, considérer l'incertitude future et l'épargne de précaution, s'interroger sur l'effet de la transmission successorale, etc.
QUELLE HYPOTHÈSE PRÉCISÉMENT ?
La rationalité a été introduite ici comme une hypothèse positive sur le comportement effectif des agents. S'il convient de s'arrêter brièvement sur cette conception, c'est non pour l'amender mais pour éviter toute ambiguïté.
L'hypothèse a été définie comme la validité objective d'un type de représentation dans lequel l'agent est censé maximiser sous des contraintes. On ne cherchera pas à définir autrement la rationalité, car cela ne pourrait être que la source de déboires.
Il en résultera une imprécision de langage, qui est d'ailleurs commune en économie ; elle concernera la notion de « rationalité limitée » employée pour caractériser certains écarts par rapport à l'hypothèse, qui est alors dite stipuler la rationalité parfaite. Quand on parle de rationalité limitée, on entend signifier que l'agent n'a pas perdu le souci d'adapter ses décisions à son objectif mais qu'il n'y réussit pas parfaitement. Le concept peut rester flou tant qu'il s'agit de contester la rationalité parfaite. Au moment de proposer une théorie reposant sur une hypothèse alternative, il faudra préciser ; mais on n'entend pas préjuger comment, et cela pour des motifs qui nous apparaîtront compréhensibles (voir sections 7 et 8).
La rationalité de l'agent doit être bien distinguée d'une autre notion qui concernerait la rationalité du système économique. S'il faut être explicite à cet égard c'est en raison de l'histoire des doctrines économiques, et des préventions que cette histoire a suscitée, même à rencontre de l'idée que quiconque puisse être rationnel.
Comme on le sait, selon certaines doctrines économiques, le système des marchés permettrait à la collectivité d'atteindre au mieux ses objectifs économiques ; il serait en somme le système rationnel de gestion économique. Dans l'ensemble, la théorie macro-économique n'a pas véhiculé ces doctrines, puisqu'elle a insisté au contraire sur les dysfonctionnements que sont l'inflation et le chômage. Elles reçoivent cependant l'appui de certains prolongements de
526
Edmond Malinvaud
la théorie de la croissance, par exemple quand est avancée la thèse selon laquelle les fluctuations conjoncturelles constitueraient les réactions optimales aux chocs subis par l'économie.
Traiter de cette thèse n'est évidemment pas le sujet ici. Mais évoquer les constructions théoriques qui la justifient, c'est rappeler l'existence, en théorie macro-économique, d'une interprétation extensive de l'hypothèse de rationalité : elle s'appliquerait non seulement à chaque agent en particulier mais encore à ces entités abstraites que sont les « agents représentatifs ». Dans les cas extrêmes, on en vient à envisager un seul agent représentatif dont le comportement traduirait fidèlement l'effet de tous les comportements individuels et obéirait à l'hypothèse de rationalité, sa fonction objectif s 'identifiant à celle de la société.
À ce point de l'exposé tout au moins, il faut mettre complètement de côté cette extension de l'hypothèse de rationalité, dont on imagine aisément qu'elle puisse conduire très près de l'idée de rationalité du système économique. D est question uniquement du comportement individuel, les effets de l'agrégation n'ayant pas à intervenir avant la section 10 qui leur sera réservée.
UNE HYPOTHÈSE QUI NE VIENT PAS SEULE
Dans les pratiques de la recherche macro-économique, la rationalité des comportements individuels est accompagnée d'hypothèses secondaires que l'on ne saurait négliger lors de la réflexion méthodologique. Ces hypothèses se trouvent préciser de diverses façons le concept opératoire de rationalité qui est retenu dans chaque cas. Leur validité peut évidemment être mise en question. Si elles sont invalidées, il n'en découle pas que la rationalité en tant que telle soit en défaut ; elle en est cependant affectée puisque l'expression qui en est donnée s'avère irréaliste.
Sans chercher à être exhaustif1, on peut citer quelques hypothèses secondaires importantes. Dans le modèle théorique et, de façon plus critique, dans son application empirique, on suppose souvent la permanence des éléments de base de la spécification, par exemple de la fonction d'utilité. On restreint habituellement l'étendue des interactions en admettant que chaque agent n'est directement motivé que par les grandeurs relatives à sa propre activité, ainsi que par les données de l'environnement général ; on admet alors en quelque sorte l'égoïsme des agents2.
D'autres hypothèses s'exprimeraient mal en dehors de la spécification mathématique, par exemple celles permettant d'établir la détermination, l'unicité et la continuité des lois de comportement liant les y;- aux jc,. Il faut surtout citer l'hypothèse de von Neumann-Morgenstern selon laquelle le comportement face au risque pourrait se représenter par la maximisation de l'espérance mathé-
1. Voir aussi Voies, p. 109 et 113 à 121. 2. Rationalité plus égoïsme conduisent à une forme forte d'« individualisme
méthodologique », mais pas la plus forte concevable puisque la théorie pose habituellement des éléments globaux qui affectent les interactions : notamment les équilibres de marché et les décisions émanant du processus politique.
527
Revue économique
matique d'une fonction d'utilité. En effet, cette hypothèse est généralement retenue dans les nombreux développements théoriques où l'incertitude joue un rôle ; de plus, elle a été déduite d'axiomes censés traduire la rationalité des agents ; elle serait donc incorporée dans l'hypothèse de rationalité si on précisait davantage la définition retenue ici.
Moins souvent citées dans les écrits méthodologiques mais très importantes dans la recherche macro-économique, les hypothèses de séparabilité dispensent d'avoir à traiter simultanément tous les aspects des comportements. Grâce à elles, l'épargne d'un ménage peut être déterminée indépendamment de la composition de sa consommation et de celle de ses placements ; l'offre de travail peut être déterminée indépendamment de l'épargne, etc.
UNE HYPOTHÈSE INEXACTE
Des présomptions et des preuves permettent d'affirmer que l'hypothèse de rationalité, telle qu'elle est employée dans la recherche macro-économique, est inexacte. On s'en doute depuis longtemps et on le sait de mieux en mieux grâce aux progrès récents de l'économie expérimentale.
Les suspicions anciennes procèdent de trois idées. Premièrement, prendre pour données les objectifs des agents, c'est ignorer l'influence des facteurs qui façonnent les préférences et les besoins ; or des facteurs sociaux, et même économiques, interviennent pour influencer préférences et besoins. L'hypothèse de rationalité fait ainsi abstraction d'une partie des interactions qui devraient figurer dans une théorie englobante. Cette inexactitude devrait surtout préoccuper quand la théorie a l'ambition de s'appliquer aux phénomènes à long terme, surtout s'il s'agit de couvrir l'ensemble de l'évolution socio-économique, donc le développement plutôt que la croissance. Faut-il attribuer de l'importance à cette inexactitude dans les réflexions sur la méthodologie macro-économique ? Sans doute, mais il faut alors avoir aussi présentes à l'esprit les autres difficultés redoutables qui paralysent les efforts visant à la construction d'une théorie objective et opératoire du développement socio-économique.
Tant que leurs ambitions restent plus limitées, les macro-économistes ont peu de raison de s'inquiéter des changements dans les objectifs fondamentaux des agents (qu'il faut évidemment distinguer des changements dans leurs informations sur le contexte environnant et sur l'avenir).
Secondement, appliquer l'hypothèse de rationalité au comportement d'une entreprise, c'est négliger la multiplicité de ceux qui y travaillent et y prennent des décisions plus ou moins autonomes (la même remarque vaut, quoiqu'à un moindre degré, pour un ménage). L'hypothèse revient à supposer une cohérence interne des diverses décisions prises par l'agent abstrait identifié à F« entreprise ». Il s'agit d'une approximation dont les défauts apparaissent à ceux qui l'examinent de près, que ce soit empiriquement ou logiquement.
Troisièmement, s'agissant encore des entreprises, l'objectif retenu en macroéconomie s'identifie à la maximisation du profit (ou à une de ses transpositions naturelles en cas d'incertitude). Or on a souvent prétendu que nombre de dirigeants poursuivaient des objectifs quelque peu différents, par exemple la croissance de l'entreprise.
528
Edmond Malinvaud
Certes, on a aussi fait prévaloir que l'incohérence des décisions internes ou la poursuite de finalités autres que le profit ne pouvait jouer que dans les marges permises par la concurrence ; faute de quoi, l'entreprise disparaîtrait. Il en résulterait qu'aucune entreprise soumise à une concurrence ne pourrait perdre de vue l'effet de ses décisions sur ses bénéfices et que, pour beaucoup d'entreprises, la marge de manœuvre résiduelle serait faible, voire négligeable.
On sait, d'autre part, que l'économie expérimentale a fait l'objet d'importants travaux au cours des deux dernières décennies. Nombre d'entre eux concernent la rationalité du comportement individuel, notamment telle qu'elle est traduite dans les théories économiques. Des travaux précurseurs sont d'ailleurs encore aujourd'hui pertinents, tels que l'expérience conçue par M. Allais en 1952 et faisant apparaître un écart systématique par rapport aux axiomes de von Neumann-Morgenstern relatifs au comportement face au risque (voir Allais- Hagen [1979]).
Je connais trop mal l'ensemble des travaux expérimentaux pour prétendre en faire un résumé précis. On peut bien entendu dire qu'ils mettent souvent en défaut l'hypothèse de rationalité parfaite et qu'ils confirment l'idée de « rationalité limitée » ; mais cette dernière expression est trop peu définie pour vraiment renseigner. Il suffira sans doute ici de citer un témoignage portant sur le cœur du sujet et tirant la conclusion de nombreuses expériences.
« D'abord, les gens n'ont pas un ensemble préétabli de préférences pour toute éventualité. Les préférences sont plutôt construites au cours du processus conduisant à un choix et les procédures mises alors en œuvre influencent les préférences impliquées par les réponses exprimées. En termes pratiques, cela signifie que le comportement a des chances de différer entre des situations que les économistes considèrent comme identiques. » (Tversky-Thaler [1990], p. 210).
UNE ATTITUDE OUVERTE
Face à cela, que font les macro-économistes qui sont à la fois soucieux de progresser dans la connaissance objective des phénomènes et conscients de ce qu'ils doivent tirer parti de la modélisation des comportements ? En réponse à la question, je dirai que, dans leur majorité, ils adoptent une attitude réceptive, qu'ils sont prêts en principe à tenir compte des écarts par rapport à la rationalité s'ils voient comment le faire de façon utile.
Certes, une petite minorité existe encore, me semble-t-il, pour souscrire à la distinction de Pareto et pour prétendre que la science économique a à se préoccuper uniquement d'un des aspects des actions humaines, celui qui apparaît dans les actions rationnelles (dites « logiques » par Pareto), la sociologie étant censée s'occuper des autres aspects. La plupart des macro-économistes définissent autrement la frontière de leur domaine : ils se réfèrent aux phénomènes globaux, à expliquer et à influencer ; ils distinguent la catégorie des phénomènes économiques ; ils n'entendent pas limiter leur analyse aux effets d'une partie seulement des facteurs intervenant sur ces phénomènes. En conséquence, ils n'ont pas d'objection de principe à réviser leurs modélisations pour mieux tenu- compte des particularités de la rationalité limitée.
529
Revue économique
Au fond, la thèse exposée dans un ouvrage récent de méthodologie économique doit leur convenir (Hausman [1992]). Le philosophe Daniel Hausman a intitulé son ouvrage La science économique : inexacte et séparée1. Il résume sa thèse dans les termes suivants :
« Beaucoup des principes de base de l'économie peuvent être regardés comme des lois inexactes et les méthodes d'évaluation théorique que les économistes emploient en pratique sont scientifiquement acceptables. Mais il y a un autre aspect de la méthodologie économique que je ne défendrai pas : l'insistance de l'économie à se concevoir comme une science séparée. » (p. 1.)
Ce que Hausman entend par science séparée se comprend par référence à la définition de Pareto ; il écrit : « Bien qu'ils aient été incapables de tracer ainsi les limites de leur discipline, les économistes aiment considérer leur domaine comme celui des conséquences des choix rationnels dans un contexte de rareté. » (p. 3.)
S 'agissant des « lois inexactes », il s'agit de celles énonçant comment les choses seraient en l'absence d'interférences, ou encore de celles faisant intervenir de vagues clauses ceteris paribus. Parmi les hypothèses des lois inexactes figure le plus souvent la rationalité parfaite des agents, mais aussi suivant les cas telle ou telle hypothèse secondaire qui a l'avantage pratique de justifier un raisonnement mathématique (par exemple les rendements constants). La méthode deductive qui prévaut en économie pour l'analyse des comportements élémentaires n'impose pas le dogmatisme pour le maintien de ces hypothèses. Au contraire :
« Quand des expériences sont possibles et quand existent des alternatives sur lesquelles se reporte la crédibilité initiale de la théorie jusqu'alors acceptée, alternatives qui offrent de plus des avantages pragmatiques analogues, alors la méthode deductive de l'économiste lui recommande de changer de théorie » (p. 223).
J'interprète l'attitude de la grande majorité des macro-économistes comme conforme à cette recommandation. Ils n'ont pas un attachement dogmatique à l'hypothèse de rationalité parfaite ; ils s'intéressent aux résultats contraires de l'économie expérimentale ou de la théorie dite de l'organisation industrielle ; pour eux la question consiste à savoir s'ils peuvent tenir compte de ces résultats et comment.
UN AUTRE PARADIGME ?
Peut-on imaginer de remplacer la rationalité parfaite par d'autres hypothèses qui soient meilleures ? Peut-être ; mais ni les macro-économistes ni ceux qui se
1. L'ouvrage traite de la théorie micro-économique contemporaine, notamment de l'équilibre général. Il est ambigu sur le fait de savoir si les économistes ont d'ores et déjà une « attitude ouverte » ou si leur méthodologie devrait les y conduire. Traitant de théorie macro-économique, je crois être fondé à adopter l'interprétation positive de la thèse.
530
Edmond Malinvaud
penchent sur leur problèmes méthodologiques ne semblent envisager un véritable renouvellement de paradigme. Pensant surtout au gain possible en réalisme et accessoirement aux problèmes effectifs de la reconstruction théorique, ils doutent que l'on puisse faire plus que modifier au cas par cas la modélisation en y restreignant le rôle de la rationalité, et cela d'une façon adaptée à chaque cas, souvent d'ailleurs en jouant plus sur les hypothèses secondaires que sur la rationalité elle- même. Ce sont les solutions pragmatiques dont il sera question dans un instant.
Bien qu'il recommande aux économistes de ne plus concevoir leur discipline comme une science séparée et de mieux connaître les travaux des psychologues, des sociologues et des spécialistes de la science cognitive, Hausman écrit aussi :
« L'instabilité des comportements irrationnels et les effets éducatifs des théories de la rationalité portent à croire qu'une théorie qui décrit les individus comme se comportant rationnellement a plus de chance d'être vraie qu'une théorie qui les représente comme se comportant de façon irrationnelle. » (p. 279).
De même, après avoir exposé les preuves de l'irrationalité des comportements, Sen [1987] écrit : « L'irréalisme du comportement rationnel peut être grand, mais l'irréalisme de toute espèce particulière de comportement irrationnel pourrait être encore plus grand. » (p. 7 1.) Et plus loin :
« II ne sera pas facile de trouver des substituts aux hypothèses usuelles de comportement rationnel... qui figurent dans la littérature économique traditionnelle, à la fois parce que leurs défauts reconnus ont paru appeler des remèdes divergents, et aussi parce qu'il y a peu d'espoir de trouver un autre système d'hypothèses qui soit aussi simple et utilisable que les hypothèses traditionnelles de maximisation de l'intérêt personnel et de cohérence des choix. » (p. 72).
Sans doute convient-il d'évoquer aujourd'hui les éventuelles perspectives offertes par la théorie de l'évolution {evolutionary economics). Un actif courant de recherche prétend, en effet, expliquer la formation des préférences individuelles et des modèles mentaux sous-jacents à la rationalité limitée par un processus de sélection naturelle. La mode est lancée ; elle va sûrement tenir un certain temps. On pourrait être tenté d'y trouver un paradigme nouveau pour la représentation des comportements. De fait, Douglas North [1994] y a fait allusion, à côté d'autres voies, pour la construction d'une théorie future du développement, le sujet de sa récente conférence Nobel.
On conçoit qu'un historien, s'intéressant au temps long, à l'évolution des cultures, des normes et des institutions, souhaite attribuer une place à la sélection naturelle des caractéristiques individuelles et sociales les plus adéquates à la vie collective. Mais, clairement, cette sélection doit exiger de longs délais, même si elle opère autrement que par les processus biologiques qui retiennent les gènes les mieux adaptés. Les problèmes posés aux macro-économistes n'impliquent pas des durées comparables et ne peuvent guère être éclairés par une approche dont on comprend qu'elle inspire en revanche les recherches des anthropologue s .
SOLUTIONS PRAGMATIQUES
D ne saurait être question de passer en revue les solutions pragmatiques qui sont, ou pourraient être, adoptées pour mieux tenir compte des variations des
531
Revue économique
objectifs individuels ou des manques de rationalité des agents. Puisqu'elles diffèrent d'un cas à l'autre, elles sont potentiellement diverses et nombreuses. Afin de ne pas les passer totalement sous silence, on rappellera ici trois exemples où l'attitude ouverte et pragmatique des macro-économistes se manifeste : le rôle des habitudes et des références affectant les comportements, la séparabilité des décisions, le traitement des anticipations.
D'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, le contexte des comportements peut varier davantage que le présupposent les modèles de la théorie micro-économique. Conscients de cela, les macro-économistes peuvent altérer les lois de comportement déduites de cette théorie : les adaptations de la demande de travail aux fluctuations conjoncturelles peuvent être plus ou moins rapides et complètes suivant ce qui est perçu comme correct à cet égard par le public ; l'épargne d'un ménage représentatif peut dépendre d'un niveau de vie pris comme référence (hypothèse du revenu relatif, ou présence de retards d'adaptation traduisant la persistance des habitudes) ; etc.
Ainsi qu'on l'a vu, la séparabilité des divers aspects des comportements figure souvent parmi les hypothèses secondaires commodes auxquelles les théories macro-économiques ont recours. Ce n'est pas le sujet ici de discuter le réalisme des séparations ainsi introduites en pratique, même si on peut avoir des doutes à son propos à la lumière de certains travaux économétriques sur données individuelles. Au contraire, l'observation d'écarts par rapport à la rationalité parfaite justifie des séparations plus poussées que celles déduites de l'étude abstraite des comportements ; elle peut valider certains usages de la macro-économie appliquée.
Plus précisément, il est instructif de faire ici référence à un article de Thaler [1990] selon lequel on observe que les diverses ressources dont disposent les ménages sont moins fongibles les unes avec les autres qu'il résulterait de la rationalité parfaite admise par les théories du cycle de vie et du revenu permanent. Sans doute en vue de simplifier leurs décisions courantes ou de discipliner leur propre comportement, les ménages selon Thaler établiraient mentalement des caisses ou comptes distincts et s'imposeraient des règles pour l'affectation des ressources inscrites respectivement à ces comptes. Les règles seraient par exemple : premièrement, vis selon tes moyens, n'emprunte ni à ton « compte de patrimoine » ni à ton « compte de revenus futurs » pour augmenter ta consommation courante, sauf en cas d'urgences bien définies, telles qu'une période de chômage. Deuxièmement, verse à un « compte pour les mauvais jours » une proportion donnée de ton revenu. Troisièmement, économise pour ta vieillesse d'une façon aussi automatique que possible, par exemple en souscrivant à un plan de retraite, etc.
De telles règles contribueraient à expliquer pourquoi la consommation des ménages évolue si bien en concordance avec leur revenu disponible, beaucoup mieux que ne le prédisent les théories du cycle de vie et du revenu permanent (les contraintes le liquidité et l'incertitude sur le futur y contribuent aussi). Ces règles justifieraient que les équations d'épargne des modèles distinguent diverses sources de revenu et ne traitent pas les plus-values comme les revenus, et cela en allant au-delà de ce qu'impliqueraient les différences dans les volatilités des processus erratiques de ces ressources.
532
Edmond Malinvaud
LES ANTICIPATIONS
Faut-il appliquer l'hypothèse de rationalité à la formation des anticipations ? Si oui, comment ? Ces questions ont tant occupé la théorie macro-économique, et l'occupent tant encore, qu'on ne peut totalement les négliger ici. Mais il serait maladroit aussi de trop s'y attarder. C'est pourquoi on s'en tiendra à quelques affirmations simples, évidemment trop simples pour rendre compte de la complexité du sujet . La perspective sera encore une fois positive, malgré la forme normative donnée aux questions ci-dessus.
Il existe deux usages de l'expression « anticipations rationnelles », se référant l'un aux comportements effectifs, l'autre aux modèles théoriques. Selon le premier, les prévisions faites par un agent seraient dites rationnelles si elles tiraient le meilleur parti possible de toute l'information accessible à cet agent. À l'inverse, elles seraient adaptatives si elles extrapolaient les évolutions passées. Les deux types d'anticipations se distinguent si l'information publique est crédible et annonce sans ambiguïté un changement d'évolution. On peut ainsi tester laquelle des deux propriétés s'applique le mieux aux anticipations directement connues, par exemple grâce à des enquêtes systématiques. Les conclusions des tests économétriques s'expriment simplement : ni l'une ni l'autre des deux hypothèses ne semble traduire fidèlement les observations, qui restent sujettes à une notable variabilité inexpliquée.
La plupart des comportements ont des conséquences futures et ne peuvent donc pas être bien analysés sans considération des anticipations sur le contexte avec lequel ils interféreront. Ainsi, pour expliquer l'épargne d'un ménage, il est naturel de faire intervenir ses prévisions quant au flux de ses revenus disponibles futurs. En particulier, si un changement non prévu de la fiscalité est décidé, si ce changement doit affecter positivement les ressources disponibles du ménage, celui-ci doit rationnellement l'anticiper et réduire son épargne courante. En est-il bien ainsi dans les faits ? C'est un second thème de travaux économétriques, dont les conclusions ne sont pas encore parfaitement claires, mais incitent à reconnaître au moins un certain effet de ce type (Seater [1993]).
Face à de tels résultats économétriques, la solution pragmatique adoptée par la plupart des macro-économistes semble être de retenir explicitement ou implicitement des anticipations adaptatives mais de les amender quand il y a des raisons bien identifiées pour le faire, par exemple en cas de fort changement de l'environnement (forte hausse du prix du pétrole pour l'inflation) ou de la politique économique (fiscalité, désindexation, etc.).
Dans la théorie abstraite, l'expression « anticipations rationnelles » a un autre sens. Elle désigne un concept d'équilibre s'appliquant à un modèle dynamique dans lequel les valeurs présentes des variables endogènes sont influencées par les prévisions que les agents sont censés faire sur les valeurs futures de ces variables ; il y est supposé que les prévisions en cause coïncident avec ce que donne la solution du modèle pour ces valeurs futures. La validité de l'hypothèse est ainsi intimement liée à la validité de tout le modèle : non seulement les
1. Une complexité dont est bien rendu compte dans le livre de B. Walliser [1985].
533
Revue économique
agents doivent être rationnels, mais aussi le modèle doit correctement représenter le système économique auquel il prétend être applicable.
Ce concept logique joue un grand rôle dans toute la théorie économique moderne, notamment dans la théorie micro-économique. En macro-économie, il est intervenu surtout de deux façons. D'abord dans les modèles de croissance où il paraissait naturel : puisqu'il s'agissait de représenter des évolutions régulières de longue période, les agents vivant ces évolutions et en constatant les manifestations devaient être supposés capables d'en prévoir sans erreur la poursuite, leurs prévisions étant d'ailleurs alors aussi des anticipations adaptatives simples. Quand les modèles de croissance ont été généralisés pour s'appliquer aux fluctuations conjoncturelles, surtout par l'école dite « des cycles réels », l'hypothèse a été maintenue, quoiqu'elle apparaisse déjà moins naturelle.
Il faut surtout rappeler l'usage fait de l'hypothèse dans les années soixante- dix par ceux qui ont prétendu traiter de l'efficacité des politiques macro-économiques à l'aide de modèles extrêmement schématiques. Ne comprenant parfois que deux ou trois équations structurelles simples, les modèles en question aboutissaient bien à une détermination endogène des anticipations, mais ils le faisaient dans un cadre très spécial (Voies, p. 539-552). Beaucoup de lecteurs ont pu alors conclure que, finalement, la représentation des phénomènes était détériorée par rapport à celle qu'offraient les modèles théoriques supposant des anticipations exogènes mais traduisant par ailleurs mieux les structures du système économique. Fort heureusement, la mode de ce type de contributions semble passée.
LES SURPRISES DE L'AGRÉGATION
On ne doit jamais traiter de macro-économie sans penser à l'agrégation. Effectivement, appliquer l'hypothèse de rationalité à un haut niveau d'agrégation peut avoir un tout autre sens que l'appliquer à un agent pris isolément.
Jusqu'à ce point, mon examen a porté sur le comportement individuel et sur sa modélisation. L'étape suivante de construction de la théorie macro-économique doit être l'étude des effets globaux de tous les comportements individuels, sans doute d'abord celle des relations entre les grandeurs agrégées intéressant l'activité de tous les agents d'un même secteur, tous les ménages par exemple. Étudier de près cette étape n'est pas le sujet ici.
Mais il ne faut pas oublier les nombreux cas où, sans aucune considération des problèmes d'agrégation1, le raisonnement s'appuie sur un modèle dans lequel un ou quelques agents représentatifs remplacent la multiplicité des agents élémentaires et où l'hypothèse de rationalité est appliquée directement au comportement de ce seul ou de ces quelques agents représentatifs. Le cas d'un seul tel agent peut même être dit avoir une importance toute particulière s'il est
1. Ce n'est évidemment pas considérer les problèmes d'agrégation que de supposer les agents identiques à tous égards, de sorte qu'ils puissent être tous représentés par l'un quelconque d'entre eux.
534
Edmond Malinvaud
compris comme caractérisant le plupart des modèles théoriques modernes de la croissance, ainsi que ceux de l'école des cycles réels (il existe, certes, aussi dans ces modèles une activité de production transformant inputs en outputs dans les conditions les plus économiques possibles ; mais on peut à peine parler d'une entreprise représentative tant sa présence est passive).
On imagine aisément qu'il n'y a guère de différence entre supposer la rationalité du seul agent représentatif contenu dans un modèle macro-économique et supposer directement que le système économique lui-même se comporte au mieux, c'est-à-dire réalise les meilleures performances possibles. On rencontre alors une connotation parfois attribuée au mot rationalité en macro-économie : non plus seulement celle des agents considérés individuellement, mais celle des institutions régissant leurs rapports mutuels. Traiter de cette connotation, qui s'oppose à la perception de dysfonctionnements macro-économiques, n'est pas le sujet ici, ainsi qu'on l'a vu plus haut (section 3).
L'étude des effets de l'agrégation des comportements individuels est encore très incomplète. On le voit quand on constate qu'elle doit être reprise à chaque fois que l'on change un tant soit peu la représentation du système économique (Malinvaud [1981] et Voies, p. 209-218). Chaque théorie conduit ainsi à des propriétés spécifiques pour les agrégations qu'elle comporte. Il est rare que le raisonnement sur agents représentatifs apparaisse alors sûr en l'absence de preuves empiriques.
Pour le comprendre, il suffit de faire référence au problème qui a été le plus étudié, même s'il concerne d'abord la théorie micro-économique de l'équilibre concurrentiel et a été posé dans ce cadre. On sait que l'analyse des demandes de biens par un consommateur rationnel a dégagé quelques propriétés générales qu'aurait le système de ses lois de demande. Outre l'homogénéité et la loi de Walras, ces propriétés portent sur la « matrice de Slutsky ». Mais, en toute généralité, seules l'homogénéité et la loi de Walras subsistent pour le système des lois de demande agrégées qui s'expriment sur les marchés (Polemarchakis [1981]). Est-il alors arbitraire de poser des hypothèses plus spécifiques sur ces lois agrégées, comme on est amené à le faire par exemple pour démontrer l'unicité et la stabilité de l'équilibre ? Pas nécessairement ; s'il se trouve que la distribution statistique des caractéristiques individuelles est dispersée de façon suffisante et adéquate, on peut démontrer la validité au moins approximative des hypothèses en cause, et cela même sans supposer la rationalité individuelle (Grandmont [1992]). Le résultat est spécial, mais révélateur.
L'attention doit en effet se déplacer. Les travaux les plus fructueux portent non plus sur la seule étude formelle de l'agrégation, mais plutôt, en liaison intime avec elle, sur la prise en compte des propriétés observées des distributions statistiques des caractéristiques individuelles des agents et de leurs comportements. Le récent livre de Werner Hildenbrand [1994] démontre parfaitement l'efficacité de cette méthode.
Ainsi faut-il conclure ce tour d'horizon en insistant sur la combinaison indispensable entre observation et réflexion analytique. Contrairement à ce que l'on a souvent prétendu, cette combinaison ne s'effectue pas exactement en deux temps : celui de la construction abstraite d'un modèle et celui de son estimation à l'aide de données. Déjà, dans l'élaboration du modèle, la prise en compte pragmatique de l'observation intervient. On le voit en particulier quand on examine la place et la forme de l'hypothèse de rationalité.
535
Revue économique
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Allais M. and Hagen O. eds [1979], Expected Utility Hypothesis and the Allais Paradox, Dordrecht, Reidel.
Grandmont J.M. [1992], « Transformation of the Commodity Space, Behavioral Heterogeneity, and the Aggregation Problem », Journal of Economic Theory, juin.
Hausman D. [1992], The Inexact and Separate Science of Economics, Cambridge, Cambridge University Press.
Hildenbrand W. [1994], Market Demand, Princeton, Princeton University Press. Malinvaud E. [1981], Théorie macroéconomique, Paris, Dunod. Malinvaud E. [1991], Voies de la recherche macroéconomique, Paris, Odile Jacob. Les
références sont ici aux pages de l'édition de poche, collection « Points », série Économie, E33, Paris, Le Seuil, février 1993.
North D. [1994], «Economie Performance Through Time», American Economie Review, juin.
Polemarchakis H. [1981], «Rationalité, observabilité et agrégation», Cahiers du séminaire d'économétrie, n° 22.
SEATER J. [1993], « Ricardian Equivalence », Journal of Economie Literature, 31 (1), mars.
Sen A. [1987], « Rational Behaviour », dans Eatwell and al., The New Palgrave, vol. 4, Londres, Macmillan.
THALER R. [1990], « Saving, Fungibility and Mental Accounts », Journal of Economie Perspectives, 4(1).
Tversky A., Thaler R. [1990], « Anomalies : Preference Reversal », Journal of Economie Perspectives, 4 (2).
Walliser B. [1985], Anticipations, équilibres et rationalité économique, Paris, Cal- mann-Lévy.