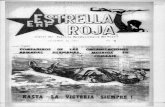RAPPORT DE CONJONCTURE - cnrs.fr · Pour contrer une vision re´ductrice et line´aire de la...
Transcript of RAPPORT DE CONJONCTURE - cnrs.fr · Pour contrer une vision re´ductrice et line´aire de la...
2006
RAPPORT DE CONJONCTUREdu Comité national de la recherche scientifique
Interdisciplinarité
CNRS EDITIONS15, rue Malebranche – 75005 Paris
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:58 - page I (1)
’ CNRS - SGCN, Paris, 2008ISBN : 978-2-271-06748-7
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page II (2)
Sommaire
Préface V
Introduction VII
Commission interdisciplinaire 42 – Santé et société 1
Commission interdisciplinaire 43 – Impacts sociaux des nanotechnologies 7
Commission interdisciplinaire 44 – Modélisation des systèmes biologiques, bioinformatique 23
Commission interdisciplinaire 45 – Cognition, langage, traitement de l’information, systèmes naturels etartificiels 31
Commission interdisciplinaire 46 – Risques environnementaux et société 55
Commission interdisciplinaire 47 – Astroparticules 63
Index des auteurs 71
Adresse Internet : http://www.cnrs.fr
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page III (3)
III
Préface
Avec ses departements et ses instituts, le CNRS couvre l’ensemble des champs scientifiques.Cette specificite fait de lui le seul organisme francais a pouvoir lancer et soutenir des operationspluridisciplinaires et interdisciplinaires sur une palette tres large de thematiques. La pluridiscipli-narite, deja largement mise en œuvre, reunit, autour d’objectifs bien identifies, des chercheurs dedisciplines distinctes qui apportent leurs concepts et leurs methodes. C’est ainsi que le CNRS peutfaire dialoguer concepts et technologies de pointe et traiter de grandes questions de societe tellesque l’energie, l’environnement ou la biodiversite.
Mais pour explorer des voies nouvelles, faire emerger des idees et des concepts originaux auxinterfaces entre les disciplines, il faut promouvoir des demarches non conventionnelles, innovanteset comportant souvent une part de risque. Il faut faire travailler ensemble des chercheurs d’horizonsdifferents. C’est la finalite declaree des Commissions Interdisciplinaires (CID) que de favoriserl’emergence de nouveaux champs de recherche a l’intersection de plusieurs competences disci-plinaires. Veritables pepinieres, les CID permettent le recrutement et la promotion de chercheursqui prennent, avec des specialistes d’autres disciplines, le risque de la construction en commun denouveaux objets d’etudes.
Au cours du Colloque du Comite National de la Recherche Scientifique sur l’Interdisciplinariteen 1990, Edgar Morin insistait sur « l’etonnante variete des circonstances qui font progresser lessciences en brisant l’isolement des disciplines », notamment par « l’emergence de nouveauxschemes cognitifs et de nouvelles hypotheses explicatives », et par la « constitution de conceptionsorganisatrices qui permettent d’articuler les domaines disciplinaires dans un systeme theoriquecommun ». Dans le cadre de dynamiques nouvelles, les CID soutiennent, au-dela des interactionsentre specialistes et de l’enrichissement mutuel, un veritable decloisonnement disciplinaire, quicommence a porter ses fruits dans les directions evoquees par Edgar Morin.
Temoin, cette edition du rapport de conjoncture des CID qui met en valeur ces demarchescomplexes grace auxquelles le CNRS renouvelle sa capacite a faire avancer le front de la connaissance.
Elisabeth GiacobinoChargee de mission pour l’interdisciplinarite
aupres du Directeur general du CNRS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page V (5)
V
Introduction
INTERDISCIPLINARITÉ, UNE NÉCESSITÉ OU UNE MODE?
Le CNRS est tout particulierement bien arme pour impulser et mener a bien des recherchesinterdisciplinaires. Une premiere approche vers l’interdisciplinarite proposee par le groupe dereflexion mis en place par la precedente direction du CNRS (1) a consiste a explorer une frontiereentre deux ou plusieurs disciplines en favorisant l’acces a une culture plurielle grace a des forma-tions adaptees et/ou a des contacts etroits entre chercheurs des differentes disciplines. Cetteapproche passe par une appropriation collective des concepts et des methodes, et peut conduirea l’emergence d’une nouvelle discipline grace a une synergie des apports des deux disciplines dedepart. Elle se joue en general sur le moyen ou le long terme. Dans ce qui suit, nous insisterons surune autre approche qui consiste a repondre a une question complexe d’origine scientifique et/ousocietale, en mobilisant des specialistes de plusieurs disciplines qui vont definir et construireensemble leur programme interdisciplinaire.
1 – L’INTERDISCIPLINARITÉ, UNE NÉCESSITÉ,PAS UNE DIRECTIVE
Au-dela de l’idee que « l’interdisciplinarite correspond a cette volonte de confronter, d’articu-ler, voire d’integrer, pour un objet ou un but commun de recherche » (2), nous proposons de poserle probleme a l’envers, et de ne pas partir d’une volonte « a priori » de construire de l’interdisci-plinarite. La mise en œuvre de l’interdisciplinarite devrait correspondre a une reelle necessite soitscientifique, soit societale (3). Ainsi, il ne faudrait en aucun cas forcer l’interdisciplinarite (« l’orga-
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page VII (7)
VII
nisme a pour devoir d’inciter, il ne peut evidemment contraindre » (4)), ne pas faire de la reactionpar rapport a de la pro-action qui, elle, est justifiee. Faire « des ponts internes aux disciplines » (5) aun interet si on doit traverser une riviere et non simplement pour construire un nouveau pont au-dessus de cette riviere. L’interdisciplinarite ne doit donc pas se construire a partir de paradigmesdogmatiques qui peuvent rapidement engendrer des appauvrissements scientifiques.
Mais, si les disciplines constituent des categories fondamentales du savoir, elles ne peuventpas toujours repondre aux demarches scientifiques internes, ni encore moins a la demande externe.La particularite des propositions d’interdisciplinarite, c’est de devoir repondre soit a des besoinsscientifiques (autour d’un objet), soit a une demande societale (autour d’une application). Il s’agitde repondre a une question. Il ne faut faire appel a l’interdisciplinarite que lorsqu’elle est indis-pensable (« Le but commun de recherche, le projet, la question scientifique, constituent le point dedepart et non la finalite » (6)). Ainsi, le but de la recherche doit etre de faire avancer le front dusavoir et de la connaissance et non de viser a accroıtre le nombre de nouvelles disciplines.
2 – LE CONCEPT D’INTERDISCIPLINARITÉ RÉVISÉ
Le concept d’interdisciplinarite ne saurait se reduire aux sciences de l’environnement, memesi, par essence, celles-ci se developpent sur des bases interdisciplinaires (7). La creation d’unnouveau departement « Environnement et Developpement Durable » au CNRS a permis de poserles enjeux de l’interdisciplinarite de maniere concrete. Avant meme de se demander si noussommes dans un processus de pluri, d’inter ou de transdisciplinarite, il convient de revenir a ladefinition meme du concept d’interdisciplinarite avec des exemples concrets et quelques propo-sitions preliminaires.
2.1 MISE EN ŒUVRE DU CONCEPT D’INTERDISCIPLINARITÉ
La mise en œuvre du concept d’interdisciplinarite ne s’exprime pas necessairement par lavision lamarckienne d’une evolution sequencee pluridisciplinarite-interdiciplinarite-transdiscipli-narite (8). Aussi, il convient d’insister sur le fait que la mise en œuvre du concept d’interdisci-plinarite ne doit pas etre strictement politique et ne pas constituer un instrument de controle dupouvoir. Le passage « obligatoire » de pluri a inter et enfin a transdisciplinarite sur une echelle de20 ans est une vision etatiste des choses, comme s’il fallait necessairement viser la transdisciplina-rite. Ce modele devrait etre revisite pour eviter l’echec.
En fait, l’interdisciplinarite se pose en opposition a la pluridisciplinarite, et c’est la ou se situentles veritables enjeux. L’interdisciplinarite s’inscrit dans une volonte commune de collaboration et deconfrontation de concepts et de methodes des la conception de chaque projet scientifique. Il s’agitde repondre a une question scientifique commune ou partagee, pas de servir de vernis a unprogramme construit par quelques specialistes d’une unique discipline. C’est ensemble que leschercheurs issus des differentes disciplines doivent definir et construire leur programme interdisci-plinaire. De ce fait, l’interdisciplinarite ne correspond et ne doit correspondre en aucun cas a unprogramme interdepartemental. Pour contrer une vision reductrice et lineaire de la demarchescientifique, il convient d’eviter de generaliser la distinction inter/pluri/transdisciplinarite qui ne
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page VIII (8)
VIII
peut fonctionner en realite que dans des cas assez rares (comme, par exemple, la physico-chimieou les sciences de l’environnement) mais plutot tendre vers la notion de couplage disciplinairefaible ou fort.
2.2 2.2 LES BESOINS DÉCLENCHENT L’INTERDISCIPLINARITÉ– QUELQUES EXEMPLES CONCRETS
Il convient donc etre pragmatique et de demontrer a quel point des besoins reels vont appelertout naturellement a l’interdisciplinarite. L’interdisciplinarite au CNRS peut etre developpee a partird’objets de recherche bien identifies et surtout qui soient susceptibles de reunir des chercheursvenus d’horizons varies. L’interdisciplinarite est, avant toute chose, la recherche d’une expertisecollective exercee par les competences necessaires reunies pour aborder un probleme complexe,ce que l’on pourrait appeler une question scientifique multiple (9). Plusieurs exemples eloquentsde besoins ayant declenches des projets interdisciplinaires peuvent etre proposes :
– La psycho-acoustique est un bon modele de fonctionnement de l’interdisciplinarite bienque couvrant un champ de recherche tres specialise. Elle est a la frontiere de trois disciplines detrois champs distincts, l’acoustique pour les sciences « dures », la physiologie pour les sciences duvivant et la psychologie pour les sciences humaines.
– Le SIDA, constituant un reel probleme a la fois societal et medical, a beneficie d’une avanceconsiderable grace a une pratique de l’interdisciplinarite nee sur les recherches reunissant desdisciplines tres variees (virologie, epidemiologie, sociologie, anthropologie).
– « Les villes a l’heure des changements climatiques » constitue un theme de recherche faisantintervenir l’interdisciplinarite et non pas un programme intitule « Environnement et villes », dont letitre vague ne pose pas de vraie question scientifique.
2.3 LE VOLONTARISME PLURIDISCIPLINAIRE
On ne decrete donc pas l’interdisciplinarite. Nous insistons sur cette notion de couplage faibleou fort, lie a la resolution d’une question scientifique, qui peut etre ponctuelle, et pas necessaire-ment mener a l’interdisciplinarite, et encore moins a la transdisciplinarite. C’est pourquoi, parler deproblematiques, d’objets de recherche interdisciplinaires parait plus exact que parler d’interdisci-plinarite. Certains concepts pourtant a priori transversaux, comme, par exemple, celui de santeenvironnementale, ne font pas forcement appel a l’interdisciplinarite. L’interdisciplinarite corres-pond donc bien a la reunion voire au mariage de disciplines sur un projet. L’interdisciplinarite n’estpas definie/dirigee/obligee, il s’agit bien de repondre collectivement a une question scientifique etnon de bricoler quelques elements disparates pour aller dans le sens de la mode du temps. Cepartage ne devrait pas etre dirige par l’un ou l’autre des acteurs en presence. Un projet interdisci-plinaire doit emerger a partir d’un mode collegial de fonctionnement, etre le fruit d’une visioncommune ou tout du moins partagee, de facon consensuelle. Il s’agit de se confronter collective-ment a un probleme. En aucun cas l’interdisciplinarite ne pourra etre une reussite si elle se fait avecdes matelots qui besognent a la pluridisciplinarite et un capitaine pretendant « orchestrer » l’inter-disciplinarite.
INTRODUCTION
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page IX (9)
IX
L’interdisciplinarite est intimement liee a ce qu’Edgar Morin appelle la « complexite » (10)d’une question. Les questions scientifiques portant sur des problemes suffisamment complexesnecessitent une reflexion interdisciplinaire (11), comme, par exemple, le probleme societal desbanlieues francaises. Sur le plan de la formation a la recherche, a cote d’un enseignement disci-plinaire classique, l’interdisciplinarite doit aussi se preparer en tant que culture scientifique des leMaster recherche.
3 – LE CNRS, CREUSET UNIQUE POUR RÉALISERL’INTERDISCIPLINARITÉ
La France possede une structure de recherche remarquable qui se nomme le CNRS et qui peut,a un niveau national et international, influencer les dynamiques de recherche. Cette structure estpar essence pluridisciplinaire et peut donc etre visionnaire au niveau de l’interdisciplinarite. Il s’agitdans la pratique quotidienne du scientifique de mettre en place, a partir d’un objet, un projetcommun de recherche, mais seulement si c’est necessaire. Le role du CNRS n’est pas de faire del’ideologie sur ce sujet. Il doit contribuer a accroıtre le savoir, meme si celui-ci est tres disciplinaireet/ou hyper specialise, car sa finalite n’est pas de faire emerger de nouvelles sciences mais de faireemerger de nouveaux savoirs. Notre role est donc de documenter le pourquoi de l’interdiscipli-narite dans un domaine precis.
Le developpement d’une culture de projet devrait etre un des principaux points de depart etun justificatif de poids du besoin d’interdisciplinarite. Le Programme MOUSSON est un bon exem-ple d’interdisciplinarite et sa puissance de reflexion est a prendre en compte. Ainsi, il s’agit de nepas faire de proselytisme, mais d’identifier en priorite les champs emergeants. Ceci permettra a larecherche francaise d’eviter de pietiner et de continuer d’etre competitive sur la scene internatio-nale. Cette reconnaissance passe par une action federative des disciplines, ce qui constitue uneregle a suivre. Si le theme « Ville et mobilite durable » est revendique comme un probleme majeur,mettons-nous ensemble pour l’aborder ! N’oublions enfin jamais l’urgence qu’il y a a faire de vraisbilans et surtout une veritable evaluation de ces projets interdisciplinaires.
Groupe de travail « Interdisciplinarite »du Conseil scientifique du CNRS
Pierre Alart, Gilles Boetsch, Franco Brezzi,Christian Gorini, Marc Lucotte et Daniel Mansuy.
Notes
(1) Le Queau D. et al., Promouvoir l’interdisciplinarite au CNRS, Paris, CNRS, 2005.
(2) Ibid.
(3) Facilitating Interdisciplinary Research, National Academy of Sciences, National Academy of Engineering and Institute ofMedicine of the National Academies, Washington DC, The National Academies Press, 2005.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page X (10)
X
(4) Le Queau D. et al., op. cit.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Grand Challenges in Environmental Sciences, National Research Council (NRC), Report from the Committee on Grand Chal-lenges in Environmental Sciences, Washington, DC, National Academy Press, 2001.
(8) Le Queau D. et al., op. cit.
(9) Morin E. L’intelligence de la complexite, Paris, L’Harmattan, 1999.
(10) Ibid.
(11) Complex Environmental Systems : Synthesis for Earth, Life and Society in the 21st Century, Report from the Advisory Committeefor Environmental Research and Education, Arlington, VA : National Science Foundation, 2005.
INTRODUCTION
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page XI (11)
XI
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 42SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Président de la CIDJean-Paul MOATTI
Membres de la CIDJean-Paul AURAY
Simone BATEMAN-NOVAES
Christelle BAUNEZ
Manuel BOUVARD
Martine BUNGENER
Martine CADOR
Claude CASELLAS
Franck CHAILLAN
Benoît DERVAUX
Olivier DUTOUR
Farid EL MASSIOUI
Philippe ENCLOS
Laurent FASANO
Christian GROSS
Yves LÉVI
Jacques MILLET
Christophe TIFFOCHE
INTRODUCTION
Au cours des dix dernieres annees, lesSciences Humaines, Economiques etSociales appliquees a la sante (SHES-S)ont connu, au plan international, un develop-pement rapide. Certaines tendent (notammentanthropologie de la sante, economie de lasante, psychologie et psychosociologie de lasante, sociologie de la sante) a se constitueren champ disciplinaire a proprement parler,dote d’une autonomie relative forte par rapporta leur discipline de reference, avec ses societessavantes internationales, ses Congres inter-nationaux (qui rassemblent des milliers departicipants) et ses revues specialisees dontcertaines atteignent des Impact Factors signifi-catifs (1). Dans d’autres disciplines de SHES, ilexiste des creneaux de developpement bienetablis et structures pour les applications a lasante et a la medecine (droit et sante, sociolo-gie des sciences appliquees a la biomedecine,histoire de la medecine, sociologie politique dela protection sociale, etc.). Par ailleurs, onconstate une montee en puissance des publi-cations de SHES dans les meilleures revuesbiomedicales.
Ce dynamisme s’alimente d’abord decelui des differents champs scientifiquesconcernes mais tout autant de l’importancedes enjeux economiques, culturels et sociaux
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 1 (13)
1
lies a la sante que les SHES peuvent contribuera eclairer :
– le poids croissant des interets econo-miques lies a l’industrie pharmaceutiqueet biotechnologique, qui demeure le secteurle plus profitable au plan international, avec labranche des assurances, en depit du ralentisse-ment regulier du nombre de molecules nou-velles mises sur le marche ainsi que de leurdegre d’innovation (2) ;
– la place de plus en plus centrale que la« culture du risque » tend a occuper dans lavie quotidienne des societes contempo-raines (3) ;
– la mise sur l’agenda politique d’unnombre croissant d’enjeux de securite sani-taire et les crises de sante publique qui leursont souvent associes (4) ;
– l’internalisation croissante, dans les pra-tiques de soins et dans l’organisation des sys-temes de sante, des contraintes de maıtrisede la croissance des depenses de sante ;
– la tendance a la « chronicisation »du risque maladie sous les effets du vieil-lissement demographique, de la prevalencecroissante des maladies chroniques et des han-dicaps associees a l’age, ainsi que, simplement,des avancees de la science biologique et duprogres medical ;
– la montee en puissance du « consume-risme » en matiere de sante, liee a l’elevationdes niveaux d’education et d’acces aux techno-logies de l’information des populations, quipeut alimenter a la fois les mouvementssociaux de patients et leur revendication d’unplus grand partage de l’information et de ladecision medicales, l’integration dans les poli-tiques publiques de la lutte contre les inegalitesd’acces aux soins et d’etats de sante (5) commel’extension des creneaux de marche relevantdu champ sanitaire.
CONJONCTURE NATIONALE
L’un des avantages comparatifs, au planinternational, des premiers travaux francais enSHES-S dans les annees 1960/80, dont la lignedominante se referait au concept de socio-eco-nomie de la sante, etait justement d’avoiraffirme une telle demarche doublement inter-disciplinaire. Celle-ci a favorise, dans le champde la sante, une confrontation plus pousseeentre les differentes SHES que dans la plupartdes autres champs appliques, et elle a permisd’attirer l’attention sur plusieurs specificites desproblemes et systemes de sante, dont les para-digmes dominants dans ces disciplines ne per-mettaient pas de bien rendre compte. Cettedynamique initiale a neanmoins fini par s’epui-ser car elle a entretenu une certaine deconne-xion des recherches francaises en SHES de lasante par rapport aux recherches internationa-les du domaine (et du coup une sous-represen-tation dans les publications scientifiquesinternationales) ainsi que par rapport aux« avancees » theoriques les plus recentes enSHES (6). Il en a decoule, au cours des dixdernieres annees, de facon variable maisconvergente selon les domaines, une tendancede plus en plus marquee des chercheurs a s’ef-forcer a un retour vers les « fondamentaux » desdisciplines de SHES. Outre l’amelioration de laqualite et de la quantite des publications quiont accompagne ce mouvement, cette demar-che s’est, la encore, revelee fructueuse a denombreux titres dont on ne peut bien sur pasfaire ici la liste exhaustive.
A titre d’exemples, les recherches en eco-nomie de la sante inspirees de la theorie del’agence et des contrats ont revele les limitesdes politiques de maıtrise des depenses priori-tairement fondees, comme en France, sur lecontrole malthusien de l’offre, et renouvelel’approche des specificites de la relation mede-cin/patient qui tendent a rendre inoperantesles solutions classiquement proposees aux pro-blemes d’asymetries d’information dans lecadre des marches (7). Toujours en economiede la sante, la mise en relation des travauxd’evaluation economique de strategies medi-
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 2 (14)
2
cales avec le cadre de reference de l’economiedu bien-etre (welfare economics) et de l’ana-lyse cout-benefice (8) permettent de lever lesnombreuses ambiguıtes methodologiques quiavaient pu presider a l’introduction du calculeconomique dans ce domaine (9). De meme,les references a la sociologie des professions eta la sociologie des organisations ont apporteun eclairage indispensable a la comprehensiondes mecanismes de regulation des systemes desante et d’evolution de l’hopital moderne,comme la theorie des representations enpsychologie sociale a celle des discordancesmaintes fois constatees entre attitudes etcroyances d’une part, comportements effectifsde sante d’autre part. L’approche anthropolo-gique, quant a elle, a etendu son champ depreoccupations aux pratiques et representa-tions des personnels de sante et au fonctionne-ment des structures de soins, privilegiantdesormais l’analyse de la rencontre (et souventde la confrontation) des « agendas » respectifsdes patients, de leur entourage, des soignantset des acteurs institutionnels, nationauxcomme internationaux, de la sante. En droit,en histoire, et en philosophie (entre autresautour des reflexions soulevees par la bio-ethique), des champs specialises sur lesenjeux de sante ont emerge de facon signifi-cative.
Au plan pratique, comme l’ont revele lesconcours chercheurs de la CID 42 en 2005/2006, il existe desormais un important vivierde jeunes post-doctorants et chercheursdans la plupart des disciplines de SHESqui se specialisent en sante et qui peinenta trouver des debouches statutaires leur per-mettant de perenniser leur investissement dansce champ.
Cette evolution des dix dernieres anneesa pu cependant entretenir une certaine insuffi-sance de rapprochement entre des equipes (etdes chercheurs) de SHES-S mettant a profitleurs liens avec les disciplines biomedicales(au travers notamment de l’INSERM ou de cer-tains departements de sante publique des UFRde Medecine), et d’autres equipes (notammentCNRS) demeurant rattachees a des laboratoires« generalistes » de SHES et eprouvant certaines
difficultes a penetrer en profondeur et de faconperenne le terrain de la sante. Comme au planinternational, elle alimente desormais unrisque d’autonomisation excessive dessous-champs de recherche en SHES de lasante qui pourrait conduire a sacrifier la perti-nence (scientifique et concrete) des recherchesa un souci de pure sophistication methodolo-gique « en soi » (10). Tout en maintenant l’enra-cinement fort dans chacune des disciplines dereference, il faut aujourd’hui renouer avec lesacquis d’interdisciplinarite qui caracteri-saient les debuts des SHES-S, en particulierdans notre pays.
S’inscrivant dans la continuite du pro-gramme interdisciplinaire « Sciences Biomedi-cales, Sante et Societe », la creation de la CID42 Sante & Societe du CNRS constitue uneinnovation strategique majeure, qui va au-delade l’organisme lui-meme, dans la mesure ou,pour l’instant et pour la premiere fois enFrance, elle constitue le seul lieu institutionnelqui rend possible une double interdisciplina-rite : entre les equipes SHES specialisees ensante et celles qui demeurent « generalistes »d’une part, entre les SHES et les sciences dela vie d’autre part. Sauf a envisager une gene-ralisation de cette double demarche (dans lecadre de l’AER ?) par la mise en place d’uneinstance analogue mais commune a l’ensembledes EPST concernes (CNRS, INSERM, IRD,INRA, etc.), sa poursuite paraıt d’autant pluscruciale que la conjoncture internationale,theorique et pratique, des SHES-S met a l’ordredu jour la relance d’une nouvelle interdiscipli-narite.
S’agissant des thematiques qui permettentla mise en œuvre de cette nouvelle interdisci-plinarite, elles peuvent etre regroupees autourde deux axes :
1. Dechiffrer les interventions sur levivant, analyser la genese et l’impact sur lasociete des innovations biomedicales :
– les progres de la biomedecine et desapplications biotechnologiques qui lui sontliees contribuent a modifier en profondeur lesrepresentations du vivant, les pratiques profes-sionnelles et de recherches concernees et, plus
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 42 – SANTE ET SOCIETE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 3 (15)
3
largement, les rapports entre sciences biome-dicales, medecine et societes. Ces progresaffectent les definitions memes de la personnehumaine et les grandes categories anthropo-logiques des differentes cultures (vie, genre,filiation, douleur, mort, etc.). Ils bousculentcertaines dimensions fondatrices du fonction-nement economique et de l’ordre social ;
– les SHES ont un role important a jouerpour dechiffrer les modalites par lesquellesl’ensemble des technologies nouvelles (tantbiomedicales que d’information et de commu-nication), tendent a modifier les rapports a lasubjectivite et a l’identite, les conceptions desoi et du corps comme des mecanismes essen-tiels de la regulation economique et sociale(systemes d’assurance maladie, etc.). Au plansocial, certaines de ces possibilites techniquesinterviennent directement sur les frontieresentre des categories que l’on pouvait jusquela considerer comme intangibles : frontieresentre la vie et la mort (reanimation assistee,soins palliatifs) ; de la parente (fecondation invitro, clonage) ; entre le normal et le patholo-gique (vieillissement, depression) ; entrel’homme et l’animal (xenogreffes) ; entre cequi releve du marche et du secteur public ousolidaire. Souvent porteuse d’amelioration del’etat de sante, l’accessibilite a ces nouvellestechnologies peut neanmoins induire de nou-velles formes d’inegalites et de discriminationsentre differents groupes sociaux, entre paysriches et pays pauvres, et implique e toutefacon des arbitrages complexes entre impera-tifs de sante publique, efficacite economique etjustice sociale (acces aux medicaments dans lesPED, brevetabilite des genes, etc.).
2. Saisir les nouvelles formes de la « medi-calisation », et leur impact sur les groupes etsolidarites sociales :
– les limites de ce qui constitue les do-maines privilegies de la prise en charge par la
medecine ont toujours repondu a la fois a unelogique scientifique et a une logique sociale.Ces limites se deplacent aujourd’hui rapide-ment sous la pression conjuguee des progresde la biomedecine (en particulier en genetiqueet en imagerie) d’une part, des mutations socio-economiques qui affectent la stabilite de l’em-ploi ainsi que les systemes de redistribution etde protection sociales. Cette double pressionest exacerbee par le vieillissement demogra-phique, et l’augmentation du nombre des per-sonnes vivant avec une maladie ou/et unhandicap chronique (ou contraintes de suivredes traitements medicaux a vie ou de longueduree) ;
– au-dela de la diversite des groupesconcernes (personnes agees, accidentees dela vie ou handicapees de naissance, personnesa risque genetique ou comportemental depathologies lourdes, etc.), les SHES doiventcontribuer aux debats, en renouvellement per-manent, sur la definition des notions de nor-malite et de therapeutique ainsi que sur lesformes d’intervention sanitaire et les types depolitiques publiques censees repondre auxbesoins de ces personnes. Comme le confirmela mise en place par l’OMS d’une Grande Com-mission sur les « Determinants Sociaux de laSante », faisant suite a un exercice similaire sur« Macroeconomie & Sante », la question de lapersistance d’inegalites sociales face a la santeet a l’acces aux soins demeure centrale. LesSHES, en interdisciplinarite avec les sciencesde la vie, sont essentielles pour mieux com-prendre les chapines causales complexes quiconduisent a ces inegalites qui ne se limitentpas aux effets directs des determinants socio-economiques de base. Enfin, les transforma-tions des relations entre les professionnels desante et les patients qu’ils prennent en chargesont a la croisee d’evolutions multiples que lesSHES peuvent, mieux que toutes autres disci-plines, contribuer a decoder.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 4 (16)
4
Notes
(1) Par exemple, Journal of Health Economics, Social Science& Medicine, Health Affairs, Milbank Quarterly, Health Psycho-logy, American Journal of Public Health, Annals of BehavioralMedicine ont des IF compris entre 2,5 et 3,5.
(2) Angell M. The truth about drug companies. RandomHouse, New-York, 2004.
(3) Beck U. Risk Society, Towards a New Modernity. SagePublication, London, 1992.Giddens A. Modernity and Self-Identity. Stanford UniversityPress, Los Angeles, 1991.Peretti-Watel P. Sociologie du risque. Armand Colin, Paris,2000.
(4) Noiville C. Du bon gouvernement des risques. PUF, Paris,2003.Setbon M., Raude J., Fischler C., Flahault A. Risk perception ofthe « mad cow disease » in France : determinants and conse-quences. Risk Analysis, 25, 2005, Pages 813-826.Bagayoko-Penone N., Hours B. (Eds.) Etats, ONG et productiondes normes securitaires dans les pays du sud, Paris, L’Harmat-tan, 2005.
(5) Renault E. L’experience de l’injustice. Reconnaissance etclinique de l’injustice. La Decouverte, Paris, 2004.
(6) Pour l’economie de la sante, voir : Benamouzig, D. La santeau miroir de l’economie. PUF, Paris, 2005.Pour la psychologie de la sante, voir : Morin, M. Parcours deSante, Armand Colin, Paris, 2004.
(7) Rochaix L. Asymetries d’information et incertitude ensante : les apports de la theorie des contrats. Economie & Pre-vision 1997, 129-130 : 11-24.
(8) Dreze N., Stern N. The theory of cost-benefit analysis.Handbook of Public Economics, Vol. II,, North Holland, Ams-terdam, Pages 909-986, 1987.
(9) Carrere M.O. Preface. In Drummond M.F. et al. Methodesd’evaluation economique des programmes de sante. Econo-mica, trad. fr., Paris, 1998.
(10) Par exemple, lorsque les conferences du Health Econo-mics Study Group britannique presentent des dizaines decommunications sur les methodologies de revelation des pre-ferences face a des choix de santetout en negligeant totale-ment des sujets comme ceux de la propriete industrielle etde l’innovation pharmaceutique ou de l’organisation hospi-taliere.
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 42 – SANTE ET SOCIETE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 5 (17)
5
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Président de la CIDDominique VINCK
Membres de la CIDAline AUROUX
Pierre BEAUVILLAIN
Gilles BERTRAND
Patrick BOISSEAU
Dominique BOULLIER
Jean-Pierre DJUKIC
Jean-Marc DOUILLARD
Hugues DREYSSE
Marc DRILLON
Giancarlo FAINI
François GUILLEN
Gérard HELARY
Philippe LAREDO
Louis LAURENT
Patrick SCHMOLL
André TOUBOUL
André VIOUX
L’emergence des nanosciences et desnanotechnologies amorce des transformationsdu paysage scientifique et industriel. Cher-cheurs, decideurs publics et prives, auteursde science-fiction comme opposants entre-voient un bouleversement de l’industrie etdes modes de vie. En France comme a l’etran-ger, le debat public comme les travaux deschercheurs en sciences sociales en viennent aidentifier une serie de questions majeurespour la societe en termes de regulation desdynamiques scientifiques, technologiques eteconomiques. Ces regulations concernentl’evaluation, la maıtrise des risques, l’inte-gration des nouvelles technologies comme ladefinition de priorites societales.
Le phenomene est egalement accom-pagne d’exagerations (hype) en termes defabuleuses promesses liees a ces nouvellesconnaissances et technologies ainsi que decraintes correlatives suscitees par ces exagera-tions. Craintes et exagerations sont autant lefait de scientifiques, d’institutions, de roman-ciers, d’entreprises que de mouvements poli-tiques ou citoyens. Si leurs fondementssont generalement sapes par les experts, quitendent a minimiser les unes comme lesautres, elles suscitent neanmoins des reac-tions sociales, politiques et economiques (parexemple, en termes de comportement d’achat)qui generent, a leur tour, des peurs de la partdes investisseurs industriels, des decideurspolitiques et des institutions de recherche.
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 7 (19)
7
Depuis les annees 2000, s’expriment une seriede reactions et des mouvements d’opposition,y compris des boycotts et des deplacements depreferences economiques. Le phenomenen’est certainement pas passager ; tout indiquequ’il sera constitutif, dans la duree, de la dyna-mique socio-scientifique, technique et indus-trielle des nanosciences et nanotechnologies.
Diverses institutions ont deja reagi en ras-semblant des experts et des commissions et enproduisant des rapports sur les risques, l’eva-luation et la mise en forme des technologies :OPECST, DG sante et consommateur, assu-reurs de Suisse, nanoforum, Academie dessciences, Royal Society et Royal Academy ofEngineering (1), NSF, etc. La reconnaissanceinternationale du besoin de se pencher surles questions liees a la sante, a l’environne-ment, a l’economie et a la societe ne fait nuldoute. Les principaux plans de developpementdes nanotechnologies dans le monde pre-voient explicitement d’integrer ces questionsdans les programmes de recherche a pro-mouvoir, par exemple, le Plan strategiquedeveloppe par le National Science and Tech-nology Council des Etats-Unis (NNI) (2) ou lePlan pour l’Europe 2005-2009 de la Commis-sion europeenne (3). Les institutions initientaussi diverses formes de dialogue science –societe (voir par exemple ce qui est realisedans le cadre du reseau EPTA (4)).
Par ailleurs, des equipes, des reseaux etdes programmes de recherche (en sciencessociales, toxicologie, metrologie, etc.) commen-cent a se structurer sur le plan international(pays anglo-saxon et Nord de l’Europe). Leschercheurs sont egalement convoques pour ali-menter l’aide a la decision, l’evaluation cons-tructive des choix technologiques (constructivetechnology assessment aux Pays-Bas), le debat etla mise en place d’un systeme de regulation pla-netaire (par exemple, leBureau consultatif inter-national pour une nanoscience responsable).
Les enjeux societaux sont manifestementde grande ampleur tant sur le plan econo-mique que politique. Ils sont lies aux besoinsde legitimer les choix technologiques et indus-triels, voire d’en debattre, de normaliser lesproduits, les technologies et les instruments
de mesure, d’harmoniser les moyens d’actionainsi que de limiter les usages la ou le compor-tement du produit est imprevisible et potentiel-lement dangereux. Il s’agit aussi d’informer, deprevenir, de surveiller et d’alerter, de legaliser,de reguler (regulation economique, politique,societale, ethique) pour proteger les marches,les consommateurs et les citoyens. Il en va ducontrole par la societe des dynamiques socio-economiques qui s’engagent. La question sepose de savoir comment les gouvernementset les institutions pourront traiter les impactssocio-economiques, environnementaux etsanitaires sans decourager l’exploration desperspectives benefiques.
1 – LA QUESTION DES« IMPACTS SOCIAUX » DES« NANOTECHNOLOGIES »
La CID 43 « Impacts societaux des nano-technologies » est supposee contribuer a laconstitution d’un milieu de recherche enmesure de traiter avec rigueur les questionssocietales nouvelles liees aux nanosciences etnanotechnologies et a produire la connais-sance de base utile a la reflexion collective eta la prise de decision. Dans ce contexte, lafaiblesse numerique de la recherche francaiseen toxicologie, en epidemiologie et en sciencessociales dans le domaine est remarquable. Enexplicitant sa vision des enjeux de la recherchedans le domaine, la CID 43 entend contribuerau renforcement d’un tel milieu de recherche.
1.1 « IMPACT » ?
La CID 43 est intitulee « Impacts societauxdes nanotechnologies ». Toutefois la notiond’impact est problematique. Elle est critiqueedepuis longtemps dans les sciences socialesparce qu’elle laisse entendre que les change-
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 8 (20)
8
ments observes seraient la consequencedirecte des caracteristiques intrinseques desnouvelles technologies. Cette causalite a large-ment ete mise en cause tant les mecanismes al’œuvre qui conduisent a tel ou tel effet identi-fie sont varies et parfois complexes. Les effetsobserves s’expliquent autant par la nouveauteintroduite que par la maniere de l’introduire,par la facon dont les multiples acteurs impli-ques s’en emparent et par les effets pragma-tiques produits par leurs anticipations. De lameme maniere, il est malsain de reduire lesprogrammes de recherche dans le domaine aune forme de prediction des impacts ; predic-tion d’ailleurs d’autant plus difficile que lesexperts eux-memes (scientifiques et industrielsnotamment) ne sont pas en mesure de definirprecisement a quoi serviront reellement lesnanotechnologies. Le domaine est large etmal defini. Les applications imaginables sontinnombrables et beaucoup ne verront jamaisle jour parce que les acteurs, economiquesnotamment, feront necessairement des choix.L’evaluation globale des impacts est donc par-ticulierement compliquee. Elle suppose des’appuyer sur un solide fond de recherche enmesure de qualifier les processus a l’œuvre ;elle suppose aussi d’etre reconduite demaniere reguliere au fur et a mesure que seprecisent les developpements scientifiques ettechnologiques.
Au lieu de traiter des « impacts sociaux », latendance dominante dans les programmes derecherche internationaux et dans les instancesde regulation est plutot de s’interroger sur lesenjeux et sur l’inscription societale des nano-technologies. Il s’agit de comprendre les meca-nismes a l’œuvre et de preparer la mise enplace des regulations societales qui devraientpermettre de tirer effectivement profit (entermes de benefices pour l’humanite) de cestechnologies, tout en minimisant les risques,dommages et inegalites. Les nouvelles techno-logies ne s’imposent pas d’elles-memes. Lamajorite des inventions ne deviennent d’ail-leurs jamais des innovations. Pour qu’elless’inscrivent effectivement dans les pratiques,elles supposent que soient engagees diversestransformations de la nouveaute technolo-gique – qui ne rencontre pas d’emblee les inte-
rets des acteurs dans la societe – et de la societe– qui doit, par exemple, transformer ses reglesde droit, ses organisations et les competencesdes individus.
Sur le plan de la recherche, la question estaussi de comprendre la maniere dont les cher-cheurs peuvent integrer dans leur travail cettepreoccupation de l’insertion societale desnanotechnologies. L’histoire des sciences etdes techniques nous enseigne que les cher-cheurs ne sont pas insensibles a leur envi-ronnement et integrent partiellement lespreoccupations et les modes de raisonnementcontemporains, mais que cette articulationpourrait etre optimisee. La mise en œuvred’espaces de travail interdisciplinaire contri-bue a faire porter la reflexion au cœur de larecherche, par la realisation d’un couplage plusetroit entre les questions societales et les ques-tions scientifiques et technologiques. La ques-tion se pose donc de comprendre les processusde traduction et d’endogeneisation des ques-tions societales au sein des communautesscientifiques, des institutions et des laboratoires.
1.2 « NANO » ?
Le terme « nanotechnologie » fait aussidebat dans la communaute scientifique. Apart le fait de se referer a l’echelle du nano-metre (les dimensions inferieures au micron),l’eventail et la specificite de ce que recouvre leterme est loin de faire l’objet d’un consensus.Certains restreignent le domaine aux nano-objets et aux phenomenes associes (y comprisl’interaction entre les nano-objets) tandis qued’autres y incluent tous les objets dont aumoins une des dimensions est nanometrique.Le flou de la definition est encore accru auniveau des nanotechnologies qui renvoient ades assemblages et a des systemes dans les-quels les nano-objets ou les objets dont unedes dimensions est nanometrique ne sontqu’un element parmi d’autres. De meme lesavis sont tres partages sur leur caracteredisruptif : activite seculaire (comme la chimie)« relookee », evolution naturelle pour certains,
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43 – IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 9 (21)
9
revolution pour d’autres. Au flou de ces defini-tions s’ajoute un phenomene collectif dans lemonde des sciences qui se traduit par l’inflationdu recours au terme « nano », en vertu d’effetsde mode, de visibilite recherchee et d’argu-mentaire destine a convaincre les instances etpartenaires qui soutiennent la recherche. Lameme extension se retrouve aussi tres large-ment au niveau des debats publics ou les« nanos » recouvrent un large ensemble d’objetsheterogenes (poudres, nano-machines, etc.) ycompris des objets qui, jusqu’a ce jour sontplutot des microsystemes (par exemple, lesRFID).
Dans ce debat semantique, certains cher-chent a specifier et a delimiter le domaine cequi conduit a faire sortir du debat toutes uneserie de questions : exit les questions de res-pect de la vie privee avec le RFID, exit lesquestions de toxicite qui ne sont pas nouvelles(reference aux particules submicroniques de lasilicose, de l’asbestose ou des emitions desmoteurs Diesel). Or, qu’elles soient specifiquesaux nanos ou pas, qu’elles soient nouvelles oupas, ces questions se posent ou se reposent apropos des nanotechnologies. Il est du devoirdes chercheurs de ne pas les evacuer. Les« nanos » peuvent aussi etre envisageescomme un cas d’ecole qui permet de revisiterdes questions importantes.
Les nanos posent des questions de cate-gorisation (encore plus que dans le cas dudeveloppement des OGM) dont la resolutiondevrait aider a structurer des priorites et desprogrammes de recherche specifique, parexemple, en fonction des differentes genera-tions de nanotechnologie : nano-structurespassives, nanostructures actives, nanosystemesintegres et nanosystemes moleculaires hetero-genes. Ces differentes technologies correspon-dent probablement a des enjeux et des risquesde natures differentes. Le domaine des nano-technologies etant evolutif, la reflexion sur lacategorisation et sur les priorites devra elle-meme etre evolutive et integree dans le pilo-tage des programmes de recherche.
Les debats publics, de toutes les ma-nieres, auront probablement des conse-quences pour les organismes de recherche,
comme c’est deja le cas a l’etranger. Une ins-titution comme le CNRS sera sollicitee pourfaire progresser les connaissances la ou il y ades interrogations ainsi que pour offrir unebase d’expertise independante. Personne necomprendrait que le CNRS ne se preoccupepas de ces questions.
2 – LES DOMAINESDE RECHERCHE
ET LEURS ENJEUX
Les scientifiques s’accordent a considererles nanotechnologies comme un domaineprometteur pour traiter quelques-uns des prin-cipaux enjeux de societe actuels : le develop-pement de solutions alternatives aux energiesfossiles, la protection des ressources en eau(depollution), le developpement durable, leprogres medical (vectorisation de medica-ments, biopuces), le developpement de solu-tions pour le stockage, la transmission etl’affichage de l’information, etc.
Le probleme majeur est de reussir l’in-scription des nanosciences dans la societe.Cette inscription societale se heurte a des ques-tions et a des incertitudes majeures pour les-quelles nous manquons de connaissance :incertitudes sur les objets (nanoparticules,nanodispositifs, etc.) et leur comportement,sur la toxicite et les risques, sur les fonctionna-lites et usages, sur les modeles de developpe-ment industriel, sur les nouvelles modalites del’organisation du travail scientifique, sur la geo-politique et les regulations a l’echelle plane-taire, sur la reaction des marches et descitoyens.
La recherche au CNRS devrait fournir lesbases scientifiques necessaires permettantd’anticiper les developpements et les questionsqui se posent afin d’etre en mesure d’accompa-gner le mouvement. Le CNRS et ses membressont deja sollites pour participer aux debatspublics. Il pourrait se donner les moyens de
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 10 (22)
10
construire des programmes de recherche surles questions qu’un debat public ne sauraitsuffire a trrancher. Ainsi, il sera probable-ment interpelle sur des questions telles que :comment sont decides les programmes derecherche ? Qu’a-t-on le droit d’explorer et dequelle facon (encadrer les recherches par ledroit, inventer de nouvelles procedures demo-cratiques pour en decider) ? Comment travailleren laboratoire pour proteger les personnels derecherche ? Quelles procedures mettre en placepour les nouveaux produits ? Que mettre enplace pour suivre la competition internationale(moyens financiers, humains, organisationnels,cooperations europeennes et internationales,cooperations avec les SHS) ? Il convient aussid’aider la communaute des nanosciences etnanotechnologies a se construire sa proprereflexivite et capacite de pilotage des trajec-toires d’innovation. Les sciences sociales ontmontre que se construisent des « chemins dedependance technologique » qui restreignentl’eventail des possibles orientations de re-cherche (par exemple, sur des solutions non-nano). La question se pose des lors, pour lagouvernance des programmes de recherche,de la facon de se donner les moyens d’assurerun pluralisme des choix technologiques etd’eviter les verrouillages precoces sur des tra-jectoires technologiques irreversibles.
Les principaux domaines de competence,directement concernes par ces questions, sontla toxicologie, l’epidemiologie et les sciencessociales (droit, economie de l’innovation, ges-tion, histoire des techniques, sciences poli-tiques, sociologie).
2.1 LA DANGEROSITÉDES NANOPARTICULES
ET DES NANODISPOSITIFS
Concernant les nanoparticules, il estprobable que leur production pour des appli-cations diverses va croıtre. Institutions pu-bliques et assureurs, ainsi qu’une partie de lacommunaute scientifique ont identifie qu’il y
avait urgence pour l’etude de leur dangerosite.Les industriels hesitent a s’engager dans undomaine ou les risques (responsabilite enga-gee vis-a-vis des employes et des clients, rejetpotentiel et retournement des marches) sontencore trop eleves. De meme d’autres indus-tries comme les materiaux, la cosmetiquedeviennent objet de doute. Il n’y aurait deve-loppement industriel que si les risques sontconnus et maıtrises. Plusieurs institutions ontdonc engage des processus d’expertise colle-giale et d’etat de l’art sur les risques connus etsur les nouveaux risques potentiels. Il est una-nimement reconnu que la nanotoxicologie estun large domaine de recherche encore tresfaiblement explore ; les donnees manques, lesmodeles d’analyse sont insuffisants. Le prin-cipe de precaution est appele a etre observepour longtemps tandis que des chercheursappellent de leurs vœux une collaborationscientifique internationale sur ces questions.
Plusieurs possibilites de financement dela recherche existent aujourd’hui dans les payseuropeens tandis qu’un appel a proposition aete lance dans le cadre du 6e PCRD de l’Unioneuropeenne. Une recherche fondamentaleen amont est engagee au niveau national eteuropeen. Elle porte sur la detection, sur lareactivite des nanoparticules ainsi que sur l’in-teraction nanoparticules – organisme vivant.
Toutefois, la communaute scientifiquereste encore tres reduite et meriterait d’etrerenforcee, meme si les quelques laboratoiresactifs dans le domaine ont pris l’initiative dese coordonner et de travailler en reseau – ini-tiative qu’il convient de saluer et de soutenir. Ledomaine s’etend de la toxicologie a la detec-tion, en passant par la caracterisation, neces-saire pour produire des connaissances de base,qui releve de la chimie et de la physique. Lesmethodes de protection (filtres, dosimetrie)font egalement partie du lot.
Les notions de dangerosite et de risqueconcernent non seulement des problemes detoxicite, mais plus generalement d’activite etd’interactivite avec les systemes vivants, lesecosystemes et les etres humains pour lesquelsles modeles d’analyse sont encore insuffisants.
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43 – IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 11 (23)
11
La reponse europeenne (CTEKS,2004) (5) preconise de definir les projets nano-technologiques en fonction des indicationsfournies par des disciplines comme l’ecologie,la geographie et la sociologie. Les enjeux geo-politiques sont tels qu’ils exigent la construc-tion d’un dialogue a l’echelle internationale,supporte par des programmes de recherche.Avec les nanotechnologies, les decideurs poli-tiques sont amenes a revoir les cadres d’exper-tise et d’elaboration des choix scientifiques ettechnologiques, avec la mise en place d’unedemocratie technique qui œuvre plus enamont que par le passe. Le probleme est d’in-venter les cooperations transdisciplinaireslocales et transnationales permettant de pro-mouvoir l’interet general. Une institutioncomme le CNRS devrait etre en mesure dejouer un role pionnier dans ce domaine.
Concernant la toxicologie, il y a un deficitmanifeste en France, qu’il s’agisse de la chimieou des nanotechnologies, alors qu’il y a uneforte demande societale (en 2005 et 2006, iln’y avait que 2-3 projets ANR sur le sujet). LeCNRS pourrait toutefois contribuer a asseoir labase de connaissances dans ce domaine (toxi-cologie, detection, protection) en se renforcantet en structurant l’effort de recherche. Sa neu-tralite est precieuse dans une situation poten-tiellement controversee, mais cette neutralite estaussi fragile et menacee dans un contexte ou lesequipes sont egalement poussees a la collabo-ration avec les industriels. Le probleme estd’imaginer des mecanismes faisant que ses tra-vaux soient credibles pour les divers acteursconcernes, y compris le grand public. Or, laaussi les inconnues sont grandes ; nous connais-sons encore mal les mecanismes a l’œuvre et lesprocessus de construction de la credibilite dansla societe. Des reponses au moins partielles sontla redondance (y compris au niveau Europeen)et peut etre aussi une reflexion sur des proto-coles specifiques garantissant confrontation,tracabilite et controle externe.
La question des protections se pose a tousles niveaux :
– en entreprise : comment doivent tra-vailler les personnels de la recherche et lesemployes dans les entreprises du secteur ?
Faut-il aller jusqu’a imposer des laboratoiresou des unites de productions avec des en-ceintes confinees (a l’image de ce qui existeen chimie ou en biologie) pour avoir le droitde manipuler certaines nanoparticules ? Si oui apartir de quels seuils ?
– pour decider de certaines voies derecherches delicates, peut-on se satisfaire dedispositions generales ? Faut-il des comites adhoc (d’ethique) pour aborder ces questions aufur et a mesure qu’elles se poseront et pourdefinir les dispositifs operationnels appropries(par exemple, une police interne a la sciencecomme dans les NIH) ?
– pour le public : quelle normes, quellereglementation ? Faut-il un dispositif calquesur la chimie, sur l’industrie du medicament ?
2.2 L’INSCRIPTION SOCIÉTALEDES NANOTECHNOLOGIES
Les sciences sociales ont un role impor-tant a jouer dans l’elucidation des mecanismeset des processus d’inscription et de regulationsocietale des produits des nanosciences et desnanotechnologies. Le succes ou l’echec desinnovations est largement conditionne pardes processus collectifs dans lesquels inter-viennent de multiples acteurs (industriels,legislateurs, medias, citoyens, associations,etc.). Il importe d’en comprendre les mecanis-mes : analyse des representations sociales etdes formes de mediation, structuration de nou-velles elites professionnelles et sociales, ana-lyse des formes de regulation (economiques,politiques et societales), analyse des processusde transformation des nanoobjets suivant lesattentes de la societe, analyse des processusd’emergence de nouveaux groupes sociauxconcernes.
La constitution et l’implication d’unecommunaute de recherche en sciences socialesest largement reconnue comme importantepour aider a comprendre les dynamiques al’œuvre et les mecanismes de legitimation des
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 12 (24)
12
choix technologiques et industriels. Il s’agitd’accompagner les processus de normalisationdes produits et technologies ainsi que la limi-tation des usages, pour ameliorer la vigilancesocietale et mesurer les effets des mecanismesde regulation economique, politique, societaleen termes de protection des consommateurs etdes citoyens. Les grandes questions qui seposent sont, en particulier, les suivantes :
Comprendre les mécanismesde régulation et leurs effets
Le developpement des nanotechnologiesconstitue un bouleversement important de l’in-dustrie et de la societe qui ne peut etre laisse alui-meme tant sont eleves les risques (sanitaire,environnementaux, respect des libertes et de lavie privee, etc.). Scientifiques, politiques, indus-triels et citoyens s’accordent pour appeler deleurs vœux une certaine regulation. Or, lesmecanismes de regulation des innovations tech-nologiques majeures sont encore tres malconnus. Ces regulations sont variees (droit,administrations et action des inspecteurs, regle-mentations et normalisations de toutes sortes,depot de plaintes et leur traitement par la justice,role des assureurs, des consultants, des modesmanageriales et des grands corps de l’Etat, debatet discussion, etc.) et le genre d’effet qu’ellesproduisent dans la duree reste a elucider. Unimportant champ de recherche pluridiscipli-naire devrait etre impulse sur ces questions.Seraient directement concernes historiens,sociologues, politistes, economistes et juristes.Des travaux de recherche en histoire, parexemple, pourraient porter sur la regulation dephenomenes technologiques comme l’implan-tation de l’industrie chimique, de l’eclairage augaz ou le controle des machines a vapeur (voirles travaux du centre Koyre). L’histoire fourniune grande gamme d’experiences qui permetde faire varier les parametres et de montrer leseffets de certains phenomenes difficiles a dece-ler dans le contemporain.
Il serait egalement pertinent d’explorerles possibilites de construction de systemesde regulation et de gouvernance plus en
mesure d’anticiper et de faire preuve d’intel-ligence sociale : etude des formes institu-tionnelles et organisationnelles et ce qu’ellesproduisent dans la duree. Il convient parexemple d’etudier les effets dans la duree(sur l’innovation, les risques, l’equite, la dyna-mique des marches, etc.) des differentesmanieres d’interpreter et de mettre en œuvrele principe de precaution.
Des questions se posent, y compris dansle domaine des brevets, concernant la norma-lisation et la protection de nouveaux objetsdont les proprietes ne sont pas necessairementreproductibles.
Les nanotechnologies etant convoqueesdans des projets qui touchent au vivant, al’etre humain et au cerveau (y compris l’ideed’une amelioration de l’etre humain), ilconvient de tirer les lecons de passe quantaux diverses modalites de regulation des tech-niques qui touchent a l’humain (deviances despersonnes, derives sectaires, usages commer-ciaux et derives societales).
Parmi les questions que l’on voit se pro-filer pour l’avenir, nous retiendrons a titred’exemple :
– l’irruption des nanotechnologies dansl’alimentation (nanofood) et la demande dereflexion sur la regulation dans ce domaine ;
– l’emergence de materiaux ou de proce-des a base de nanoparticules et la question dece qui est legitime ou non de faire (par exem-ple en termes de « nanoremediation » des solspollues) ;
– l’association entre developpement desnanotechnologies, developpement durable etequite ;
– l’exploration de la frontiere d’humanite.Avec les xenogreffes et l’hybridation de dispo-sitifs techniques intelligents dans le corpshumain, les conceptions anthropologiquesclassiques de l’humanite sont remises encause et, avec elles, les fondements des reperesnormatifs de l’action. Les problemes soulevespar les acteurs portent notamment sur la cons-truction d’etres hybrides, les risques sanitaires
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43 – IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 13 (25)
13
et les risques lies a l’industrialisation et a lamise en marche des pratiques innovantes.
Toutes ces questions impliqueront desdebats scientifiques et de societe pour la cons-truction collective de nouveaux reperes et denouvelles regulations de l’action. Dans cetteexploration collective, le fait de disposerd’une solide communaute scientifique ensciences sociales sera determinante ; elledevra permettre d’injecter dans la discussiondes resultats de recherche fonde sur des tra-vaux empiriques solides et sur une conceptua-lisation rigoureuse afin de ne pas laisser le seulequilibre des opinions (des chercheurs, despolitiques ou des citoyens) definir les choixcollectifs.
Comprendre l’éclosionet la dynamique des controverses
Apres les grandes controverses (sangcontamine, vache folle, OGM) qui ont ebranlenos societes depuis 20 ans, il y a fort a parierque les nanotechnologies exploseront sur lascene publique au travers de nouvelles contro-verses de grande ampleur. Le melange desalliances entre sciences, industries et militaires,de la mondialisation des transactions et desdebats, de la proliferation de fictions litteraireset de mouvements sociaux porteurs d’aspira-tions humanistes et transhumanistes, constituele terreau approprie pour l’eclosion de grandsdebats portant sur les visions probables et sou-haitables du monde futur. Les institutions derecherche, les entreprises et les Etats risquentd’etre pris dans ces immenses controverses. Lasociologie et les sciences politiques ont dejadeveloppe une capacite d’expertise dans cedomaine qu’il convient de remobiliser etd’etoffer pour suivre et comprendre ce qui sejoue dans le cas des nanotechnologies. Lequestionnement se decline sur divers niveaux :
– comprendre a quelles conditionspeuvent emerger des mouvements d’alerte etde critique au sein des reseaux scientifiques, auplus proche des dispositifs et des questionsconcretes qu’ils soulevent, comme au sein dela societe. Il s’agit aussi de voir par quels meca-
nismes mettre en œuvre un processus collectifde discernement (rendu public, epreuve detangibilite) et de tri des alertes, conduisant ala mise en place de garde-fou ;
– comprendre comment les mouvementscritiques vont installer leurs dispositifs de pro-testation dans la duree, tenant compte d’unegamme d’action d’alertes, de critique radicaleet de debat public notamment. Il s’agit de pour-suivre le developpement de methodes d’ana-lyse du suivi des mouvements de protestation,sans porter de jugement a priori et sans devenirl’instrument d’une acceptabilite sociale. Cestechniques d’analyse doivent etre en mesurede suivre au plus pres les dossiers, au-dela del’effondrement des propheties de bonheur, etde rendre compte des controverses dans leurcomplexite ;
– explorer les modalites d’engagementdu public dans la mise en forme des prioritessociotechniques. Le questionnement est d’au-tant plus fondamental que le public ne consti-tue pas une entite simple et homogene doted’une rationalite unique. Un des enjeux tientau fait que l’engagement du public peut contri-buer a l’identification precoce de certains ris-ques comme a une meilleure inscription desnouveautes dans la societe. On sait aujourd’huiqu’il ne suffit pas de bien informer et de biencommuniquer ; il s’agit de construire des dispo-sitifs qui rendent possible la co-constructiondes analyses et des choix. L’eventail des metho-des deliberatives et ce qu’elles construisentdans la duree reste un champ d’investigationa peine explore.
Analyser les mécanismes de l’insertionsociétale des nanomachines
Des programmes de recherche et deve-loppement sortiront de nouveaux etres (a lafrontiere du vivant) avec lesquels les societes(droit, ethique, politique) devront composer.Les filieres de production industrielle se recom-posent et de nouveaux systemes de productions’inventent. Les entreprises et les nations sontconduites a operer des choix strategiquesparce qu’il sera de plus en plus difficile d’in-
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 14 (26)
14
vestir tout azimut. L’introduction de ces tech-nologies conduit a transformer des pans impor-tants de la vie en societe, a imaginer les usageset les nouveaux reseaux sociotechniques aconstruire.
Les questions de recherche portent simul-tanement sur les transformations (legislatives,professionnelles, economiques, marche del’emploi, etc.) a l’œuvre ou souhaitables pouretre en mesure de tirer profit de ces nano-res-sources et pour assurer une regulation socie-tale a l’egard des risques emergents. Il s’agit,entre autres :
– d’analyser les visions et valeurs impli-cites qui contribuent a mettre en forme lesnouvelles technologies sur les plans tech-niques et societaux. Ces visions et valeursorientent et contraignent les trajectoires scien-tifiques et sociotechniques et expliquent enpartie les irreversibilites qui se mettent enplace. Or, il importe pour la societe de garderun controle sur ces trajectoires et une possibi-lite d’emprunter une trajectoire alternative ;
– d’etudier la repartition des risques, desdesagrements et des benefices (y compris lafracture nord-sud) ;
– de comprendre les conditions d’emer-gence des nanotechnologies et d’analyser lerole respectif des grandes entreprises et desstart-ups a l’echelle europeenne. Des questionsimportantes se posent a propos des modelesde developpement economique.
Se pencher sur le phénomènede globalisation des nano
Nous assistons a l’emergence d’unschema de developpement mondial des nano-technologies, mais nous ne disposons pas desinstruments d’analyse permettant de raisonnerles mecanismes a l’œuvre, qui relevent del’economie, de la sociologie (des sciencescomme des societes) et de la geopolitique.Les questions d’engagement du public et deregulation se posent eminemment au niveauplanetaire. Sur ce plan, le fosse a combler sur
le plan de la recherche et des institutions estphenomenal.
2.3 RECONFIGURATIONDE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE
Le defi pour les technologues, decideurspolitiques, industriels et citoyens, est de trou-ver les moyens d’influencer le cours des evo-lutions technologiques des leurs premieresmises en forme et avant que des trajectoiresirreversibles se soient constituees. Ces misesen formes dependent des interactions entrede multiples acteurs, notamment les cher-cheurs et les industriels. La comprehensionde la constitution des trajectoires des nanotech-nologies et de leurs impacts societaux supposealors de prendre en compte les transformationsen cours au niveau des acteurs scientifiques,technologiques et industriels. Les productionsscientifiques et technologiques et leur inscrip-tion societale dependent de la dynamique desacteurs qui les concoivent.
Analyser les modèlesde développement scientifique
Le probleme est aujourd’hui de mieuxcomprendre les dynamiques et les modelesde developpement scientifique (convergenceNBIC, concentration des ressources) et lesmodeles industriels. Des questions se posentaussi concernant les dynamiques differencieesdes nanosciences et des nanotechnologies,ainsi que sur la diversite des chemins de deci-sions, la structuration de groupes expertsinattendus, l’emergence de circuits de pouvoirconcurrents dans le financement de la re-cherche. La recherche sur ces questions pour-rait s’appuyer sur les laboratoires de sciencessociales deja bien implantes en anthropologieet sociologie des sciences et en economie del’innovation.
Sur le plan des dynamiques scientifiques :la transformation des articulations entre disci-
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43 – IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 15 (27)
15
plines (convergence), la fusion de la science etde l’ingenierie, de la technologie et de la mede-cine, les nouvelles organisations du travail(plateformisation, reseaux) constituent desphenomenes qu’il convient d’analyser,d’autant plus que les acteurs scientifiqueseux-memes s’interrogent beaucoup sur lestransformations a l’œuvre ou souhaitable deleurs propres institutions, disciplines et pra-tiques de travail. Des questions fondamentalesse posent quant a l’avenir de certaines disci-plines et quant a la realite d’une convergenceentre disciplines. Sur ce plan, la recherche enscientometrie pourrait apporter une aide. De lameme maniere, des questions se posent quanta l’anticipation des domaines qu’il conviendraitd’investir, par exemple en regard des grandesmasses de donnees qui resulteront de la proli-feration de capteurs de toutes sortes ou de laprise en compte de la complexite. Des ques-tions de fonds se posent quant a la manieredont les disciplines se deploient et se recom-posent, en relation avec les coups de forceindustriels et politiques qui modifient le pay-sage de la recherche.
Ce qui se passe en matiere de nanotech-nologies est aussi exemplaire d’un double phe-nomene de concentration territoriale et demise en reseau des competences scientifiqueset technologiques. Ce phenomene, majeurdans l’histoire des sciences et des techniquesapres l’aire de la Big Science, se traduit par laconstitution de districts scientifiques et tech-niques. Un tel phenomene retient l’attentionde sociologues, economistes, politologues,gestionnaires et geographes. Les questionsportent sur la territorialisation des sciences etsur les dynamiques economiques correspon-dantes. Dans le meme ordre d’idee, des ques-tions se posent quant a la dynamique del’emploi et quant aux relations Nord-Sud.
Comprendre la transformationdes pratiques de recherche
Chercheurs et technologues dans lesnanotechnologies agissent dans des institu-tions de plus en plus hybrides : de recherche
fondamentale et appliquee, privee et publique,melangeant les disciplines (convergence). Ilssont, en outre, pris dans une spirale mediatiqueforte, des sollicitations industrielles accrues,des questionnements ethiques et societauxfondamentaux et une concurrence internatio-nale feroce.
Dans ce contexte, l’organisation de larecherche se transforme et de nouvelles figuresprofessionnelles de chercheurs emergent.Nous assistons a des transformations fonda-mentales des institutions et des pratiques derecherche qui interrogent les chercheurs eux-memes quant a leur identite professionnelle etaux finalites de ce qu’ils font. Le questionne-ment sur l’inscription des nanotechnologiesdans la societe ne se limite ainsi pas a ce quesi passe en aval de la recherche (mediatisation,regulation des applications et usages) ; il opereaussi au cœur des institutions productrices deconnaissances certifiees et de ruptures concep-tuelles pour la technologie. De la dynamiquede ces institutions depend en partie la dyna-mique societale des nanotechnologies. Ilimporte donc d’engager suffisamment de tra-vaux de recherche pour comprendre ce qui s’yjoue afin d’eviter d’en faire un point aveugle dela gouvernance d’ensemble. Plutot que de seconcentrer sur les seuls impacts societaux,encore largement indeterminables, il importede comprendre comment ces impacts resultentaussi de modes de production scientifique ettechnique particulier qui posent question auxchercheurs eux-memes. Il en est ainsi de lamise en relation des industriels et des scienti-fiques des laboratoires publics, identifieecomme une faiblesse dans tous les rapportsofficiels. Il convient, en particulier, d’analyserles pratiques professionnelles des chercheursqui evoluent dans un contexte d’hybridationorganisationnelle instable.
Au niveau des laboratoires, il convientaussi de regarder comment les chercheursorganisent leurs activites en relation avec lesdifferentes arenes societales, politiques etindustrielles. Les chercheurs de base sont gene-ralement convaincus que la science progresse,mais ils developpent en meme temps un regardcritique, ancre sur leurs experiences au contact
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 16 (28)
16
des objets et des instruments, qui les porte arelativiser les mots d’ordre (industriels ou ins-titutionnels) et les propheties qui tendent atotaliser sous l’appellation de nanotechnologiedes problemes et des travaux de natures diffe-rentes. Ils procedent a des choix dont la dyna-mique n’est pas determinee uniquement pardes facteurs intrinseques. Les enjeux financiersde la recherche les conduisent, notamment,vers une forme de duplicite vis-a-vis des deci-deurs politiques et autres gestionnaires de larecherche. La maniere dont s’elaborent lesstrategies de recherche individuelles et collec-tives gagnerait a etre etudiee, de meme que latransformation des modalites de travail (nou-velles formes de division du travail) et desidentites professionnelles. Nous manquons derecherches socio-anthropologiques portant surles laboratoires, y compris industriels, pourasseoir une reflexion sur les dynamiques al’œuvre et pour analyser les « modes de pro-duction scientifique et technologique ».
Comprendre l’émergence des nanos
L’emergence des nanotechnologies est unphenomene qui retient deja l’attention des his-toriens anglo-saxons. De telles recherchesdevraient permettre de mieux anticiper cetype de phenomene. Il s’agit notamment demieux saisir le role des attentes et des projec-tions faites par les differents acteurs ainsi quel’etablissement et la stabilisation de nouveauxreseaux sociotechniques. Des questions speci-fiques relevent notamment de l’economieautour des modeles industriels et de develop-pement economique.
Comprendre les processusde reconfiguration des organisationset des professions
On assiste a des processus d’hybridationdes entites de recherche et des chercheurs, surle plan des appartenances organisationnelles etdisciplinaires. Il s’y invente des agencementsorganisationnels (notamment autour de plate-formes technologiques), de nouvelles formes
de production des savoirs et de gestion de l’in-novation. Gestion par projet et gestion deslaboratoires sont repenses et soulevent desquestions relevant de la dynamique des orga-nisations et de l’harmonisation de culturesmaterielles heterogenes. Pour maıtriser lesdynamiques a l’œuvre, les acteurs ont besoind’identifier et de caracteriser les nouvellesregles et structures apparues avec le develop-pement des nanosciences et nanotechnologies,par exemple, les regles qui commandent lepartage des outils de travail ou les droits deproprietes. De meme, les processus de diffu-sion des concepts aux interfaces, notammententre les disciplines, sont encore meconnus etsont a la source de questions recurrentes pourla politique scientifique : comment agir sur cesprocessus a differentes echelles ?
Il convient aussi de comprendre les allian-ces et resistances des chercheurs de base vis-a-vis des changements organisationnels.
Au-dela des processus d’hybridation entreorganismes prives et publics, le passage auxnanotechnologies va aussi de pair avec unetransformation des metiers de chercheurs etd’ingenieur dont les competences en viennenta se rapprocher. La recherche est appelee aqualifier le phenomene et a en saisir la porteeen termes de professionnalite, de constructionidentitaire et de trajectoire professionnelle.
Des questions se posent aussi quant a lamaniere d’organiser la recherche (ses finalites,son organisation disciplinaire ou thematique)et ses liens avec la societe (construction de laconfiance, pertinence et modalite des contro-les). Comment, par exemple, concilier valori-sation de la recherche et construction de laconfiance du public ?
3 – ÉTAT DES LIEUXPAR THÈME
La CID 43 « Impacts societaux des nano-technologies » est supposee contribuer a la
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43 – IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 17 (29)
17
constitution d’un milieu de recherche enmesure de traiter avec rigueur les questionssocietales nouvelles liees aux nanosciences etnanotechnologies et a produire la connais-sance de base utile a la reflexion collective eta la prise de decision. Dans ce contexte, lafaiblesse numerique de la recherche francaiseen toxicologie, en epidemiologie et en sciencessociales dans le domaine est a souligner et adeplorer.
3.1 FORCES ET FAIBLESSESDE LA RECHERCHE FRANÇAISE
En France, un milieu de recherche est encours de constitution et de structuration entoxicologie et en sciences sociales (economie,sociologie, droit, histoire et sciences poli-tiques), mais globalement, l’expertise est nette-ment insuffisante en sciences sociales commeen toxicologie.
Sur la dangerosite des nanoparticules etdes nanodispositifs, quelques laboratoires sontactifs et competents dans ce domaine enFrance, mais ils meriteraient d’etre renforcescomme le CEREGE (transferts et transforma-tions des contaminants dans les ecosystemes)a Marseilles. D’autres laboratoires sont egale-ment actifs dans le domaine et fonctionnent enreseau.
Quant a l’inscription societale des nano-technologies, a ce jour, les travaux sont encoreglobalement assez rares, mais la situationchange rapidement avec de forts moyensinvestis par les institutions de recherche al’etranger.
Dans les grands colloques internationauxdu domaine des Sciences studies, depuis 2004,les sessions consacrees aux relations entrenanotechnologies et societe occupent uneplace croissante. Les chercheurs americains,britaniques et nord-europeens y sont tres pre-sents. Un reseau international est apparudepuis 2005 sur ces thematiques : Internatio-nal Nanoscience and Society Network (INSN).
Deux equipes de chercheurs francais (LATTSUMR CNRS-ENPC, PACTE UMR CNRS-Univer-sites de Grenoble) y sont presentes.
La majorite des chercheurs en sciencessociales dans le monde anglo-saxon s’est pre-cipitee sur le debat societal en traitant des pro-blemes ethiques et societaux que posent lesnanotechnologies (a partir des ecrits d’auteurscomme Drexler, etc. et de la science-ficton ou apartir du developpement et de l’implantationde puces sous-cutanees). En France, ce sontsurtout les travaux de Bernadette Bensaude-Vincent et de Jean-Pierre Dupuy (CREA,Ecole polytechnique), qui relevent de la philo-sophie et de l’histoire des sciences, qui sont lesplus visibles sur la question des nanotechno-logies.
D’autres chercheurs se penchent surl’imaginaire des chercheurs ou sur les percep-tions du grand public, sur la mise en œuvre dedebats publics (nanojury, nanoforum, etc.) etsur la mediatisation des nanotechnologies. Lestravaux sont encore loin d’etre satisfaisants a cejour. Toutefois, plusieurs chercheurs francaisse sont engages sur ces questions et abou-tissent a des resultats fort interessants, en par-ticulier le travail du sociologue Pierre-BenoıtJoly (INRA) concernant les modalites d’uneintervention du public sur ces sujets et ceuxde Francis Chateauraynaud (EHESS) qui mobi-lise des methodologies de suivi et d’analyse descontroverses extremement innovants et precis.
Les recherches en sciences politiques nesont pas encore manifestes en France sur cesquestions, tandis qu’une petite equipe de ju-ristes du CNRS (CECOJI) developpe, depuis2005, un projet de recherche interdisciplinaire,prospectif, sur les questions de droit et nano-technologie. Le CNRS n’est pas un acteurimportant, en nombre, dans le domaine dudroit ; son atout serait toutefois peut etre detravailler a l’interface entre le droit, les techni-ques et les usages. Les enjeux en termes dedefinition des reglementations et de leur har-monisation internationale sont considerables.Pour les sciences politiques, un objectif estd’etudier la mise en forme de nouveauxgroupes d’elites qui ne reposent pas sur destrajectoires socioprofessionnelles previsibles
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 18 (30)
18
et d’analyser les repertoires d’actions mobilisespar ces groupes. Il s’agit egalement de se pen-cher sur les bureaucraties techniques (en par-ticulier, les agences) legitimes a venir pourtraiter de ces questions.
Sur la question des dynamiques dereconfiguration de la recherche et de l’indus-trie, les travaux de sciences sociales publies ouen cours dans le monde sont encore extreme-ment rares. Peu nombreux sont les chercheursqui se penchent sur les dynamiques scienti-fiques et industrielles effectivement a l’œuvreou qui travaillent etroitement avec les labora-toires. Dans le domaine des etudes des politi-ques publiques, de l’economie de l’innovationet de la gestion, des recherches emergent auxEtats-Unis et en Europe ou un reseau s’eststructure (Nanodisctrict). Deux equipes fran-caises (GAEL UMR INRA – UniversiteP. Mendes-France et LATTS UMR CNRS-ENPC) y sont tres actives. Dans le domainede l’etude des sciences (ethnographie de labo-ratoire en particulier), rares encore sont lesequipes actives dans le monde. L’equipe laplus active en ce domaine est actuellementl’UMR PACTE (CNRS – IEP et Universites deGrenoble) ; d’autres travaux sont egalementengages notamment a l’Univeriste de Gote-borg (Suede) et a l’Universite de Lucerne(Suisse).
Cependant, la recherche francaise sur cesquestions est numeriquement tres faible et sanscommune mesure avec les gros investisse-ments consentis sur les sciences sociales auxEtats-Unis. La recherche francaise s’organise enun nombre reduit de laboratoires, dont certainsregroupent deja des equipes de taille signi-ficative, developpant des echanges entre eux.Parfois, localement, comme c’est le cas a Gre-noble, cadre d’une forte concentration delaboratoires actifs dans le domaine des nano-sciences et nanotechnologies, le nombre dechercheurs et doctorants engages, toutes disci-plines SHS confondues, est tel qu’on puissedeja parler d’un pole d’excellence. Par compa-raison aux travaux qui apparaissent dans lescolloques internationaux, les chercheurs SHSfrancais engages dans le domaine temoignentde travaux de grande qualite et souvent origi-
naux, mais encore trop souvent peu visibles enlangue anglaise.
Les forces de la recherche SHS francaisesur les nanotechnologies :
– quelques poles de recherche (EHESS,ENPC, Universites de Grenoble, Polytech-nique, etc.), actifs et d’excellence, qui seconnaissent et developpent des travaux encooperation ;
– des recherches qui se developpent sou-vent en relation etroite avec les acteurs dudomaine (institutions de recherche et labora-toire, entreprises ou acteurs du debat public).Au cours des derniers colloques internatio-naux, il est apparu que ce travail de sciencessociales en relation etroite avec les laboratoiresdu domaine constitue un atout considerable etconduit a des analyses tres differentes de cellesqui proviennent des seuls elements de debatdans l’espace public ;
– des chercheurs SHS qui developpentdes cooperations interdisciplinaires, parexemple entre sociologie et gestion, entredroit et sociologie.
Les faiblesses de la recherche francaisedans ce domaine sont les suivantes :
– faiblesse numerique liee au fait que lesinstitutions de recherche investissent tres peu(un seul recrutement CNRS (6)). Le contrasteest frappant avec la situation americaine ou laNSF a cree en 2006 deux grosses equipes derecherche (par exemple, le Center for Nano-technology in Society a l’Universite de Califor-nie a Santa Barbara avec pres de 40 personnes),dotees chacune de 5 millions de dollars sur uneduree de 5 ans, et structurant un reseau plusetendu de petites equipes. L’ANR a, depuis2007, lance un volet « aspects ethiques socie-taux » dans son programme PNANO, mais lacommunaute scientifique en sciences socialessur les nanotechnologies est encore numeri-quement si faible que les propositions derecherche soumises se comptent sur lesdoigts d’une main ;
– visibilite dans le monde anglo-saxonencore insuffisante (bien qu’en progressionrapide) ;
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43 – IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 19 (31)
19
– des equipes localement tres fragiles,reposant sur un unique chercheur ou ensei-gnant-chercheur, entoure de quelques docto-rants, et a la merci des ressources incitatives. Ilconviendrait de stabiliser et de renforcer lesquelques poles d’excellence existants ;
– l’absence de grands programmes inter-disciplinaires de sciences sociales sur lesquestions liees aux nanotechnologies a la dif-ference, par exemple, du Quebec, ou les rec-teurs des universites elaborent un plan d’actionpluriannuel (2006-2009) pour les sciencessociales. Ce plan a pour objectifs de definirun cadre conceptuel pour la recherche,de mobiliser rapidement les chercheurs ensciences sociales sur les questions de nano-technologies, ainsi que de developper etd’organiser l’expertise dans le domaine. Lefinancement de ce plan de mobilisation dessciences sociales devrait etre a hauteur de10 % du budget du programme NanoQuebec.
Globalement, meme si des equipes dechercheurs en SHS travaillent etroitementavec les laboratoires actifs dans les nano-sciences et nantotechnologies, les dispositifsd’echange entre disciplines sont encore insuf-fisants :
– il n’y a pas de noyau significatif de plu-sieurs chercheurs en sciences sociales au seind’un grand labo de sciences exactes ;
– il n’y a pas de coordination des sectionsdu Comite National concernant les questionsde nanotechnologies ;
– il n’y a pas de poles de recherche plu-ridisciplinaire visible, en mesure d’afficher descompetences, par exemple, en « nanotoxicolo-gie et dialogue societal », en « nanotechnologieet socio-economie de l’innovation » ;
– il y a peu d’implications des chercheursen sciences de la nature ou SPI dans le travailde recherche des sciences sociales. Le pro-bleme est aussi qu’une partie de la commu-naute scientifique est dans la negation desquestions qui se posent. Globalement, la sen-sibilite des chercheurs aux questions societalesest modeste, en particulier chez les plus jeunes.Il n’y a pas non plus de processus manifeste
d’endogeneisation de la reflexion dans lareflexion strategique des laboratoires, contrai-rement a la prise en compte des dynamiquesscientifiques internationales et des exigencesvehiculees par le monde industriel. De plus, ily a peu de systemes de veille et d’alerte ouchercheurs de base et laboratoires jouent unrole reconnu. Les chercheurs en nanoscienceset nanotechnologies pourraient aider lessciences sociales a ouvrir la boıte noire desnanotechnologies et, inversement, s’appro-prier les resultats intermediaires (par exemple,concernant les processus de territorialisationde la recherche, la reconfiguration des identitesprofessionnelles, les modeles de developpe-ment qui orientent les dynamiques scienti-fiques collectives ou les questions concrered’equite qui s’inscrivent dans les details de laconception des nanodispositifs, etc.) pour enevaluer les repercussions sur leurs propresrecherches.
Globalement, aussi, le flux de recrute-ment, dans ces domaines pourtant considerescomme importants, n’est pas suffisant, nimeme significatif.
3.2 LES LABOTATOIRESCONCERNÉS
Nano-toxicologie
CEREGE (UMR CNRS – Universite PaulCezanne) (dir. J.-Y. Bottero) – Centre Euro-peen de Recherche et d’Enseignement desGeosciences de l’Environnement ; actif sur lesquestions de transferts et de transformationsdes contaminants dans les ecosystemes.
LBME – Laboratoire de Biogenotoxicite etMutagenese Environnementale (EA – Univer-site de la Mediterranee, Marseille) (dir.A. Botta).
LCMC – Laboratoire de Chimie de laMatiere Condensee (Universite Pierre et MarieCurie, Paris) (equipe « nanomateriaux inorgani-ques » dir. J.P. Jolivet).
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 20 (32)
20
Laboratoire de chimie analytique (Univer-site Paris XI) (dir. F. Moussa).
Au CEA – DRECAM (Saclay) – trois labo-ratoires associes ou unites mixtes du CNRS :Laboratoire Francis Perrin (URA 2453, dir.C. Reynaud) ; Laboratoire Pierre Sue (UMR9956, dir B. Gouget) ; Laboratoire Claude Fre-jacques (URA CNRS 331, dir. O. Spalla).
LEMIR (Laboratoire d’Ecologie Micro-bienne de la Rhizosphere) (UMR 163 CNRS-CEA- Universite de la Mediterranee, dir.T. Heulin) : Biologie des echanges entre plan-tes et bacteries rhizospheriques.
Laboratoire de Cristallographie et Minera-logie de Paris (microscopie electronique).
ITODYS (Interfaces, Traitements, Organi-sation et Dynamique des Systemes) (UMRCNRS-Paris VII).
SHS
CECOJI (UMR CNRS – Universite d’Ivry) –Centre d’Etudes sur la COoperation JuridiqueInternationale [droit] (dir. I. de Lamberterie).
Droit compare (UMR CNRS – Universitede Paris 1) (dir. H. Ruiz-Fabri) – Centre derecherche en droit des sciences et des techni-ques [droit].
GAEL (UMR INRA –Universite P. Mendes-France, Grenoble) – Laboratoire d’economieappliquee de Grenoble [economie-gestion](dir. B. Ruffieux).
GEMAS (UMR CNRS – Universite de Paris-Sorbonne) – Groupe d’Etude des Methodes del’Analyse Sociologique [sociologie] (dir.T. Shinn).
GSPR (EHESS) – Groupe de SociologiePragmatique et Reflexive [sociologie].
LATTS (UMR CNRS – ENPC et Universitede Marne-la-Vallee) – LAboratoire Techniques,Territoires et Societes) (dir. J.-M. Offner),equipe « Technique, Innovation et Organisa-tion » (dir. P. Flichy).
PACTE (UMR CNRS – IEP, Universites deGrenoble) [sciences politiques, sociologie etsciences du territoire] (dir. G. Saez) – Dispositiftransversal « Sciences et societe » (dir. D. Vinck,C. Gilbert, Y. Chalas).
Notes
(1) « Nanosciences et Nanotechnologies : Opportunities andUncertainties » (2004), Royal Society and Royal Academy ofEngineering, www.royalsoc.ac.uk.
(2) « The National Nanotechnology Initiative » (2004), NationalNanotechnology Initiatives, www.nano.gov
(3) « Nanosciences et nanotechnologies : an action Planfor Europe 2005-2009 » (2005), Commission de l’Unioneuropeenne, http ://www.euractiv.com/en/science/nanotech-nology/article-117523
(4) http ://www.eptanetwork.org/EPTA/ search.php ?pattern=nanotechnology&title=title&desc=desc&keyword=-1.
(5) Nordmann A. (2004) Rapporteur du High-Level ExpertGroup Foresighting the New Technology Wave – ConvergingTechnologies : Shaping the Future of European Societies :Report. Brussels : European Commission, 27 sept. 2004,http ://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/ntw/pdf/final_report_en.pdf.
(6) En ajoutant le concours 2007, le CNRS aura peut-etrerecrute en tout et pour tout trois chercheurs en sciences socia-les pour travailler sur les nanotechnologies ; en l’occurrence, ils’agirait de deux juristes (via la CID 43) et d’un sociologue (viala section 40).
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 43 – IMPACTS SOCIAUX DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 21 (33)
21
ANNEXE
ANNEXE 1 :LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES
Pour etablir ce document, la CID 43 aconsulte une serie de collegues reperes pourleur competence et investissement dans ledomaine de la CID :
Remy Barre, economie
Bernadette Bensaude-Vincent, histoire etphilosophie
Francis Chateauraynaud, sociologie
Claude Gilbert, sciences politiques
Pierre-Benoıt Joly, economie
Isabelle de Lamberterie, juriste
Vincent Mangematin, gestion
Dominique Pestre, histoire
Francois Tardiff, nanotechnologue
Virginie Tournay, sociologie et sciencespolitiques
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 22 (34)
22
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 44MODÉLISATION DES SYSTÈMES BIOLOGIQUES,
BIOINFORMATIQUE
Président de la CIDBernard PRUM
Membres de la CIDDominique CELLIER
Christian COGNARD
Gilbert DELEAGE
Érick DUFOURC
Pierre-Olivier FLAVIGNY
Christine FROIDEVAUX
Olivier GANDRILLON
Olivier GASCUEL
Thierry GRANGE
Nicolas HERMANN
Julie MAALOUM
Nathalie MAUREL
Christian MICHEL
Benoît PERTHAME
Marie-France SAGOT
Thomas SIMONSON
Éric WESTHOF
La biologie a grande echelle est a l’origined’une masse considerable de donnees quiconcerne tous les niveaux du vivant :
– les genes, les proteines et leurs inter-actions ;
– les genomes, leur dynamique et leurevolution ;
– les cellules, leur organisation et lesmecanismes moleculaires sous-jacents ;
– les organes et leur fonctionnement ;
– les organismes et leur physiologie ;
– les especes et populations ;
– les systemes ecologiques.
L’exploitation de ces donnees est au cœurde la CID 44. Elle requiert a la fois des modelesmathematiques et physiques qui represententles lois complexes du vivant, et des travaux eninformatique, pour simuler ou estimer cesmodeles, fouiller les donnees, et pour integrertoutes ces sources d’informations heterogenesau sein de bases de donnees et de connais-sances. L’objectif est une meilleure compre-hension du vivant, avec des enjeux dans tousles domaines, environnementaux, agrono-miques, medicaux et pharmaceutiques. Lesannees passees ont vu ces disciplines se deve-lopper de facon extraordinaire (les articles les
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 23 (35)
23
plus citees aujourd’hui, toutes sciences confon-dues, sont lies a l’exploitation informatique desdonnees genomiques). Le mouvement conti-nuera tres certainement. La biologie dedemain sera largement faite par des biologistes« secs », modelisateurs et/ou bioinformaticiens,par opposition aux biologistes « humides » tra-vaillant a la paillasse. L’objectif de la CID 44 estde favoriser les recherches dans ces domainesd’interface, en mettant en avant des chercheurset des travaux innovants sur le plan methodo-logique et repondant a des questions biolo-giques importantes. On trouvera dans la suiteles principaux axes de recherche concernes,avec un regard plutot biologique tout d’abord(quelles grandes questions biologiques ?), puisplutot methodologique (quels modeles ? quelsalgorithmes ? quelle integration des donnees ?).Ces deux regards sont le plus souvent indisso-ciables, mais ce mode de presentation faciliterala lecture par les tenants des differentes disci-plines d’origine. Finalement on tracera unrapide etat des lieux, avant de conclure parles recommandations essentielles.
1 – GÉNOMIQUECOMPARATIVE
ET FONCTIONNELLE
On a pu croire qu’apres le sequencage dugenome humain la course aux genomes allaitralentir. On assiste en realite a une forte acce-leration. Cette acceleration, facilitee par l’appa-rition de nouvelles techniques de sequencagerapides et peu couteuses, est due a l’interet decomparer les genomes et d’explorer les diver-gences evolutives a differentes echelles, depuisles etudes intra-specifiques jusqu’aux analysesregroupant les grands domaines du vivant.Ainsi, 500 genomes procaryotes sont sequen-ces actuellement et plus de 700 projets desequencage de genomes bacteriens sont encours. Plusieurs souches de E. Coli ont dejaete entierement sequencees, tandis que49 genomes complets d’eucaryotes sont
aujourd’hui disponibles. Et on pourrait multi-plier les exemples (levures, virus, etc.), tandisque s’estompent les frontieres entre especes :plus de 70 projets de sequencage de metage-nomes sont en cours, visant a caracteriser lemateriel genetique a partir d’echantillons envi-ronnementaux.
Cette masse considerable de donneesrepresente un nouveau changement d’echelle.La bioinformatique s’est d’abord consacree auxgenes, a leur comparaison, leur evolution etleur fonction. Elle peut desormais s’attaqueraux genomes. Les enjeux sont considerables.Par exemple, les etudes sur les bacteries sontliees a la pathogenicite ou a la diversite et al’adaptation, et ont donc un impact potentieldirect en sante et en biotechnologie. Des geno-mes essentiels comme celui de PlasmodiumFalciparum (l’agent de la Malaria, responsablede deux millions de morts chaque annee dansle monde) sont largement incompris et onattend beaucoup des etudes comparatives.Mais les difficultes sont evidentes. Se posetout d’abord le probleme de la taille : onpasse typiquement de mille nucleotides pourun gene a plusieurs millions de paires de basesdans un genome de petite taille, d’ou des diffi-cultes algorithmiques importantes. Et on saitmal aujourd’hui comment evoluent les ge-nomes (rearrangements, elements transposa-bles, role des virus, etc.), ce qui impose destravaux de modelisation et d’estimation statis-tique des differents modeles envisages.
La biodiversite se developpe suite a descontingences historiques et une evolutionmoleculaire neutre encadree par des con-traintes structurales de developpement et deregulation. Alors que la microevolution (deve-loppement horizontal de l’arbre phyloge-netique) est dominee par les contingenceshistoriques, la macroevolution (developpe-ment vertical de l’arbre phylogenetique) esttres fortement contrainte pour des raisonsstructurales et de controle. La genomique com-parative permet de departager et de degagerles elements moleculaires responsables de cesevolutions biologiques. Ainsi, les travauxrecents de comparaisons des genomes dumacaque, du singe et de l’homme ont montre
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 24 (36)
24
que l’allele trouve chez le macaque corresponda l’allele malade chez l’homme. De telles com-paraisons, generalement aussi surprenantesqu’innovantes, ont de profondes repercussionssur notre comprehension et le traitement deces maladies humaines.
La genomique fonctionnelle qui s’attacheentre autres, a comprendre la fonction desgenes, comprend notamment l’etude massivedes transcriptions, des proteines et de leursinteractions au sein d’une cellule. On assiste ala multiplicite des « -omics » (genomics, trans-criptomics, proteomics, metabolomics etc.).Toutes ces nouvelles approches ont transformela biologie moleculaire moderne d’une science« pauvre en donnees » en une science « riche endonnees ». Elles permettent d’envisager, des apresent, des analyses integrees allant dessequences completes des genomes aux conse-quences phenotypiques de mutations, en pas-sant par les aspects structuraux et fonctionnelssur les differents acteurs cellulaires. Face a cevolume croissant de donnees complexes etheterogenes, l’integration des donnees cou-plee a des analyses bioinformatiques compara-tives et predictives est cruciale pour realiser ladescription etendue de la fonction d’un gene etde la comprehension de son role non seule-ment au niveau moleculaire, mais egalementaux niveaux superieurs des voies cellulaires,des complexes macromoleculaires, de la cel-lule ou de l’organe.
2 – BIOLOGIEDES SYSTÈMES, RÉSEAUX
La biologie des systemes, ou biologie sys-temique, est souvent minimisee ou memedecriee. Certes, une definition claire et accepteen’est pas simple a trouver. La biologie molecu-laire et structurale produit une quantiteincroyable de donnees precises et fineschaque annee. Leur integration en une visiontout a la fois coherente et synthetique restecependant bien souvent fort lointaine. Une
des raisons est que nous ne gerons pas auniveau theorique la syntaxe des flux de l’infor-mation biologique. L’objectif de la biologie dessystemes est l’etude des reseaux dynamiquescrees par les objets biologiques en interaction.La biologie des systemes ne se borne donc pas al’etude des reseaux metaboliques ou gene-tiques. Des apports theoriques importants ontete realises ces dernieres annees sur les reseauxbiologiques ou non. Les similarites entre cesdivers types de reseaux sont surprenantes.Toutefois, une caracteristique frappante desreseaux biologiques est leur robustesse coupleea leur evolvabilite. L’espace des systemes bio-logiques sur lequel nous pouvons agir a des finsd’intervention, de controle ou de regulationapparaıt donc restreint. Les consequences deces observations sont lourdes pour les develop-pements en therapie humaine et seule unecomprehension globale des interactions per-mettra de degager des nouvelles voies d’at-taque. Les consequences de ces travaux enbiologie (au niveau fondamental tout commepratique) n’en sont pas encore bien compriseset peu diffusees. Les travaux de biologie syste-mique ouvrent la voie a la biologie synthetiquedont les buts consistent a utiliser en ameliorantet en simplifiant les systemes biologiques a desfins d’ingenierie et de production. Au niveauinformatique, de nombreuses difficultes inhe-rentes a la biologie systemique proviennentdes structures memes de recherche et de diffu-sion des connaissances : nous partageons et dif-fusons generalement des modeles plutot quedes donnees brutes. Comment permettre a desordinateurs de s’echanger ces modeles, de lesverifier sur les donnees brutes, de les retrouverdans les publications, de les assembler et departager les resultats avec d’autres ?
3 – BIOINFORMATIQUESTRUCTURALE
Le grand enjeu de la bioinformatiquestructurale est de comprendre la relation
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 44 – MODELISATION DES SYSTEMES BIOLOGIQUES, BIOINFORMATIQUE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 25 (37)
25
entre structures macromoleculaires et fonction-nement biologique de la cellule. Cela passe parune comprehension large des macromoleculeset de leurs complexes, en prenant en compteleurs structures, leurs mouvements, et leursinteractions. Il faut donc decrypter le vocabu-laire et la grammaire d’un dialogue moleculairetres complexe a differentes echelles de taille(de l’atomique au mesoscopique), de temps(de la picoseconde a la seconde) et d’espace(compartimentation, diffusion, encombrementcellulaire). La bioinformatique structurale estfortement associee aux developpements de labiologie structurale experimentale, et donc a lafois aux programmes massifs de sequencagesgenomiques et aux programmes de determina-tion de structures tridimensionnelles. En effet,les aspects structuraux (proteiques et nu-cleiques, experimentaux et theoriques) sontessentiels a la reussite des grands projets degenomique.
Dans ce contexte, plusieurs secteursimportants de la bioinformatique structuraledoivent continuer a etre developpes ; d’autres,tres recents ou nouveaux, doivent etre renfor-ces ou crees. Un premier groupe de secteurssont lies au probleme du repliement des pro-teines et a la prediction de structures : identifi-cation et classification de motifs structuraux,developpement de methodologies compara-tives au niveau structural, phylogenie struc-turale, analyse structurale predictive dessequences/structures (ADN, ARN, proteines),probleme inverse du repliement, modelisationpar homologie a grande echelle. Un deuxiemegroupe se situe a l’interface avec les techniquesde biologie structurale experimentale : recons-truction de gros edifices 3D en utilisant desdonnees heterogenes (cryoEM, RMN liquideet solide, biocristallographie, fluorescence,imagerie moleculaire, AFM) ; ces secteursnecessitent des couplages de codes informa-tiques et de nouveaux developpements metho-dologiques. Un troisieme groupe concerne lacomprehension des mecanismes d’assemblagemacromoleculaires (e.g., approches multi-echelles) et des forces mises en jeu (e.g., expe-rimentations sur molecules uniques) et de leurdynamique ; ce secteur concerne notammentles reseaux d’interaction proteine-proteine,
mais aussi l’autoassemblage de membraneslipidiques. Un quatrieme secteur concerneplus directement les relations structure-fonc-tion et les mecanismes detailles de macromo-lecules d’un interet particulier. Il inclut lasimulation des mouvements moleculaires(domaines, approches de ligands), les techno-logies d’ingenierie in silico de proteines ou deligands (d’interet, par exemple), et la simula-tion en dynamique moleculaire de gros sys-temes associant proteines, membranes, ouARN (e.g., ribosome, facteurs de transcription,proteines membranaires, entourees d’unmodele realiste de leur environnement).
4 – ÉVOLUTIONET ADAPTATION :
DU GÈNE À L’ÉCOLOGIE
L’evolution et l’adaptation forment unautre grand pan de la biologie. Les objets biolo-giques sont issus d’un processus d’heritage et demutations, et ceci a toutes les echelles, du geneaux systemes ecologiques en passant par lesespeces. Comprendre et retracer l’evolution deces objets est souvent un pas decisif dans lacomprehension de la fonction (par exemple,des genes), dans l’elucidation de la structure(par exemple, des proteines), ou de la placedans un ensemble complexe (par exemple, desespeces au sein des ecosystemes). Retracerl’evolution apparaıt egalement essentiel dansl’etudes des maladies emergentes ou en evolu-tion constante, telles que le SIDA, le SARS ou lagrippe. Les etudes evolutives sont au centre desgrands projets internationaux sur l’Arbre de laVie, qui est la phylogenie de l’ensemble desespeces contemporaines et constituera un reper-toire remarquable de la biodiversite globale.
Cette capacite a comprendre et modeliserle passe devrait prendre une nouvelle dimen-sion dans ses applications ecologiques avec lesetudes sur le rechauffement climatique. Com-ment les especes s’adapteront-elles ? Quels
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 26 (38)
26
nouveaux equilibres entre especes se forme-ront localement, quels seront les impacts surles societes humaines ? Ces questions se posentnaturellement dans un contexte multidiscipli-naire : la formalisation mathematique y estvariee et ancienne ; les methodes informa-tiques avancees sont indispensables ; le cou-plage de codes climatiques et de dynamiquedes populations est a l’ordre du jour. La mode-lisation biologique et geophysique, ainsi quel’integration des donnees genomiques, pheno-typiques, ecologiques, et climatiques, sont fon-damentales et necessaires.
5 – MODÉLISATIONMATHÉMATIQUE
Toute science passe depuis des sieclespar des modelisations, tres essentiellement denature mathematique. La physique et la chimiesont sorties d’un mode descriptif au dix-huitieme siecle avec la mise en equation del’attraction des corps ou des reactions chi-miques, passant plus tard par des calculs depotentiels. Si la biologie dans son essence aechappe a cette modelisation – il y a descontre-exemples, tels les modeles proies-pre-dateurs ou les dynamiques de populations –,c’est clairement du fait de sa complexite.
Ce mot, « complexite », est celui qui carac-terise en premier les domaines d’interdiscipli-narite reconnus (le cerveau, l’univers, lessciences sociales). Suivant un mecanismecurieusement observe tout au long de l’histoiredes sciences, la disponibilite des outils abstraitsva de pair, et souvent precede leur emploi dansles disciplines « concretes ». Aujourd’hui lesoutils conceptuels, au premier rang desquelsles outils mathematiques, ont acquis depuisun siecle, disons, la capacite de traiter de telsproblemes complexes : les fonctions derivablesont cede le pas au mouvement brownienet a ses avatars, les espaces euclidiens a desespaces de Hilbert de dimension infinie, lesequations differentielles (reduites a etre « ordi-
naires » !) partagent le terrain avec des systemesdynamiques de plus en plus complexes.
Cette complexite se reflete d’abord parune complexite accrue des modeles mathema-tiques, faisant souvent appel – ce qui est symp-tomatique de l’ampleur des problematiques –a des domaines relevant des maths dites« pures » : c’est le cas des systemes dynamiqueset des graphes, par exemple pour les processusbiochimiques, leur fonctionnement et leur evo-lution. C’est egalement le cas de la theorie desjeux, pour ce qui concerne les systemes ecolo-giques et leurs fragiles equilibres. C’est aussi lecas de la geometrie appelee a jouer un rolecentral, non seulement pour modeliser dansl’espace usuel les positions relatives des mole-cules pour mieux comprendre leurs inter-actions (par exemple, notion de site actifpresente a un substrat), mais surtout pourrendre compte dans des espaces de tres hautedimension (espaces de lacets, par exemple) dela topologie des molecules biologiques (brinsd’ADN, par exemple) et de leurs deplacementspossibles (repliement, ouverture, etc.) sansdoute le long de geodesiques dans ces espacescomplexes. Cette complexite devrait aussiconduire a des modelisations multi-echellespour lesquelles des evenements de natures dif-ferentes (evenements moleculaires de naturestochastique, evenements cellulaires et tissu-laires plus deterministes) seront integres dansun meme modele utilisant des formalismesadequats et differents selon les niveaux.
Mais les mathematiques plus tradition-nellement tournees vers les applicationsconservent un grand role dans l’interactionmath-biologie. Toutes les methodes de maxi-misation sont mises a contribution pour tacherde modeliser cette extraordinaire optimisationqui caracterise le Vivant. Les equations diffe-rentielles modelisent aussi bien la dynamiquemoleculaire que les deplacements de popu-lations. La modelisation probabiliste est large-ment employee, par exemple pour representerles evenements evolutifs (mutation, speciation,rearrangements genomiques, etc.). Et bien sur,tous les modeles devant etre choisis sur descriteres d’ajustement aux observations, tousleurs parametres devant etre estimes, toute
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 44 – MODELISATION DES SYSTEMES BIOLOGIQUES, BIOINFORMATIQUE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 27 (39)
27
hypothese devant etre testee, les statistiquessont centrales dans cette interdisciplinarite.
6 – MÉTHODES ET OUTILSINFORMATIQUES
Un axe essentiel de recherche en bio-informatique est l’algorithmique du texte.Exploiter les donnees genomiques necessitedes algorithmes toujours plus fins et rapidespour explorer les banques de donnees, trouverpar alignement les sequences homologues aune sequence donnee, ou detecter des motifset signaux, notamment representes par desautomates probabilistes ou des modeles deMarkov caches. L’alignement multiple est unetache fondamentale (pour caracteriser unefamille ou en retracer l’evolution) qui necessitetoujours des developpements algorithmiques.Plus recemment, de nombreux efforts se sontportes sur les rearrangements genomiques et lecalcul de distances de rearrangements ; ces tra-vaux ont entraıne des developpements fonda-mentaux sur les permutations, qui formentaujourd’hui un champ tres actif de la rechercheen algorithmique.
L’algorithmique bioinformatique concerneaussi d’autres structures discretes. De nom-breux problemes en evolution sont lies auxarbres (phylogenies) et a leur combinatoire,notamment dans le but d’assembler l’Arbre dela Vie a partir des arbres partiels que l’on peutdeja trouver dans les banques en grande quan-tite. Les arbres et leur algorithmique sont ega-lement centraux pour l’etude et la comparaisondes structures d’ARN. L’algorithmique desgraphes est elle aussi largement mise a contri-bution et developpee, en raison de la quantitesans cesse croissante de donnees de typegraphe, qu’il s’agisse d’interactions proteiques,ou de reseaux metaboliques et de regulation,dont on dispose pour de nombreux orga-nismes. L’objectif est alors de comparer, parexemple pour trouver des regularites statisti-quement significatives.
D’autres taches necessitent clairementdes developpements informatiques. En parti-culier, de nombreux problemes se rattachenta l’optimisation et/ou au calcul massif impli-quant le developpement de codes paralleleset distribues. C’est notamment le cas en matierede structure et de dynamique moleculaire. Il estsignificatif que dans ce domaine des travauxprometteurs aient ete inspires par la robotiqueet le controle des bras articules, en suivantl’analogie mecanistique entre bras et chaıneproteique.
L’informatique doit egalement repondreaux defis presentes par l’analyse integree desdonnees de la biologie a grande echelle.Celles-ci sont non seulement volumineuse eten croissance rapide, mais egalement tres hete-rogenes (combinant, par exemple, des don-nees de sequences, des annotations surcelles-ci, et des donnees textuelles servant dereference pour ces annotations). Les nouvellesmethodes doivent incorporer des composantsde fouilles de donnees developpes dans lesdomaines de la statistique et de l’intelligenceartificielle, ainsi que des methodes de classifi-cation. En outre, des techniques d’analyse del’information doivent etre utilisees, allant de lavalidation et de l’affinement des donnees, jus-qu’a l’extraction des informations pertinenteset leur utilisation dans un cadre d’aide a ladecision. L’integration etroite de ces protocoleset logiciels dans des ensembles entierementautomatiques sera necessaire. Cette integrationexigera egalement des formats de donnees, desmodeles et des ontologies standard, afin derendre le transfert d’informations aussi transpa-rent que possible.
7 – ÉTAT DES LIEUX
Une etude bibliometrique rapide (1)permet de positionner les recherches se faisanten France dans ces domaines. En matiere depublications en bioinformatique (2), la Francese place en 4e position (� 120 publications),
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 28 (40)
28
tres loin derriere les USA (� 1000), mais aussiassez loin derriere l’Allemagne (� 260) et l’An-gleterre (� 220), deux pays qui ont fortementinvesti le domaine depuis une bonne dizained’annee, et qui beneficient de la presence delaboratoires Europeens. La France devancelegerement le Japon, le Canada et la Chine(� 90). Pour ce qui concerne les publicationsen biologie des systemes (3), la France (23) estmal placee, loin derriere USA (� 200), Japon(� 85) ou Angleterre (� 75), mais aussi, parexemple, derriere l’Italie (37) et l’Espagne (28).On peut voir dans ces chiffres la consequenced’une certaine inertie ; la biologie des systemesest depuis quelques annees largement mise enavant au niveau mondial, mais la France n’apour l’instant fait que peu d’efforts institution-nels (1 appel ANR plutot restrictif en 2006 et2007, rien auparavant). Ce meme facteur (avecun decalage d’une dizaine d’annees, et accen-tue par le manque de continuite des pro-grammes et appels d’offres) explique sansdoute aussi les resultats seulement honorablesen bioinformatique, par comparaison avecl’Allemagne par exemple.
Une autre mesure simple est la presencedu theme bioinformatique dans les laboratoiresdu CNRS, telle qu’on peut la trouver dans l’an-nuaire des laboratoires sur le site du CNRS. EnSdV, 63 laboratoires sur 310 sont fleches bio-informatique, tandis qu’en MPPU on en trouve12 sur 335, et en ST2I 11 sur 236. Meme s’il nes’agit pas d’une mesure reelle de l’activite, celamontre que les sciences de la vie ont biencompris l’interet de ces approches, mais queles mathematiques et l’informatique n’y ontencore mis que peu de forces. Il est egalementsignificatif que le theme biologie des systemes(ou tout autre equivalent) n’apparaisse toutsimplement pas sur le site, dans aucun labora-toire. Enfin, on trouve difficilement plus de 4-5 laboratoires dont le nom evoque directementla bioinformatique ou la modelisation des sys-temes biologiques, alors que de tels labora-toires existent en grand nombre a l’etranger.Ceci montre, si besoin, que l’effort vers l’inter-disciplinarite que constitue la CID 44 doit abso-lument se poursuivre et s’intensifier.
Depuis 2004, la CID 44 a assure lerecrutement (ou promotion CR1-DR2) de33 chercheurs (voir le bilan 2007 pour plus d’in-formations). La pression etait tres forte, puisquenous avons auditionne environ 600 candidats.Quelques autres recrutements sur les themes dela CID 44 ont ete faits dans d’autres sections (07,21, 22, 29), mais avec generalement un carac-tere interdisciplinaire moins marque. Notam-ment, ont ete recrutes dans les sections debiologie des chercheurs appliquant des metho-des et programmes bioinformatiques, plutotque contribuant a les faire progresser. Dans lememe temps, de nombreux postes de bioinfor-matiques ont ete affiches dans les Universites,pour repondre au besoin d’enseignements dansces disciplines devenues indispensables a labiologie d’aujourd’hui. Ce bon niveau generalde recrutement n’a malheureusement pas tou-jours ete accompagne de la creation de fortesequipes ou laboratoires, si bien que certainsenseignant-chercheurs sont parfois isoles ence qui concerne les aspects interdisciplinaires(ca n’est generalement pas le cas pour les recru-tements CNRS et CID 44, ou cet aspect est prisen compte lors des concours).
8 – RECOMMANDATIONS
On peut retenir des grands axes presentesci-dessus quelques mots clefs : genomiquecomparative et fonctionnelle, biologie structu-rale, reseaux biologiques, environnement etbiodiversite, dont le developpement dans lesannees a venir necessitera a l’evidence desdeveloppement specifiques en modelisationmathematique (EDP, modeles stochastiques),en algorithmique (du texte mais aussi desarbres et des graphes), en classification, et enbases de donnees et de connaissances. Pourmener a bien ce programme, et maintenir desrecherches de premier plan en France, il faut :
Accentuer les efforts en terme de postesinterdisciplinaires, avec l’objectif de combinerau mieux :
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 44 – MODELISATION DES SYSTEMES BIOLOGIQUES, BIOINFORMATIQUE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 29 (41)
29
1. reponses aux grandes questions de labiologie et developpement des approches agrande echelle ;
2. avancees des travaux methodolo-giques, car ceux-ci accompagnent (voir prece-dent) les progres en biologie, et presententsouvent un interet propre dans leur disciplined’origine.
Ces postes devraient principalement rele-ver d’une section interdisciplinaire (de typeCID 4, pour assurer l’interet sur les deux ver-sants), mais aussi des sections disciplinaires, etaller vers SdV, mais aussi vers les autres depar-tements, ST2I et MPPU en particulier.
Ne pas oublier, comme c’est encore par-fois le cas, le suivi des chercheurs a la marge deplusieurs disciplines, dont la carriere dependd’une section pouvant lui preferer un cher-cheur davantage centre sur le cœur de sa disci-pline. Ce suivi doit bien sur s’etendre auxequipes et laboratoires interdisciplinaires.
Developper les equipes ou laboratoiresclairement situes a l’interface, en mettantl’accent sur ST2I et MPPU (voir ci-dessus) et
en multipliant les laboratoires et equipes bi-appartenant. A ce titre, une politique incitativedoit etre mise en place (relancee, car des effortsavaient ete faits au tournant des annees 2000),au travers de programmes CNRS, mais aussi del’ANR. Cette derniere s’est jusqu’alors montreepeu interdisciplinaire, et il conviendrait de lapousser a lancer un programme d’interfaceambitieux, entre biologie, mathematique etinformatique.
Developper l’activite de services en bio-informatique, qui est indispensable aux biolo-gistes. Pour etre performante, cette activite doitabsolument etre adossee a la recherche. Enretour, la recherche beneficie de services perfor-mants, par exemple lorsqu’il s’agit de recupererdes donnees ou de mesurer les progres apportespar telle ou telle methode. Une bonne part del’interface entre biologistes et chercheurs enmodelisation et bioinformatique, passe par lesplateformes de services. Le developpement decette activite implique essentiellement desrecrutements d’ITA, qui stabiliseront et amplifie-ront les services aujourd’hui assures par desCDD en nombre toujours croissant.
Notes
(1) Web of Science de l’ISI, periode 2004-2007, nombre d’arti-cles dont au moins un auteur est dans le pays considere (lesresultats sont similaires en considerant des periodes plus largesou plus restreintes).
(2) Publications dans la revue Bioinformatics (Oxford) qui estla plus ancienne et a le facteur d’impact le plus eleve ; desresultats similaires sont obtenus avec d’autres revues commeBMC Bioinformatics.
(3) Publications dans Biosystems, Molecular Biosystems, Sys-tems Biology, Molecular Systems Biology.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 30 (42)
30
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45COGNITION, LANGAGE,
TRAITEMENT DE L’INFORMATION :SYSTÈMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Président de la CIDMichel DENIS
Membres de la CIDPascal AMSILI
Christian CAVÉ
Carlos DEL CUETO
Colette FABRIGOULE
Bernard FRADIN
Line GARNERO
Édouard GENTAZ
Christian HUDELOT
Jean-Paul LACHARME
Christian MARENDAZ
Guillaume MASSON
Jean-Luc NESPOULOUS
Élisabeth PACHERIE
Hélène PAUGAM-MOISY
Jean-Marie PIERREL
François RIGALLEAU
Jean-Luc SCHWARTZ
Catherine THINUS-BLANC
Simon THORPE
Gérard-Richard WALTER
INTRODUCTION
Le domaine des sciences cognitivesregroupe un large ensemble de disciplinesqui, a travers des demarches conceptuelleset methodologiques differenciees, ont encommun de traiter du probleme general de laconnaissance. Leur objectif est de rendrecompte des processus par lesquels se construitet se developpe la connaissance et par lesquelscelle-ci s’inscrit sur une variete de supports etde dispositifs (naturels ou artificiels). Commec’est le cas dans toute demarche pluridiscipli-naire, les chercheurs engages dans les sciencescognitives convergent sur des noyaux concep-tuels communs (comme ceux de representa-tion, d’intelligence, d’agent cognitif, etc.) etvisent a elaborer une representation (scientifi-quement valide et mutuellement acceptee) desstructures et des processus de connaissancequi ne soit plus tributaire d’une seule approche(comportementale, neuroscientifique, linguis-tique, philosophique, informatique, etc.).
L’etude de la cognition naturelle (celleque manifestent les organismes vivants pour-vus d’un systeme nerveux) comprend a la foisla description de ses expressions comporte-
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 31 (43)
31
mentales, celle des processus qui peuvent enetre inferes et celle des mecanismes cerebrauxqui les sous-tendent. L’etude de la cognitioninclut la comprehension des relations entreces trois niveaux, ainsi que leur modelisationet leur simulation par des systemes artifi-ciels. En outre, les sciences de la cognitiontraitent des interactions entre systemes cogni-tifs (naturels et artificiels), avec un interet par-ticulier pour le langage, mais plus largementtous les systemes semiotiques de communica-tion. Le champ inclut donc l’ergonomie cogni-tive et les interactions homme-machine. Enfin,le traitement de l’information, que ce soit ausein des systemes cognitifs ou dans les inter-actions entre systemes, fait partie integrante dece champ de recherche pluridisciplinaire.
Dans ce contexte, l’interdisciplinarite n’estpas envisagee comme une fin en soi, maiscomme un instrument de progres dans la cons-truction d’un savoir plus integre que chacundes savoirs produits au sein des disciplines. Parcontraste avec des entreprises partenarialesdans lesquelles une interdisciplinarite « de ser-vice » consiste essentiellement en l’emprunt demethodes au service d’un objectif delimite, l’in-terdisciplinarite est une necessite intrinsequedans la pratique des sciences cognitives, unedemarche au long cours qui se developpesans etre bornee par des echeances temporellespredeterminees. Les sciences cognitives fon-dent leur identite sur un dialogue permanentautour d’un objet qui n’appartient en propre aaucune des disciplines participantes.
LA DYNAMIQUEDES SCIENCES COGNITIVES :CINQ TRAITS SIGNIFICATIFS
DE LEUR ÉVOLUTION RÉCENTE
Il est utile, dans un document visant arefleter la conjoncture d’un domaine scienti-fique, de signaler les aspects majeurs de sonevolution au cours des dernieres annees,reflets de la dynamique qui a marque et conti-nue de marquer les sciences cognitives.
1. En France, les sciences cognitives sesont constituees au cours des annees quatre-vingts autour d’un noyau de depart incluantla psychologie, la logique, la philosophie, lessciences du langage, l’informatique, disciplinesdu premier cercle auxquelles se sont assezrapidement rattachees les neurosciences.Pour etre precis, ce ne sont pas ces disciplinesdans leur entier qui se sont engagees dans leprogramme des sciences cognitives, mais unefraction – plus ou moins importante – dechaque discipline. Si la psychologie scienti-fique s’identifie largement aujourd’hui a la psy-chologie « cognitive », les autres disciplinesincluent des secteurs qui restent etrangersaux preoccupations cognitives. Ainsi, si unepartie des neurosciences est franchement« cognitive », une bonne partie des neuro-sciences ne l’est pas du tout. Au cours desannees, des secteurs d’autres disciplines sesont rapproches des disciplines a fort contenucognitif. L’extension s’est faite vers de nou-veaux champs disciplinaires qui sontparties prenantes des sciences cognitives :l’anthropologie, l’ethologie, la geographie, lesmathematiques, la physique theorique, l’eco-nomie. L’objectif n’est pas, pour le domainequi nous occupe, de revendiquer toutes lessciences, mais de veiller a ce que les disciplinesqui rencontrent une thematique cognitive aientla possibilite effective de la partager avec lesautres disciplines.
2. Les sciences cognitives se sont consti-tuees initialement autour des fonctions cogni-tives « classiques » : sensori-motricite, langage,memoire et apprentissage, mecanismes atten-tionnels, raisonnement et resolution de pro-blemes. Les annees recentes, sous l’influencedes contributions issues des nouvelles disci-plines, ont vu le domaine s’etendre a de nou-veaux champs et de nouveaux objets.Ainsi, le domaine des emotions et de l’affecti-vite – qui restait eloigne de celui de la cognition« rationnelle » – est maintenant entre dans lechamp des sciences cognitives. Une autre ten-dance s’est manifestee depuis peu, celle d’uninteret grandissant pour les performances col-lectives (qu’il s’agisse de societes d’insectes ouencore d’agents d’un systeme economique).L’approche genetique des fonctions cognitives
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 32 (44)
32
commence elle-meme a prendre un tour pro-metteur. En bref, l’etat des sciences cognitivesn’est pas fige et connaıt un renouvellementpermanent.
3. L’evolution des sciences cognitives seconfond avec celle de leurs paradigmes. Lespremiers ages des sciences cognitives ontreflete un ancrage assez fort dans les modelessymboliques (faisant appel a des modules detraitement relies au sein d’architectures super-visees par des mecanismes de controle). Puisse sont developpees les approches conne-xionnistes (tenant l’apprentissage comme leresultat de modifications de connectivite entredes unites de traitement). La periode plusrecente est marquee par le developpement dela modelisation computationnelle, celui dessystemes dynamiques non lineaires et l’emer-gence de la statistique bayesienne au servicedes sciences du vivant.
4. Le developpement des sciences cogni-tives a ete fortement affecte par le developpe-ment de technologies avancees mises auservice de la recherche. La neuroimagerie,a travers ses methodes en evolution rapide, acertainement contribue a inflechir les pro-blematiques vers une prise en compte plusimportante de l’infrastructure cerebrale desconduites et des processus cognitifs. L’exploi-tation des donnees fournies par la neuroima-gerie revele a son tour le besoin de modelesmathematiques en vue d’integrer les proprie-tes de larges ensembles neuronaux commebases des fonctions cognitives. Plus recem-ment, les techniques de realite virtuelle etde realite augmentee jouent un role impor-tant non seulement dans l’investigation desfonctions sensori-motrices, mais aussi dansles demarches de remediation et de traitementdes handicaps.
5. Depuis une dizaine d’annees, lessciences cognitives illustrent une articulationde plus en plus marquee avec les besoins dela societe et une prise en compte des enjeuxde sante et de remediation (vieillissement,handicaps cognitifs, handicaps sensoriels,psychopathologie). Les secteurs industrielstendent egalement a s’ouvrir de plus en plusaux sciences cognitives (qu’il s’agisse de l’inge-
nierie de la langue, de l’ingenierie de la santeou de l’ajustement des produits industriels aux« usages »). Ce terrain a ete largement preparepar la recherche en ergonomie cognitive, dontl’importance est largement reconnue, maisdont les efforts ne sont pas suffisamment sou-tenus par nos organismes de recherche.
Le domaine des sciences cognitives estdonc en renouvellement continu. Sa respec-tabilite scientifique est tributaire du fait qu’ils’appuie sur des disciplines fortes dontl’identite ne se dilue pas dans la demarcheinterdisciplinaire. Meme dans un paysagecontemporain ou les institutions de rechercherestent preoccupees de l’ancrage de leurs ope-rations sur des specialites disciplinaires bienidentifiees, les sciences de la cognition pour-suivent un programme important de recherchefondamentale et font beneficier plusieurs sec-teurs de la societe de leurs avancees (educa-tion, sante, rehabilitation). L’attractivite dusecteur ne faiblit pas, comme en temoigne lemaintien a un niveau eleve des candidaturesqui se portent sur les postes interdisciplinaires(depuis 2005, une moyenne comprise entre100 et 120 candidats se presentent chaqueannee sur les concours de la CID 45), ce quirend d’autant plus necessaire que les orga-nismes et agences a large potentiel interdisci-plinaire, au premier rang desquels se trouventle CNRS et l’ANR, developpent les programmesadequats dans le domaine.
COMMENT STRUCTURERUN RAPPORT DE CONJONCTURESUR LES SCIENCES COGNITIVES ?
Il n’existe pas de structure canonique dedescription du champ des sciences cognitivesqui puisse servir de guide pour presenter unbilan sur l’etat des sciences cognitives, mais ontrouve au contraire une pluralite de structura-tions possibles.
1. Parmi ces structurations, une methodedemandant sans doute assez peu d’imagination
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 33 (45)
33
est celle qui consiste a passer en revue, l’uneapres l’autre, les disciplines constitutives duchamp. Cette formule permet de mettre l’ac-cent sur les contributions specifiques, mais defacon eclatee. La methode aurait toutefois unavantage, celui de refleter le degre d’implica-tion de chacun des grands champs discipli-naires dans la demarche interdisciplinaire.
2. Une autre methode pourrait consister apasser en revue les grands domaines ou lesgrands « objets » des sciences cognitives. Ainsidecouperait-on le champ de la facon suivante :
a) la cognition comme produit et mani-festation de systemes naturels (au niveauindividuel et au niveau collectif, tant chez l’hu-main que dans les especes animales) ;
b) la cognition telle qu’elle est realisee,modelisee, construite, implementee au seinde systemes artificiels (traitement du lan-gage, synthese de la parole, comprehensionartificielle, vision artificielle, robotique) ;
c) les interactions entre formes naturel-les et formes artificielles de la cognition ; laquestion de leurs analogies et de leurs specifi-cites ; les problemes (a la fois theoriques etapplicatifs) poses par l’adaptation de la cogni-tion naturelle aux systemes artificiels (commu-nication homme-machine, interfaces homme-machine et cerveau-machine, multimodalite) ;
d) les avancees en matiere de modelisa-tion (modelisation en logique, en sciences dulangage, cognition distribuee, reseaux de neu-rones artificiels, systemes multi-agents, appro-ches mathematiques de la complexite, etc.).
Ce decoupage a, de fait, deja ete utilisedans de precedents Rapports de Conjoncture.Sa valeur est de permettre une approche plusintegree, et hierarchisee, des domaines.
3. Nous avons opte ici pour une formulesensiblement differente des deux precedentes,afin de mettre l’accent sur les attentes scien-tifiques emergeant au sein des grands do-maines disciplinaires des sciences cognitiveset qui se traduisent par la recherche d’interfa-cages avec d’autres domaines. Dans la mesureou le present exercice est mene en reponse aune demande de l’organisme CNRS, nous pas-
serons en revue les attentes identifiables ausein des champs qui correspondent auxquatre Departements Scientifiques qui ontvocation a couvrir les sciences cognitives (et,institutionnellement, assurent la tutelle de laCID 45). Ainsi, nous passerons en revue lesquestions qui emergent au sein des sciencesdu vivant et qui servent aux chercheurs de cesdomaines pour susciter des operations derecherche partageables avec les autres secteursde la science. Nous ferons de meme ensuiteavec les questions nees au sein des scienceshumaines et sociales, puis celles nees ausein des sciences et technologies de l’infor-mation et de l’ingenierie, et enfin celles neesau sein des sciences physiques et mathe-matiques. Pour chaque nouvelle « prise deperspective », nous introduirons brievement lenouvel angle d’attaque de la famille de disci-plines concernee, puis nous developperons leslignes de recherche majeures qui structurent ledomaine.
1 – LES SCIENCESCOGNITIVES VUES DEPUISLES SCIENCES DU VIVANT
Il est classique d’entrer dans le paysagedes sciences cognitives par les formes « natu-relles » de la cognition. La cognition naturelleest saisie par des indicateurs de differentsniveaux. Les plus classiques et les plus prati-ques par la psychologie cognitive ont ete etrestent les indicateurs comportementaux.Au nombre de ceux-ci, on donnera une placeprivilegiee au fait que la cognition humaines’exprime par le langage. Dans le present rap-port, cette dimension sera traitee dans la partiesuivante. Enfin, les traces cerebrales de lacognition fournissent des indicateurs d’uneautre nature, dont il s’agira de comprendreles relations avec les indicateurs comporte-mentaux et de chercher a en modeliser lescaracteristiques.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 34 (46)
34
1.1 L’APPROCHE DES PROCESSUSCOGNITIFS COMPLEXES
Une des caracteristiques recentes de lapsychologie et des neurosciences est l’appari-tion de nouveaux champs de recherche impli-quant la prise en compte de comportementstres elabores (les comportements economi-ques en sont un exemple). Cette extension desproblematiques inclut aussi des preoccupa-tions sur les conduites sociales (humaines etanimales) et sur la dimension emotionnelledes conduites humaines. L’idee nouvelle quisous-tend cette evolution est que l’on ne peutplus separer aujourd’hui les processus debas niveau et les processus de hautniveau, alors que ce clivage a assure uneclaire distribution des roles parmi les cher-cheurs dans les dernieres decennies. Pour desprocessus consideres comme de haut niveau,par exemple les processus lies a la conscience,il est desormais acquis que l’on pretende enetudier les bases, y compris les bases neuro-biologiques. Cette evolution s’accompagnebien entendu d’un renouvellement des me-thodes. Par exemple, les techniques de realitevirtuelle et de realite augmentee permettentd’aborder des problemes classiques dessciences cognitives – comme les relationsentre le naturel et l’artificiel – dans des termestotalement renouveles.
Cette attractivite des processus com-plexes est a l’origine de la floraison de nou-velles « disciplines » qui signalent leur volontede modifier leur niveau d’approche en leurconferant une qualification neuroscienti-fique (« neuro-economie », « neuro-philoso-phie », « neuro-geometrie », « neuro-esthetique »,etc.). Cette pratique suggere implicitement quel’on serait interdisciplinaire en passant directe-ment d’une discipline donnee vers les neuro-sciences, c’est-a-dire sans passer par lamodelisation psychologique. Ce court-cir-cuit dans la demarche est une source de pre-occupation pour la psychologie, qui est ladiscipline la mieux equipee pour fournir desmodeles cognitifs documentes, inspires detheories etayees par des methodologies com-
portementales elles-memes bien attestees.Cette tendance profonde est peut-etre, dansle meme temps, un des facteurs du relatif affai-blissement de la psychologie dans la recherchescientifique francaise, alors que la situation dela discipline n’est pas aussi preoccupante dansd’autres grands pays developpes. Personnen’est dupe de l’inclination grandissante a intro-duire de la neuroimagerie dans un programmede recherche pour « cognitiviser » celui-ci et enmeme temps accentuer sa respectabilite scien-tifique. Ceci etant pose, la neuroimagerie estun instrument scientifique desormais incon-tournable de la psychologie a condition queson utilisation soit guidee par des hypotheses.Un corollaire de cette consideration est qu’ilest essentiel pour la neuroimagerie de ne pasetre decouplee de la recherche en sciencescognitives.
Les grandes fonctions cognitivesnaturelles constituent la matiere majeure dela psychologie. Outre le langage (traite dans lapartie suivante), les recherches sur la memoiresont particulierement bien representees enFrance. Nos equipes jouent un role crucialdans le developpement des recherches surl’apprentissage implicite. Il est d’ailleurs remar-quable que ces recherches se developpent enrelation etroite avec celles sur le langage (atravers l’etude de la capacite a reperer implici-tement des mots dans une suite entendue).Elles aboutissent a un modele du role de laconscience et de l’attention dans l’apprentis-sage. De nouveaux groupes se developpent,qui participent aux recherches sur la localisa-tion cerebrale des operations d’encodage etde recuperation en memoire explicite. Lesrecherches sur les processus attentionnels etles processus de planification de l’action sontegalement bien developpes en France. Cesrecherches sont liees a celles sur les effets duvieillissement cognitif normal et pathologique,et plus largement sur les effets cognitifs desmaladies neurologiques et psychiatriques. Lesapplications constituent des enjeux de societetres importants. Un domaine dans lequel laFrance occupe une bonne place internationaledans les recherches comportementales et dansles interactions avec informaticiens et geo-graphes est celui de la cognition spatiale. La
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 35 (47)
35
representation mentale de l’espace et la plani-fication des conduites spatiales s’appuientsur la conjonction de fonctions comme lamemoire, le raisonnement, la capacite de tra-duire une perspective egocentrique sous formeallocentrique et vice versa. La aussi, l’etude desdysfonctionnements et le developpement desaides a la navigation prennent une importancegrandissante.
Les comportements et les processuscognitifs et neurophysiologiques qui leur sontsous-jacents sont ancres dans des fonctionne-ments sociaux qui ont une grande impor-tance chez l’homme et dans de nombreusesautres especes. Or cette dimension demeuretrop peu representee actuellement en psycho-logie cognitive, alors meme que l’on assiste auplan international a un essor des neurosciencesdites sociales et affectives. C’est precisement lacaracteristique fondamentale de la psychologiesociale experimentale que d’integrer la dimen-sion sociale et culturelle de l’homme. A l’aidedes concepts et des methodes de la psycholo-gie cognitive, cette branche de la psychologieetudie :
a) la maniere dont l’individu organisementalement son environnement social (com-ment il encode, stocke et recupere l’informa-tion sur cet environnement) ;
b) les consequences de cette organisationavec ses composantes affectives et emotion-nelles sur l’interaction sociale ;
c) l’influence de cette interaction sur lesfonctionnements cognitifs eux-memes (me-moire, attention, langage, etc.).
Ces questions constituent une partieintegrante des sciences cognitives, forte d’im-portantes implications societales dans lesdomaines de l’education, de la sante et du tra-vail. La recherche dans ce secteur, malheureu-sement, n’est pas suffisamment encouragee.Elle l’est partout ailleurs en Europe et auxEtats-Unis depuis 20 ans, et plus encore aujour-d’hui en raison de son importance dans lesprogrammes interdisciplinaires impliquant parexemple les neurosciences integratives, lasociologie ou l’economie.
L’ethologie apporte une contributionessentielle a la comprehension de l’organisa-tion des conduites et a l’etude des communica-tions interindividuelles. Elle est au premierplan dans la percee actuelle qui se developpedans l’etude des comportements collectifs.L’interaction sociale est examinee pour seseffets sur la plasticite des conduites et surl’emergence des differences individuelles. Lestravaux menes dans les unites CNRS d’etholo-gie montrent comment la transmission epige-netique des comportements est affectee, parexemple, par les styles de maternage. Laneuro-ethologie et l’etude de la communica-tion (notamment chimique) dans la reconnais-sance intra- et interspecifique font partie desmethodes de pointe de nos laboratoires. Lasignification de ces recherches tient au faitqu’elles nous renseignent non seulement surdes processus individuels, mais aussi sur desprocessus qui guident la dynamique des popu-lations animales.
La complexite des conduites se revelenon seulement dans le contexte de la norma-lite, mais encore davantage dans les evolu-tions pathologiques de ces conduites. Levieillissement cerebral fait partie des enjeuxmajeurs de la recherche en sciences cognitives.Ce secteur se developpe avec une preoccupa-tion visant a eclairer les therapies et les proce-dures de rehabilitation. Dans le domaine de lapsychopathologie, des desorganisations di-verses, comme l’autisme ou les phobies, sontexaminees sous l’angle de leurs composantescognitives. La realite virtuelle est utilisee dansdes programmes de remediation. Enfin, la neu-ropharmacologie est un secteur important,dans la perspective de la mise au point demolecules susceptibles de contribuer a la repa-ration de fonctions cognitives alterees. Unautre aspect concerne le fait que la consomma-tion de psychotropes (legaux ou non) entraınedes « changements cognitifs » encore malconnus. L’evaluation de l’incidence des psy-chotropes sur les fonctions cognitives n’estpas ignoree par les chercheurs, mais davantagede recherche fondamentale est certainementnecessaire. Un trait important de la recherchedans ces domaines est en effet l’adoption d’uneperspective de plus en plus unifiee entre la
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 36 (48)
36
recherche en pathologie et la recherche fonda-mentale, mais la mise en place d’interfacesentre recherche fondamentale et recherche cli-nique doit encore etre developpee.
1.2 QUESTIONS DE MODÉLISATION
L’essor des sciences du cerveau et de lacognition, couple avec le developpement denouveaux outils d’imagerie fonctionnelle despopulations neuronales impliquees dans lesfonctions cognitives, entraıne une tres fortedemande en modelisation et simulationdes etats neuronaux, depuis les echelles lesplus microscopiques (modeles biophysiques)jusqu’aux plus integrees (connectivite fonc-tionnelle entre aires). Les neurosciencescomputationnelles et la neuroinforma-tique sont des disciplines en developpementrapide a l’interface entre les sciences de la vie,les mathematiques, la physique et l’informa-tique. Ces dernieres annees, des avanceesimportantes ont ete effectuees dans plusieursdomaines : modelisation des activites de popu-lations (interpretation probabiliste, electro-physiologie, imagerie fonctionnelle) etmodelisation du comportement (perception,programmation motrice, neuro-economie) ;modelisation de la dynamique des reseauxneuronaux artificiels (comportements nonlineaires, apprentissage, emergence de reseauxstructures topographiquement) ; implementa-tion de modeles detailles de neurones (mo-deles 3D a compartiments) ; etude de reseauxneuronaux asynchrones a large echelle basessur les evenements neuronaux. Ces effortspour comprendre le code neuronal sont indis-pensables pour interfacer les systemes biolo-giques et artificiels (reseaux de neuroneshybrides, neuroprotheses). Ils aident aussi amieux comprendre les bases physiologiquesdes signaux de l’activite neuronale (EEG/MEG, IRMf, imagerie photonique). Enfin, desprojets d’interface entre biologie et physiqueexplorent les potentialites de systemes electro-niques calques sur l’organisation du systeme
nerveux (integration a tres grande echelle,calcul analogique, bio-robotique).
Au niveau international, on assiste a unestructuration de plus en plus importante desefforts de recherche en modelisation duvivant, grace a des regroupements entre bio-logistes, mathematiciens et informaticiens ausein d’instituts ou de reseaux pluridiscipli-naires. Un effort international important estegalement consacre au developpement d’outilsstandardises de simulation, a la mise en placede bases de donnees experimentales orienteesvers les modeles, mais aussi au developpementde moyens informatiques pour la simulation dereseaux neuronaux d’echelles jusqu’ici inega-lees. La France dispose d’un fort potentiel enbiologie et en sciences et technologies de l’in-formation, mais il lui reste encore a structurerune communaute nationale forte en neuros-ciences computationnelles. A de rares excep-tions, elle est absente d’enjeux emergentscomme les systemes hybrides macroscopiques(neuro-ingenierie), la constitution de bases dedonnees en neurosciences ou en imagerieou encore l’integration entre equipes de mo-delisation et equipes de biologistes ou decogniticiens. Alors qu’elle dispose de bonnescompetences en neuroinformatique (simula-tion, reseaux de neurones), la France reste enretrait quant a la modelisation biologiquementinspiree des fonctions cognitives. Elle disposeen revanche d’une forte tradition en mathema-tiques appliquees et en physique, au CNRScomme au sein d’autres EPST ou universites.Elle devrait favoriser les interactions entre lesneurosciences cognitives et ces disciplinesdans des structures interdisciplinaires de taillesuffisante et investir dans la formation dejeunes chercheurs a la charniere entre phy-sique et biologie ou entre mathematiques etneurosciences.
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 37 (49)
37
1.3 SCIENCES DU VIVANTET SCIENCES DE L’INGÉNIERIE
Il est bien reconnu aujourd’hui que parmiles questions majeures des sciences cognitives,des questions particulierement centrales sesituent a l’interface entre les sciences duvivant et les sciences et technologies del’information. Les interactions entre les cher-cheurs de ces deux grands domaines sont unerealite, mais qui demande assurement a etreplus fortement developpee. Si l’on considerepar exemple un cas concret, l’etude de lavision, il apparaıt la situation suivante. D’uncote, il existe une communaute importante tra-vaillant sur divers aspects de la vision des sys-temes biologiques. Ces chercheurs utilisentune grande variete de methodes allant de l’en-registrement des neurones au sein du systemevisuel a la psychologie experimentale, en pas-sant par l’imagerie cerebrale, pour ne mention-ner que quelques exemples. De l’autre cote, etplus particulierement en France, il existe uneautre communaute constituee en grande partiede chercheurs ayant une formation d’ingenieurqui tentent de developper des systemes artifi-ciels capables de « voir ». Or, bien que ces deuxcommunautes s’interessent a la vision, il s’agitde deux mondes pratiquement decouples. Defait, le nombre de chercheurs qui participent ala fois aux grands congres de vision artificielleet aux colloques de vision naturelle restemodeste.
Or, il existe de veritables signes d’uneconvergence entre la vision biologique et lavision par machine. Il y a une dizaine d’annees,les donnees venant de la biologie sur la rapi-dite du systeme visuel soulevaient des doutesconcernant le type d’architecture de traitementutilise. Specifiquement, il semblait qu’unepartie important des traitements pourraitse realiser en mode dit « feed forward ». Al’epoque, ce principe semblait etre en contra-diction avec la plupart des modeles de visionpar machine qui avaient besoin de beaucoupde processus de type iteratifs pour, par exem-ple, segmenter des scenes. Or, les meilleursalgorithmes de categorisation des scenes et
des objets par ordinateur d’aujourd’hui adop-tent des architectures tres proches de ce quel’on trouve en biologie, c’est-a-dire, desarchitectures hierarchiques qui fonctionnenten grande partie en mode « feed forward ».Plus generalement, les interactions entre cher-cheurs travaillant sur le vivant et l’artificiel sontextremement benefiques pour les deuxcommunautes. Les ingenieurs ont avantage ane pas ignorer ce que l’on peut apprendre dessystemes vivants, tandis que les chercheurs enbiologie ne peuvent se soustraire aux ques-tions visant a comprendre « comment » fonc-tionnent les systemes complexes. L’utilisationde la simulation par ordinateur est un moyenpour eux de tester leur niveau de comprehen-sion et d’affiner leurs modeles.
1.4 TRAITEMENT DU SIGNALEN IMAGERIE CÉRÉBRALE
Si l’imagerie fonctionnelle cerebrale abeaucoup contribue a la comprehension desbases neurales des fonctions cognitives,c’est en grande partie grace aux developpe-ments methodologiques en statistiques, traite-ment du signal et des images realises pourinterpreter les donnees recueillies dansles diverses modalites d’imagerie. Ainsi, degrandes avancees ont ete faites sur les me-thodes de detection des activations en IRMfonctionnelle et sur les methodes de localisa-tion des sources des signaux enregistres enMEG et EEG. Les recherches les plus innovan-tes dans ce domaine concernent la fusion dedonnees entre les differentes modalites, qui estdevenue d’actualite grace a l’apparition dessystemes d’acquisition EEG compatibles avecl’IRM fonctionnelle. De plus, afin non seule-ment de localiser les aires cerebrales impli-quees, mais egalement de trouver les liensfonctionnels entre ces regions, les recherchesactuelles concernent l’estimation des connecti-vites fonctionnelles, qui se traduisent soit pardes correlations temporelles entre les signauxBOLD recueillis en IRM fonctionnelle, soit pardes relations dynamiques entre les activites
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 38 (50)
38
neuronales, recueillies en MEG et en EEG,issues de differentes aires du cerveau. Cesdernieres sont basees sur l’hypothese d’assem-blees de neurones transitoires qui se forme-raient par la synchronisation de leurs activitespour realiser un comportement donne. Denombreuses methodes ont ete ainsi develop-pees pour mesurer les synchronisations entreles signaux recueillis directement sur les cap-teurs ou, mieux, entre les aires corticales apresavoir applique des methodes de problemeinverse pour localiser les activites MEG etEEG. Enfin, avec le developpement recent del’imagerie de diffusion en IRM, il est possiblede reconstruire les trajets des faisceaux defibres blanches, donnant ainsi acces au substratanatomique de cette connectivite.
La recherche en France possede desequipes de neuroimagerie reconnues interna-tionalement, reparties entre le CEA, l’INSERMet quelques equipes au CNRS. Cependant,cette recherche souffre de la dispersion et dumanque de grands centres d’imagerie inter-disciplinaires, reunissant biologistes, psy-chologues, physiciens, mathematiciens etspecialistes de traitement du signal et desimages, comme c’est le cas dans de nombreuxcentres au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, auJapon ou, tout recemment en France, a l’initia-tive du CEA. La creation envisagee de grandscentres de recherche en neurosciences enFrance devrait favoriser de tels rapprochements.
2 – LES SCIENCES COGNITIVESVUES DEPUIS LES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
Il existe de nombreux points, au sein duvaste territoire des sciences humaines et so-ciales, a partir desquels peuvent etre definiesdes problematiques partageables avec d’autressciences cognitives. Deux disciplines consti-tuent sans doute les sources essentielles del’investissement intellectuel dans les sciences
de la cognition, a savoir les sciences du langageet la philosophie. L’anthropologie constitue unautre domaine au sein duquel a emerge une« anthropologie cognitive ». Quant au domainede l’economie, il a commence a manifester luiaussi un interet pour les sciences cognitives,qui n’est pas sans rapport avec l’interet gran-dissant des chercheurs pour l’etude desreseaux sociaux d’agents cognitifs.
2.1 LINGUISTIQUE,PSYCHOLINGUISTIQUE
ET NEUROPSYCHOLINGUISTIQUE
Alors que les recherches sur la productionet la comprehension du langage sont au cœurdes considerations linguistiques et psycho-linguistiques depuis des decennies, notreconnaissance de ces phenomenes eminem-ment cognitifs reste encore partielle. Un enjeumajeur est de developper des approches inte-grees confrontant des theories linguistiquesa des donnees experimentales en ne negli-geant aucun aspect du phenomene (de lavariabilite acoustique et l’audition a la seman-tique et la pragmatique). Dans ce contexte, quia deja donne des resultats, s’est revelee la per-tinence de certaines initiatives : proceder a descomparaisons translinguistiques ; prendre encompte la variabilite interindividuelle (unepartie importante de la variabilite observee enperception et comprehension peut trouver sonorigine dans des processus de tres bas niveau,ce qui suggere que l’on gagnerait a renforcerl’interface neurosciences/sciences cognitivesen prenant en compte les connaissancesacquises – entre autres – en phonetique) ;developper la modelisation, afin de rendre laFrance davantage presente dans les debats surles modeles cognitifs du langage. En particu-lier, la conception de modeles dynamiques,inspires par exemple des travaux sur les sys-temes dynamiques complexes, est un enjeumajeur. Plus generalement, davantage d’atten-tion meriterait d’etre portee sur les avanceesissues des sciences de la complexite, domaine
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 39 (51)
39
ou la presence d’equipes francaises est encroissance. On notera a ce propos que la ques-tion des donnees en linguistique est abordeeaujourd’hui sous un jour nouveau. Le recours ade grandes masses de donnees numerisees, del’ecrit ou de l’oral, est de plus en plus ressentipar les chercheurs comme une necessite.
Pour reprendre une distinction souventutilisee pour decrire le domaine, les sciencesdu langage s’organisent autour de trois champsdisciplinaires : la linguistique, la psycholinguis-tique et la neuropsycholinguistique. La linguis-tique traite des proprietes structurelles deslangues naturelles. Elle peut etre pratiquee– et est effectivement pratiquee par de nom-breux linguistes – en dehors de toute inter-action avec les deux autres disciplines. Lapsycholinguistique, pour sa part, corresponda la partie de la psychologie qui s’interesseaux faits de langage. Elle s’appuie a la fois surdes connaissances edifiees par la psychologie(en particulier, dans le domaine du developpe-ment) et sur des connaissances issues de lalinguistique. Elle peut etre pratiquee indepen-damment de tout interet pour l’infrastructurecerebrale des activites langagieres etudiees.Cependant, lorsque le chercheur se proposede rendre compte des mecanismes cerebrauxresponsables de ces activites, il s’engage dansune demarche neuropsycholinguistique, quinecessite de s’appuyer a la fois sur les connais-sances issues des deux autres domaines.
Dans les recherches psycholinguistiquesmenees en France, et singulierement au CNRS,tant chez l’adulte que chez l’enfant, les etudesconsacrees au lexique mental predominent.Elles ont permis la mise en evidence de pheno-menes originaux comme l’activation d’unerepresentation mentale de l’orthographe lorsde l’audition d’un mot. Mais notre pays a surtoutete un lieu important pour la modelisation del’acces lexical et pour la localisation cere-brale des composantes du lexique mental. Cesetudes se developpent dans deux directions :d’une part, les recherches sur les troubles dudeveloppement du langage (dyslexie, dyspha-sie) deja bien entamees, et qui visent a delimiterles composantes genetiques des troubles ;d’autre part, les etudes inter-langues qui
visent, entre autres objectifs, a verifier la gene-ralite des modelisations du developpement.
Un saut qualitatif a ete franchi par la psy-cholinguistique, a savoir le passage d’une psy-cholinguistique essentiellement centree sur lemot isole au profit des mots en contexte. Il estimportant que les recherches psycholinguis-tiques ne se cantonnent pas au lexique, maisparticipent a l’essor des travaux sur la syntaxeet sur le discours, avec des collaborations entreles psychologues et les linguistes specialistes deces questions. A cote de la theorie generative etdes approches qui poursuivent les memes objec-tifs, des theories nouvelles et fertiles ont vu lejour en linguistique cognitive, et des chercheursfrancophones commencent a examiner leur vali-dite psychologique, tout en proposant desmodelisations precises. Parmi les questionsemergentes, on notera les nouvelles preoccupa-tions liees au bilinguisme, dans un contexte ou lanorme mondiale n’est plus l’unilinguisme, et auxphenomenes d’attrition (perte ou deteriorationde la langue maternelle, par exemple dans descontextes d’expatriation prolongee). Une autrequestion est celle de la variabilite inter- et intra-individuelle, donc celle des strategies, qui tournede plus en plus les linguistes vers la pragma-tique. Les liens entre raisonnement, pragma-tique et cerveau commencent a se developperau CNRS, avec le lancement de programmesnovateurs. Par exemple, la theorie de la perti-nence fait desormais l’objet de validations expe-rimentales, ce qui illustre l’interet du dialogueentre linguistique et psychologie cognitive. Ilexiste aussi des modelisations des interactionspragmatiques (notamment dans le cadre du trai-tement des questions, des compliments, etc.).
2.2 TRAITEMENT AUTOMATIQUEDU LANGAGE ET TRAITEMENT
DE DONNÉES TEXTUELLES
Dans la pratique interdisciplinaire, lessciences du langage ont un interfacage etablide longue date avec les sciences et technolo-gies de l’information, notamment dans le
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 40 (52)
40
domaine du traitement automatique du lan-gage (TAL). Ce domaine a connu de forts deve-loppements en France, tant au CNRS que dansd’autres organismes. Au sein de cette commu-naute, une distinction existe entre le TALcomme industrie de la langue, ou l’accent estmis sur l’aspect ingenierie, et le TAL quis’adresse aux sciences cognitives et qui serefere a des hypotheses sur le fonctionnementhumain. Un autre secteur connaıt actuellementune forte relance, c’est l’approche orientee versles corpus, qui inclut de plus en plus unepreoccupation cognitive. Correle a cette appro-che se dessine un retour du comparatisme, quipose des questions par essence cognitives(comme la question des universaux).
Une semantique « machinale » a gros grainest en plein essor : l’accroissement constant desdocuments accessibles rend necessaire unacces le plus automatise possible au sens desmots qu’ils emploient. Elle est stimulee par lavisee d’un Web semantique, sous l’impulsiondu consortium qui gere le Web. Cette seman-tique pour donnees textuelles volumineuses etheterogenes s’attache essentiellement aulexique et aux relations lexicales (synonymie,homonymie, hyperonymie). Elle cherche larobustesse : la possibilite de traiter du texte« tout venant », « revise » ou non, en quantitequelconque. C’est une semantique de lamesure : la quantification y est centrale, et ladimension logique discrete. La tradition desemantique proprement linguistique y pesemoins que l’ancrage dans la tradition philoso-phique des ontologies. Ici sont vises moins lessens que les « concepts » denommes par lesmots. Les travaux se centrent pour l’essentielsur la desambiguısation semantique, c’est-a-dire l’attribution en contexte a un mot dusens pertinent en fonction d’un repertoire desens predetermine.
L’autre grande direction de travail estl’acquisition semantique. Ce volet recouvred’abord la mise en evidence de similaritessemantiques entre mots a partir de distribu-tions proches et des propositions d’organisa-tion en « classes semantiques », a plat ouhierarchisees. Ce volet recouvre aussi la carac-terisation des differentes acceptions d’un mot.
Les phenomenes de polysemie et d’homo-nymie genent en effet la mise au jour automa-tique de classes semantiques : les mots qui enrelevent etablissent des « ponts » indus entre desregroupements de mots qui autrement seraientplus nettement separes. A l’oppose, leurreperage prealable est presuppose par lesrecherches en induction de sens. Il repose enl’occurrence sur des connaissances lexicogra-phiques et n’est pas effectue automatiquement.
A ces travaux se sont ajoutees plus recem-ment les recherches visant a degager les prin-cipes de constitution et d’evolution des« folksonomies », ces etiquetages semantiquesoperes de maniere cooperative sans visee for-malisante. La comprehension de ces ontologies« naıves » est necessaire pour exploiter la prisequ’elles offrent sur les donnees annotees, maisaussi pour cerner les mecanismes cognitifs decategorisation qui sont a l’œuvre.
2.3 ORIGINE ET ÉVOLUTIONDU LANGAGE
Depuis une quinzaine d’annees, lesetudes sur les origines du langage ont connuun renouveau certain. L’emergence du lan-gage, et plus largement l’emergence de lacognition humaine qui lui est intimementliee, est abordee par les specialistes de nom-breuses disciplines, allant de la modelisation ala primatologie, en passant par la linguistique,l’archeologie, la paleoanthropologie et la gene-tique.
Au sein de cette palette d’approches, lamodelisation et la simulation informatique sontprobablement celles qui ont connu au niveauinternational la plus forte croissance, et sansaucun doute celles qui accueillent le plus dejeunes chercheurs. De nombreuses avanceesont ete realisees depuis les premiers travauxsur l’emergence de conventions lexicales ouphonologiques relativement simples jusqu’auxrecherches recentes melant robotique evolu-tionniste, theories linguistiques sophistiqueeset modeles issus des sciences de la comple-
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 41 (53)
41
xite. Ce mouvement prend principalementracine dans quelques centres de recherche(Sony CSL Paris, Bruxelles, Edimbourg,Hong-kong), mais n’est guere representedans la recherche academique francaisehormis quelques chercheurs isoles. Afin departiciper a cette recherche qui n’en estencore qu’a ses balbutiements et qui permetd’entrevoir de nombreuses perspectives appli-quees (robots « parlants », interfaces intelli-gentes aux proprietes emergentes adapteesa l’utilisateur, systemes d’acquisition ou detransfert des connaissances), il semble impor-tant de disseminer les acquis des sciences dulangage parfois negliges par les chercheursinformaticiens. De meme, les donnees de lapsychologie cognitive et des neurosciencespeuvent trouver une place de choix dans lesrecherches actuelles, en mobilisant les acquissur la cognition humaine et en proposant dessolutions cognitivement pertinentes et enphase avec les utilisateurs humains pour lesfuturs systemes artificiels.
2.4 PHILOSOPHIEDE LA COGNITION
Les champs d’investigation traditionnelsde la philosophie recoupent en grande partieceux des autres sciences de la cognition.La philosophie a joue un role unique dansla definition des categories fondamentalesde la cognition : perception, memoire, langage,raisonnement, action, emotion. La philosophiede l’esprit, la philosophie du langage, la phe-nomenologie, l’epistemologie et l’ontologiepoursuivent aujourd’hui ce travail dans uneinteraction reciproque avec les autres sciencescognitives. La philosophie de la cognitionintervient en tant qu’elle apporte une contribu-tion specifique, d’ordre conceptuel, a l’etudede ces objets et, reciproquement, la reflexionphilosophique contemporaine beneficie large-ment des eclairages nouveaux apportes par lestravaux issus des sciences cognitives, eclaira-ges qui permettent un enrichissement et unrenouvellement de ses problematiques.
La philosophie de l’esprit a developpe desinteractions particulierement fructueuses avecles neurosciences, la psychologie experimentaleet developpementale et la psychopathologie. Ilconvient de souligner que, sur le plan interna-tional, les philosophes francais jouent dans cedomaine un role pilote depuis une dizaine d’an-nees en prenant au serieux les exigences d’in-terdisciplinarite qu’implique l’epistemologienaturaliste. Ce role a consiste a participer nonseulement a la clarification conceptuelle, maisaussi a la validation empirique des theories por-tant sur divers domaines de la cognition, telsque la representation de l’action et les modalitesde la conscience d’agir, la comprehension d’au-trui, la conscience de soi et de son corps, lapropagation des croyances ou l’evaluationmetacognitive du raisonnement.
Parmi les chantiers interdisciplinaires quise sont ouverts depuis une quinzaine d’anneeset dans lesquels la recherche philosophiquefrancaise apporte une contribution importante,on citera :
a) la cognition sociale (travaux surl’empathie, les bases cognitives de la coopera-tion, la dynamique des croyances collectives,les bases cognitives du jugement moral) ;
b) la cognition animale et l’etude desformes de la pensee pre-linguistique ;
c) la conscience (correlats neuronaux dela conscience, conscience phenomenale, cons-cience perceptive et conscience de l’action,subjectivite et conscience de soi, memoire exe-cutive) ;
d) les formes non conceptuelles derepresentation dans le domaine de la per-ception et de l’action ;
e) la rationalite et les emotions (roledes facteurs affectifs dans la prise de decisionet dans la fixation des croyances) ;
f) la psychopathologie (troubles de laconscience de soi dans la schizophrenie et l’au-tisme, croyances delirantes).
L’organisation de la recherche francaiseen philosophie dans le domaine de la cogni-tion presente trois caracteristiques importantes.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 42 (54)
42
Tout d’abord, sur le plan institutionnel, elle sepratique pour l’essentiel au CNRS plutot quedans le cadre de l’Universite, encore trop lar-gement soumise au cloisonnement discipli-naire. La deuxieme caracteristique de larecherche francaise en philosophie dans ledomaine de la cognition est de se faire eninteraction tres etroite avec des chercheursdes disciplines empiriques. Les centres ousont menees les recherches fonctionnent dansun environnement fortement interdisciplinaire,en contact avec des equipes de psychologie, depsycholinguistique, de neurosciences cogni-tives, de linguistique theorique. Enfin, cescentres entretiennent de nombreuses collabo-rations scientifiques en Europe et dans lemonde et sont internationalement reconnus.
2.5 ANTHROPOLOGIE COGNITIVE
Alors que la psychologie s’interesse sur-tout aux capacites humaines a travers leursmanifestations individuelles, l’anthropologieconsacre ses efforts aux cultures, comme mani-festations de ces capacites au sein de commu-nautes de populations. La recherche enanthropologie construit alors une sciencedes specificites humaines, a la fois dansleurs caracteristiques universelles et dans leurvariete. L’anthropologie a progressivementevolue vers des questions de nature cognitive,mais avec le presuppose majeur d’aborder lacognition comme une realite culturellement« situee ». Ainsi, l’anthropologie cognitive d’au-jourd’hui s’interesse a des objets qui sont exac-tement ceux dont traite la psychologiecognitive (comme la perception, la pensee, laconstruction du savoir, la maıtrise du nombre,etc.). Si ces questions sont abordees dans desenvironnements naturels, la description desdonnees observees s’appuie sur des standardsde la methodologie empirique qui ne sont fon-cierement pas differents de ceux utilises par lapsychologie cognitive.
Parmi les thematiques a fort contenucognitif illustrees dans les laboratoires francaisfigure la question de la flexibilite des capaci-
tes cognitives humaines, comme facteur expli-catif de la variabilite culturelle. On trouveegalement des travaux importants sur la ques-tion de la normalite (comment s’edifient desnormes au sein d’une communaute culturelle)et sur la constitution des identites indi-viduelles et collectives. L’anthropologiecognitive rend compte des structures deconnaissance (« modeles » ou « schemas men-taux ») partages par les membres d’une societe.Ces structures cognitives ont une grande valeuradaptative dans la mesure ou ils permettentaux individus de generer des inferences dansles situations ne contenant que des informa-tions partielles. Les schemas en questionvarient tres largement d’une culture a l’autre,mais l’observation interessante est le caractereuniversel de la disponibilite de tels schemas. Laquestion des modeles culturels est elle-memeetroitement liee a la question des croyances.L’anthropologie revele la variete des criteresde rationalite appliques aux croyances par dif-ferentes cultures. A cet egard, les rapproche-ments avec la psychologie cognitive sont d’ungrand interet, dans la recherche de criteresconceptuels permettant de differencier les« croyances » et les « connaissances ».
2.6 ÉCONOMIE COGNITIVE
Depuis une trentaine d’annees, l’econo-mie sollicite de plus en plus la psychologie. Ilexiste plusieurs types de collaboration. L’eco-nomie (ou finance) comportementale profitedes travaux en psychologie pour expliquerpost hoc les irrationalites des marches qui nepeuvent pas etre expliquees par des dysfonc-tionnements structurels (comme la mauvaiseorganisation des marches, etc.). L’economiepsychologique, pour sa part, exploite les tra-vaux en psychologie sociale et cognitive pourreviser les axiomes des modeles de choix quisont integres dans les modeles economiques.L’economie experimentale, en s’appuyant surla theorie des jeux, cree des economies artifi-cielles qui permettent de verifier les comporte-ments economiques des acteurs dans des
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 43 (55)
43
situations controlees. Il s’agit d’un domainebien represente par plusieurs laboratoires duCNRS. Il existe aussi une « neuro-economie »qui essaie d’expliquer les comportements eco-nomiques en termes de structures cerebrales.Finalement, la psychologie economiqueapplique les idees et techniques de la psycho-logie sociale au domaine de l’economie.
L’objet de l’economie cognitive est deprendre en compte les croyances et le raison-nement des individus dans la theorie econo-mique, tant au niveau des agents qu’a celui deleurs interactions dynamiques et des pheno-menes collectifs qui en resultent. L’expressionrecouvre parfois l’economie de la connais-sance, c’est-a-dire l’economie des outils deconnaissance et d’apprentissage des savoir-faire ou l’economie des biens d’information.L’economie cognitive est bien implantee enFrance, mais les autres courants mentionnesplus haut sont plus developpes a l’echelle mon-diale. Alors que l’economie cognitive s’inte-resse surtout a la modelisation des croyances,les autres applications s’interessent egalement ala modelisation des « evaluations » (ponderationrelative des gains et des pertes, des resultats acourt et a long terme, etc.). Pour ces raisons, ilspuisent largement dans les resultats de la psy-chologie sociale (qui s’interesse elle aussi al’evaluation et aux affects) et ceux de la psy-chologie animale (les modeles de « temporaldiscounting » ont leur origine dans les recher-ches sur les delais de gratification chez le rat).
La place des sciences cognitives en eco-nomie reste tres marginale, en depit des contri-butions de personnalites scientifiques depremier renom (comme H. Simon et D. Kahne-man). Pourtant les apports des sciences cogni-tives a la comprehension profonde de conceptscentraux de l’economie comme les croyanceset leur revision ou encore le raisonnement faceaux capacites cognitives limitees sont essen-tielles. Inversement, les sciences cognitives sesont longtemps interessees a la cognition del’agent individuel independamment de soninsertion sociale. Pourtant, une strategie fonda-mentale pour aborder la cognition consiste aposer le principe qu’un agent pense et agitrationnellement dans une societe ou les
autres agents font de meme. Pour ce faire,une interaction forte entre les sciences cogni-tives et les sciences economiques et sociales estincontournable.
3 – LES SCIENCES COGNITIVESVUES DEPUIS LES SCIENCES
ET TECHNOLOGIESDE L’INFORMATIONET DE L’INGÉNIERIE
La perspective consideree ici est celle dessciences computationnelles ou sciences de l’in-genieur, pour la partie d’entre elles qui visent lasimulation des fonctions cognitives et sensori-motrices humaines, avec pour implication unengagement avec des partenaires specialistesde la cognition humaine.
3.1 VARIÉTÉ DES OBJECTIFSET DES RÉALISATIONS DES SCIENCES
COMPUTATIONNELLES DANS LEDOMAINE DE LA COGNITION
Les efforts de modelisation developpespar l’ingenierie ont des objectifs varies, quipeuvent neanmoins etre regroupes en deuxgrandes classes pour la clarte de l’expose :d’une part, on trouve les travaux qui visent amodeliser pour comprendre des observa-bles fournis par la nature ou par l’experimen-tation ; d’autre part, on trouve les travaux quivisent a modeliser pour creer des artefactsayant pour vocation d’etendre le champ desactivites humaines.
La premiere demarche consiste en la crea-tion d’outils qui servent a l’observation et al’analyse (domaine illustre par les informati-ciens specialistes du traitement du signal) ou
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 44 (56)
44
en l’elaboration de techniques et d’outilsconceptuels permettant de modeliser des phe-nomenes. A cette categorie appartiennent lesoutils probabilistes (dont les outils bayesiens)et l’analyse statistique non lineaire. S’y rattacheegalement l’heritage, aujourd’hui largementpartage, issu de l’intelligence artificielle, desreseaux de neurones, des systemes dyna-miques (dont il est utile de rappeler qu’ils’agit d’outils conceptuels originellement deve-loppes par des physiciens et qui ont ete« empruntes » par d’autres disciplines).
La seconde demarche se propose d’effec-tuer des simulations en vue de creer des arte-facts que l’on rangera eux-memes en deuxcategories :
a) d’une part, on distingue les artefactsqui constituent des « prolongements » del’humain, c’est-a-dire qui assistent des opera-teurs dont les capacites cognitives ou sensori-motrices sont par nature limitees. Les meilleursexemples de « protheses » developpees dans cecontexte sont les differentes sortes de « bio-artefacts » mis au service des personnes souf-frant d’un handicap sensoriel ou moteur. Ici seretrouvent les chercheurs impliques dans lamouvance de recherche NBIC (pour « nano-bio-info-cognitive »). Mais ici se retrouve plusgeneralement toute la recherche sur les inter-faces, l’analyse de la parole, l’analyse descenes, les systemes de reconnaissance desemotions, la realite virtuelle, la robotiquecognitive et les interactions multimodales ;
b) d’autre part, on trouve les systemespartenaires et les differentes formes d’inter-actions mediatisees, ou la puissance del’outil informatique vient servir des objectifscognitifs. Les domaines les mieux illustres al’heure actuelle sont l’intelligence « ambiante »,« l’ubiquitous computing », les « objets commu-nicants » et les systemes embarques. Les sys-temes ainsi developpes requierent une forteimplication des chercheurs en ergonomie,qui sont garants de l’ajustement de ces sys-temes aux capacites individuelles des opera-teurs.
Enfin, les deux secteurs ainsi decrits entre-tiennent entre eux des liens etroits. En fournis-
sant des modeles de la perception (surtout lavision) et des modeles de perception-action,les neurosciences nourrissent l’inspiration desroboticiens, avec d’evidentes applications dansle domaine de la navigation et de l’orientationdans l’espace. Ici, la notion « d’affordance »,venue de la psychologie, repond a des besoinsexprimes par les roboticiens. Une ligne derecherche en fort developpement est celle desinterfaces cerveau-machine, qui font l’objetd’un demarrage remarque au niveau internatio-nal. C’est le cas, en particulier, des neuropro-theses, qui consistent a commander un systemeartificiel a partir de signaux neuronaux. On estbien ici au cœur de la problematique des inter-faces entre systemes naturels et systemes artifi-ciels, servie a la fois par une modelisationavancee et des technologies de pointe. Quel-ques equipes francaises animent des projetsnotables dans ce domaine, impliquant des neu-roscientifiques, des mathematiciens, des infor-maticiens et des roboticiens, mais aussi, lorsquela recherche s’oriente vers la rehabilitation deshandicaps, des equipes medicales.
L’autre domaine privilegie des relationsentre la cognition et le monde de la techno-logie est celui de la realite virtuelle et dela realite augmentee. Ces techniques con-naissent un developpement considerabledans les differents usages (industriels, educatifset ludiques) qu’en fait la societe, mais aussidans le monde de la recherche. Les dispositifsde haute performance technologique mobili-sent des competences de differentes natures,dont celles faisant appel a l’analyse des aspectssensoriels et cognitifs des situations ineditescreees par ces dispositifs. Un besoin ergono-mique de grande ampleur se fait jour, non seu-lement dans la perspective du calibrage desinterfaces ou de la mesure du mal du simula-teur, mais sur les situations perceptives ineditescreees par la realite virtuelle, qui s’ajoutent aurepertoire des situations naturelles et en-gendrent des processus cognitifs et des ajuste-ments comportementaux nouveaux.
Ce sont autant de domaines dans lesquelsla recherche francaise, notamment celle qui estdeveloppee dans les unites du CNRS, s’illustrespecialement, grace aux opportunites d’inte-
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 45 (57)
45
raction offertes par la composition d’unorganisme qui est, par construction, pluridisci-plinaire.
3.2 INTELLIGENCE ARTIFICIELLEET SCIENCES COGNITIVES
Retracer en quelques lignes l’histoire desrapports complexes entre l’intelligence artifi-cielle (IA) et les sciences cognitives est impos-sible. On peut cependant rappeler que dansune premiere phase, les preoccupations del’IA etaient tres cognitives, mais que ses resul-tats, spectaculaires, n’etaient absolument pasgeneralisables. C’est pourquoi, dans unephase suivante, l’IA a pris un virage theoriqueafin de mieux expliquer les fondements de sessucces et de ses echecs, et de determiner desalgorithmes efficaces pour resoudre cer-tains problemes presumes requerir de l’intelli-gence, sans plus se soucier d’une eventuelleproximite avec les procedes par lesquels lessujets humains les resolvent.
Les tendances illustrees par ces deuxphases perdurent au sein de l’IA, mais les deve-loppements les plus recents sont lies (a) a lapossibilite d’acceder, grace au Web, a unequantite d’information sans commune mesureavec ce qui etait disponible auparavant et (b) aune demande accrue, de la part de nombreuxacteurs du Web, d’incorporer de « l’intel-ligence » dans leurs applications. Les deve-loppements technologiques les plus recents(miniaturisation, mobilite, informatique distri-buee) accentuent cette tendance.
De ce fait, certaines problematiques clas-siques de l’IA – comme la comprehension de lalangue ou la representation des connaissances– ont subi un changement radical, passantd’une description fine de quelques pheno-menes circonscrits dans des domaines res-treints, a des analyses necessairement plusgrossieres de corpus considerables. L’objectiflui aussi s’est modifie, et loin de l’exigence de
correction et de completude de sa « periodelogique » correspondant a une comprehensionen profondeur, l’IA vise plutot un resultat suf-fisamment robuste pour des applications de lavie courante.
Les liens theoriques entre IA et sciencescognitives persistent aux niveaux ou ils sesituent traditionnellement : dans les « grandsclassiques » de l’IA qui comportent une fortedimension cognitive (modelisation cognitive,robotique, apprentissage automatique, com-prehension de la langue, etc.), et dans ledebat philosophique et epistemologique surla nature meme de la cognition. Mais l’appari-tion de nouveaux domaines, comme la bio-informatique, et de nouvelles metaphores logi-cielles, comme les systemes multi-agents,creent d’autres points de contact entre l’IA,les sciences du vivant et les sciences sociales.Mais les rapports entre IA et sciences cognitivestendent maintenant a se deplacer vers l’aval,vers une analyse des besoins humains permet-tant de savoir quel niveau de performance l’IAdoit viser afin d’apporter une assistance effi-cace dans les taches impliquant une forte com-posante cognitive.
La place de l’IA francaise continue a etrehonorable dans le paysage europeen et mon-dial (on pourrait le verifier en mesurant la pro-portion de contributions francaises dans lesgrandes conferences ou dans le comite edito-rial des grandes revues par rapport a ce qu’elleetait il y a 10 ou 20 ans). Il ne semble pas quel’on puisse deceler une veritable specificite desrecherches francaises en IA : certains sous-domaines y sont un peu mieux representes,d’autres un peu moins bien. Les recherchessur la langue sont plutot dans cette dernierecategorie, peut-etre parce que l’effort des cher-cheurs francais se partage entre des travaux surla langue francaise et sur la langue anglaise...au point qu’un des meilleurs analyseurs lexi-caux du francais a ete realise par des cher-cheurs allemands !
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 46 (58)
46
3.3 INTERACTIONSHOMME-MACHINE
Nous considerons ici le champ de re-cherche qui se developpe autour des systemeset des technologies de l’information et de lacommunication. Les chercheurs font porterl’essentiel de leur attention sur les processusqui president a la conception, a la constructionet au fonctionnement de ces systemes, ainsiqu’aux interactions que les humains realisentavec eux. La perspective des sciences cogni-tives consiste a maintenir la cognition humainedans la boucle informationnelle qui relie leshumains et les artefacts. Deux enjeux majeurss’ensuivent pour les chercheurs du domaine :creer des systemes artificiels qui se comportentcomme des agents cognitifs dotes de capacitesrationnelles (computationnelles) ; faire porterpar ces systemes des representations et desmodes de traitement qui soient fonctionnelle-ment compatibles avec ceux des operateurshumains.
Le domaine de l’IHM ne se constitue pasen tant que « discipline » au sens strict, maisplutot comme un ensemble de problemes defi-nissant un champ scientifique interdisci-plinaire. Dans ce contexte, l’ergonomie estinvitee a mettre en œuvre ses methodes deconception et d’evaluation des logiciels et desinterfaces. L’informatisation generalisee desactivites professionnelles rend en effet indis-pensable les recherches sur l’ergonomie deslogiciels, sur les aides logicielles a la realisationde taches, sur les aides a la decision dans lecontrole de processus. La necessaire modeli-sation de l’utilisateur porte alors sur les acti-vites de raisonnement, de diagnostic et depronostic, de prise de decision et de planifica-tion (incluant la replanification). Enfin, le lan-gage restant au centre de la plupart desdispositifs informatises, il est important demieux connaıtre l’impact des systemes d’infor-mation electroniques sur la lecture, la compre-hension, la recherche d’informations, letraitement d’informations multimedias (texteset images) ou multimodales (informationsvisuelles et auditives).
Une thematique en developpement estcelle des interactions dialogiques entre lesagents humains (utilisateurs d’un dispositif) etdes agents logiciels jouant le role d’assistantsd’interface. La generalisation des systemes dis-tribues autour de l’Internet cree des besoins etpose des problemes nouveaux aux specialistesde l’IHM (cette derniere etant jusqu’ici surtoutorientee vers le poste de travail). Un champconsiderable s’ouvre ici en vue de creer desoutils mediateurs permettant a des utilisateursordinaires d’acceder a des services en ligne,pour lesquels les assistants logiciels devrontinteragir de maniere aussi naturelle que pos-sible, ce qui impose de prendre en compte ladimension langagiere, sociale et cognitive desinteractions. Par exemple, des agents conver-sationnels animes viennent completer l’inter-face usuelle, sous la forme de personnagesvirtuels produisant des signes non verbaux(dont on connaıt le role important dans la com-munication humaine, comme le regard, legeste ou l’expression faciale).
L’IHM a egalement un role a jouer dansl’assistance au travail collectif et, plusgeneralement, aux activites collectives(« groupware »). La gestion des connaissancesd’un collectif et la capitalisation des savoirsconstituent des domaines importants, dans les-quels les chercheurs visent a clarifier le role desconnaissances episodiques, la tracabilite desdecisions et de la logique de conception.D’un point de vue applicatif, ces questions ren-voient a l’evaluation et a la specification ergo-nomique des mecanismes de reutilisationdeveloppes en genie logiciel et en intelligenceartificielle. Les capacites cognitives de focalisa-tion, d’adaptation et de cooperation sont ega-lement exploitables par les chercheurs eninformatique dans la conception de systemesa base d’agents.
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 47 (59)
47
3.4 ROBOTIQUEET SCIENCES COGNITIVES
On peut identifier trois niveaux d’inter-actions entre la robotique et les sciences cogni-tives allant du simple interet pour unediscipline lointaine (pas d’interaction) a laconstitution d’une science de la cognitiondont la robotique et les neurosciences compu-tationnelles seraient deux des elementsmajeurs. Entre les deux, les sciences cognitiveset plus generalement les systemes vivantsconstituent une source d’inspiration pour larobotique et, complementairement, les robotssont des outils interessants pour des expe-riences en psychologie ou en neurobiologie.
Le renouveau apporte par la robotiqueces dernieres annees (en IA et en sciencescognitives) concerne l’importance de « l’embo-diement » (« incarnation ») et permet de discuterd’un point de vue experimental et formel desliens entre corps et cognition. Par exemple, laprise en compte de proprietes emergeant de ladynamique des interactions robot/environne-ment (souvent tres difficiles a predire) permetdans certains cas de simplifier et de rendre plusrobustes les architectures de controle robo-tiques, mais aussi de proposer des solutionsoriginales pour expliquer certains processuscognitifs (approche ascendante de la cogni-tion). La robotique et les neurosciencescomputationnelles offrent ainsi un cadreunique pour faire cooperer des specialistesen neurosciences, psychologie, physique,mathematiques et informatique en apportantde nouveaux moyens pour etudier les relationsentre structures cerebrales et fonctions cogni-tives grace a des modeles capable de controlerdes robots. Les experimentations robotiquespermettent de valider la coherence d’unmodele et ses implications comportementales(ou dynamiques) pour ensuite proposer demeilleurs modeles et de nouvelles experiencesen sciences cognitives.
La possibilite aujourd’hui de construiredes micro-robots (et peut-etre un jour desnano-robots) pose la question a la fois du
controle d’un robot isole et du controleglobal d’une grande population de robots(intelligence collective ou « swarm intelli-gence »). Les contraintes liees a la faible puis-sance de calcul qui peut etre embarquee dansces robots a conduit naturellement les roboti-ciens a s’interesser a l’ethologie et a proposerdes algorithmes bases sur des notions d’auto-organisation permettant la resolution deproblemes complexes par une populationd’agents elementaires (par exemple, algo-rithmes reposant sur l’emploi de strategies sen-sori-motrices simples au niveau individuel).
A l’autre extreme, on assiste a l’arrivee derobots humanoıdes et autres robots compa-gnons (chiens artificiels, robots expressifs), quidevraient un jour pouvoir assister des per-sonnes a mobilite reduite ou amuser les enfantset les adultes. Cependant, meme si la meca-nique et le controle bas niveau de ces robotsetaient entierement satisfaisants, un grandnombre de travaux resterait a faire pour pro-curer a ces systemes un « cerveau » capable deles controler et de leur donner des moyensintuitifs, efficaces et acceptables pour interagiravec des humains (modeles de l’attentionconjointe, capacite a afficher un etat « emotio-nel », capacite a prendre son tour dans uneinteraction). Les problemes d’ingenierie re-joignent plusieurs grandes questions dessciences cognitives et sont directement lies ala tres haute integration de ces robots. La diver-site de leur capacite d’action et de perceptionrend possible le test de modeles cognitifs com-plexes. Mais malgre les percees recentes dansla comprehension du cerveau et des dyna-miques neuronales sous-jacentes, la compre-hension de ces mecanismes cognitifs continued’etre un fantastique defi en partie a cause del’enorme quantite d’informations qui doiventetre incluses dans ces systemes.
Ces travaux se retrouvent dans la robo-tique epigenetique qui essaie de combinerles sciences du developpement, les neuro-sciences, la biologie, la robotique cognitive etl’intelligence artificielle. L’une des questionsfondamentales est de comprendre commentdes structures cognitives complexes emergentdes interactions d’un systeme « incarne » avec
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 48 (60)
48
un environnement physique et social. La robo-tique epigenetique ou developpementaleinclut le double but de comprendre des sys-temes biologiques par une integration pluridis-ciplinaire entre sciences sociales et sciences del’ingenieur et, simultanement, de permettre ades robots et autres systemes artificiels dedevelopper des capacites d’apprentissage etd’adaptation a des environnement tres diversau lieu de devoir programmer une solutionpour chaque comportement desire (solutionsouvent limitee, de plus, a un environnementdonne).
La communaute francaise est presentedans ces differents domaines, mais avec desequipes souvent trop isolees et un manquede moyens pour aborder les defis que posecette nouvelle robotique. Malgre une volonteaffichee dans certains appels d’offres de l’ANR,on ne retrouve que tres peu de travaux reelle-ment pluridisciplinaires impliquant a niveauegal la robotique et les sciences cognitives(l’un servant trop souvent d’alibi a l’autre).
4 – LES SCIENCESCOGNITIVES VUES DEPUISLES SCIENCES PHYSIQUES
ET MATHÉMATIQUES
Bien que relativement peu de physicienset de mathematiciens en France travaillent surdes thematiques relevant des sciences cogni-tives, il existe neanmoins une communauteactive et reconnue internationalement, avecune tradition deja ancienne (en physique,essentiellement depuis le milieu des anneesquatre-vingts pour ce qui est de la modelisa-tion), avec une reconnaissance de ces thema-tiques par les commissions disciplinaires (ainsi,la section 02 inclut « cognisciences » dans la listede ses mots-clefs). On constate aussi dans lesannees recentes, aussi bien en France qu’al’etranger, une augmentation de l’interet desmathematiciens pour ce domaine et un flux
regulier de physiciens et mathematiciens rejoi-gnant des laboratoires interdisciplinaires ourelevant d’une autre discipline que la leur (engeneral, la biologie). La formation par la phy-sique (experimentale ou theorique) ou par lesmathematiques, sur des sujets a l’interface avecd’autres disciplines, est assurement l’un deselements-clefs du succes de l’apport de cesdisciplines.
4.1 SCIENCES PHYSIQUESET SCIENCES COGNITIVES
La physique est avant tout une disciplineexperimentale. Elle fournit des outils auxautres disciplines. Parmi ceux devenus essen-tiels en sciences cognitives, on peut citer lestechniques d’IRM, l’imagerie photonique oudes techniques encore plus recentes et tresprometteuses de suivi optique de moleculesuniques, permettant par exemple l’etude dela dynamique des neuro-recepteurs lors dudeveloppement du systeme nerveux. Dansces cas de nouvelles techniques, les expe-riences sont le plus souvent le fait de collabo-rations entre physiciens et biologistes. En fait,la biophysique experimentale est en pleinessor, avec certaines composantes orienteessciences cognitives, comme par exemplel’etude des bases physiques de systemes sen-soriels. Ces experiences concues selon uneapproche physique abordent des questionssous un angle different de ce qui se pratiquedans un laboratoire de biologie et conduisent adevelopper des techniques experimentalesplus « naturelles », destinees a etre mises enœuvre dans le cadre d’un laboratoire de phy-sique (par exemple, la conception de capteursde type « MEMS », Micro-Electro-MechanicalSystems).
Mais la physique ne s’interesse aux expe-riences qu’a travers un cadre conceptuel ettheorique et elle developpe pour cela desoutils conceptuels et des approches analy-tiques et numeriques. Ceux-ci, relevant enparticulier de la physique theorique, de la phy-
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 49 (61)
49
sique statistique, de la physique des systemesdynamiques non lineaires, ont fait leur preuveegalement dans le domaine des sciencescognitives, par des apports significatifs dansle domaine de la modelisation. Dans cedomaine, les frontieres sont souvent flouesavec les mathematiques appliquees (proba-bilites, systemes dynamiques) ou avec l’in-formatique (lorsqu’il s’agit de simulationsnumeriques, dites « multi-agents » en informa-tique, ou de developpements algorithmiques,comme les algorithmes d’apprentissage, parexemple).
La modelisation des physiciens s’attaquea diverses echelles – de la biophysique de lasynapse ou du neurone a la dynamique dereseaux – et avec une gamme de modeles decomplexite plus ou moins grande, cherchantun compromis entre description « realiste » etsysteme analysable mathematiquement. Cestravaux concernent, d’une part, l’analyse desdynamiques possibles (oscillations, bursts)resultant des proprietes biophysiques et,d’autre part, la modelisation du traitementde l’information (fonction de memoire,modes d’apprentissage, codage). La physiques’interesse souvent au passage d’une echellea l’autre (ce qui est la specificite de la phy-sique statistique), par exemple pour expliquerle comportement global d’un reseau ou d’unefonction (par exemple, une fonction dememoire) a un niveau integre, a partir des pro-prietes des neurones composant le reseau. Cestravaux s’attachent, d’une part, a degager des« proprietes generiques » (decrire dans unespace de parametres les differents types decomportements auxquels on peut s’attendre)et, d’autre part, a analyser des systemes speci-fiques (hippocampe, cervelet, retine).
Pour le physicien, il y a un continuumentre les aspects purement biophysiques etceux relevant plus specifiquement des sciencescognitives. Ainsi, comprendre l’eventuellefonction cognitive de synchronies ou d’oscilla-tions demande, entre autres choses, d’analyser,sans a priori sur cette fonction, les conditionspour lesquelles un ensemble de neurones peutavoir ce type d’activite collective. L’etude detelles proprietes dynamiques des reseaux est
actuellement un theme particulierement actif.Un autre domaine essentiel est celui de l’inter-pretation de l’activite neuronale en tant que« code » (quelle information est portee parl’activite neuronale ?). Ce theme ancien estrenouvele par la conjonction des progresdans l’enregistrement d’activites neuronales etles progres theoriques dans l’analyse ducodage, au niveau du neurone individuel etsurtout d’un ensemble de neurones, dans uncadre statistique. La physique statistique, par-tageant avec la theorie de l’information lesmemes concepts fondamentaux concernantl’inference statistique (cadre bayesien), est unacteur important de cette dynamique.
Une autre composante prometteuse est lamodelisation a l’interface cognition/systemescomplexes en SHS. De maniere generale, lesoutils issus de la physique permettent d’ana-lyser l’evolution comportementale d’unepopulation en fonction des capacites d’appren-tissage et d’adaptation des individus. Ceciconcerne les domaines de la cognition sociale,de l’economie cognitive, mais aussi parexemple de la psycho/socio-linguistique(emergence et evolution de la langue). Lesdeveloppements spectaculaires des approchesexperimentales (« behavorial game theory »,economie experimentale, neuro-economie)doivent permettre une modelisation prenanten compte des caracteristiques realistes ducomportement individuel.
4.2 MATHÉMATIQUESET SCIENCES COGNITIVES
Le progres des sciences cognitives est pourune large part tributaire de la place croissantequ’y tiennent les methodes mathematiques demodelisation et les techniques de simulationinformatique. Il ne s’agit pas seulement desoutils mathematiques que l’on trouve danstoutes les disciplines pour analyser les donnees(probabilites et outils statistiques, analyse encomposantes principales, transformee de Fou-rier, etc.). Il s’agit aussi de structures mathema-
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 50 (62)
50
tiques et d’algorithmes specifiques permettantde modeliser et de simuler des classes specifi-ques de phenomenes. En outre, les mathemati-ques constituent par elles-memes un champd’investigation privilegie pour les sciencescognitives quand il s’agit de comprendre lesfondements de la discipline ou encore d’abor-der le probleme de leur enseignement. Enfin, deplus en plus de problemes mathematiques ori-ginaux naissent au sein des neurosciences etvont a coup sur provoquer l’apparition detheories nouvelles. Pour toutes ces interactions,les disciplines de la cognition peuvent compteren France sur une communaute mathematiquedynamique et variee. Cependant, meme si destravaux remarquables sont deja accomplis, ilreste encore beaucoup a faire pour impliquerdavantage les mathematiciens.
Bien que leur essence reside dans lesdemonstrations et dans la production d’algo-rithmes et de calculs, les mathematiques senourrissent de questions qui ont leur originedans les autres sciences. On connaıt lesgrands apports des mathematiques aux neuro-sciences, notamment a travers l’equationd’Hodgkin-Huxley et les systemes non lineairesqui en sont derives. Cette equation demeurefondamentale pour les modeles de neurones,meme si elle necessite encore des amenage-ments (comme ceux que propose la theoriedes bifurcations de systemes dynamiques).Cette direction est toujours tres active, parexemple avec la theorie des modeles canoni-ques. Elle est appelee a se developper encore,par exemple avec les familles universelles debifurcations a plusieurs parametres. Pour sapart, la description mathematique de la dyna-mique interne des activations biochimiques etdes expressions genetiques en est encore a sesdebuts. En revanche, les methodes probabilis-tes en general ont trouve un large terrain d’ap-plications (codage par population, analysebayesienne, apprentissage statistique, etc.). Leparadigme demeure la theorie de l’informationde Shannon, tout en etant parfois complete pardes mesures de complexite algorithmique.Enfin, venant de la physique statistique, lesreseaux de Hopfield sont une autre reference.Il reste cependant encore beaucoup a faire dupoint de vue plus proprement mathematique
que physique. Ainsi, la theorie des systemesmonotones devrait inspirer davantage derecherches. La theorie des processus stochasti-ques intervient egalement, mais c’est encorepeu par rapport a ce qu’elle est en mesured’apporter des maintenant.
Pratiquement, toutes les mathematiquesappliquees se retrouvent quelque part dans ledomaine des sciences du cerveau. Dans cer-tains secteurs, la recherche mathematique aclairement rejoint la recherche en neuro-sciences. Les domaines les plus actifs (enFrance comme ailleurs) sont l’analyse d’ima-ges, l’analyse bayesienne, les statistiques, latheorie de l’information (probabiliste et algo-rithmique), les systemes dynamiques (equa-tions differentielles, systemes statistiques), lesequations aux derivees partielles et la geome-trie differentielle. L’analyse d’images et lavision artificielle impliquent l’ecole d’analyseharmonique, a travers la theorie du signal(ondelettes), les equations aux derivees par-tielles (filtrage echelle-espace, equations dediffusion non lineaires, geometrie multi-echelle, modeles variationnels), la geometriedifferentielle classique et la topologie. Sansdoute les structures a mettre en jeu pour com-prendre la dynamique cerebrale ne sont-ellespas encore toutes exactement formulees. Il estvrai qu’elles ne sont pas faciles a anticiper,dans la mesure ou le cerveau fonctionne a plu-sieurs niveaux, du plus dynamique et du plusconcret jusqu’au plus abstrait. En outre, cesniveaux sont le plus souvent couples etmelent les echelles. Il sera probablementimportant de marier des structures connuesd’algebre et d’analyse, de geometrie et de pro-babilites, mais aussi d’en inventer d’autres. Lesnotions d’invariance, d’ambiguıte et de variabi-lite, dont les mathematiciens ont deja abon-damment traite, sont certainement d’uninteret general pour les sciences cognitives.
Les echanges des mathematiques et dessciences cognitives sont egalement capablesd’offrir une nouvelle comprehension desmathematiques. En particulier, de nouveauxpoints de vue peuvent emerger sur la questiondes fondations des mathematiques. Cettequestion des fondations a inspire de grands
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 51 (63)
51
mathematiciens dans des directions differentes(Poincare et Einstein, mais aussi Leibniz et Hil-bert). Il existe une tradition qui merite d’etrepoursuivie sur l’intuition et la construction del’espace et du temps, faisant appel a la fois auxnotions physiques et aux concepts psychologi-ques. Quel est le rapport entre l’espace repre-sentatif et l’espace des actions ? Y a-t-il un ordred’apparition des geometries au cours du deve-loppement de l’enfant ? Doit-on voir l’originede la geometrie dans les varietes d’oscillationsou bien dans le mouvement et les referencesspatiales necessaires a l’integration multisen-sorielle ? Plus generalement, la questionposee est celle de l’origine sensible des mathe-matiques, comme le font apparaıtre lesreflexions de R. Thom sur la forme et l’infor-mation et sur la semiophysique. La question dela nature des objets communs reste un pro-bleme multidisciplinaire qui concerne lesmathematiques. Enfin, les nombres et les figu-res, leur perception et les operations qu’ils sup-portent, constituent un immense champ derecherche en sciences cognitives, notammenta travers leurs implications pour l’enseigne-ment des mathematiques.
5 – LE RÔLE MAJEURDU CNRS DANS LE SOUTIENAUX SCIENCES COGNITIVES
Les lieux d’ou emergent les questions– nouvelles ou classiques – relevant dessciences cognitives sont multiples : sciencesdu vivant, sciences humaines et sociales,sciences et technologies de l’information etde l’ingenierie, sciences physiques et mathe-matiques. Chaque lieu d’emergence exprimedes besoins d’interaction et etablit des partena-riats intellectuels et strategiques qui illustrentles capacites d’interdisciplinarite presentes ausein de chacune des disciplines.
Le cadre institutionnel le plus facilitateurpour l’interdisciplinarite est evidemment un
organisme ou une pluralite de disciplines estdeja assuree. C’est le cas du CNRS (sans quececi minimise la valeur des contacts que l’orga-nisme entretient a l’exterieur, avec les autresEPST et les etablissements d’enseignementsuperieur et de recherche). Parmi les domainesinterdisciplinaires dont le CNRS fournit lesacteurs, les sciences cognitives constituent undomaine particulierement important. Non seu-lement le CNRS heberge les differentes formesde collaboration interdisciplinaire en sciencescognitives, mais il a ete pionnier en la matiere.La premiere grande initiative de soutien auxsciences cognitives a ete mise en œuvre parle CNRS sous la forme du PIR Cognisciences.Cette operation a contribue significativement ainstaller la recherche cognitive comme un desaxes interdisciplinaires remarques du CNRS. LeCNRS a continue de s’impliquer lorsque lerelais des initiatives a ete pris par d’autres ope-rateurs (GIS Sciences de la Cognition, ACICognitique). Parallelement a ces grands pro-grammes, le CNRS a ete particulierementproactif en lancant au moins quatre Pro-grammes Interdisciplinaires plus thematisespermettant a toutes ses communautes – SDV,SHS, STIC (puis ST2I et MPPU) – de soutenir lesefforts des chercheurs en sciences cognitives.
L’operation la plus recente, lancee par leCNRS a partir de l’initiative de trois Sections duComite National, a ete la creation d’une Com-mission Interdisciplinaire entierementdediee au recrutement de chercheurs situesaux interfaces dans le domaine de la cognition(la CID 45). A la difference des sections, la CIDn’a pas en charge le suivi d’un domaine etd’une communaute stable de chercheurs dansun perimetre predefini de laboratoires. Elleœuvre a l’etape sensible du recrutementdes jeunes chercheurs possedant unedouble formation et des jeunes cadres encharge d’une operation structurante. Elle s’ap-puie sur un ensemble d’expertises croisees etfonctionne comme l’observatoire d’unecommunaute et d’un champ scientifiquequi sont, en fait, en construction permanente.Ce role est illustre, en particulier, par la confec-tion du present rapport, ainsi que la contribu-tion de la CID 45 au Plan Strategique du CNRS(30 septembre 2006). Une autre concretisation
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 52 (64)
52
importante de l’implication du CNRS est lacreation en 2002 d’une UMS, le Relais d’In-formation sur les Sciences de la Cognition(RISC), qui assure une fonction de diffusionde l’information sur les sciences cognitives etjoue un role important dans le developpementde la cooperation entre equipes et entrechamps disciplinaires.
Le role specifique du CNRS dans le deve-loppement des sciences cognitives et la bonnetenue des unites CNRS en sciences cognitivesau plan national, europeen et international jus-tifient que l’organisme investisse dans desstructures et des outils qui permettent la pour-suite de cet effort. Cet effort, qui passe cer-tainement par une concertation avec l’ANR,doit se traduire par une strategie scientifiqueincluant des Programmes Interdisciplinairespropres, des structures federatives (de type« Groupements de Recherche Interdiscipli-naires »), la creation « d’Unites de RechercheInterdisciplinaires » (preconisees dans lerapport de D. Le Queau, « Promouvoir l’Inter-disciplinarite au CNRS ») et, assurement, l’ins-cription dans la duree de la mission de la CID45, qui est une mission permanente.
La communaute des chercheurs CNRSqui contribuent a un ou plusieurs volets dessciences de la cognition est aujourd’hui del’ordre de 600. Un inventaire des formationsrelevant des sections 07, 27, 34 et 35 quiaccueillent des chercheurs engages dans l’in-terdisciplinarite sur le theme des sciencescognitives montre que leur nombre atteint 80.En outre, si l’on considere l’amont, tout aumoins en France, il existe 199 formations uni-versitaires liees aux sciences cognitives, dont4 leur sont entierement dediees sur le cyclecomplet LMD. Il existe donc un potentielhumain considerable, pour qui l’existenced’une CID est un signal fort. L’existence d’uneCID consacree aux sciences cognitives est unmessage significatif a l’intention d’une commu-naute de jeunes chercheurs qui sont incites adevelopper une vraie strategie interdiscipli-naire et qui sont prets a faire le pari difficileet risque de la double, voire de la triple forma-tion. Evidemment, le CNRS attend des jeuneschercheurs un niveau scientifique eleve. Dans
le paysage actuel, ou la competition est intense(depuis 2005, le nombre moyen de candidatspar poste ouvert en CID 45 s’eleve a 16 pour lesCR et 13 pour les DR), il n’y a pas de raison dedouter de la qualite des chercheurs en sciencescognitives recrutes au CNRS sur profil interdis-ciplinaire.
Un autre aspect du potentiel humainconcernant le CNRS est le role des ITA dansla recherche et l’evolution des metiers, en par-ticulier ceux des IR et des IE dans le domainedes sciences cognitives. Il s’agit d’un enjeuimportant pour la conception de la rechercheen general. Dans le domaine qui nous occupe,les developpements informatiques de toutessortes (realite virtuelle, protheses cognitives,informatique pour l’imagerie, neuroinforma-tique, etc.) requierent des competences nou-velles, sans commune mesure avec les besoinsqui existaient dans les premieres annees dessciences cognitives. Les IR et le IE tendent aetre, en general, davantage impliques qu’aupa-ravant dans le questionnement scientifique. Enoutre, le besoin en formation, pour l’ensemblede la communaute, est tres important. Laconstitution de « reseaux metiers » pour lacognition devrait permettre de former, desouder et de dynamiser cette communaute.Les besoins qui s’expriment commencent arecevoir des reponses (par exemple, a traversla creation d’un repertoire des competences etsavoir-faire en sciences cognitives par l’UMSRISC). La valorisation des realisations tech-niques des ITA, qui est souvent trop faible,devrait tirer profit de nouvelles initiatives,comme la mise en place d’une cellule duCNRS chargee d’aller chercher l’innovation aucœur de ses propres laboratoires.
Ce rapport resulte d’un travail effectuepar les membres de la CID 45 (« Cognition,Langage, Traitement de l’Information : Sys-temes Naturels et Artificiels ») en reponse a lademande du Conseil Scientifique du CNRS. Letravail a ete mene avec la participation de JeanLorenceau, directeur du Relais d’Informationsur les Sciences de la Cognition (UMS 2551)et les contributions redactionnelles de DanielBennequin, Christophe Coupe, Colette Fabri-
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 45 – COGNITION, LANGAGE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION : SYSTEMES NATURELS ET ARTIFICIELS
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 53 (65)
53
goule, Bernard Fradin, Line Garnero, PhilippeGaussier, Benoıt Habert, Denis Hilton, PascalHuguet, Daniel Kayser, Jean-Paul Lacharme,Guillaume Masson, Jean-Pierre Nadal, Jean-
Luc Nespoulous, Elisabeth Pacherie, FrancoisPellegrino, Jean Petitot, Joelle Proust, FrancoisRigalleau, Jean-Luc Schwartz, Simon Thorpe etNicolas Vibert.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 54 (66)
54
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 46RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTÉ
Présidente de la CIDMartine HOSSAERT-MCKEY
Membres de la CIDJean-Claude ANDRÉ
Pascale BAUDA
Jean-Yves BOTTERO
Marie CORNU
Pierre GARMY
Janine GIBERT
Claude GILBERT
Michel GRÉGOIRE
Jacky HIRSCH
André LACROIX
Pierre LASCOUMES
Geneviève MICHON
Frédéric OGÉ
Raphaël ROMI
Céline ROZENBLAT
Léna SANDERS
Richard SEMPÈRE
Tarik TAZDAÏT
Anne TRESSET
Marie-Madeleine USSELMANN
MOTS CLES DE LA CID 46 :
– risques naturels et environnementaux :evaluation des risques, impacts socio-econo-miques, perception des risques par la popula-tion, adaptation de l’homme aux changementsenvironnementaux, elaboration de techniquesde prevention, evaluation socio-economiqueet acceptabilite des risques, politique publique,ecologie de la conservation ;
– applications relatives aux risques envi-ronnementaux resultant des changements cli-matiques, du changement d’utilisation desterres, de la pollution des milieux naturels etdes actions sur la biodiversite.
La CID 46 « Risques environnementauxet societe » a pris la suite, a partir de 2005,d’une premiere commission interdisciplinaireœuvrant sur des thematiques proches, intitulee« Environnement continental : logiques etfonctionnements des ecosystemes ». Celle-ci, al’instar des autres CID, n’apparaıt pas specifi-quement dans le Rapport de conjoncture duComite national de la recherche scientifique,edite par le CNRS en 2004. Cependant le texte« Environnement, risques, securite » de l’axe« Environnement, energie et developpementdurable » figurant dans le volume 2 du rapportgeneral (p. 117 sqq.) est suffisamment expliciteet developpe pour nous dispenser de revenirlonguement ici sur les attendus epistemolo-giques generaux des problematiques de laCID. C’est pourquoi on trouvera uniquement
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 55 (67)
55
dans ce qui suit quelques considerationspragmatiques issues d’une experience dedeux annees de fonctionnement de la commis-sion interdisciplinaire (2005 & 2006) et nourriesd’un seminaire de reflexion des membres de laCID, tenu a Montpellier en juin 2006.
La grande originalite de la CID 46 est demelanger deux communautes, celle dessciences humaines et sociales (SHS) et celle,dite des sciences « dures » (SDV et SDU) pourpromouvoir de nouveaux champs de re-cherche integrant les deux domaines.
1 – LES ENJEUXSCIENTIFIQUES
� Les trois mots cles du titre de la CID enfixent clairement le programme et les limites. Ils’agit bien de prendre en consideration lerisque (que l’on definit de maniere tres gene-rale comme le croisement d’un alea et d’unevariable sociale, consideree en termes de vul-nerabilite) dans ses dimensions environne-mentales (ce qui exclut par exemple certainsrisques d’ordre strictement technologique) eten regard de groupes humains en societe. Lesprincipales notions a prendre en compte sontdonc celles de vulnerabilite, de representationet de perception du danger, de memoire durisque, de politiques de gestion et de repara-tion, de comportements face au risque et enfind’evolution dans le temps du risque objectiflui-meme et aussi du concept du risque enfonction des cultures et des societes. Alorsque dans un premier temps, la notion derisque avait pu paraıtre reductrice dans ledomaine environnemental, il apparaıt aucontraire qu’elle est un determinant majeurde la specificite de la CID 46, le risque pouvantdifficilement trouver d’ancrage scientifiquevalide dans le champ des sections monodisci-plinaires du Comite national. On n’ergoterapas sur le libelle du titre de la commissionqui en l’etat a le merite de la clarte. Les mem-bres de la CID aimeraient cependant que le
mot « societes » soit orthographie avec un plu-riel pour mettre en exergue la relativite tempo-relle et spatiale de l’apprehension du risquedans l’environnement. On pourrait en outresonger a une declinaison du type « Aleas, vul-nerabilites, environnements et societes » dontl’avantage serait une explicitation de la notionde risque, meme si elle n’est problematiqueque dans son acception courante et non dansle domaine scientifique.
La finalite declaree des CID etant de favo-riser l’emergence de nouveaux champs derecherche a l’intersection de plusieurs compe-tences disciplinaires, il s’avere dans les faitsque la CID 46 repond effectivement bien acette double exigence. En temoignent lenombre, la diversite et la qualite des candida-tures qu’elle a eu a examiner en deux ans. Levivier scientifique existe et il est generalementd’un excellent niveau, les problematiques por-tees par la CID demeurent d’une totale acuiteet d’une pertinence tres actuelle, aucune sec-tion traditionnelle du CN ne semblant capablede se substituer a elle dans l’etat de l’art pre-sent.
� Ainsi, le champ thematique de la CID 46est globalement articule sur le fonctionnementdes ecosystemes et leur evolution et les ris-ques environnementaux associes. On entendpar ecosystemes les hydrosystemes et lesecosystemes marins et terrestres, en integrantdans ceux-ci la composante anthropiqueexprimee au travers tant des « pressions » ouusages que de la valorisation des ressources(on parlera d’anthropo-eco-systemes), maisaussi la composante historique via les appro-ches « paleos » qui permettent de contraindreles modeles actualistes de l’evolutiondu climat et des environnements et de consi-derer les phenomenes etudies dans la longueduree.
Par ailleurs, la strategie de recherchepeut/doit aussi etre tournee vers l’action envisant a fournir les fondements d’une « ingenie-rie environnementale » pour developper unerecherche finalisee tant vers l’action publiqueque le developpement economique.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 56 (68)
56
1.1 DES APPROCHES COMBINÉES
Le fonctionnement écosystémiqueet sa dynamique
Une approche « ecosystemique » doit enparticulier s’interesser a la dimension tempo-relle, tant au regard de la dimension « histo-rique » (paleo-ecologie) que « prospective »(changement global et production agrono-mique ou evolution climatique et environne-mentale).
L’approche économique et sociale
On peut structurer ces interactions enquatre grandes questions classiques :
– a) en quoi l’activite economique de laproduction (de biens et de services) participe-t-elle a la modification des ecosystemes, despaysages et du climat ? Quels risques cree-t-elle pour l’environnement naturel ? Quelssont les decisions et modes d’organisation desentreprises et des pouvoirs publics qui peuventaccroıtre ou reduire ces risques ?
– b) en quoi les differentes societes, dufait de leur histoire et de leurs savoirs re-pondent-elles differemment aux transforma-tions de leur milieu et de leurs ressources ?
– c) en quoi les modifications des ecosys-temes, des paysages et du climat influencent-elles en retour le cours des activites econo-miques ? Quels risques courent ces activiteseconomiques du fait de ces modifications ?Quelles modifications engendrent les risquesles plus forts et quels modes d’organisation etde decision adoptent les entreprises et les pou-voirs publics pour s’en premunir ?
– d) en quoi le savoir produit par lesetudes scientifiques sur les modifications etalterations des ecosystemes contribue-t-il a lacreation de nouveaux secteurs economiques ?Quelle valorisation economique donner auxtravaux scientifiques ?
L’approche par les risques
L’introduction d’une dimension « risques »dans l’approche des sujets est interessante dupoint de vue heuristique. Cette approche, asso-ciee au fait que le fonctionnement des eco-systemes doit integrer une dimensioneconomique et sociale, conduit a systematiserune approche par alea et vulnerabilite.
L’approche qui considere les risques « natu-rels » (ceux-ci pouvant etre definis comme« causes » par la nature) et les risques « environ-nementaux » (ceux-la pouvant etre « subis » par lanature) semble en effet trop reductrice.
La notion d’alea et de vulnerabilite analy-see au travers du fonctionnement des ecosys-temes, avec prise en compte d’une dimensioneconomique et sociale, est en effet plus fruc-tueuse pour comprendre les processus encause. Elle doit permettre egalement d’explici-ter, notamment dans le cadre d’une approcheprospective liee au changement global, lesphenomenes d’irreversibilite (en utilisant leconcept de resilience) notamment par la miseau point d’indicateurs adaptes.
La mobilisation des demarches interdici-plinaires peut aussi s’averer utile et fecondepour les situations d’incertitude dans lesquellesle risque n’est pas encore pleinement caracte-rise (OGM, produits chimiques, nanotech-nologies, etc.). Elles participent alors auxdemarches de precaution.
L’approche par les risques sera en parti-culier systematique pour les sujets concernant :
– les changements globaux avec notam-ment les consequences de l’effet de serre et dela fragmentation des paysages ;
– les seismes, mouvements gravitaires,tsunamis, etc. ;
– les crues (inondation) et flux associes(erosion). La degradation des sols par l’erosionconstitue un axe important (en particulier enmilieux mediterraneens), ainsi que les amena-gements hydrauliques associes (leurs effets surles crues et les milieux aquatiques, et les conse-quences de leur etat et de leur gestion) ;
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 46 – RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 57 (69)
57
– les contaminations chroniques et/ouaccidentelles des sols et des milieux aquatiquespar les pratiques humaines (produits chi-miques, dechets et leur transformation enmateriaux secondaires), la sante des plantes ;
– la sante humaine via la chaıne tro-phique mais aussi via la degradation de notreenvironnement (air, eau) liee aux developpe-ments de produits ou de technologies etle contact direct avec l’homme ou encorevia l’emergence – ou la reemergence –de maladies liees aux modifications environ-nementales ;
– les invasions biologiques liees a l’acti-vite et aux deplacements humains ;
– d’autres (epuisement des grands aqui-feres, eruptions volcaniques, feux de forets,etc.).
Ces approches combinees doivent per-mettre de traiter la delicate question du com-promis entre la minimisation des risquesencourus par les – ou du fait des – activiteseconomiques et le maintien des fonctions natu-relles assurees par les ecosystemes et garantesde la biodiversite (notion de developpementdurable).
1.2 UNE ÉCHELLE APPROPRIÉE
L’echelle a laquelle les sujets doivent etreabordes de facon privilegiee est la « meso-echelle » (i.e. l’echelle des territoires).
C’est l’echelle des processus ecosyste-miques et de l’action economique et sociale.C’est aussi l’echelle de l’ecologie des paysages.
Cependant, cette meso-echelle doit pou-voir etre depassee, et ceci en particulier dansdeux cas :
– la prise en compte du « changementglobal » qui, dans sa dimension climatique enparticulier, peut mobiliser des « boucles defonctionnement » qui vont au-dela des terri-toires et que l’on abordera au moyen des
outils « paleos » ou historiques, ou prospectifs,correspondant alors a une echelle plus large ;
– l’axe « ecotoxicologie » : au travers de lachaıne trophique ou du contact direct avecdes contaminants, les processus de transfertmettent en jeu, aussi bien dans le milieu quechez l’homme, des mecanismes analysables etconceptualisables a micro et nano-echelle(echelle cellulaire, voire moleculaire).
2 – LES MOYENS D’ACTIONET D’ORGANISATION
À MOBILISER
2.1 CADRESDE L’INTERDISCIPLINARITÉ
Les sections concernees par la CID sontles sections 19 et 20 (SDU), 29 (SDV), 31, 37, 39et 40 (SHS). Suivant la nouvelle nomenclatureet la nouvelle organisation des departementsscientifiques, ceux directement en relationavec les activites de la CID sont : MPPU (Pla-nete et Univers), Sciences du vivant, SHS, EDDet Ingenierie. Au-dela des rapports entretenusavec les sections des autres departements, lelien fort avec le departement EDD, apparu pos-terieurement a la CID, est naturel en raisonmeme de l’interface tres large qui existe entreles preoccupations de la CID et les compe-tences du departement, sans que, pourautant, celles-ci soient reductibles les unesaux autres. Telle quelle, la couverture discipli-naire au sein de la CID apparaıt satisfaisante etpermet de faire face a toutes les situations sansrecours a des expertises exterieures. On peutcependant suggerer d’associer a l’avenir la sec-tion 13 (Physicochimie : molecules, milieux), lasection 18, les deux sections historiques 32 et33 du departement SHS, tant il est vrai quebeaucoup des problematiques de la CID nepeuvent s’analyser utilement que dans letemps long, et enfin la section 36.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 58 (70)
58
2.2 ÉVALUATION
Comme les autres CID, la CID 46 n’est pasune section du Comite national de plein exer-cice. Lui est devolu uniquement le recrutementde chercheurs sur les thematiques interdiscipli-naires qui lui sont propres, mais elle n’assurel’evaluation ni de chercheurs en poste, memepas ceux qu’elle a contribue a recruter, ni delaboratoires. Ces restrictions importantes dansle domaine des competences possibles des CIDn’est pas sans creer de difficultes. Les cher-cheurs recrutes sur des postes dont l’enonceet le champ sont, par definition, interdiscipli-naires se retrouvent aussitot apres leur integra-tion dans une logique de carriere scientifiqueet d’evaluation qui rentrent de facto dans lescompetences d’une section monodisciplinaire.Parallelement, les laboratoires dont la de-marche se situe franchement dans la ligne inter-disciplinaire des thematiques des CID sontastreints, selon la regle de droit commun, aune evaluation de leur activite par une ou plu-sieurs sections du CN mais sont prives de l’ap-port d’une vision interdisciplinaire.
Pratiquement la solution envisageablepourrait etre celle de la co-evaluation entre la– ou les – section(s) de rattachement des cher-cheurs et des laboratoires (ou des equipes) etla CID selon le principe du libre choix desinteresses. L’alourdissement des taches pourles CID, engendre par la mesure qui conduiraita organiser une veritable session d’automne etles visites de laboratoires correspondantes,serait largement compense par le gain en per-tinence scientifique dans le suivi a long termedes chercheurs et des laboratoires. Juridique-ment, le dispositif ne fait aucune difficulte dansla mesure ou il est explicitement vise dansl’article 4 de l’arrete du 12 novembre 2004portant creation des CID au CNRS. « En appli-cation des dispositions prevues a l’article 24 dudecret du 24 novembre 1982 susvise, ces com-missions exercent, dans leur domaine d’acti-vite, les competences devolues aux sectionsdu Comite national de la recherche scienti-fique, notamment en matiere d’analyse de laconjoncture scientifique et de ses perspectives.
Elles exercent toutes les competences devo-lues auxdites sections par les statuts du per-sonnel du Centre national de la recherchescientifique, notamment en matiere d’eva-luation. Elles peuvent etre consultees surtoutes questions relevant de leur domaine,notamment lors de l’evaluation des unites derecherche. ».
2.3 UNE ÉCOLE D’ÉTÉ ?
Les membres de la CID proposent, dansun delai de deux ans c’est-a-dire avant l’expi-ration de leur mandat actuel, l’organisationd’une Ecole thematique dans le cadre des« Entretiens de Cargese » destinee a approfondirla thematique qui leur paraıt centrale : Com-ment se pose la question du risque dans lecadre de l’interaction homme – milieu, societes– environnements, traitee dans l’interdiscipli-narite a echelles multiples d’espace et detemps ? Il conviendrait en effet de s’interrogerau fond sur le regime des connaissances et desrecherches dans le champ, d’examiner lanature et les modalites des transmissionsentre scientifiques et publics (decideurs, ges-tionnaires et grand public) qui se font pourl’heure apparemment assez mal.
2.4 HISTORIQUE DES POSTESET DES RECRUTEMENTS
SUR DEUX ANS
� Depuis sa creation en 2005, la CID 46 aprocede a deux campagnes de recrutementpour un total de 11 postes ouverts auxconcours.
DR 2
2005 : 2 postes ouverts sur les themesrelevant de la CID 46 (46/01) ;
2006 : 0 poste.
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 46 – RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 59 (71)
59
CR1
2005 : 2 postes fleches [Quantification etgestion des risques environnementaux (46/02)– Aspects ethnobiologiques et/ou ethnoecolo-giques de la conservation de la biodiversite,affecte a un laboratoire SDV (46/03)] ;
2006 : 1 poste colorise [Environnement,vulnerabilites territoriales et sante (46/01)].
CR2
2005 : 3 postes fleches [Speciation etmetabolisme des metaux et environnement,affecte a un laboratoire Chimie (46/04)– Impacts socio-economiques du changementclimatique (46/05) – Evaluation des vulnerabi-lites sociales et territoriales dans la gestion desrisques environnementaux (46/06)] ;
2006 : 2 postes fleches [Economie et socio-logie des changements climatiques, affecte a unlaboratoire de l’IPSL (46/03) – Econometrie,econometrie spatiale, affecte au laboratoireSPE a Corte (46/04)],
1 poste colorise (46/02) (Production pri-maire dans les ecosystemes littoraux anthro-pises – Paleo-environnements et hominides).
Du bilan ressortent les elements princi-paux suivants :
– postes banalises : 2 ;
– postes colorises : 2 ;
– postes fleches : 7 dont 2 non pourvus ala suite de concours infructueux (46/05 en 2005et 46/04 en 2006) soit 29 % de perte.
� Les chiffres parlent d’eux-memes et l’oncomprendra aisement que la CID 46, en raisonde l’experience qu’elle a acquise desormais, seprononce sur plusieurs orientations pour l’ave-nir qui lui semblent strategiques :
– il est de la plus haute importance, pourinstaller la pratique interdisciplinaire dans laduree, que l’on recrute non seulement dejeunes chercheurs au niveau CR mais aussides scientifiques experimentes et reconnusinternationalement en prevoyant un volant suf-fisant de postes ouverts au concours de direc-teur de recherche. A cet egard, l’absence en
2006 de postes dans cette categorie est lourde-ment contreproductive, pour le champ inter-disciplinaire bien sur mais aussi et surtout parle message negatif qu’on envoie ainsi auxjeunes chercheurs attires par une demarcheinterdisciplinaire sur leur avenir a longueecheance ;
– le coloriage des postes permet a la foisau CNRS d’affirmer une politique scientifiqueforte mais pragmatique qui affiche des inten-tions et des orientations a court et moyen termemais tient compte du potentiel humain existanta un moment donne. Le coloriage sur un profil,pour prendre tout son sens, devrait etre main-tenu sur plusieurs exercices budgetaires jus-qu’au recrutement effectif, au meilleur niveau ;
– tous les postes ouverts aux concours nepeuvent pas etre colorises. Une proportion de50 % maximum semble raisonnable : elle prendeffectivement en compte la necessite d’unepolitique volontariste de recrutement sur desthematiques considerees comme prioritairessans pour autant y enfermer toute la jeunerecherche interdisciplinaire et laisse une partsignificative a des propositions spontaneessur des sujets emergents qui auraient autre-ment beaucoup de difficulte a s’imposer ;
– a contrario, le flechage des postes pre-sente une quantite d’inconvenients quidevraient etre dirimants. La seule vertu qu’onpuisse lui attribuer eventuellement est parfaite-ment identique a celle du coloriage dansl’affirmation d’un plan programme de recrute-ment. En revanche, il conduit, dans une pro-portion deraisonnable de cas, a ne paspourvoir les postes mis au concours ou biena retenir des candidats qui, hors flechage,n’auraient certainement pas supporte laconcurrence d’autres candidats de niveau lar-gement superieur ;
– il va sans dire, en outre, mais certainsflechages passes montrent que ce n’est pas uneevidence partagee par tous, que les profils fle-ches ou colorises qui n’entrent pas clairementdans les thematiques interdisciplinaires de laCID sont a proscrire categoriquement. Oncomprendra dans cette categorie les postesdont le caractere interdisciplinaire reste a
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 60 (72)
60
demontrer (par exemple concours 46/04 en2005 et en 2006), et ceux dont le principalmot cle releve a l’evidence d’une autre CID(par exemple concours 46/01 en 2006).
2.5 PROPOSITIONSDE COLORIAGES DE POSTESÀ COURT ET MOYEN TERMES
– pollutions anciennes, marqueurs,risques contemporains et developpementdurable (CR2) ;
– societes, cultures et invasions biolo-giques (CR) ;
– anthropologie de l’environnement (CRou DR) ;
– agrobiodiversite et societes (CR ouDR) ;
– dynamique des paysages : modelisationdes interactions milieu physique/processusecologiques/activites humaines (CR) ;
– etude et modelisation des processus dela dynamique cotiere en relations avec les ame-nagements anthropiques et le changement cli-matique (CR) ;
– evaluations socio-economiques desproduits de la prevision oceanographique.
3 – LE POSITIONNEMENTNATIONAL
ET INTERNATIONAL
Il est clair que le CNRS detient un role cledans le developpement des recherches sur ledomaine interdisciplinaire qui est celui de laCID 46. Meme si d’autres etablissements(INRA, CIRAD, quelques universites, etc.) ytiennent une place, de facon institutionnelle
parfois, en raison de l’implication personnellede chercheurs et d’enseignants chercheurs plussouvent, on voit mal quel acteur public, endehors du CNRS, pourrait jouer le role structu-rant a moyen et long terme dans un champ dela recherche desormais constitue mais encoreneuf, en le maintenant a l’ecart des ecueils tou-jours presents de la « recherche – action » et desderives finalistes.
Au niveau international il s’agit encored’une demarche assez innovante favori-sant l’emergence de nouveaux champs derecherche a l’intersection de plusieurs do-maines de competences. Peu d’exemplessont connus au niveau institutionnel et laaussi le CNRS a sa carte a jouer en tant quedemarche novatrice.
3.1 MODALITÉSD’INTERVENTION DU CNRS
Le champ scientifique couvert par laCID 46 s’est vu dote en quelques annees descadres conceptuels, methodologiques et epis-temologiques qui lui etaient necessaires pourconstruire son objet et le legitimer. Legitima-tion qui provient en outre d’une fortedemande sociale et politique, cristalliseerecemment par la mediatisation de quelquesgrands desordres environnementaux dedimension planetaire (rechauffement clima-tique et ses consequences visibles, appauvris-sement de la biodiversite, OGM, etc.). Le CNRSse doit de renforcer son leadership dans cesdomaines d’avenir en poursuivant une poli-tique ambitieuse et determinee qui passe parun affichage significatif d’emplois au recrute-ment et a la promotion, y compris au niveaupost-doctoral, par le soutien a la constitutionde reseaux de type GDR structures au niveauinternational (GDRE et GDRI), par le lance-ment autonome ou la participation au lance-ment d’appels a projets specifiques au niveaunational (ANR) et international.
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 46 – RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 61 (73)
61
3.2 PROPOSITIONSDE PROGRAMMES
INTERDISCIPLINAIRES PRIORITAIRESDANS LE CHAMP DE LA CID 46
– echelles et changements d’echelle desapproches du risque dans l’environnement : dunanoscopique au global ;
– modelisation des processus historiqueset prospective dans l’evaluation des risquesenvironnementaux ;
– risques environnementaux et pau-vretes.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 62 (74)
62
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 47ASTROPARTICULES
Président de la CIDJean-Loup PUGET
Membres de la CIDÉmile-Michel ARMENGAUD
Éric AUBOURG
Jean BALLET
Geneviève BÉLANGER
Karim BENAKL
Francis BERNARDEAU
Pierre BINETRUY
Luc BLANCHET
Emmanuel GANGLER
Martin GIARD
Christophe GROJEAN
Élyette JEGHAM
Jürgen KNODLSEDER
Sylvie LEES-ROSIER
Marie-Christine LÉVY-NOËL
Jean-Michel MARTIN
Yannick MELLIER
David POLARSKI
Gérard SMADJA
Tiina SUOMIJARVI
INTRODUCTION
Le domaine a l’interface entre physiquedes hautes energies et astrophysique, commu-nement appele « astroparticules », s’est forte-ment developpe durant les dix dernieresannees. Le CNRS en a fait une de ses prioritesscientifiques, et une commission interdiscipli-naire dediee a ete creee et renouvelee.
Les grands domaines couverts par cettespecialite sont :
– l’etude des sources extremes dans l’Uni-vers, produisant des particules de tres hauteenergie ;
– l’utilisation de l’Univers comme labora-toire d’etude des interactions fondamentales,grace aux tres hautes energies et densites quiy sont atteintes ;
– la cosmologie, c’est-a-dire l’etude del’evolution de l’Univers, depuis le Big Bangjusqu’au temps present, ce qui donne aussiacces a la physique des plus hautes energies.
De nombreux autres themes viennent s’as-socier a ces domaines fondamentaux : tests deslois fondamentales (gravite, physique trans-planckienne), astrophysique nucleaire, etc. L’as-troparticule est donc un espace de rencontresentre de nombreuses disciplines de physique(physique nucleaire, physique de la matiere
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 63 (75)
63
condensee, physique quantique, physique desplasmas, physique de la combustion, etc.), avecegalement une riche activite theorique.
1 – LES GRANDESQUESTIONS
Le domaine des astroparticules souhaiterepondre a un certain nombre de questions,dont le nombre et la diversite expliquentl’attrait qu’il provoque :
– le Big Bang : la singularite initiale est-elle fondamentale, ou un reflet de notre igno-rance des lois de la physique pres du Big Bang ?
– l’inflation : son existence sembleconfirmee. Quels sont les mecanismes decette phase d’expansion exponentielle del’Univers primordial ?
– l’asymetrie matiere-antimatiere : lemodele standard de la physique des particulesne peut l’expliquer. Quelle est son origine ?
– la matiere noire : quelle est la naturede la matiere sombre ?
– l’expansion acceleree : quels sont lesmecanismes qui la produisent ? Faut-il modifierla gravitation ou introduire de l’energie noire ?Dans ce cas, quelle est la nature de cette ener-gie noire ? Est-ce une constante cosmologique ?Quelle est son equation d’etat ? Quel est sonlien avec l’energie du vide de la theorie deschamps ?
– la nouvelle physique : gravite quan-tique, dimensions supplementaires (quel est lenombre exact de dimensions spatiales de l’Uni-vers ?) ;
– les limites de validite de la relativitegenerale : de nouvelles experiences devraientpermettre de tester en particulier le principed’equivalence (entre masse gravitationnelle etmasse inertielle) ;
– les premiers objets lumineux :quand et comment sont apparues les premieresstructures (amas, galaxies, etoiles) ? Quelle estla physique de la reionisation de l’Univers ?
– les particules a tres haute energie :quels sont les sites d’acceleration ? Les meca-nismes de propagation ? Quelle est la compo-sition de ces rayons cosmiques ? Leur spectreen energie donne-t-il des indices d’une nou-velle physique ?
– les trous noirs : on sait qu’ils sontassocies a de nombreuses sources de particulesenergetiques. Il reste beaucoup a comprendredans les mecanismes d’accretion et d’ejectionmis en jeu ;
– les sursauts gammas : on commencetout juste a percevoir ce que peut etre leurorigine ;
– les supernovae : comment explosent-elles ? On est encore incapable de simuler l’ex-plosion de certains types de supernovae, pour-tant a l’origine des elements lourds dansl’Univers ;
– les etats extremes de la matiere :quelle est la structure interne d’objets tels queles etoiles a neutrons ?
– la masse des neutrinos : quelle est lamasse des neutrinos, quel est leur role cosmo-logique, quels sont leurs parametres demelange, a l’origine des oscillations de neutri-nos recemment mises en evidence ?
2 – LA NÉCESSITÉD’APPROCHES CROISÉES
2.1 COMPLÉMENTARITÉTHÉORIE-EXPÉRIENCES
Parmi les questions de physique fonda-mentale evoquees dans le paragraphe prece-dent, certaines se posent dans un cadreconceptuel bien determine – par exemple lanecessite de completer notre connaissance dusecteur des neutrinos ou encore la recherchede matiere noire supersymetrique – d’autresont des bases theoriques moins solides et net-tement moins balisees.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 64 (76)
64
Ainsi le probleme que pose l’existenced’une energie noire met en cause notre com-prehension meme de ce que peut etre le videquantique. A ce probleme il n’existe pas dereponses theoriques satisfaisantes, en tout caspas qui repondent a l’ensemble des questionsposees. Les pistes envisagees font appel, qui aune nouvelle composante du fluide cosmolo-gique, qui a des modifications de la gravite al’aide de dimensions supplementaires, etc.C’est sans doute a l’aide d’observations varieesde l’univers a bas redshift – evolutions desgrandes structures, SNs – que l’on parviendraa mieux cerner la nature du probleme.
On se trouve dans une situation similaireavec la physique de l’univers primordial. Si leparadigme inflationnaire a ete largementconsolide par les observations recentes, ilreste un simple cadre de travail. Contrairementau cas de la matiere noire, les theoricienspeinent a proposer des candidats precis aurole d’inflation qui puissent s’inserer dans uneextension du modele standard des hautes ener-gies. Les progres que l’on pourra realiser dansce domaine a moyen ou a long terme s’ap-puient sur des recherches tres transversales,theoriques bien sur, mais aussi observation-nelles avec la reconstruction du spectre desfluctuations de metrique primordial a l’aidedes observations des anisotropies ou de lapolarisation du CMB, mais aussi de l’ensembledes traceurs des grandes structures de l’uni-vers, catalogues de galaxies, releves de lentillesfaibles, nuages Lyman-alpha, etc.
Il est bien sur d’autres domaines quibeneficient de complementarites d’approches,la recherche des ondes gravitationnelles, lacomprehension du mode de fonctionnementde sites astrophysiques tres energetiques ouencore l’emergence des premiers objets del’univers. Au-dela du travail d’investigationtheorique pur, on a besoin ici de s’appuyersur des simulations numeriques dediees degrande ampleur.
Insistons enfin pour une grande classe dequestions sur la necessite de disposer d’appro-ches observationnelles dites « multi-messa-gers ».
2.2 DES STRATÉGIESMULTI-MESSAGERS
Il est clair que la comprehension fine desites astrophysiques extremes passe necessai-rement par la mise en œuvre de moyens obser-vationnels inedits en astronomie traditionnelle.Il s’agit ainsi de collecter autant d’informationque possible a l’aide de plusieurs messagers :
– les photons, depuis les ondes radios jus-qu’aux gammas de haute energie qui tracent leszones d’acceleration de particules, d’annihila-tion de matiere noire et l’Univers primordial ;
– les rayons cosmiques (protons et ions),qui nous renseignent sur les phenomenesd’acceleration, et sur la propagation intergalac-tique et galactique ;
– les neutrinos, qui donnent des informa-tions sur les zones profondes d’objets opaquesaux photons ;
– les ondes gravitationnelles, produitespar les mouvements de la matiere (sourcesastrophysiques et cosmologiques, en particu-lier les trous noirs et les objets compacts) et parl’Univers primordial.
Soulignons que les neutrinos de hauteenergie, les rayons cosmiques d’ultra-hauteenergie et les ondes gravitationnelles sont desdomaines pionniers.
3 – PROJETS EN COURSET FUTURS
3.1 LES GRANDES STRUCTURESDE L’UNIVERS
Plusieurs sondes permettent d’explorer lageometrie de l’Univers, et d’acceder a desinformations sur sa composition et la naturede l’energie noire : supernovae utiliseescomme chandelles standards, fond diffus cos-
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 47 – ASTROPARTICULES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 65 (77)
65
mologique, releves a grand champ, cisaille-ment gravitationnel, oscillations de baryons.La France a une excellente position dans ledomaine des supernovae et du cisaillementgravitationnel (« weak shear ») grace au pro-gramme « Legacy Survey » du CFHT, a Hawaı(CFHTLS, SNLS, SNFactory). Dans le domainedu fond diffus, elle a acquis une experiencecertaine grace a l’experience ballon Archeops,et joue un role important dans la mission spa-tiale Planck, prevue pour 2007, avec un roleleader dans un des deux instruments (HFI),qui devrait permettre des progres importantssur l’etude de la polarisation du fond cosmolo-gique. Il est important d’assurer le retour scien-tifique de ces projets.
Le projet americain SDSS (Sloan DigitalSky Survey), dont la France est absente, bene-ficie en ce moment d’un retour scientifiqueexceptionnel, en grande partie du a la combi-naison entre photometrie a grand champ etspectroscopie.
Vue l’importance des sujets concernes(cisaillement gravitationnel, supernovae,oscillations de baryons, mesures d’amas degalaxies), la France (et l’Europe) doivent defi-nir une strategie de participation a de futursprojets d’astronomie grand champ, qui bene-ficieraient, a l’instar du SDSS, d’une associa-tion avec un survey spectroscopique. Enparticulier se posent les questions d’une par-ticipation au projet LSST et du role de l’ESO.L’extension dans le domaine infrarouge de cessurveys (par exemple avec VISTA) permet decaracteriser des objets plus lointains ; c’estessentiel pour la recherche de supernovae az41.
De la meme facon, la France est pourl’instant absente des projets concernant lesmesures de la raie a 21 cm de l’hydrogeneaux redshifts cosmologiques, qui donne accesen particulier a la physique de la reionisation etaux oscillations de baryons. A court terme ilserait possible d’envisager une collaborationavec des projets tels que LOFAR en Europeou des projets analogues aux USA et en Aus-tralie, et a plus long terme au projet SKA(Square Kilometer Array).
Du cote du fond diffus cosmologique, laprochaine etape est la mesure de sa polarisa-tion, en particuliers des modes B. L’experienceBRAIN, en Antarctique, et le projet spatialSAMPAN sont dedies a ce type de mesure. Al’international un certain nombre d’experien-ces, au Pole Sud ou dans l’Atacama, sont encours de construction. La comparaison entreles possibilites d’une nouvelle experience ausol et d’un satellite est indispensable.
Un autre aspect important du fond diffuscosmologique est l’etude des avant-plans, a lafois en tant que « pollution » du signal cosmolo-gique, et en tant qu’objets d’etude en soi (effetsSZ, Rees-Sciama, physique de la Galaxie et dela MHD interstellaire). La correlation avec dessurveys optiques tels que ceux mentionnes ci-dessus est indispensable afin d’extraire lessignaux les plus faibles.
3.2 ASTRONOMIE GAMMA
La France a une excellente position dansle developpement d’instrumentation dans cedomaine, illustree par son role de leader dansle satellite INTEGRAL (PI du spectrometre SPI,fourniture du detecteur principal de l’imageurIBIS), et a la contribution importante au tele-scope Cherenkov HESS en Namibie. Il convientd’assurer le retour scientifique de HESS, et ledeveloppement de HESS2 est une priorite. Lelancement du satellite GLAST est prevu pour2007 ; malgre le retrait du financement CNES en2003, l’IN2P3 et le CEA contribuent significati-vement a ce projet. HESS2 et GLAST explorenttous deux une gamme de frequence peu obser-vee jusqu’a present mais cruciale.
Le projet Simbol-X en collaboration avecl’Italie, choisi dans le cadre de l’appel d’offresdu CNES de satellites en vol en formation,ouvre une nouvelle generation de telescopesspatiaux pour l’astronomie a hautes energies.Le lancement est prevu pour 2012.
Dans le domaine des sursauts gammas,une etape importante est l’analyse des contre-
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 66 (78)
66
parties optiques qui peuvent servir de sondescosmologiques. C’est un des enjeux du projetX-Shooter (spectrographe au VLT, prevu pour2007). Les enjeux concernent a la fois la cos-mologie (diagramme de Hubble a plus grand zqu’avec des supernovae) et la physique deshautes energies.
Le satellite SVOM/ECLAIRs, developpedans le cadre de la collaboration avec la Chineet prevu pour un lancement fin 2011, ameliorerala detection des sursauts eux-memes.
3.3 RAYONS COSMIQUESDE HAUTES ÉNERGIES
L’excellente presence de la communautefrancaise dans l’experience AUGER, en Argen-tine, doit etre soulignee.
La possibilite de detecter les rayons cos-miques par les ondes radio produites lors dudeveloppement de la gerbe est actuellementexploree par le projet CODALEMA. Outre soninteret pour les rayons cosmiques (cout, et dis-ponibilite jour et nuit du detecteur), les com-petences acquises pourraient se reveler utilesdans le domaine de l’astronomie impulsion-nelle et dans le cadre d’une future participationa des projets de releves cosmologiques tels queSKA et LOFAR.
Le futur de l’experience AMS est lie a celuide la station spatiale internationale, et doncincertain.
3.4 MATIÈRE NOIRENON BARYONIQUE
L’experience EDELWEISS a obtenu d’ex-cellents resultats, en partie grace a l’existencedu Laboratoire Souterrain de Modane. La phaseEDELWEISS II utilise 10 kg de germanium. UneR&D vers la tonne est entamee, il convientmaintenant de construire un projet europeenautour de la technologie la plus adequate. Il est
important de pouvoir utiliser differents mate-riaux, et pour cela de disposer de plusieursmethodes de rejection des particules chargees.Pour maintenir la bonne position internatio-nale des equipes francaises sur ce domaine,un effort important sur les technologies utili-sees est indispensable.
La detection indirecte offre de bonnesperspectives, aussi bien par l’intermediaire dedetecteurs gamma qu’avec des telescopes aneutrinos tels qu’Antares.
Du cote des accelerateurs, le LHC et lepossible futur accelerateur lineaire pourraientapporter leur contribution a l’enigme de lamatiere noire, en creant en laboratoire les par-ticules dont elle est peut-etre formee.
3.5 NEUTRINOS
Pour les neutrinos de haute energie, l’ex-perience Antares est en cours de deploiementet permet d’envisager un telescope a neutrinosen vraie grandeur (KM3).
Du cote des basses energies, plusieurstechnologies sont utilisables et actuellementexplorees, tel le projet Double-CHOOZ(aupres d’un reacteur) ou les projets aupres d’ac-celerateurs, qui amelioreront notre comprehen-sion des oscillations de neutrinos et pourraientaider a comprendre l’asymetrie matiere-antima-tiere. Un detecteur Cherenkov Megatonne, dansle tunnel du Frejus, permettrait d’ameliorer leslimites sur la duree de vie du proton, et de detec-ter les neutrinos en provenance d’une super-nova proche. Dans ce domaine, l’elaborationd’une strategie a long terme et d’un choix entreces methodes est indispensable.
3.6 GRAVITATION
Microscope, actuellement en construc-tion, testera le principe d’equivalence. En cequi concerne les ondes gravitationnelles,
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 47 – ASTROPARTICULES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 67 (79)
67
VIRGO entre dans sa phase d’exploitation,avec une tres bonne participation francaise, etsera suivie par une phase VIRGO 2. L’etapesuivante consiste a explorer une autre gammede frequence, probablement beaucoup plusriche, avec une experience spatiale, LISA,dans laquelle la France vient d’entrer. Une pre-miere etape est le demonstrateur LISA-PathFin-der. La detection des ondes gravitationnelles al’aide d’instruments de type LISA devrait deve-nir, a long terme, un outil observationnel d’im-portance comparable a l’optique.
Le chronometrage des pulsars rapidespermet de mettre une limite superieure auxondes gravitationnelles de periodes longues,en particulier les ondes gravitationnelles d’ori-gine primordiale. Des reseaux internationauxde chronometrage des pulsars se mettentactuellement en place, pour realiser le « pulsartiming array ».
Dans le domaine de la metrologie :
– le chronometrage des pulsars rapidespermettra, grace a la construction d’un referen-tiel celeste, de lier le systeme de reference dusysteme solaire au systeme de reference extra-galactique ;
– la realisation d’ephemerides de pulsarsa l’aide de l’observation radio est indispensablepour rechercher les contreparties gamma deces objets, en particulier avec GLAST.
3.7 THÉORIE
Les grands chantiers de physique fonda-mentale restent lies d’une maniere ou d’uneautre au probleme de la construction d’unetheorie unifiant gravite et mecanique quan-tique. La theorie des cordes en est de loinl’approche la plus elaboree. Il reste qu’elle nepropose pas d’extension bien definie dumodele standard des particules.
In fine ce qu’on aimerait avoir c’est evi-demment un scenario complet :
– qui rende compte d’une phase infla-tionnaire permettant d’engendrer les grandesstructures de l’univers ;
– qui contienne une extension du modelestandard des particules avec une (ou des) par-ticule(s) de matiere noire et qui permette unebaryogenese ;
– qui rende compte d’une energie noire.
On en est encore loin ; les travaux actuelss’attachent a l’une ou l’autre de ces facettes, leplus souvent dans le cadre de la theorie descordes, quelquefois dans des approches alter-natives. A ce jeu-la, c’est la richesse d’une com-munaute qui en fait sa force, avec des expertsen theorie des cordes, en physique de l’universprimordial, en physique des particules ouencore en relativite generale. La communautefrancaise s’est indeniablement etoffee dans cesdomaines ces dernieres annees. L’effort doitetre poursuivi.
Une autre grande activite theorique estcelle de simulations numeriques de milieuxcomplexes. Citons dans ce cadre le projet Hori-zon dont un des objectifs est de mieux cernerles phenomenes physiques lies a la formationdes premiers objets de l’univers ou encorel’evolution des grandes structures de l’univers.On peut aussi citer la realisation de simulationsnumeriques de coalescence d’objets compactspour la generation des ondes gravitationnellesou encore la realisation de codes de magneto-hydrodynamique decrivant la physique des jetsou des disques d’accretion. Soulignons quece sont la de veritables projets qui necessitentdes ressources humaines et techniques im-portantes. D’autres chantiers sont en coursd’ouverture comme la comprehension de lapropagation de particules dans les milieuxastrophysiques, le developpement des gerbesatmospheriques.
3.8 QUESTIONS STRATÉGIQUESPOUR CE SECTEUR
INTERDISCIPLINAIRE
Les sections precedentes montrent larichesse de ce secteur aussi bien par les ques-tions fondamentales posees que par les appro-
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 68 (80)
68
ches methodologiques multiples qu’il neces-site.
Les chercheurs, enseignants-chercheurset ingenieurs travaillant sur ces themes appar-tiennent au CNRS, au CEA et aux universites.L’annexe 1 donnera liste des unites concerneeset leur repartition entre etablissements.
L’existence de la CID 47 a non seulementpermis le recrutement de chercheurs amenantdans une unite le savoir faire et la culture d’unautre departement du CNRS mais a eu, parl’existence meme de ces recrutements sur descriteres d’interdisciplinarite, un effet incitatifsur une partie importante de la population dejeunes docteurs qui ont deliberement choisid’aller effectuer un sejour post-doctoral dansune unite relevant d’un departement ou d’uneculture differents de celle de l’unite ou il/ellesavaient effectue leur these. La CID a aussirecrute au niveau CR1 et DR2 des chercheursetrangers de haut niveau qui ont permis d’ac-celerer le developpement de nouveaux sujetscritiques. Enfin la CID a organise un seminairede prospective qui a reuni les chercheurs deces thematiques et, outre la production d’undocument de prospective, a aussi permis aces communautes de debattre et d’apprendrea se connaıtre.
Notons cependant que ces recrutementsde chercheurs etrangers sont rendus difficilespar les salaires et les moyens de recherche quela France peut offrir par rapport a d’autres pays,comme en temoignent des desistements auniveau CR1. En outre, sur certains concours,des flechages – non pertinents pour une CID– ont complique le processus de recrutement.
Ce bilan est donc tres positif. Les CID nesont pas, et n’ont pas de raison d’etre, desstructures permanentes. Il est par contre essen-tiel que quand une CID est dissoute, la redis-tribution des thematiques qu’elle couvrait etleur place dans le dispositif de recherchesoient pleinement pris en compte dans le nou-veau decoupage des sections du comite natio-nal qui lui non plus n’a pas vocation a etreimmuable.
Au sein du CNRS, tous les chercheurs etingenieurs travaillant sur ces themes depen-
dent du nouveau departement MPPU. Lesgrands projets instrumentaux soit d’observa-tion soit de simulation sont pilotes par l’undes deux instituts (IN2P3 et/ou INSU), souventen collaboration avec le CEA et avec desmoyens mis en place par le Centre d’EtudesSpatiales. De plus, trois grandes agences inter-nationales – le CERN, l’ESA et l’ESO – pilotentles grands projets internationaux de ce secteur.Cette structure complexe appelle plusieursremarques et suggestions :
– le partage des responsabilites entredepartements et instituts doit imperativementetre clarifie pour ce qui concerne les moyenshumains que le CNRS dedie aux grands projetsde ces secteurs, en particulier aux TGE interna-tionaux. Les agences internationales exigent deplus en plus des engagements precis etcontractualises. Les mecanismes pour la miseen place d’une part, le suivi d’autre part de cesengagements doivent etre etablis en liaisonetroite avec les etablissements partenairesnationaux (CEA, CNES) ;
– la prospective de cette thematique doitetre coordonnee en impliquant toutes lesagences concernees, afin de definir en memetemps les questions scientifiques critiques pourla periode concernee et les projets dans les-quels les equipes francaises doivent s’engager.Cette prospective ne peut se faire valablementqu’avec une bonne visibilite de la situationinternationale et surtout europeenne. Il est anoter que l’articulation de la strategie duCNRS par rapport aux structures europeennesest implicitement incluse dans « positionne-ment national et international » mais pas expli-citee. Dans le secteur concerne par ce rapport,le contexte international est celui de la compe-tition ou de la collaboration bilaterale avec lesequipes travaillant sur les memes sujets, maissurtout l’organisation europeenne de la re-cherche essentielle pour un secteur ou les pro-jets sont souvent lourds ;
– le recrutement de chercheurs sur lesthematiques nouvelles croissantes doit etresoutenu par le decoupage et l’intitule des fu-tures sections du comite national et par descoloriages pluriannuels de postes ;
COMMISSION INTERDISCIPLINAIRE 47 – ASTROPARTICULES
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 69 (81)
69
– cette thematique represente une frac-tion grandissante des activites des deux insti-tuts du CNRS (IN2P3 et INSU) qui est distribueeentre eux. Le fonctionnement de ces institutsdoit etre rediscute pour tenir compte de cetteevolution.
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 70 (82)
70
Index des auteurs
Les références renvoient au numéro de page.
AMSILI Pascal, 31ANDRÉ Jean-Claude, 55ARMENGAUD Émile-Michel, 63AUBOURG Éric, 63AURAY Jean-Paul, 1AUROUX Aline, 7
BALLET Jean, 63BATEMAN-NOVAES Simone, 1BAUDA Pascale, 55BAUNEZ Christelle, 1BEAUVILLAIN Pierre, 7BÉLANGER Geneviève, 63BENAKL Karim, 63BERNARDEAU Francis, 63BERTRAND Gilles, 7BINETRUY Pierre, 63BLANCHET Luc, 63BOISSEAU Patrick, 7BOTTERO Jean-Yves, 55BOULLIER Dominique, 7BOUVARD Manuel, 1BUNGENER Martine, 1
CADOR Martine, 1CASELLAS Claude, 1CAVE Christian, 31CELLIER Dominique, 23CHAILLAN Franck, 1COGNARD Christian, 23
CORNU Marie, 55
DEL CUETO Carlos, 31DELEAGE Gilbert, 23DENIS Michel, 31DERVAUX Benoît, 1DJUKIC Jean-Pierre, 7DOUILLARD Jean-Marc, 7DREYSSE Hugues, 7DRILLON Marc, 7DUFOURC Érick, 23DUTOUR Olivier, 1
EL MASSIOUI Farid, 1ENCLOS Philippe, 1
FABRIGOULE Colette, 31FAINI Giancarlo, 7FASANO Laurent, 1FLAVIGNY Pierre-Olivier, 23FRADIN Bernard, 31FROIDEVAUX Christine, 23
GANDRILLON Olivier, 23GANGLER Emmanuel, 63GARMY Pierre, 55GARNERO Line, 31GASCUEL Olivier, 23GENTAZ Édouard, 31GIARD Martin, 63GIBERT Janine, 55
GILBERT Claude, 55GRANGE Thierry, 23GRÉGOIRE Michel, 55GROJEAN Christophe, 63GROSS Christian, 1GUILLEN François, 7
HELARY Gérard, 7HERMANN Nicolas, 23HIRSCH Jacky, 55HOSSAERT-MCKEY Martine, 55HUDELOT Christian, 31
JEGHAM Élyette, 63
KNODLSEDER Jürgen, 63
LACHARME Jean-Paul, 31LACROIX André, 55LAREDO Philippe, 7LASCOUMES Pierre, 55LAURENT Louis, 7LEES-ROSIER Sylvie, 63LÉVI Yves, 1LÉVY-NOËL Marie-Christine, 63
MAALOUM Julie, 23MARENDAZ Christian, 31MARTIN Jean-Michel, 63MASSON Guillaume, 31MAUREL Nathalie, 23
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 71 (83)
71
RAPPORT DE CONJONCTURE 2006. INTERDISCIPLINARITE
MELLIER Yannick, 63MICHEL Christian, 23MICHON Geneviève, 55MILLET Jacques, 1MOATTI Jean-Paul, 1
NESPOULOUS Jean-Luc, 31
OGÉ Frédéric, 55
PACHERIE Élisabeth, 31PAUGAM-MOISY Hélène, 31PERTHAME Benoît, 23PIERREL Jean-Marie, 31POLARSKI David, 63
PRUM Bernard, 23PUGET Jean-Loup, 63
RIGALLEAU François, 31ROMI Raphaël, 55ROZENBLAT Céline, 55
SAGOT Marie-France, 23SANDERS Léna, 55SCHMOLL Patrick, 7SCHWARTZ Jean-Luc, 31SEMPÈRE Richard, 55SIMONSON Thomas, 23SMADJA Gérard, 63SUOMIJARVI Tiina, 63
TAZDAÏT Tarik, 55
THINUS-BLANC Catherine, 31THORPE Simon, 31TIFFOCHE Christophe, 1TOUBOUL André, 7TRESSET Anne, 55
USSELMANN Marie-Madeleine, 55
VINCK Dominique, 7
VIOUX André, 7
WALTER Gérard-Richard, 31
WESTHOF Éric, 23, 11
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 72 (84)
72
Coordination et réalisation
COORDINATION SCIENTIFIQUE
Gilles BOËTSCH
COORDINATION TECHNIQUE
SGCN – Caroline BAUER-HACKER
RÉALISATION
CNRS ÉDITIONS
Centre national de la recherche scientifiqueSecrétariat général du comité national (SGCN)3, rue Michel-Ange75794 Paris cedex 16
Rapport_conjoncture2_08152 - 7.7.2008 - 15:59 - page 73 (85)