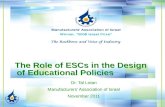Anna Lotan Greens Professional Skin Rejuvenation Brochure (Hebrew Version)
Quelles Limites Pour LOTAN
-
Upload
soumaya-elhichri -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Quelles Limites Pour LOTAN
QUELLES FRONTIÈRES « NATURELLES » POUR L'OTAN ? David G. Haglund Armand Colin / Dunod | Revue internationale et stratégique 2002/3 - n° 47pages 37 à 45
ISSN 1287-1672
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2002-3-page-37.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haglund David G.,« Quelles frontières « naturelles » pour l'otan ? »,
Revue internationale et stratégique, 2002/3 n° 47, p. 37-45. DOI : 10.3917/ris.047.0037
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Armand Colin / Dunod.
© Armand Colin / Dunod. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
CONTROVERSE
Quelles frontières « naturelles » pour l’OTAN ?David G. Haglund*
■ LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUEDAVID G. HAGLUND ■
Le recours à la métaphore d’« architecture » étant fréquent dans les débats sur lasécurité européenne et transatlantique, l’introduction de cette contribution, relative àla future configuration de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), sedevait donc d’y faire référence. Louis H. Sullivan, l’un des plus grands architectes amé-ricains de la fin du XIXe siècle, aimait à prêcher que, dans son domaine, « la fonctionprécède toujours la forme ». Le travail de ce pionnier, notamment dans la constructiondes gratte-ciel, allait devenir une référence pour une génération entière d’architectesaméricains, et marquera, de manière irrémédiable, le paysage urbain des grandes villesaméricaines1. La maxime de L. H. Sullivan a parfois été récusée par les générations sui-vantes d’architectes, certains d’entre eux préférant même en inverser les termes, faisantdépendre la fonction de la forme. Mais ceux d’entre nous, qui sont aujourd’huiconfrontés à la question de l’élargissement et de la future configuration de l’OTAN,devront, à l’évidence, s’inspirer de la sagesse du principe énoncé par cet entrepreneur.Tant que le statut et la composition de l’OTAN ne seront pas redéfinis, il sera impos-sible de concevoir, de manière précise, ce que doivent être ses frontières « naturelles ».
En effet, ceux qui étudient la configuration territoriale des pays savent à quel pointil est difficile de définir une frontière « naturelle ». Néanmoins, il apparaît souventque, une fois que les États ont établi des frontières durables, celles-ci sont si adéqua-tes qu’elles semblent avoir été préétablies et ordonnées par un être divin ou, tout aumoins, par une logique innée. Dans le cas des frontières naturelles des États-Unis, cesdeux références ont été invoquées tout au long de la période de l’expansion territo-riale. En effet, pour chaque vague de colons, ce qui semblait être une frontière natu-relle (les Appalaches, le Mississippi, les Rocheuses, puis même le Pacifique) apparais-sait, pour celle d’après, comme une simple halte sur la route de la conquêteterritoriale et de la gloire nationale2. Mais l’exemple américain n’est pas isolé, comme
La revue internationale et stratégique, n° 47, automne 2002
* Professeur du Département d’études politiques de l’Université Queen’s, Canada.1. L. H. Sullivan révolutionna l’architecture urbaine américaine en s’aidant de la technique de cons-
truction par structure d’acier. Ainsi, en 1891, il construisit le Wainwright Building, à Saint-Louis, dans leMissouri. Il fonda l’« École de Chicago », qui réunissait également John Wellborn Root, Daniel Burnham,Dankmar Adler et Frank Lloyd Wright. Voir, à ce propos, Sean Dennis Cashman, America in the GuildedAge : From the Death of Lincoln to the Rise of Theodore Roosevelt, New York, New York University Press,2e éd., 1988, p. 127.
2. Albert K. Weinberg est celui qui a le mieux rendu compte des fondements théoriques de la quêteaméricaine de ses frontières naturelles, Manifest Destiny : A Study of Nationalist Expansionism in AmericanHistory, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1935 ; rééd., Chicago, Quadrangle Books, 1963.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
le montre le cas des frontières « naturelles » de la France. Cependant, le processus futinversé. Car, si l’Hexagone apparaît aujourd’hui comme la forme naturelle du pays,cette même forme géométrique a, pendant longtemps, souffert d’une image négative,rappelant douloureusement qu’elle ne représentait que les vestiges d’un empire, autre-fois glorieux1.
Par ailleurs, si les nations ou les États possèdent une configuration intrinsèque, etse développent en dehors de tout plan préconçu, en revanche, les organisations inter-nationales sont, par essence, des entités « fonctionnelles », créées pour répondre à desproblèmes spécifiques. Mais il faut savoir prendre de la hauteur lorsqu’il s’agit dedéterminer leur cadre opérationnel. Autrement dit, nous devrions pouvoir concevoirles limites territoriales de leur action. Ainsi, certaines organisations ont une vocationuniverselle, l’Organisation des Nations unies (ONU) ou l’Organisation mondiale ducommerce (OMC), par exemple. En ce qui les concerne, nous pouvons conclure queleur champ de compétences s’étend sur la planète entière. Mais la plupart des autresorganisations internationales ont une vocation régionale, et, puisqu’il est difficile dedéfinir l’aire géographique que couvre une « région », il nous faut nous attarder surla signification de leurs sigles.
QUE RECOUVRE UN SIGLE ?
En ce qui concerne l’Alliance atlantique, on aurait pu espérer être guidé par les initia-les de son sigle : l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. Il est vrai que rien danscette dénomination ne suggère une adhésion immuable. Cependant, on peut en déduireque son élargissement doit se faire dans le cadre de ses frontières « naturelles », commecela a été le cas à plusieurs reprises. Ainsi, on pourrait supposer que, à leur tour, cesfrontières évoluent suivant les contours de l’aire géographique couverte par la régionnord-atlantique. La pierre d’achoppement réside dans le fait que, dès ses origines,l’Alliance n’a pas été un regroupement régional nord-atlantique, et ce, à double titre.
D’une part, l’Alliance ne regroupe pas tous les pays de la région nord-atlantique.En Europe, les exceptions sont notables : l’Irlande, dès la création de l’Organisation,et l’Espagne, pendant plus de trente ans. De plus, l’océan Atlantique Nord est séparéde l’Atlantique Sud par l’équateur. Ainsi, à la fois dans le Nouveau Monde et sur leVieux Continent, de nombreux pays du littoral nord-atlantique n’ont jamais eu, etn’auront jamais, de perspective d’adhésion à l’Alliance.
D’autre part, la garantie de défense collective, définie dans l’article 5 du traité deWashington, du 4 avril 1949, couvre des pays qui se situent en dehors de la régionnord-atlantique. Dans le Nouveau Monde, l’OTAN s’étend ainsi jusqu’aux rivages del’océan Pacifique, et bien au-delà, jusqu’à Hawaï et l’Alaska avec ses îles Aléoutien-nes. Sur le Vieux Continent, un effort d’imagination est nécessaire pour considérercertains alliés (la Turquie, la Hongrie, la République tchèque ou encore l’Italie et laGrèce) comme des pays voisins du littoral atlantique.
On pourrait alors répliquer, à la question posée par le titre de cet article : Pour-quoi l’OTAN doit-elle nécessairement avoir, à l’avenir, des frontières naturelles déter-minées, alors qu’elle n’en a jamais eues par le passé ? En effet, certains analystesconsidèrent l’Alliance comme une « communauté de démocraties libérales », c’est-à-dire un groupe d’États liés par un attachement à des valeurs politiques communes,
38 ■ LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
1. Eugen Weber, My France : Politics, Culture, Myth, Cambridge (Mass.), Belknap Press of HarvardUniversity Press, 1991, p. 69-70 : « L’une des raisons pour lesquelles, pendant si longtemps, personne nes’est référé à l’“Hexagone”, pour évoquer la France, de la même manière que l’usage populaire veut quel’on parle de l’“Élysée” lorsqu’on évoque la présidence, tient à ce que cette forme géométrique ne parais-sait pas suffisamment majestueuse. Les grandes idées appellent les grands noms... »
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
plutôt que par la crainte d’un adversaire commun. Si tel était le cas, les frontières del’OTAN correspondraient alors simplement à celles de l’expansion de la démocratie1.
Avant d’en conclure que les frontières de l’OTAN s’étendront jusqu’aux cieux, ilnous faut envisager la question de la nature juridique de l’Alliance, telle qu’elle estdéfinie par sa charte constitutive, le traité de Washington de 1949. L’article 10, relatifà l’admission de nouveaux membres, dispose : « Les Parties peuvent, par accord una-nime, inviter à accéder au traité tout autre État européen susceptible de favoriser ledéveloppement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de larégion de l’Atlantique Nord [...]. »2 Le puzzle semble alors résolu : les frontières natu-relles de l’OTAN ne peuvent pas s’étendre au-delà de celles de l’Europe, et incluent,bien entendu, les deux États d’Amérique du Nord enfantés par le Vieux Continent,les États-Unis et le Canada.
Cependant, l’expression « frontière naturelle » recouvre une autre réalité. En effet,elle peut se référer aussi à un champ de compétences, plutôt qu’à de simples critèresd’adhésion. Ainsi, les Balkans ont longtemps été considérés comme situés « hors zonede défense » de l’OTAN, alors qu’ils faisaient, incontestablement, partie intégrante ducontinent européen. L’OTAN a, pendant longtemps, eu pour mission principale ladéfense collective de l’Europe occidentale contre l’URSS, perçue comme une menacepour son intégrité territoriale. Mais les mandats des organisations internationalesévoluent en fonction du contexte géopolitique, et, aujourd’hui, personne ne contesteque les Balkans se situent naturellement dans le champ d’opération de l’Allianceatlantique.
Aussi, pour répondre à la question soulevée par cet article, il nous faut envisagerdeux problèmes. Le premier concerne l’élargissement de l’Alliance, qui devrait avoirlieu à l’occasion du sommet de Prague, en novembre 2002. Le second concerne lafonction de l’OTAN, plus que la question de sa forme : quel devra être son champd’opération et l’étendue de ses compétences ? Je commencerai mon analyse par laquestion de la fonction de l’OTAN, car elle est intimement liée aux objectifs que lesÉtats-Unis voudront donner à l’Alliance atlantique. En effet, la conception que s’enferont les décideurs politiques à Washington déterminera l’importance de son élargis-sement et les lieux de son intervention.
DONALD DE GAULLE
Au début de l’année 2002, lors d’une conférence de l’OTAN qui s’est tenue à Gen-val, en Belgique, Dominique Moïsi a attiré l’attention de son auditoire en soulignantque, une fois encore, l’Alliance était menacée par un individu isolé. À la fin desannées 1960, Charles de Gaulle avait déjà défié l’Organisation ; selon D. Moïsi, c’estaujourd’hui au tour de Donald Rumsfeld, le secrétaire américain à la Défense. Ana-lysant le déroulement de la guerre en Afghanistan, D. Moïsi avait posé la questionsuivante : « Qu’advient-il d’une créature lorsque son créateur n’a plus confiance enelle ? »3 Cette question reflète une préoccupation des spécialistes de la politique euro-
DAVID G. HAGLUND ■ 39
1. Michael C. Williams, « The Discipline of the Democratic Peace : Kant, Liberalism and the SocialConstruction of Security Communities », European Journal of International Relations, vol. 7,décembre 2001, p. 525-553.
2. The NATO Handbook : 50th Anniversary Edition, Bruxelles, Office d’information et de presse del’OTAN, 1998, p. 398.
3. Citation d’un article de Thomas L. Friedman, « The End of NATO ? Europe Had Better Catch Up »,International Herald Tribune, 4 février 2002, p. 6. Les 17 et 18 janvier 2002, une conférence avait été orga-nisée, sur l’initiative de la délégation américaine à l’OTAN, et elle était destinée à offrir une opportunité auxreprésentants permanents de l’Alliance et à un petit groupe d’analystes politiques et de journalistes dedébattre des sujets d’actualité de la communauté transatlantique.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
péenne qui porte sur la perception de l’Alliance par l’actuelle Administration améri-caine. Mais l’Europe n’est pas la seule à voir émerger un certain pessimisme quant àla viabilité de l’OTAN. Certains analystes américains mettent en avant les divergencesde points de vue, de plus en plus profondes, entre les États-Unis et leurs alliés euro-péens, devenus lointains. Ainsi, William Pfaff, Daniel Schorr et d’autres analystesdiagnostiquaient même que « l’OTAN est morte »1.
Depuis la fin de la guerre froide, certains analystes ont souvent été prompts àémettre un jugement très pessimiste sur l’avenir de l’OTAN. Dans l’ivresse de la vic-toire qui a suivi l’effondrement de leur rival idéologique de longue date, l’URSS, denombreux experts et analystes politiques américains ont prédit la disparition inéluc-table de l’Alliance, puisque celle-ci était dépourvue de sa raison d’être – à savoir, ladéfense de l’Europe contre une grande puissance adverse2. Peu de temps après, unenouvelle génération d’analystes émergea pour contester l’affirmation selon laquelleles Alliés avaient besoin d’un ennemi commun pour rester solidaires. Ainsi, confor-mément à ce qui allait devenir la pensée dominante, l’OTAN s’est transformée, deve-nant une organisation plus politique que militaire. Sa mission principale n’est plusd’assurer une défense collective à ses membres, mais l’extension de la « zone de paix »en Europe centrale et orientale, dont l’un des aspects est la gestion des conflits dansles zones périphériques de l’Europe3.
L’évolution du mandat de l’OTAN, passant d’une défense collective au principed’une « coopération en matière de sécurité », aura certainement des répercussions surles frontières de l’Alliance. Ainsi, la gestion des conflits périphériques en Europe, quia impliqué un engagement militaire dans les Balkans, a permis d’inclure définitive-ment cette zone dans le champ d’intervention de l’OTAN. Par conséquent, les frontiè-res de l’Alliance se sont étendues grâce à l’implication de l’Alliance dans le conflit,rôle qui lui était reconnu par tous. De plus, si désormais l’extension de la zone depaix est subordonnée à l’emploi de « conditionnalités politiques », incitant les candi-dats à l’adhésion à respecter les principes démocratiques, l’élargissement de l’OTANdevient alors inévitable4.
Avant les attentats du 11 septembre 2001 et la guerre menée en Afghanistan, seulela théorie pouvait étayer les prédictions des acteurs du débat sur la viabilité del’Alliance. Les tenants de la thèse « réaliste », enfermés dans l’idée que, sans ennemi,l’Alliance n’avait plus de raison d’être, se voyaient opposer par d’autres spécialistesmaintes raisons justifiant non seulement sa survie, mais encore son développement.Cette dernière thèse devint la tendance dominante et, ce faisant, expliqua que, en sur-vivant, l’Alliance s’élargirait nécessairement. Pour les tenants de cette thèse, ainsi que
40 ■ LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
1. D. Schorr avait fait ce commentaire, le 13 mai 2002, dans le cadre d’une émission intitulée « AllThings Considered », diffusée par la Radio publique nationale, quelques jours après la publication del’article de William Pfaff, « NATO Is Dead : Allies Look to EU for Future Security », International HeraldTribune, 11-12 mai 2002, p. 6.
2. Voir Kenneth N. Waltz, « The Emerging Structure of International Politics », International Security,vol. 18, automne 1993, p. 75, dans lequel il affirme que les jours de l’OTAN n’étaient pas comptés, mais queses années l’étaient. Le même auteur affirme que l’OTAN a, en réalité, cessé d’exister en tant qu’Alliance.Voir encore, du même auteur, « Structural Realism after the Cold War », International Security, vol. 25,été 2000, p. 19.
3. Pour une analyse pertinente du débat sur la mission de l’OTAN d’un point de vue institutionnel, voirCeleste A. Wallander, « Institutional Assets and Adaptability : NATO after the Cold War », InternationalOrganization, vol. 54, automne 2000, p. 705-735.
4. Une tentative d’exploration des mécanismes de la conditionnalité, du point de vue de la « théorie dela stabilité institutionnelle », est présentée dans l’article de Lars Skalnes, « From the Outside In, from theInside Out : NATO Expansion and International Relations Theory », Security Studies, vol. 7, été 1998,p. 44-87.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
pour l’Administration Clinton et certains gouvernements des pays membres del’Alliance, l’OTAN constitue alors le vecteur principal de diffusion démocratique,l’extension de la démocratie permettant ainsi de réduire les probabilités de conflitsdans la région, selon la « théorie de la paix démocratique ». Celle-ci repose sur leconstat que les démocraties n’ont pas recours à la force pour résoudre leurs litiges.Par conséquent, plus les États démocratiques seraient nombreux, plus la paix seraitacquise1.
Les événements du 11 septembre 2001 ont fourni la preuve que les États-Unis,qui étaient de fervents défenseurs de l’Alliance, ne lui accorderaient plus autantd’importance que par le passé. Ainsi, quelles pourraient être les répercussions de cerepositionnement des États-Unis sur l’avenir de l’Alliance ? La question est perti-nente, et même si D. Moïsi l’a posée de manière abrupte, il nous faut comprendrel’intérêt qu’accordent les spécialistes américains au maintien de la sécurité « multila-térale », que seule l’OTAN semblait, jusqu’à présent, en mesure d’assurer.
QUELLE OTAN POUR LES ÉTATS-UNIS ?
Il serait erroné d’affirmer que le débat public américain est clos et qu’une positionclaire en a été dégagée. Cette dernière pourrait émerger à la suite du sommet dePrague, qui doit avoir lieu en novembre 2002, mais il existe, pour le moment, au moinstrois écoles de pensée qui méritent d’être mentionnées. L’école des « abstentionnis-tes »2, qui a le moins de résonance politique, rassemble ceux qui, pour diverses raisons,souhaitent que les États-Unis se dissocient complètement ou, tout au moins, dans unelarge mesure, de leurs alliés européens. Les deux autres écoles sont celles qui ont le plusde poids et de pertinence dans le débat politique américain actuel, et qui retiendront,pour le moment, notre attention (bien qu’il soit imprudent d’écarter totalement l’écoledes « abstentionnistes »). La première d’entre elles rassemble les « canadianistes »,appelée ainsi non pas parce qu’elle s’est développée au Canada, mais parce que sa per-ception de l’OTAN, comme une alliance politique dont la nouvelle mission est d’assurerune « coopération en matière de sécurité », fait écho au souhait, exprimé depuis long-temps par les Canadiens, de voir évoluer l’identité de l’Alliance3. La deuxième écolerassemble les « globalistes », qui souhaitent non seulement que les capacités militairesde l’Alliance soient renforcées, mais qu’elles soient déployées dans les contrées les pluséloignées du globe. Ainsi, chacune de ces écoles livre une vision différente de ce que les« frontières naturelles » de l’OTAN pourraient ou devraient être.
Pour les « canadianistes », dont la position est assez proche, voire identique, à cellede Richard Haass, conseiller en politique étrangère au département d’État, la confi-guration idéale de l’OTAN devrait être la suivante : l’Alliance devrait être un pointd’ancrage pour les jeunes démocraties, en les accueillant en son sein, s’inscrivant ainsidans la continuité de la vision prônée par l’Administration Clinton. Dans cette pers-pective, l’OTAN devrait aussi, à terme, intégrer la Russie, non par une adhésion
DAVID G. HAGLUND ■ 41
1. De façon surprenante, l’OTAN est apparue comme l’objet d’étude favori d’un groupe émergentd’analystes, les social constructivists, qui soulignaient, inter alia, le pouvoir des valeurs sur la valeur dupouvoir. Voir Rebecca R. Moore, « NATO’s Mission for the New Millenium : A Value-based Approach toBuilding Security », Contemporary Security Policy, vol. 23, avril 2002, p. 1-34. Tous les analystes ne furentpas convaincus. Parmi les sceptiques, on trouve Dan Reiter, « Why NATO Enlargement does not SpreadDemocracy », International Security, vol. 25, printemps 2001, p. 41-67 ; et Errol A. Henderson, Democracyand War : The End of an Illusion ?, Boulder (Co.), Lynne Rienner, 2002.
2. Je rends compte ici, assez librement, du schéma développé par Charles William Maynes, « Conten-ding Schools », National Interest, no 63, printemps 2001, p. 49-58.
3. Voir l’article que j’ai publié, « The NATO of Its Dreams ? Canada and the Co-operative SecurityAlliance », International Journal, vol. 52, été 1997, p. 464-482.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
immédiate, mais en l’associant aux activités de l’Alliance, par la création de nou-veaux mécanismes institutionnels, destinés à renforcer leur partenariat sur les ques-tions de sécurité (le terrorisme, le contrôle des armes, la gestion des crises). Ainsi, lacréation d’un nouveau comité Russie/OTAN, à l’issue de la réunion ministérielle deReykjavik, en mai 2002, montre que cet objectif est en passe d’être réalisé1. Enfin,l’Alliance devrait recourir plus souvent à l’article 4 du traité de Washington, qui éta-blit un mécanisme de consultation, plutôt qu’au volet opérationnel de l’article 5, touten conservant, cependant, sa capacité de défense collective. La conception des « cana-dianistes » est fondée sur l’idée que le contexte de la sécurité internationale a été pro-fondément modifié et qu’il est impératif pour l’Alliance de prendre en compte cettenouvelle donne. L’un des plus importants changements qui soit intervenu est la perted’intérêt dont l’OTAN a fait l’objet aux yeux des Américains. Celle-ci résulte du faitque Washington doit faire face à de nouveaux dangers, qui se situent en dehors de sasphère traditionnelle d’intervention, l’Europe, longtemps menacée par la perspectived’un affrontement entre les deux grandes puissances. Ainsi, les « canadianistes »considèrent que les problèmes de sécurité européens ont été, pour l’essentiel, résolus,et que le spectre d’une confrontation majeure sur le Vieux Continent est totalementécarté. Désormais, la résolution des questions de sécurité en Europe appartient auxEuropéens eux-mêmes. Celles-ci peuvent être gérées par le biais d’un renforcement dela Politique européenne de sécurité et de défense commune (PESDC) et d’une Allianceatlantique nécessairement plus « européanisée ».
En revanche, les « globalistes » refusent de consigner l’OTAN à un rôle secondairesur le grand échiquier américain. Ils estiment que l’Alliance doit reprendre une posi-tion centrale dans la politique étrangère américaine, mais à condition que des modifi-cations structurelles soient effectuées. Selon eux, deux changements indispensablesdoivent, en particulier, être envisagés. Tout d’abord, l’OTAN devra affirmer – cequ’elle ne s’était pas résolue à faire lors du sommet de Washington, en avril 1999 –que son champ d’intervention s’étend au-delà de sa zone traditionnelle d’interventioneuro-atlantique, même si cette dernière a déjà été élargie, dans les années 1990, parl’inclusion des Balkans. Pour les « globalistes », l’OTAN doit s’intéresser à l’ensemblede la planète.
Le second changement concerne la réduction des inégalités dans les capacités mili-taires au sein de l’Alliance. Celle-ci risque d’être problématique pour les alliés euro-péens, engagés dans une maîtrise de leurs budgets de Défense, alors que les « globa-listes » prônent l’inverse. Cependant, ils reconnaissent que la guerre en Afghanistan aconstitué un véritable « vote de désaveu » de la part des États-Unis, vis-à-vis del’Alliance. Selon les « globalistes », ce désaveu s’explique, d’une part, parce quel’Administration Bush a tiré ses propres « leçons » de la guerre en ex-Yougoslavie,en 1999 – à savoir, le refus de voir des contraintes imposées à ses forces militairesdans le cas où il serait absolument nécessaire de gagner la guerre, et ce, par tous lesmoyens –, et, d’autre part, parce que les États-Unis se défient des capacités militairesde leurs alliés, qui, pendant des décennies, ont négligé leurs investissements militaires.
À l’instar des « canadianistes », les « globalistes » sont conscients des avantagesque représenterait un élargissement de l’OTAN. Ces derniers se sont ralliés au point devue des « canadianistes » comprenant l’importance d’un élargissement de la zone depaix en Europe. Ils sont donc favorables à l’adhésion d’au moins sept nouveauxmembres, à l’occasion du prochain sommet. Mais, tandis que les « canadianistes » se
42 ■ LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
1. Voir Todd S. Purdum, « NATO Approves a Pact Giving Russia a Voice in Alliance », InternationalHerald Tribune, 15 mai 2002, p. 1 et 5. Voir également Peter Schmidt, « Eine neue, politische NATO mitRussland ? », Jahrbuch für Internationale Sicherheitspolitik (à paraître).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
contenteraient de voir l’OTAN continuer à se concentrer, plus ou moins activement,sur sa zone traditionnelle d’intervention, les « globalistes » considèrent que la modifi-cation de son mandat originel est insuffisante. En effet, ils soutiennent que, à moinsqu’une Alliance plus affirmée et plus forte fasse la preuve d’une capacité et d’unevolonté d’aider les États-Unis à faire face à la menace globale et « vitale » que repré-sente le terrorisme, ces derniers auront un intérêt limité à préserver l’existence del’OTAN. Par conséquent, si la position des « globalistes » se différencie de celle des« abstentionnistes », il n’en demeure pas moins que le message sous-jacent qu’ilsadressent aux Alliés est clair : renforcez votre politique de défense, sinon, vous pou-vez tirer un trait sur la coopération transatlantique.
LES ENJEUX DU SOMMET DE PRAGUE
Le prochain sommet de l’OTAN, qui doit se tenir, en novembre 2002, à Prague,en Tchéquie, constituera un test majeur de la capacité d’adaptation de l’Alliance. Cefaisant, il désignera quelle école parmi celles qui animent le débat américain verra saposition l’emporter. Il était prévu que le sommet traite essentiellement la question del’élargissement. Mais, petit à petit, il a été annoncé comme le sommet des « capaci-tés », perçu comme une opportunité, voire une dernière chance, offerte aux Alliés,d’apporter la preuve des efforts accomplis en vue de réduire l’écart entre leurs capaci-tés opérationnelles et celles des États-Unis. Les leaders européens de l’Alliance nereproduiront pas l’erreur qu’ils avaient commise lors du sommet de Washington,invoquant la nécessité d’une Initiative sur les capacités de défense (ICD) globale ettrès coûteuse. En effet, il semblerait que cette idée ait été abandonnée, non pasqu’elle soit, dans son principe, sans intérêt, mais parce que la plupart des Alliés ontdes priorités de budget autres que la défense. Le programme qui lui succède présentedes avantages certains. Plus limité, il est destiné à permettre aux Alliés de maintenirdes capacités de combat opérationnelles, en investissant dans des niches fonction-nelles leur assurant ainsi une complémentarité avec les unités américaines – ce quefont déjà, depuis un certain temps, et pour les mêmes raisons, les forces canadiennes1.
Les Alliés devraient donc réussir à résoudre le problème des inégalités des capaci-tés militaires, conformément à une pratique courante au sein de l’Alliance, c’est-à-dire par un compromis qui a l’apparence d’un progrès, sans toutefois en constituerun. Un doute subsiste cependant quant à l’accueil qui lui sera réservé par les « globa-listes ». En ce qui concerne les autres sujets majeurs qui seront évoqués à Prague,notamment celui qui devait dominer le débat – la question de l’élargissement –, unconsensus semble également en voie d’élaboration. En effet, lorsque, en 2000, neufcandidats ont déclaré, de manière quelque peu présomptueuse, leur intentiond’adhérer ensemble à l’Alliance, à l’occasion du prochain élargissement, les expertsont envisagé cet éventuel « big bang » avec beaucoup de scepticisme2. Aujourd’hui, cescepticisme a fait place à une sagesse toute conventionnelle, au point que ce « bigbang » serait imminent. Toutefois, il ne devrait pas concerner les neuf candidats du« front commun » de 2000, mais sept d’entre eux : l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie,la Slovénie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie3.
DAVID G. HAGLUND ■ 43
1. Voir Colin Clark, Amy Svitak, « Transformation, NATO Style : Europe to Trade Do-It-All Militariesfor Niche Forces », Defense News, 29 avril - 5 mai 2002, p. 1 et 4. Pour une approche canadienne de lacomplémentarité des niches, voir David G. Haglund (ed.), Over Here and Over There : Canada-US DefenceCooperation in an Era of Interoperability, Kingston (Ont.), Queen’s Quarterly, 2001.
2. Joseph Fitchett, « NATO Growth Spurt Unlikely by 2002 », International Herald Tribune,23 mai 2000, p. 11.
3. Les deux autres membres de ce « front commun » sont l’Albanie et la Macédoine.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
Il serait inapproprié de considérer le sommet de Prague comme un tournant décisifpour l’Alliance, que ce soit dans le sens d’une rupture ou d’une consolidation. Cepen-dant, l’issue du sommet sera lourde de conséquences pour les tenants de la vision« globaliste » de l’OTAN. À cet égard, si l’Alliance devait encore une fois échouer – cequi sera sans doute le cas – à concevoir que le monde entier lui appartienne, nuldoute que les « globalistes » seront déçus. Mais l’école « globaliste » ne représentepas, à elle seule, toutes les opinions exprimées sur ce sujet, et l’issue probable dusommet – à savoir, une deuxième vague d’élargissement, à laquelle s’ajouteront quel-ques politesses sur les mérites d’une ICD revue à la baisse – devrait satisfaire les« canadianistes ». Pour autant, l’imminence de la démonstration de l’incapacité del’OTAN à s’affirmer comme une solution aux problèmes vitaux des États-Unis ne son-nera pas le glas de l’Alliance, quoi qu’en disent les experts.
Cependant, le sommet devrait confirmer la tendance lourde qui se profile déjàdepuis ces dernières années, notamment que les États-Unis sont de moins en moinsenclins à concevoir l’Alliance comme un outil essentiel pour la défense de leurs inté-rêts. Sur ce sujet, la position des « canadianistes » se résume à la constatation sui-vante : l’OTAN reste un outil de la politique étrangère américaine, mais l’époque oùelle était considérée comme le seul et l’ultime moyen d’expression de la stratégie amé-ricaine est révolue – sous réserve qu’elle ait jamais existé. Si l’Alliance doit servir àWashington, autrement que pour ancrer la démocratie en Europe (un objectif qui nedoit pas être sous-estimé), elle fonctionnera alors à l’image d’une holding, agissant leplus souvent avec le soutien militaire de quelques-uns de ses membres, rarement avectous, à la manière des « coalitions d’intérêts ».
CONCLUSION
Quelles seront donc les frontières naturelles de l’OTAN ? Si la maxime de L. H. Sul-livan devait trouver à s’appliquer ici, alors les frontières se détermineront logique-ment en fonction des responsabilités qu’assumera une Alliance atlantique élargie etplus politique. L’OTAN constituera un groupe d’États dont les frontières deviendrontde plus en plus difficiles à distinguer de celles d’une Europe au sens large, incluantl’Amérique du Nord. Sa composition devrait ressembler à celle de l’Organisationpour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avec la différence majeure quel’OTAN sera en mesure de conserver une capacité militaire d’action pour la gestiondes crises en Europe, capacité que l’OSCE n’a jamais réussie à atteindre.
Cependant, la conservation de cette capacité militaire dépendra de la faculté desEuropéens à subvenir aux besoins de financement de leur politique de défense. LesÉtats-Unis ne vont pas se désengager totalement en Europe, mais ils considéreront– si cela n’est pas déjà le cas – que les enjeux de sécurité appelant une réponse mili-taire se situent désormais en dehors de l’Europe. Parfois, à l’instar de la guerre menéeaujourd’hui en Afghanistan, certains de leurs alliés seront en mesure de participeractivement aux opérations répondant aux enjeux de sécurité internationale. Dansd’autres cas, ils refuseront d’intervenir, ou leur intervention ne sera pas souhaitée.Mais le type de coopération que les États-Unis attendront de la part de leurs alliéseuropéens concernera essentiellement le partage des informations des services de ren-seignement et une coopération en matière d’application du droit, des domaines quirelèvent du troisième pilier de l’Union européenne (UE).
En ce qui concerne le deuxième pilier de l’UE et les aspirations de certains payseuropéens à créer une PESDC viable, il n’est pas certain que, au cas où les « canadia-nistes » gagneraient les faveurs du débat américain, ceci soit défavorable aux intérêtseuropéens, bien que W. Pfaff pense que n’importe quel projet américain concernant
44 ■ LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod
l’OTAN se ferait forcément au détriment des intérêts européens1. Au contraire, le pro-jet d’extension de l’article 4, relatif au mécanisme de la consultation, envisagé parl’école des « canadianistes », servirait, à double titre, les intérêts européens, plus pré-cisément les intérêts de ceux qui souhaitent construire une « Europe de la défense »plus forte.
D’une part, en accueillant sept nouveaux membres, sans que cet élargissementn’implique des coûts trop importants – puisqu’il ne sera probablement pas demandéà ces candidats de s’investir militairement –, l’OTAN continuera à servir les intérêts del’UE. En effet, l’Alliance contribuera, à sa manière, à réaliser les objectifs de l’Europeoccidentale, qui souhaite, à terme, intégrer à moindre coût les pays d’Europe centraleet orientale dans « sa » communauté. Ainsi, en s’élargissant, l’OTAN gardera le rôlequ’elle a toujours joué : celui de bailleur politique de la sécurité européenne. De plus,cette zone de paix devrait être renforcée par un élargissement de l’UE elle-même.Cependant, si les coûts de cet élargissement s’avéraient être lourds, ils pourraient, àterme, remettre en cause le projet européen. Avant que les pays membres de l’UEn’aient déterminé comment ils se partageront le poids financier de la réforme des ins-titutions et du fonctionnement de l’Union, ils devraient au moins savoir gré à l’OTANde résoudre une partie de leurs problèmes.
D’autre part, puisqu’il est évident pour l’école des « canadianistes » que les Euro-péens assumeront davantage de responsabilités dans le maintien de leur propre sécu-rité que par le passé, il en découle nécessairement que l’OTAN deviendra, de plus enplus, une organisation « européanisée » ; sinon, elle ne sera pas. Cette tendance iné-luctable n’impliquera pas forcément une coopération accrue entre l’Alliance et laPESDC, mais cela pourrait être le cas, car des raisons profondes donnent sens à cetteunion. L’une de ces raisons réside dans l’impulsion offerte par la réduction des sub-sides militaires américains, qui ont longtemps soutenu la sécurité européenne. La réti-cence de la majorité des pays d’Europe occidentale à investir de manière plus consé-quente dans leur propre sécurité constitue le handicap majeur du projet européen.Désormais, ce choix ne leur est plus donné.
(Traduit de l’anglais par Émilie Aberlen et Anh-Dao Bassot)
DAVID G. HAGLUND ■ 45
1. William Pfaff, « For Europe, a Tough Call on Defense Cooperation », International Herald Tribune,18-19 mai 2002, p. 4.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
6.20
3.23
8.95
- 2
9/03
/201
5 16
h24.
© A
rman
d C
olin
/ D
unod
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 196.203.238.95 - 29/03/2015 16h24. ©
Arm
and Colin / D
unod