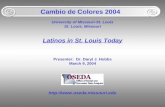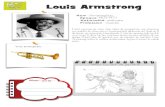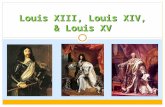Louis Hébert, Université du Québec à Rimouski louis...
Transcript of Louis Hébert, Université du Québec à Rimouski louis...

Applied Semiotics / Sémiotique appliquée, nº 26 (2018) SCHÉMA DE LA COMMUNICATION ET TYPOLOGIE DES SITUATIONS D'ANALYSE
Louis Hébert, Université du Québec à Rimouski
Tentative Entre Ce que je pense Ce que je veux dire Ce que je crois dire Ce que je dis Ce que vous avez envie d'entendre Ce que vous croyez entendre Ce que vous entendez Ce que vous avez envie de comprendre Ce que vous croyez comprendre Ce que vous comprenez Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même... Werber (2000 : 34)
Résumé Un schéma de la communication sémiotique comporte cinq grands facteurs. Ainsi, (3) le produit sémiotique est-il créé par un (1) producteur au cours d’un processus de (2) production et « reçu » par un (4) récepteur au cours d’un processus de (5) réception. En combinant ces facteurs, on dégage, en complétant substantiellement une typologie de Nattiez, 21 grandes situations d’analyse. La typologie convoque différentes formes des facteurs de la communication, notamment selon qu’elles sont empiriques (« réelles », par exemple, l’auteur réel) ou construites (par exemple, l’image que le texte donne de son auteur). Suivent des critiques de la tripartition qu’utilisent Molino et Nattiez ainsi qu’un certain nombre de compléments à la typologie principale. L’un de ces compléments fait état des opérations typiques associées : au producteur et à la production ; au produit ; au récepteur et à la réception. Ces opérations sont respectivement l’intention (ou intentionalisation), l’inscription et la perception. Un autre de ces compléments distingue les sources d’« erreurs » dans le « parcours communicatif », soit (1) la mésinscription (sur- ou sous-inscription) comme conséquence d’une méproduction et (2) la méperception (sur- ou sous-inscription) comme conséquence d’une mésinterprétation.
Introduction
Un schéma de la communication littéraire ou plus généralement sémiotique (mais y a-t-il d’autre communication possible que sémiotique ?) peut servir à produire une typologie

38
des approches analytiques, des produits sémiotiques, etc. Il y a, semble-t-il, du moins pour les approches, deux grandes manières de s’en servir. Dans la première, on établit l’élément du schéma qui est principalement visé par l’approche (par exemple, l’émetteur ou le producteur pour l’approche biographique). Dans la seconde, on précise l’élément de départ et l’élément d’arrivée de la visée analytique. Par exemple, on peut se servir du texte comme point de départ pour collecter des informations sur le producteur comme point d’arrivée.
Les schémas de la communication peuvent être plus ou moins complexes et donc les typologies fondées sur eux seront plus ou moins complexes. Parmi les schémas de la communication qui ont été proposés, il y a celui de Jakobson (1963 ; qui situe les fonctions du langage) et celui de Rastier (1989 : 47-53). Nous avons présenté ailleurs (Hébert, 2001 : 47) notre propre schéma de la communication sémiotique en enrichissant le schéma de Rastier.
Nattiez (1997), en se fondant sur la tripartition de Molino (2009), a établi une typologie de six situations d’analyse en exploitant un schéma de la communication très simple, que nous appellerons le schéma fondamental de la communication. Dans un premier temps, nous enrichirons la typologie de Nattiez et contribuerons ainsi à la classification des approches analytiques qui occupent éventuellement ces situations d’analyse typiques. Dans un second temps, nous apporterons des critiques et des précisions à la tripartition de Molino. Puis nous tirerons parti de la tripartition de différentes manières, par exemple en distinguant des opérations typiques associées : au producteur et à la production ; au produit ; au récepteur et à la réception. Ces opérations sont respectivement l’intention (ou intentionalisation), l’inscription et la perception. Un autre de ces compléments distingue les sources d’« erreurs » dans le « parcours communicatif », soit (1) la mésinscription (sur- ou sous-inscription) comme conséquence d’une méproduction et (2) la méperception (sur- ou sous-inscription) comme conséquence d’une mésinterprétation. 1. Le schéma minimal de la communication
1.1 Les éléments du schéma
La communication littéraire, ou plus généralement sémiotique, peut être envisagée, notamment, comme procédant d’une structure. À ce titre, elle se décompose en termes (ou relata, relatum au singulier), en relations entre les termes (relations ou opérations) et en opérations ou processus (ou actions) structurels (sur les termes, relations ou opérations).
Les principaux éléments de la communication sont trois termes : le producteur (en l’occurrence l’auteur), le produit (en l’occurrence le texte), le récepteur ; et deux processus (qui fondent également des relations) : la production, qui va du producteur vers le produit et la réception, qui va du récepteur vers le produit. Comme on le voit, les opérations sont menées par des termes agents, le producteur et le récepteur, et appliquées sur un terme patient, le produit. On remarque que le processus de réception va du récepteur vers le produit, en ce que le récepteur prend pour objet le produit créé par le producteur. La réception, fut-elle une

39
simple lecture (au sens habituel du terme), est toujours, ou du moins implique toujours une interprétation, au sens que donne Rastier à ce mot, c’est-à-dire l’assignation d’un sens à un produit sémiotique.
Cependant, il y a également un processus, dont nous ne tiendrons pas compte ici, qui va du produit vers le récepteur, en ce que le produit est destiné (comme signal) et éventuellement transmis à un récepteur. On peut appeler « transmission » ce processus et distinguer deux transmissions : celle du document (par exemple, un livre) et celle de l’élément, appelons-le « produit sémiotique », dont le document est le support (le texte que véhicule le livre). De même que le produit sémiotique est le résultat de la production, la lecture (au sens de résultat de l’interprétation) est le résultat de la réception ; cette lecture peut éventuellement être convertie en texte, oral et fixé ou non sur un support, ou écrit et nécessairement fixé sur un support. D’autres éléments encore participent de la structure de la communication littéraire, par exemple le contexte externe (ou entour), dont font partie les systèmes (par exemple, la langue), mais nous n’en ferons pas état ici.
Le schéma ci-dessous représente la structure de la communication littéraire simplifiée telle que nous venons de la présenter. Les principes valent pour la communication sémiotique en général. On peut appeler ce schéma « schéma minimal de la communication », en ce qu’il s’agit du minimum dont on doit faire état pour rendre compte adéquatement de la communication.
Structure simplifiée de la communication littéraire
1.2 Éléments empiriques et construits
En vertu du principe que tout élément d’une structure peut être analysé en lui-même (on le dira alors empirique), ou encore utilisé comme indice, c’est-à-dire point de départ d’une inférence (déduction, induction, abduction), pour connaître un autre élément de la structure dont on dégage alors une version construite (une « image »), on peut distinguer, à partir de la structure que nous venons de présenter, un grand nombre de situations d’analyse (ou perspectives d’analyse).
Nous distinguons donc entre un élément empirique (ou réel) et son pendant construit : producteur empirique (son être, ses intentions, ses messages, etc.) et producteur construit ; production empirique et production construite ; récepteur empirique et récepteur construit (dont, pour les textes, le lecteur modèle et, plus généralement, le récepteur modèle) ; réception empirique et réception construite. Un élément construit est l’« image » que donne de l’élément empirique l’élément qui sert comme source d’informations.
A. Producteur
(auteur)
B. Produit(texte)
C. Récepteurd. production e. réception

40
Si l’on ajoute des éléments au schéma de la communication littéraire, on pourra en distinguer la version empirique et celle construite. Par exemple, Fouquier (1984 : 138) ajoute le monde au schéma et distingue alors entre le monde empirique et le monde qu’il appelle justement « construit ». On pourra, à l’instar de Jakobson, ajouter le code (plus précisément les codes ou systèmes) et le contact et en distinguer les versions empiriques et construites.
Entre un élément empirique et son pendant construit, différentes relations comparatives sont susceptibles d’être établies : identité (ou conformité), similarité, opposition (contrariété ou contradiction), altérité. Par exemple, l’auteur construit à partir du texte peut être très différent de l’auteur réel.
Plus précisément, les éléments construits sont élaborés en utilisant un élément comme source d’indices, mais aussi, éventuellement, en l’utilisant comme source d’informations thématisées. Par exemple, si le texte est l’élément source et qu’il parle de l’auteur directement (par exemple, dans un texte autobiographique), on pourra utiliser ces informations thématisées (inscrites directement dans les contenus du texte) pour produire l’auteur construit. Un même élément peut avoir deux statuts en même temps et relever de deux sortes d’informations : indice et information « directe », thématisée. Par exemple, le fait que l’auteur rapporte tel élément autobiographique humiliant servira à construire l’image d’un auteur plus soucieux de vérité que de son bien-paraître.
Le schéma ci-dessous résume notre propos. Structure simplifiée de la communication littéraire avec éléments empiriques et construits

41
1.3 Aperçus typologiques
Rapportées à notre schéma, les approches littéraires dites internes privilégient le produit en lui-même ; les approches dites externes privilégient soit l’auteur, soit le récepteur. L’analyse du contexte peut être considérée soit comme un troisième type d’analyse externe, soit comme une voie éventuellement intégrée dans l’analyse du producteur, du produit ou du récepteur ; en effet, le contexte influe sur ces éléments et s’y reflète, fût-ce par la négative ou l’omission significative. Distinguons sommairement des familles d’approches selon l’accent qu’elles mettent sur l’un ou l’autre des éléments : auteur (biographie, psychologie de l’auteur, contexte social influant sur l’auteur, etc.) ; production (étude génétique des brouillons, etc.) ; texte (approches dites immanentes : narratologie, rhétorique, sémiotique, etc.) ; réception (théories de la réception et de l’interprétation, de la lecture, etc.) ; récepteur (sociologie du lecteur, psychologie du lecteur, contexte social influant sur lui, etc.). On peut distinguer autant de contextes qu’il y a d’éléments dans le schéma : ainsi le contexte du producteur (de la naissance de l’auteur jusqu’au moment de la fin de la production de l’œuvre voire au-delà) n’est pas nécessairement le même que le contexte du récepteur, le contexte de l’auteur n’est

42
pas coextensif au contexte de la production, puisqu’il le dépasse. Pour une typologie des approches, voir Hébert 2014 et Hébert, 2016-b. 2. Les 21 situations d’analyse
On verra donc les principales situations d’analyse relativement à la structure de la communication littéraire retenue. Nous donnerons des exemples avec des textes, mais également, dans certains cas, avec des œuvres musicales (exemples provenant de Nattiez).
REMARQUE : LA TYPOLOGIE DE NATTIEZ Nous complétons donc une typologie de Nattiez (1997). Nous appelons « producteur » ce qu’il nomme « émetteur ». Nous appelons « production » et « réception » ce qu’il appelle « processus poïétique » et « processus esthésique ». Nous appelons « produit » (ou « texte ») ce qu’il appelle « niveau neutre ». La typologie de Nattiez intègre les deux processus et le niveau neutre, sans distinguer explicitement le processus et l’agent qui lui correspond, soit l’émetteur pour la production et le récepteur pour la réception. Nous les distinguons ici. La typologie de Nattiez distingue six situations d’analyse. Nous en couvrons 21. Voici les correspondances, le premier chiffre référant à la typologie de Nattiez et le second, à la nôtre : 1 = 1 ; 2 = 7 ; 3 = 9 ; 4 = 11 ; 5 = 13. Le sixième cas, du moins dans l’exemple donné par Nattiez, est en fait une combinaison de deux situations : 2 = 7 et 3 = 4 : « La dernière situation analytique correspond à la communication musicale proprement dite [puisqu’elle couvre tous les éléments de la structure]. C’est le cas où l’analyste considère que son analyse immanente est tout autant pertinente pour la poïétique que pour l’esthésique. La théorie de Schenker en est un bon exemple, puisque l’auteur prétend s’appuyer sur des esquisses de Beethoven et considère que ses analyses indiquent comment les œuvres doivent être jouées et perçues. Bien sûr, dans ce cas précis, l’esthésique inductive de Schenker est normative. » (Nattiez, 1997) Faisons remarquer que ce parcours de Schenker, qui va de la production vers la réception en transitant par le texte, ne correspond en fait qu’à une seule des combinaisons possibles entre les trois éléments dont tient compte Nattiez.
2.1 Facteurs en eux-mêmes
1. Le produit, le texte en lui-même (analyse dite immanente) : on analyse l’œuvre en elle-même sans faire de liens significatifs (en nombre et en importance) avec les autres éléments de la communication littéraire. Par exemple, relève de cette perspective l’analyse du sonnet Les chats de Baudelaire par Jakobson et Lévi-Strauss. En musicologie, « L’exemple typique en est sans doute l’analyse du rythme dans Le sacre du printemps par Pierre Boulez. » (Nattiez, 1997)
2. Le producteur, l’auteur en lui-même : on analyse le producteur en lui-même sans faire de liens significatifs avec les autres éléments de la communication littéraire. Par exemple, ce sera une analyse de la vie personnelle de l’auteur. C’était souvent la situation dans les études littéraires traditionnelles, où, en définitive, on parlait peu de l’œuvre elle-même, mais beaucoup du producteur et son contexte (le contexte effectuant son emprise sur le produit par le biais du producteur et de la production).

43
3. La production en elle-même : on analyse la production en elle-même sans faire
de liens significatifs avec les autres éléments de la communication littéraire. Par exemple, on produit une analyse limitée au processus créateur (par exemple, tel qu’il apparaît dans la succession entre deux brouillons consécutifs).
4. Le récepteur en lui-même : on analyse le ou les récepteurs en eux-mêmes sans faire de liens significatifs avec les autres éléments de la communication littéraire. Par exemple, on établira les caractéristiques (par exemple, sociologiques) du lectorat associé à telle œuvre.
5. La réception en elle-même : on analyse la ou les réceptions (lectures, descriptions, interprétations, critiques, analyses, etc.) en elles-mêmes sans faire de liens significatifs avec les autres éléments de la communication littéraire. Par exemple, on fera l’analyse des émotions d’un lecteur à la lecture de l’œuvre. 2.2 Facteur de départ (imageant) et facteur d’arrivée (imagé)
6. Du texte vers le producteur : on se sert du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du producteur. Par exemple, on imagine qui était le Baudelaire réel en se servant d’un texte de Baudelaire comme indice de son auteur.
7. Du texte vers la production : on se sert du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles de la production. Par exemple, on imagine les circonstances, les étapes, etc., de la production de l’œuvre en se servant du texte comme indice de celle-ci. Cette analyse, que l’on peut appeler poïétique inductive, serait « une des situations les plus fréquentes de l’analyse musicale : on observe tellement de procédés récurrents dans une œuvre ou un ensemble d’œuvres qu’on a à peine à croire “que le compositeur n’y ait pas pensé” » (Nattiez, 1997). Faisons remarquer qu’un haut niveau de récurrence n’indique pas nécessairement la présence de conscience. La part non consciente mais structurée d’un créateur peut créer une telle récurrence ; le simple hasard, même si c’est statistiquement peu probable, peut faire de même.
8. Du texte vers le récepteur : on se sert du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du ou des récepteurs. Par exemple, on imagine à quel lecteur l’œuvre s’adresse en dégageant l’image de ce lecteur que l’œuvre dessine (que l’auteur en soit conscient ou non).
9. Du texte vers la réception : on se sert du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles de la réception ou des réceptions. Par exemple, on imagine

44
comment peuvent se produire les différentes réceptions de l’œuvre à partir du texte pris comme indice de celles-ci. Voici comment Nattiez présente cette situation d’analyse :
Comme la poïétique inductive [cas 7], l’esthésique inductive constitue également le cas le plus fréquent de l’analyse musicale. C’est elle qui consiste à faire des hypothèses sur la manière dont une œuvre est perçue en se fondant sur l’observation de ses structures. Dans la plupart des analyses qui se veulent pertinentes perceptivement, le musicologue s’érige en conscience collective des auditeurs et décrète “que c’est cela que l’on entend”. Ce type d’analyse se fonde sur l’introspection perceptive ou sur un certain nombre d’idées générales que l’on peut avoir à propos de la perception musicale (Nattiez, 1997).
10. Du producteur vers le texte : on se sert des caractéristiques du producteur
comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du texte. Par exemple, la misogynie avérée d’un producteur pourra abaisser, par rapport à un texte d’un non-misogyne, le seuil d’activation nécessaire pour percevoir de la misogynie dans le produit.
11. De la production vers le texte : on se sert des caractéristiques de la production comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du texte. « À l’inverse [de la poïétique inductive, cas 7], le musicologue peut procéder à partir de documents extérieurs à l’œuvre – lettres, propos, esquisses – à l’aide desquels il interprète du point de vue poïétique les structures de l’œuvre, d’où le nom de poïétique externe. C’est la démarche que la musicologie historique traditionnelle a pratiquée le plus souvent. » (Nattiez, 1997)
12. Du récepteur vers le texte : on se sert des caractéristiques du ou des récepteurs comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du texte. Par exemple, si tel texte en principe destiné aux enfants plaît également aux adultes, c’est qu’il doit avoir des propriétés particulières de textes pour adultes (syntaxe, vocabulaire plus complexe, sous-entendus plus subtils, etc.).
13. De la réception vers le texte : on se sert des caractéristiques de la réception ou des réceptions du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du texte. Servons le même exemple, pour cette situation et la précédente. Riffaterre considère que si plusieurs récepteurs d’un même texte réagissent, fût-ce de manières opposées, à un même élément du texte, c’est que cet élément est doté de propriétés structurales particulières et qu’il mérite d’être retenu dans l’analyse. Nattiez présente ainsi notre cas 13 : « À l’inverse [de l’esthésique inductive, cas 9], on peut partir d’une information recueillie auprès des auditeurs pour tenter de savoir comment l’œuvre a été perçue, d’où le nom d’analyse esthésique externe que je lui donne. Le travail des psychologues expérimentalistes – qui relève aujourd’hui de ce que l’on appelle la psychologie cognitive – appartient à cette cinquième situation. » (Nattiez, 1997)
14. Du producteur vers le récepteur : on se sert des caractéristiques du producteur du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du ou des récepteurs. Par exemple, souvent le tempérament d’un producteur, tel qu’il informe le texte,

45
sélectionnera de manière privilégiée un lecteur de même tempérament (sauf dans le cas où, par exemple, le lecteur cherche le dépaysement d’un auteur qui lui soit différent).
15. Du producteur vers la réception : on se sert des caractéristiques du producteur du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles de la ou des réceptions.
16. De la production vers le récepteur : on se sert des caractéristiques de la production du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du ou des récepteurs.
17. De la production vers la réception : on se sert des caractéristiques de la production du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles de la ou des réceptions.
18. Du récepteur vers le producteur : on se sert des caractéristiques du ou des récepteurs du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles de l’auteur. On en trouvera un exemple en inversant l’exemple présenté pour le cas 14 : un lecteur de tel tempérament « sélectionne » en principe un auteur de même tempérament ou du moins de tempérament compatible.
19. Du récepteur vers la production : on se sert des caractéristiques du ou des récepteurs du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles de la production.
20. De la réception vers le producteur : on se sert des caractéristiques de la ou des réceptions du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles du producteur.
21. De la réception vers la production : on se sert des caractéristiques de la ou des réceptions du texte comme source d’informations sur les caractéristiques possibles de la production. 2.3 Combinaison de plus de deux facteurs
Évidemment, des renvois d’un élément vers deux autres éléments, éléments corrélés (c’est-à-dire récepteur et réception ou producteur et production) ou non (par exemple, producteur et réception), sont possibles ; inversement, des renvois de deux éléments, corrélés ou non, vers un troisième sont à prévoir. Plus de deux facteurs peuvent également être pris en compte ensemble comme point de départ et/ou d’arrivée. Et peut-être n’est-ce pas là le fin mot des combinaisons possibles ; et c’est sans compter qu’on peut raffiner la combinatoire

46
en ajoutant des variables (par exemple, les systèmes, le contexte, etc.). Évidemment, des situations d’analyse peuvent être combinées, en succession ou en simultanéité. Nattiez en donne deux exemples :
Des allers-retours peuvent s’instaurer entre poïétique inductive [cas 7] et poïétique externe [cas 11]. Par exemple, l’hypothèse poïétique de l’analyste est parfois confirmée par les données fournies par la troisième situation analytique [cas 11]. Parfois, l’analyse poïétique inductive fait découvrir des stratégies poïétiques que l’analyse externe n’avait pu mettre en évidence. […] Tout comme il y a des allers-retours entre poïétique inductive [cas 7] et poïétique externe [cas 11], il y en a entre esthésique inductive [cas 9] et esthésique externe [cas 13] : les expérimentations des cognitivistes viennent vérifier les hypothèses proposées par les analystes qui, comme Meyer ou Lerdahl-Jackendoff, proposent une analyse des structures à pertinence perceptive ; c’est à partir des hypothèses des théoriciens que des expériences peuvent être entreprises (Nattiez, 1997).
3. Approfondissements
3.1 Critique de la tripartition de Molino et Nattiez
Dans la tripartition émetteur, produit, récepteur, le niveau neutre, c’est-à-dire le produit sémiotique en lui-même, est rapporté par Molino (2009 [1975]) et Nattiez (2009) à une « trace matérielle » : « des mots ou des taches de couleur sur une feuille de papier, des simulacres sur un écran, des gestes et des mouvements, une partition, des ondes sonores, linguistiques ou musicales, etc. » (Nattiez, 2009 : 13). C’est, nous semble-t-il, imprécis.
La « trace matérielle » peut alors se subdiviser en stimuli physiques périsémiotiques (par exemple, des graphes) et en supports (par exemple, du papier, un document papier). Les stimuli physiques périsémiotiques sont des occurrences, des manifestations concrètes (par exemple, des phones, des graphes), que recouvrent les types, les modèles abstraits (par exemple, respectivement, des phonèmes, des graphèmes) auxquels ils correspondent. Ces types sont des signifiants.
On pourrait croire que le parcours interprétatif est séquentiel et va du stimulus physique à son signifiant, puis au signifié de ce signifiant, voire, par la suite, à la (re)présentation (image mentale) et/ou au référent associé au signifié et/ou à la (re)présentation. Cependant, ce serait négliger des phénomènes non strictement séquentiels, notamment la sélection réciproque de tous ces corrélats (par exemple, signifiant et signifié se sélectionnent mutuellement) ainsi que les effets cumulatifs, anticipatoires (« préactifs ») et rétroactifs. C’est négliger également des phénomènes antérieurs : les signifiants et signifiés déjà existants (sans parler des (re)présentations) sont le fruit de parcours interprétatifs antérieurs stabilisés et chosifiés, naturalisés.
Le support et les stimuli physiques périsémiotiques sont éventuellement transmis au terme d’un parcours transmissif. Les signifiants, les signifiés, qui composent ensemble le produit sémiotique, et les (re)présentations sont éventuellement communiqués au terme d’un parcours communicatif. Le parcours communicatif présuppose un parcours transmissif. Plus précisément, les signifiants, signifiés et (re)présentations ne sont pas transmis, mais

47
reproduits ; c’est en ce sens que l’on peut dire qu’ils sont communiqués. Le parcours communicatif peut être vu comme unidirectionnel, allant du producteur vers le récepteur, mais en réalité il se décompose en un parcours productif et un parcours réceptif. Un parcours est constitué de termes, de relations, d’opérations, d’étapes, de temps, d’anticipations, de rétrospections, d’anté-actions (ou préactions) et de rétroactions, etc.
Il faut distinguer les corrélats fins et les corrélats moyens. Les stimuli physiques périsémiotiques sont, pour les textes en général, des moyens utilisés seulement pour produire les signifiants et ceux-ci sont des moyens pour produire les signifiés (et ceux-ci, peut-être, des moyens pour produire des (re)présentations), qui sont les fins. Il faut préciser que, dans les textes littéraires, les signifiants sont, en principe, également les fins de la production (par exemple, c’est patent en poésie versifiée). Cependant, dans la musique et la peinture, par exemple, les stimuli physiques, périsémiotiques ou non, sont à la fois des fins et des moyens. En effet, certaines sémiotiques peuvent de nature produire et viser des effets perceptifs physiques soutenus, à priori en dehors de tout effet de signifiant, de signifié ou de (re)présentation. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des signifiants et des signifiés dans ces sémiotiques et cela ne veut pas dire que les stimuli extrasémiotiques ne peuvent pas, par ailleurs, être intégrés comme éléments périsémiotiques.
Au sens le plus large, l’analyse du niveau neutre se produit lorsque l’on exclut ou, devrait-on dire, lorsque l’on essaie d’exclure le plus possible les facteurs de la production et les facteurs de la réception. Cette réduction peut être méthodologique, c’est-à-dire, consciente, explicitée et pertinente (du moins selon un observateur donné). Elle peut être non méthodologique, c’est-à-dire non consciente et donc non explicitée, qu’elle soit pertinente (par accident) ou non (selon un observateur donné). L’analyse du niveau neutre peut donc porter sur les stimuli physiques en eux-mêmes, lorsque la chose est pertinente : notamment, en arts visuels et en musique. Elle est peu pertinente pour la plupart des textes écrits, sauf dans les textes « poétiques » (poèmes ou autres), où la typographie, la mise en page ou la mise en livre, par exemple, peuvent être signifiantes. L’analyse du niveau neutre peut évidemment porter sur les signifiants en eux-mêmes et/ou les signifiés en eux-mêmes et/ou les (re)présentations en elles-mêmes ; « en eux-mêmes », « en elles-mêmes » veulent ici dire, non pas nécessairement séparément, mais plutôt sans les rapporter directement et intensément à la production ou à la réception. 3.2 Statuts d’une même caractéristique selon les perspectives
Considérons que la production, le produit en lui-même et la réception sont les trois grandes perspectives de l’analyse. En faisant varier les perspectives pour une même analyse, on peut vérifier si les caractéristiques ou leur statut coïncident d’une perspective à une autre. Prenons les études génériques. Par exemple, un auteur pourra croire avoir produit un conte, le récepteur pourra considérer qu’il s’agit plutôt d’une nouvelle, tandis que l’analyse immanente pourra produire un troisième classement, et dire qu’il s’agit d’un récit.

48
En faisant varier les perspectives de l’analyse, on peut spécifier si une même caractéristique est : pour ce qui est de la production : voulue ou non (intentionnelle ou non) ; pour ce qui est du produit dans son immanence : inscrite ou non ; et pour ce qui est de la réception : perçue ou non.
Quelques précisions. Nous parlons de perception dans le sens d’une interprétation qui « perçoit » tel élément ; il ne s’agit pas d’une perception non interprétative. S’il existe une intentio auctoris (plus généralement, une intention du producteur), il existe également une intentio operis (une intention du produit) et une intentio lectoris (une intention du récepteur) ; sur ces intentions, voir notamment Rastier (2011 : 237). On pourra donc non seulement distinguer l’intention de la production de sa mise en œuvre effective dans le processus de production, mais également l’intention de la réception de sa mise en œuvre effective dans le processus de réception.
Par exemple, un producteur peut vouloir inscrire et avoir inscrit un thème donné, mais ce thème pourra ne pas être perçu par le récepteur (cas 2 du tableau ci-dessous). Une situation étrange, mais possible est celle d’une mauvaise interprétation qui tomberait pile sur ce qui était voulu par le producteur, mais n’avait pas été inscrit par lui (cas 3 du tableau).
Le tableau ci-dessous présente les huit combinaisons possibles entre les variables présentées.
Les combinaisons entre voulu / non voulu, inscrit / non inscrit et perçu / non perçu
INSTANCES : PRODUCTION PRODUIT RÉCEPTION VARIABLES : VOULU NON VOULU INSCRIT NON INSCRIT PERÇU NON PERÇU Cas 1 + + + Cas 2 + + + Cas 3 + + + Cas 4 + + + Cas 5 + + + Cas 6 + + + Cas 7 + + + Cas 8 + + +
3.3 Correspondance des caractéristiques selon les perspectives
Le tableau ci-dessous présente les quatre combinaisons possibles quant à la teneur de ce qui est « intentionné », inscrit et perçu.
Les combinaisons du contenu « intentionné », inscrit et perçu
PRODUCTION (intention)
PRODUIT (inscription)
RÉCEPTION (perception)
01 A A A 02 A A X 03 A X A 04 A X Y

49
Explications : X = A’ ou ¬ A ou B ou Ø ; Y = A’ ou ¬ A ou B ou Ø (mais Y ne peut être identique au X de la quatrième ligne). A’ = un A transformé par rapport à A (identité partielle) ; ¬ A = opposé (contraire ou contradictoire) de A ; B = élément différent de A sans être similaire ou opposé ; Ø = absence d’élément.
Plus précisément, la combinatoire se fera entre : (1) une caractéristique et son absence (par exemple, roman ou pas ?) ; (2) entre une caractéristique et son opposé dyadique (par exemple, roman ou antiroman ? roman ou poésie ?) ; (3) entre une caractéristique et son opposé non dyadique (par exemple, roman, ou poésie, ou théâtre ou essai ? animal, ou humain ou végétal ?) ; (4) entre une caractéristique et une autre du même ensemble non oppositif (par exemple, telle couleur ou telle autre couleur ? parmi les milliers de couleurs possibles) ; (5) entre une caractéristique et la même caractéristique partiellement identique (par exemple, sonnet régulier ou sonnet irrégulier ?) ; (6) entre une caractéristique et une autre caractéristique qui ne relève pas du même ensemble (par exemple, roman ou fer à repasser ?). 3.4 Compléments possibles
La typologie peut évidemment être complétée. Par exemple, en passant d’une approche catégorielle (du tout ou rien) à une approche graduelle (avec des degrés), on pourra préciser notamment le degré d’intention, d’inscription, de perception (complète, partielle, etc.). Ainsi notre A’, qui est qualitatif, peut également être envisagé sous l’angle quantitatif comme l’aboutissement d’un processus « incomplet » (par exemple, roman ou quasi-roman ?).
On pourra ajouter la variable perceptible / non perceptible (graduelle : non perceptible, faiblement perceptible, toujours perceptible, perceptible sous telles conditions, etc.). Pour prendre un exemple grossier, un compositeur de musique contemporaine pourra prévoir un concert d’ultrasons. Les ultrasons seront voulus, inscrits, mais non perceptibles et non perçus. Les œuvres à microsignes (peinture microtonale, musique microtonale, etc.) jouent sur la frontière entre perception et non-perception, entre signe et non-signe. À l’instar de Klinkenberg (1996 : 68-73), on pourra ajouter la variable : perception consciente / non consciente (par exemple, subliminale).
À l’instar de Klinkenberg (1996 : 70) encore, on pourra ajouter une variable qui reflète l’hypothèse, bonne ou erronée, que se fait le récepteur sur le caractère intentionnel / non intentionnel de tel élément. On peut penser que si l’émetteur veut inscrire un élément, c’est pour qu’il soit perçu, et c’est généralement le cas ; mais il y a sans doute des cas où un émetteur a inscrit un élément qu’il voulait imperceptible ou quasi-imperceptible ; c’est ce qui se produit dans les œuvres à microsignes voire signes minimaux ou signes limites, comme la musique ou la peinture microtonales.

50
3.5 Un dispositif tétradique
Les perspectives peuvent être prises les trois ensemble, comme nous le faisons dans nos tableaux précédents, ou deux par deux. Comme nous l’avons vu, entre les différentes perspectives, des différentiels sont susceptible de se loger. Prenons le comique et les perspectives de la production et de la réception et construisons ce qu’on peut appeler un « carré de la communication » (ou plus exactement un carré de la production et de la réception). En gros, quatre combinaisons sont possibles : (1) comique du côté de la production perçu comme comique du côté de la réception (par exemple, la blague a marché) ; (2) comique du côté de la production perçu comme non-comique du côté de la réception (par exemple, la blague tombe à plat) ; (3) non-comique du côté de la production perçu comme non-comique du côté de la réception (par exemple, on ne rit pas de ce qui justement n’était pas destiné à faire rire) ; (4) non-comique du côté de la production perçu comme comique du côté de la réception (par exemple, on rit de ce qui n’était pas destiné à faire rire, que l’on soit conscient ou non de l’écart entre ce qui était voulu et ce qui a été obtenu). Le non-comique peut être interprété comme ce qui n’est pas comique voire ce qui est sérieux, voire encore ce qui est triste. On voit que si deux sujets observateurs différents sont impliqués dans la comparaison d’une caractéristique en fonction des perspectives, il y aura soit consensus de caractérisation soit conflit de caractérisation.
Ce dispositif tétradique permet évidemment de décrire bien d’autres phénomènes que le comique / non comique. Dressons une typologie grossière. Les phénomènes étudiés peuvent être : des signifiants, des signifiés, des signes ; des systèmes et éléments systémiques (genres, styles, etc.) ; des tonalités (comique / non comique, etc.) ; des éléments dialogiques (croyances, idéologie, sous-entendu / non sous-entendu, présupposé / non présupposé, ironie / non-ironie, etc.) ; des éléments rhétoriques (norme / écart, sens littéral / figuré, etc.) ; des types sociologiques (produits restreints (par exemple, le grand art) / produits de masse (par exemple, le Kitsch).
Techniquement parlant, ces quatre combinaisons avec deux valeurs et leur négation respective forment un 4-Groupe de Klein (à distinguer du carré sémiotique ; voir Hébert 2016a-). Mais nous avons vu que toutes les valeurs en cause dans la comparaison des perspectives ne se laissent pas ramener à une valeur et sa négation. Autrement dit, toutes les comparaisons des perspectives ne produisent pas nécessairement un 4-Groupe de Klein. 3.6 Typologie des « erreurs » communicationnelles en fonction des perspectives
En fonction des perspectives analytiques, distinguons les grandes « erreurs » communicationnelles suivantes : 1. Mésinscription : conséquence d’une méproduction : croire avoir inscrit / non inscrit ce qui est, respectivement, non inscrit / inscrit.

51
1.1 Sous-inscription : conséquence d’une sous-production : ne pas avoir inscrit ce que l’on voulait inscrire et croyait avoir inscrit. 1.2 Sur-inscription : conséquence d’une sur-production : avoir inscrit ce que l’on ne voulait pas inscrire et croyait ne pas avoir inscrit. 2. Méperception : conséquence d’une mésinterprétation : croire inscrit / non inscrit ce qui est, respectivement, non inscrit / inscrit. 2.1 Sous-perception : conséquence d’une sous-interprétation : ne pas percevoir ce qui est inscrit. 2.2 Sur-perception : conséquence d’une sur-interprétation : percevoir comme inscrit ce qui ne l’est pas.
Évidemment, les erreurs peuvent se combiner. On peut ainsi, dans une même interprétation, ne pas voir telle chose qui est inscrite et voir telle chose qui n’est pas inscrite.
On peut considérer que toute production contient une part de méproduction. Cette méproduction n’est en soi ni positive ni négative. Par exemple, un écrivain peut écrire de manière non consciente quelque chose qui est de valeur esthétique supérieure à un élément intentionnel ; de même la non-inscription non consciente de tel élément peut augmenter la valeur esthétique du produit. Symétriquement, on peut considérer que toute interprétation est mésinterprétation. Encore une fois, ce n’est en soi ni positif ni négatif. Par exemple, une lecture mésinterprétative peut contenir une valeur herméneutique supérieure à une lecture parfaite (sur la « lecture erratique », qu’on peut généraliser en réception erratique, voir Saint-Gelais, 2007).
Distinguons la sous-interprétation involontaire, celle que vise notre typologie, de la sous-interprétation volontaire, qui néglige volontairement des éléments, en particulier la sous-interprétation de méthode qui néglige volontairement et de manière pertinente des éléments en vue d’objectifs ciblés. De même, distinguons la sur-interprétation involontaire, celle que vise notre typologie, de la sur-interprétation volontaire. Mais souvent les sur-interprètes ne voient pas qu’ils sur-interprètent ; comme chacun le sait, on est toujours le sur-interprète ou le sous-interprète d’un autre…
Les erreurs et non-erreurs sont associées à des types d’instances qui les produisent. Par exemple, on peut considérer le lecteur modèle comme l’instance qui ne commet aucune erreur interprétative, ou qui ne commet que quelques erreurs interprétatives, ou que des erreurs interprétatives sans incidence importante, ou qui ne commet que les erreurs interprétatives souhaitées (par exemple, en tombant, comme voulu par l’auteur, dans les fausses pistes d’un roman policier).
Notice biobibliographique Louis Hébert est professeur à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Ses recherches portent principalement sur la sémiotique (textuelle et visuelle), la sémantique interprétative, la méthodologie de l’analyse littéraire, l'onomastique, Magritte, le bouddhisme. Il a publié

52
L’analyse des textes littéraires : une méthodologie complète (Paris, Classiques Garnier), Dispositifs pour l’analyse des textes et des images. Introduction à la sémiotique appliquée (deuxième tirage, Limoges, Presses de l’Université de Limoges) et Introduction à la sémantique des textes (Paris, Honoré Champion). Il a dirigé Le plaisir des sens. Euphories et dysphories des signes (Québec, Presses de l’Université Laval) et codirigé, avec Lucie Guillemette, trois livres (Québec, Presses de l’Université Laval) : Signes des temps. Temps et temporalités des signes ; Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité ; Performances et objets culturels. Il a placé en prépublication quelques livres dans Internet, dont Introduction à l’analyse des textes littéraires : 41 approches (http://www.signosemio.com/documents/approches-analyse-litteraire.pdf) et Dictionnaire de sémiotique générale (http://www.signosemio.com/documents/dictionnaire-semiotique-generale.pdf). Enfin, il est directeur de Signo – Site Internet bilingue de théories sémiotiques (www.signosemio.com ; 20 000 visites par mois en moyenne) et d'une base de données Internet sur la quasi-totalité des œuvres et thèmes de Magritte (www.magrittedb.com). Courriel : < [email protected] >.
Ouvrages cités
HÉBERT, L. (2001), Introduction à la sémantique des textes, Paris, Honoré Champion. HÉBERT, L. (2014), L’analyse des textes littéraires : une méthodologie complète, Paris,
Classiques Garnier. HÉBERT, L. (2016-a), Dictionnaire de sémiotique générale, dans L. Hébert (dir.), Signo,
http://www.signosemio.com/documents/dictionnaire-semiotique-generale.pdf. HÉBERT, L. (2016-b), Introduction à l’analyse des textes littéraires : 41 approches, dans
L. Hébert (dir.), Signo, http://www.signosemio.com/documents/approches-analyse-litteraire.pdf.
JAKOBSON, R. (1963), « Linguistique et poétique », dans Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, p. 209-248.
KLINKENBERG, J.-M. (1996), Précis de sémiotique générale, Paris, Seuil. MOLINO, J. (2009), Le singe musicien, Arles, Actes Sud / INA. NATTIEZ, J.-J. (1997), « De la sémiologie générale à la sémiologie musicale. L’exemple
de La cathédrale engloutie de Debussy », Protée, vol. 25, nº 2 (automne), p. 7-20. NATTIEZ, J. J. (2009), « Introduction à l’œuvre musicologique de Jean Molino », dans J.
Molino, Le singe musicien, Arles (France), Actes Sud / INA, p. 13 à 69. RASTIER, F. (1989), Sens et textualité, Paris, Hachette. RASTIER, F. (2011), La mesure et le grain, Paris, Honoré Champion. SAINT-GELAIS, R. (2007), « La lecture erratique », dans B. Gervais et R. Bouvet (dir.),
Théories et pratiques de la lecture littéraire, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 175-190.
WERBER, F. (2000), L’encyclopédie du savoir relatif et absolu, Paris, Albin Michel.