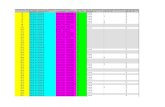lesystmedumond01duhe
-
Upload
dimitris-leivaditis -
Category
Documents
-
view
19 -
download
0
description
Transcript of lesystmedumond01duhe
-
ASTng':c:;v hpraWT-
ijekceLIBRARY OF
WELLESLEY COLLEGE
PURCHASED FROMHorsford Pund
-
LE SYSTMEDU MONDE
-
Pierre DUHEMCORRESPONDANT DE L'iNSTITUT DE FRANCEPROFESSEUR A L'UNIVERSIT DE BORDEAUX
LE SYSTMEDU MONDE
HISTOIRE DES DOCTRINES COSMOLOGIQUES
DE PLATON A COPERNIC
TOME PREMIER
PARISLIBRAIRIE SCIENTIFIQUE A. HERMANN ET FILS
LIBRAIRES DE S. M. LE ROI DE SUEDE
6, RUE DE LA SORBONNE, 6
191
3
-
*s*t^s\
JJt.
HAll
SU
l
-
AYANT-PROPOS
L'uvre dont nous entreprenons aujourd'hui la publication
aura de vastes proportions, pourvu que Dieu nous donne la force
de l'achever. Cette ampleur et effray le trs grand dsintres-
sement de nos diteurs, MM. A. Hermann et fils, si aucune aide
ne s'tait offerte pour les seconder. Une gnreuse subvention de
l'Institut de France, une trs importante souscription du Ministre
de l'Instruction publique ont permis de mettre sous presse les
volumes qui rassemblent les rsultats de nos recherches. Peut-tre
ces pages apporteront-elles quelque utile renseignement au cher-
cheur soucieux de connatre ce que les prcurseurs de la Science
moderne ont pens du Monde, des corps qui le composent, des
mouvements qui l'agitent, des forces qui l'entranent. Que le
lecteur auquel notre ouvrage aura, de la sorte, rendu quelque
service, veuille bien, comme nous -mme, garder toute sa recon-
naissance pour ceux qui sont dues cette subvention et cette sou-
scription ; nous avons nomm M. G. Darboux, Secrtaire perptuelde l'Acadmie des Sciences, et M. Gh. Bayet, Directeur de l'En-
seignement suprieur ; sans leur bienveillance, cet crit n'et pas
vu le jour.
Bordeaux, 4 novembre 1913.
Pierre DUHEM.
-
NUNQUAM IN ALIQUA .ETATE INVENTA FUIT ALIQUA SCIENTIA, SED
A PRINCIPIO MUNDI PAULATM ( IREVIT SAPIENTIA, ET ADHUC NON EST
COMPLETA IN HAC VITA.
(Fratris Roeri BAGOIN Compeiul'iiuii studii, cap. V)
-
PREMIRE PARTIE
LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
-
CHAPITRE PREMIER
L'ASTRONOMIE PYTHAGORICIENNE
I
pour l'histoire des hypothses astronomiques, il n'est pas de commen-
cement ARSOLU. L'INTELLIGENCE DES DOCTRINES DE PLATON REQUIERT
L'TUDE HE L'ASTRONOMIE PYTHAGORICIENNE.
En la gense d'une doctrine scientifique, il n'est pas de com-
mencement absolu ; si haut que l'on remonte la ligne des pen-
ses qui ont prpar, suggr, annonc cette doctrine, on parvient
toujours des Opinions qui, leur tour, ont t prpares, sug-gres et annonces ; et si l'on cesse de suivre cet enchanement
d'ides qui ont procd les unes des autres, ce n'est pas qu'on ait
mis la main sur le maillon initial, mais c'est que la chane s'en-
fonce et disparat dans les profondeurs d'un insondable pass.
Toute l'Astronomie du Moyen-Age a contribu la formation
du systme de Copernic ; par l'intermdiaire de la Science isla-
mique, l'Astronomie du Moyen-Age se relie aux doctrines hell-
niques ; les doctrines hellniques les plus parfaites, celles qui
nous sont bien connues, drivent des enseignements d'antiques
coles dont nous savons fort peu de choses ; ces coles, leur
tour, avaient hrit des thories astronomiques des Egyptiens, des
Assyriens, des Ghaldens, des Indiens, thories dont nous ne con-
naissons presque rien ; la nuit des sicles passs est tout fait
close, et nous nous sentons encore bien loin des premiers hommesqui aient observ le cours des astres, qui en aient constat la rgu-
larit et qui aient tent de formuler les rgles auxquelles il obit.
-
G LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
Incapables de remonter jusqu' un principe vraiment premier,nous en sommes rduits donner un point de dpart arbitraire l'histoire que nous voulons retracer.
Nous ne rechercherons pas quelles furent les hypothses astro-nomiques des trs vieux peuples, Egyptiens, Indiens, Chaldens,Assyriens ; les documents o ces hypothses sont exposes sontrares ; l'interprtation en est fort souvent si malaise qu'elle faithsiter les plus doctes ; toute comptence, d'ailleurs, nous feraitdfaut non seulement pour juger, mais simplement pour exposerles discussions des orientalistes et des gyptologues.Nous ne rapporterons pas non plus, du moins en gnral,
ce que l'on a pu reconstituer des doctrines des anciens sages de laGrce ; les minces fragments, parfois d'authenticit douteuse, aux-quels leurs ouvrages sont maintenant rduits, ne nous laissentgure deviner comment leurs penses sont nes les unes desautres, comment chacune d'elles s'est dveloppe l .
Rsolument, c'est Platon que nous ferons commencer cettehistoire des hypothses cosmologiques; il est le premier philo-sophe dont les crits utiles notre objet nous soient parvenusentiers et authentiques ; le premier, par consquent, dont nouspuissions, au sujet des mouvements clestes, connatre toute lapense ou, du moins, tout ce qu'il a voulu nous livrer de cettepense.
Mais, tout aussitt, nous voyons apparatre ce qu'il y a d'arbi-
traire, partant de peu rationnel, dans le choix d'un tel point dedpart. Pour comprendre les thories astronomiques de Platon, ilne suffit pas d'tudier Platon, car ces thories ne sortent pas
d'elles-mmes ; elles prennent leur principe ailleurs et driventde plus haut. Ce que Platon a crit touchant les mouvementsclestes est constamment inspir par l'enseignement des colespythagoriciennes et, pour bien comprendre l'Astronomie acad-mique, il faudrait bien connatre auparavant l'Astronomie ita-lique.
Nous voici donc amens dire quelques mots des doctrinesastronomiques qui taient reues chez les Pythagoriciens, afin demieux pntrer (-elles que Platon professera.
i. Le meilleur guide que puisse trouver celui qui dsire connatre les doc-trines cosmologiques des Hellnes avant le temps de Platon, c'esl l'ouvragesui \ .1 ut :
Sir Thomas Hbath, {.ristar-chus o/Samos, the Ancient Gopernicus. I Historyof Greek Isl/'onomy to Aristarchus together with Aristarcnus's Treatise on theSizes and Distances oftke Sun and Moon. .1 New Greek Textwith Translationmiil Notes. ' Kfnnl. im '.
-
L ASTRONOMIE PYTHAGORICIENNE 1
II
CE QUE L'ON SOUPONNE DES DOCTRINES ASTRONOMIQUES DE PYTHAGORE
Les ides les plus fausses ont cours depuis longtemps sur lesdoctrines astronomiques de Pythagore, et les efforts des ruditsparviennent malaisment troubler ou ralentir ce cours. Fr-quemment, par exemple, on entend attribuer Pythagore l'hypo-thse qui explique le mouvement diurne des astres par la rotationde la Terre, alors que rien n'autorise croire qu'il ait admis cettehypothse.
Qu'est-il arriv, en effet? Dans les crits d'Aristote, on a trouvque certaines thories astronomiques taient cites comme en faveurauprs des Pythagoriciens . On en a conclu tout aussitt qu'ellesavaient t imagines par leur chef, lillustre sage de la GrandeGrce. Ou oubliait que l'Ecole pythagoricienne a dur de longssicles, qu'elle tait encore florissante au temps d'Aristote, etqu'entre le sixime sicle, o vivait son fondateur ', et le quatrimesicle, o crivait le Stagirite, ses doctrines avaient eu grandementle temps d'voluer.
Qu'est-il encore arriv ? Des polygraphes, des compilateursque de longs sicles sparaient de Pythagore, nous ont rapportsans critique tout ce que l'on contait de leur temps sur ce philo-sophe, transform en une sorte de personnage lgendaire ; et deshistoriens ont eu la navet d'accueillir ces propos comme s'ilsvenaient d'crivains bien informs et dment autoriss.En un de ces mmoires dont la prodigieuse rudition et la pru-
dente mthode ont fait faire de si grands progrs l'histoire de laScience antique, Thodore-Henri Martin a entrepris de marquer ceque l'on pouvait dire, avec quelque certitude, de l'Astronomie dePythagore 2 . Et, tout d'abord, il a fix les rgles qu'il faut suivresi l'on veut retrouver quelques traits authentiques de cette Astro-nomie.
Il ne faut pas attribuer Pythagore ce qu'Aristote ou mmed'autres auteurs plus modernes ont dit des systmes astronomi-
i. On s'accorde placer la vie de Pythagore entre les annes 670 et 470av. J.-C.
2. Th.-H. Martin, Hypothse astronomique de Pythagore (Bulletino di Biblio-grafiaedi Storia dlie Scienze matematiche et fisiche pubblicato da B. Bon-compagni, t. V, 1872, pp. 99-126).
-
8 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
ques des derniers Pythagoriciens. Quelques-unes seulement deces doctrines 1 sont attribues expressment Pythagore lui-mmepar des tmoignages anciens que rien ne contredit ; il y a lieu depenser que celles-l remontent vraiment jusqu' lui ; mais cellesqu'aucun auteur ancien ne lui attribue sont probablement plusrcentes. A plus forte raison, quand des auteurs ancien-!, quiconnaissaient bien les doctrines des Pythagoriciens plus rcents,attribuentunanimement Pythagore des doctrines trs diffrentes,doctrines qui ont d naturellement prcder celles-l dans le dve-loppement de la Philosophie et des Sciences en Grce, et qu'aucunGrec n'avait mises avant l'poque de Pythagore, il y a tout lieude croire quelles lui appartiennent en propre .
Lorsqu'on a tri, l'aide d'un tel crible, les tmoignagesantiques, que reste-t-il que l'on puisse regarder comme reliquesde l'Astronomie du fondateur de l'Ecole italique ?
Il semble assur, en premier lieu, que Pythagore enseignaitque la terre est sphrique et qu'elle est immobile au centre duMonde.
Tout d'abord, il est bien certain que, longtemps avant l'poqued'Aristote, des Pythagoriciens soutenaient ces propositions ; enun de ses plus clbres dialogues, Platon met en scne le pytha-goricien Time, et Time enseigne ces doctrines. D'autre part,des tmoignages divers et concordants affirment que cet enseigne-ment tait celui de Pythagore ; c'est ce que dclarent, par exem-ple, Alexandre Polyhistor, Diogne de Larte 2 qui le cite, etSuidas \Que Pythagore ait connu la loi du mouvement diurne des toiles,
cela ne fait l'objet d'aucun doute ; elle tait familire aux philo-sophes grecs qui lavaient prcd. Mais il semble qu'on lui doiveattribuer un progrs trs considrable sur la science possdepar ces philosophes ; il parait avoir, le premier, discern la loidu mouvement du Soleil.
Les philosophes grecs antrieurs au fondateur de l'Ecole itali-que n'ont prt ' au Soleil qu'un seul mouvement au-dessus dela Terre habite, savoir un mouvement diurne d'Orient en Occi-dent, un peu infrieur en vitesse au mouvement diurne des toiles(ixes dans le mme sens, et accompagn seulement d'un cartannuel du Nord au Sud cl du Sud au Nord. -
i. Th.-H. Martin, Op. laud, p. ioi,'. Diooenes l,.u:i(Tii;s. /) vitis, dogmatibus et apnphtegmatibus clarorum phi-
losophorum lib, VIII, afi-26.3. Suidas, Lexicon, au mot [luQxyopiZuKoq.I\. Tu.-H. Martin, Op. laud., |>. ro2.
-
L ASTRONOMIE PYTHAGORICIENNE 3
Si nous en croyons les renseignements que nous fournissentStobe ' ci le De p/acitis philosophorum faussement attribu ;'i Plu-tarque s
,Pythagore serait parvenu dbrouiller cette marche, en
apparence si complique ; il aurait compris que le mouvement duSoleil pouvait se dcomposer en deux rotations ; de ces deux rota-tions, la premire, dirige d'Orient en Occident, s'accomplitautour des mmes ples et dans le mme temps que la rotationdiurne des toiles ; en cette premire rotation, le Soleil dcrit,sur la sphre cleste, un cercle parallle I'quateur ; la secondea lieu d'Occident en Orient, autour de ples autres que ceux dumouvement diurne, et elle est parfaite en un an : il y a tout lieude penser que Pythagore la regardait aussi comme uniforme ; enelle seconde rotation, le Soleil dcrit, sur la sphre cleste un grandcercle, Vcliptique, dont le plan est inclin sur celui de I'quateur.
Le gnie grec, si sensible la beaut' qu'engendrent les combi-naisons gomtriques simples, dut tre singulirement sduit parcette dcouverte ; elle fortifia en lui, si elle ne l'y fit germer, l'ideque le Monde, et particulirement le Monde cleste est soumis auxrgles ternelles des nombres et des figures ; elle suscita sansdoute, enl'Ecole pythagoricienne, la conviction que les cours desastres, quel qu'en soit le caprice apparent, se laissent rsoudre encombinaisons de mouvements circulaires et uniformes ; emprunteaux Pythagoriciens par Platon, transmise de Platon Eudoxe,cette conviction donnera naissance l'Astronomie gomtrique
;
et elle ne cessera de dominer les divers systmes de cette Astro-nomie qu'au jour o Kepler aura l'incroyable audace de substi-tuer le rgne de l'ellipse au rgne du cercle.
Aprs avoir si heureusement dcompos le mouvement du Soleilen deux rotations autour d'axes diffrents, Pythagore a-t-il com-plt sa dcouverte en dcomposant de la mme manire le coursde la Lune et des cinq plantes? Eut-il l'ide de regarder lamarche de chacun de ces astres errants comme la rsultante dedeux rotations, l'une, la rotation diurne, accomplie d'Orient enOccident et identique celle des toiles, l'autre accomplie d'Occi-dent en Orient autour des ples de l'cliptique, en un temps dter-min pour chaque astre et variable d'un astre l'autre ?
Il est fort possible que l'Astronomie soit redevable Pythagorede ce nouveau progrs.
i . Stoh.ei Eclogce physic, I, 23 (Joannis Stou.ei Eclogavum physicarum etethicarum libri duo. Recensuil Augustus Meineke ; Lipsise, i8f>. Tom. I,j). i38).
2. Pseudo-Plutabque, De placitis philosophorum lib. If, cap. XII, $3.
-
10 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
Le pripatticien Adraste, dont Thon de Smyrne nous a con-serv en partie renseignement astronomique, indique vaguement 1
que Pythagore s'tait occup des rvolutions lentes que les plantesexcutent dans le sens oppos la rvolution diurne des fixes.
Si ce progrs n'est pas l'uvre mme de Pythagore, il semble,en tous cas, qu'il ait t accompli de son temps et au sein descoles de la Grande Grce.
Sans tre prcisment disciple de Pythagore, Alcmon de Cro-tone, contemporain du grand philosophe, plus jeune que lui, habi-tant de la mme ville, avait avec lui quelques rapports de doctrine 2 .Or Stobe ', le Pseudo-Plutarque * et le Pseudo-Galien s nousapprennent qu'Alcmon et les mathmaticiens faisaient mouvoirles plantes en sens contraire du mouvement des toiles fixes .Ces mathmaticiens ne sont-ils pas les premiers disciples de Pytha-gore ?
Tel est le bilan des connaissances astronomiques que nous pou-vons, avec quelque vraisemblance, attribuer au fondateur del'Ecole italique et ses premiers lves
; ce bilan est beaucoupmoins riche que celui qu'avaient dress les historiens de laScience, alors qu'ils recevaient sans contrle les lgendes les plusdouteuses ; en particulier, il ne permet aucunement de placerPythagore au nombre des prcurseurs de Copernic.On aurait tort, d'ailleurs, de passer de cet excs l'excs con-
traire et de faire fi de l'Astronomie italique. En introduisant en Grce la notion de la sphricit de la
Terre et des mouvements propres du Soleil, de la Lune et desplantes'1
,d'Occident en Orient, suivant des cercles obliques
l'quateur cleste, Pythagore et ses premiers disciples ont fait faireun grand pas aux notions astronomiques des Grecs. Cette gloireleur appartient ; on ne pourrait que la compromettre en leur attri-buant des inventions et des mrites qui ne leur appartiennentpas.
i. Thkovis S.\iyit.\/io[ Phtqnici Liber
-
l'astronomie pythagoricienne 11
III
LE SYSTME ASTRONOMIQUE DE PHILOLUS
Si Pythagore et ses premiers disciples fixaient la Terre au centredu Monde, on ne tarda pas, au sein de l'Ecole italique, admet-tre une hypothse toute diffrente. De cette thorie nouvelle,Philolas parait tre l'inventeur.
Le pythagoricien Philolas naquit Grotone selon Diogne deLarte, et . Tarcnte selon les autres crivains qui ont parl de lui
;
il vcut quelque temps Hracle de Lucanie, puis il alla se fixer Thbes en Botie ; selon un passage du Phdon de Platon, il yrsidait la fin du v e sicle avant notre re ; il fut donc contempo-rain de Dmocrite et de Socrate.
Philolas avait rdig un trait De la Nature, en trois livres. Il yexposait, pour la premire fois, par crit l'enseignement, jusqu'alorspurement oral, de l'Ecole pythagoricienne ; mais cet enseigne-ment, il apportait, surtout en ce qui concerne l'Astronomie, biendes modifications que n'eussent avoues ni Pythagore ni ses pre-miers disciples.
L'ouvrage de Philolas est aujourd'hui perdu; mais, au sujet desdoctrines astronomiques qu'il proposait, nous nous trouvons treassez exactement renseigns par les tmoignages d'auteurs anciensqui avaient sous les yeux le trait De la Nature.
Aristote, en ses livres Du Ciel 1,discute d'une manire assez
dtaille la thorie de Philolas ; la vrit, il n'en nomme pasl'auteur
;il la met sur le compte de ceux d'Italie que l'on nomme
Pythagoriciens 0. ~ip\ 'I^aAiav, xaXo-jjj.svo'. os nyOvpst.01 . Levague de cette indication a grandement contribu faire attribuer Pythagore lui-mme ce qui tait opinion de son discipleloign. s
Simplicius, en commentant la discussion d'Aristote, y a ajoutquelques dtails complmentaires emprunts, en partie, un critperdu d'Aristote sur les doctrines pythagoriciennes ; d'autrescrivains, Stobe en particulier, et aussi le Pseudo-Plutarque, enson De placitis philosophoriim, nous ont transmis de nouveaux ren-
_
t.Aristote, De lo lib. Il, cap. XIII (Artstotelis Opra, d. Ambroise
Firmin-Didot, t. H, p. 4o3. Aristoteles grce. Ex recensione [mmanuelisBekkeri edidit Academia Regia Borussica. Berolini, i83i. Vol. I, p. 293,col. a).
-
12 LA COSMOLOGIE IIKU. i:\HH I.
seignements, parfois mme des citations textuelles du trait dePhilolaiis.
Ds le dbut du \ix ( sicle, les rudits ont t tents par l'.abon-dance des indications qui concernent la thorie astronomique dePhilolaiis ; ils se sont efforcs de reconstituer cette thorie ; Schau-bach en 1802 '. Bckh en 1810 eten 1819 - ont, les premiers, entre-pris cette uvre
;plus prs de nous, Th. -II. Martin 3 et Gio-
vanni Schiaparelli ; y ont mis la main ; moins que l'on nedcouvre de nouveaux documents, il ne semble pas que l'onpuisse rien ajouter ce que ces divers auteurs nous ont appris.
Philolaiis est profondment convaincu des ides arithmtiquesqui avaient cours en l'Ecole de Pythagore. Selon un fragment deson ouvrage que Jamblique 5 et Syrianus 8 nous ont conserv, iladmet que les nombres sont la cause permanente de tout ce quiarrive dans le Monde .Un autre passage, cit par Jamblique 7
,nous dit que l'unit
est le principe des nombres et de tout ce qui existe, et qu'elle estidentique Dieu .
Le Monde, dit encore un fragment reproduit par Strobe 8,
le Monde est un, et le principe de l'ordre qui y rgne est aucentre.
Dieu, ouvrier du Monde, lisons-nous encore w,
a plac aucentre de la sphre de l'Univers un feu dans lequel rside le prin-cipe du commandement. Cette sphre de feu centrale, immobile,Philolaiis, en ce passage, la nomme le foyer ('Earria).
i. Schaubacu, Geschichte der griechischen Astronomie bis aufEratosthen.es,pp. 4.
r>.r> seqq. Gttingen, 1802.
2. Bckh, De Platonico systemate coelestium globorum, et de vera indoleastronomiae Philolaicae. Heidelberg, 1810. Rimprim, avec des additionsimportantes, dans : August Bckh 's, Gesammelte kleine Schriften. Bd. III:Reden und Abhandlungen, pp. 266-342 ; Leipzig-, 1866. Bckh, Philolaos desPythagoraers Lehren nebst Bruchstcke seines U erkes, Berlin, 1 8
19
.
3. Th.-H. Martin, Hypothse astronomique de Philolaiis (Bulletino
-
L ASTRONOMIE PYTHAGORICIENNJ 13
Au sujet de celte premire hypothse essentielle de l'Astrono-mie philolaque, les tmoignages abondent. Voici d'abord celuid'Aristote ' : Les Pythagoriciens croient qu'au corps le plusnoble convient la plus noble place, que le feu est plus noble quela terre, que les lieux terminaux sol plus nobles pie les lieuxintermdiaires, enfin que les lieux terminaux sont l'espace extrmeet le centre. De l ils concluent par analogie ([lie ce n'est pas laterre jui occupe le centre de la sphre du Monde, niais le feu. Hinoutre, ces Pythagoriciens pensent que ce que l'Univers a de plusimportant est aussi le poste qu'il est le plus digne de garder ; etcomme le centre est ce lieu le plus important, ils le nomment leposte de garde de Jupiter (Ato ouXax-r) .
Aristote s'exprimait peu prs de la mme manire en son traitSur les doctrines pythagoriciennes, d'aprs ce que nous en rapporteSimplicius -.
Chalcidius, commentant le Time de Platon, nous dit aussi 3 queles Pythagoriciens nomment le feu central Jovis cu.stos ; il ajoutequ'il est, leur avis, le principe de toute matire
; que par lui,la Terre, YAntichthone dont nous parlerons tout l'heure et, sansdoute, tous les autres astres sont mus en cercle.Ce feu central recevait de Philolaus les noms les plus varis et
les plus propres en exprimer l'excellence ; au dire de Stobe v , ille nommait foyer de l'Univers (to riavxo; aria), demeure deJupiter, mre des Dieux, autel, lieu, mesure de la Nature.
Le feu central, sige de la Divinit et principe des mouvementsclestes, n'est pas le seul feu qui soit dans l'Univers ; nobles tousdeux, les deux termes extrmes doivent, Aristote nous l'a dit, treoccups par la plus noble des substances, par le feu ; aux confinsde l'Univers, donc, s'tend une rgion igne. Stobe 5 vient con-
i. Aristote, De Clo I il. II, cap. XIII (Aristoteus Opra, d. Firmin-Didot,t. il, j). [\o' ; d. IJekker, t. I, p. 2ij3, col. a).
2. SiMPLicn In Aristotelis de Clo libros comment(tria ; in lib. I, cap. XIII(SiMPLicn Gommentarius in IV libros Aristotelis de Caelo. Ex rec. Sim. Kars-teni, Trajecli ad Rhenum, MDGGCLXV, pp. 229-230. Simplicit /// Aristotelisde Caelo commentaria. Edidit I. L. Heiberg, Berolini MDCCCLXXXXIV,p. 5i3). Les commentaires sur la Physique et sur le De Clo d'Aristoterdigs Athnes, au VI e sicle de noire re, par Simplicius, sont une mineinpuisable le renseignements prcieux. Simplicius rsume ou cite textuel-lement une foule d'ouvrages aujourd'hui perdus. L'exactitude de ces rsumset de ces citations est garantie parla 1res grande valeur intellectuelle du com-mentateur.
3. Chalcidu Commentarius in Timum Platonis, S CXX1 (Fragmenta philo-sophoram grcorum. Collegil F. Mullachius. Vol. Il, p. 2095 Paris, AmbroiseFirmin-Didot ).
4. Stob/ei Eclog physic, I, 22 ; d. Meineke, p. i34-5. Stobe, loc. cit.
-
14 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
firmer sur ce point le renseignement qu'Aristote nous a donne ;il nous apprend que Philolas admettait l'existence d'un autre feusuprme, entourant le Monde.
L'espace compris entre le feu central et le feu d'en haut (avo8svTtCtp) tait partag ' en trois domaines concentriques.
La rgion la plus leve, la plus voisine du feu suprieur, rece-vait le nom d'Olympe ("QXup/rco) ; l, les lments se trouvent l'tat de puret parfaite ; c'est l, sans doute, que Philolas pla-ait les toiles fixes.
Au-dessous de l'Olympe, s'tend le Monde (KffjAO) ; lorsqu'autravers du Monde, on descend du feu suprme vers le feu central,on rencontre d'abord les cinq plantes, puis le Soleil, enfin laLune.
Tous ces astres tournent autour du feu central, dont ils reoi-vent le mouvement. Le Soleil n'est pas lumineux par lui-mme
;
c'est une masse transparente comme le verre qui reoit l'illu-mination du feu d'en haut et la renvoie vers nous 2 .
Au-dessous du Monde 3 entre la Lune et le feu central, s'tendla rgion que Philolas nomme le Ciel (Opxv) ; c'est en cettergion que se trouvent les choses soumises la gnration, apa-nage de ce qui aime les transmutations. Ev
-
l'astronomie pythagoricienne 13
ces mlanges son! sujets aux changements et aux transformationsde toutes sortes; ils sol soumis la gnration et la destruc-tion.
11 convenait de signaler ds maintenant, aines que nous com-menons les distinguer, les premiers linaments de cette doc-trine dont nous aurons constater, au cours des sicles, la durablefortune et la tyrannique emprise.
Pntrons en l'Opavo, en la rgion de la gnration et du chan-gement ; nous y trouvons la Terre.
La Terre tourne, d'Occident en Orient, autour du feu central;ce mouvement est dirig comme les mouvements du Soleil et desautres astres errants, mais il ne se fait pas dans le mme planque ces derniers ; la succession des jours et des nuits s'expliquepar les positions diverses que la Terre et le Soleil prennent, l'un l'gard de l'autre, en leurs rvolutions autour de 'Ee-La.Oue telle soit bien, au sujet du mouvement de la Terre, la
pense de Philolaiis, des tmoignages multiples nous en donnentl'assurance.
Le faux Plutarque ' dit que la Terre dcrit autour de 'EffTW uncercle oblique (xar xuxou ooG), mais dans le mme sens que leSoleil et la Lune. Au De Clo, Aristote nous apprend 2 que, selonles Pythagoriciens, la Terre est un des astres, et qu'elle tourneen cercle autour du centre, produisant ainsi le jour et la nuit . 11s'exprimait plus explicitement encore en son crit Sur les doctrinespythagoriciennes, dont Simplicius nous a gard ce passage 8 : LesPythagoriciens disaient que la Terre devait tre compte aunombre des astres, qu'elle se mouvait autour du centre, ce quichangeait sa position par rapport au Soleil et produisait le jour etla nuit Ils nommaient la Terre la caverne ( "AvTpov) ; ils la regar-daient comme l'instrument mme du temj)s ; c'est elle, en effet,qui est la cause des jours et des nuits ; la partie de la Terre quiest tourne vers le Soleil et illumine produit le jour; la partie,au contraire, qui est tourne vers le cne d'ombre engendr parla Terre elle-mme produit la nuit.
Lu circulant autour du feu central, la Terre tourne toujours verslui la mme l'ace, celle qui se trouve aux antipodes de la rgionhabite ; il en rsulte que la vue de ce feu central est constammentdrobe aux humains.
i. Pseudo-Plutarque, De placitis philosophorum lib. III,
-
16 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
Il est galement un astre que l'paisseur mme de la Terre cachesans cesse aux yeux des hommes; c'est YAnti-terre ou Anlichthone('AvT'lytov). Voyons comment Philolaus avait t conduit pos-tuler l'existence de ce corps.Avec toute l'Ecole pythagoricienne, il admettait, nous l'avons
vu, que les nombres sont la cause permanente de tout ce quiarrive dans le Monde . Or, pour les Pythagoriciens, le nombreDix tait le nombre parfait ; aussi Philolaus voulait-il que dixcorps clestes tournassent autour du feu central ; la sphredes toiles fixes, les cinq plantes, le Soleil, la Lune, la Terreenfin fournissaient neuf corps sidraux : il en fallait un dixime,d'o l'hypothse de l'Anti-terre.Que la pense de Philolaus ait bien suivi une telle dmarche,
nous le savons par des tmoignages multiples. 11 semble aux Pythagoriciens, dit Aristote en sa Mtaphysique ',
que Dix est un nombres parfait et qu'il comprend en lui-mmetoute la nature des nombre ; ils affirment que dix est le nombredes corps qui sont mus dans le Ciel ; et comme, seuls, neuf telscorps nous apparaissent, titre de dixime, ils ajoutent l'Anti-chthone.
Alexandre d'Aphrodisias, commentant ce passage de la Mta-physique, crit plus explicitement i :
Les Pythagoriciens rputaient que Dix tait un nombre par-fait ; d'autre part, les phnomnes leur montraient que neuf estle nombre des sphres en mouvement, savoir les sept sphres desastres errants, la huitime qui est celle des toiles lixes, et la neu-vime qui est celle de la Terre ; ils croyaient, en effet, que la'J'erre se meut en cercle autour du foyer lixe de l'Univers qui,selon eux, est constitu par le vu ; ils ajoutaient donc, en leursdoctrines, une sorte d Anti-terre ; ils supposaient qu'elle se meuttoujours l'oppos de la Terre, et ils pensaient que, par celamme, elle demeure toujours invisible. Aristote parle encore deees choses aux livres Ihi Ciel et. avec plus de dtails, en sou critSur les doctrines des Pythagoriciens .
C'est en se rfrant cet ouvrage Sur les doctrines des Pythago-riciens que Simplicius ; nous donne des renseignements qui con-cordent avec les prcdents :
i. Aristote, Mtaphysique, livre I, ch. V (Aristotelis Opra, d. AmbroiseFirmin-Didot, l. Il, p. \rf; d. Bekker, vol. Il, j>. 986, col. a).
2. Ai.kxandri A.PHRODISIENSIS In Aristotelis Metaphysica cornmentaria. EdiditMichael Hayduck. Berolini, 180,1 ; in lih. I cap. Y, pp. /jn-/|i.,3A>implicii In Aristotelis De Clo libros commentarii ; in lil>. Il cap. XIII
(EdfcKarsten, pp. 228-2 20. ; d. Heiberg, pp. 4' i-5ia).
-
L*ASTRONOMIE PtTflGOHICNNE 17
Les Pythagoriciens disent que la Terre n'enveloppe pas le
centre du Monde ; au milieu de l'Univers, ils placent le l'eu ;autour du feu se meut, affirment-ils, l'Antichthone qui, elle aussi,est une terre, mais que l'on nomme Anti-terre parce quelle setrouve l'oppos de cette Terre-ci. Aprs l'Antichthone vient notreTerre qui, elle aussi, tourne autour du contre ; aprs la Terrevient la Lune. Voici, en effet, ce qu'Aristote lui-mme conte versla fin des Pythagoriques :
La Terre, qui se comporte comme un des astres, se ment
autour du centre et sa disposition l'gard du Soleil produit le jour et la nuit. L'Anti-terre se meut aussi autour du centre, en suivant la Terre. Nous ne la voyons pas, parce que la masse de la Terre se trouve toujours entre elle et nous.
Ce qu'ils affirment l , poursuit Aristote, ils n'y parviennent pas en cherchant, comme il convient de le faire, les raisons et les.> causes des phnomnes ; mais, au contraire, ils sollicitent les phnomnes dans le sens de certaines opinions et raisons qui leur sont propres ; ils s'efforcent de les adapter ces opinions, ce qui est inconvenant au plus haut degr.
Admettant, en ettet, que le nombre Dix est un nombre par- fait, ils ont voulu lever jusqu' dix le nombre des corps qui se meuvent en cercle. Selon ce dsir, la sphre des toiles fixes leur donnant un premier corps, les astres errants sept autres corps et notre Terre encore un, ils ont complt la dizaine au moyen de l'Antichthone. Tous ces textes, et d'autres encore que nous pourrions emprun-
ter Stobe ou au De placitis philosophorum, s'accordent nousapprendre que l'Anti-terre est plus voisine du feu central que laTerre. Ils s'accordent galement affirmer que l'Anti-terre tourneen mme temps que la Terre, de telle sorte que les habitants decette dernire, logs sur l'hmisphre qui ne peut apercevoir lefoyer central, soient galement incapables de voir l'Anti-terre. Ensa rotation autour du foyer, l'Antichthone suit la Terre de manire se trouver toujours en conjonction ou toujours en opposition avecelle pour un observateur qui se trouverait au centre du Monde.De ces deux hypothses, quelle est celle qu'admettait Philo-
las? Le nom mme d'Anti-terre ('AvtIvOwv) donn l'astre hypo-thtique veille l'ide que, par rapport au foyer, cet astre se
trouvait toujours l'oppos de la Terre. Le texte suivant duPseudo-Plutarque 1 semble confirmer cette supposition :
i. Pseudq-Plutarque, De placitis philosophorum lib. III, cap. XI.
DUHEM 2
-
18 LA COSMOLOGIE HELLENIQUE
Philolaus le Pythagoricien disait que le feu se trouvait aumilieu du Monde, car il tait le foyer de l'Univers ; en secondlieu venait l'nti-terre
;puis, en troisime lieu, la Terre que nous
habitons ; elle se trouve place du ct oppos (s evavxiaxs'.yivY}) et sa rvolution entoure [celle de] l'Anti-terre ; il enrsulte que les habitants de chacune de ces deux terres ne peu-vent tre aperus de ceux qui se trouvent en l'autre.
Il est naturel de penser que la rgion habite de l'Anti-terre,comme la rgion habite de la Terre, est celle que le feu centraln'chauffe pas ; ds lors par rapport ce feu central, il faut quela Terre et l'Anti-terre soient sans cesse en opposition, si l'on veut
que les habitants de chacun de ces deux astres ne puissent jamaisapercevoir l'autre astre. Il est vrai que le faux Plutarque ne nous
dit pas que les habitants de l'Antichthone ne puissent apercevoir
la Terre ; il nous affirme seulement qu'ils ne sauraient apercevoir
les habitants de la Terre.Encore qu'il et imagin l'Antichthone afin de porter dix le
nombre des corps qui tournent autour du feu central, Philolausdevait chercher, parmi les phnomnes astronomiques, quelqueindice qui rvlt l'existence de ce corps invisible. Il crut trouver
cet indice dans les clipses de Lune.Il remarqua qu'en un lieu donn de la Terre, les clipses de
Lune visibles sont plus frquentes que les clipses de Soleil ; il
crut ncessaire, pour expliquer ce phnomne, d'invoquer d'au-tres clipses de Lune que celles qui sont produites par la Terre ;ces clipses supplmentaires, il les mit sur le compte de l'Anti-
terre.
Ce point de la thorie philolaque est encore un de ceux au
sujet desquels les tmoignages abondent.Au De Clo, Aristote nous dit 2 : Certains croient qu'il peut
exister des corps qui tournent autour du centre et que l'inter-position del Terre rend invisibles pour nous. A l'aide de cettesupposition, ils expliquaient que les clipses de Lune fussent plus
nombreuses que les clipses de Soleil ; ils disaient que les clip-ses de Lune taient produites non seulement par l'ombre de la
Terre, mais encore par l'ombre de ces corps supposs 3 .
i. Sur cette question, l'Atichthone est-elle en conjonction ou en oppositionavec la Terre par rapport au feu central, Bekh est demeur dans le douteIhCKH, Vom Philolaischen Weltsystem ; addition date de 1 863-1 804 et insredans Bucckh's, Gesammelte kleine Scliriften, Bd. III, pp. 320-342).
2. Aristote, De Clo Iib. Il, cap. XIII (Ahistotelis Opra, d. Firmin-Didot,t. II, p. 4o3 ; d. Bekker, vol. I, p. 293, col. b.).
3. Cette explication eut vog-ue mme en dehors des cole? pythagoriciennes;
-
L ASTRONOMIE PYTHAGORICIENNE 11)
Stobe vient ici confirmer 1 le tmoignage d'Aristote : Selonl'histoire crite par Aristote et l'affirmation de Philippe d'Oponte,certains Pythagoriciens attribuent les clipses de Lune l'inter-position soit de la Terre, soit de FAnti-terre . Ce Philipped'Oponte, disciple de Platon, avait crit sur les clipses de Soleilet de Lune.
Le Pseudo-Plutarque dous apprend "', lui aussi, que, selon cer-tains Pythagoriciens, les clipses de Lune sont produit.-, soit parla Terre, soit par L'Anti-terre.
Dans h' systme de Philolas, la Terre n'occupe pas le centredu Monde ; elle est une certaine distance de ce centre autourduquel elle tourne ; toutefois Philolas et ses disciples n'hsitaientpas, en la plupart des questions astronomiques, raisonnercomme si la Terre se trouvait au centre de l'Univers. Selon eux,nous dit Aristote 3
,la circonstance que la Terre est une distance
du centre gale au rayon du cercle qu'elle dcrit n'empche pasles phnomnes de nous apparatre comme si la Terre tait aucentre du Monde ; de mme [dans le systme que nous adoptons]maintenant, le fait que nous sommes une distance du centregale au rayon [terrestre] ne produit aucune diffrence sensible.
Cette explication supposait que la distance de la Terre au centredu Monde ft une grandeur comparable au rayon terrestre et (pieles distances de la Terre aux astres fussent des grandeurs beau-coup plus considrables.
Plutarque (et non plus le Pseudo-Plutarque quia crit le De pla-citis phiiosophorum), Plutarque, disons-nous, nous apprend com-ment Philolas et ses disciples valuaient ces diverses distances.
Beaucoup de philosophes, dit-il \ introduisent ce propos lesides jiythagoriciennes et procdent en triplant sans cesse lesdistances partir du centre. Prenant le [rayon du] feu commeunit, ils comptent 3 jusqu' l'Anti-terre, 9 jusqu' la Terre, 27jusqu' la Lune, 81 jusqu' Mercure, 243 jusqu' Vnus, 72i>jusqu'au Soleil; ce dernier nombre est la fois un carr et uncube ; aussi nomment-ils le Soleil le carr-cube. Ils obtiennent lesautres distances par triplication successive.
Anaxagore admettait aussi que nombre d'clipss de Lune taient produitespar l'ombre de certains corps qui nous demeuraient invisibles (Schaubach,Geschichte der griechischen Astronomie l>is aufEratosthenes, p. 456).
i. Stob.ei Eelogphysic, I, 26 ; d. Meineke, p. i53.2. Pseudo-Plutarque, De placitisphilosophoram lib. II, cap. XXIX.3. Aristote, De Clo hb. II, cap. XIII (Aristotelis Opra, d. Ambroise
Firmin-Didot, vol. II, pp. 43-4o4 ; d. Bekker, vol. II, p. 293, col. b).4- Plutarque, De anim procreatione in Timceo cap. XXXI (Plutarque,
uvres, d. Firmin-Didot, pp. 1207-1258).
-
20 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
De telles distances conviennent mal l'explication qu'Aristote arapporte ; le rayon de l'orbite lunaire n'est que le triple du rayonde l'orbite terrestre ; les phnomnes lunaires vus de la Terreseraient singulirement diffrents de ceux que l'on observerait ducentre du Monde. De plus, Mercure et Vnus sont ici placs entrela Lune et le Soleil ; les autres textes s'accordent nous dire quePhilolaus plaait les cinq plantes au-dessus de la Lune et duSoleil. Peut-tre, doue, serait-il imprudent d'attribuer Philolausles valuations que Plutarque nous rapporte au sujet des distancesdes divers astres au centre du Monde.En ce systme de Philolaus, un dernier point mrite claircis-
sement.La sphre des toiles fixes y est constamment compte au nom-
bre des dix corps qui tournent autour du feu central ; cette sphren'est donc pas regarde comme immobile ; un certain mouve-ment lui est attribu.Bckh avait cru pouvoir conclure de l ' que Philolaus connais-
sait le phnomne de la prcession des quinoxes ; le mme auteura, d'ailleurs, renonc plus tard cette opinion, que Th. IL Martina compltement rfute -. Nanmoins, il parat certain que Philo-lais attribuait la sphre toile une certaine rvolution autourdu centre du Monde, rvolution oriente comme celles des astreserrants mais, vraisemblablement, plus lente que celle-ci. Le joursidral n'tait donc pas gal la priode de la rvolution dela Terre autour du Foyer ; il tait un peu plus long.
Cette lente rvolution du Ciel toile fut sans doute conservepar les Pythagoriciens postrieurs Philolaus qui remirent laTerre au centre du Monde, mais en lui donnant un mouvement derotation autour de son axe ; en effet, Ptolme constate 3 que,parmi eux, certains admettent que cette rotation de la Terre estaccompagne d'une rotation du Ciel autour du mme axe, ces deuxrotations tant tellement accordes que les rapports de la Terreet du Ciel soient sauvegards.
Tel est ce systme de Philolaus, dont les auteurs les plus diversnous ont conserv de menus fragments et que la patience des ru-dits est parvenue reconstituer. Si on l'apprcie comme il con-
i. Bckh, Philolaos des Pythuyorers Lehren, Berlin, 1819, p. 118.2. Tu.-H. Martin, Mmoire sur cette question : La prcession des quinoxes
a-t-elle t connue des gyptiens ou de que/que autre peuple avant Hipparque?Ch. H, 2. Paris, 18G9.
3. Claude Ptolme, Composition mathmatique, livre I, ch. VI ; trad. Halma,t. I, p. 19 ; Paris, i8i3. Claudii Ptolemaei Opra quae exstant omnia.Vol. I. Syntaxis mathematica. Edidit J. L. Heiberg. Pars I. Lipsiae,MDCCCLXXXXVIII. A', ', p. 24.
-
l'astronomie pythagoricienne 21
vient, dit G. Schiaparelli \ en le reliant aux dogmes fondamen-taux de la Philosophie pythagoricienne, il apparatra certainementcomme l'une des plus heureuses inventions du gnie humain. Etcependant, certains auteurs modernes, incapables de se transporterpar la pense ces temps o toute la science tait crer partirdes fondations, en ont parl avec mpris ; ils l'ont soumis auxmmes rgles de critique que s'il s'tait agi de juger une uvrescientifique actuelle. Ceux-l ne sont pas dignes de comprendre lapuissance de spculation qui tait ncessaire pour joindre ensem-ble l'ide de la rotondit de la Terre, celle de son isolement dansl'espace, et celle de sa mobilit ; et pourtant, sans ces ides, nousn'aurions eu ni Copernic ni Kepler ni Galile ni Newton. Ce systme a eu, dans les temps modernes, une singulire for-
tune.
Parmi les textes anciens qui lui ont suggr ses hypothsesastronomiques, Copernic a cit, et deux reprises, le passage duDe placilis philosophorum o il est dit que Philolas considrait laTerre comme un astre et qu il lui faisait dcrire un cercle obliqueautour du feu central. Il n'en a pas fallu davantage pour quenombre d'auteurs modernes fissent de Philolas l'inventeur del'Astronomie hliocentrique et l'avant-coureur de Copernic. Gas-sendi, dont l'rudition tait habituellement mieux informe, futle premier, en sa Vie de Copernic, donner cours cette lgende ;Ismal Bouillaud en accrut la vogue lorsqu'on 104o, il intitula :Astronomia philolaca l'expos du systme hliocentrique qu'ilvoulait substituer celui de Kepler; Hiccioli, Weidler, Montucla,Bailly, Delambrc rptrent l'envi cette erreur que tant de textesformels, et si aisment accessibles, suffisaient condamner. Rienn'gale la rapidit avec laquelle se rpand l'erreur historique sice n'est la tnacit qu'elle oppose aux tentatives de rfutation.
IV
HICETAS ET ECPHANTUS
L'astronomie de Philolas demeura sans doute longtemps enfaveur dans les coles qui suivaient les traditions de Pythagore.Lorsqu'Aristote discute cette doctrine, il l'attribue toujours nonpoint Philolas, mais aux Pythagoriciens, ceux d'Italie ;
i . G. Schiaparelli, /precuraori dl Copernico nelV Antichit ; loc. cit., p. 388.
-
22 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
ces expressions, aussi bien que le soin avec lequel le Stagiriterfute cette hypothse, semblent prouver qu'elle comptait, de sontemps, de nombreux partisans parmi les philosophes de la GrandeGrce. Elle en eut mme aprs lui, car Simplicius nous apprend 1qu' Archdme, qui vivait aprs Aristote, fut encore de cetteopinion .Pendant le temps qui s'coula de Philolaiis Aristote, les Pytha-
goriciens imaginrent encore d'autres systmes astronomiques d'ol'hypothtique feu central et la non moins hypothtique Anti-terrese trouvaient exclus. L'un des systmes qui se prsenta ainsi leur pense est celui qui place la Terre au centre de l'Univers, maisla fait tourner d'Occident en Orient autour de l'axe du Monde, afind'expliquer le mouvement diurne des astres.
Copernic, cherchant autoriser de l'avis des anciens son Astro-nomie nouvelle, cite ou invoque deux reprises un passage desAcadmiques de Cicron ; voici ce passage 3 :
Au dire de Thophraste, Nictas de Syracuse professe l'opi-nion que le Soleil, la Lune et toutes les choses clestes demeurentimmobiles, et que rien ne se meut dans le Monde, fors la Terre ;celle-ci, tournant autour de son axe avec une extrme vitesse,produit les mmes apparences que l'on obtient en supposant laTerre fixe et le Ciel mobile. Certains pensent que, dans le Time,Platon dit la mme chose, mais d'une manire quelque peu plusobscure.
Accordons quelque attention au commentaire de ce texte.Le tmoignage qu'il nous apporte mrite la plus entire con-
fiance. Thophraste, le disciple prfr d'Aristote, avait crit uneHistoire de FAstronomie en six livres ; le troisime livre de saPhysique tait un trait du Ciel ; c'est assez dire quelle comp-tence il possdait pour parler des mouvements clestes.
Cicron emprunte donc Thophraste un renseignement sur lesopinions d'un philosophe que la plupart des manuscrits nommentNictas ; ce philosophe se nommait en ralit non pas Nictas (Nwevtz), mais Ilictasf'lxsTa;) ; Diogne de Larte, le Pseudo-Plularquenous ont conserv son vritable nom ; Eusbe le nomme 'Ixsnr;. I iesauteurs, confirmant le dire de Thophraste, nous apprennent quecet astronome tait de Syracuse ; ils nous apprennent aussi qu'il
tait pythagoricien ; mais du temps o il vcut, ils ne nous disent
i. Simplicii In Aristotdis de Clo liros commentarii (d. Karstern, p. 229 ;d. Heiber, p. 5i3).
2. Gicehonis Qustiones Academic priores, II, 8g.
-
l'astronomie pythagoricienne 23
mot, et rien qui ait quelque prohabilit n'a pu tre conjectur par1rs modernes.
Gicron nous apprend, d'aprs Thophraste, que cet Hictas, endonnant la Terre un mouvement de rotation autour de son a\
-
24 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
Le texte du Pseudo-Plutarque semble tablir un lien encore plustroit entre le systme d'Hictas et celui de Philolaiis ; le voici ' : Thaes et ses successeurs disent qu'il y a une seule Terre ; lepythagoricien Hictas deux, celle-ci et l'Anticlithone . L'hypothsede l'Antichthone est ici attribue non pas Philolaiis, qui n'estpas nomm, mais Hictas, ce qui est absolument incompatibleavec les opinions de ce dernier, telles que Thophraste nous lesa fait connatre. D'ailleurs, quelques lignes plus loin, en cettecompilation du faux Plutarque, c'est Philolaiis, et non plus Hic-tas, qui est nomm 2 comme principal auteur de l'hypothse del'Anti-terre.
Bckh 3 et Th. -IL Martin* ont conjectur, avec beaucoup de vrai-semblance, que le texte o le Pseudo-Plutarque nomme Hictas taitun texte mutil, et qu'il devait se lire ainsi : Thaes et ses succes-seurs disent qu'il y a une seule Terre ; Hictas le pythagoricien,une ; Philolaiis le pt/t/ta
-
l'astronomie PYTHAGORICIENNE 2o
Pseudo-Plutarque ' font mouvoir la Terre, non pas d'un mouve-ment qui la fasse changer de place, mais comme une roue, autourde son propre centre, d'Occident en Orient.
Saint Hippolyte crit de mme ' : Un certain Ecphantus deSyracuse dit que la Terre, milieu du Monde, se meut autour de sonpropre centre [de l'Occident] vers l'Orient.
Enfin Eusbe rpte \ en l'explicitant, l'information du Deplacitis philosophorum : Hraclide du Pont et Ecphantus deSyracuse font mouvoir la Terre, non pas d'un mouvement qui lafasse changer de place, mais d'un mouvement de rotation (?peir-Ttxi), la faon d'une roue qui tourne autour d'un axe, d'Occi-
dent en Orient, autour de son propre centre .Entre le systme de Philolas, qui l'ait tourner la Terre autour
du feu central, et le systme des pythagoriciens Hictas etEcphantus, qui la font tourner sur elle-mme, doit-on voir unlien et peut-on tablir une transition ? Giovanni Schiaparelli l'apens. Fort justement, il a fait remarquer 4 que les connaissancesgographiques des Grecs s'taient peu peu tendues ; ils avaientpu converser aussi bien avec des Ibres des bords du Tage qu'avecdes Indiens des rives du Gange, avec des insulaires de Thul oudes habitants de Taprobrana ; nul des hommes qu'ils avaient purencontrer en la rgion accessible de la Terre n'avait jamais vul'Antichthone ni le feu central se lever au-dessus de l'horizon
;
force fut donc aux Hellnes de relguer ces deux corps dans ledomaine de la fantaisie.
Mais en renonant au systme de Philolas, les pythagoriciensen retinrent tout ce qu'ils en pouvaient conserver sans absurditmanifeste. Ils conservrent donc au feu central sa position et samission vivificatrice ; mais de la Terre et de YAnti-terre, ils firentles deux hmisphres d'un astre unique ; au centre de cet astre,centre immobile et identique au centre du Monde, fut plac lefoyer de l'Univers.
En ce foyer, rsidait le principe moteur de toutes les sphres ;la Terre, qui en tait plus voisine que tout autre corps, devaittourner autour de ce foyer avec la rapidit la plus grande ; onattribua donc la Terre le mouvement diurne autour des plesde l'quateur.
i, Pseudo-Plutarque, De placitis philosophorum lib. III, cap. XIII.2. L'ouvrage de saint Hippolyte dont nous parlons ici est souvent attribu a
Origne sous le titre : Origenis Philosophumena sive omnium hresium refu-tatio ; [Origenis Opra omnia, accurante Migne, t. VI, pars III, lib. I, cap. XV(Patrologice grc tomus XVI, pars III) coll. 339-3/jo].
3. Eusebii Prparatio Evangelica, lib. XV, cap. LVIII.4- Giovanni Schiaparelli, Op. cit., pp. 4o2-4o5,
-
26 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
Au temps d Aristote, cette transformation du systme de Philo-laus tait dj un fait accompli, dans les coles pythagoriciennes
;
dans ces coles, semble-t-il, ceux qui tenaient encore pour le sys-tme de Philolaiis avaient la rputation d'hommes arrirs ; c'estdu moins ce que nous devons conclure d'un texte ' o Simpliciusnous rapporte ce qu'Aristote disait en ses Pythagoriques.
Simplicius vient d'tudier, d'aprs cet ouvrage, le systme dePhilolaiis ; il poursuit ainsi :
Aristote a expos en ces ternies les Ides des Pythagoriciens;
mais ceux [d'entre eux] qui ont reu en partage une connais-sance plus exacte des ces choses (ot o yvyjTWTsp'.ov kOtv ulstow-'/vts) placent au milieu le feu, dou de la puissance cratrice(o/jf'.o'jpy'.xr! ojvaij.'-;) ; de cette position centrale, le feu vivifie toutela Terre et rchautl ce qui, en elle, s'est refroidi. C'est pourquoiles uns le nomment la tour de Jupiter, comme Aristote le dit enses Pythagoriques, d'autres le poste de Jupiter, comme cet auteurle rapporte en ces livres-ci [le De Clo], d'autres encore le trnede Jupiter, selon ce que nous content certains crivains.
Ils disent que la Terre est un astre en ce sens qu'elle est l'in-strument [de la mesure] du temps ; elle est, en effet, la cause desjours et des nuits; en celle de ses parties que le Soleil illumine,elle produit le jour, en l'autre partie, qui se trouve au sein ducne d'ombre qu'elle engendre, elle produit la nuit. Ces Pythago-riciens donnent le nom d'Anti-terre la Lune ; ils la nommentgalement terre thre, parce qu'elle peut intercepter la lumiredu Soleil, ce qui est le propre de la Terre, et aussi parce qu'elleest la limite infrieure de la rgion cleste comme la Terre est lalimite infrieure de la rgion sublunaire.
Peut tre trouverait-on que ce texte n'est pas assez explicite ;peut-tre lui reprocherait-on de ne pas dire assez nettement quele centre (to jjlso-ov) o se trouve le feu est la fois le centre duMonde et le milieu de la Terre ; de ne pas affirmer assez claire-ment que la rotation de la Terre est la cause des jours et desnuits. Tout doute cet gard sera lev par un second texte ; cenouveau texte mane d'un scholiaste dont le nom nous est inconnu;mais, assurment, ce scholiaste puisait aux mmes sources queSimplicius ; voici ce qu'il nous dit * :
Les Pythagoriciens enseignent que le feu crateur se trouve
i. Simplicii In Aristotelis libros de Clo commenlarii, in lib. II cap. XIII;d. Karsten, p. 229 ; d. Heiberg, p. 5i2.
2. Brandis, Scholia in Arislotete.m, pp. 5o4-5o5 (Aristotelis Opra. EdiditAcademia Regia Borussica. Vol. IV).
-
l'astronomie pythagoricienne 27
autour du milieu et du centre de la Terre (rcup evai 3|{uoupyixov-sp ;. to uis-ov Te xal xivrpov ttJ yfj) ; c'est lui qui rchauffe la Terre
et l'anime, c'est lui qui maintient l'ordre sa surface. Us disent
que la Terre est un astre en tant qu'elle est un instrument [dutemps]. Pour eux, l'Anti-terre est identique la Lune. Ils la nom-ment une terre thre ; l'Univers ayant t divis en douze par-ties, ils prennent les trois lments pour la composer. Cet astre quiest en mouvement (Toto o t arpov cpp[i.svov) c'est la Terreque revient notre scholiaste, aprs avoir parl de la Lune Cetastre qui est en mouvement fait la nuit et le jour ; la nuit, en effet,provient du cne d'ombre qu'il projette derrire lui ; le jourest en la rgion de la Terre qui est claire par le Soleil. Pour cesraisons, ils ont nomm le feu tour et poste de garde de Jupiter ;ils l'appellent aussi demeure de Vesta ('Horia otxo) et trne deJupiter; le centre, eu effet, est le sige des puissances conserva-trices de ces dieux et la cause de l'union entre les parties de l'Uni-vers .
Parmi ces Pythagoriciens, mieux informs que les sectateurs dePhilolaiis, dont Simplicius et le scholiaste anonyme viennent denous faire connatre les doctrines, il nous faut sans aucun doute
ranger Hictas et Ecphantus ; ils taient de ceux, en effet, qui nemettaient pas la Terre hors du centre du Monde, pour la fairetourner autour d'un feu allum en ce centre ; ils la faisaient tour-ner sur elle-mme, mais il est vraisemblable qu'en la masse dece corps, ils enfermaient le feu central.
Les divers textes cits en ce Chapitre reprsentent peu prstout ce qui nous est parvenu de l'enseignement astronomiquedonn par les Ecoles de la Grande Grce ; ce sont documents bienfragmentaires, au moyen desquels il est fort malais de reconsti-tuer les diverses doctrines professes par les Pythagoriciens ausujet des mouvements clestes, et de deviner comment ces doc-trines ont pu driver les unes des autres. Le peu que nous savons,toutefois, des systmes labors par les Pythagoriciens pourrendre compte des mouvements clestes suftit veiller en nousl'tonnement et l'admiration ; on demeure surpris de la fconditet de l'ingniosit de la pense hellnique ; peine cette pense setrouve-t-clle aux prises avec le problme astronomique, qu'elle enmultiplie les essais de solution et qu'elle l'aborde par les voies lesplus diverses. Tandis que nous continuerons parcourir l'histoirede l'Astronomie grecque, ces sentiments d'tonnement et d'admi-ration ne cesseront de grandir.
-
CHAPITRE II
LA COSMOLOGIE DE PLATON
LES QUATRE ELEMENTS ET LEURS IDEES
Au moment d'aborder l'tude de la Cosmologie de Platon, on nesaurait se dfendre d'un sentiment de crainte ; on est galementeffray et par la hauteur de la pense qu'il s'agit d'interprteret par les obscurits qui, trop souvent, en embrument les con-tours.
Platon a crit un dialogue, le Tbne, dont l'objet est d'ex-poser en dtail la doctrine qu'il professait sur la composition duMonde ; mais des allusions la Physique et l'Astronomie seretrouvent en d'autres dialogues, au Phdon, dans la Rpublique,dans les Lois ; et, parfois, l'accord entre ces allusions et les ensei-gnements du Time ne se manifeste pas avec une entire vi-dence.
Constamment inspires par la plus haute Mtaphysique, lesthories physiques et astronomiques de Platon sont, en outre,lies de la manire la plus intime des analogies gomtriqueset arithmtiques o se retrouvent les tendances de l'Ecole pytha-goricienne ; et ce symbolisme mathmatique est singulirementpropre faire hsiter les commentateurs modernes qui la Phi-losophie pythagoricienne apparat comme un mystre.En outre, la pense de Platon s'exprime bien souvent sous la
forme d'allgories dont les voiles potiques laissent malaismentdeviner les contours prcis des propositions astronomiques.
-
LA COSMOLOGIE DE PLATON *2i>
Toiles sont les difficults
-
30 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
gomtrique : x est le ct du carr quivalent au rectangledont /et t sont les cts. La dtermination de la longueur x est unproblme de Gomtrie plane dont la solution tait assurmentfamilire aux Pythagoriciens. Ce carr x*, quivalent au rectangledont f et t sont les cts, est l'intermdiaire entre les deux carrs
f-, /2
,
qui ont respectivement / et /pour cts.Si l'Univers tait une figure plane sans paisseur, il suffirait
ainsi, entre le feu et la terre, d'un seul intermdiaire qui joueraitentre eux le rle de la moyenne proportionnelle entre deux gran-deurs ; mais l'Univers est un corps tendu selon les trois dimen-sions ; ce n'est pas aux problmes de Gomtrie plane qu'il fautcomparer les questions dont il est l'objet ; c'est parmi les probl-mes relatifs aux solides qu'il faut chercher des analogies.Formons donc une question de Gomtrie trois dimensions qui
soit comme l'extension du problme de la moyenne proportion-nelle. Nous y parviendrons en cherchant, entre deux quantitsdonnes, /et /, deux autres quantits intermdiaires, a et e, tellesque l'on ait
f a ea e t
Ces deux quantits a et e seront donnes par les formules
a = v'A
e = W-Enonces, la mode des Grecs, en langage gomtrique, ces
deux formules correspondent bien deux problmes solides : a estl'arte d'un cube quivalent un prisme droit dont la hauteurest / et dont la base est un carr de ct /; e est l'arte d'un cubedont la hauteur est f et dont la base est un carr de ct / ; cesdeux cubes a\ e* sont eux-mmes intermdiaires entre les deuxcubes /', / ! .
C'est par analogie avec ce problme que Platon adjoint au feuel la terre deux lments intermdiaires, l'air et l'eau; le feu,l'air, l'eau, la terre seront les uns l'gard des autres ce que sontles quatre grandeurs /, a, e, t.
C'est pour cette raison qu'entre l'air et la terre, Dieu a misdeux lments intermdiaires ; il a tabli entre eux, autant quefaire se pouvait, un mme rapport, afin que l'air soit l'eaucomme le feu est l'air, et que l'eau soit la terre comme l'air est l'eau. O'Jtoj St) ~'jp; t; xal -p\$ uotu; pa t; g Gso; v jjia-ia Gsl/.al 7:30; aAXirjAa xocGotov t,v Suvoctov v tov aTv Xoyov uccvaa-usvo;
-
LA COSMOLOGIE DE PLATON ',U
Sia -do Tic; pa, touto aie a -go; iJStop, xai oti /,p itp uScop, uowp-pas yr.v... '.
L'Univers est donc maintenant visible grce au feu, tangiblegrce la terre, uni par le ministre des deux lments interm-diaires, l'air et l'eau \
Ces quatre lments, d'ailleurs, nous les voyons constammentse transformer les uns dans les autres. Ce qu'en ce momentnous nommons eau se transforme par concrtion, nous leconstatons, et devient terre et pierres ; lorsqu'au contraire, elledevient plus fluide et se dissocie, l'eau se transforme en vapeuret en air ; l'air brlant devient du l'eu ; inversement, le feu com-prim et teint reprend la forme d'air; l'air resserr et condensdevient nuage et brouillard ; le nuage et le brouillard, rendusplus compacts, s'coulent en eau, et de cette eair s'engendrent denouveau de la terre et des pierres, v
Sans cesse, l'espce d'un lment se transforme en une autreespce ; nous n'avons donc pas le droit, prenant une partie d'unlment, de dire c'est cela (toto) et point autre ebose ; car le mot :cela implique, en ce que nous montrons, l'ide d'un objet per-sistant et stable
;pour exprimer cet tat perptuellement fuyant
des lments, nous devons user de mots qui dsignent non pas lasubstance, mais la manire d'tre ; nous ne devons pas dire c'estcela (toto), mais c'est de telle faon (toiotov), c'est tel que del'eau, c'est tel que du feu.
Ce sentiment de l'tat de transformation perptuelle o se trou-vent les lments, sentiment si vif que pour dsigner le feu, l'air,l'eau et la terre, Platon ne voudrait plus user de substantifs,mais seulement de qualificatifs, ce sentiment, disons-nous, paraitinspir de la philosophie d'Heraclite. Mais voici que, tout aussitt,nous entendrons ime dvelopper des penses qui semblentapparentes aux doctrines de Dmocrite.
i. Le sens de ce passage est si clair que l'on s'tonne du nombre de com-mentaires et de discussions auxquels il a donn lieu. Nicomaque, Jamblique,Chalcidius, Proclus, Macrobe dans l'Antiquit, Marcile Picin lors de la Renais-sance, ont discut celte pense de Platon. Chez les modernes, elle a t tu-die par :Augcst Bckh, De Platonica corporis mundani fabrica conjlati ex dmentis
yeometrica ratione concinnatis / Heidelberg, i8ou. Rimprim dans: AlgustBceckhs, Gesammelte kleirte Schriften, Bd. 111, pp. 229-252, Leipzig-, 1 806. Cetterimpression est accompagne (pp. 253-205) d'une addition intitule : E.ccur-sils de geometricis inter plana et inter solida medietatibus ; cette addition estdate de 805.
Th.-IL Martin, Etudes sur le Tirne de Platon, t. I, pp. 337 S9 (I- '> Paris, 1840.Zeller, Philosophie der Griechen, 1859 (seconde dition), t. IL part. L pp. 5u
sqq.
2. Platon, Time. 49 j d. cit., p. 217.
-
32 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
Ce corps particulier 1,
que nous voyons et touchons, qui a main-tenant l'aspect de l'eau, mais qui, tout l'heure, sera de la terreou de l'air, est-il la seule eau qui existe, ou bien au contraire,existe-t-il une eau en soi, de telle sorte que ce mot : eau dsigneune ralit ? Y a-t-il quelque chose qui soit le feu lui-mme etpar soi (ap' sert', ti Tcup aTO lo sauTO) ? Toutes ces substances, dontnous parlons toujours comme si elles taient en soi et par soi, sont-elles ainsi en ralit ? Ou bien, au contraire, les corps que nousvoyons de nos yeux, que nous percevons par l'intermdiaire denotre corps, sont-ils les seules choses qui aient une telle ralit ?Faut-il penser que hors d'eux, rien n'existe d'aucune manire ?Est-ce tort que nous disons de chacun d'eux qu'il est d'une cer-taine espce (eloo^) que l'esprit conoit ? Cette espce n'est-ellerien d'autre qu'un mot ? On a dit, parfois, que le problme du Ralisme et du Nomina-
lisme avait t pos par Porphyre; il est difficile, cependant, d'enimaginer un nonc plus net et plus formel que celui que nousvenons d'entendre de la bouche de Platon.La rponse 2
,d'ailleurs, ne sera pas moins nette que la ques-
tion : L'espce existe, se comportant toujours de la mmemanire, exempte de toute gnration et de toute corruption, abso-lument incapable de recevoir en elle aucune autre espce, inca-pable aussi de pntrer en une espce diffrente ; elle ne peut treperue ni par les yeux ni par aucun sens ; elle n'est accessiblequ' la contemplation intellectuelle. Il existe aussi une secondechose que l'on dsigne par le mme nom, qui est faite laressemblance de l'sloo; ; cette chose tombe sous les sens, elle acommencement, elle est sans cesse en mouvement, elle vientoccuper un certain lieu, puis elle en est chasse.
Ce mouvement continuel des choses concrtes qui sont suscep-tibles de gnration et de corruption suppose une troisime ra-lit, l'espace, capable de fournir ces choses le lieu que le mou-vement leur fait occuper puis dlaisser. Voyons donc ce quePlaton enseignait au sujet de cet espace, et comparons-le ce queses prdcesseurs avaient dit du mme sujet.
i. Platon, Time, 5i ; d. cit., p. 219.2. Platon, Time, 52; d. cit., p. 219.
-
LA COSMOLOGIE DE PLATON '.V.\
II
LE PLEIN ET LE VIDE SELON LES ATOMISTES
Le gomtre le plus expert ne saurait dfinir l'espace ; mais deshommes qui ont tudi, si peu que ce soit, la Gomtrie peu-vent, entre eux, parler de l'espace sans crainte de ne point s'en-tendre ; ils savent tous ce qu'on peut affirmer de l'espace et cequ'o en peut nier ; ils y conoivent tous de la mme manire despoints, des lignes, des surfaces ; ils accordent tous que par deuxpoints quelconques, on peut faire passer une ligne droite qui n'est
borne ni dans un sens ni dans l'autre ; ils savent aussi qu'il n'estpas de limite infrieure la petitesse du segment que deux pointspeuvent marquer sur une telle ligne.
Il en est du temps comme de l'espace. On demandait Lagrangeune dfinition du temps. Savez vous ce que c'est? rpondit-il son interlocuteur ; si oui, parlons-en ; si non, n'en parlons
pas. Tous les gomtres donc savent ce que c'est que le temps,car ils en parlent ; ils considrent tous des instants successifs ousimultans, des dures gales ou ingales.
L'union de la notion d'espace avec la notion de temps leurpermet, d'ailleurs, de raisonner du mouvement. Dans l'espace, ilsconoivent des points, des lignes, des ligures qui demeurent immo-biles ou qui se meuvent, qui demeurent invariables de forme ouqui se dforment.
Aussi longtemps, donc, que les gomtres suivent le conseil dePascal, qu'ils discourent de l'espace, du temps et du mouvementsans essayer de les dtinir, ils s'entendent parfaitement entre eux.Le dsaccord survient, et quel dsaccord ! lorsque les hommesveulent philosopher sur ces choses, lorsqu'ils prtendent direquelle en est la nature et quelle en est la ralit.
Deux grands courants se dessinent alors en la pense des philo-sophes.
Les uns admettent que le temps et le mouvement dont les go-mtres discourent n'existent point hors de notre raison ; soit qu'ilsles regardent comme des ides abstraites que la raison a tiresdes perceptions, soit qu'ils les considrent comme des formes pr-existant en la raison et par lesquelles elle impose un ordre auxperceptions.
DUHEM 3
-
34 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
Les autres supposent que nos ides de temps et d'espace repro-duisent fidlement en nous des choses qui existent rellement horsde nous.En la ralit extrieure notre pense il y a, selon ces derniers
philosophes, un espace illimit qu'ils nomment Yespace absolu.Les corps que nous percevons occupent certaines portions de cetespace, et ces portions d'espace sont les lieux de ces corps. Laralit de l'espace n'est pas lie la ralit des corps qui y trou-vent leur lieu ; si un corps tait ananti, le lieu qu'il occupe
demeurerait vide ; si tous les corps taient anantis, l'espaceabsolu n'en subsisterait pas moins, mais il serait Yespace vide.
De mme qu'il existe un espace absolu, il existe un temps absoludont la ralit ne dpend ni de notre pense ni de l'existence descorps et de leurs changements.Aux divers instants d'une mme dure absolue, un corps peut
demeurer au mme lieu de l'espace absolu ; ce corps est alors enrepos absolu ; un corps peut, au contraire, occuper des lieux dif-
frents des instants diffrents ; il est alors en mouvement absolu.Parmi les philosophes qui s'accordent regarder comme vraies
ces propositions, on peut encore distinguer les adeptes de diverses
coles, ainsi que nous aurons occasion de le noter. Mais on peut
remarquer que les tenants de l'espace absolu et du mouvementabsolu se sont surtout recruts parmi les philosophes qui taienten mme temps gomtres.
Ces philosophes-gomtres ont-ils t victimes d'une illusion ?Ont-ils imprudemment cd au dsir de raliser hors d'eux-mmesles abstractions auxquelles se complaisait leur raison ? Nous ne
discuterons pas ici cette question, car nous ne voulons pas faire
uvre de philosophe, mais d'historien. Or, pour que l'historien
accorde de l'importance, en son exposition, la doctrine de
l'espace absolu et du mouvement absolu, il lui suffit qu'auxpoques les plus diverses, de trs grands esprits l'aient professe.
Cette doctrine, nous la rencontrons de bonne heure en la Philo-
sophie grecque ; c'est elle qu'admettaient les anciens Atomistes,
Leucippe et Dmocrite, qui la tenaient peut-tre des Pythagori-
ciens.
A la base de leur Mtaphysique, Leucippe et Dmocrite plaaientcet axiome : Le non-tre existe exactement au mme titre que l'tre.Le non-tre, ils ridentiiiaient l'espace vide, tandis que les corps
reprsentaient, pour eux, l'tre.
-
LA COSMOLOGIE DE PLAtfON 'X\
Dmocrite, nous dit Plutarque ' affirmait que le quelque-chosen'a pas plus d'existence que n'en a le rien-du-tout ; il donnait, eneffet, le nom de quelque-chose au corps et le nom de rien-du-toutau vide. [A7jp.6xpvro] Biopfcexat ja) aXXov to ov -h unrjSv elvai.Aiv ;;.V OVOutrV 70 (Ttaa, u.7^v 8 70 xevv.
Aristote s'exprime plus explicitement encore - : Leucipe et sonami Dmocrite affirment que les lments (aTOivea) sont le plein(70 tzX^z;) et le vide (70 xevv) ; le premier, ils disent que c'estl'tre (70 ov), et le second que c'est le non-tre (70 y.r, v) ; de cesdeux lments, l'tre est ce qui est jilein et rigide (70 tcXtjos^ xalarepsv), tandis que le non-tre est ce qui est vide et sans rsi-stance (70 xsvv xal jjiavov). Le non-tre donc, leur avis, n'existe pasmoins que l'tre, car le vide n'existe pas moins que le corps. Dans cet espace vide, rellement existant au mme titre que les
corps pleins, ceux-ci se meuvent, et nul doute que Leucippe etDmocrite n'aient attribu ce mouvement tous les caractresd'un mouvement absolu.
Cette doctrine qui loge les corps pleins dans un espace vide doud'une ralit gale celle des corps qu'il contient, toute l'Ecoleatoinistique l'a professe ; Lucrce, au premier livre de son Dereritm natura, l'a formule en de beaux vers :
Omnis, ut est, igtur, per se, Natura, duabusConsistit rbus ; nain corpora sunt, et inane,Haec in quo sita sunt, et qua diversa moventur
;
Corpus enim per se coinmunis deliquat esseSensus
;quo nisi prima lides fundata valebit,
Haud erit occultis de rbus quo referentesConlirmare animi quicquam ratione queamus.Tum porro locus, ac spatium, quod inane vocamus,Si nullum foret, haud usquam sita corpora possentEsse, neque omnino quoquam diversa meare ;Id quod jam supera tibi paullo ostendimus ante.
'rterca nihil est, quod possis dicere ab omniCorpore sejunctum, secretunique esse ab inani
;
Quod quasi tertia sit rerum natura reperta.
Ergo preeter inane, et corpora, tertia per seNulla potest rerum in numro natura relinqui.
1. Flutarchus, Adversus Coloten, IV, 2.2. Aristote, Mtaphysique, livre I, eh. IV (Aristotelis Opra, d. Didot,
t. II, p. 474 > d. Bekker, vol. II, p. 985, col. b).
-
30 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
III
LA THORIE DE L ESPACE ET LA CONSTITUTION GEOMETRIQUE DES ELEMENTSSELON PLATON
La Physique que Platon professe au Time parat troitementrelie la Physique de Leucippe et de Dmocrite '. Le rle queceux-ci attribuaient au non-tre au rien-du-tout, au vide (to >Jir,
ov, 70 ayjv, 70 xevov), Platon l'attribue ce qu'il nomme l'espace
(r, ywpa) 2.Platon, nous l'avons vu, place d'abord au sommet de la ralit
les ides des choses, ides qui ne sont susceptibles ni de gnra-tion ni de changement ni de destruction, ides qui ne tombent passous les sens, qui ne peuvent tre connues que par l'intuition ration-
nelle (v xal irXw sxslOsv ar.o/X'^twoy. Ce mouvement local,qui est, pour un tre changeant, commencement d'existence en un
i. Sur les rapports des doctrines de Platon avec celles de Dmocrite, voir :Albert Rivaud, Le problme du devenir et la notion de la matire dans ta
Pliitosop/iie grecque depuis les origines jusqu' Thophraste ; thse de Paris,1905, s 2i -
r> pp- 309-811.
InoeboRG Hammkh Jensen, Demokrit uud Plalo (Archiu j'iir Philosophie. I.Arc/tin J'ir Geschichte dcr Philosophie, Bd. XVI, pp. 02-105 et pp. ai 1-229;njto).
2. Sur les diverses attributions de la yoa dans Platon, voir Albert Rivaud,Op. laud., 1. III, ce. II, III et IV ; pp. 285-3i5.
-
LA COSMOLOGIE DE PLATON 37
lieu, suivi de la disparition de cet tre en ce mme lieu, supposeun lieu qui demeure tandis que ce mouvement se produit. Ce lieu,ce n'est pas l'tre absolu et idal qui le peut fournir ; l'tre per-manent, en elle!, ne reoit jamais en lui-mme un autre trevenu d'ailleurs, non plus qu'il ne pntre jamais en aucun autretre o'jt si; auto elcroevuievov XXo XXoev outs auxo su; aXXo ~o'.lv. Ce lieu ne pourra donc se trouver qu'en un troisime genred'tre, en l'espace. Gomme l'tre absolu et idal, l'espace est sous-trait la destruction ; mais il n'est pas, comme lui, impntrableaux autres tres ; tous ceux qui naissent et meurent, il offre uneplace : ... Tpvcov os y. vvo ov tot^.; ytopa? el, mOopv o -^o-osyo-ijlvov, 'Spav ok rcapyov 'o-a eysi vvscriv -y.rrv/.
Cet espace, comment le connaissons-nous ? Platon nous dit qu'ilne tombe pas sous les sens par lesquels nous percevons les treschangeants et corruptibles ; et, bien qu'il ne nous le dise pas, iladmet sans doute que l'espace n'est pas, comme les ides pures,contempl par l'intuition intellectuelle. Il ne peut tre atteint,poursuit l'auteur du Tinte, que par un certain raisonnementhybride mttov Xoy',.7|ju xv v6G
-
38 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
un espace, ncessairement illimit, o cet Univers est log, et danscet espace, rien n'existe, en sorte qu'il est vide. Au sein mme duMonde, Platon, la diffrence des Atomistes, n'admet l'existenced'aucun espace vide ; il rejette l'opinion, professe par les Ato-mistes, selon laquelle l'existence du vide serait requise pour lapossibilit du mouvement. En un langage ' qui fait songer celuiqu'emploiera Descartes, il affirme que tout mouvement produit ausein de l'Univers, qui est absolument plein, est un mouvementtourbillonnaire qui se ferme sur lui-mme. C'est au sujet de l'airvacu par notre respiration qu'il formule cette doctrine : Iln'existe aucun vide o puisse pntrer l'un des corps qui sont enmouvement ; lors donc que nous chassons le souffle hors de notrepoitrine, il est manifeste chacun, par ce qui vient d'tre dit, quece souffle ne s'en va pas dans le vide, mais qu'il chasse de son lieul'air voisin ; l'air chass, son tour, chasse toujours celui qui luiest voisin
;par cette mme ncessit, tout l'air se meut en cercle ;
en la place que l'air quitte, un autre air entre comme s'il tait adh-rent l'air qui s'est chapp, et il remplit cette place ; tout ceteffet se produit simultanment l'image d'une roue qui tourneautour de son axe, et cela parce que rien n'est vide. Emwrixevov ouov ortv et twv cpepopiviov ojvavc' v elo-eXOelv ti, to o
7rvsGaa epsTou irap' y,|j.o)v ew, to jj.T7. toGto yjoti 7iav~l oYtXov w oux
el xevov, XX to tcX^t'Iov ex ty,^ opa to9et " to o' wOo'jjjlsvov cEXa'Jvs'.to tcXt^s'Iov el, xal xa-u Ta'JTTjV ty,v vyxrjV Tcv 7rsp'.eXauv6|ji70v sigTrp/ opav, oQev ^TJXOe to TcveCijJia, enov xsw-e xal vaTXrip'Jv aUT7|VuvsTceTa'. T() Tcvs'Jjj.aT'., xal toOto ajj.a rcv olov Tpoyou Tcep'.ayoiivou
yv/veTa. ot to xevov Lv/|8v elvou.
A la vrit, si Platon ne reoit pas en son Monde le videdes Atomistes, on ne peut pas dire non plus qu'il y mette ce
(jue ces philosophes nommaient le plein, c'est--dire cette sub-stance non dfinie, mais rigide et impntrable, dont ils for-maient les corps ; dans l'espace, dans la ypa, Platon n'admetd'autres corps rels que des assemblages de figures gomtriques.
Ce raisonnement hybride qu'est le raisonnement gomtriqueva, en effet, conduire Time figurer, dans l'espace, interm-diaire entre l'tre et les apparences changeantes, les essences sp-
cifiques du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. La thorie despolydres rguliers lui dcouvrira ce que sont ces essences.Time dcrit 2 d'abord les trois polydres rguliers dont les
1. Platon, Time, 79 ; d. cit., p. 23g2. Platon, Time, 54-56; d. cit., pp. 221-222.
-
LA COSMOLOGIE DE PLATO.N 39
faces sont des triangles, savoir le ttradre, l'octadre et Ficosa-
dre ; puis il dfinit le cube; il est trop gomtre, sans doute,pour ignorer qu'il existe un cinquime polydre rgulier, le dod-cadre pentagonal, et c'est celui-ci qu'il t'ait allusion lorsqu'ildit : Il existe une cinquime combinaison dont Dieu a us pourdessiner l'Univers '. Mais les quatre premiers polydres repr-sentent seuls les essences spcifiques des lments.
A la terre, nous donnerons l'espce cubique ; entre les quatregenres d'lments, en effet, la terre est la plus immobile ; parmiles corps, elle est la plus apte se fixer; il est donc ncessairequ'elle ait les bases les plus fermes . Or les bases carres ducube assurent la figure qui les prsente une plus grande stabilitque les bases triangulaires des autres polydres.Au feu, au contraire, nous attribuerons le polydre qui est le
plus mobile parce que ses bases sont les moins nombreuses, quiest le plus aigu, le plus apte diviser et couper, en un mot le
ttradre. A l'air et Feau qui sont, par leur mobilit dcrois-sante, les intermdiaires entre le feu et la terre, nous donneronsl'octadre et l'icosadre.
Comment faut-il entendre cette correspondance entre les quatrelments et les polydres rguliers? Faut-il simplement regarderle cube, l'icosadre, l'octadre et le ttradre comme des sym-
boles des essences spcifiques de la terre, de Feau, de l'air et dufeu ? Faut-il, au contraire, limitation des sectateurs de Dmo-crite, imaginer que les corps lmentaires visibles et tangiblessont rellement des assemblages de telles particules polydri-ques? Que cette seconde opinion soit celle de Platon, il ne semblepas que l'on en puisse douter, lorsqu'on lit ce passage :
11 est donc juste et vraisemblable de regarder la figure dusolide ttradrique comme tant l'lment et la semence du l'eu,
i. Selon Jean Philopon, voici comment il faut interprter ce passade : Demme que le dodcadre rgulier douze faces, de mme Dieu a compos leMonde de douze globes embots les uns dans les autres, savoir la terre, l'eau,l'air, le feu sublunaire, les sept orbes des astres errants et l'orbe des toilesfixes (Ioannes Grammaticus Philopoms Alexandrin us //( Procli Diadochi duo-deoigmti argumenta de mundi ternitate... loanne Mahotio Argentenae inter-prte. Lugduni, excudebat Nicolaus Edoardus, Campanus, 1057. In Procli Dia-dochi argumentum decimumtertium, p. 2/j4- - Ioaxxes Philoponus De aeternitateMundi contra Proclum. Edidit Hugo Rabe. Lipsiae, MDCCCXCIX. XIII, 18,pp. r>3G-337) Platon, en effet, dans le Phdre et dans le Ve livre des Lois,forme le monde de douze sphres concentriques ; mais il ne parait pas abso-lument certain qu'il ait jamais admis, comme Aristote, une sphre de feusublunaire; on doit plus vraisemblablement supposer que la premire sphre,pour lui comme pour les Pythagoriciens de son temps, tait celle du feu cen-tral que la terre contient. Voir, ce. sujet, Th.-H. Martin, Etudes sur le Tinte,Paris, 1841 ; tome II, note XXXVII, 3, pp. 114-119, et note XXXYTII, pp. 1 4 1-1 4^-
-
40 LA COSMOLOGIE HELLNIQUE
la seconde figure comme tant l'lment de l'air, la troisimecomme tant l'lment de l'eau, [la ligure cubique, enfin, commetant l'lment de la terre]. Ces solides, il nous les faut concevoirsi petits qu'il nous soit impossible de discerner isolment aucund'eux en chaque espce d'lments ; mais lorsque ces solides setrouvent runis en trs grand nombre, nous voyons la masse qu'ilsforment par leur ensemble. Gomment cette opinion peut-elle tre reue sans contradiction ?
Contre Leucippe et Dmocrite, nous avons entendu Platon affirmerqu'il n'y avait pas de vide, que tout mouvement se produisait clansle plein absolu et prenait, partant, la forme tourbillonnaire ; il s'estexpliqu, cet gard, avec une nettet que Descartes ne surpas-sera pas.
Croyait-il donc que des icosadres, que des octadres pussentse juxtaposer les uns aux autres de manire former, sans laisserentre eux aucun intervalle vide, des masses continues d'air oud'eau ? Assurment, il tait bien trop gomtre pour le penser.
Qu'en faut il conclure ? Que les diverses parties de sa doctrineprsentent entre elles d'irrductibles contradictions. Si l'on s'endevait tonner et scandaliser, nous rapprocherions de l'incoh-rence de Platon l'incohrence de Descartes. Descartes, lui aussi,admet qu'il n'existe pas de vide ; lui aussi, il admet des matireslmentaires dont chacune est forme de petits corps d'une figuredtermine ; s'est-il jamais demand, cependant, comment lesspires rigides de sa matire subtile pouvaient remplir, au point dene laisser aucun espace vide, les interstices des sphres qui for-ment la matire grossire ?
11 semble bien que Platon (et c'est encore une des analogies quel'on peut relever entre sa pense et celle que concevra Descartes)n'ait mis en ces figures dont les lments sont composs aucunprincipe rel et permanent autre que l'tendue mme qu'ellesoccupent. C'est pourquoi Aristote nous dit fort justement 1 quePlaton, dans le Time, identifie l'tendue occupe par un corps,la //'>pa, avec le principe qui subsiste en tous les changements dece corps, avec ce qu'Aristote nomme uXy) et ses commentateurslatins maleria. Platon donc, dans le Time, dit que l'tendue etla matire sont une mme chose, lib xai IlXaTtov ttjv OXtjv xal rrjvyo')pav to auTO Tjatv svai sv t(o Tip.ai. A une semblable identifi-cation entre l'tendue occupe, le lieu, et le principe de per-manence qu'est la matire, Aristote s'opposera avec grand sens
;
i. Aristote, Physique, I. IV, ch. Il (IV) (Aiustotelis Opra, d. Didot, t. II,|)|). 286-287 ; d. Bekker, vol. II, p. 209, col. b).
-
LA COSMOLOGIE DE PLATON il
la matire, dira-t-il, ne se spare pas de la chose relle ; lie lieu",au contraire, en peut tre spar ; r\ uXyj o ywprrai xo npyyMto^Ttrv os totov voveTat. C'est par l, en effet, que le mouvementlocal est possible ; pour qu'il y ait mouvement local, il faut qu'unemme matire quitte un lieu pour acqurir un autre lieu, donc quela matire soit autre chose que le lieu.
Cette tendue dont Platon t'ait la matire permanente des l-ments capables de changement et qu'il nomme \ pour cette raison, la nourrice de la gnration, rj yevaeuiq Tithjvrj , cette tendue,disons-nous, reoit les formes diverses qui constituent le feu, l'air,
l'eau et la terre ; chacune de ces formes (jjiopcpvi) est, en mmetemps, source de puissance (Svajxt) ; ds lors, la %pa perd sonhomognit. Les puissances qui la remplissent ne sont plus par-tout semblables, elles ne s'quilibrent plus en tout point
;par
consquent, l'tendue elle-mme n'est plus en quilibre nulle part ;branle par chacune de ces puissances, elle oscille partoutd'une manire irrgulire ; rciproquement, une fois mise en mou-vement, elle branle son tour chacune de ces formes. Toutes cesformes agites en tout sens, elle les meut de telle manire qu'ellessoient toujours de mieux en mieux distingues les unes des autres,comme le sont les objets qui tombent, aprs avoir t secous etvanns, sous les cribles ou sous les instruments propres purerle froment ; celles qui sont compactes et lourdes sont entranes
dans un sens, celles qui sont fluides et lgres sont portes vers
un autre lieu ; elle donne ainsi chacune d'elles sa place. 1 vj. oto utj8' ojxoitov BuvaLtscov [M^'t roppoirtov fJwrwrXa;j9ai v.%-z o'jov aur/i
Icopporev, aXX' vouaXw -v-rtTaXavToyuivrv a-eUa^at, fjtlv y-' exetvcov
aTY,v, juvouaeViriv S' au roxXtv xeva jUw -zb. o xt.vouu.Eva XXa XXocrsel cppeaQai Biaxpivoueva, aioTcep ~ utcotwv "Xoxvtov te xal opyvwv tvTepl T7|V to cttou xSapcrtv ffei6u.va xal vixjJKUjxeva - ijlsv tuxv xal^apa XXiftj Ta os uav xal xouoa el rpav et. ospueva 'opav. Parcette opration, semblable celle qui, l'aide du van, spare le blde la balle, les quatre lments, mlangs d'abord et confondusen un dsordre extrme, se sparent les uns des autres, et chacund'eux vient occuper, dans le Monde, la rgion qui lui est propre.
Il est clair qu'en ce passage, Platon ne laisse plus la '^wpa
l'indiffrence et l'inactivit qui conviendraient seules l'espacevide ; peu peu, il est arriv assimiler cette ytpa un fluide quibaigne les ligures polydriques dont les lments sont forms ; cefluide lui a paru susceptible de se mouvoir sous l'action de forces
i. Platon, Tirne, 52-53 ; d cit., p. 220.
-
42 LA COSMOLOGIE HELLENIQUE
exerces par les lments et, son tour, de communiquer sonmouvement aux corps qui sont plongs en lui. La notion d'espacegomtrique, que le mot ypz exprimait tout d'abord, s'est graduel-lement matrialise ; la y/opa est devenue, premirement, ce qu'ily a de permanent dans les lments, l'analogue de la \j\r\ d'Aris-tote ; elle est devenue, ensuite, le principe qui a ordonn le chaosprimitif et qui, chaque lment, a assign son lieu naturel.On serait donc singulirement du si l'on cherchait une suite
logique rigoureuse en la thorie de l'espace et du lieu que le Timenous propose. Cette thorie, cependant, mrite attention, carPlaton, en la formulant, a cherch le premier, au dire d'Aristote ', rsoudre le grand problme du lieu et du mouvement. Tousdclarent que le lieu est quelque chose ; mais lui seul a tent dedire ce qu'il tait.
IV
ARCHYTAS DE TARESTE ET SA THORIE DE LESPACE
Cet loge est-il entirement mrit et ne s'appliquerait-il pas Archytas de Tarente plus justement qu' Platon?
Le Pythagoricien Archytas naquit Tarente vers l'an iiOav. J.-C. et prit vers 360, dans un naufrage, sur les etes d'Apulie.Platon le connut pendant son voyage en Italie et entretint uncommerce de lettres avec lui, en sorte qu'il n'est pas permis dengliger l'influence que les doctrines d'Archytas ont pu exercersur celles de Platon.Parmi les ouvrages qu' Archytas avait composs, il se trouvait
un livre Sur les termes qui dsignent l'Universel (Ilepl twv xaoouXoycov) -
; ce livre tait parfois plus brivement intitul ''' : Del'Universel (lep'. to icavro). Ce trait est aujourd'hui perdu ', maisSimplicius, en son Commentaire aux Catgories d'Aristote, y faitde nombreuses allusions et en cite divers fragments.
Or, en cet ouvrage, Archytas, selon l'usage pythagoricien qui
faisait du nombre dix un nombre sacr, a class en dix chefs d'ac-
i. Ahistote, Phr/sir/ue, 1. IV, chap. II [IV] (Aristotelis Opra, d. Didot,t. II, p. 286 ; d. Bekker, vol. I, p. 209, col. b).
2. Simplicii In Aristotelis Categorias Commentaram. Edidit CarolusKalbfleisch. Berolini, MCMVII. Promium, p. i3.
3. SlMPUCil Op. laud., loc cit., p. 2.4. On a donn, sous le titre : Aitcrn Turenlini deceni prdicamenta
( Venetiis, apud Rutilium Borgominerium, i50i) ou sous le titre : T v ta (sic)lSXij riz iar rci$z. 'koyjirou fouivoi Si*.ut.iyot x9oAtxot. . . (Lipsise, apudE. Voegelium,s.d.) une soi-disant dition, purernent apocryphe, de cet ouvrage.
-
FA COSMOLOGIE DE PLATON 43
cusation ou catgories (xaTYjyopat) les notions simples que nousformons et formulons au sujet de toute chose. C'est l'imitationd'Archytas qu'Aristote, son tour, a mis, l'entre de sa Logi-que, un trait Des dix catgories.
Cette circonstance, d'ailleurs, n'est pas la seule o le Stagiritcse soit laiss guider par l'exemple du Pythagoricien de Tarentc.Celui-ci avait encore compos ' un trait Sur les notions
-
44 LA COSMOLOGIE HELLMQUX
On peut dire de l'Univers, de l'ensemble des choses autres quele lieu, qu'elles ont un lieu ; ce lieu, c'est la frontire mme quiborne l'Univers ; c'est, en effet, par la puissance du lieu que cetUnivers est contraint d'occuper telle tendue limite, de mmeque chaque corps est rduit telle dimension par la pression ou latension que le lieu exerce sur lui.
Citons les passages de Simplicius d'o se peut extraire cettedoctrine d'Archytas :
Aprs avoir rapport une remarque de Jamblique, le Commen-tateur Athnien poursuit en ces termes ' :
Si toutefois, comme Archytas semble vouloir l'insinuer, lelieu possde l'existence par lui-mme, si absolument aucun corpsne peut exister moins d'tre dans le lieu, c'est le lieu quiimpose des limites aux corps et qui se borne lui-mme. En effet,si le lieu subsistait, dpourvu de toute force, au sein du videinfini, s'il se trouvait dans l'espace sans possder une certaine con-sistance, il faudrait donc que ses bornes lui fussent imposes dudehors. Mais il possde une puissance active, une essence incor-porelle qui est borne ; il empche le volume des corps de crotreou de dcrotre indfiniment ; ce volume, il assigne en lui-mmedes limites ; proprement parler, donc, c'est de lui-mme qu'ilimpose un terme (to Trpas) aux corps. C'est ce qu'Archytas dclaraitlorsqu'il disait : Puisque tout ce qui se meut se meut en un lieu, il est clair qu'il faut qu'un lieu subsiste tout d'abord, lieu
dans lequel existeront ensuite ce qui meut et ce qui subit l'ac- tion motrice. Peut-tre donc, d'aprs cela, le lieu est-il le pre- mier de tous les tres, puisque tout tre ou bien est en un lieu, ou bien ne peut exister indpendamment du lieu . Archytassuppose avec raison que le lieu est antrieur (7cpe
-
LA COSMOLOGIE DE PLATON 43
et, il en serait de mme l'infini. Il est ncessaire, par cons- quent, que toutes choses se trouvent dans le lieu, mais que le lieu ne soit en rien. Les tres sont disposs les uns par rapport
aux autres comme le sont les choses bornes par rapport celles qui les bornent ; le lieu propre au Monde universel, c'est le terme mme de l'ensemble des tres ; y*P tw r.M-b; xo^u -~Q^ tzzot.^ -vTcov Twv ovccov o-t'.v .
De ces textes d'Archytas et des commentaires dvelopps parSimplicius, il rsulte que le Pythagoricien de Tarente admettait
la ralit d'un lieu absolu, d'un lieu dont l'existence ne tut pas
subordonne celle des corps. Mais ce lieu n'tait nullement, pourlui, l'espace des gomtres ni le vide des Atomistes. Il lui attribuaitune limite que ne saurait admettre ni l'espace pur ni le vide. En
outre, il le regardait comme capable d'agir sur les corps logs en
lui. Par l, le -tzo; d'Archytas n'tait pas sans analogie avec lay/pa
de Platon. Plus exactement peut-on dire que la '/^pa platonicienne
apparat, comme une notion composite qui tient, d'un ct, del'espace pur des gomtres et du xsvov atomistique, et qui, d'autrepart, emprunte certains caractres au t-o; d'Archytas.
V
la cinquime essence selon L'pinomide
La terre, l'eau, l'air, le l'eu tant composs de petits cubes, depetits icosadres, de petits octadres, de petits ttradres, Platons'applique montrer comment ces formes gomtriques expli-quent toutes les proprits, toutes les actions de ces lments.Nous ne suivrons pas le dveloppement de cette Physique quinous entranerait fort loin de notre objet '. Nous en prendronsseulement occasion d'une remarque.
Ce que ime vient de nous enseigner touchant l'essence spci-fique des lments met, pour ainsi dire, en vidence la formesous laquelle Platon conoit la Physique.
Les choses que nous voyons et que nous touchons, qui sontsujettes la gnration, au changement, la destruction, sontchoses relles; mais elles ne sont que les images d'autres ralits.
i. Le lecteur dsireux de connatre cette Physique et la Physiologie qui endcoule pourra lire avec fruit les notes contenues en l'ouv