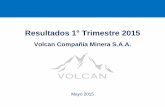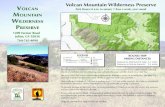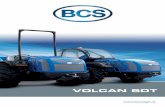Paul-Laurent Assoun Freud and Nietzsche Athlone Contemporary European Thinkers Series 2003
"Lecture Psychanalytique d'Audessous Du Volcan", par Paul-Laurent Assoun (2009)
Transcript of "Lecture Psychanalytique d'Audessous Du Volcan", par Paul-Laurent Assoun (2009)

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=TOP&ID_NUMPUBLIE=TOP_107&ID_ARTICLE=TOP_107_0031
Au risque du toxique. Lecture psychanalytique d’Au-dessous du volcan
par Paul-Laurent ASSOUN
| L ’Espri t du Temps | T OPIQ UE
2009/2 - n ° 107ISSN 0040-9375 | ISBN 9782847951493 | pages 31 à 45
Pour citer cet article : — Assoun P.-L., Au risque du toxique. Lecture psychanalytique d’Au-dessous du volcan, TOPIQUE 2009/2, n° 107, p. 31-45.
Distribution électronique Cairn pour L’Esprit du Temps.
© L’Esprit du Temps. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Topique, 2009, 107, 31-45.
AU RISQUE DU TOXIQUE
Lecture psychanalytique d’Au-dessous du volcan
Paul-Laurent Assoun
« La vie s’appauvrit, elle perd de son intérêt dèsl’instant où, dans les jeux de la vie, on n’a pas ledroit de risquer la mise suprême, c’est-à-dire la vieelle-même. »
C’est bien sous la plume de Freud que l’on trouve ce qui, bien plutôt quequelque éloge du risque – qui, on le sait, n’est guère de son style — , relèved’un constat fondamental, en son genre clinique, relatif à une certaine écono-mique de la vie et du désir. Le créateur de la psychanalyse prend acte, au cœurde sa réflexion sur la mort 1, de ce fait de paupérisation de la capacité vitale, dèslors que l’existant se trouve — dans quelque conjoncture que ce soit – amputé,fût-ce à son insu, de ce « droit » et de cette envie de risquer la mise suprême du« jeu », que la vie le nécessite à jouer, soit la vie même… L’existence devientalors aussi « insipide », à son dire, qu’un « flirt américain dans lequel il est éta-bli d’emblée que rien n’a le droit de se passer », en contraste avec une « relationamoureuse continentale dont les graves conséquences doivent toujours resterprésentes à l’esprit des deux partenaires ». La métaphore, on le voit, réintroduitle sérieux de l’érotique dans l’affaire – traçant une frontière – inter-continen-tale – entre le simple titillement de la jouissance et le désir « pour de bon ».
Entre le « risque-tout » – familier à l’époque des « conduites » dites « à ris-que » sur lesquelles il va falloir revenir, dans la mesure où elles nous imposentla conjoncture du malaise de l’époque – et le « risque-rien », voué à la léthar-
1. S. Freud, Considérations actuelles sur la guerre et la mort, 1915, II, « Notre relation à lamort », in Gesammelte Werke, Fischer Verlag, G.W.X., p. 243 (d’après notre retraduction).
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 31

gie d’une vie vaccinée contre le risque et une anémie du désir, se fraie la voiede l’épreuve du risque pour l’existant désirant. Voilà qui cadre la question durisque, cette notion plombée d’idéologie, en sa dimension de réel inconscient.
DU RISQUE DE VIVRE…
Affrontons la vérité de La Palice : pas de risque s’il n’y a, pour qui y est sou-mis, « quelque chose à perdre », donc s’il n’y a place, dans sa vie psychique,d’un quelque chose à jouer. Le sujet qui court un risque est donc exposé à une« moins-value ». Or, la perte totale, le risque absolu, pour le vivant, c’est assu-rément la perte du bien qu’est « sa » vie.
Il est vrai que le terme s’est historiquement imposé – tardivement, au XVIesiècle – dans une perspective de « calcul des risques » : les compagnies d’assu-rances assurent sur les risques, elles ont même en un sens inventé la notion àl’usage de la modernité, comme garantie sur les expéditions périlleuses – celle-ci se déchiffrera dès lors volontiers en ces termes. Mais précisément, c’est unefaçon de neutraliser et de narcotiser le risque comme réel. L’assurance-vie pro-met une vie sans risques, du moins qui ne soient « calculés »… et qui rapportentdes « intérêts ». La vie même devient définissable dans cette perspective commeun risque chiffré, c’est-à-dire quantifié et évalué. L’évaluation s’impose mêmecomme antidote au risque de penser, ce qui est aujourd’hui plus que jamaisflagrant 2. Il est certes rassurant de voir d’avance « couverts » les risques quinaissent au cours de la vie, évitant le spectre de la précarité qui naît de l’im-prévu ingérable, mais qu’en est-il du risque de vivre même, celle que nulle« assurance tous risques » ne peut « couvrir » ? Et que ne pût-on contracter uneassurance contre le risque de désirer – ce qui ferait l’économie des symptômes.Du moins est-ce ce dont témoigne notre clinique. Bien des symptômes naissentdu remords térébrant d’une vie que le sujet ne veut plus et surtout ne sait plusrisquer (d’où sa « mauvaise conscience » larvée qui crée le malaise, voire cris-tallise le symptôme).
Cela s’éclaire a contrario par l’expression : « Je n’ai plus rien à perdre » –signe que le locuteur se croit sorti de cette arithmétique des plaisirs, alors qu’ilest « échec et mats » sur le damier des « coups » de la vie. L’expression a doncune connotation objectivement mélancolique. Le mélancolique est celui qui estsi totalement identifié, pour le pire, à l’objet de la perte qu’il n’a plus d’espace(interne) pour le risque de désirer. Façon de signifier que le « rien » a barre surlui. En revanche il n’y a de risque que si le sujet tient suffisamment à sa peaupour appréhender de la perdre.
32 TOPIQUE
2. P.-L. Assoun, Malaise dans l’évaluation in « Évaluation » Journal Français dePsychiatrie n°29, Erès, p. 11-16.
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 32

Un risque, la langue le dit bien, « se court ». La perte totale, le risque absolu,pour le vivant, c’est la perte du bien qu’est « la vie » ou plutôt « sa » vie. Làencore celui qui est déjà mort au désir est suprêmement étranger au risque. Prendreun risque, c’est s’exposer à un danger qui touche en dernière instance à l’auto-conservation. Mais l’on s’expose là au risque… de tourner en rond – ce quefont très précisément les bavards discours des « conduites à risques » – si pré-cisément le savoir de l’inconscient n’ouvrait une piste nouvelle.
… AU RISQUE DE DÉSIRER : L’AUTRE SCÈNE DU RISQUE
Ce que la psychanalyse articule avec le primat de la pulsion est cette prisedu sujet dans le sexuel impropre à la satisfaction 3, soit que le vivant est médiépar l’érotique. L’Eros contient à la fois une prodigieuse et inégalable expansi-vité du vivant et une exigence encombrante, épine plantée dans toute « sciencedu vivant », qui s’exténuerait à tenter de l’intégrer.
Dépendance de son être à l’autre, prise en compte de l’objectalité qui vientcompliquer foncièrement la tâche du vivant. Inscription par là même dans lacastration, angoisse « hors vie » sur laquelle vient se fracasser le vivant, dès lorsqu’il est pris dans la parole. Cela nous place dans la logique économique de lajouissance, d’où le risque se trouve foncièrement repositionné. Le discours actueln’est pas avare du terme, mais, comme toujours, il ne croit pas si bien dire. Lediscours des « conduites à risque » doit donc être mis au risque de la psychana-lyse, qui recadre la notion depuis le réel inconscient : c’est bien alors désirerqui s’avère constituer le risque des risques. Ainsi le sujet peut-il même feindrede mettre sa vie en jeu pour faire diversion à la vérité de son désir – ce qui cettefois nous rapproche de la signification inconsciente véritable de la conduite àrisque, « inconduite » au regard au désir. Ce qui ouvre les vannes de la pulsionde mort, qui, on le sait, envahit systématiquement les espaces désertés par l’éro-tique.
LE « HAUT RISQUE » : L’EXPLOIT
Réexaminons le moment le plus patent de « haut risque » qui éclaire le malaisedes temps de paix. À l’état de guerre, le sujet se voit confronté à un risque immi-nent et évident de perdre la vie, épreuve décisive, ici et maintenant, pour lespulsions d’auto-conservation. Ce qui, dans le texte freudien consacré au destinpathologique en état de guerre 4, est désigné comme Wagnis, terme qui désigne
PAUL-LAURENT ASSOUN – AU RISQUE DU TOXIQUELECTURE PSYCHANALYTIQUE D’AU-DESSOUS DU VOLCAN
33
3. S. Freud, Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse.4. S. Freud, Introduction à « Sur la psychanalyse des psychonévroses de guerre ».
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 33

un mélange difficilement restituable « d’audace » et de prise de risque. Par uneintuition clinique remarquable – au reste inspiré des travaux de Karl Abraham –,Freud entrevoit dans les « psychonévroses de guerre » le lieu et le vif même dudanger, soit la peur de soi qui s’ouvre à l’occasion de ce choc frontal avec laconjoncture de risque. Ou plutôt très littéralement la peur de son propre corpsdont le sujet se trouve alors intempestivement rapproché.
Dans l’état de guerre, le sujet n’a pas peur que de l’autre, celui de la tran-chée d’en face : s’il « tombe malade », c’est qu’il se voit si rapproché de soncorps, de cette altérité moins bruyante pour le « moi de paix », qu’il expérimentel’angoisse d’avoir un corps, brusquement capable de tout 5. Soit : plus encoreque de le perdre, de ne pouvoir plus en dénier l’évidence soit la tendance à seporter aux extrémités. Telle est l’épreuve de vérité de l’état de guerre. C’est plusprécisément la peur de l’acte auto-destructif qui profiterait (« lâchement », serait-on tenté de dire) de la conjoncture pour se frayer la voie, aux dépens du moiqui, lui, préférerait continuer à vivre.
L’auto-conservation est bien en jeu et mise en péril, mais ce dont le sujets’effraie le plus – en tout cas au point que cela produise le symptôme trauma-tique –, c’est de cette tentation de mourir, risque qui émane de lui-même, ensituation. De ce conflit ouvert du moi (au sens d’une « blessure ouverte ») – dontle moi devient le champ de bataille –, Freud assigne le lieu propre : « Il se joueentre l’ancien moi pacifique et le nouveau moi belliqueux du soldat et devientaigu dès qu’au moi-de-paix devient évident quel grand danger il court à causedes risques (Wagnisse) de son « double » nouvellement formé » 6.
La formule est d’autant plus déterminante qu’elle va bien au-delà du risquelocalisé de guerre. Ou plutôt assigne-t-elle le noyau de ce qui se joue dans les« conduites » face au risque – ce qui est décidément tout autre chose que leséquivoques « conduites à risque » –, d’un casus belli. On notera le repérage parFreud du surgissement, dans le bruit et la fureur de la guerre, de ce « double »qui fait courir au sujet le risque de dilapider sa vie, de se jeter au-devant de lamort, bref de devenir malgré lui un « risque-tout ». Voilà qui le fait trembler dela tête aux pieds…
Cela dessine l’enjeu symbolique structurel : le sujet tient à la vie par la filia-tion et la place dans le symbolique. Que celui-ci, dans quelque condition deguerre que ce soit, se trouve ébranlé, et le sujet ne s’inscrit plus, il se dé-dou-ble dangereusement. Les conduites à risque dont se gargarise le discours sociald’actualité ne font que pointer la position de ces sujets qui, de ne pouvoir étrein-dre leur existence, cherchent dans des conduites dangereuses une façon derencontrer leur « double » et de le dompter.
34 TOPIQUE
5. P.-L. Assoun, Corps et symptôme. Leçons de psychanalyse, Economica/Anthropos, 3e éd.,2004.
6. P.-L. Assoun, « Guerre et paix selon Freud. Destins collectifs de la pulsion de mort » in« Existe-t-il une guerre juste ? », Topique n°102, L’Esprit du Temps, 2008, p.135-142.
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 34

LE RISQUE, MORT ET/OU VIF
Qu’est-ce donc que ce danger interne, sinon la rencontre du vif même de la« pulsion de mort » ?
Voilà qui décale décisivement la problématique du risque, toujours peu ouprou indexée à une problématique du risque de mort, au risque de vivre, au pointde rencontrer la mort comme vérité du vivant. Formule paradoxale demandeexplicitation.
« Étrange pulsion qui travaille à la destruction de sa propre demeure », s’ex-clame Freud 7. Or, une façon de mourir à petit feu ou de distiller la pulsion demort, c’est ce qu’offre la conduite toxique. Voilà en effet qui cadre l’approchede ce que l’on peut tenir pour la stratégie toxique, au-delà de la catégorie sommetoute comportementale d’« addiction ».
LA GESTION TOXIQUE DU RISQUE
C’est en ce point qu’il est possible de situer la « politique toxique » du ris-que dont on a commencé à prendre la vraie mesure. Le discours social alertesur le risque d’intoxication sous le chef que le sujet y laissera la santé. Constatindéniable, sauf à s’aviser que le sujet dit « addicté » s’empoisonne sciemmentjustement parce que l’existence l’empoisonne. Le paradoxe est qu’il s’exposeau risque avéré des effets nocifs du toxique, qui, il le sait mieux que personne,« nuit gravement à la santé », parce qu’à lui, la vie l’empoisonne.
De cette dialectique, on trouve la description inégalée dans Au-dessous duvolcan de Malcolm Lowry 8 surclassant, pour peu qu’on le complète d’une oreilleanalytique, tous les stéréotypes de discours sur l’alcoolisme. Description sai-sissante de l’ex-consul Geoffrey Firmin qui s’enfonce dans l’enfer de l’alcoolavant de trouver une mort ignominieuse dans les bas-fonds de la cité. Cette loca-lisation infra-volcanique, Quauhnahuac, allusion à la situation toponymique dulieu du Mexique, Cuernavaca, où, à l’instar de son héros, le romancier MalcolmLowry a séjourné – le Mexique étant pour lui le lieu du déchirement amoureux,de Jan Gabrial à Margerie Bonner – désigne mystérieusement ce côtoiementavec l’abîme.
« Je ne puis me soûler, quelque quantité que je boive » ( p. 165). Tel estle constat du Consul adonné à la puissance de l’alcool. Tel est en effet le véri-table alcoolique qu’il n’est jamais ivre pour de bon. Mais suspendons pourl’instant l’étiquette « alcoolique », vocabulaire édifiant dès l’origine.
PAUL-LAURENT ASSOUN – AU RISQUE DU TOXIQUELECTURE PSYCHANALYTIQUE D’AU-DESSOUS DU VOLCAN
35
7. S. Freud, Nouvelle suite des conférences d’introduction à la psychanalyse8. M.Lowry (1909-1957) , Under the volcano (1947) que nous citons ci après d’après l’édi-
tion du Livre de Poche
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 35

Considérons seulement le buveur impénitent en tentant d’entrer dans sonunivers, ce qui suppose de s’imbiber nous-même de sa modalité subjective.Quel abîme côtoie-t-il ? Pourquoi cherche-t-il par cette voie l’équilibre ébrieuxqui le protège du vertige (de vivre) ?
« FAIRE LE PLEIN »
Pourtant, perfectamente borracho, telle est l’expression par laquelle le com-pagnon de beuverie mexicain caractérise d’emblée l’état d’ébriété atteint par lehéros : « Parfaitement soûl », pourrait-on traduire. Le terme borracho, empruntéà la langue locale, espagnol sud-américain, contient peut-être quelque chose dusignifiant, mieux que ses équivalents anglais ou français. Que dit le dictionnairele plus averti, celui de la Real Academia ?
Cet équivalent d’ebrio désigne le fait d’être enivré, embriagado – on entend« embrigadé » – par la boisson (bebida) et par extension celui qui s’enivre habi-tuellement. Buveur professionnel en quelque sorte. C’est aussi au sens colloquialcelui qui est « vivement possédé d’une passion quelconque », par exemple dela colère. Invitation à envisager l’alcoolisme comme passion.
L’adverbe accolé au terme fait bien allusion à un état de perfection. L’effet,sinon la finalité, serait-il donc d’atteindre un certain état de complétude ? Il s’agitde se faire plein comme une outre, de se remplir à ras bord : idéal de plénitudequi touche à la mystique, comme le précise l’auteur dans sa préface française– ce que le français « bourré » exprime avec une trivialité efficace.
En contraste : « Rien au monde n’était plus terrible qu’une bouteille vide !À moins que ce ne fût un verre vide » (p. 166). On sent, à l’affect de cette excla-mation, l’enjeu ontologique de cette horreur du vide : elle n’est pas seulementterrible parce que frustrante, mais parce que montrant la béance de l’être, dontil s’agit de se distraire au moyen de la drogue. L’ivrogne est toujours dans cetentre-deux, de la bouteille pleine ou vide. Rempli, il est identifié à une bouteillevidée.
Il n’en rappellera pas moins que l’alcool, remplissant le corps, est bien « unenourriture ». On notera l’axiome anthropologique : « Qu’est l’homme, sinon unepetite âme qui maintient debout un cadavre ? » (p. 483). Sauf à préciser : c’estpar l’alcool que le sujet acquiert cette âme qui, le temps de l’imprégnation, luirefait du corps, un corps non imbibé étant équivalent ipso facto à un cadavre…Sauf à ce qu’entre deux « beuveries », le sujet se cadavérise à nouveau. L’alcoolest façon de s’auto-conserver à mort…
36 TOPIQUE
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 36

LA CHUTE : DU BORRACHO AU BORRACHON
Cet état de perfection est destiné à être partagé, entre hommes, communautéerratique de borrachos.
Mais au-dessus des borrachos, il y a les Borrachones – ceux qui donnentleur intitulé à cet impressionnant tableau – quasi- tapisserie – que le Consuldécouvre en cours de roman (p. 344-345), espèce de vision dantesque de l’Enferréservé aux alcooliques. Cette « croûte » de propagande prohibitionniste trouveécho direct dans le sentiment de l’alcoolique, de se retrouver esseulé au milieude l’enfer en plein jour, séparé des autres, à commencer … des femmes.
Voilà, mis en équation hallucinatoire, le problème : recherche d’une pléni-tude esseulée, au cœur de laquelle le sujet rencontre son enfer : « Soudain, ileut une impression jamais éprouvée encore avec une aussi brutale certitude. Ilétait lui-même en enfer » (p.346).
MÉTAPHYSIQUE DU DÉMISSIONNAIRE
Examinons donc ce borracho, misérable et sublime aux yeux de son créa-teur, pour tenter de situer, au delà de toute métaphysique, l’objet intime de sapeur.
De consul, il n’a plus que le nom, s’étant désisté de sa fonction. C’est aureste foncièrement un démissionnaire de la vie, inapte à quelque fonction quece soit en ce monde, par une défaillance radicale de l’identification, ayant rompuses attaches – il est aussi, logiquement, divorcé. Longtemps avant de divorcerd’avec sa femme, il est divorcé d’avec « la vie ». Ce célibataire cherche dansles vapeurs de l’alcool un antidote au risque de vivre. Bref, c’est un « hommelibre », seulement marié avec son toxique. Confirmation que la dépendance cache une soif inextinguible d’indépendance, envers l’objet et, au-delà, avec lacastration, comme nous l’avons établi ailleurs 9.
Cet alcoolique ne titube pas, comme il a le soin de préciser avec fierté –même s’il lui arrive de s’allonger parterre, geste qui, pour signer la position dudéchet, semble empreint, à son évocation, d’une secrète magnificence : « Il n’estpas de ceux qui titubent dans la rue », et, quand il s’allonge, c’est encore « engentleman » ! (p. 164). Formulation qui montre la dignité singulière qu’il affi-che au cœur de son naufrage.
Il doit donc rester debout pour témoigner, et de quoi ? Disons d’abord : dufait que l’amour manque au monde et qu’il en est le témoin lucidement incon-solable. La philosophie du Consul est simple : « L’amour est la seule chose qui
PAUL-LAURENT ASSOUN – AU RISQUE DU TOXIQUELECTURE PSYCHANALYTIQUE D’AU-DESSOUS DU VOLCAN
37
9. P.-L. Assoun, «Le briseur de souci ou l’indépendance toxique. Thèses sur l’inconscienttoxicomane », in Markos Zafiropoulos, Christine Condamin, Olivier Nicolle, L’inconscient toxi-que, Anthropos Economica, 2001, p. 91-118.
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 37

donne un sens à nos pauvres allées et venues sur terre » (p. 94). Suit une mys-térieuse allusion à l’usage de l’alcool : « c’est de cette manière que je bois aussi,comme absorbant un éternel sacrement ». L’alcool vient donc à la place de l’amourmanquant. Il en garde , au cœur de la déchéance, le cachet de sacralité.
L’alcoolique, malade incurable et insatiable de l’amour – ce qui donneraitsens à ses « allées et venues » – s’administrerait l’alcool comme antidote à savacance dans l’ambiance. En l’absorbant, à la façon d’un « sacrement ». Soifd’éternité faisant écho à la répétition sans fin du geste de boire. Cette boisson,il avoue d’ailleurs que, la portant à (ses) lèvres », il ne peut la « croire réelle »( p. 95). C’est en effet le « semblant » dont la présence est indispensable, fautede quoi lui est insupportable la réalité. D’ailleurs, le monde fait semblant d’ai-mer, alors… S’il le dit, on peut le croire, sauf à mettre à jour, derrière cettedésespérance de l’amour, quelque chose de plus précis, qui est la peur de lafemme. C’est là la seconde avancée, après la déploration générale sur l’amouruniversel.
LA FEMME ET L’ALCOOL
Il y a plus précisément l’amour en souffrance d’une femme. Imbibé, remplitelle une borracha ( une outre), l’alcoolique se nourrit de l’attente du retourimprobable de la femme aimée qui a nom Yvonne. Il y a bien là un chagrind’amour, qu’il s’agirait donc de « noyer », selon la formule convenue. Mais ilfaut y regarder de plus près. Voici en effet le retour qui semble se produire contretoute attente et tout espoir.
Or, le retour de l’objet aimé, dans une atmosphère d’illumination halluci-née, n’interrompt pas la route vers l’objet solitairement chéri. Il l’accélère plutôt.Tant qu’il pouvait monologuer son manque de cette femme adorée, elle étaitdésirable. À présent qu’elle est là, en chair et en os, que tout est possible d’unnouveau commencement, il faut bien convenir qu’elle angoisse, plus encore desa présence que de sa vacance. Ainsi se montre que, conformément à ce qui pré-cède, il y a pire que le risque de vivre, soit le risque de désirer. La jalousie enversle frère est là l’alibi à se désister.
LE TEMPS ALCOOLISÉ
C’est ce qui organise cette errance qui remplit ce roman prolixe, en écho àson objet. Ce qui est remarquablement évoqué de la liquidité essentielle du tempsalcoolique, entre dépression et jouissance : « la journée s’étendait devant lui telun merveilleux désert ondulant sans limites où l’on allait, bien que de façonmerveilleuse, se perdre ; se perdre, mais pas si totalement qu’il ne lui fût
38 TOPIQUE
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 38

possible de trouver les quelques rares points d’eau nécessaires, ou les oasis àtequila éparses où des légionnaires de la damnation, loustics qui ne compre-naient rien à ce qu’il disait, de la main, faisaient signe de s’enfoncer, son pleinune fois fait, dans cette glorieuse solitude. Paradis où l’homme n’a jamais soif…»(p. 250). « Il se pourrait même qu’on découvrit au désastre (l’« inévitable désas-tre personnel ») à la fin, certain élément interne de triomphe ».
Triomphe masochiste, certes. Mais tout est dit là de la temporalité sans limi-tes, ondulante, de la perdition, en sa fluidité infinie – un temps qui n’est engagédans la particularité d’aucun désir – trouée d’enclaves de jouissance, en ces« oasis » de satisfaction qui en sont la seule perspective quotidienne, où il s’agitalors de « faire le plein ». Les seuls « panneaux indicateurs », dans cette dérive,sont les « bars » ou cantinas avec ces « pousse-à-boire » sinistres, qui n’ont pasbesoin de parler : en cet univers où la loi du langage est suspendue, tout estréduit à ce « sémaphore ».
LE CHOIX D’OBJET MESCALIEN
Freud a attiré notre attention sur le mariage heureux et sans ambivalence del’alcoolique avec son objet 10. Cela organise son calcul de risques à lui : « Laroute aux pierres branlantes et rompues s’étirait au loin à jamais telle une vied’angoisse. Il pensa : 900 pesos = 100 bouteilles de whisky = 900 dito de tequila.Nergo : l’on ne doit boire ni de la tequila ni du whisky, mais du mescal » (p. 150-151). On voit que notre homme a l’éthique de son objet : ce n’est pasparce qu’il boit sans mesure qu’il boit n’importe quoi. Ou alors, s’il boit ce qu’ila sous la main, il ne perd pas de vue la hiérarchie des jouissances. Certes, encas d’urgence, whisky et tequila feront largement l’affaire. Mais le « mescal »,la boisson locale, constitue l’objet électif. Selon une mise au point des plus claire :« La tequila,… c’est pour la santé…et c’est délicieux, c’est comme la bière ».On voit donc apparaître un « spectre » des plus précis : à une extrémité, on trouvela bière et le vin – cela, c’est « de la petite bière » –, au- dessus, la tequila – unesorte de bière plus épicée, sud- américaine, non loin du whisky – et à l’autreextrémité, le mescal, seule drogue sérieuse et chemin assuré vers le pire : « sije recommence à boire du mescal, alors, oui, j’en ai peur, ce sera la fin » (p. 371). On voit que le déni n’empêche pas la lucidité.
La préface de Lowry traduit un véritable respect de cette boisson mexicaine,dont il se fait en quelque sorte le promoteur : « Soit dit en passant, je m’aper-çois que j’ai fait tort au mescal et à la tequila qui sont des boissons que j’aimebeaucoup, et pour cela je devrais peut-être présenter des excuses au gouverne-ment mexicain ». Sarcasme à moitié sincère : quoique le mescal apparaisse comme
PAUL-LAURENT ASSOUN – AU RISQUE DU TOXIQUELECTURE PSYCHANALYTIQUE D’AU-DESSOUS DU VOLCAN
39
10. S. Freud, Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 39

l’instrument électif du ravage, l’auteur ne voudrait pas nuire à sa réputation. Le« mescal » est innocent, il est pur et puissant, ce n’est pas sa faute si le droguéy accole son impuissance et son impureté…
Il y a une raison en quelque sorte doctrinale à cette prime au mescal : « lemescal est aussi une drogue que l’on prend sous la forme de « boutons de mes-cal » et « la transcendance de ses effets est une des épreuves bien connues desoccultistes ». Lowry, visiblement sympathisant du chemin de croix de son hérosauquel il configure le sien, avance une hypothèse qui en dit long : « Il sembleque le Consul soit arrivé à confondre les deux états, et après tout peut-être n’a-t-il pas tort » ( p. 29).
Ce qu’il suggère ici, c’est que l’amoureux du mescal s’embrouille entre cesdeux fonctions, de « pochetron » et de mystique. Il cherche la « transcendance »au fond de la bouteille. C’est comme une victime probatoire de sa magie. D’uncôté, le mescal est l’alcool à bon marché, une sous-tequila, « que l’on peut obte-nir dans n’importe quelle cantina » – plus facilement, précise l’Américain, quele whisky écossais dans l’impasse des deux-Anges (quel nom !) ; de l’autre, c’estun vecteur de « transcendance ». Que l’ouvrage tout entier s’adonne à des spé-culations simili-cabalistiques procède de cette tentative d’échappée mystique àl’objectalité et à son incarnation féminine.
La bonne intuition est celle de la magie : l’alcool est l’objet qui supprimemagiquement la douleur d’exister – même si cela tourne à la « magie noire ».Reste la conviction chez Lowry, au-delà de tout espoir thérapeutique, que c’estune opération qui eût pu réussir. Le Consul serait ainsi le martyr d’une équipéemystique qui a mal tourné. Selon la belle formule de Lowry qu’il faut garder àl’esprit pour suivre tout le roman : « les agonies de l’ivrogne trouvent une trèsexacte similitude dans les agonies du mystique qui a abusé de ses pouvoirs. Icile Consul a mélangé toute l’affaire d’une façon magnifiquement ivre» (p. 29).
Derrière ces vapeurs mystiques, on entrevoit des formules plus solides quantau repérage de l’impasse subjective : allusion (curieusement, sous l’autorité deWilson, selon l’humour habituel de l’auteur) aux « forces dont l’homme est lesiège, et qui l’amènent à s’épouvanter de lui-même » (p. 30). Nous y sommes.
CHUTE, RECHUTES ET PARACHUTES
L’expérience de l’alcoolique, au-delà de ses éternelles « rechutes », est biencelle de la Chute : « Le sujet en est aussi la chute de l’homme, son remords, sonincessante lutte pour la lumière sous le poids du passé, son destin ». Le lourdsymbolisme de la « chute », à la verticale, des Borrachones – en opposition aux« sobres » qui demeurent « en haut » –, trouve sa légitimation dans ce sentimentde chuter sans cesse à nouveau. Rappelons-nous qu’il se fait fort de ne pas titu-ber : il est au plus haut – parmi les anges – et/ou au plus bas – au ras du sol.
40 TOPIQUE
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 40

Érigé ou allongé, jamais vertigineux. À moins d’appeler vertige ce frôlementde l’Autre qu’il va trouver un jour dans un certain manège. Moment décisif desa fuite en avant que ce moment où, embarqué sur un manège déserté, avec pourseule compagne sa bouteille, il expérimente cette jouissance de tourner en rond,la tête en bas (cette tête dont l’alcool le dépossède) et où il se dessaisit de tousles objets sans lesquels on ne peut vivre dans ce monde : chutent au sol, sansqu’il en ait cure, son argent et, surtout, ses papiers. La grande roue devient sym-bolique de ce « philobatisme » mis en évidence par Balint en contraste de« l’ocnophilie » 11. Perché sur ses hauteurs, au-delà de tout risque, précisément,le voilà devenu l’homme sans nom. Au-delà de l’ivresse même, ce « para-chute »dont il n’a plus que faire.
La question de l’Eden n’est pas loin pour qui fait ainsi le déchet : « L’allégorieest celle du Jardin d’Eden » et de « l’Arbre de vie ». Il y a chez le héros du désas-tre une philosophie de la métamorphose et de la renaissance physique qui contrasteavec son ravage : « Peut-être était-ce … l’âme qui vieillissait, tandis que le corpspouvait se renouveler bien des fois à moins de s’être fait, de l’âge, une routineimmuable » (p. 142). Allusion aux mille vies du « serpent à plumes ».
Il y a une demande de reconnaissance précise du Consul, celle de la com-plication et du défi que constitue « une vie d’ivrogne » : « Ah, une femme nepouvait savoir les périls, les complications, oui, l’importance d’une vie d’ivro-gne ! » (p. 164). Seul est-il habilité à parler de cet « embrouillamini » qu’est savie et dans laquelle il est plus difficile de s’orienter que dans le labyrinthe deMinos. Yvonne en tout cas ne sera pas Ariane.
« BOIRE UN COUP » OU LA NON-RENCONTRE À RÉPÉTITION
Quand, cherchant sa femme au dernier rendez-vous, dans chaque restaurant,il se met à « boire un coup », il donne une parabole de ce ratage de la rencontreavec l’objet proprement dit. La répétition de l’acte, vide et remplissant à la fois,de « boire » répète la non-rencontre de l’objet. Mais c’est aussi parce que lamère manque à l’appel qu’il faut « marquer le coup ».
Quel sens donner au mot « coup » dans l’expression « boire un coup » ? Ontrouve décrite cette lutte à mort entre le désir de la femme et la jouissance del’alcool : « il se souvint qu’elle était perdue ; puis non, ce n’était plus vrai, cesentiment appartenait à hier... Elle n’était en rien perdue, elle était ici tout letemps, ici maintenant… elle est ici ! Réveille-toi, elle est revenue ! Mon amour,ma chérie, je t’aime ! Le désir de la trouver à l’instant, de la ramener à la mai-son… de mettre fin à cette promenade insensée, d’être par dessus tout seul avecelle ». Appétence d’« une vie normale »… Mais voici, au bout de cette exulta-
PAUL-LAURENT ASSOUN – AU RISQUE DU TOXIQUELECTURE PSYCHANALYTIQUE D’AU-DESSOUS DU VOLCAN
41
11. M. Balint, Thrills and Regressions, 1959 tr. fr. Les voies de la régression, Payot, 1972.
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 41

tion, le basculement : « Le désir passa », à la façon du soleil : « tout devint sou-dain d’une manière transcendantale affreux et tragique, distant, transmué, commeune finale impression sur les sens de ce qu’était la terre transportée dans uneobscure région de mort, un tonnerre chargé de douleur, sans remède. Le Consulavait besoin de boire » (p. 369-370).
On ne peut mieux dire que « le besoin de boire » apparaît en réponse com-pulsive et impérieuse à ce sentiment d’entrée, sans transition, une fois « passé »le mirage du désir, dans cette « obscure région de mort », ténèbres en plein midi(comme dans la crucifixion) – forme nocturne du « démon de midi » – 12 oùrésonne seulement, au cœur de la déréliction, le « tonnerre » de la douleur, quin’a pas de remède… hors du pharmacon. Plus précisément : c’est parce qu’iln’y a pas de remède qu’il y a celui-là. L’alcool n’est pas fait pour remédier, iln’arrange rien, il vient seulement comme vade-mecum d’une traversée de cemonde abandonné des dieux, viatique d’une « promenade insensée ».
Bref, c’est l’incidence de la pulsion de mort qui vient saboter les élans del’érotique, révélant la dimension mélancolique de l’affaire : l’alcoolique est cet« homme ruiné », dont les poches se vident de monnaie, qui ne contient plusrien – sauf à transformer cette faillite en exaltation maniaque sporadique, commesur le manège. La « machine infernale » constitue la plus magnifique parabolematérielle de cette pulsion de mort qui le fulgure.
Mais alors, il faut bien reconnaître qu’au fond de l’élan vers une femme, ily a chez l’alcoolique une farouche haine inconsciente de la femme, à laquelleFreud a fait écho en en soulignant régulièrement le ressort homosexuel. Plusprécisément, la femme aimée, sans laquelle la vie n’est qu’un malheur, contientune menace. Son désir vient ravager l’homme. Pourquoi ?
LE PÈRE AVORTÉ
Qu’est-ce qui fait que finalement Geoffrey Firmin échoue dans son rapportà la vie, au désir et à la femme ? Lowry nous en donne les clés, tout en faisantquelque peu diversion par le récit du remords relatif à un acte de sauvagerie deguerre – digne du Lord Jim de Conrad.
Voici la troisième et décisive avancée : on peut le mesurer à son recul faceà la paternité, celui qui se révèle non fortuitement au sortir de ce grand vertigeproduit par la « machine infernale », soit le manège où il vient de vivre cettetranse. Touché brusquement par les enfants autour de lui, lui échappe la penséeque : « Yvonne et lui auraient eu des enfants, auraient dû avoir des enfants,auraient pu avoir des enfants, auraient…» (p. 383).
42 TOPIQUE
12. P.-L. Assoun, Le démon de midi, Éditions de l’Olivier, 2008.
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 42

Cet exercice grammatical joue sur le conditionnel – absolu, puis infléchi parles auxiliaires « devoir » et « pouvoir ». Il ne s’agit pas d’une évocation évasive :Geoffrey rencontre là rien moins que la forclusion de sa paternité, l’impossibi-lité de répondre à la demande d’enfant de la femme aimée. Ce devenir-pères’écrit au subjonctif plus encore qu’au conditionnel : « que ne puis-je être père ! »
On comprend que c’est au moment où il se retrouve comme nu, littérale-ment et symboliquement « sans papiers », que lui vient ce qui, plutôt qu’un regret,est une évidence : ce qui est impossible dans ce lien à cette femme par ailleurspassionnément désirée, c’est cette demande d’enfant à laquelle il est impuis-sant à répondre. Pour la bonne raison qu’il ne peut envisager sans angoissedélabrante de prolonger sa propre existence au-delà de lui-même.
Chaque nouveau verre perpétue en ce sens un secret infanticide. Plus pré-cisément : à chaque verre qui éloigne de la femme, c’est un père qui avorte.
L’AVE MARIA
On ne s’étonnera pas de le voir prier, lui, l’homme sans foi et qui, sinon uneDéesse Mère, la Vierge ? Pour celui qui déclare « il n’y a pas d’explication à mavie », mais qui constate son angoisse – « Bien que ma souffrance semble n’avoiraucun sens je suis toujours dans l’angoisse » (p. 485) –, il ne reste qu’à invo-quer l’Autre, « la Mère des vivants ». La question est « Où est l’amour ? ». Ils’agit bien de localiser l’Amour : « Apprenez moi à aimer de nouveau, à aimerla vie ». Mais la demande n’est pas d’enlever la souffrance – pas de pseudo« résilience »13 pour cette trempe d’homme — mais : « Faites moi vraiment souf-frir ». Cela suppose de faire le déchet, soit le saint : « Je suis tombé bas. Faites-moitomber encore plus bas, que je puisse connaître la vérité ».
Cela revient à un vœu, à la fois Ave Maria rénové et version révisée du « Notre-Père » : « Délivrez moi de cette effrayante tyrannie de moi ». On voit bien latentation de la sainteté chez le mescalito, aspiration à la pureté des « Mystères ».C’est à la fois un enfant non sevré et celui qui cherche dans le retour fantasma-tique au sein maternel l’évasion à la forclusion.
DE LA ROUTE DE LA MORT À L’IMPOSSIBLE BATEAU IVRE
Tout le roman – qui se déploie, note Lowry, sur douze heures – revient à une« promenade » en forme de fuite du personnage principal. Une fois l’Aimée reve-nue, il ne cesse de l’éviter. Quand enfin, il donne un semblant d’assentiment à
PAUL-LAURENT ASSOUN – AU RISQUE DU TOXIQUELECTURE PSYCHANALYTIQUE D’AU-DESSOUS DU VOLCAN
43
13. P.-L. Assoun, « La résilience à l’épreuve de la psychanalyse » ,in Synapse n°198, octo-bre 2003, p.25-28.
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 43

la femme aimée (il ne fait pas semblant, mais c’est un monologue intérieur quine lève pas la forclusion), il n’a de cesse de trouver une échappée. Celle qu’ilatteint dans cette ascension du Volcan, pérégrination dans cette région de déchi-rure géologique, dominée par la barranca. C’est comme l’histoire d’unepromenade qui tourne mal.
Cherchant les lettres de la femme – elle est là en chair et en os, mais il luiparle par ses lettres relues en différé —, il va s’échouer dans la pire cantina,entre prostituées et ruffians, où il se désignera, lui, sans papiers, comme « sus-pect », espion et finira par trouver la mort de la main d’hommes de la pire espèce.Freud a toujours souligné ce caractère homosexué de la jouissance alcoolique– ce moment où les « copains » consolent de la désertion des « bonnes femmes ».Mais ici c’est de ces collègues de taverne qu’il recevra le coup fatal, précisé-ment le jour des morts. Ayant fui la femme impossiblement désirée, il se serajeté dans les bras d’une mort infligée par des hommes. Tel le « chien mort » jetédans la barranca à sa suite. Ultime ironie, en se voyant mourir : « Bon Dieuquelle moche façon de mourir » ( p. 617).
On voit en quoi le radeau de Méduse « piloté » par le héros de Lowry ensei-gne sur la dimension subjective du risque. Son épopée sinistre – sa prolixitémême en indique l’ambition épique – situe l’alcoolisme du côté d’une impos-sible ivresse – celle que donne l’amour d’objet en son soutien fantasmatique.Réinvention du « bateau ivre » par une mystique du naufrage.
Paul-Laurent ASSOUN20, rue de la Terrasse
75017 Paris
Paul-Laurent Assoun – Au risque du toxique. Lecture psychanalytique d’Au-dessous duvolcan
Résumé : Il s’agit de déterminer ce « risque » veut dire dans l’expérience incons-ciente : l’examen de la position freudienne sur le lien du désir à la mort permet d’en déga-ger l’enjeu. « Exclure la mort des comptes de la vie » apparaît contradictoire avec le désirmême, mais c’est précisément ce que ne cesse d’expérimenter l’analyse, inscrivant lesymptôme dans l’entre-deux d’un déni de la mort et d’une insistance du désir. Au-delà del’éloge imaginaire du risque, qui configure certaines formes de malaise dans la civilisa-tion, il s’agit pour la psychanalyse de confronter le sujet au risque de désirer, par confron-tation à la vérité du symptôme. Là intervient l’examen de le position du sujet face au« risque toxique », modalité de gestion du clivage indiqué. La lecture d’ « Au-dessous duvolcan » de Malcolm Lowry permet de situer le recul face au désir et à la femme, où lesujet, refusant l’être-père, remet à zéro les comptes du symbolique et voit s’ouvrir, via lemescal, un voyage dans une temporalité erratique qui le mènera à la mort. La question du
44 TOPIQUE
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 44

risque inconscient trouve son illustration dans ce voyage volcanique, « échappée belle » etmorbide où le sujet se met en danger et en jeu.
Mots-clés : Vie – Mort – Risque – Désir – Toxique – Temps – Répétition.
Paul-Laurent Assoun – Chancing with Death. A Psychoanalytical Reading of Under theVolcano
Summary : This article attempts to determine the meaning of the word ‘risk’ inunconscious experience – analysis of Freud’s position on the bond linking desire to deathis essential here. The notion of ‘excluding death from the balance sheet of life’ at firstseems contradictory with that of desire, but does in fact lie at the heart of analytical expe-rience, as the symptom is written into the gap between denial of death and the insistenceof desire. Over and above the imaginary tribute paid to risk-taking, at the basis of certainforms of discontent in our civilization, it is psychoanalysis’ role to confront the subjectwith the risk of desire itself, by confronting the analysand with the truth of his or hersymptom. This leads the subject to examine the notion of ‘deadly risks,’ as a means ofmanaging this split. Malcolm Lowry’s Under the Volcano is an eloquent evocation of thesubject’s retreat before desire and woman, refusing to become a father, reducing the sym-bolic level to nothing, and embarking, with the aid of mezcal, on an erratic journeythrough time whose ultimate destination is death. The question of unconscious risk-takingfinds its full expression in this volcanic voyage, this ‘great escape’ redolent with death, inwhich the subject puts himself in infinite danger, gambling with his own life.
Key-words : Life – Death – Risk – Desire – Toxic – Time – Repetition.
PAUL-LAURENT ASSOUN – AU RISQUE DU TOXIQUELECTURE PSYCHANALYTIQUE D’AU-DESSOUS DU VOLCAN
45
top 107 bat int 8/07/09 9:42 Page 45