LE FANTASME METROPOLITAIN...Marie, la Place Bonaventure, les stations de métro et l'ancien pavillon...
Transcript of LE FANTASME METROPOLITAIN...Marie, la Place Bonaventure, les stations de métro et l'ancien pavillon...

Extrait de la publication

L E F A N T A S M E M E T R O P O L I T A I NL ' A R C H I T E C T U R E D E R O S S E T M A C D O N A L D
Extrait de la publication

DANS LA MÊME COLLECTION
Béatrice Sokoloff, Barcelone ou Comment refaire une ville.
Extrait de la publication

JACQUES LACHAPELLE
L E F A N T A S M E M E T R O P O L I T A I NL ' A R C H I T E C T U R E D E R O S S E T M A C D O N A L D
B U R E A U X , M A G A S I N S E T H O T E L S
1905-1942
LES PRESSES DE L ' U N I V E R S I T É DE M O N T R É A L
Extrait de la publication

Couverture :
À droite : Banque Royale, Toronto, 1913-1915.Extérieur. Photographie tirée de Construction,juillet 1915
À gauche : édifice Price, Québec, 1928-1930.
Perspective reproduite de JRAIC, juin 1930, p. 213.
Conception graphique : Gianni Caccia
Mise en pages : Folio infographie
Données de catalogage avant publication (Canada)
Lachapelle, Jacques, 1959-
Le fantasme métropolitain : l'architecture de Ross
et Macdonald : bureaux, magasins et hôtels de Ross
et Macdonald 1905-1942
Comprend des réf. bibliogr.
ISBN 2-7606-1754-8
1. Immeubles commerciaux - Canada - Histoire - 2oe siècle.
2. Architecture - 20' siècle - Canada.
3. Ross, George Allen, 1878-1945.
4. Macdonald, Robert Henry, 1875-1942. I. Titre.
6̂214.03132 2000 725'.2'097109041 coo-94Ooi5-x
Dépôt légal : 3° trimestre 2001
Bibliothèque nationale du Québec
© Les Presses de l'Université de Montréal, 2001
Cet ouvrage a été publié grâce à une subvention de la Fédération
canadienne des sciences humaines et sociales, dont les fonds
proviennent du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada.
Les Presses de l'Université de Montréal remercient le ministère
du Patrimoine canadien du soutien qui leur est accordé dans le
cadre du Progamme d'aide au développement de l'industrie de
l'édition.
Les Presses de l'Université de Montréal remercient également le
Conseil des Arts du Canada et la Société de développement des
entreprises culturelles du Québec (SODEC).
Imprimé au Canada
Extrait de la publication

Remerciements
Je dois à madame Béatrice Sokoloff, professeure titulaire à l'Institut d'urbanisme de
l'Université de Montréal, l'initiative de ce projet de livre et ses encouragements à le
mener à bien. Le manuscrit repose sur les recherches qui ont servi à trois chapitres
d'une thèse de doctorat présentée à l'Université Laval en 1994 et dans laquelle j'ai dû
replonger. Ces études avaient bénéficié d'une bourse du Conseil de recherches en
sciences humaines. Elles ont été menées sous la direction de Claude Bergeron que je
remercie à nouveau. Quant à la présente publication, elle bénéficie d'une bourse du
Programme d'aide à l'édition savante de la Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales.
Les recherches ont nécessité la consultation de plusieurs fonds d'archives parmi
lesquels je dois souligner le Centre Canadien d'Architecture qui m'a donné accès au
fonds Ross et Macdonald afin de procéder à son dépouillement. L'importance de
cette institution dans l'avancement de la connaissance sur l'architecture canadienne
est inestimable. Son personnel affable mérite d'être remercié, en particulier monsieur
David Rosé qui a indexé le fonds Ross et Macdonald et qui a eu la générosité de me
fournir de précieuses informations alors qu'il faisait lui-même un mémoire de maîtrise
sur les hôtels de ces architectes. Le personnel des Archives publiques de l'Ontario
où est conservé le fonds de la compagnie Eaton a lui aussi fait montre d'une aimable
attention. Quelques mois avant que la compagnie Eaton ne soit démantelée par une
faillite, la direction du magasin du centre-ville de Montréal m'a autorisé à photogra-
phier son restaurant du 9e, comme on l'appelait familièrement. Les événements qui
ont suivi donnent une saveur particulière à ce privilège. Devant le danger d'une
éventuelle démolition, il est heureux que le ministère de la Culture et des Commu-
nications du Québec ait procédé au classement de ce lieu comme monument histo-
rique. Pour les visites de leurs édifices et pour les photographies qui ont été gracieu-
sement offertes, je suis également redevable aux hôtels Macdonald à Edmonton et
Royal York à Toronto, qui font partie tous deux du réseau du Canadien Pacifique, et
aux hôtels Fort Garry à Winnipeg et Saskatchewan à Regina.
Enfin, une recherche comme celle-ci a beau se faire dans une relative solitude,
l'aide et l'encouragement des parents et amis font toute la différence. Je les remercie
tous, sachant qu'ils sauront se reconnaître mais je m'en voudrais de ne pas nommer
Marthe Aikman, Manon Guité et René Tirol, trois personnes dont le soutien
indéfectible m'a été des plus précieux.
Extrait de la publication

Page laissée blanche
Extrait de la publication

Sigles
AAPQ Association des architectes de la province de Québec
ACP Archives du Canadien Pacifique
AF The Architectural Forum
ANC Archives nationales du Canada
ANQ Archives nationales du Québec
ANQM Archives nationales du Québec à Montréal
APO Archives publiques de l'Ontario
AR The Architectural Record
CCA Centre Canadien d'Architecture
ΠThe Canadian Engineer
CN Canadien National
CP Canadien Pacifique («Canadian Pacific Railway»)
CR The Contract Record
CRER The Contract Record and Engineering Review
CRMW Canadian Railway and Marine Word
GTR Grand Trunk Railways
GTP Grand Tronc Pacifique (Grand Trunk Pacific Railways)
IRAC Institut royal d'architecture du Canada
JRAIC Journal of thé Royal Architectural Institute of Canada
MBAM Musée des beaux-arts de Montréal
MIT Massachusetts Institute of Technology
A/I5W Marine and Shipping World
OAQ Ordre des architectes du Québec
RIBA Royal Institute of British Architects
RMW The Railway and Marine World
SÉAC Société pour l'étude de l'architecture au Canada

Extrait de la publication

Introduction
Au Québec comme ailleurs, l'histoire de la modernité en art et en architecture asouvent obéi à une vision manichéenne qui oppose l'inertie des conventions à uneliberté créatrice qui doit refléter le temps présent. D'apparence quasi mythique, cettelutte contre une tyrannie du passé comporte une part de vérité et une part demasque. La vérité, c'est qu'il est indéniable qu'après la Deuxième Guerre mondiale,le désir d'être et de paraître moderne, autrement dit le modernisme, a été fécond eta suscité des œuvres extraordinaires. A Montréal, des lieux comme la Place Ville-Marie, la Place Bonaventure, les stations de métro et l'ancien pavillon des États-Unis(l'actuelle Biosphère), pour n'en nommer que quelques-uns, ont chamboulé les idéesreçues et sont devenus des icônes de la modernité. Le masque, c'est que la rupture,par définition, exclut. En effet, le discours moderniste, avec son désir de faire neuf,tend à s'approprier en entier le concept de modernité. Ainsi, on a laissé dans l'ombrel'inventivité des architectes victoriens du xixe siècle et, ce qui concerne de plus prèsla présente étude, le professionnalisme des architectes des premières décennies duxxe. Les uns et les autres avaient beau s'inspirer des styles du passé, cela ne lesempêchait pas d'éprouver, eux aussi, le sentiment d'être moderne, c'est-à-dire desuivre, et peut-être à l'occasion de subir, les progrès de la société industrielle. Poureux, la modernisation signifiait l'urbanisation, le relativisme des styles, l'apparition debesoins spécifiques à l'essor d'une économie capitaliste, les contraintes et lesopportunités des nouvelles technologies en construction, etc. Ces changementsprenaient leur plein essor dans les métropoles de telle sorte que celles-ci ont fini parconstituer le rêve pour ne pas dire un fantasme, auquel les grandes villes devaientaspirer. C'est à ce modernisme naissant et vacillant que cette étude sur les grandsimmeubles convie. Elle rejoint à plusieurs égards un courant historiographique quitend désormais à relever des traces de modernité dans des faits de culture qui ne seréclamaient pas d'une esthétique radicalement nouvelle1.
Au cours des quatre premières décennies du xxe siècle, le gigantisme architectural,dont le gratte-ciel fait partie, est au cœur de la transformation des grandes villesindustrielles. On sait que, du point de vue de la technologie, le gratte-ciel, apparu à lafin du xixe siècle aux États-Unis, est la résultante de deux innovations complémen-taires: l'ascenseur et la charpente métallique. La première permet de dépasser lacontrainte naturelle de l'ascension à pied, généralement fixée à un maximum de six
Perspective reproduite de JRAIC, juillet 1950.11Ross et Macdonald. Architects' Building, Montréal, 1929-1954. Démoli. lINTRODUCTION

étages2. La seconde abolit le problème du poids et de la massivité des structures en
maçonnerie. À cet égard, le fait que les murs extérieurs ne soient plus porteurs, mais
portés par la structure d'acier de telle sorte qu'ils ne conservent qu'une fonction de
parement ou d'écran a constitué un tournant décisif. Ces murs-rideaux peuvent être
minces et légers et, comme on s'en étonnait encore dans les années 1920, érigés à
partir de n'importe quel étage et non plus nécessairement à partir du sol3.
Indépendamment des considérations techniques, le gratte-ciel est le fruit de la
spéculation qui a suivi l'urbanisation rapide des villes industrielles: le sol et
l'architecture sont désormais vus comme sources de profit. Dans ce contexte, le
gratte-ciel a constitué, en termes d'espace, d'infrastructure et d'image, une réponse
aux attentes des promoteurs immobiliers dans le secteur tertiaire. Si Chicago et
New York ont particulièrement contribué à son évolution, l'édifice en hauteur s'est
répandu à un point tel qu'il a transformé la physionomie du quartier central de la
plupart des villes nord-américaines.
Cette architecture s'inscrivait parfaitement dans les audacieuses explorations du
victorien tardif. Mais après une période d'enthousiasme et de fascination, la course
à la hauteur a été freinée, et les mots gratte-ciel ou tour, qui suggèrent des volumes
élancés, ne s'appliquent qu'à quelques cas. Il vaut mieux alors parler de gigantisme
ou de grands immeubles. C'est qu'au tournant du xxe siècle, un vent de réforme
politique et idéologique a soufflé sur l'Amérique et entraîné dans son sillage la
question urbaine. En architecture, un discours sur le beau, fondé sur les préceptes
de l'Ecole des beaux-arts de Paris, a remplacé le modèle victorien. Un grand nombre
d'architectes ont suivi ce mouvement de retour à l'académisme, c'est-à-dire à la
discipline, aux règles et à la normalisation des compositions. On cherchait ainsi à
mettre fin à l'éclectisme parfois farfelu du victorien tardif, mais du même coup, on
écartait des pistes innovatrices en émergence, comme l'Art nouveau et l'école de
Chicago, en particulier l'œuvre de Louis H. Sullivan. C'est ce qui explique que ce
courant académique ait longtemps été perçu par les historiens comme un conser-
vatisme mal venu. Encore aujourd'hui, ceux pour qui l'évolution de l'architecture est
le combat du modernisme contre toute forme d'inertie sont désarmés par la répé-
tition des solutions de design qui caractérisent la période. La production du début du
xxe siècle ne peut les amener qu'à conclure au vide créatif et surtout à une inadé-
quation dans l'expression d'une quelconque modernité. La révision critique récente,
généralement moins attachée au seul modernisme, est plus nuancée. Mais on retient
surtout les édifices institutionnels traités de manière monumentale, et auxquels on
reconnaît aisément une qualité de planification et d'exécution digne du
professionnalisme dont les architectes se réclamaient.
Pour ce qui est de l'architecture du secteur tertiaire qui nous intéresse ici, elle n'a
pas échappé à cette discipline de la règle et de l'imitation. Sans ignorer les besoins
nouveaux que les grands immeubles d'affaires satisfont et leur importance dans
l'environnement urbain, les architectes les considéraient souvent comme une quantité
négligeable du point de vue artistique, comme un pis-aller, car à leurs yeux, seule la
commande publique était suffisamment prestigieuse pour permettre la pleine expres-
sion de leur art. Une fois l'enthousiasme de la nouveauté passé, c'est en regard de
cette contradiction fondamentale entre la soi-disant intemporalité des règles acadé-
LE FANTASME METROPOLITAIN12
Extrait de la publication

miques et la rapidité des bouleversements de la société industrielle que les immeubles
d'affaires seront réalisés au début de ce siècle. Dans ce contexte, ils ne méritent pas
tous les reproches qu'on leur a faits. Pour le démontrer, nous analyserons
l'ensemble de la question, de sa dimension urbanistique jusqu'à la planification
intérieure. Outre un premier chapitre qui donne des indications sur cette perception
de la ville en ce début de siècle et sur le débat concernant la conquête de la
hauteur, trois types architecturaux seront abordés : les édifices à bureaux, qui sont
les plus répandus mais aussi les plus typés; les grands magasins, qui permettent de
renouveler le commerce ; et les hôtels, qui sont les plus complexes des grands
édifices. Cependant, pour éviter de nous éparpiller dans des critères de classification
toujours discutables, nous allons privilégier l'étude de cas, plutôt que l'inventaire et
le répertoire. Nous pourrons ainsi nous concentrer tant sur l'extérieur, que sur
l'intérieur des édifices. Pour cela, nous avons retenu les œuvres de l'agence Ross et
Macdonald, qui fut active de 1913 à 1944, ainsi que celles de Ross et MacFarlane, qui
l'a précédé de 1905 à 1912.
Compte tenu des objectifs de cette étude, deux de ces architectes, Ross et
MacFarlane, ont le mérite d'avoir une formation académique typique de leur
génération et les trois se sont spécialisés dans les immeubles d'affaires. Pour ce qui
est de la formation, avec la valorisation de l'académisme au tournant du siècle, le
curriculum idéal d'un architecte canadien ne pouvait plus contenir, comme autrefois,
qu'un simple apprentissage auprès d'un praticien. Il devait inclure des études univer-
sitaires, de préférence aux États-Unis. Un voyage en Europe était vu comme un
complément utile qui permettait de se familiariser avec les vénérables modèles du
passé, tandis que l'École des beaux-arts était devenue un lieu de pèlerinage pour la
jeune génération américaine. C'est exactement le parcours qu'a suivi George Allen
Ross (1878-1946). En 1902, il a complété un programme d'études de deux ans au lieu
de quatre au MIT à Cambridge. Il y a suivi les cours de l'architecte français Constant
Désiré Despradelle qui s'inspirait de ses propres études à la célèbre école pari-
sienne4. Ross a par la suite fait un stage chez Parker et Thomas à Boston, puis un
autre chez les renommés Carrère et Hastings à New York, ce qui lui a permis de se
familiariser avec la pratique dans de grandes agences. Lors d'un voyage en France et
en Italie, il s'est arrêté à l'atelier Redon, rattaché à l'École des beaux-arts5. David H.
MacFarlane (1875-1950) a fait de même, mais plus modestement: brèves études au
MIT, stages dans des agences montréalaises (Maxwell et Maxwell, Hutchison et
Wood), puis court séjour en Europe. Pour ce qui est de Robert Henry Macdonald
(1875-1942), son parcours s'avère différent. Australien d'origine, il a occupé des
emplois au Canada et aux États-Unis, entre autres chez George B. Post et fils à
New York. Il s'est familiarisé avec la production américaine avant de travailler chez
Ross et MacFarlane dès 1907. C'est par suite de la rupture de cette dernière agence
que Ross s'est associé à Macdonald en 1913.
Ross et Macdonald ont formé ce qui allait devenir l'une des plus grandes agences
au Canada, peut-être même la plus grande vers la fin des années 192O6. La pratique
à grande échelle suit un modèle américain intimement lié à l'industrialisation de la
société. Dès le xixe siècle, au lieu de travailler seuls au service de la bourgeoisie et
des institutions, certains architectes ont aligné leur pratique sur celle des hommes
INTRODUCTION 13

Ross et Mocdono/d. Architects' Building, Montréal, 1929-1954.Plans des bureaux de /'agence Ross et Macdonald aux
douzième, treizième et quatorzième étages.
Reproduits deJRAlC, septembre 1951.
d'affaires. Ils se regroupent et forment
des sociétés. Les associés se partagent le
profit tandis que leurs employés, souvent
nombreux, obéissent à une taylorisation
du travail. La productivité de l'atelier de
conception et l'efficacité du design
constituent deux de leurs principaux
objectifs. Il s'agit d'offrir le meilleur service
professionnel au client en profitant d'une
équipe solide qui peut élaborer
rapidement une architecture de qualité.
Ross et Macdonald ont clairement adopté
cette approche. Les plans de leurs .
bureaux dans l'Architects' Building
témoignent de leur succès et de
l'organisation serrée du travail. Il y avait
même une section d'ingénierie. Les
patrons sont isolés, laissant croire que
leur rôle est avant tout administratif, ce
que confirment les articles de
Macdonald7. Il est important de souligner
cet aspect, car il appuie le caractère
accessoire que prennent les architectes
dans cette étude. Il n'est pas question en
effet de pousser la connaissance sur les
individus pour tenter d'identifier une
quelconque psyché dans un travail
artistique. Ce serait dérisoire dans une
pratique où le design se fait en équipe et
où la participation de-s patrons
architectes est incertaine. Pour Ross et
Macdonald, l'objectif principal qui consiste
à satisfaire leur clientèle va à rencontre
d'une vision de l'architecture comme art
d'expression, mais attention, cela ne
signifie pas que leur œuvre soit anonyme.
De fait, George A. Ross a poussé très
loin ce rôle de l'architecte homme
d'affaires, au point de faire parfois partie
de syndicats de promoteurs pour des
immeubles au centre-ville de Montréal,
devenant ainsi son propre client. Il avait
alos une certaine latitude dans le design.
Comme le nom l'indique, l'Architects'
Building comptait parmi ces édifices.
H LE FANTASME METROPOLITAIN
Extrait de la publication

Il existe peu d'architectes qui, comme Ross et ses associés, se soient spécialisésavec autant de succès dans la commande commerciale au cours de cette période.Mais ils sont d'autant plus intéressants pour les fins de cette étude que leurproduction comprend un nombre élevé de grands immeubles, pour ne pas dired'immeubles de plus en plus grands. Ainsi, l'édifice Transportation (1909-1912), deCarrère et Hastings en association avec Ross et MacFarlane, détenait en 1909 lerecord du plus grand édifice de l'Empire britannique8. Puis, en 1913, le Read (1912-1913) devenait «le plus grand édifice d'affaires au Canada9». Un an plus tard, la gareUnion à Toronto (1914-1921) était comparée aux plus grandes gares des États-Unis10.L'année suivante, l'édifice de la Banque Royale à Toronto (1913-1915) dépassait enhauteur toutes les autres constructions de l'Empire britannique". En 1924, l'hôtelMount Royal à Montréal était déclaré le plus grand hôtel de l'Empire, mais cinq ansaprès, il était surpassé par le Royal York à Toronto12. Et en 1928, le Dominion SquareBuilding remportait le titre de plus grand édifice commercial du Canada13. Ce goût ducolossal peut paraître futile, et pourtant, même s'ils ne rivalisent pas avec les exem-ples états-uniens, ces records attestent des profondes mutations du paysage urbainen ce début de siècle. À cet égard, l'agence Ross et Macdonald fait figure de chef defile et acquiert une notoriété nationale. Sa production, fidèle au goût académique etau professionnalisme qui distinguent cette période, constitue un groupe témoinprivilégié pour l'étude du phénomène singulier des grands immeubles au Canada.
Dans la mesure où l'architecture résulte d'un entrecroisement de forces idéolo-giques diverses et parfois contradictoires, le contexte du début du siècle fournitdifférents axes de questionnement qui orientent notre recherche. Le premierconcerne les rapports entre le grand immeuble et la ville. Pour les architectes et pourla population, la ville est un lieu conflictuel : on éprouve à la fois un attrait et uneaversion face à la concentration et à la rapidité des changements qui ont lieu aucentre-ville. La question de la hauteur suscite crainte et fascination. Les réactionssont fortes. La concentration de grands immeubles pose même un problème socialquant aux activités, voire même aux personnes qui y ont droit de cité. La premièrepartie de cet ouvrage touchera cette redéfinition du quartier central qu'entraînél'arrivée des grands immeubles.
Le second axe de questionnement est l'impact des idéaux d'efficacité économiqueet de pragmatisme du milieu des affaires dans la planification des grands immeubles.Si l'historiographie a surtout fait ressortir les aspects stylistiques de l'académisme desBeaux-Arts et de l'Art déco, Ross et Macdonald ont dû tenir compte des logiques deprofit et de rentabilité. À travers leur œuvre, nous verrons que non seulement legrand immeuble participe à une transformation de la morphologie urbaine, mais qu'ilchange le sens du rapport entre les intérieurs et l'environnement extérieur. En fait, letexte qui suit tentera de démontrer que la problématique des grands immeubles estliée aux aspirations de la société industrielle canadienne du début du xxe siècle.Malgré l'apparent conservatisme qu'on peut leur reprocher après coup, les grandsimmeubles de cette période ont contribué à la modernisation de l'architecture.
Extrait de la publication


1 LES ENJEUX METROPOLITAINS
Transformer la ville
À partir du xixe siècle, la mesure de lavitalité économique des grandes villesnord-américaines fait souvent référenceà deux figures emblématiques, l'uneexogène et l'autre endogène, soit lamétropole et le quartier central. Lapremière figure consiste à présentercertaines villes comme des pôlesd'attraction et de rayonnement pour lesactivités qui ont une échelle régionale,nationale ou même internationale. Dèslors, un certain fantasme métropolitain— qui sert fort bien le milieu desaffaires et en particulier les institutionsqui ont une emprise sur un vaste ter-ritoire — se met en place. On se targuedes symboles du dynamisme de la ville,de son progrès et de sa prospérité. Laqualité de l'environnement urbain et
J'architecture n'échappent pas à cetoptimisme collectif qui porte les gran-des villes à se faire concurrence. Lesprojets ambitieux et coûteux ont sou-vent été considérés comme des signes
du caractère métropolitain d'une ville.Le grand immeuble, ne serait-ce que parsa taille, compte parmi ces signes.
La seconde figure est le centre-ville.Avec l'étalement des villes au xixe siècle,certains commerces, pour assurer leur
croissance, veulent dépasser l'échelle duquartier pour atteindre la ville entière etsa région. Ils ont alors avantage à serapprocher les uns des autres, la con-centration assurant une masse critiqueaccrue : les travailleurs sont des con-sommateurs potentiels et les clientsd'un marchand peuvent devenir ceuxde l'autre, et vice-versa. La proximitéfacilite aussi les échanges de servicesentre les activités du secteur tertiaire.Le partage des infrastructures devientun avantage. En même temps, lesindustries polluantes sont — autant quepossible — rejetées dans des quartierspériphériques afin de préserver l'attraitde cette zone centrale. Seules les petitesmanufactures sont tolérées.L'amélioration des moyens de circulation— le transport public ou la voiture —favorise d'autant cette concentrationque la ville s'étale tout autour. L'accèsau quartier central doit donc être facilitéde sorte qu'une fois sur place, lesconsommateurs puissent réaliserplusieurs transactions en peu
de temps. Avec l'avènement du train,la gare, plutôt que le port, déterminel'emplacement de ce secteur central. Letrain assure le lien entre le quartier desaffaires et les régions, entre la centra-nte du secteur et le rayonnement
Ross et Macdonald. Édifice Confédération, avenue McGII Collège,
au coin de la rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, 1927-1928. Photographie :J.L, iççç.
LES ENJEUX MÉTROPOLITAINS V
Extrait de la publication

Daniel H. Bumham et Edward H.
Bennett, partenaires de 1903 o
1912. Vue vers /'ouest du projet de
Place du centre civique, planche
132 du Plan de Chicago, 1909,
dessinée par Jules Guér/n (Amé-
ricain, 1866-1946), crayon et
aquarelle sur papier, 1908,
75,5 x 105,5 cm. Prêt permanent
à l'Art Institute of Chicago de la
Ville de Chicago, 28.148.1966.
Photographie ©1998, The Art
Institute of Chicago. Tous droits
réservés.
métropolitain. Il y a une logiqued'ensemble.
Ces figures reflètent l'idéologie pro-gressiste dominante à l'ère victorienne.Mais au xxe siècle, même si l'économieconnaît une forte croissance et quel'urbanisation reste intense, on souhaiteaméliorer ce modèle urbain. Les cou-rants réformistes sont responsables deces changements. Ils remettent enquestion plusieurs préceptes aména-gistes du siècle précédent, dont ceuxde la hauteur et de la densification ducentre-ville. On critique l'idéologiedominante qui a amené les hommespolitiques à centrer leurs programmessur la notion de progrès pour confor-mer l'administration publique auxbesoins et demandes des spéculateurset des industriels, ce qui se fait souventau détriment du bien-être général, oudu moins au détriment des ouvriers'.Les réformistes visent au contrairel'assainissement des mœurs politiques
et l'intervention de l'État pour améliorerles conditions de vie des citoyens. Ilsveulent que chacun puisse profiter untant soit peu de la prospérité. Suivantdes principes de justice sociale, ils pré-sentent le progrès comme une amélio-ration du bien-être collectif, incluant lasanté, l'éducation et la culture, et nonplus comme un simple bilan écono-mique. Autrement dit, il s'agissait defaire bénéficier les masses, et non plusles seuls individus, de l'enrichissementgénéral.
Au début du siècle, l'espace urbain aété vu comme un des moyens d'amélio-rer les conditions de la collectivité. Il asuscité un débat original auquel ontcontribué entre autres des médecinspréoccupés d'hygiène, des citoyens etcitoyennes soucieux de sécurité, et desarchitectes et des artistes convaincusdes bienfaits de l'art. Parmi les courantsde pensée qui ont émergé, on retrouvele City Beautiful Movement qui a été très
18 LE FANTASME METROPOLITAIN

influent en Amérique du Nord, où il amarqué la reconnaissance de la profes-sion d'urbaniste. Il est le pendant, àl'échelle urbaine, d'une architectureinspirée de l'Ecole des beaux-arts deParis. Il évoque en effet l'urbanisme dubaron Haussmann (1809-1891) etconfirme l'intérêt des Américains pourla grande tradition classique française.Sa naissance est étroitement associée àl'élaboration du plan pour l'Expositioncolombienne de Chicago en 1893, parDaniel H. Burnham (1846-1912) etFrederick Law Olmsted (1822-1903).Ceux-ci avaient entre autres prévu dedégager une grande esplanade avec unbassin central devant la gare qui déter-minait l'axe principal de la composition.Pour les pavillons d'exposition, Burnhamavait fait venir quelques-uns des archi-tectes de formation Beaux-Arts les plusrenommés des États-Unis. Chacundevait se soumettre aux prescriptionsgénérales dont la limite de la hauteur.L'ensemble présentait un effet monu-mental saisissant. Le City Beautiful futpar la suite mis de l'avant dans de nom-breux projets urbains dont ceux deWashington (1902), Cleveland (1903),San Francisco (1904) et Chicago (1908),tous sous l'autorité de Daniel Burnham,protagoniste principal de cet urbanismemagistral de l'ordre et de la beauté.
Le City Beautiful s'inscrit parfaitementdans l'esprit de réforme de cettepériode, puisque comme l'indique lerapport pour le réaménagement deChicago, il s'agit d'un programmeidéologique à la fois égalitariste eteugénique :
L'ordre est un des meilleurs investisse-
ments qu'une ville puisse faire, mais
l'attrait du plan de Chicago n'est pas un
attrait commercial. C'est un attrait
humain, un attrait moral, un attrait pour
améliorer Chicago, pas pour l'argent qui
s'y trouve, mais pour les bienfaits men-
taux, moraux et physiques qu'un plan bien
ordonné peut apporter à la population.
Le plan de Chicago n'est pas une panacée
pour tous les maux civiques de notre ville.
Son but vise simplement le développe-
ment physique de Chicago pour le bien
non pas d'une seule classe de la popu-
lation ou d'un secteur de la ville mais pour
le bien de tous les citoyens de Chicago,
pour le bien de tout Chicago2.
Conçu avant tout par des architecteset des architectes paysagistes de for-mation, les plans du City Beautifulmettent l'accent sur l'esthétique et lesespaces verts. Au mieux, dans ce derniercas, on espérait que les parcs aident àprévenir le crime, la malpropreté et lesmaladies3. L'importance accordée à lanature rattache ce mouvement auromantisme du xixe siècle en amont, etaux Congrès internationaux d'architec-ture moderne (CIAM) en aval. L'esthé-tique, quant à elle, avait pour objet« d'améliorer la santé et le sens moraldes gens et de stimuler la fierté locale etpatriotique4». Cette cure de beautéurbaine nécessitait un plan d'ensemblefondé sur des principes d'ordre, dehiérarchie et de cohérence. Le CityBeautiful a de ce fait condamné lemodèle de la trame en damier héritéedu xixe siècle. Ce système, jugé plusmécanique que rationnel, était considérécomme le propre d'architectes arpen-teurs mal formés. Il n'aurait satisfait queles besoins de spéculateurs plus soucieuxde rentabilité que de qualité. Il est vrai
que la régularité de la trame facilitait lescomparaisons d'échelle et de superficieet transformait les mises en marché en
de simples calculs de prix au pied carré.
LES ENJEUX METROPOLITAINS 19
Extrait de la publication

Mais, pour ses détracteurs, un plan
uniforme empêchait de mettre en valeur
les édifices publics ; il était insensible aux
particularismes. Pour compenser, l'archi-
tecte victorien favorisait la disparité des
édifices contigus en les individualisant par
des effets spectaculaires, souvent
clinquants. De l'ordre apparent du plan
naissait un paysage architectural éclec-
tique dont les gratte-ciel n'auraient fait
qu'amplifier les travers. Pour les uns,
ils étaient des monstruosités hors
d'échelle; pour d'autres, ils enlaidissaient
la silhouette des villes. Le City Beoutiful
Movement présentait la ville comme un
organisme nucléé, structuré et intégré,
plutôt que conçu comme une trame
régulière et continue. Toutes les parties
étaient interdépendantes et reliées entre
elles par le réseau d'avenues, de parcs et
de places5.
En plus de l'esthétique, le plan d'ur-
banisme devait résoudre la question du
transport, qu'il soit automobile, ferro-
viaire ou maritime6. On pensait en effet
qu'avec le développement du centre-
ville, les rues tracées au xixe siècle
étaient devenues trop étroites pour la
circulation du xxe siècle. Presque toutes
de largeur équivalente, elles n'offraient
aucune souplesse. Une rue résidentielle
et une rue commerciale n'étaient pas
différenciées, bien que le poids du trafic
y diffère énormément. La vitesse, la
mobilité, l'efficacité des métropoles se
voyaient contrariées. Le nombre accru
de véhicules motorisés ne faisait
qu'aggraver le problème. De plus, aux
heures de pointe, les piétons qui four-
millaient sur les trottoirs trop étroits
formaient une masse mouvante mais à
ce point compacte qu'il devenait difficile
de s'engager à contresens7.
Le gratte-ciel était lui aussi accusé de
causer la congestion du trafic et la sur-
densification. Cette critique est maintes
fois rapportée dans des articles au tour-
nant du siècle. La seconde conférence
américaine sur l'urbanisme, en 1910, fut
même consacrée à cette question8. Mais
par un raisonnement de cause à effet
qui fonctionne dans les deux sens,
l'inefficacité des réseaux de rues était
elle-même dénoncée, parce que en
partie responsable du phénomène des
grands immeubles9. C'est parce que l'on
ne pouvait pas circuler facilement dans
la ville qu'il fallait concentrer les bureaux
et les commerces. Suivant cette der-
nière logique, la verticalité des bâtiments
compensait l'inadéquation du système
des transports. Aussi croyait-on qu'en
améliorant ce dernier, le centre-ville
pourrait enfin s'étaler davantage au lieu
de pousser en hauteur10.
Pour casser la répétition d'une trame
urbaine en damier et pour accélérer la
circulation à travers la ville, le City
Beautiful favorisait les voies obliques qui
sont devenues par la suite de véritables
figures fétiches du mouvement. Comme
le veut la maxime «Time is money»,
elles devaient servir à diminuer les
pertes de temps, à réduire la fatigue des
travailleurs, et ainsi accroître leur pro-
ductivité. On espérait sauver annuelle-
ment d'énormes sommes d'argent, du
moins dans une perspective macro-
économique de la ville". Du point
de vue de l'espace cependant, ces
boulevards confortaient l'héritage
victorien car ils servaient le rayonne-
ment symbolique et réel du centre-ville
et, par le fait même, ils consacraient le
quartier central comme lieu de travail.
On croyait qu'il était préférable d'habi-
ter loin de l'agitation du centre, dans
une banlieue verte et tranquille où les
valeurs familiales pouvaient le mieux
s'exprimer. La réflexion n'allait pas plus
LE FANTASME METROPOLITAIN20
Extrait de la publication

loin. Le problème inhérent à la dicho-
tomie entre un centre-ville comme lieu
de travail et une banlieue éloignée qui
deviendrait, selon l'expression usuelle,
une ville-dortoir n'a à peu près pas été
soulevé. La solution fut constamment
réduite à une dimension technique. Le
tramway, le train, le métro, les boule-
vards et les autoroutes ont tour à tour
soulevé l'espoir de régler cette ques-
tion. En vain, car cet héritage de la
culture industrielle où le quotidien est
partagé dans différents secteurs de la
ville demeure un problème d'actualité.
Avec le City Beautiful, les boulevards
diagonaux avaient une autre fin : la mise
en scène urbaine. Exploitant la notion
d'espace public, les avenues et les
places devaient offrir à la collectivité un
paysage urbain grandiose et animé que
les institutions publiques devaient
embellir. Hôtels de ville, gares, biblio-
thèques, musées, etc. devenaient ainsi
des constructions privilégiées pour
signifier cette répartition des richesses
collectives. Puisqu'il y avait des liens
étroits entre l'académisme Beaux-Arts
et cet urbanisme, ces écrins des vertus
civiques recevaient idéalement un
traitement classique monumental. Par un
curieux paradoxe, la position centrale et
la majesté de ces bâtiments transcri-
vaient souvent, de manière presque
impériale, les prétentions démocratiques
de l'idéologie réformiste. Le City Beau-
tiful, comme l'architecture Beaux-Arts,
n'a pas su éviter l'écueil d'une vision
élitiste et autoritaire de la culture et de
la société.
Les autres édifices devaient eux aussi
se plier à cette vision d'ensemble. Il
fallait qu'ils soient en harmonie les uns
avec les autres plutôt que traités isolé-
ment. À l'exposition de Chicago, les
principaux pavillons étaient alignés les
uns aux autres et ils étaient en majorité
classiques. Ils avaient aussi une même
ligne de corniche à soixante pieds de
hauteur et leur couleur uniforme a valu
à l'ensemble le surnom de «ville
blanche». Ainsi, comme ce fut le cas
pour l'Exposition colombienne, les plans
d'urbanisme du City Beautiful favorisent
une limitation de la hauteur. Au-delà de
l'esthétique, il fallait, disait-on, éviter de
trop densifier la ville, car cela n'aurait
comme résultat que d'amener
« désordre, vice et maladie, et par le fait
même [de] devenir la plus grande
menace au bien-être de la ville elle-
même12». De telle sorte que, si l'on en
juge par les remarquables planches de
présentation du projet de Chicago,
l'architecture commerciale du centre-
ville devait former une masse uniforme,
étalée et découpée en îlots, comme si
l'on avait crevassé et retranché d'une
matière compacte les rues et les cours
intérieures. S'attachant par leurs
discours à dénoncer la monotonie du
plan en damier qu'une architecture
hétéroclite compense mal, les apôtres
du City Beautiful inversent ce rapport : ils
souhaitent la continuité de la texture
architecturale d'un édifice à l'autre,
avec des accents toniques à des points
stratégiques du plan urbain, soit les
carrefours, les places, les entrées, etc.
Très souvent, il s'agissait de mettre en
perspective les monuments les plus
significatifs. Par opposition aux origina-
lités victoriennes qui faisaient des
édifices des emblèmes publicitaires,
l'individualité des bâtiments privés devait
dorénavant se subordonner à un projet
collectif plus vaste: la ville. À Chicago,
Burnham a voulu donner la même
hauteur à tous les immeubles commer-
ciaux du quartier central et leur imposer
le même type d'implantation dans le
LES ENJEUX METROPOLITAINS 21
Extrait de la publication

TABLE DES MATIERES
7 Remerciements9 Sigles
11 Introduction
17 1 LES ENJEUX MÉTROPOLITAINS
17 Transformer la ville
22 La peur des gratte-ciel26 Le zonage : un compromis
31 2 LES ÉDIFICES À BUREAUX
31 L'héritage académique31 La « rationalité voluptueuse » des premières œuvres36 Vérités et mensonges architecturaux: le Transportation43 « Look like business and nothing more» : colosses des années 192047 Un précurseur des mégastructures: l'édifice Dominion Square
52 Le gratte-ciel Beaux-Arts : la Banque Royale à Toronto54 Déjouer l'ombre et la lumière: les gratte-ciel Art déco
61 3 LES GRANDS MAGASINS
61 Eaton ou le rêve inachevé64 Les projets de Ross et Macdonald pour Eaton
79 4 LES GRANDS HÔTELS
79 Le prestige des hôtels
80 Les châteaux de chemin de fer
81 Le Château Laurier: une conception de Bradford Lee Gilbert
91 La vie de château
99 Le luxe du Château Laurier
100 Le charme pittoresque : l'hôtel Macdonald
104 Manhattan dans les Prairies: l'hôtel Fort Garry
112 L'affirmation du gigantisme: l'hôtel Mount Royal
121 La forme épurée: l'hôtel Saskatchewan
125 La ville dans la ville: le Royal York
137 En guise de conclusion : un modernisme avant l'heure
145 Notes
157 Glossaire
165 Archives
167 Bibliographie

Acheve d'imprimer
enaout 2001 sur les presse de
imprimeries scontimental inc.,divison Meritoho
Imprimeu Cananda - Printed in Cananda
Extrait de la publication











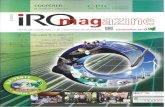







![ORCHESTRE METROPOLITAIN DU GRAND · PDF file · 2015-07-15... JE NE T’AIME PAS | I DON’T LOVE YOU [4:37] (1934, Maurice Magre) ... Dans certains pas- ... R ACHELLE TAYLOR Apart](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5aa6f4df7f8b9a50528bb6f0/orchestre-metropolitain-du-grand-2015-07-15-je-ne-taime-pas-i-dont.jpg)