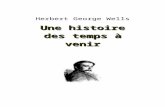Le droit d'auteur à l'épreuve de la liberté d'expression · 2020. 7. 30. · 1 Introduction «...
Transcript of Le droit d'auteur à l'épreuve de la liberté d'expression · 2020. 7. 30. · 1 Introduction «...

Le droit d’auteur à l’épreuve de la liberté d’expression
Mémoire
Maîtrise en droit
Florian Izquierdo
Université Laval
Québec, Canada
Maître en droit (LL.M.)
et
Université de Paris-Sud
Orsay, France
Master (M.)
© Florian Izquierdo, 2018

ii
Résumé
Droit d’auteur et liberté d’expression entretiennent des rapports ambivalents. Autrefois
complémentaires en vertu d’un équilibre historiquement pensé par le législateur, leur relation
s’est détériorée pour se commuer en véritable affrontement lequel doit, aujourd’hui, être
apprécié à l’aune des droits fondamentaux au sein desquels figurent droit d’auteur et liberté
d’expression. En dépit de la résistance initiale de juges du fond rétifs à l’idée de s’enfermer
dans pareille logique concurrentielle, le conflit, devenu récurrent, s’est généralisé tant en droit
interne qu’à l’échelle européenne. La confrontation s’opère désormais sous l’égide d’un
mécanisme juridique encore récemment inédit en la matière : le contrôle de proportionnalité,
redoutable instrument de restructuration du droit et des rapports de force qu’il abrite
inévitablement. L’introduction du contrôle de proportionnalité dans le giron du droit d’auteur,
sous l’impulsion des cours européennes - dont la méthode de raisonnement a été imitée puis
définitivement adoptée par la Cour de cassation -, témoigne d’un changement de paradigme
pour le moins manifeste. En cela, le mécanisme augure des bouleversements majeurs pour la
matière et en affecte des concepts-phares. En instituant et systématisant une mise en balance
permanente du droit d’auteur et de la liberté d’expression, le contrôle de proportionnalité tend
à faire de cette dernière une limite externe au droit d’auteur qui viendrait possiblement le
neutraliser ou en réduire le champ d’application naturel. Une perspective qui inquiète - dans la
mesure où elle fait ressurgir le spectre d’un fair use européen - au point de menacer la pérennité
du droit d’auteur et de la conception qui, en droit interne, l’innerve et le structure. À moins que
la liberté d’expression, dont le champ d’application semble hypertrophié, n’exige aujourd’hui,
à l’ère de la révolution numérique, une position hégémonique dont le corollaire serait
l’affadissement inexorable mais nécessaire du droit d’auteur.

iii
Table des matières
Résumé ................................................................................................................. ii
Table des matières ............................................................................................. iii
Remerciements .................................................................................................... v
Introduction......................................................................................................... 1
I. La mise en concurrence progressive du droit d’auteur et de la liberté
d’expression ......................................................................................................................... 11
A. L’acceptation graduelle du conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression .................................................................................................................................................. 11
1. Un équilibre interne au droit d’auteur : la configuration initiale de la confrontation
entre droit d’auteur et liberté d’expression ......................................................................... 11
a. Les exceptions au droit d’auteur, garantes de l’équilibre entre droit d’auteur et liberté
d’expression.............................................................................................................................. 12
b. La réticence marquée d’objecter la liberté d’expression au droit d’auteur .......................... 16
2. Les prémisses de la mise en balance du droit d’auteur et de la liberté d’expression ... 19
a. Les prémisses d’une mise en balance discutable du droit du public à l’information et du droit
d’auteur ..................................................................................................................................... 19
b. La mise en balance de la liberté de création et du droit d’auteur cantonnée à un cas précis 23
B. L’introduction définitive du contrôle de proportionnalité, un changement de
paradigme évident dans la dialectique entre droit d’auteur et liberté d’expression
............................................................................................................................ 27
1. L’immixtion en droit interne d’une méthode de raisonnement supposément aux
antipodes des logiques du droit d’auteur ............................................................................. 27
a. Le contrôle de proportionnalité à l’étude : histoire récente, principe de fonctionnement et
modalités de mise en œuvre ..................................................................................................... 27
b. Les écueils inhérents à la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité ........................... 33
c. Les bienfaits escomptés du contrôle de proportionnalité ..................................................... 37
2. La mise en balance du droit d’auteur et de la liberté d’expression à travers le contrôle
de proportionnalité ................................................................................................................. 41
a. L’opposition récurrente entre droit d’auteur et liberté d’expression à travers la jurisprudence
européenne................................................................................................................................ 41
b. L’importation en droit interne du conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression sous sa
nouvelle forme .......................................................................................................................... 47
II. La neutralisation du droit d’auteur au moyen d’une conception extensive
de la liberté d’expression : probabilité avérée ou vue de l’esprit ? .............. 55

iv
A. Les droits fondamentaux à travers le prisme du droit d’auteur : entre
instrument de paralysie et condition d’une application renouvelée ................... 55
1. La perspective du rétrécissement du champ d’application naturel du droit d’auteur à
travers l’avènement d’une limite externe ............................................................................. 56
a. Les droits patrimoniaux de l’auteur de l’œuvre première en péril ? .................................... 56
b. L’exclusion pressentie de certaines atteintes à l’intégrité de l’œuvre .................................. 59
2. Les droits fondamentaux au service d’une application plus effective du droit d’auteur
.................................................................................................................................................. 63
B. Un rapport de force incertain entre droit d’auteur et liberté d’expression :
dynamique et perspectives .................................................................................. 66
1. L’affadissement progressif du droit d’auteur, conséquence de la montée en puissance
de la liberté d’expression ....................................................................................................... 67
a. L’obsolescence constatable du droit d’auteur à l’aune des œuvres transformatives ............ 67
b. La liberté d’expression, catalyseur du déclin du droit d’auteur ? ........................................ 74
2. Le rétablissement souhaitable de la liberté d’expression dans ses délimitations d’origine
.................................................................................................................................................. 78
a. L’instrumentalisation regrettable de la liberté d’expression, cheval de Troie d’un fair use
européen ................................................................................................................................... 78
b. Plaidoyer en faveur d’un équilibre plus vertueux et pérenne entre droit d’auteur et liberté
d’expression.............................................................................................................................. 82
Conclusion ......................................................................................................... 91
Bibliographie ..................................................................................................... 92

v
Remerciements
En préambule, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Madame et Monsieur
les Professeurs Sophie Verville et Arnaud Latil pour avoir accepté de diriger mon mémoire et
m’avoir accompagné tout au long de ce travail ainsi que pour leur sollicitude et leur
bienveillance continues.
Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à Madame le Professeur Alexandra Bensamoun
pour m’avoir donné l’opportunité d’intégrer une formation sans nulle autre pareille.
Mes remerciements vont également à Monsieur le Professeur Georges Azzaria pour les
précieux conseils qu’il a sus me prodiguer au cours de l’atelier de présentation.
En outre, si remercier mes parents pour le soutien indéfectible qu’ils me témoignent
depuis toujours relève de l’évidence, je m’y astreins avec la discipline qu’exige l’exercice.
Enfin, je ne peux que rendre grâce à Eléna.

1
Introduction
« De toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation, celle dont
l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté, c’est
sans contredit celle des producteurs du génie »1. Ce postulat, affirmé puis réaffirmé avec
résolution par Joseph Lakanal, dépasse et transcende l’antinomie de principe entre liberté et
propriété pour mieux mettre en exergue leur entente réciproque, une fois celles-ci transposées
à la propriété intellectuelle. Plus largement, cette conception s’explique et se justifie au moyen
de raisons historiques et politiques évidentes. « La Révolution française avait prolongé, par un
patrimoine incorporel, sa conception de la propriété en tant que liberté élargie de la personne »2.
Dès lors, la propriété ne saurait empiéter sur la liberté dans la mesure où, indissolublement
liées, elles ne font qu’un.
Ainsi, pendant longtemps, droit d’auteur et liberté d’expression ont évolué de concert, se
conjuguant harmonieusement3. Plus que ça, ils faisaient montre d’une certaine complémentarité
dans la mesure où les revendications historiques qui les ont faits naître sont inextricablement
jointes4. Pour s’en convaincre, il suffit de revenir aux conditions qui ont présidé à la naissance
du droit d’auteur : l’abolition de ce qu’on nommait autrefois le privilège des libraires dans la
nuit du 4 août 1789 - les conséquences en furent d’ailleurs désastreuses et il fallut attendre les
décrets-lois révolutionnaires de 1791 et 1793 consacrant respectivement le droit de
représentation et le droit de reproduction pour que le droit d’auteur émerge véritablement -
n’avait-elle pas, de manière indirecte, mis un terme à la censure royale alors en vigueur5 ?
L’idée d’une osmose entre droit d’auteur et liberté d’expression a prospéré au point
d’innerver, à de multiples égards, les principes qui structurent et régissent le régime du droit
d’auteur en droit positif. Les implications de la liberté d’expression en la matière sont
1 Joseph Lakanal dans Carine Bernault, André Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire
et artistique, 5e édition, Paris, LexisNexis, 2017, à la p 12 [Méthode de citation du Guide McGill utilisée]. 2 René Savatier, « Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui » (1959) 342 Revue
Internationale de Droit Comparé. 3 Julie Groffe, « Droit moral et liberté de création » (2017) 43 Revue Internationale de Droit d’Auteur 5, à la p 8. 4 André Lucas. « Droit d’auteur, liberté d’expression et "droit du public à l’information" (libres propos sur deux
arrêts des Cour de cassation belge et française) » dans Alain Strowel, François Tulkens, Droit d’auteur et liberté
d’expression, Regards francophones, d’Europe et d’ailleurs, Larcier, 2006, à la p 123. 5 Ibid.

2
pléthoriques de telle sorte qu’il est, ici, impossible d’en dresser une liste exhaustive. Elles se
manifestent premièrement à travers la limitation de la protection dans le temps. En effet, « les
créations tombées dans le domaine public sont alors librement réutilisables, sans être à nouveau
appropriables »6. Parallèlement, le principe d’égalité de protection en vertu duquel la protection
accordée par le droit d’auteur est indifférente au genre ou au mérite de l’œuvre de l’esprit
s’inscrit sans le moindre doute dans une perspective identique7. Enfin, illustration sûrement la
plus marquante, les exceptions au monopole sont en nombre conséquent fondées sur la liberté
d’expression et visent à concilier sans soubresaut les deux impératifs. En outre, si la liberté
d’expression influe sur les concepts et les équilibres du droit d’auteur et en dessine leurs
contours ; elle participe également, de manière sous-jacente, de leur maintien. Et pour cause, la
notion d’originalité, par exemple, qui se définit classiquement - selon la célèbre formule de
Henri Desbois - comme « l’empreinte de la personnalité » se retrouverait dépourvue d’utilité
en l’absence d’une liberté d’expression artistique accordée aux créateurs8. Il en va de même
lorsque Desbois affirme ensuite que les idées sont « par essence et par destination de libre
parcours », révélant ainsi que la réservation a trait uniquement aux créations de forme.
Plus généralement, la liberté d’expression est un terreau fertile pour le droit d’auteur qui n’a
vocation à jouer que si celle-ci est en mesure de produire pleinement ses effets. De même,
réciproquement, le droit d’auteur stimule la création. Il en est l’aiguillon et la récompense9.
« Le droit d’auteur, en ce qu’il fournit au créateur des moyens de subsistance, est aussi une
assurance de sa liberté de création future ».10 Ainsi, pour Frédéric Pollaud-Dulian, « le droit
d’auteur constitue, dans l’ordre des droits subjectifs, le contrepoint de ce qu’est la liberté de
création et d’expression, dans l’ordre des libertés individuelles : tous deux, chacun dans son
propre registre, défendent et exaltent la création et l’individu créateur »11. Une position, faisant
consensus en doctrine, étayée par le Professeur Julie Groffe :
« En effet, tous deux visent finalement le même objectif en ce que chacun éclaire la démarche créatrice en
amont comme en aval. En amont, c’est-à-dire au stade où le processus créatif est initié, c’est la liberté de
création qui permet à l’auteur en germe d’avoir la latitude suffisante pour créer comme il l’entend. En aval,
6 Isabelle Pignard, La liberté de création, Université Nice Sophia Antipolis, 2013, à la p 15. 7 Code de la propriété intellectuelle, JO, 3 juillet, 1992, 8801, article L. 121-3. 8 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 8. 9 Pierre Sirinelli, « Le droit d’auteur à l’aube du 3ème millénaire » (2000) 1 La Semaine Juridique Édition Générale
13, à la p 14. 10 Alexandre Zollinger, Droit d’auteur et droits de l’homme, LGDJ, 2008, à la p 244. 11 Frédéric Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, 2e éd, Paris, Economica, 2014, à la p 52.

3
c’est-à-dire une fois qu’il y a création de forme […] portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur […]
le droit moral […] aura vocation à assurer la protection de la création12. En d’autres termes, liberté de
création et droit moral se succèdent chronologiquement, la formalisation originale s’imposant comme le
critère de basculement depuis la liberté vers le droit […] la dualité a vocation à assurer à l’artiste une
protection de tous les instants […] droit moral et liberté de création tendent finalement tous deux à protéger
le créateur dans le lien qu’entretient celui-ci avec sa création »13.
Le droit d’auteur se mue alors en « garantie de la liberté artistique »14 à tel point « qu’aucun
autre régime juridique ne semble en mesure d’assurer à l’auteur le degré de liberté qui lui est
nécessaire pour qu’il puisse proprement remplir sa mission sociale »15.
Pourtant, les relations entretenues se sont rapidement envenimées, le lien s’est étiolé et la
logique concurrentielle sous-jacente entre droit d’auteur et liberté d’expression s’est accentuée
ces dernières années sous l’effet de la fondamentalisation du droit, phénomène d’ampleur qui
prend l’apparence d’une véritable lame de fond.
Ce phénomène dual, révélateur d’une mécanique à double-détente, désigne, dans un
premier temps, « l’appréhension de certaines règles par des normes d’origine
supralégislative »16. Dès lors, la fondamentalisation consiste à rechercher la reconnaissance
d’une règle par des normes qui bénéficient d’une position élevée au sein de la pyramide des
normes. En d’autres termes, il s’agit d’isoler une norme consacrée légalement avant de lui faire
accéder à un statut supérieur. La fondamentalisation du droit d’auteur s’est opérée en deux
temps, d’abord en droit interne puis, successivement, à l’échelle du droit de l’Union
européenne.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 juillet 200617 - postérieure à une décision
qui déjà admettait qu’il existait un « objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde la
12 Frédéric Pollaud-Dulian, « Droit moral et droits de la personnalité » (1994) 15 La Semaine Juridique Édition
Générale 8 : Le droit moral est intrinsèquement lié à l’œuvre et la liberté de création à l’auteur. 13 Julie Groffe, op. cit., note 3, aux p 7 et 8. 14 Alexandre Zollinger, op. cit., note 10, à la p 244. 15 Mihailo Stojanovic, « La raison d’être du droit d’auteur » (1979) 4 Revue Internationale de Droit d’Auteur 3, à
la p 139. 16 Arnaud Latil, Création et droits fondamentaux, LGDJ, 2014, à la p 12. 17 Cons constitutionnel, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de
l'information, Rec 2006 88, 2006-540 DC.

4
propriété intellectuelle »18 - au sujet de la transposition de la directive Droit d’auteur et droit
voisin dans la société de l’information reconnaît une valeur constitutionnelle à la propriété
intellectuelle et à l’ensemble de ses composantes - le droit d’auteur et les droits voisins - et
attributs - patrimoniaux, intellectuels et moraux -, le Conseil rattachant la propriété
intellectuelle au droit de propriété par référence à l’article 17 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen19 qui le consacre. « La reconnaissance du droit d’auteur en tant que droit
de propriété le fait, du même coup, entrer dans la catégorie des droits fondamentaux »20.
Depuis la consécration textuelle dont il jouit par l’intermédiaire de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, le droit de propriété a connu un élargissement conséquent de son champ
d’application, notamment sous l’influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel21.
Propriété incorporelle imprégnée de valeur spirituelle, la constitutionnalisation du droit
d’auteur ne saurait être surprenante22. Une jurisprudence s’est d’ailleurs étoffée afin d’intégrer
graduellement puis définitivement les aspects purement patrimoniaux de la propriété
intellectuelle23. Pour le droit d’auteur, la reconnaissance d’une valeur supra-législative a donc
été « tardive, progressive et évolutive »24.
À l’échelle internationale, le droit d’auteur jouit d’une double consécration, à la fois textuelle
et jurisprudentielle. Reconnue à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme25 ainsi qu’à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, la propriété intellectuelle est également protégée, en droit de l’Union européenne,
sur le fondement de l’article 17-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne26, texte d’application directe qui prévaut sur les normes issues des États membres
18 Cons constitutionnel, 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, Rec 2004, 2004-499 DC. 19 « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». 20 Carine Bernault, André Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, op. cit., à la p 34. 21 Cons constitutionnel, 28 février 2014, 2013-370 QPC : « Considérant que les finalités et les conditions
d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ
d’application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle ». 22 Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, 10e éd, Paris, PUF, 2017, aux p 39 et 40. 23 Cons constitutionnel, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, Rec
2009, 2009-580 DC. 24 Christophe Geiger dans Michel Vivant, Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, 2e édition, Paris, Dalloz,
2015, à la p 34.
25 « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent […] Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ». 26 « La propriété intellectuelle est protégée ».

5
dans la mesure où il revêt une valeur identique aux traités. Directe, la protection apparaît
également comme indirecte comme en atteste la jurisprudence pour le moins fournie rendue en
la matière. Sur ce point, encore est-il pertinent de relever que la Cour de justice de l’Union
Européenne - constat qui s’applique également à la Cour européenne des droits de l’homme -
élabore « une jurisprudence de plus en plus abondante, où elle s’empare et remodèle les
concepts du droit d’auteur et des pans entiers de son régime »27. Ce faisant, en vertu de la
décision Anheuser-Bush28, la Cour européenne des droits de l’homme indique que la « propriété
intellectuelle bénéficie sans conteste de la protection de l’article 1 du Protocole n°1 ». Par la
suite, elle en fait un droit fondamental29. Une position sur laquelle s’est alignée la Cour de
justice30.
En ce sens, il est manifeste que « confortablement installés par le traité de Lisbonne au sommet
de la hiérarchie des normes de l’ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux
irradient de plus en plus sur le droit de l’Union européenne et de ses États membres, renouvelant
ainsi les sources du droit de la propriété intellectuelle de manière considérable »31.
En outre, la fondamentalisation désigne, dans un second temps, l’articulation - idéalisée
en conciliation, elle s’apparente davantage à un conflit - qui tend à opposer les droits
fondamentaux situés à la confluence du droit d’auteur avec ce dernier. En effet, « la
consécration du droit d’auteur comme droit fondamental ne signifie pas qu’aucun antagonisme
ne puisse apparaître entre le droit d’auteur et d’autres droits de l’Homme. Simplement, il ne
s’agit plus dans cette hypothèse de constater que le droit d’auteur porte atteinte à un droit
fondamental, mais plutôt de relever que deux dispositions d’égale valeur sont en apparence
contradictoires. La question est alors de déterminer comment concilier concrètement les
diverses dispositions antagonistes, et non de définir une hiérarchie permettant de résoudre de
manière abstraite, générale et absolue tout conflit normatif »32. Et pour cause, « quel que soit
son objet, quel que soit son texte de référence […] une liberté peut toujours se voir imposer des
27 Célia Zolynski, « L’élaboration de la jurisprudence de la CJUE en droit de la propriété littéraire et artistique »
dans Mélanges en l’honneur du Professeur André Lucas, LexisNexis, 2014, aux p 813 et s. 28 CEDH, 15 février 2006, Anheuser-Busch, aff 73049/01. 29 CEDH, 29 janvier 2008, Balan c Moldavie, qff 19247/03. 30 CJCE, 12 septembre 2006, Laserdisken ApS c Kulturministeriet, aff C-479/04. 31 Christophe Geiger, op. cit., note 24, à la p 19. 32 Alexandre Zollinger, op. cit., à la p 10.

6
sacrifices […] au nom d’une autre liberté ou d’un objectif de valeur constitutionnelle : aucune
liberté, aucun droit ou principe ne possède un caractère absolu »33.
Parmi ces droits et libertés de valeur supra-législative et inexorablement conduits à entrer en
conflit avec le droit d’auteur figurent le droit de la concurrence, les droits de la personnalité et,
surtout, la liberté d’expression ainsi que les subdivisions qui en émanent. À ce titre, il convient
de préciser, à ce stade de notre étude et afin d’en clarifier le propos qui suivra, que le terme
liberté d’expression est ici employé dans son acception la plus large. Si, par la suite, notre
recherche se polarisera autour de la liberté de création - ou liberté d’expression artistique34 -, le
droit du public à l’information, dont l’existence réelle demeure sujette à caution, mérite que
l’on s’y attarde au regard du foisonnement de décisions dans lesquelles il a été opposé au droit
d’auteur.
La liberté d’expression, « liberté fondamentale »35 de tout premier ordre - en tant qu’elle
conditionne l’exercice et l’effectivité de toute une pluralité de droits et libertés -, revêt une
importance telle qu’elle s’affirme comme un principe structurant de la démocratie36. La liberté
d’expression est garantie, en droit interne, par la combinaison des articles 10 et 1137 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et nourrit une jurisprudence constitutionnelle
ayant vocation à lui conférer une entière plénitude38. Parallèlement, elle est consacrée, à
l’échelon supra-national, par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en droit européen, par
l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales39, disposition à l’origine d’une multitude de décisions prétoriennes dont
certaines nous intéressent au plus haut point.
33 Christophe Geiger, op. cit., note 24, à la p 35. 34 Alexandre Zollinger, op.cit., note 10 à la p 189. L’auteur fait la distinction entre libertés de création et
d’expression artistique : « Elles sont l’expression d’un droit de l’Homme unique, la liberté artistique, mais
correspondent chacune à un angle d’approche distinct et déterminé ». 35 Cons constitutionnel, 10 et 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence
financière et le pluralisme des entreprises de presse, 84-181 DC. 36 Patrick Waschmann, « La liberté d’expression » dans Rémy Cabrillac, Libertés et droits fondamentaux, 23e
édition, Paris, Dalloz, 2017, à la p 486. 37 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi ». 38 Cons constitutionnel, 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française, 94-345 DC ou encore Cons
constitutionnel, 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 94-352 DC. 39 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans

7
« Sous-ensemble »40 ou « démembrement »41 de la liberté d’expression, la liberté de création
se définit désormais comme une liberté bien assise, « certaine dans son existence, intimement
liée à la liberté d’expression mais ne se réduisant pas à celle-ci »42. En effet, la liberté de
création accuse un fort particularisme que le « poids écrasant » de la liberté d’expression tend
à édulcorer43. Aussi, elle emprunte les caractères de cette dernière et « y ajoute les siens
propres »44. Ces spécificités irréductibles à la liberté de création - dont l’objet est de permettre
à l’artiste de débuter sa démarche artistique sans se trouver bridé ou contraint par autrui -
tiennent notamment au fait que son exercice ne représente pas à une fin en soi et ne donne pas
systématiquement lieu à création ou encore que la diffusion n’en constitue pas une condition
sine qua non45. De plus, son objet, à savoir la création, activité intellectuelle consistant à
produire une chose, est un fait encore largement ignoré du droit46. Et pour cause, objet mouvant
et complexe, « l’activité créatrice est par définition source permanente de nouveauté, donc de
changement, donc de désordre »47.
Si ses fondements juridiques sont « disparates et hétéroclites »48, la liberté d’expression
artistique est mentionnée à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à
l’article 15 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. De plus,
elle fait l’objet d’une reconnaissance en droit positif par le truchement jurisprudentiel. La
reconnaissance de la liberté de création découle d’une interprétation de l’article 10 par la Cour
européenne : l’arrêt Muller49, confirmé depuis par la jurisprudence Alinak50, indique que
« l’article 10 […] englobe la liberté d’expression artistique ». Parallèlement, en jurisprudence
interne51, « la liberté de l’art est placée dans l’orbite de la liberté d’expression »52.
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ». 40 Dany Cohen, « La liberté de créer » dans Rémy Cabrillac, op.cit., note 36, à la p 559. 41 Julie Groffe, op.cit., note 3, à la p 8. 42 Dany Cohen, « La liberté de créer » dans Rémy Cabrillac, op.cit., note 36, à la p 557. 43 Arnaud Latil, op.cit., note 16, à la p 184. 44 Dany Cohen, « La liberté de créer » dans Rémy Cabrillac, op.cit., note 36, à la p 559. 45 Ibid. 46 Arnaud Latil, op.cit., note 16, à la p 184. 47 Dany Cohen, « La liberté de créer » dans Rémy Cabrillac, op.cit., note 36, à la p 558. 48 Alexandre Zollinger, op.cit., note 10 à la p 184. 49 CEDH, 24 mai 1988, Müller et autres c Suisse, aff 10737/84 : « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou
exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensables dans une société
démocratique ». 50 CEDH, 4 mai 2006, Alinak c Turquie, aff 73049/01. 51 Cass civ 1re, 29 octobre 1990 : « Le principe de la liberté d’expression, notamment en matière de création
artistique ». 52 Arnaud Latil, op.cit., note 16, à la p 36.

8
Enfin, le droit du public à l’information est classiquement présenté comme le corollaire de la
liberté d’expression. Invoqué de manière récurrente par les plaideurs, il demeure discutable
compte tenu de la différence de nature entre le droit - dont il revêt les caractéristiques
intrinsèques - et la liberté - en l’occurrence, celle qui le fonde, la liberté d’expression.
Si droit d’auteur et liberté d’expression ont pu jusqu’ici démontrer une réelle
complémentarité, elle n’est pas exempte de toute remise en question. En adoptant une autre
grille de lecture, transparaissent aisément, en germes, les prémisses de l’actuel conflit. En effet,
« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »53 proclamait déjà la
sacrosainte Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, principe qui, dans notre
système juridique contemporain, peut trouver son corollaire à travers ces mots, ici empruntés
au professeur Pierre-Yves Gautier : « La liberté est certes sacrée, mais elle s’arrête là où on
empiète sur le droit des autres »54. Un droit qui peut très bien prendre la forme du droit de
propriété, « limite légitime à la liberté de création »55. Dans l’équation entre droit d’auteur et
liberté de création, la tension se cristallise autour du droit moral. « Dans cette perspective, il est
évident que le droit moral reconnu à l’auteur sur son œuvre peut constituer un obstacle très net
à la création […] Dans l’absolu, la confrontation semble inévitable : le droit moral est un droit
de protection qui se traduit bien souvent par une faculté de blocage, et donc par un
comportement actif de la part de l’auteur, tandis que la liberté de création impose justement une
abstention d’autrui, et donc un comportement passif. Il est difficile, à première vue, d’envisager
que la coexistence puisse s’opérer sereinement : celui qui invoque la liberté de création va
chercher à paralyser le droit moral, tandis que celui qui invoque le droit moral va chercher à
limiter la liberté de création »56.
La confrontation entre droit d’auteur et liberté d’expression ne saurait prétendre être
inédite. Elle n’est, en définitive, que la résurgence de l’éternelle problématique inhérente aux
exceptions et limitations susceptibles de paralyser l’application du droit d’auteur57.
53 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789, article 4. 54 Pierre-Yves Gautier et Alice Pézard, « Nouvelle méthode de raisonnement du juge ? L’arrêt de la Cour de
cassation du 15 mail 2015 sur le juste équilibre des droits » (2016) 57 Legicom 5, à la p 13. 55 Arnaud Latil, op. cit., note 16 à la p 122. 56 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 5. 57 André Lucas et Jane Ginsburg. « Droit d’auteur, liberté d’expression et libre accès à l’information (étude
comparée de droit américain et européen) » (2016) 249 Revue Internationale de Droit d’Auteur 4 : « La question
des limitations-exceptions a toujours été et reste une question-clé du droit d’auteur comme le montre l’intensité
des débats législatifs, judiciaires et doctrinaux menés sur ce terrain miné ».

9
Profondément novateurs en revanche sont les termes dans lesquels elle se pose. La liberté
d’expression ne s’exprime plus désormais à travers les exceptions mais s’affirme comme limite
externe au droit d’auteur dg semble destinée à lui être opposée de manière permanente. Une
opposition qui se systématise sous l’égide du contrôle de proportionnalité - mécanisme ayant,
d’emblée, vocation à jouer un rôle majeur - mobilisé pour départager les droits mis en balance.
En d’autres termes, la dimension conflictuelle entre droit d’auteur et liberté d’expression
monopolise désormais le juge comme la doctrine.
La liberté d’expression, droit désormais concurrent du droit d’auteur et cheville ouvrière
de sa déliquescence ?
Il s’agira ici d’apprécier les rapports qu’entretiennent droit d’auteur et liberté
d’expression à l’aune, notamment, des développements jurisprudentiels récents en droit
européen et en droit interne qui tendent, de manière sous-jacente, à accorder une primauté à
peine voilée à la liberté d’expression et aux droits qui en émanent (I). Une fois ce premier
constat effectué, il sera bon d’en tirer les enseignements qui s’imposent et d’examiner s’il est
réellement légitime d’entrevoir un affadissement et, à terme, un déclin du droit d’auteur ou si
pareille analyse relève uniquement d’une vue de l’esprit (II). Si la présente étude est étrangère
à quelconque approche comparatiste, des incursions en droit américain ou canadien pourront
être faites dès lors qu’elles se justifieront.
S’il est, à l’heure actuelle, prématuré de se prononcer définitivement sur l’irruption des
droits fondamentaux et sur l’immixtion du contrôle de proportionnalité afférent en tant que
moyen privilégié de la mise en balance des intérêts dans le périmètre du droit d’auteur, nul
doute que le phénomène, sujet à caution, interpelle et inquiète. Véritable changement de
paradigme, il augure des bouleversements majeurs pour la matière - certains ont déjà été initiés,
à l’image du passage à un arbitrage externe - et affecte en profondeur les équilibres en présence.
En cela, la dynamique à l’œuvre renouvelle intégralement la physionomie de la confrontation
entre liberté d’expression et droit d’auteur et implique nécessairement de repenser notre
approche de la matière et d’en redéfinir les contours, notamment la démarcation fluctuante entre
liberté de création et respect du droit moral que les jurisprudences récentes obscurcissent. Plus
inquiétant encore, le mécanisme apparaît symptomatique d’un rétrécissement, voire d’un
affadissement du droit moral comme des prérogatives patrimoniales dont l’exercice est de plus
en plus restreint au gré des contentieux. À terme, ce serait précisément la pérennité du droit

10
d’auteur qui serait battue en brèche. Celui-ci, devenu une gène trop conséquente, serait effacé
ou neutralisé par un contrôle de proportionnalité au service exclusif de la liberté d’expression.
Par-là, ce serait la consécration d’une conception qui se représente dans le droit d’auteur un
droit qui inhibe plus qu’il n’émancipe et qui, ainsi, rendrait son déclin inéluctable après en avoir
postulé le crépuscule. Une perspective qui est confortée par le contexte dans lequel elle s’insère,
à savoir celui d’une société où l’émergence du droit du public à l’information et la
démocratisation de la culture sont synonymes d’autant de nouveautés à appréhender pour la
matière.
Pour autant, est-il souhaitable de condamner l’invocation de la liberté d’expression en tant que
limite exogène au droit d’auteur ? D’autant que le phénomène, qui n’a rien de conjoncturel, est
parti pour s’inscrire dans la durée. Il semblerait a priori que l’argument tiré de la liberté
d’expression s’inscrit au sein d’un courant qui tient pour ligne directrice de conférer à la liberté
de création sa pleine effectivité et de lui ôter les possibles obstacles susceptibles de l’entraver
excessivement. Une liberté de création qui, dans une société façonnée par la révolution
numérique et les possibilités qui en découlent, a vocation à jouer un rôle conséquent. De ce
point de vue, la liberté de création est une marge de manœuvre supplémentaire et le droit moral
représente une entrave à la même création en raison de ses caractéristiques intrinsèques.
En somme, parce qu’elle traduit un renversement de perspective entre le droit d’auteur et les
autres droits fondamentaux, la liberté d’expression ébranle les fondements de la matière. Encore
s’agit-il de déterminer si cette reconfiguration en signe le déclin ou alors lui assure un équilibre
plus vertueux, spécifiquement adapté aux besoins nouveaux des différents acteurs. En
considération des différents éléments et enjeux évoqués à titre liminaire, notre étude se
proposera d’apprécier donc l’affirmation du professeur Édouard Treppoz : « l'invocation par la
Cour de cassation de la liberté d'expression, englobant la liberté de création, constitue un
formidable outil de reconstruction ou de déconstruction, c'est selon, du droit d'auteur »58.
58 Édouard Treppoz, « Klasen : liberté de création en tension » (2016) 39 Jurisart, 2016 28, à la p 29.

11
I. La mise en concurrence progressive du droit d’auteur et de la liberté
d’expression
Le conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression, dans les modalités qui lui sont
propres aujourd’hui, est la conséquence directe d’une longue évolution (A) laquelle a eu pour
catalyseur l’introduction en droit interne d’un mécanisme dont l’utilisation à l’échelle supra-
étatique était déjà bien répandue, le contrôle de proportionnalité. À travers sa mise en œuvre,
les droits en présence sont mutuellement confrontés afin de déterminer lequel doit prévaloir
(B).
A. L’acceptation graduelle du conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression
À l’origine, les juridictions récusaient avec détermination les velléités exprimées par
d’aucuns qui ambitionnaient de faire de la liberté d’expression une limite externe au droit
d’auteur. L’équilibre était, en effet, garanti au sein du périmètre du droit d’auteur, au cœur du
régime juridique qui le structure et l’articule (1). Toutefois, la jurisprudence a progressivement
rendu des décisions qui, rétrospectivement, peuvent s’interpréter en signes avant-coureurs de
ce qui, plus tard, allait advenir dans la mesure où elles procèdent, de manière sous-jacente, à
une mise en balance embryonnaire du droit d’auteur et de la liberté d’expression (2).
1. Un équilibre interne au droit d’auteur : la configuration initiale de la
confrontation entre droit d’auteur et liberté d’expression
Les exceptions légales ont pour vocation première de contribuer à l’équilibre entre droit
d’auteur et droits situés au carrefour de celui-ci (a). Si ces soupapes de sécurité présentent des
écueils considérables, leur légitimité et leur utilité sont indéniables. Dès lors, pour beaucoup, il
n’apparaît pas pertinent d’établir une limite au droit d’auteur au-delà de ce qui a été prévu par
le législateur (b).

12
a. Les exceptions au droit d’auteur, garantes de l’équilibre entre droit d’auteur et liberté
d’expression
« Remettre au juge le soin de concilier au cas par cas le droit d’auteur et la liberté
d’expression […] comme l’implique le test de proportionnalité de l’article 10 de la Convention,
est de mauvaise méthode. C’est oublier, en effet, que l’arbitrage est déjà fait par la loi sur le
droit d’auteur »59. De cette analyse du professeur André Lucas, il ne faut pas déduire que la loi
est auto-suffisante - le droit d’auteur ne saurait évoluer en vase-clos ou constituer un système
« autarcique »60 - mais que « les préoccupations mises en avant pour faire obstacle au droit
d’auteur ont déjà été expressément prises en compte par le législateur »61 à travers les
dérogations au droit exclusif que sont les exceptions. Ce n’est pas pour autant, par ailleurs, que
le juge voit son rôle négligé ou minimisé alors que d’aucuns dénoncent un « surencadrement
légal des exceptions », symptomatique d’une défiance à l’égard du juge62. Son pouvoir
d’appréciation réside dans la bonne application desdites exceptions et il lui appartient de
déterminer si les justiciables sont fondés à s’en prévaloir. Il l’exerce, notamment, lorsqu’il juge
que l’intention humoristique, critère constitutif de l’exception de parodie ne saurait avoir pour
effet d’exclure une « intention de fond étrangère à tout humour » afin de « légitimer des
emprunts nécessaires au plein exercice de la liberté d’expression »63.
Les exceptions ont pour objectif de « concilier les impératifs de la protection du droit
d’auteur avec d’autres exigences tout aussi fondamentales »64. En ce sens, elles s’inscrivent
naturellement dans une volonté d’équilibre. Le considérant 31 de la directive Droit d’auteur et
droits voisins dans la société de l’information65 évoque d’ailleurs le juste équilibre que l’on
cherche à atteindre au moyen des exceptions, ce qui, il semblerait, a pour conséquence indue
59 André Lucas, op. cit., note 4, à la p 135. 60 Valérie-Laure Benabou, « Puiser à la source du droit d’auteur » (2002) 192 RIDA 3. 61 André Lucas, op. cit., note 4, à p 136. 62 Pierre Sirinelli, « Propos introductifs » dans André Lucas, Pierre Sirinelli, Alexandra Bensamoun. Les
exceptions au droit d’auteur, État des lieux et perspectives dans l’Union Européenne, Paris, Dalloz, 2012 9, à la
p 14. 63 André Lucas, op. cit., note 4, à la p 139. 64 Hugo Wistrand, Les exceptions apportées aux droits de l’auteur sur ses œuvres, Paris, Éditions Montchrestien,
1968. 65 Directive CE, Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information, [2001] JO, L 167/10, considérant 31 : « Il convient de maintenir un juste
équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-
ci et les utilisateurs d'objets protégés ».

13
de rendre le contrôle de proportionnalité superfétatoire, ce sur quoi nous reviendrons plus tard
dans notre étude.
En France, les exceptions font l’objet d’une consécration légale. Elles sont formulées, pour
l’essentiel, à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui renferme une liste
limitative d’exceptions, système fermé dont le choix a été dicté par des arguments de sécurité
juridique. Pour le justiciable qui souhaite invoquer une exception, il s’agit, en effet, d’un gage
de prévisibilité important.
Les exceptions se définissent comme des limites internes au monopole dont elles paralysent
l’application alors que les conditions de celle-ci sont réunies66. D’ordre public, elles ne
sauraient créer de droits subjectifs dans le patrimoine des tiers. D’interprétation stricte67, elles
s’interprètent en faveur du monopole de l’auteur. De plus, leur mise en œuvre est encadrée par
le test des trois étapes. Standard de référence, il implique qu’une exception soit conforme aux
conditions - elles présentent un caractère cumulatif - qu’il édicte : « Les exceptions et
limitations […] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à
l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du droit »68.
Depuis plus d’une décennie, la tendance est à la multiplication des exceptions dont le nombre
a été doublé suite à la transposition de la directive de 2001. De nouvelles ont vu le jour entre
temps, à l’occasion notamment de l’adoption de la Loi pour une République numérique69. Ce
phénomène d’extension va de pair avec un recours plus fréquent aux exceptions : elles sont, en
effet, sollicitées de manière quasi-systématique.
Les limites au monopole devant être justifiées en toutes circonstances, les exceptions
reposent nécessairement sur un ou plusieurs fondements parmi lesquels la liberté d’expression
occupe une place majeure. À l’image des exceptions prises dans leur généralité, elles entendent
concilier droit d’auteur et liberté d’expression afin de maintenir un équilibre entre les
66 CJUE, 27 juin 2013, VG Wort, aff C-457/11 : La mise en œuvre du droit est « totalement exclue ». 67 CJUE 10 avril 2014, ACI Adam BV e.a. c Stichting de Thuiskopie et autres, aff C-435/12. 68 Directive CE, Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information, [2001] JO, L 167/10, art 55. 69 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JO, 8 octobre 2016, 0235.

14
prérogatives des auteurs et les libertés des tiers70. Parmi celles-ci - liste non exhaustive -,
figurent les exceptions de courte citation et d’analyse ainsi de parodie.
Récemment assimilé à une terre d’élection pour la création transformative, la première constitue
une « véritable permission légale de reprendre une œuvre antérieure pour l’incorporer dans une
œuvre seconde »71. En effet, l’auteur de l’œuvre première ne peut interdire, en vertu des
dispositions de l’article L. 122-5 et sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont
incorporées. Si les conditions d’application de l’exception, mises au point par la jurisprudence,
sont, en pratique, souvent difficile à réunir - l’exception doit nécessairement poursuivre une
finalité didactique, au moyen d’une incorporation dans une œuvre citante d’un extrait d’une
œuvre première, à quoi s’ajoute une exigence de brièveté - elle tend à l’objet d’un élargissement
sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne72.
L’exception de parodie est, sans nul doute, l’exception la plus intimement liée à notre sujet.
Innervée par la liberté d’expression au point d’avoir été reconnue comme « un des aspects du
principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression »73, elle protège la caricature et la
satire. Elle a d’autant plus vocation à jouer un rôle majeur au sein des relations qu’entretiennent
droit d’auteur et liberté d’expression qu’elle fait l’objet d’une « lecture particulièrement
libérale »74 depuis la jurisprudence Deckmyn, du nom de la décision rendue par la Cour de
justice de l’Union européenne le 3 septembre 201475, au terme d’une question préjudicielle
relative à l’interprétation devant être faite de l’exception de parodie. En résulte que la parodie,
désormais caractérisée comme notion autonome, a pour seuls critères constitutifs, ou lois du
genre lesquelles sont particulièrement souples, d’évoquer une œuvre existante tout en s’en
différenciant de manière perceptible afin d’éviter tout risque de confusion et de constituer une
manifestation d’humour ou de raillerie. Ainsi, la Cour ne juge pas opportun de vérifier si la
parodie représente un réel apport en termes de création par rapport à l’œuvre parodiée ou s’il
ne s’agit que d’une copie servile présentant des modifications résiduelles. En revanche, la Cour
70 Sur ce point, existe une controverse de nature sémantique. Doit-on préférer l’emploi du terme « droits » à celui
de « libertés » et, si oui, que recouvrent ces droits ? 71 Valérie-Laure Benabou, Rapport de la mission du CSPLA sur les œuvres transformatives, 2014, à la p 52. 72 CJUE, 1er décembre 2011, Eva Maria Painer c Standard VerlagsGmbH et autres, aff C-145/10. 73 CA Paris, 28 février 1995. 74 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 71 à la p 55. 75 CJUE, 3 septembre 2014, Deckmyn, aff C-201/13.

15
souligne que l’application de l’exception doit respecter un équilibre entre les droits des titulaires
et la liberté d’expression de l’utilisateur d’une œuvre protégée.
En conséquence, les exceptions fondées sur la liberté d’expression accordent à celle-ci
une large place en rendant possible d’utiliser l’œuvre d’autrui sans avoir, au préalable, à
recueillir son autorisation. En cela, elles permettent d’appréhender la marge de liberté qu’il
convient de réserver à ceux qui aspirent à utiliser des œuvres préexistantes76. Une pratique qui
tend à se généraliser et ne se cantonne pas uniquement aux artistes établis mais à chaque
utilisateur et sur laquelle nous reviendrons plus longuement dans la suite de cette étude.
Aussi, pour le professeur André Lucas, il appartient à chaque législateur national de trouver
l’équilibre qui lui paraît le plus approprié, en prenant en compte les revendications des tiers.
Par-là, il refuse d’octroyer au juge la possibilité de refaire la loi en imposant un autre équilibre
que celui qui a été voulu77. Une position qui fait consensus en doctrine : il appartient au
législateur « d’énoncer une règle abstraite et générale, au nom de l’intérêt social, et non au juge
de déplacer les lignes à l’occasion de conflits précis entre particuliers » afin de « rechercher le
point d’équilibre entre intérêts antagonistes »78.
Outre les exceptions évoquées, d’autres principes et aménagements du droit d’auteur
traduisent une prise en considération considérable de la liberté d’expression. La durée limitée
dans le temps des droits patrimoniaux ou encore le domaine public, fonds commun dans lequel
tout un chacun peut puiser à l’expiration de ladite durée, en constituent les illustrations les plus
remarquables. Il est, dès lors, manifeste que la construction et les logiques qui prévalent en droit
interne sont exorbitantes au recours aux droits fondamentaux pour arbitrer l’éventuel conflit
entre droit d’auteur et liberté d’expression, conflit censé être désamorcé a priori par un
législateur soucieux d’assurer un équilibre qu’il estime pertinent. Si les alternatives à la
fondamentalisation existent - d’aucuns militent pour une application plus récurrente de la
théorie de l’abus de droit79 qui ne ferait primer la liberté d’expression qu’uniquement dans des
circonstances exceptionnelles80 - force est de constater que celles-ci, jugées inadaptées aux
76 Pierre Sirinelli, op. cit., note 62, à la p 9. 77 André Lucas, op. cit., note 4, à la p 137. 78 Pierre Sirinelli, op. cit., note 62, à la p 13. 79 CA Paris, 30 mai 2001 : la théorie de l’abus de droit s’applique au droit d’auteur. 80 André Lucas, op.cit., note 4, à la p 141 : « La méthode, éprouvée, nous paraît de loin préférable à celle qui
consiste à borner le périmètre du droit d’auteur par la mise en balance avec des droits fondamentaux aux contours
incertains ».

16
besoins naissants des différents acteurs, peinent à convaincre : « « Les aspirations sont diverses.
Entre les désirs des particuliers, les revendications de liberté de créateurs d’œuvres
transformatrices ou dérivées ou le souhait de liberté de certains intermédiaires, comment
apporter une réponse univoque à des situations si diverses où chacun appelle à la rescousse les
droits fondamentaux »81. C’est là une délicate équation à résoudre.
Les exceptions privilégient un arbitrage interne au droit d’auteur, situé dans son
périmètre naturel ; ce qui a pour pendant de récuser toute limite externe que l’on souhaiterait
opposer au droit d’auteur. Cette conception, héritage de la tradition personnaliste si prégnante
en droit interne, a longtemps été défendue par la jurisprudence, la Cour de cassation y
démontrant à plusieurs reprises son attachement (b).
b. La réticence marquée d’objecter la liberté d’expression au droit d’auteur
Le droit d’auteur « à la française » se caractérise par la conception personnaliste et
romantique qui l’irrigue et le sous-tend notamment du fait de l’influence encore très forte de la
grande loi de 195782. De cette histoire résulte un régime juridique dont les règles sont élaborées,
appliquées et interprétées en contemplation de l’auteur lequel, figure de proue, est placé au
centre du dispositif qui lui est dédié. Ce régime de faveur connaît, pourtant, aujourd’hui un net
recul sous l’effet conjugué des logiques issues du copyright et de la révolution numérique.
Toutefois, la conception personnaliste continue de participer de l’idée, plutôt démentie en
l’espèce, que le droit d’auteur est un droit souverain ou presque. À cet égard, les principes
instaurés en droit interne sont, à l’origine, rétifs à ce qui leur est exorbitant : pour le Professeur
André Lucas, le principe de l’interprétation stricte des exceptions, par exemple, est « peu
favorable à l’admission de limites externes »83. Réticence textuelle à laquelle s’ajoute le refus
des juges du fond, bientôt corroborés par la Cour de cassation en aval, de consacrer de telles
limites.
À l’aube du 21è siècle, il était de jurisprudence constante84 de récuser « l’idée d’utiliser
la liberté d’expression […] pour fonder des limites au droit d’auteur autres que les exceptions
81 Pierre Sirinelli, op. cit., note 62, à la p 9. 82 Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, JO, 14 mars 1957, 2723. 83 André Lucas, op. cit., note 4, à la p 126. 84 Trib gr inst Paris, 6 novembre 2002 ; Trib gr inst Paris, 30 avril 2002 ; Trib gr inst Paris, 11 janvier 2002.

17
légales »85. Une position reprise par la doctrine pour laquelle « la messe, apparemment, est dite
en droit français »86.
La problématique s’était d’ailleurs posée de manière remarquable à l’occasion d’un
litige relatif à l’exposition du peintre Maurice Utrillo. « Pour la première fois, le danger […]
venait de la Convention européenne des droits de l’homme ! Pour la première fois, le droit
d’auteur était mis en cause […] au nom des droits de l’homme ! Le coup était aussi rude
qu’inattendu, car le droit d’auteur était attaqué sur son propre terrain : celui de la défense de la
culture »87. En l’espèce, un reportage consacré à l’exposition avait été réalisé puis diffusé. Les
images représentaient les tableaux de l’artiste sans que leur auteur ait recueilli, au préalable,
l’autorisation d’y procéder auprès des ayants-droit. En première instance, le défendeur fît valoir
le droit du public à l’information, exception externe au monopole dont il s’estimait
bénéficiaire88. Un argument qui, à la surprise générale, a été admis ; le tribunal de grande
instance de Paris jugeant, dans un raisonnement à étapes successives, que le droit du public à
l’information comprenait le droit de voir, que les images présentes dans un reportage participent
de l’information du public et, enfin, que soumettre la diffusion du reportage à autorisation aurait
pour conséquence directe de priver une fraction du public de son droit à l’information89. En
somme, il se fondait sur le syllogisme en vertu duquel « le droit de voir est nécessaire puisqu’il
fournit un élément de connaissance à un fait : or, le fait est, en l’occurrence, une exposition de
tableaux ; donc, montrer les tableaux est nécessaire »90. La décision a suscité l’ire de la doctrine
- d’aucuns n’hésitant pas à condamner le « mauvais usage des droits de l’homme »91 quand
d’autres pointaient « une menace pour le droit d’auteur »92.
La vindicte s’est apaisée quand la cour d’appel de Paris93 a infirmé la décision avant de
définitivement s’éteindre avec la confirmation de la Cour de cassation94. Il appert, en effet, de
85 André Lucas, op. cit., note 4, à la p 125. 86 Christophe Caron, « La Convention européenne des droits de l’homme et la communication des œuvres au
public : une menace pour le droit d’auteur ? » (1999) 1 Communication commerce électronique 9, à la p 9. 87 Bernard Edelman, « Du mauvaise usage des droits de l’homme (à propos du jugement du TGI de Paris du 23
février 1999) » (2000) 29 Recueil Dalloz Sirey 455, à la p 455. 88 Id., à la p 456 : L'article 10 de la Convention institue « un droit du public à l’information qui constitue une
exception aux dispositions figurant dans le code de la propriété intellectuelle ». 89 Trib gr inst Paris, 23 février 1999, Recueil Dalloz Sirey, à la p 580. 90 Bernard Edelman, op. cit., note 87, à la p 455. 91 Ibid. 92 Christophe Caron, op. cit., 33 93 CA Paris, 30 mai 2001. 94 Cass civ 1re, 13 novembre 2003 n° 01-14385.

18
l’arrêt rendu par cette dernière que « le monopole légal de l'auteur sur son œuvre est une
propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect
de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les
exceptions inscrites à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l'abus
notoire prévu à l'article L. 122-9 du même Code ». Elle poursuit en indiquant que la diffusion
des tableaux litigieux n’était pas indispensable à la réalisation du but d’information poursuivi
avant de conclure que « le moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'Homme s'avère, ainsi, inopérant ».
En refusant d’opposer l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
au droit d’auteur et en se remettant exclusivement aux exceptions consacrées légalement, la
Cour de Cassation confère sa pleine effectivité aux prérogatives des titulaires en leur
garantissant un champ d’application conséquent. Par-là, elle préserve les logiques qui lui sont
inhérentes et accorde sa primeur à un équilibre interne à la matière. Elle s’inscrit, à ce titre, dans
le prolongement de la jurisprudence antérieure qui jugeait que la liberté d’expression ne saurait
faire obstacle au droit d’auteur. Par la suite, elle réitèrera d’ailleurs sa position par le truchement
d’un arrêt rendu le 25 mai 200495 dans lequel elle écarte la possibilité pour un éditeur de presse
contrefacteur de se prévaloir de la liberté d’expression pour s’exonérer des faits qui lui sont
reprochés : « est irrecevable, car nouveau et mélangé de faits, le moyen tiré d'une
méconnaissance de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales par l'obstruction apportée à la liberté de l'éditeur de
promouvoir son propre magazine en reproduisant sa couverture, les conclusions d'appel,
limitées sur ce point à une affirmation générale et amalgamée d'atteintes à la liberté
d'expression, au principe de la liberté du commerce et au droit à l'information, étant exemptes
de tout raisonnement juridique précis de nature à influencer la solution du litige, notamment eu
égard au monopole d'exploitation de l'auteur de la photographie reproduite »96.
Ainsi, dans les premières années du nouveau siècle, le droit français résiste
farouchement aux quelques velléités tendant à l’immixtion en droit d’auteur des droits
fondamentaux et de ce qu’ils véhiculent comme potentiels effets pervers pour la matière :
« Outre que leur contenu même et leur protection sont, en l'occurrence, incertains, les libertés
95 Cass civ 1re, 25 mai 2004, 01-17.805. 96 André Lucas, « Représentation contrefaisante d’une photographie sur les offres d’abonnement d’un magazine »
(2004) 46 La Semaine Juridique Édition Générale 10170.

19
ou droits fondamentaux ne peuvent pas justifier la violation des prérogatives des auteurs et de
leurs ayants droit […] Les prérogatives des auteurs sont des droits subjectifs bien délimités,
comportant des exceptions légales précises, dont l'économie ne devrait pas pouvoir être
bouleversée ou anéantie par l'invocation de libertés vagues et inconditionnées, que ces droits
ne remettent, d'ailleurs, pas véritablement en cause - sauf à ce que tout droit individuel, qu'il
s'agisse de droit de propriété ou de droits de la personnalité, soit considéré comme une atteinte
à la liberté d'autrui, ce qui n'a manifestement aucun sens dans un Etat de droit et représente
même la négation du système juridique »97. Pourtant, en dépit d’une volonté sans cesse
renouvelée de préserver l’équilibre initialement construit, des voix commencent à porter et
appellent de leurs vœux un recours aux droits fondamentaux. Un phénomène, prenant acte de
la relation conflictuelle entre droit du public à l’information et droit d’auteur, et qui présage
« l’avènement d’un conflit, véritable changement de paradigme »98.
2. Les prémisses de la mise en balance du droit d’auteur et de la liberté
d’expression
Très vite, la confrontation entre droit d’auteur et liberté d’expression s’installe et se
pérennise. Bicéphale, elle s’opère sur le double terrain conjugué des deux démembrements de
la liberté d’expression et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui
la consacre : le droit d’information au public (a) et la liberté de création (b).
a. Les prémisses d’une mise en balance discutable du droit du public à
l’information et du droit d’auteur
« Les tensions entre droit d’auteur et droit du public à l’information se sont
progressivement accentuées en raison principalement de deux facteurs : l’un est économique
[…] l’autre principalement technique »99. Le premier tient à l’émergence d’une économie de la
connaissance dont la ressource fondamentale revêt un caractère immatériel et, donc, en partie
insaisissable. Le second réside dans l’imperfection regrettable des mesures techniques,
97 Frédéric Pollaud-Dulian, « Droit à l’information. Droit de propriété. CEDH. Reproduction illicite », 2 (2008)
Revue Trimestrielle de Droit commercial 78. 98 Christophe Geiger, « Droit d’auteur et droit du public à l’information » (2005) Recueil Dalloz Sirey 104, à la p
112. 99 Ibid.

20
procédés inaptes à différencier utilisations légitimes et œuvres qui ne peuvent prétendre à
protection.
Parallèlement - et c’est là, possiblement, le facteur le plus déterminant - « l’extension
démesurée qu’a connu le droit d’auteur n’a pas été contrebalancée par l’extension du champ
des exceptions […] restées cantonnées dans des limites très étroites »100. En effet, pour
beaucoup le droit d’auteur est victime d’hypertrophie101 suite à l’introduction d’un nombre trop
conséquent d’œuvres protégeables au sein de son périmètre ; ce qui a pour effet,
réciproquement, de réduire la marge de manœuvre des tiers. En conséquence, « certains droits
nouveaux ont été créés au détriment des espaces de libertés accordés par la propriété
intellectuelle »102. Des droits, à l’image du droit du public à l’information, dont les mérites sont
vantés sans être idéalisés. Invoquer des règles externes au droit d’auteur n’étant la solution
idéale, il demeure préférable que ces problèmes soient réglés par le législateur. Or, le
législateur, enserré dans un lacis de contraintes et supposé partisan de l’immobilisme, n’est pas
en mesure de les solutionner. Dès lors, les droits fondamentaux apparaissent comme un moyen
privilégié pour assurer l’équilibre visé. S’ils présentent des risques d’abus et
d’instrumentalisation - leur formulation élargie et imprécise y est propice -, ils garantissent
souplesse et flexibilité103.
C’est pourquoi le droit du public à l’information tend à être invoqué de manière exponentielle
par les justiciables sans que l’on ne sache pertinemment ce qu’il recouvre réellement. Les
fondements sur lesquels il repose sont incertains, à l’image de l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme qui évoque exclusivement une liberté et non un droit.
Classiquement, il demeure le « droit pour tout un chacun d’utiliser librement une information,
d’exercer pleinement une liberté »104. Appliqué au droit d’auteur - ce qui implique au préalable
de concevoir l’œuvre dans sa dimension informationnelle-, il se définit comme le « droit
d’obtenir des informations sur l’œuvre protégée par le droit d’auteur, le droit d’être informé sur
l’œuvre et son contenu »105.
100 Id, à la p 114. 101 Alexandra Bensamoun, « La protection de l’œuvre de l’esprit par le droit d’auteur : “qui trop embrasse mal
étreint” », (2010) Recueil Dalloz Sirey 2919. 102 Christophe Geiger, op.cit., note 98, à la p 112. 103 Id., à la p 120. 104 Id., à la p 104. 105 Id., à la p 105.

21
Pour rappel, le droit du public à l’information avait été admis en première instance dans
l’affaire Utrillo avant que la cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation ne viennent le
neutraliser en refusant d’en faire une limite externe au droit d’auteur. Ici, la Cour de cassation
ne se livre pas à une mise en balance du droit d’auteur et du droit du public à l’information.
Mieux, elle fait en sorte de l’écarter. Sur ce point, la décision Onze Mondial106 marque un
tournant en tant qu’elle réalise une articulation - en lieu et place du traditionnel syllogisme -
entre les deux droits qui, certes, penchera en faveur du droit d’auteur.
En l’espèce, un magazine avait représenté, alors que dépourvu d’autorisation, le trophée de la
coupe du monde de football, œuvre protégée. Pour s’exonérer de l’acte de contrefaçon
justement allégué, le défendeur arguait que la publication était justifiée par l’actualité et
concourait au droit du public à l’information. La Cour de cassation institue alors un avatar de
la balance des intérêts en énonçant que « le droit à l'information du public consacré par l'article
10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve
ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés ; qu'il en est ainsi des droits
de propriété intellectuelle, biens au sens de l'article 1 du 1 Protocole additionnel ». Jugeant que
la reproduction du trophée excédait la couverture de l’événement et ne participait pas à
l’information du public, la Cour affirme que ladite reproduction « relevait de l’exploitation de
l’œuvre » et, à ce titre, constituait une contrefaçon en l’absence d’autorisation.
La Cour indique en filigrane que les droits et libertés reconnus par l’article de la Convention
européenne ne sont pas supérieurs au droit d’auteur dans la hiérarchie des normes lorsqu’elle
affirme que le droit du public à l’information ne saurait autoriser des reproductions illicites
d’œuvres de l’esprit107. L’exercice du droit du public à l’information se retrouve conditionné
par le respect du droit d’auteur.
La décision s’inscrit dans l’orbite d’une jurisprudence désormais bien établie laquelle, après
mise en perspective des intérêts - et non contrôle de proportionnalité -, fait primer le droit
d’auteur. Dans deux décisions rendues le 1 mars 2005108, la « Cour de cassation écarte, une
nouvelle fois et à juste raison, les arguments fallacieux que les pourvoies prétendaient trouver
dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ou plus généralement
106 Cass civ 1re, 2 octobre 2007, 05-14.928. 107 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 97. 108 Cass civ 1re, 1 mars 2005, 02-17.391 ; Cass civ 1re, 1 mars 2005, 02-17.393.

22
dans le respect des libertés fondamentales »109 en énonçant que « le respect des droits des
auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre
transmission des messages télévisés diffusés par satellites ». Par la suite, le 7 mars 2006, elle
estimait que « le respect dû aux auteurs dans la reproduction de leurs œuvres, tel qu’aménagé
par la législation française, ne constitue pas une entrave au droit du public à l’information » 110.
Un seul élément discordant semble trancher avec le flot univoque des décisions rendues.
Il s’agit de la censure, par le Conseil constitutionnel, de la loi Hadopi 1111 sur la question des
échanges illicites de fichiers112. La loi, très controversée, investissait l’autorité administrative
du pouvoir exorbitant de prononcer des suspensions d’accès. Une disposition qui sera censurée
au motif que la liberté de communication ne saurait subir de potentielles limitations et
restrictions de la part d’une autorité administrative indépendante : « Ces pouvoirs pouvaient
donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de
communiquer librement […] le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant
le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de
protéger les titulaires du droit d'auteur ». Il appartenait, en effet, selon le Conseil, au juge
judiciaire, en tant que gardien des libertés individuelles, d’y procéder.
Par la présente décision, le Conseil constitutionnel retient ainsi le grief relatif à la
méconnaissance de la liberté d’expression. Outre qu’elle rapatrie l’utilisation d’Internet dans le
giron de la liberté de communication - qui implique désormais la liberté d’accès aux services
de communication en ligne - et, donc, de la liberté d’expression ; la décision concilie cette
dernière avec le droit d’auteur : le législateur est fondé à « édicter des règles de nature à
concilier la poursuite de l’objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur Internet avec
l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ». La
liberté d’expression semble d’ailleurs l’emporter sur l’objectif assigné de protection des
œuvres, en témoigne l’importance toute particulière qui lui est accordée : « la liberté
d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une
109 Frédéric Pollaud-Dulian, « Droit de représentation. Retransmission par câble d’une télédiffusion d’œuvres par
satellite. Installation d’une antenne parabolique collective. Public distinct. Articles L. 122-2 et 132-20 du CPI.
Libertés de communication ou de réception des programmes satellitaires » (2005) 2 Revue Trimestrielle de Droit
commercial 302. 110 Cass civ 1re, 7 mars 2006, 03-18.360. 111 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, JO, 13 juin
2009, 0135. 112 Cons constitutionnel, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, 2009-
580 DC.

23
condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ». Et
pour cause, « la conciliation ne veut pas dire que le Conseil peut les renvoyer dos à dos et il
devait trancher, soit dans le sens de la loi qui souhaitait privilégier la protection du droit
d’auteur, soit en faveur de la liberté de communication entendue de manière extensive. C’est
cette deuxième branche de l’alternative qui a été choisie par le Conseil »113. Or, l’utilisation
abusive ou frauduleuse des réseaux est de nature à priver les auteurs quels qu’ils soient, de cette
protection114.
À rebours de la Cour de cassation qui se refuse encore à exercer un contrôle de
proportionnalité, le Conseil constitutionnel y procède dans cette décision après l’avoir institué
un peu plus tôt dans sa jurisprudence115. Avant que celui-ci ne soit généralisé à l’ensemble des
juridictions citées, la première chambre civile a semblé s’acheminer dans une telle direction au
sujet, non pas du droit du public à l’information ou de la liberté de communication, mais de la
liberté de création (b).
b. La mise en balance de la liberté de création et du droit d’auteur cantonnée à un
cas précis
Il apparaît manifeste que le droit d’auteur et, plus précisément, le droit moral peut entrer
en collision avec la liberté de création. Ce droit, attaché à la personne de l’auteur de manière
perpétuelle, impose des limites à l’auteur d’une œuvre dérivée dans sa liberté de création. Au-
delà de l’auteur second, le droit exclusif a pour effet de faire « disparaître la liberté de tous
autres que l’auteur d’utiliser l’œuvre »116. Cette physionomie au sein de laquelle la liberté de
création est subordonnée au respect du droit moral a naturellement donné lieu à conflit et a
incité la Cour à procéder à une mise en balance préfigurant, a posteriori, le contrôle de
proportionnalité qui suivra.
Les Misérables, l’œuvre de Hugo, figure au panthéon de la littérature française. Alors
quand une prétendue suite a été donnée à ce monument national - deux romans intitulés Cosette
113 Michel Verpeaux, « La liberté de communication avant tout. La censure de la loi Hadopi 1 par le Conseil
constitutionnel » (2009) 39 La Semaine Juridique Edition Générale 274. 114 Ibid. 115 Cons constitutionnel, 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental, 2008-562 DC. 116 Dany Cohen, « La liberté de créer » dans Rémy Cabrillac, op. cit., note 36, à la p. 326.

24
ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif se revendiquaient comme tels -, l’ayant-droit de
l’auteur originel a saisi la justice, invoquant la violation du droit au respect de l’œuvre de Hugo.
La plainte, déclarée irrecevable en première instance117, a finalement été admise en appel :
« aucune suite ne saurait être donnée à une œuvre telle que Les Misérables, à jamais achevée,
et que, la Société Plon a, en éditant et publiant Cosette ou Le temps des illusions et Marius le
fugitif et en les faisant passer pour la suite des Misérables, porté atteinte au droit moral de Victor
Hugo sur cette œuvre littéraire »118. Les juges font donc fi de la liberté de création reconnue
aux auteurs d’œuvres dérivées, préférant se livrer à une analyse fondée sur le mérite et le genre,
tous deux indifférents en droit d’auteur. Cela leur sera reproché par la Haute juridiction119 qui,
au visa des articles L. 121-1 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, casse l’arrêt de la cour d’appel
qui « n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au droit moral et s’est déterminée en méconnaissance
de la liberté de création ». Elle énonce, dans une formule de principe, « que la suite d’une œuvre
littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à
l’intégrité de l’œuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l’œuvre ou
ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation
dont ils ont bénéficié ». Par-là, la Cour tend à souligner que « l’arbitrage entre droit
d’auteur et liberté de création artistique doit être différent selon que l’utilisation est faite avant
et après l’expiration du monopole »120.
Avant l’expiration du monopole et en l’absence d’autorisation, l’auteur d’une œuvre seconde
doit être en mesure de se prévaloir d’une exception, à l’image de la citation ou de la parodie,
ou, nous le verrons, de faire appel aux droits fondamentaux. À l’extinction des prérogatives
patrimoniales, la liberté de création offre à l’auteur la possibilité de donner une suite à une
œuvre préexistante à condition de respecter le droit moral de son auteur, celui-ci revêtant un
caractère perpétuel. Hors du champ du monopole, la libre utilisation devient le principe et le
droit d’auteur se mue en exception121. Pour le professeur Frédéric Pollaud-Dulian, il s’agit de
la « première fois qu’on fait prévaloir une liberté sur le droit d'auteur, alors que, jusqu'ici, la
Cour de cassation avait fermement écarté les moyens tirés des droits reconnus par la Convention
117 Trib gr inst Paris, 12 septembre 2001. 118 CA Paris, 31 mars 2004. 119 Cass civ 1re 30 janvier 2007, n° 04-15543. 120 Christophe Geiger, « Droit d’auteur et liberté de création artistique : un fragile équilibre » (2007) 26 Revue
Lamy Droit de l’Immatériel 59. 121 Ibid.

25
européenne de sauvegarde des droits de l’homme contre les dispositions du code de la propriété
intellectuelle »122. Il dénonce, notamment, que la liberté d’adaptation soit uniquement conçue à
travers le prisme des droits patrimoniaux et de leur extinction alors que l’adaptation d’œuvre
suppose indubitablement l’altération plus ou moins profonde de celle-ci. Une altération qui
s’évalue et s’apprécie à l’aune du droit moral mis en cause précisément par l’adaptation
litigieuse - une œuvre tombée dans le domaine public, fonds commun dans lequel chacun peut
se servir -, ne nécessite pas d’autorisation pour être reprise. D’autant que Hugo avait fait part
de sa volonté qu’aucune suite ne soit apportée à son œuvre. « Décider le contraire revient à nier
le sens même du droit moral et à faire comme si l'adaptation ou la suite était un acte neutre vis-
à-vis de l'œuvre originelle »123. Il poursuit en ces termes : « La liberté de création justifie que
chacun puisse créer librement ses propres œuvres à partir de son propre fonds et du fonds
commun, mais pas que l'on puisse utiliser une œuvre - même tombée dans le domaine public -
contre la volonté de son auteur. Or, l'attendu précité dit bien que la liberté de création s'oppose
à ce que l'auteur ou ses héritiers interdisent qu'une suite soit donnée à l'œuvre »124.
Toutefois, encore est-il pertinent de mentionner que l’arrêt consacre la liberté de création sous
réserve du droit à l’intégrité de l’œuvre et du droit de paternité. En conséquence, une atteinte
au droit moral sera toujours susceptible d’être caractérisée dès lors que l’œuvre seconde
méconnaîtrait l’œuvre première, dans sa forme ou dans son esprit. Dans une perspective
identique, celle de la protection et la sauvegarde d’un droit moral fort, la Cour reconnaît
d’ailleurs la faculté à un cohéritier d’agir seul pour défendre son droit moral. Celle-ci a, en effet,
davantage « voulu réaffirmer le domaine public et veiller à ce que le droit moral n'entraîne pas
insidieusement de facto la reconstitution des monopoles »125. À rebours des droits
patrimoniaux, le droit moral s’affirme comme un droit de défense en dépit du fait qu’il
s’émousse avec le temps. Ce pourquoi la Cour intime aux juges du fond d’apprécier l’existence
d’une dénaturation. En somme, « entre le droit moral de l’auteur de l’œuvre adaptée et la liberté
de création de l’adaptateur, c’est ce dernier qui doit triompher, faute de preuve d’une atteinte
effective »126.
122 Frédéric Pollaud-Dulian, « Droit moral post mortem. Adaptation. Suite d’une œuvre tombée dans le domaine
public. Liberté de création. Dévolution successorale. Intervention d’organismes professionnels » (2007) 3 Revue
Trimestrielle de Droit Commercial 354. 123 Ibid. 124 Ibid. 125 Christophe Caron, « La publication d’une “suite” d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public ne peut
être interdite en son principe » (2007) 7 La Semaine Juridique Édition Générale II 10025. 126 Pierre-Yves Gautier, op. cit., note 22, à la p 341.

26
Surtout, l’arrêt postule l’introduction du contrôle de proportionnalité en droit interne et
intègre les logiques propres aux droits fondamentaux. L’invocation de l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme en est le principal révélateur. À tel point que
pour le professeur Bruguière, « si le principe de proportionnalité n’est pas expressément présent
dans le fameux arrêt Les Misérables, le contrôle opéré par le juge s’en rapproche fortement »127.
Un principe de proportionnalité, sous-jacent, voire « souterrain128, qui s’exprime à travers le
cadre du contrôle. La conception européenne du contrôle de proportionnalité aurait voulu que
le juge apprécie la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée par le droit moral à la
liberté de création. Ce que semble requérir la Cour de cassation en déplorant l’absence
d’examen circonstancié des œuvres pour apprécier l’existence d’une dénaturation.
Rétrospectivement, il apparaît que « c’est exactement le raisonnement qui est suivi par la Cour
de cassation dans l'arrêt Klasen et pour Les Misérables […] il fallait expliquer concrètement en
quoi ce principe devait au final s’imposer »129.
Aussi, les droits fondamentaux trouvent désormais leur application en droit d’auteur. L’arrêt
procède à un recentrage du droit d’auteur et témoigne de la volonté démontrée par la Cour de
cassation de pallier certaines déviances, conduisant à une surprotection du droit d’auteur130
laquelle est identifiée comme un des causes de son déclin. En cela, la jurisprudence Les
Misérables se situe aux antipodes de la conception que défendait et prônait la Haute juridiction
auparavant131. Désormais, le droit moral est strictement encadré son exercice, notamment
lorsqu’il s’opère à titre post mortem en conformité avec l’idée selon laquelle « si le droit
d’auteur permet en principe au créateur de tirer profit de ses œuvres et de vivre de son art,
un droit d’auteur trop étendu ou manié sans nuances peut l’empêcher de créer »132.
Signe avant-coureur, cet arrêt s’apparente tout autant à un point de non-retour. La Cour
met, en effet, « le doigt dans un engrenage qu’elle avait évité jusque-là »133 en incitant, à
l’avenir, les justiciables à invoquer les droits fondamentaux afin de neutraliser l’application des
127 Jean-Michel Bruguière, « L’absence d’examen circonstancié déjà dans l’arrêt Les Misérables », (2016) 39
Jurisart 22. 128 Ibid. 129 Ibid. 130 Christophe Geiger, op. cit., note 120. 131 Cass civ 1re, 5 décembre 2006, 05-11.789 : « Toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une
œuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ». 132 Christophe Geiger, op.cit., note 120. 133 Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit., note 122.

27
dispositions d’ordre public du Code de la propriété intellectuelle. Une tendance, aisément
vérifiable, qui a pour point de convergence un outil : le contrôle de proportionnalité (B).
B. L’introduction définitive du contrôle de proportionnalité, un changement de
paradigme évident dans la dialectique entre droit d’auteur et liberté d’expression
Le contrôle de proportionnalité a fait une entrée remarquée en droit interne. Le
mécanisme, en effet, est sujet à caution dans la mesure où il bouleverse les fondements sur
lesquels reposait le droit d’auteur (1) en leur supplantant une nouvelle articulation. Celle-ci,
porteuse de changement, se caractérise par la mise en balance, cette fois-ci ostentatoire, des
droits fondamentaux au rang desquels reviennent, évidemment, le droit d’auteur et la liberté
d’expression à l’aune du principe de proportionnalité (2).
1. L’immixtion en droit interne d’une méthode de raisonnement
supposément aux antipodes des logiques du droit d’auteur
Le contrôle de proportionnalité est éreinté tant en principe qu’en pratique. Son
introduction et sa systématisation, sous l’influence manifeste des cours européennes, ont suscité
une violente diatribe de la part de la doctrine (a). Les maux dont il serait la source sont, en effet,
nombreux : l’imprévisibilité et la subjectivité reviennent notamment comme leitmotiv (b).
Toutefois, sur fond de spectre fair use, des intérêts et avantages lui sont trouvés (c). Le contrôle
de proportionnalité ne devrait donc pas être condamné de manière si hâtive, d’autant que celui-
ci, probablement irrévocable, semble parti pour s’inscrire dans la durée.
a. Le contrôle de proportionnalité à l’étude : histoire récente, principe de fonctionnement et
modalités de mise en œuvre
Le contrôle de proportionnalité suscite des appréciations tranchées. « Loué ou honni,
force est de constater qu’il s’est imposé comme un raisonnement juridique de premier plan »134.
D’apparition récente en droit privé135 - encore inédit il y a peu en propriété intellectuelle et tout
particulièrement en droit d’auteur -, il fait partie de longue date du paysage juridique en droit
134 Arnaud Latil, « Contrôle de proportionnalité en droit d’auteur » (2016) 39 Jurisart 18. 135 Cass civ 1re, 4 décembre 2013, 12-26.066.

28
public136 et en droit européen. Au sein de ce dernier, il s’est développé sous l’impulsion des
deux cours, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union
européenne. Pour la première, il s’agit, notamment, d’apprécier la légitimité d’une ingérence
d’origine étatique dans l’exercice d’un droit fondamental garanti137. Ce faisant, elle se fonde
sur la Convention. La seconde, quant à elle, use du contrôle de proportionnalité afin de mesurer
la pertinence de l’atteinte à un droit de l’Union européenne commise par un État membre138.
« D'évidence, la Cour de cassation n'est plus la seule source juridictionnelle du droit d'auteur.
On assiste, en effet, depuis une dizaine d'années, dans ce domaine, à une remarquable montée
en puissance des Cours de Luxembourg et de Strasbourg »139. Ces dernières, en effet,
participent de l’harmonisation du droit par l’intermédiaire des réponses et solutions apportées
aux questions préjudicielles dont la masse ne cesse de croître. L’harmonisation ne saurait être
innocente et apparaît davantage comme finalisée. Elle répond à l’ambition de conférer sa pleine
effectivité à la fois à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme. En conséquence, le juge national est tenu de
lire le droit national à travers le prisme des droits fondamentaux140.
Mais, l’introduction du mécanisme de la proportionnalité en droit privé s’explique
majoritairement par l’horizontalisation dont il a fait l’objet. Invoqué désormais par des
personnes privées aussi bien que par des personnes publiques, il oblige le juge judiciaire à
examiner les ingérences faites aux droits fondamentaux dont sont titulaires les justiciables. Un
phénomène dont la conjonction avec le mouvement de fondamentalisation fait du contrôle de
proportionnalité un contrôle de conventionnalité des lois. En effet, l’essor des droits
fondamentaux a formé un « réservoir inépuisable de principes supérieurs à contenu variable qui
permettent au juge judiciaire de juger la règle de droit et de l’écarter en général ou dans tel cas
particulier »141. En cela, ils témoignent d’une « fécondité abrogatoire exceptionnelle »142.
136 Conseil d’État, 19 mai 1933, Benjamin. 137 Arnaud Latil, op. cit., note 134. 138 Ibid. 139 Alain Girardet. « Le rôle de la Cour de cassation dans les évolutions du droit d’auteur et des droits voisins »
(2017) 1 Communication Commerce Électronique 7. 140 Ibid. 141 Laurent Aynès « Moins de règles et plus de principes ? Le nouveau rôle du juge » (2017) 2 Revue de
Jurisprudence Commerciale 174, à la p 176. 142 Ibid.

29
La Cour de cassation a adopté le contrôle de proportionnalité selon les vœux de son
président, Bernard Louvel sensible à la jurisprudence rendue par les cours européennes143.
Depuis un certain temps, la Haute juridiction s’interrogeait sur les structures et les méthodes de
raisonnement exposées dans les arrêts afin de déterminer si celles-ci devaient réexaminées144
avant d’être importées aux juges du fond. On ne peut, effectivement, avoir une Cour de
cassation avec une méthode particulière et des juges du fond qui en appliquent une différente
ou opposée145. À cet égard, le souhait d’inscrire le contrôle de proportionnalité dans les
« techniques classiques » de la cassation est évident146. Il résulte de la lassitude qu’éprouve la
Cour à voir ses décisions infirmées au niveau européen. Désormais, « elle doit se moderniser,
se démocratiser, s'adapter aux modes de raisonnement européens en matière de droits
fondamentaux si elle ne veut pas subir un ostracisme »147. Parallèlement, les cours européennes
ont intérêt à déléguer le contrôle aux juridictions internes dans la continuité de la marge
nationale d’appréciation qu’elles leur reconnaissaient et qui suppose, pour ce faire, un cadre
étatique. En effet, le juge interne bénéficie, plus que quiconque, d’un accès direct au droit de
son pays.
Le contrôle de proportionnalité se substitue au syllogisme juridique, méthode utilisée par la
Cour de cassation depuis sa création et la refonte des juridictions du fond qui a pour objet
l’application de la norme juridique générale à une situation factuelle donnée. À cet égard, le
syllogisme « atteste de la prééminence de la règle de droit et fait du jugement une réalisation
concrète de celle-ci »148. Mais, cette « gymnastique intellectuelle […] se heurte à de nouvelles
méthodes, en provenance des cours européennes »149 directement influencées par les pratiques
issues de la common law. Parmi celles-ci, on compte l’absence d’obligation de se référer à un
texté écrit, le caractère profondément individuel des droits, le refus de l’application mécanique
du droit et, surtout, le fait que le juge détermine la solution qu’il estime la plus juste après avoir
soupesé les intérêts respectifs des parties. Réciproquement, le contrôle de proportionnalité se
situe aux antipodes de la tradition romaniste qui prévaut dans les pays civilistes, « tradition qui
ne conçoit de rapport entre droit commun et règles propres que sous la forme d'une application
143 Bertrand Louvel, « Réflexions à la Cour de cassation » (2015) Recueil Dalloz Sirey 1326. 144 Pierre-Yves Gautier et Alice Pézard, op.cit., note 54, à la p 6. 145 Ibid. 146 Hugues Fulchiron. « Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode » (2017) 12 Recueil Dalloz Sirey
656. 147 Pascal Puig, « L’excès de proportionnalité » 1 (2016) Revue Trimestrielle de Droit Civil 70. 148 Laurent Aynès, op. cit., note 141, à la p 175. 149 Pierre-Yves Gautier et Alice Pézard, op. cit., à la p 7.

30
ou d'une dérogation »150. Pour autant, cette affirmation mérite d’être nuancée quand l’on sait
que l’attachement au syllogisme juridique est plus prégnant dans l’imaginaire collectif que dans
la réalité. Le Professeur Hugues Fulchiron insiste d’ailleurs sur le « caractère largement
mythique de celui-ci »151. Selon lui, le contrôle de proportionnalité emprunte d’ailleurs
certaines logiques propres au raisonnement syllogistique dans la mesure où le juge s’interroge
sur la règle applicable puis sur celle contestée. En cela, il est produit de « l’hybridation des
familles de droits »152.
Cette évolution sur la forme va de pair avec de profonds bouleversements sur le fond
(la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle entend
lui octroyer de nouveaux pouvoirs). Ils ont pour point de convergence les fonctions de la Cour
de cassation qui tendent progressivement à évoluer. « La Cour de cassation est en train de se
transformer d'elle-même en une institution de pleine juridiction sur le modèle des cours
européennes » alors qu’elle est à l’origine « une institution au service du pouvoir législatif,
chargée de contrôler et d’unifier l’application par les juges de la règle de droit »153. La
juridictionnalisation de la Cour repose sur un contrôle renforcé des arrêts rendus qui, désormais,
comprend le contrôle des qualifications données et, celui des faits mis de côté par les juges du
fond afin d’écarter la règle applicable et, enfin, l’examen de la motivation. Elle réside également
dans le choix opéré d’une motivation plus étoffée, rendue indispensable par l’appréhension des
faits, au moyen de l’extension des motifs. Pluridisciplinaire, elle renseignerait sur les
conséquences de la solution adoptée. La nouvelle manière de juger induit naturellement une
nouvelle matière de motiver dans un rapport de causalité souhaité154. Et pour cause,
« l'imperatoria brevitas, forme attachée au langage de la loi, n'est plus adaptée dès lors que la
Cour de cassation ne se considère plus comme la sentinelle des lois mais comme une
juridiction »155. Toutefois, pour l’heure, la structure classique des arrêts est préservée156.
150 Frédéric Zenati-Castaing, « La juridictionnalisation de la Cour de cassation » 3 (2016) Revue Trimestrielle de
Droit Civil 511. 151 Hugues Fulchiron, op. cit., note 146. 152 Frédéric Zenati-Castaing, op. cit., note 150. 153 Frédéric Zenati-Castaing, op. cit., note 150. 154 Ibid. 155 Ibid. 156 Hugues Fulchiron, op. cit., note 146 : « À l'évidence, la Cour ne souhaite pas remettre en cause la construction
traditionnelle de ses arrêts : le contrôle de proportionnalité est enchâssé dans la structure classique des décisions
de rejet comme des décisions de cassation ».

31
La modification constatée apparaît comme « l'aboutissement d'un long processus rampant qui
s'est amorcé dès le XIXe siècle. Ce processus s'est accéléré depuis quelques décennies sous
l'influence d'un mouvement d'acculturation, mouvement qui a pour effet d'éroder la spécificité
de la cassation »157. Il porte un nom, celui de la réforme de la Cour de cassation. Qu’abrite-elle
réellement ? Le projet de réforme a pour vocation de métamorphoser la Cour de cassation en
un avatar de « Cour européenne des droits de l’homme de dimension nationale pour préserver
ou reconquérir sa souveraineté »158 laquelle est mise en péril. Cette aspiration se révèle difficile
à atteindre tant les obstacles qu’elle sera vouée à rencontrer sont nombreux. Pour ce faire, il
conviendra, de toute évidence, de dépasser la dichotomie de principe, vite devenue poreuse,
entre le droit et les faits. « L'instrument principal de cette révolution est une pratique
volontariste du contrôle européen de proportionnalité, contrôle qui oblige la Cour de cassation
à connaître des faits, brisant l'interdit qui fonde son institution […] En se convertissant à la
méthode de la proportionnalité, la Cour de cassation entend s'acculturer elle-même, c'est-à-dire
cesser d'être une Cour de cassation pour devenir, comme les cours européennes, une
juridiction », celle des droits de l’homme159.
Aussi, le principe de proportionnalité, « méthode de conciliation des normes
européennes avec les normes nationales » élevé au rang de principal général de l’Union
européenne160, consiste à rechercher si les atteintes portées par ces dernières aux premières ne
présentent pas de caractère disproportionné et si l’objectif poursuivi ne pouvait être atteint à
moindre coût. Le contrôle, quant à lui, consiste dans la mise en balance de deux droits afin de
déterminer dans quelles mesures l’un prime sur l’autre161. Fondé sur une appréciation in
concreto, il privilégie la casuistique et se caractérise, en ce sens, par sa nature
« hypercontextualisée »162. En cela, il oblige à intégrer des faits, de nature sociale, au cœur du
raisonnement juridique163. Leur introduction au sein du raisonnement appartient exclusivement
au juge qui décide arbitrairement de les insérer ou de les récuser. Au terme de la mise en
balance, un juste équilibre entre les intérêts concurrents - forme de compromis le mieux adapté
à la réalité concrète du litige - doit être atteint. Une fois appliqué à l’opposition entre droit
157 Frédéric Zenati-Castaing, op. cit., note 150. 158 Ibid. 159 Ibid. 160 Ibid. 161 Arnaud Latil, op. cit., note 134. 162 Ibid. 163 Ibid.

32
d’auteur et liberté d’expression, il s’agit de préserver la liberté d’expression des tiers extérieurs
au monopole tout en sauvegardant le droit de propriété de son titulaire.
En pratique, le contrôle de proportionnalité apparaît comme un test en deux étapes qui
comporte, en premier lieu, un examen de l’opportunité de la restriction et, ensuite, l’examen
des modalités de ladite restriction164. En d’autres termes, sont à déterminer la nature du droit
potentiellement violé par l’application de la règle de droit, la réalité de l’atteinte et son caractère
excessif en contemplation des droits et intérêts en cause165. À ce titre, le droit en question doit
nécessairement revêtir une nature fondamentale en l’absence de laquelle le contrôle de
proportionnalité se convertirait en appréciation en équité. Mais encore, il est impératif de
l’isoler : le droit du public à l’information, démembrement de la liberté d’expression, doit être
invoqué comme tel et rattaché aux textes qui le consacrent. Enfin, l’appréciation du caractère
excessif de l’atteinte par rapport au but légitime poursuivi n’est autre que l’élément le plus
caractéristique du contrôle de proportionnalité. Ici, s’exerce la pondération entre les droits en
présence au regard de l’ensemble des faits de l’espèce.
L’exercice du contrôle de proportionnalité requière la participation des juges du fond comme
de la Cour de cassation et suppose une certaine synergie dans la répartition des rôles : « L'avenir
du contrôle de proportionnalité se joue en grande partie dans l'équilibre entre la mission
reconnue aux juges du fond de garantir le respect des droits et libertés individuels, au risque
d'interprétations et de pratiques divergentes, et la fonction unificatrice de la Cour de cassation ».
Au contrôle succède le contrôle du contrôle lequel est exercé par la Haute juridiction sur la mise
en œuvre du contrôle par les juges de première et seconde instances »166. S’il ne fait guère de
doute qu’il porte sur la qualification des faits par le juge du fond, son intensité véritable fait
question. Pour la doctrine, il consisterait à apprécier si le contrôle de proportionnalité a été
effectué par les juges, avec effectivité - ce qui implique la pesée réelle des intérêts -,
correctement et justement167. Cette superposition des contrôles confine à la redondance.
D’autant que la Cour de cassation sera inévitablement conduite à procéder de nouveau à la mise
en balance des droits, tâche qui ne lui appartient pas sous peine de remettre définitivement en
cause la logique préexistante. Le choix de cette méthode par la Cour se justifie, en revanche, en
164 Olivier Bailly, « Proportionnalité : vers un nouvel office du juge ? » (2016) 7 La Semaine Juridique Édition
Générale 333. 165 Hugues Fulchiron, op. cit., note 146. 166 Ibid. 167 Ibid.

33
tant qu’elle représente le moyen privilégié pour opérer sa mue. Juridiction suprême, au service
des libertés individuelles face à la menace du législateur168, elle ne s’en tiendra pas à dire le
droit mais s’appliquera à le faire. La mise en place d’un contrôle de proportionnalité a pour
corollaire l’abandon du contrôle de légalité et, donc, du système du pourvoi.
Ainsi, progressivement, la Cour de cassation édifie le régime du contrôle de
proportionnalité qui, en définitive, « n’est rien d’autre qu’un contrôle d’opportunité : il s’agit
de se demander si l’arbitrage politique opéré par la loi [..] est convenable, c’est-à-dire
normalement acceptable »169. Loin d’être figé, il a vocation à être réévalué. Il a, pourtant,
vocation à se maintenir : « La constance et la prudence de la Cour sur la forme (montrent le
soin qu'elle prend à inscrire le contrôle dans le cadre des techniques classiques de la cassation),
comme sur le fond (en témoigne son souci de laisser aux juges du fond une grande liberté
d'appréciation), prouvent en tout cas sa volonté d'imposer ce contrôle comme une dimension
naturelle, et si possible dépassionnée, du contrôle de conventionalité »170. Mais, la tendance
n’est pas à la normalisation et le contrôle de proportionnalité demeure un point d’achoppement
autour duquel se noue une tension permanente (b).
b. Les écueils inhérents à la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité
« L'axe central de cet aggiornamento est la promotion du principe de proportionnalité,
une nouvelle idole qui détrône celle de la loi »171. S’il est prématuré pour pérenniser ou abolir
le principe de proportionnalité - en raison d’un manque de recul évident -, celui-ci, et le
mécanisme qui le met en œuvre, suscitent de nombreux questionnements. D’autant qu’il s’érige
en instrument de la réforme de la Cour de cassation. Les maux, dérives et excès qui lui sont
reprochés pullulent. En premier lieu, le contrôle de proportionnalité aurait pour conséquence
de « remettre en cause les équilibres législatifs abstraits »172, supplantés « au profit d’équilibres
fondés sur les droits fondamentaux »173. Des équilibres où conciliation devient rapidement
synonyme de hiérarchisation créant, de fait, des droits fondamentaux de premier et de second
plans. De ce fait, le contrôle de proportionnalité serait porteur d’imprévisibilité juridique, elle-
168 Laurent Aynès, op. cit., note 141, à la p 177. 169 François Chénedé, « Petite leçon de réalisme juridique » (2017) 4 Recueil Dalloz Sirey 663. 170 Hugues Fulchiron, op. cit., note 147. 171 Frédéric Zenati-Castaing, op. cit., note 150. 172 Arnaud Latil, op. cit., note 134. 173 Ibid.

34
même cause d’insécurité juridique, par le renforcement de la subjectivité des juges qui amorce,
par ailleurs, la résurgence du spectre de l’arbitraire.
Pour Montesquieu, « si les tribunaux ne doivent point être fixes, les jugements doivent
l’être à un tel point, qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étaient une opinion
particulière du juge, on vivrait dans la société, sans avoir précisément les engagements que l’on
y contracte »174. Cette conception qui a longtemps prévalu en droit français et qui fait du juge
« la bouche de la loi » est battue en brèche par l’introduction du contrôle de proportionnalité et
la démarche casuistique afférente. La loi nationale, en effet, peut voir son application écartée
au motif qu’elle entraîne une ingérence injustifiée aux droits et libertés reconnus aux individus.
« Le particularisme des données factuelles peut donc, à lui seul, justifier la paralysie de la règle
de droit si le juge estime excessive l'atteinte portée à un droit fondamental »175. À cet égard,
l’intensification du contrôle de proportionnalité est « légicide »176. S’il ne s’agit évidemment
pas d’abroger la loi dans la mesure où la disproportion qui lui est reprochée n’intervient que
dans une situation donnée, son éviction localisée affecte lourdement sa vigueur et sa
légitimité177. La loi en ressort inexorablement dévalorisée et tend à devenir facultative, comme
un instrument parmi d'autres à la disposition du juge, un simple poids à poser dans la balance
des intérêts178. Le juge, autrefois inféodé à la norme législative, s’en affranchit et dicte, de
manière circonstanciée, son application. « Quelle est la règle ? Le juge vous le dira »179. S’en
suit une inversion des rapports manifeste : « la règle de droit est sommé s’expliquer et de se
justifier »180. Toute cette démarche implique une redéfinition du rôle du juge. Et pour cause,
celui-ci s’érige en défenseur des droits individuels contre la machine étatique de production de
la norme181. Aussi, se manifeste avec acuité le risque que le principe de proportionnalité
permette au juge de se prononcer en équité.
Quid, dès lors, de la prévisibilité de la règle, gage de sécurité juridique ? Aucune garantie
d’application ne pourra désormais accompagnée la règle invoquée par les justiciables. S’en suit
un processus de fragmentation de la règle de droit. « La généralité de la règle cède le pas à une
174 Montesquieu, De l’Esprit des lois, Flammarion, 1993, « De la constitution d’Angleterre » (Livre XI). 175 Pascal Puig, op. cit., note 146. 176 Frédéric Zenati-Castaing, op. cit., note 150. 177 Ibid. 178 Pascal Puig, op. cit., note 146. 179 Philippe Conte, « Le droit n’est plus le tennis » (2016) 52 La Semaine Juridique Édition Générale 2409. 180 Laurent Aynès, op. cit., note 141, à la p 177. 181 Id. à la p 9.

35
application casuistique, tantôt autorisée, tantôt refusée, en fonction d'une balance des intérêts
dont personne ne peut à l'avance prévoir l'inclinaison »182. L’application erratique de la loi
dessine un droit à géométrie variable. Potentiellement, tout acte illicite pourrait devenir licite.
Dans cette hypothèse, le contrôle apparaît contraire aux principes promulgués par la Convention
européenne des droits de l’homme qui garantit « l'espérance légitime de tout citoyen de voir la
loi s'appliquer dans les termes voulus par le législateur »183.
En réalité, le contrôle de proportionnalité s’éloigne des contrées du droit pour mieux embrasser
les faits - ceux mis en exergue par les juridictions inférieures184 - et les intégrer au raisonnement.
En cela, il est un outil de dépassement de la dichotomie entre droit et fait, matrice d’origine de
la Cour de cassation185. À cette fin, la Cour se fonde sur les exceptions au principe de séparation
du fait et du droit parmi lesquelles on compte, notamment, la mise en œuvre du contrôle de
proportionnalité186. En conséquence, le contrôle de proportionnalité « érige non seulement les
faits contre le droit, l'intérêt individuel contre la règle générale, mais également le juge contre
la loi »187.
Enfin, toutes ces sources d’inquiétudes sont exacerbées par le caractère général du contrôle de
proportionnalité et l’amplitude des droits fondamentaux sur lesquels il se fonde. Ceux-ci sont
omniprésents depuis leur privatisation de telle manière qu’il semble toujours envisageable de
rattacher la prétention d’un justiciable à un droit fondamental existant188. Cette donnée est de
nature inquiéter si l’on prend en considération que la Cour européenne des droits de l’homme
commande d’y recourir dans l’ensemble des litiges qui mettent aux prises les droits
fondamentaux et non dans des circonstances exceptionnelles.
En droit d’auteur, objet de notre étude, l’application du contrôle menace les logiques de
la matière. Cette « déconstruction des grands équilibres » résulte de « l’immixtion de la balance
des intérêts dans le raisonnement judiciaire [qui] a rompu avec la lecture traditionnelle du
182 Pascal Puig, op. cit., note 146. 183 Vincent Vigneau, « Libre propos d’un juge sur le contrôle de proportionnalité » (2017) 3 Recueil Dalloz Sirey
123. 184 Frédéric Zenati-Castaing, op. cit., note 150. « D'après les initiateurs de la réforme, la Cour de cassation n'ira
pas par elle-même chercher les faits dont elle a besoin pour procéder à son contrôle de proportionnalité ; elle
s'inspirera des faits relatés dans les arrêts ». 185 Ibid. 186 Bertrand Louvel, « Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses
modes de contrôle » (2015) 1122 La Semaine Juridique Édition Générale 1908. 187 Pascal Puig, op. cit., note 146. 188 Jean-Pierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l'homme, 5e éd., Dalloz, Paris, 2011.

36
rapport » entre droit d’auteur et liberté d’expression189. Nous reviendrons à l’aune des
développements jurisprudentiels récents. En attendant, il demeure le contrôle fait peser un
risque d’obsolescence sur des concepts phares de la matière, à l’image des exceptions. Cette
remise en cause est double : dans un premier temps, l’exception, pour être admise, doit
désormais être conforme au principe de proportionnalité ; de plus, la limite interne que constitue
l’exception est supplantée par une limite externe dictée par le contrôle190. Enfin, en tant qu’il
apprécie l’applicabilité de l’exception, le contrôle de proportionnalité fait sienne la fonction du
triple test. En cela, il apparaît redondant.
Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité nuit à l’intelligibilité des droits fondamentaux en ce
qu’il est susceptible d’entraîner des incompréhensions quant à leur nature véritable. Outre que
le contrôle promeut des droits à l’existence incertaine - le droit du public à l’information en
constitue une illustration des plus tangibles -, il se fonde sur le postulat, relayé par la Cour
européenne des droits de l’homme mais aussi le Conseil constitutionnel, en vertu duquel les
différents droits fondamentaux se situent sur un même pied d’égalité. Or, selon le professeur
Pierre-Yves Gautier, cette dernière assertion est sujette à caution, de surcroît quand il s’agit de
la liberté d’expression et de droits individuels (nous préférons l’expression à celle de droits
subjectifs, la qualification du droit d’auteur en droit subjectif faisant débat). Ce raisonnement
tend à concevoir une hiérarchie entre les droits fondamentaux, fondée sur la prise en compte de
leur différence de nature qui aurait des implications sur la manière de trancher le conflit191. « Le
droit subjectif reconnu par la Cité à une catégorie d'individus, pour préserver des prérogatives
particulières, prime, sauf preuve contraire, les libertés publiques accordées par principe à une
population entière »192. Une opinion qui emporte l’adhésion de certains commentateurs : « La
mise en balance d’un droit et d’une liberté ne va pas de soi […] les natures mêmes du droit et
de la liberté devraient rendre impossible toute balance, puisque le droit prime, par essence, sur
la liberté qui ne doit pouvoir s’exercer que dans les espaces laissés libres »193.
Le contrôle de proportionnalité reproduirait également les abus qui sont les siens à l’échelle du
droit d’auteur. La mise en balance serait susceptible, à terme, d’engendrer une « relativisation
189 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 11. 190 Arnaud Latil, op. cit., note 134. 191 Justine Lesueur, Conflits de droits, illustrations dans le champ des propriétés incorporelles, thèse, Presses
Univ. Aix-Marseille, 2009. 192 Pierre-Yves Gautier, « Contre la “balance des intérêts” : hiérarchie des droits fondamentaux », (2015) 38
Recueil Dalloz Sirey 2189. 193 Julie Groffe, op. cit., note 3 à la p 16.

37
générale des droits »194. Les titulaires, dépossédés a posteriori des prérogatives que le
législateur leur avait accordées, se trouveraient dans l’incapacité de faire valoir leurs droits. De
manière plus générale, la sécurité juridique se trouverait anéantie si les normes édictées étaient
susceptibles d’être remises en cause à chaque cas d’espèce195.
Ainsi, les perspectives que dévoilent le contrôle de proportionnalité sont source d’une
vive inquiétude. Vigoureusement contesté dans son principe comme dans sa mise en œuvre, il
est dépeint comme le dénominateur commun à de nombreux dysfonctionnements. Instrument
d’équilibre, il produirait en réalité l’effet inverse et contribuerait à la perte de repères du droit.
Pourtant, une appréciation excessivement catégorique et univoque ne saurait convenir au
contrôle de proportionnalité qui présente également des remèdes aux maux dont souffre le droit.
Ses thuriféraires en sont, en tout cas, intimement convaincus (c).
c. Les bienfaits supposés du contrôle de proportionnalité
Depuis plusieurs années, la loi est confrontée à son inéluctable déclin. Une situation
pour le moins paradoxale au regard de la multiplication des textes, véritable maelstrom
législatif. Pourtant, la profusion et l’abondance vont de pair avec un processus d’atomisation
qui entraîne diminution de leur qualité et ineffectivité. « Ces constats ne sont certes pas
nouveaux ni propres à la propriété intellectuelle mais ils s'y manifestent avec une particulière
acuité dans un temps où les tendances les plus opposées se rejoignent pour saper sans
justification un édifice juridique et culturel, qui s'est constitué dans un élan de deux siècles de
perfectionnement »196.
La dégénérescence législative s’expliquerait, tout d’abord, par la conception contemporaine de
la loi qui voit en elle un outil de changement social et économique, un vecteur de modernité.
Preuve en est à la lecture du Livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de la
connaissance197 publié par la Commission européenne et dans lequel est mentionné que « les
technologies ainsi que les pratiques sociales et culturelles remettent constamment en question
l’équilibre établi par la législation ». La loi est donc constamment amenée à évoluer sous peine
194 Arnaud Latil, op. cit., note 134. 195 Ibid. 196 Frédéric Pollaud-Dulian, « Quo vadis lex ? La législation française sur le droit d'auteur dans les affres de la
modernité » (2016) 4 Revue Trimestrielle de Droit Commercial 641. 197 Commission européenne, Livre Vert, Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance, 2008.

38
d’obsolescence. Cet impératif affecte sa qualité rédactionnelle tout comme les effets qu’elle est
censée déployer. De cette épreuve, la loi ne ressort pas indemne. Dévalorisée et entourée d’une
vaste nébuleuse en l’absence de lignes directrices clairement définies, elle présente, à regret, un
caractère insaisissable. De toute évidence, ces écueils sont de nature à justifier le recours aux
droits fondamentaux et à leur articulation. Le retrait de la loi a, ainsi, pour corollaire la montée
en puissance de la figure du juge qui, progressivement, s’en émancipe.
Au sein du droit d’auteur, la grande loi de 1957 est considérée unanimement comme un
miracle de concision et de clarté, qualité dont les textes actuels ne peuvent se revendiquer. À la
multiplication des dispositions s’ajoutent, en effet, des textes sibyllins et alambiqués198 à
l’image de la loi relative aux livres indisponibles qui ajoute pas moins de neuf articles dans la
partie législative du Code de la propriété intellectuelle199. La loi peut également apparaître
inutile200, cela par redondance - certaines dispositions sont pratiquement identiques à d’autres
préexistantes - mais aussi en raison de son caractère inopportun. Pour illustration, on peut
s’interroger quant à la portée normative de la disposition de la récente loi sur la création201 qui
déclare que « la création artistique est libre ». D’autant que celle-ci est garantie par
l’intermédiaire des droits fondamentaux. Dans cette hypothèse, redondance et superflu
s’unissent au point de ne faire qu’un. Enfin, la loi est pléthorique et tend à la surabondance.
Sous l’impulsion du législateur européen, les réformes se succèdent au rythme des
transpositions de directives. Sur ce point, « la stratification du droit d'auteur devient
remarquable, alors qu'il a longtemps vécu avec une loi brève et efficace : quatre-vingt-deux
articles tout compris dans la loi du 11 mars 1957, plus de quatre cents aujourd'hui »202.
En ce sens, la loi ne revêt plus les qualités qui lui étaient attribuées autrefois. Anciennement,
facteur inégalé de sécurité juridique, elle tend aujourd’hui à l’imprévisibilité. La déliquescence
de la loi est, à cet égard, responsable du déplacement du centre de gravité de la matière. Le
mouvement s’opère du législateur vers le juge, désormais admis à écarte la loi à souhait après
mise en œuvre d’outils tels que le triple test ou le contrôle de proportionnalité. La loi se révèle
inapte à endiguer le phénomène : si l’article 2 de la loi sur la création précise qu’elle « s’exerce
198 Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit., note 196. 199 Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle,
JO, 2 mars 2012, 0053. 200 Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit., note 196. 201 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, JO, 8
juillet 2016, 0158. 202 Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit., note 196.

39
dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première
partie du code de la propriété intellectuelle », il est permis de douter que cette disposition
précautionneuse rapatrie dans le giron de la loi ce qui lui a échappé203.
Fort de son pouvoir croissant, le juge s’est engouffré dans la brèche ouverte par la loi.
À ce titre, le contrôle de proportionnalité doit être nécessairement exercé par le juge « puisque
le législateur s’en décharge sur lui en distribuant généreusement des droits subjectifs dont il ne
peut garantir la pleine effectivité »204. Le législateur, en effet, promulgue des droits, à l’image
de la liberté de création, parfois incompatibles avec ceux qui les précèdent. « Leur combinaison
sociale impose inévitablement des concessions réciproques dont l’équilibre doit être apprécié
par le juge »205.
La défaillance du législateur oblige le recours aux droits fondamentaux et au contrôle de
proportionnalité lesquels « émancipent le juge » et « dépoussièrent les sources du droit »206. Le
mouvement de constitutionnalisation, aujourd’hui bien enraciné, leur accorde une place
significative après en avoir reconnu la primauté. Progressivement, les normes qui bénéficient
d’une assise supra-légale se substituent à celles inférieures en application de la hiérarchie des
normes. Le recours aux droits fondamentaux est puissamment secondé par la jurisprudence qui
en constitue le terrain d’élection au gré de leur invocation continue par les justiciables. Le
passage d’un droit d’essence légicentriste à un droit de nature fortement jurisprudentielle
conduit le juge à se saisir des normes de rang supérieur et à repenser ses méthodes de
raisonnement et motivations propres. Pour le juge, les droits fondamentaux constituent le
moyen privilégié de compléter ou de suppléer la loi interne dès lors qu’elle se révèle lacunaire
ou insuffisante.
Les droits fondamentaux témoignent intrinsèquement d’une véritable défiance à l’égard de la
loi et de la puissance étatique. « C'est le fait qu'ils puissent être opposés aux trois pouvoirs
203 Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit., note 196 : « On pourrait espérer que la réserve du droit d'auteur serve à calmer
les ardeurs de la Cour de cassation dans la promotion de la liberté des tiers contre le droit des auteurs mais cette
disposition, si vague, peut-elle arbitrer, de façon générale, le conflit que le droit d'auteur avait réglé par la loi et
que la Cour de cassation a voulu déplacer sur le terrain mouvant de l'examen de proportionnalité ou de la balance
des intérêts ? ». 204 Pascal Puig, op. cit., note 146. 205 Pascal Puig, op. cit., note 146. 206 Laure Marino, « Les droits fondamentaux émancipent le juge : l'exemple du droit d'auteur » (2010) 30 La
Semaine Juridique Édition Générale 1523.

40
constitués, particulièrement au pouvoir législatif (…) qui fonde leur spécificité irréductible »207.
En droit d’auteur, la reconnaissance du caractère fondamental du droit d’auteur a marqué une
étape décisive, celle du reflux de la loi : « Sous la double onction nationale et européenne, la
notion de droit fondamental est ainsi entrée au cœur même de la matière du droit d'auteur. Elle
fragilise inévitablement le pouvoir législatif, puisqu'elle peut lui être opposée »208.
En conséquence, les droits fondamentaux seraient facteurs d’adaptation et non
d’anarchie209 offrant au juge la marge de manœuvre nécessaire pour rendre « une justice plus
souple, plus adaptée aux cas d'espèce […] tout en favorisant son harmonisation dans les pays
de droits fondamentaux »210. Prenant en considération le fait que la conciliation des droits
fondamentaux en collision implique le recours au contrôle de proportionnalité, celui-ci
deviendrait un instrument incontournable rendu indispensable par les nombreux écueils qui
entachent le système de droit d’auteur. À ce stade, le prétendre relève encore de la gageure mais
le contrôle de proportionnalité serait garant de flexibilité face à l’orthodoxie et à la rectitude de
la loi mais aussi de légitimité face à sa dévalorisation. Remède à l’inflation législative par la
mise en balance des intérêts in casu qu’il introduit et opère, il apparaît, à certains égards, porteur
de solutions.
Après avoir mis en exergue les avantages et inconvénients allégués du contrôle de
proportionnalité, procédant ainsi nous-même à une balance des intérêts - dans les arts
cinématographiques, il s’agirait là d’une mise en abyme -, il convient, pour mieux les apprécier,
de s’intéresser à la balance des intérêts de manière isolée. Comment s’opère-t-elle lorsqu’elle
est chargée d’arbitrer le conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression ? S’exécute-elle de
façon similaire en droit français et en droit européen ? Quels sont les éléments pris en compte
pour la faire pencher d’un côté et non de l’autre (2) ?
207 Dominique Chagnollaud et Guillaume Drago, Dictionnaire des droits fondamentaux, Dalloz, Paris, 2006,
Avant-propos. 208 Laure Marino, op. cit., note 206. 209 Ibid. 210 Ibid.

41
2. La mise en balance du droit d’auteur et de la liberté d’expression à travers
le contrôle de proportionnalité
La jurisprudence européenne a été la première à mettre en œuvre une balance des
intérêts en droit de la propriété intellectuelle (a). Au gré des litiges, elle a donné lieu à une
opposition récurrente entre droit d’auteur et liberté d’expression. Récemment, la balance des
intérêts a été transposée en droit d’auteur français au moyen d’arrêts retentissants qui affectent
l’ensemble de la matière, droit moral comme droits patrimoniaux (b).
a. L’opposition récurrente entre droit d’auteur et liberté d’expression à travers la
jurisprudence européenne
La jurisprudence européenne rendue en matière de propriété intellectuelle se révèle
pléthorique, conséquence directe de l’interventionnisme des cours européennes « quitte à
franchir parfois allégrement quelques frontières traditionnelles de répartition de compétences
entre l’Union et les États membres »211. S’emparer de ce domaine n’est pas innocent. La Cour,
en effet, tend à concevoir l’œuvre de l’esprit comme un bien qui doit, en ce sens, être concilié
avec les libertés économiques sur la base desquelles est fondé le marché commun212. La règle
de l’épuisement du droit de distribution s’inscrit dans cette perspective. De nombreux pans de
cette jurisprudence sont consacrés aux rapports qu’entretiennent droit d’auteur et liberté
d’expression et ont vocation à trancher le conflit de droits fondamentaux qui en résulte.
Les cours européennes, après avoir montré leurs velléités, se sont définitivement saisies
du droit d’auteur. Elles le font conjointement avec la Commission européenne - en ce qu’il
s’agit de la Cour de justice -, les nombreuses directives, transversales comme spécifiques, en
témoignent. Législateur et jurisprudence concourent concomitamment à la production
normative. L’interventionnisme s’explique par la conjonction de trois facteurs que sont le
caractère éclaté de l’acquis substantiel, les lacunes qui le parcourent et qui offrent un « espace
interprétatif » conséquent ainsi que l’intensification des questions préjudicielles213. En premier
lieu, l’Union européenne s’est intéressée au droit d’auteur sans prendre la précaution au
211 Valérie-Laure Benabou, « Retour sur dix ans de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en
matière de propriété littéraire et artistique : les méthodes » (2012) 43 Propriétés intellectuelles 140, à la p 140. 212 Carine Bernault, « Le droit d’auteur dans la jurisprudence de la CJUE. Propos introductifs », (2015) 55
Propriétés intellectuelles 119, à la p 120. 213 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 211, à la p 141.

42
préalable de fixer une orientation politique franche. Pour reprendre les mots du professeur
Alexandra Bensamoun, « le tableau européen est désordonné et incomplet. Désordonné, car on
légifère sur des prérogatives spéciales ou des objets spécifiques avant d’envisager les règles
générales. Incomplet, car en définitive un certain nombre de notions sont tantôt vaguement
appréhendées tantôt ignorées par le droit de l’Union […] Le résultat est celui d’un patchwork,
d’une construction fragmentée, sans cohérence générale et fruit de nombreux compromis »214.
Dès lors, les textes pris dans leur ensemble peuvent apparaître dénués de cohérence. L’acquis,
éparpillé et dépourvu de colonne vertébrale, est « propice à être comblé par une interprétation
allant se nicher dans les interstices vacants »215. C’est là un champ des possibles des plus vastes.
D’autant que l’interprétation qui prévaut dans les décisions rendues par la Cour de justice
s’avère être bien souvent l’interprétation téléologique (elle peut, à d’autres endroits, être
contextuelle). À cette fin, elle convoque à souhait les principes d’interprétation dont elle est en
possession - principe de l’effet utile, principe de proportionnalité et autres - ainsi que les notions
autonomes pour mieux servir la finalité assignée à la norme. Preuve en est l’élargissement
manifeste de l’exception de citation à la suite de la jurisprudence Painer216 en vertu de laquelle
la Cour abolit purement et simplement l’exigence d’œuvre citante. Elle édifie donc une œuvre
prétorienne par sédimentation qui reprend les décisions rendues antérieures pour mieux se
fonder dessus. À la lecture de la jurisprudence, il apparaît que le juge européen excède le
pouvoir d’interprétation qui était le sien à l’origine et « verse incontestablement dans la création
du droit »217, n’hésitant pas à produire la norme. Un dépassement de fonction d’autant plus
inquiétant qu’il n’a de justification que de poursuivre l’harmonisation des droits nationaux et
non de préserver les intérêts des titulaires du droit. Le professeur Valérie-Laure Benabou
regrette d’ailleurs que « le juge européen avance tapi dans l’ombre de l’interprétation […] au
besoin en tissant un maillage entre les directives. Ce comblement des lacunes de l’acquis se fait
souvent par touches successives, par tâtonnements »218.
La tension entre droit d’auteur et liberté d’expression nourrit abondamment la
jurisprudence européenne, notamment celle de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette
dernière préconise de parvenir à un juste équilibre entre les intérêts en présence après mise en
214 Alexandra Bensamoun, « Réflexions sur la jurisprudence de la CJUE : du discours à la méthode (2015) 55
Propriété intellectuelles 139, à la p 139. 215 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 211, à la p 143. 216 Painer, op. cit., note 72, attendu 136 : « Le point de savoir si la citation est faite dans le cadre d’une œuvre
protégée par le droit d’auteur ou, au contraire, d’un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence ». 217 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 211, à la p 141. 218 Id., à la page 140.

43
balance de ceux-ci depuis l’arrêt Painer qui confronte droit de reproduction des titulaires et
liberté d’expression des utilisateurs d’une œuvre. En l'occurrence, le juste équilibre impose de
privilégier l'exercice de la liberté d'expression des utilisateurs par rapport à l'intérêt de l'auteur
à pouvoir s'opposer à la reproduction d'extraits de son œuvre.
Ce conflit est indissolublement lié à la problématique des intermédiaires techniques. Une
qualité que revêtent les fournisseurs d’accès et qui va de pair avec la mise en place, par la
directive dite « commerce électronique » du 8 juin 2000219, d’un régime de responsabilité
atténuée, voire de quasi-irresponsabilité, en vertu duquel ils ne sont pas responsables des
contenus illicites qui transitent par leurs services dont certains sont constitutifs de faits de
contrefaçon.
Quatre affaires successives sont particulièrement éloquentes à ce sujet. Elles s’inscrivent dans
le prolongement direct de la décision Promusicae220 qui intime d’assurer un « juste équilibre »
entre les différents droits fondamentaux que sont le droit d’auteur et la protection des données
personnelles. Dans l’ordre chronologique, ce sont d’abord les décisions Scarlet221 et Netlog222
qui retiennent l’attention. Toutes deux rendues suite aux demandes de la SABAM, société belge
des auteurs, elles sont relatives aux injonctions de filtrage et de blocage faites aux
intermédiaires techniques, respectivement un fournisseur d’accès et un hébergeur, dans le but
de lutter contre la diffusion et le partage d’œuvres protégées. La mise en balance entre, d'une
part, la protection de la propriété intellectuelle et, d'autre part, la liberté de communication sur
Internet, la liberté d'entreprendre des prestataires techniques et la protection des données
personnelles s’est avérée inévitable. Elle devait déterminer si l’injonction était contraire à
l’article 15 de la directive du 8 juin 2000223 qui interdit aux États membres de soumettre les
prestataires techniques à une obligation générale de surveillance et recherche des contenus. Il
en résulte que l’injonction faite au fournisseur d’accès de mettre en place un système de filtrage
ne respecte pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre droit de la propriété intellectuelle
et, notamment, les droits mis en perspective parmi lesquels la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations dans la mesure où des contenus parfaitement licites seraient
219 Directive CE, Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, [2000] JOUE, L 178. 220 CJUE 29 janvier 2008, Promusicae c Telefonica, aff C275/06. 221 CJUE 24 novembre 2011, Scarlet Extended, aff C70/10. 222 CJUE, 16 février 2012, Sabam c Netlog NV, aff C360/10. 223 Directive Commerce électronique, op. cit., note 219, art 15.

44
susceptibles d’être affectés au nom de la neutralisation des contenus illicites. Dans ces arrêts,
la Cour soutient, en effet, que le droit d’auteur n’est pas intangible et que sa protection n’a pas
à être assurée de manière absolue224.
La problématique inhérente au régime de faveur dont jouissent les intermédiaires techniques
n’est en rien conjoncturelle. En passe de s’inscrire dans le temps - la Commission démontrant
une certaine inertie pour légiférer en la matière -, elle a donc ressurgi naturellement au sein du
contentieux, alimentant de plus bel l’interprétation de l’article 8.3 de la directive du 22 mai
2001 qui dispose que : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent
demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les
services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ».
En l’espèce, les plaignants souhaitaient obtenir le blocage de l’accès à un site sur lequel
circulaient sans autorisation des œuvres protégées. Après avoir souligné que l’injonction doit
faire suite à la constatation d’une infraction, constituée par une atteinte au droit d’auteur, et
précisé la qualité d’intermédiaire technique, la Cour réitère sa jurisprudence qui exige qu’une
balance des intérêts soit exécutée dès lors qu’une injonction de bloquer est susceptible d’être
prononcée. Par application du principe de proportionnalité, le droit d’auteur doit une nouvelle
fois être concilié avec la liberté d’expression et la liberté d’entreprendre. Afin d’atteindre le
juste équilibre auquel elles doivent aspirer, les injonctions de blocage doivent être efficaces et
raisonnables. Cette dernière caractéristique implique nécessairement de prendre en
considération la liberté d’entreprendre et la liberté d’information. Une jurisprudence qui n’est
pas isolée comme en atteste une décision du Conseil constitutionnel rendue le 19 juin 2009225
qui exige que ne soient uniquement ordonnées des « mesures strictement nécessaires à la
préservation des droits de propriété intellectuelle ». D’autant, que le droit d’auteur n’a pas
l’apanage du conflit. Il est de jurisprudence constante, en droit des marques, que la mesure prise
doit être effective, dissuasive, équitable mais aussi proportionnée.
À l’aune des décisions jurisprudentielles, il demeure difficile d’entrevoir la conception que se
fait la Cour de justice du droit d’auteur et des problématiques afférentes. Si la mise en balance
opérée affecte indubitablement le droit d’auteur, contraint de justifier son existence et son
application, les solutions rendues ne s’inscrivent pas nécessairement pas à son encontre. Ce qui
tend à démontrer que la Cour n’est pas foncièrement hostile au droit d’auteur mais plutôt
224 Scarlet, op. cit., note 221, au considérant 43. 225 Cons constitutionnel, op.cit., note 112.

45
attachée à un principe conciliateur qui lui est chevillé au corps. Après avoir érigé le droit
d’auteur en principe général du droit communautaire226, la Cour indique que l’interprétation
des directives est gouvernée par le principe in favorem auctoris en vertu des jurisprudences
Svensson227 et Infopaq228. Cette première impression est corroborée par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme.
Moins exhaustive en la matière - jusqu’ici l’essentiel des décisions avait vocation à
rattacher le droit de la propriété intellectuelle à l’article 1er du protocole n°1229 qui dispose que
« chacun a droit au respect de ses biens » -, la Cour européenne des droits de l’homme
s’intéresse tout de même au droit d’auteur dès lors qu’il entre en collision avec l’un des droits
que sa matrice d’origine, la convention, protège. C’est à ce titre qu’elle a pu s’interroger sur le
fait de savoir si l’exercice du droit d’auteur, comme l’interdiction de communiquer des œuvres
en méconnaissance des prérogatives des titulaires de droits sur internet, ne violait pas la liberté
d’expression. En résulte une décision protectrice qui témoigne de la prévalence du droit au
respect des créations des créateurs de mode sur la liberté d’expression230. Toutefois, si la
solution retenue apparaît nettement favorable au droit d’auteur, le raisonnement qui la précède
intime de la relativiser dans la mesure où il considère les mesures prises sur le terrain de la lutte
contre la contrefaçon comme des ingérences de la liberté d’expression - justifiées en
l’occurrence.
En l’espèce, des photographes avaient exploité en ligne les tirages issus d’un défilé de mode
alors que lesdites photographies étaient protégées par le droit d’auteur. Condamnés pour
contrefaçon, ils avaient invoqué, pour leur défense, l’exception permettant d’exploiter des
œuvres par voie de presse dans un but d’information immédiate dont le bénéfice leur a été
refusé231. En effet, l’interprétation restrictive de l’exception la circonscrivait aux œuvres
graphiques, plastiques ou architecturales et excluait, de fait, les photographies232. Les
défendeurs saisissent alors la Cour européenne des droits de l’homme dénonçant une atteinte
injustifiée à leur liberté d’expression.
226 Promusicae, op. cit., note 220. 227 CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff C-466/12. 228 CJUE 16 juillet 2009, Infopaq International as c Danske Dagblades Forening, aff C-435/12. 229 Anheuser-Bush Inc c Portugal, op. cit., note 28 ; Balan c Moldavie, op. cit., note 29. 230 CEDH, 10 janvier 2013, Ashby Donald, aff 36789/08. 231 Cass crim, 5 février 2008, 07-81.387. 232 CA Paris, 26 mars 2010.

46
La Cour admet que les requérants, en tant qu’individus, peuvent se prévaloir de leur liberté
d’expression laquelle peut être neutralisée à des conditions bien précises : « La publication des
photographies litigieuses [...] relève de l'exercice du droit à la liberté d'expression, et que la
condamnation des requérants pour ces faits s'analyse en une ingérence dans celui-ci [...] Pareille
ingérence enfreint l'article 10, sauf si, prévue par la loi, elle poursuivait un ou plusieurs buts
légitimes au regard du paragraphe 2 et était nécessaire, dans une société démocratique, pour le
ou les atteindre ». Constatant que cet intérêt, tenant dans les droits d’autrui, correspond à des
biens protégés par la convention, elle opère une balance des intérêts entre, d’un côté, la liberté
d’expression et, de l’autre, le respect des biens. Les juges tranchent, en l’espèce, en faveur du
droit d’auteur dans la mesure où la démarche des requérant présentait un caractère
essentiellement commercial. Ainsi, la Cour considère que la protection du droit d'auteur doit
l'emporter face à la liberté d'expression dans ce cas précis mais n’exclut pas pour autant que
cette dernière puisse primer dans d’autres circonstances.
L’arrêt procède à une inversion du raisonnement alors tenu par les juridictions françaises. Le
droit d’auteur se définit, en l’occurrence, comme une ingérence légitime à la liberté
d’expression dès lors qu’elle présente un caractère proportionné et apparaît justifiée par les
circonstances. Une configuration qui sera de nouveau utilisée par la CJUE au service de sa
propre jurisprudence233. Cette perspective est profondément novatrice en tant qu’elle précise
que les droits de propriété intellectuelle doivent s’analyser comme des exceptions à la liberté
d’expression234. Particulièrement importante au regard du statut dont elle jouit au sein des
démocraties modernes, la liberté d’expression prévaut dans des proportions qui sont fonction
du contexte dans lequel elle s’inscrit : la superficie de la marge d'appréciation dont disposent
les États est fontion de plusieurs éléments, parmi lesquels la nature du discours tenu est
déterminant. Dans une situation de nature politique, toute restriction est malvenue. En revanche,
si le litige s’intègre au domaine commercial, les États membres disposent d’une liberté
d’appréciation plus grande235. D’autant plus quand les intérêts en présence présentent un
caractère antinomique, la balance étant encore plus complexe à réaliser. Une telle
différenciation implique d’adopter une appréciation in concreto. Ce pourquoi l’invocation de
droits fondamentaux a pour effet de récuser toute possibilité d’analyse abstraite.
233 CJUE, 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien c Constantin Film Verleih, aff C314/12. 234 Christophe Geiger dans Michel Vivant, Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, op. cit., note 22, à la p
26. 235 CEDH, 13 juillet 2012, Mouvement raëlien suisse c Suisse, aff 16354/06.

47
Cette décision a été confirmée sans surprise l’année suivante au moyen d’une affaire au sujet
du site The Pirate Bay236. Identiquement au cas d’espèce précédent, les contrefacteurs arguaient
que la sanction infligée portait atteinte à leur liberté d’expression. Si la Cour indique que la
liberté d’expression protège la diffusion des contenus mais aussi les moyens techniques utilisés
à cette fin, elle précise que la liberté d’expression n’est pas absolue et doit être conciliée avec
les droits d’autrui. Pour opérer la balance des intérêts, elle reprend le critère du contexte dans
lequel s’est exprimée la liberté invoquée. Elle prend, ainsi, en considération la fonction sociale
dont est investi le droit pour déterminer que la condamnation n’est pas attentatoire à la liberté
d’expression. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude237.
« Il en résulte que, au fil des décisions, il se construit un véritable droit européen des
droits de l'homme de la propriété intellectuelle »238. La Cour de justice de l’Union européenne
s’est arrogée une compétence exorbitante en la matière, profitant de l’acquis communautaire et
des interstices qui le fissurent. Récusant la spécificité de la propriété intellectuelle, notamment
lorsqu’il s’agit d’une œuvre - elle ne saurait être un bien comme les autres - et faisant fi des
conceptions divergentes des États membres, la Cour a transposé ses méthodes d’interprétation
et de raisonnement au contentieux du droit d’auteur. La réception fut pour le moins satisfaisante
puisque la Cour de cassation décida d’adopter le principe de proportionnalité, n’hésitant pas à
heurter les logiques du droit d’auteur (b).
b. L’importation en droit interne du conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression sous sa
nouvelle forme
À titre liminaire, il convient de préciser que nous évoquerons ici l’introduction de la
balance des intérêts en droit français et les critères mis en œuvre à cet effet. Les conséquences
qui en résultent pour le droit d’auteur feront l’objet de développements plus importants en
seconde partie.
236 CEDH 19 février 2013, Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi c Suède, aff 40397/12. 237 Christophe Caron, « Contrefaire, c’est exprimer illicitement » (2013) 6 Communication Commerce
électronique 26. 238 Ibid.

48
Conformément aux souhaits du Président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, le
contrôle de proportionnalité - déjà bien établi en droit privé - a été transposé au droit d’auteur.
Résolument novatrice, la jurisprudence Klasen239 qui le met en œuvre, arrêt rendu le 15 janvier
2015, s’affirme comme un point de bascule paradoxalement attendu. Il s’inscrit en effet avec
discipline « dans le droit-fil du mouvement doctrinal et judiciaire visant à réaliser une
articulation entre droit d’auteur et droits fondamentaux »240. Arrêt pilote de la réforme de la
motivation des arrêts impulsée sous l’égide de la Cour de cassation, il érige le contrôle de
proportionnalité en pierre angulaire du droit d’auteur et en fait le « fer de lance »241 du
raisonnement des juges.
Les faits consistent en cas classique de contrefaçon hors application d’une exception. En
l’espèce, un artiste-peintre avait réutilisé et altéré des photographies originales préexistantes
protégées par le droit d’auteur pour créer de nouvelles œuvres d’art les incorporant. À noter,
détail loin d’être insignifiant, que les œuvres secondes s’inscrivent dans un mouvement
artistique ayant pour objet la contestation de la société de consommation moderne. Aussi,
l’auteur, après emprunt créatif, s’était affranchi de son obligation de solliciter l’autorisation de
l’auteur de l’œuvre première alors que les œuvres dérivées en sont tributaires. En conséquence,
étaient affectés tant les droits patrimoniaux - dans l’ordre, droit de reproduction et droit de
représentation - que le droit moral - du fait, premièrement, du contournement du droit de
paternité mais aussi de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre et à son contexte.
Condamné en appel dans la lignée de la jurisprudence Utrillo - les juges décidant de lui refuser
le bénéfice des exceptions de parodie et de courte citation demandé et estimant que « les droits
sur les œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d’intérêt supérieur, l’emporter sur
ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées »242 -, le défendeur forme son pourvoi autour de
deux arguments : en premier lieu, il invoque, classiquement, l’absence d’originalité des œuvres
reprises avant de faire valoir sa liberté d’expression. À cet égard, il postule que « l'opposabilité
du droit d'auteur ne peut être sollicitée, car elle aurait pour effet de porter atteinte à
[sa] liberté d'expression artistique »243. À la lumière du contentieux en matière de contrefaçon,
239 Cass civ 1re, 15 mai 2015, 13-27.391. 240 Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli, « Droit d'auteur vs liberté d'expression : suite et pas fin...», (2015) 29
Recueil Dalloz Sirey 1674. 241 A. Latil, op. cit., note 134, à la p. 18. 242 CA Paris, 18 septembre 2013, 12/02480. 243 Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli, op. cit., note 240.

49
cet argument n’est pas inédit mais voué à l’échec dès lors qu’il y a application du syllogisme
juridique, l’atteinte à la liberté d’expression n’ayant jamais été retenue pour neutraliser la
sanction infligée aux contrefacteurs. Mais, le syllogisme juridique n’est plus, supplanté par
l’exigence d’un contrôle de proportionnalité, et l’argument fondé sur la liberté d’expression se
trouve admis par la Haute juridiction.
Si l’invocation d’un tel argument n’en est pas à son coup d’essai, son admission par le juge
constitue, en revanche, une grande première. Véritable « changement de paradigme »244, l’arrêt
de principe, rendu au visa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et non au visa du Code de la propriété intellectuelle
institue le mécanisme de la balance des intérêts et affirme, que les juges du fond - lorsqu’ils
imposent à l’auteur de l’œuvre seconde le respect des droits sur l’œuvre première - étaient
invités à « expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits
en présence commandait la condamnation » prononcée au titre de la contrefaçon. Le motif de
cassation, à savoir le manque de base légale et non la violation de la loi, nuance l’arrêt en tant
qu’il permet à l’avenir aux juges du fond de maintenir la solution prononcée mais n’en amenuise
pas la portée théorique.
L’arrêt Klasen englobe le droit moral et les droits patrimoniaux de l’auteur de l’œuvre
première. Pour autant, la nature du litige tend davantage à la prise en considération des
prérogatives économiques et à leur violation. D’aucuns ont alors suggéré que la mise en œuvre
du contrôle de proportionnalité était cantonnée à la sphère patrimoniale. Or, la Cour de
cassation affirme le contraire lorsqu’elle étend le principe de proportionnalité aux atteintes à
l’intégrité des œuvres. Rétrospectivement, il est évident que la jurisprudence Klasen n’était
qu’une première étape. La systématisation de la balance des intérêts est intervenue à l’occasion
d’un litige portant sur la fameuse œuvre du Dialogue des Carmélites, énième illustration de la
problématique pour le moins épineuse entre les droits respectifs de l’auteur et du metteur en
scène d’une œuvre245.
244 Ibid. 245 Philippe Malaurie. « Les droits respectifs de l’auteur et du metteur en scène sur une œuvre destinée au
spectacle » (2017) 33 Recueil Dalloz Sirey 1955.

50
En l’espèce, l’œuvre littéraire Le Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos avait fait
l’objet d’une adaptation en opéra, hautement fidèle à l’œuvre d’origine et à son esprit, par
Francis Poulenc. L’œuvre retrace le destin de seize carmélites de Compiègne condamnées à
mort par le tribunal révolutionnaire et guillotinées. Or, récemment, un metteur en scène,
adaptant l’opéra pour le théâtre, a, comme il est d’usage, modifié l’œuvre en profondeur.
D’abord, le récit est transposé à l’époque contemporaine. Surtout, différence majeure, les
carmélites parviennent à échapper à leur « habituelle mort » grâce au sacrifice de l’une d’entre
elles.
Dans un premier temps, le Tribunal de grande instance de Paris246 avait relevé que le décalage
existant entre l’œuvre première et la mise en scène ne suffisait pas à caractériser une violation
du droit d’auteur. Une décision infirmée par la cour d’appel de Paris qui, par décision du 13
octobre 2015247, condamne l’adaptateur dont les choix altèrent profondément la fin du récit et,
partant, dénaturent l’esprit. Les juges accordent, en l’espèce, la primeur au respect du droit
moral de l’auteur dans la mesure où la seule dénaturation suffit à constituer une atteinte au droit
moral. Ladite dénaturation ayant été caractérisée alors que les juges du fond avaient souligné
que les thèmes de l’espérance et du martyr, éléments de fond, et la musique avaient été
respectés. Ici, la liberté de création est circonscrite aux limites que sont le respect de l’intégrité
et de l’esprit de l’œuvre et ne permet pas de légitimer les modifications exécutées. La cour
d'appel considère au fond que le juste équilibre entre liberté de création et droit d'auteur a été
assuré par le législateur qui pose déjà des limites proportionnées au droit d'auteur. Si bien que
prenant le contre-pied de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que dès l'instant où une
atteinte au droit moral est caractérisée, l'équilibre législatif est rompu, justifiant la
condamnation, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il en résulte une atteinte disproportionnée
à la liberté de création. Par là même elle consacre, sans référence à la décision Klasen, une
hiérarchie inverse entre un droit et une liberté248.
En premier lieu, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel pour ne pas avoir
tiré les bases légales de ses propres constatations. Après avoir qualifié d’œuvre composite la
mise en scène litigieuse et, ainsi, en la subordonnant au respect de l’œuvre première ; elle
246 Trib gr inst Paris, 13 mars 2014. 247 CA Paris, 13 octobre 2015, 14/08900. 248 Anne-Emmanuelle Kahn. « Dialogues des Carmélites : atteinte disproportionnée au droit moral » (2016) 39
Jurisart 32.

51
reproche à la cour d’appel, au visa de l’article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle,
d’avoir caractérisé une dénaturation tout en relevant que l’œuvre seconde respectait l’œuvre
d’origine dans ses éléments constitutifs. Sur la troisième branche, la Cour de cassation, intime,
au visa de l’article 10 de la CESDH, les juges du fond de procéder à une balance des intérêts
entre liberté de création et droit d’auteur : « Qu’en se prononçant ainsi, sans examiner, comme
elle y était invitée, en quoi la recherche d’un juste équilibre entre la liberté de création du
metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l’auteur du livret, justifiait
la mesure d’interdiction qu’elle ordonnait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
La mesure d’interdiction prononcée doit, en ce sens, se conformer au juste équilibre et à l’idéal
de la proportionnalité.
Si la Cour de cassation ordonne aux juges du fond de procéder à la balance des intérêts,
elle ne donne aucune information complémentaire sur la façon de s’y livrer. Peu d’indications
existent, en effet, sur les critères à mobiliser. À première vue, ceux-ci semblent mouvants et
complexes. En dehors de la marge d’appréciation accordée aux États selon, par exemple, le
contexte dans lequel il a été fait usage de la liberté d’expression - « plus l’information est
essentielle à la société démocratique, moins la marge de manœuvre de l’État est forte »249 -, les
cours européennes se montrent fluctuantes, voire nébuleuses. Parfois, par exemple, elles
paraissent s’intéresser à la fonction sociale du droit250. Il faut admettre qu’il est complexe de
faire émerger des critères pour juger de droits supposément égaux. En droit français, l’arrêt
rendu par la cour d’appel de renvoi dans l’affaire Klasen fait donc office de précurseur en tant
qu’il se prête, en pratique, « à la pesée des intérêts en présence entre droit d’auteur sur l’œuvre
première et liberté artistique de l’auteur de l’œuvre seconde exigée par la Cour de cassation »251.
Son intérêt est d’importance : si l’évolution initiée par le contrôle de proportionnalité est lourde,
seule l’utilisation qu’en feront les juges du fond déterminera s’il s’agit véritablement d’une
révolution.252 Les critères dégagés - à savoir le caractère substituable ou non de l’intégration de
l’œuvre première à l’œuvre seconde ou encore l’identification au moyen de la notoriété de
l’artiste de l’œuvre contrefaite - sont hautement controversés. Jugés insatisfaisants par une
frange de la doctrine et inaptes à protéger efficacement le droit d’auteur, d’aucuns les jugent en
249 Jean-Michel Bruguière, « Affaire Peter Klasen, les attentes déçues de l’arrêt de renvoi » (2018) 18 La Semaine
Juridique Édition Générale 513. 250 Arnaud Latil, op. cit., note 134. 251 Valérie-Laure Benabou. « Klasen : quand le contrôle de proportionnalité dégénère en contrôle de nécessité
des œuvres » (2018) 3 Dalloz IP/IT 300. 252 Édouard Treppoz, op. cit., note 58.

52
contradiction avec « l'interdiction de se reporter au mérite, au genre ou à la destination des
œuvres pour déterminer leur protection »253. Il s’agit, toutefois, de préciser avec précaution que
ces prohibitions légales concernent l’appréciation de l’originalité des œuvres et non la mise en
balance du droit d’auteur avec un droit concurrent. En cela, les critiques formulées à l’encontre
des critères dégagés sont elles-mêmes critiquables.
En dépit du dépassement progressif de la frontière, désormais bien mince, entre le fait et le
droit, la Cour de cassation se montre catégorique quand elle affirme qu’il appartient aux juges
du fond de procéder, en pratique, à la balance des intérêts. À ce titre, leur revient la tâche ardue
de déterminer les méthodes à cette fin, ce pourquoi l’arrêt de renvoi était particulièrement
attendu : quel espace concret le juge allait-il accorder à la liberté d’expression hors du système
légal des exceptions ?254. En premier lieu, la cour d’appel caractérise l’originalité des œuvres
premières, en convoquant de manière surprenante le principe de l’impression d’ensemble
usuellement amené à jouer en matière de propriété industrielle. Pour le professeur Valérie-
Laure Benabou, « le caractère utilitaire de l'œuvre première semble bien faire pencher
l'appréciation de l'originalité dans une perspective proche du droit de la propriété industrielle,
laquelle se vérifie par ailleurs dans l'analyse de la balance des intérêts »255. Par la suite, la cour
rappelle que la parodie, en vertu de la jurisprudence Deckmyn, implique une manifestation
d’humour et concerne l’œuvre en elle-même. Dès lors, la seule appartenance de l’œuvre dérivée
au courant appropriationniste ne suffit pas à obtenir le bénéfice de l’exception subordonnée à
des caractères propres. Reste encore à procéder à la balance des intérêts.
La détermination des critères pour arbitrer la conciliation entre deux droits fondamentaux est
un exercice périlleux, une ligne de crête incertaine, encore davantage, en matière de droit
d’auteur, où les juges du fond n’avaient pas pour habitude de le pratiquer : « La cour d'appel,
visiblement embarrassée par ce cadeau empoisonné, semble d'abord refuser d'opérer cette
“pesée” de deux droits en affirmant dans une formule choc “qu'il n'appartient pas au juge de
s'ériger en arbitre d'un droit qui mériterait plus protection qu'un autre”, avant de, pourtant, s'y
prêter »256.
253 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 252. 254 Jean-Michel Bruguière, op. cit., note 250. 255 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 252. 256 Ibid.

53
Avant de faire primer l’exercice d’un droit sur l’autre, la cour d’appel fait deux constats
préliminaires. Le premier est que la propriété intellectuelle ne saurait être conçue comme
illégitime au seul motif qu’elle est potentiellement susceptible d’entrer en contradiction ou de
porter atteinte à la liberté d’expression. Faut-il voir ici un amalgame entre légitimité et
proportionnalité de l’atteinte257 ? De plus, elle met à la charge du défendeur, celui qui se prévaut
de la liberté d’expression qui lui est reconnue, d'établir en quoi un juste équilibre imposait
l’utilisation des œuvres de l’auteur originel au surcroît sans son autorisation. À cette fin, il est
tenu de démonter en quoi l’emploi de l’œuvre première était impératif à sa création. Pour
apprécier de ladite nécessité, la cour met au point un critère de substituabilité. Il en résulte que
si l’emprunt de l’œuvre première n’est pas nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression
artistique alors le droit d’auteur ne peut constituer une atteinte au droit à la création :
« Considérant que […] les œuvres de M. C. Z. étaient parfaitement substituables, qu'il aurait pu
tout aussi bien utiliser d'autres photographies publicitaires du même genre ; qu'il en découle
que l'utilisation des œuvres de M. X. Y., au surcroît sans son autorisation, n'était pas nécessaire
à l'exercice de la liberté que M. C. Z. revendique ; que solliciter l'autorisation préalable de
l'auteur ne saurait donc constituer une atteinte à son droit de créer ».
Pour le professeur Valérie-Laure Benabou, « c'est ouvrir la boîte de Pandore que d'envisager la
substituabilité des œuvres comme variable d'ajustement »258. Selon elle, il s’agit d’une
restriction significative infligée à la liberté artistique. S’il appartenait, en l’espèce, au
contrefacteur d’obtenir, contre rémunération, l’autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante ;
« dit-on comprendre, a contrario, que si l'œuvre utilisée n'est pas substituable, le principe de
l'autorisation préalable de l'auteur constitue alors une atteinte à la liberté artistique ? »259. Dans
un second temps, la cour convoque le critère de l’identification de l’œuvre en vertu duquel
l’œuvre première, alors qu’intégrée à l’œuvre seconde, pourrait être isolée grâce à la notoriété
qui lui est attachée. En conséquence, une œuvre de grande notoriété serait susceptible d’être
reprise et empruntée à souhait. Sur ce point, le critère apparaît antinomique de l’interdiction de
prendre en considération le mérite de l’œuvre et introduit une « hiérarchisation malvenue de la
protection des œuvres »260. En cela, la méthode décrite est aux antipodes de la conception
historique du droit d’auteur.
257 Jean-Michel Bruguière, op. cit., note 250. 258 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 252. 259 Ibid. 260 Ibid.

54
Aussi, si la solution d’origine est maintenue - la condamnation pour contrefaçon est conservée
-, les critères mis en œuvre malmènent quelque peu les fondements du droit d’auteur en
s’intéressant à l’utilité et à la notoriété des œuvres ou encore à la distinctivité de l’emprunt. Des
risques de discrimination dans l’effectivité de la protection ou des partis pris esthétiques sont à
craindre.
En réalité, il apparaît, de manière sous-jacente, que les juges du fond demeurent rétifs à
l’application du contrôle de proportionnalité. Est-ce là un problème d’acculturation aux
méthodes issues du juge européen ou un attachement à l’équilibre législatif du droit d’auteur ?
Difficile d’y apporter une réponse. Toujours est-il que les arrêts rendus par les juges du fond,
dans les affaires Prokofiev261 et Koons rejettent avec vigueur les prétentions d’auteurs qui
invoquaient leur liberté d’expression. Dans la première affaire, relative à une composition
arguée de contrefaçon par les ayants-droit de Prokofiev en tant qu’elle s’inspirait du ballet créé
par l’auteur, le juge s’en tient en effet à la liste fermée des exceptions, limites naturelles du droit
d’auteur, et marque un retour à la jurisprudence Utrillo.
C’est que le juge du fond a peut-être conscientisé et anticipé les menaces que fait peser
sur le droit d’auteur l’invocation systématique de la liberté d’expression. À moins que cette
dynamique nouvelle ne soit la condition de son maintien (II).
261 CA Paris, 25 septembre 2015, 14/01364.

55
II. La neutralisation du droit d’auteur au moyen d’une conception
extensive de la liberté d’expression : probabilité avérée ou vue de
l’esprit ?
La liberté d’expression invoquée au titre de limite externe est, pour l’instant, dépourvue
d’application effective. L’injonction de la Cour de cassation à destination des juges du fond
d’opérer une balance des intérêts a été suivie - comment pourrait-il en être autrement - mais,
dans le peu d’exemples dont nous sommes en possession, l’articulation s’est faite en faveur du
droit d’auteur. Pourtant, si, à terme, la liberté d’expression devait être admise, nul doute qu’elle
serait synonyme de rétrécissement pour le droit d’auteur. Les prérogatives des titulaires, peu
importe leur nature, seraient potentiellement paralysées dès lors que la liberté d’expression
l’exigerait (A). Progressivement, la liberté d’expression prendrait l’ascendant et condamnerait
le droit d’auteur à son inévitable déclin. À moins que les droits fondamentaux ne soient,
précisément, la condition du maintien du droit d’auteur, lui offrant la possibilité de se voir
appliquer d’une manière entièrement repensée. Une thématique qui fait, depuis longtemps,
office de leitmotiv dans la littérature juridique. Les causes qui postulent un affadissement du
droit d’auteur, en effet, se conjuguent au pluriel et sont tout aussi nombreuses que les
implications contemporaines de la liberté d’expression. Entre obsolescence programmée et
crise de légitimité, le droit d’auteur est contraint de puiser dans les ressources à sa disposition.
Si l’avenir du droit d’auteur et les perspectives qui s’offrent à lui ne sauraient être dictés par le
simple contexte exogène, la propriété intellectuelle ne peut faire le choix d’évoluer en vase-
clos et doit composer avec les éléments qui gravitent à sa périphérie au nombre desquels on
compte évidemment la liberté d’expression. Si celle-ci nécessite résolument un encadrement -
une liberté d’expression exorbitante placée hors de toutes frontières n’aurait que pour effet de
la dénaturer et de la galvauder -, elle représente, de toute évidence et encore davantage qu’elle
a pu l’être, un support juridique indispensable à la création et, ainsi, au droit d’auteur (B).
A. Les droits fondamentaux à travers le prisme du droit d’auteur : entre instrument
de paralysie et condition d’une application renouvelée
De sa confrontation avec la liberté d’expression et, plus largement, avec les droits
fondamentaux, le droit d’auteur en sortira nécessairement transformé. Reste à déterminer si la
mutation à venir tend à refouler en bloc son application (1) ou à lui rendre ses lettres de noblesse
(2).

56
1. La perspective du rétrécissement du champ d’application naturel du droit
d’auteur à travers l’avènement d’une limite externe
La liberté d’expression déploie ses effets sur l’ensemble du droit d’auteur. Le droit
moral (b), essence de la conception française du droit d’auteur, comme les droits patrimoniaux
(a) sont mis en péril par la liberté d’expression laquelle dessine une protection à géométrie
variable et librement modulable selon les espèces.
a. Les droits patrimoniaux de l’auteur de l’œuvre première mis en péril ?
Arrêt pilote, la jurisprudence Klasen épouse également les contours d’un arrêt
« provocateur et gorgé de symboles » en tant qu’il recèle un « raisonnement redoutable » 262.
Ce raisonnement contient, en germes, des potentialités inquiétantes de nature à abolir, au gré
des espèces, l’exercice du droit de propriété intellectuelle par son titulaire.
Parmi les écueils dont le contrôle de proportionnalité serait la source, celui lié à
l’imprévisibilité inquiète le plus. Rendant impossible d’anticiper la décision du juge - d’un côté
le tiers sera dans l’incapacité de déterminer s’il peut légitimement emprunter l’œuvre
préexistante, de l’autre, de l’autre le titulaire n’aura aucun moyen de connaître de l’opposabilité
future de son droit263 -, il traduit, à ce titre, « la consécration d’une balance contra legem » pour
le professeur Julie Groffe264. Contra legem n’est pas ici employé dans son acception classique
mais au sens de légicide dans la mesure où le contrôle de proportionnalité permet de neutraliser
l’application d’une norme de type légal dès lors qu’elle porterait une atteinte excessive à une
liberté ou à un droit fondamental265. Une fois transposé au droit d’auteur, il apparaît que la
sanction prononcée au titre de la contrefaçon pourrait être paralysée si le juge considère que
celle-ci empiète avec excès sur la liberté de création de l’auteur. En ce sens, la jurisprudence
Klasen admettrait que, dans certains cas soumis à appréciation, les droits patrimoniaux de
l’auteur de l’œuvre première soient écartés au profit de la liberté d’expression artistique de
l’auteur de l’œuvre seconde. L’accepter battrait en brèche le régime de l’œuvre composite tel
262 Pierre-Yves Gautier, op. cit., note 54, à la p 7. 263Frédéric Pollaud-Dulian, « Liberté de création. Droit d’adaptation. Droit moral. CEDH » (2015) 3 Revue
Trimestrielle de Droit Commercial 515. 264 Julie Groffe, op.cit., note 3, à la p 11. 265 Id., à la p 12.

57
que fixé à l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle et le système d’autorisation
qu’il institue.
Une hiérarchie à peine voilée se dessine entre droit d’auteur et liberté d’expression :
« La prise en considération de la liberté d'expression artistique constitue un point d'orgue
logique dans un mouvement d'idées entendant faire prévaloir les droits fondamentaux sur
le droit d'auteur » [et] à infléchir le premier en raison de l’importance des seconds »266. Avant
cela, déjà, les nombreux signes avant-coureurs du changement, que ce soit en droit interne ou
à l’échelle supra-nationale, rendaient plus précaire le droit d’auteur par le raisonnement tenu
mais en confortaient en quelque sorte l’application pour les titulaires. Ici, en revanche, la Cour
régulatrice exige que l’opposabilité du droit soit systématiquement justifiée267. Il s’agit non pas
d’un renversement de la charge de la preuve mais de la prétention à faire valoir son droit. En
effet, le droit d’auteur, désormais assimilé à une ingérence est contraint démontrer en quoi son
application, nécessaire et proportionnée, respecte un juste équilibre sans lequel il est tenu pour
illégitime. La décision Klasen subordonne donc l’application du droit d’auteur à la preuve d’un
juste équilibre avec la liberté de création.
Dans un tel cas, il s’agira alors d’occulter la prérogative d’un auteur au nom de la liberté
d’expression d’un autre auteur, ce qui revient à établir des distorsions au sein du régime
juridique et nuit à l’égalité de protection entre auteurs. La réunion des conditions constitutives
de l’action en contrefaçon n’entraînerait plus nécessairement le prononcé d’une sanction268. La
notion de contrefaçon, d’importance critique en propriété littéraire et artistique, se vide ainsi de
sa substance. L’auteur de l’œuvre de seconde, du fait de sa localisation chronologique dans le
processus de création, jouirait d’une liberté d’expression exacerbée, hypertrophiée. « La liberté
d’expression jouerait alors comme une “méta-exception” externe au droit d’auteur, sans que
l’on connaisse son champ d’application exacte ni ses limites »269. Selon le professeur Frédéric
Pollaud-Dulian, dans son commentaire de l’affaire Klasen, ledit auteur, « si la balance devait
pencher du côté de la liberté créatrice, M. Klasen, de contrefacteur dépourvu de droit, se
retrouverait titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre dérivée pourtant dénaturante, exécutée et
266 Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli, op. cit., note 340. 267 Ibid. 268 Christophe Caron, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd, Paris, LexisNexis, 2015, à la p 523. 269 Alexandra Bensamoun et Pierre Sirinelli, op. cit., note 340.

58
exploitée contre la volonté de l'auteur de l'œuvre première »270. Ce droit d’auteur implicitement
octroyée serait d’ailleurs illégitime dans la mesure où les conditions légales qui subordonnent
sa délivrance ne seraient pas remplies.
À l’inverse, le premier auteur se verrait dépossédé des prérogatives qui lui échoient et, dans une
certaine mesure, de sa création. Son autorisation pour exploiter l’œuvre est désormais obsolète,
dépourvue d’utilité. Le fameux lien ombilical qui unirait, en vertu de la conception
personnaliste, l’auteur à son œuvre n’en est que plus fragilisé. Le sort réservé à l’auteur de
l’œuvre préexistante apparaît, en ce sens, infondé : « tous ces travailleurs ont mérité de […]
rester les maîtres de leur création, fruit de la conjonction de leur intelligence et de leur
sensibilité ; ils doivent donc conserver autorité et puissance sur l’œuvre »271. C’est ce que
formulait la cour d’appel de Paris, relativement à l’affaire Klasen en soutenant que « les droits
sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, en effet, faute d'intérêt supérieur, l'emporter
sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées sauf à méconnaître le droit à la protection des
droits d'autrui en matière de création artistique »272. « En effet, faire valoir que la liberté de
création pourrait l'emporter au terme de sa mise en balance avec le droit d'auteur implique que
le droit consacré par la loi et reconnu individuellement à l'auteur des photographies originales
serait à mettre sur le même plan que la liberté, alors que le législateur a lui-même restreint cette
liberté en instituant un droit subjectif assorti d'exceptions précises »273.
Aussi, l’invocation de la liberté d’expression interroge la protection véritable accordée aux
œuvres et, surtout, celle de la réciprocité274. Selon les conditions qui président à sa création,
l’œuvre se verra octroyer ou refuser le bénéfice de la protection. Quid, également, de la
protection des œuvres secondes ? Celle-ci pourra-t-elle être empruntée et intégrée à de
nouvelles œuvres de manière indéfinie et perpétuelle à moins que le contrôle de
proportionnalité ne décide l’inverse ? « En cas de réponse favorable au tiers qui voudrait
réutiliser l'œuvre seconde pour une troisième création, l'auteur de l'œuvre première se trouvera
privé du droit d'interdire la sous-adaptation - droit que lui a pourtant toujours reconnu la
jurisprudence »275.
270 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 263. 271 Pierre-Yves Gautier, op. cit., note 22, à la p 25. 272 CA Paris, op. cit., note 242. 273 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 263. 274 Ibid. 275 Ibid.

59
En définitive, au regard des potentiels effets pervers qui vont de pair avec l’invocation
de la liberté d’expression sous l’égide du contrôle de proportionnalité, il est manifeste que le
mécanisme, combiné avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, est
porteur d’une grande insécurité juridique. Bien loin d’étancher le contentieux ou de le
restreindre - l’engorgement des tribunaux est une problématique maintenant profondément
enracinée -, il renforce les prétentions excessives des tiers. « Parce qu’il permet des solutions
d’une grande malléabilité, le contrôle de proportionnalité peut se muer en instrument politique,
la balance apparaissant alors comme très subjective »276. Le paradigme de la proportionnalité
confère, en effet, aux juges une mission déterminante et une responsabilité conséquente. À ce
titre, toute subjectivité doit être écartée sous peine de sombrer dans l’arbitraire. Or, les critères,
instables, à mettre en œuvre pour exercer le contrôle de proportionnalité s’y prêtent et
pourraient, à certains égards, aboutir à une prise en considération déguisée des qualités
esthétiques ou intellectuelles attribuées aux œuvres. Le mérite se convertirait alors en « variable
d’ajustement de l’intensité de la protection accordée »277 au profit d’un « puissant principe
égalisateur »278. En conséquence, « le danger existe d’un glissement d’une balance des intérêts
vers une balance des œuvres. Or la mise en balance des œuvres, c’est la résurgence du mérite
non au stade de l’accès à la protection mais à celui de l’intensité de la protection octroyée »279.
La neutralisation des droits patrimoniaux n’est pas la seule conséquence qui résulterait
de l’admission de la liberté d’expression à titre de limite externe. Et pour cause, le droit moral
ne saurait y faire exception (2).
b. L’exclusion pressentie de certaines atteintes à l’intégrité de l’œuvre
À ce stade, il apparaît que « l'équilibre interne au droit d'auteur entre ces deux intérêts
antagonistes que sont la protection et la liberté de création peut à tout moment être remis en
cause par le juge à l'aune de ce nouveau contrôle externe »280. Ce faisant, il s’avère que la
protection est remise en question non seulement dans son versant économique - les droits
patrimoniaux permettent d’organiser l’exploitation de la création en autorisant, par exemple, la
276 Julie Groffe, op.cit., note 3, à la p 25. 277 Ibid. 278 Édouard Treppoz, op. cit., note 58. 279 Julie Groffe, op.cit., note 3, à la p 25. 280 Édouard Treppoz, op. cit., note 58.

60
reproduction ou la représentation de celle-ci -, mais également dans son pendant moral,
émanation de la vision romantique du droit. À ce titre, « à raisonner en contemplation du couple
droit moral et liberté de création, l’immixtion du contrôle de proportionnalité dans les décisions
revient à porter un coup sévère à la prérogative »281.
Le droit moral, construction juridique édifiée en contemplation de la personne de
l’auteur, traduit l’intensité du lien qui unit ce dernier à son œuvre. Il comprend réunit l’ensemble
des prérogatives extrapatrimoniales qui permettent à l’auteur de préserver sa personnalité telle
qu’elle s’exprime dans son œuvre282. Ce lien, juridiquement protégé, lui confère des
prérogatives souveraines à l’égard des tiers : droit de divulgation, droit de paternité, droit de
repentir et droit au respect de l’œuvre. Parmi ces subdivisions, la dernière exige que l’œuvre
soit préservée dans son intégrité, ce qui a trait à toute altération non consentie de sa substance,
mais également dans son esprit de manière à sanctionner les atteintes de nature contextuelle.
En cela, le droit moral se définit comme un corps de règles indispensable à la protection des
auteurs, de leurs créations et leurs intérêts283.
En matière d’atteintes au respect de l’œuvre, le droit moral est considéré comme
subissant une violation dès lors qu’une dénaturation de l’œuvre est identifiable. La dénaturation
désigne communément une « violation évidente de l’œuvre et de la personnalité de l’auteur »284.
En pratique, sa caractérisation se révèle délicate. La frontière exacte entre la liberté et la
dénaturation paraît bien mince à de nombreux égards. Si, jusqu’ici, les juges du fond ne
procédaient pas à une balance des intérêts respectifs, ils se livraient tout de même à un travail
de comparaison dont le résultat variait au gré des espèces soumises à appréciation. En la
matière, deux conceptions se distinguent formant alors « deux blocs de jurisprudence »285. Le
premier, majoritaire, accorde à l’auteur de l’œuvre seconde une latitude suffisamment large286.
À cette fin, a été reconnu à ce dernier un droit de donner « une expression nouvelle à l’œuvre
sans la dénaturer »287. La seconde admet de manière extensive la dénaturation au motif qu’elle
porte atteinte à la dignité de l’auteur288.
281 Julie Groffe, op.cit., note 3, à la p 16. 282 Christophe Caron, op. cit., note 268, à la p 216. 283 Ibid. 284 Pierre-Yves Gautier, op. cit., note 22, à la p 253. 285 Ibid. 286 Cass civ 1re, 12 juin 2001, 98-22.591. 287 Cass civ 1re, 22 novembre 1966. 288 Trib gr inst Paris, 7 janvier 1969.

61
Les hésitations des juges du fond se sont pérennisées, conférant ainsi aux solutions un caractère
légèrement imprévisible que l’application du syllogisme ne permet, au demeurant, pas toujours
d’éviter. Preuve en est la jurisprudence récente. Alors que, à titre d’illustration, l’arrêt rendu
par la cour d’appel sur l’affaire du Dialogue des Carmélites faisait prévaloir le droit d’auteur
en restreignant, à cette fin, sévèrement la liberté de création ; le tribunal de grande de Paris a
pu juger, en 2016, que l’intégration d’un poème de Paul Éluard dans le film Maps to the stars
de David Cronenberg ne portait pas atteinte au droit moral des ayants-droit (esprit de l’œuvre)
en lui conférant un sens nouveau : « la liberté d’expression de l’auteur de l’œuvre seconde doit
pouvoir s’exercer sans que l’œuvre première ne soit enfermée dans le contexte historique ou
factuel dans lequel elle a été créée […] Il n’est pas démontré que la manière dont le thème de
la liberté est appréhendé par le film constituerait une atteinte à la pensée de Paul Éluard telle
qu’exprimée dans l’œuvre »289. Ici, le juge entend faire primer la liberté de création de l’auteur
de l’œuvre seconde sur le droit moral de l’auteur de l’œuvre première290.
À la lumière de ces décisions, il semble bien difficile d’y déceler une tendance profonde. Là où
le tribunal de grande instance de Paris accordait la primeur à la liberté de création, la cour
d’appel se montrait excessivement intransigeante dans son appréciation de l’atteinte au droit
moral et, par conséquent, dans la caractérisation de la dénaturation de l’œuvre première : « si
une certaine liberté peut être reconnue au metteur en scène dans l’accomplissement de sa
mission, cette liberté a pour limite le droit moral de l’auteur au respect de son œuvre ». Selon
le professeur André Lucas, qui s’interroge à travers le prisme de l’arrêt Klasen, « on aurait […]
pu s’attendre à ce que la cour d’appel de Paris, s’inspirant de cette nouvelle donne, prenne le
soin d’énumérer précisément les raisons pour lesquelles la liberté de création du metteur en
scène devait s’effacer devant le droit moral des auteurs des œuvres en cause. […] Au lieu de
quoi elle se contente, conformément à la jurisprudence antérieure, d’établir ce qui apparaît bel
et bien comme une hiérarchie, en décidant que la dénaturation de l’œuvre suffit à constituer
l’atteinte au droit moral, quelques que soient les motivations de l’auteur de l’œuvre seconde.
Ce rappel est bienvenu »291. Cela, évidemment, avant que la Cour de cassation n’intime de
procéder à la balance des intérêts pour juger de la confrontation entre liberté d’expression et
289 Trib gr inst Paris, 25 février 2016. 290 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 19. 291 André Lucas, « Note sous Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 13 octobre 2015 » (2016) 8 Propriétés
Intellectuelles 42.

62
droit moral alors que les juges du fond avaient jugé que l’équilibre était déjà garanti et réalisé
par le législateur.
La décision de la Cour de cassation au sujet du Dialogue des Carmélites étend la
jurisprudence Klasen au droit moral, quintessence d’un droit d’auteur qui se réclame de
tradition française et en convoque, à souhait, l’esprit et les principes qui l’habitent. Si l’équilibre
entre liberté du metteur en scène et droit au respect de l’auteur de l’œuvre mise en scène était
déjà instable, il n’en est que plus précaire. Le contrôle de proportionnalité externe pourrait, en
effet, aboutir à un déplacement de la ligne de démarcation entre les deux. Après avoir relevé la
contradiction intrinsèque au raisonnement de la cour d’appel - alors que de nombreux éléments
de l’œuvre avaient été conservés ou respectés, elle concluait à la dénaturation de celle-ci - la
Cour invite les juges du fond à apprécier si la condamnation infligée au metteur en scène
épousait les proportions que lui dictait le juste équilibre à assurer entre droit moral et liberté de
création. Aussi, selon Édouard Treppoz, « l’œuvre de Bernanos […] permet à la Cour de
cassation de préciser le champ du droit au respect en matière de droit d’auteur »292. En guise de
démonstration, il souligne que la cour d’appel avait justement relevé que si la mise en œuvre
litigieuse ne portait aucune atteinte substantielle à l’œuvre, elle en altérait le sens. En d’autres
termes, il s’agit d’une atteinte contextuelle. « Il n’était donc aucunement contradictoire pour la
cour d’appel de constater l’absence de modification des dialogues et de la musique pour ensuite
caractériser l’atteinte au droit au respect. La cassation sur ce point ne semble pas pertinente,
sauf à considérer que la Cour de cassation souhaite à exclure du champ du droit moral les
atteintes contextuelles, se mettant ainsi en contradiction avec la Convention de Berne »293.
Surtout, si, à l’avenir, la condamnation ne respectait pas le juste équilibre, elle serait annulée
au profit de la liberté de création. Dès lors, il faudrait en convenir que la caractérisation d’une
violation du droit au respect de l’œuvre porterait une atteinte excessive à la liberté de création.
Ce qui conduirait naturellement à admettre certaines dénaturations à condition qu’elles soient
nécessaires et proportionnées à l’exercice de la liberté d’expression. Ces atteintes, impunies,
seraient évacuées du champ de la protection. Au-delà du risque d’imprévisibilité juridique,
transparaît un droit d’auteur inégal et lacunaire à la protection erratique. « Il est pourtant
absolument nécessaire que la loi protège le droit moral des auteurs, l'attribut le plus important
292 Édouard Treppoz, « Retour sur la dénaturation contextuelle du Dialogues des Carmélites » (2017) 352
Légipresse 438. 293 Ibid.

63
des propriétés intellectuelles »294. Pour eux, « la crainte de l’insécurité juridique est fondée,
lorsque la méthode de jugement elle-même devient imprévisible »295.
Dans cette hypothèse, les droits fondamentaux, et au premier chef la liberté
d’expression, ne seraient qu’une menace perpétuelle pesant sur le droit d’auteur. Pour ce
dernier, l’invocation de la liberté d’expression coïnciderait avec son inapplication. Pourtant,
d’expérience récente, le contrôle de proportionnalité entre droit d’auteur et liberté d’expression
accouche souvent de décisions favorables à celui-ci. Aussi, les droits fondamentaux ne
joueraient pas nécessairement au détriment du droit d’auteur et lui procureraient une application
renouvelée, adaptée aux spécificités actuelles et, ainsi, d’autant plus effective (b).
2. Les droits fondamentaux au service d’une application plus effective du
droit d’auteur
Dans la maison du droit d’auteur, les droits fondamentaux sont, pour beaucoup -
conscients de leur caractère instable et appropriable - persona non grata. Face à la défiance
quasi-générale, ils sont, a contrario, perçus par une minorité comme porteurs de solutions. En
réalité, le tableau n’est ni blanc ni noir et la problématique ne s’accommode guère des
appréciations tranchées. Dans cette hypothèse, si les droits fondamentaux constituent une
menace pour la matière, ils présenteraient également des avantages que le droit d’auteur serait
inspiré d’exploiter296. Pour étayer notre propos, nous appréhenderons, en premier lieu, le droit
d’auteur en tant que droit fondamental avant de s’intéresser à la liberté d’expression sous un
prisme nouveau puisque celle-ci n’entraverait plus le droit mais en permettrait une application
localisée et ciblée dès lors qu’il apparaît fondé à entrer en action. Ici, le conflit entre droit
d’auteur et liberté d’expression doit donc être apprécié de manière inédite.
Le droit d’auteur se définit comme un droit, par essence, finalisé. À ce titre, il a pour
objectif de protéger les droits des titulaires mais aussi ceux des tiers. La logique qui sous-tend
le droit d’auteur implique donc que son périmètre d’action comporte des limites, fondées
notamment sur des considérations d’intérêt général. Or, le droit de propriété intellectuelle est,
294 Philippe Malaurie, op. cit., note 245. 295 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 25. 296Alexandre Zollinger, « Droit d’auteur et liberté d’expression : le discours de la méthode » (2013) 5
Communication Commerce Électronique 7 : Ces menaces alléguées « ne sauraient suffire à invalider le concept
même de droits de l'homme, si essentiel ».

64
à l’origine, lui-même une dérogation à la libre concurrence. Aussi, les droits fondamentaux sont
en adéquation avec la vocation première du droit lorsqu’ils en dessinent les contours. Fidèles à
l’esprit de la propriété intellectuelle, les droits fondamentaux agissent ici comme des correctifs
afin de prévenir et pallier les potentiels excès, à la manière de la théorie de l’abus de droit297.
En s’opposant à des utilisations contraires de sa fonction naturelle, ils préservent la finalité du
droit de propriété intellectuelle et en garantissent une légitimité retrouvée. En définitive, ce
n’est là qu’une manifestation, sous une forme nouvelle, de l’équilibre qui présidait auparavant
au travers des exceptions et autres limitations de nature législative. La seule différence tient à
la nature et à l’origine, en l’occurrence externe, des limites émergentes.
La reconnaissance du droit d’auteur en tant que droit fondamental poursuit ainsi un objectif de
légitimation et participe de sa promotion. Dès lors, elle représenterait le moyen privilégié de
lutter contre sa remise en cause permanente au nom du collectivisme298.
Parallèlement, les droits fondamentaux alentours, à l’image de la liberté d’expression,
ne sont pas nécessairement hostiles au droit d’auteur et à son application. Certes, ils s’y
opposent dès lors que le droit de propriété intellectuelle empiète sur leur terrain mais ils en
respectent l’application lorsqu’elle s’impose. Sur ce point, l’affaire Ashby Donald299 est
particulièrement éclairante. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie de cette
affaire, en profite pour désamorcer le conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression malgré
le recours à la balance des intérêts et relativise l’impact de l’invocation de la liberté
d’expression au titre de moyen de défense à une action en contrefaçon300. « Ce discours de la
méthode appliqué à l'art délicat de la conciliation des droits fondamentaux est ici instructif et
rassurant à double titre : par les principes qu'il dégage et par leur mise en œuvre dans le cas
d'espèce »301. D’autant que la décision insiste sur le caractère impérieux de la lutte contre la
contrefaçon et du respect du droit d’auteur.
La Cour européenne des droits de l’homme a vocation à interpréter la Convention au gré du
contentieux qui lui est soumis. Ce faisant, elle explicite les principes qu’elle recueille, en
297 Christophe Geiger, « Les droits fondamentaux garanties de la cohérence du droit de la propriété intellectuelle »
(2004) 29 La Semaine Juridique Édition Générale 1313. 298 Laure Marino, op. cit., note 206. 299 Ashby Donald, op. cit., note 230. 300 Alexandre Zollinger, op. cit., note 296. 301 Ibid.

65
détermine la substance et délimite la portée du texte. Preuve en est l’article premier du Protocole
n°1, relatif au respect de la propriété, qui a donné lieu à une jurisprudence fournie. Au moyen
de l’élaboration de la notion autonome de biens, la Cour a rattaché le respect de la propriété
intellectuelle à la disposition précitée. La décision Ashby Donald en donne une illustration en
reprenant la solution déjà énoncée selon laquelle « « l'article 1er du Protocole n° 1 s'applique à
la propriété intellectuelle ». Cela démontre avec clarté les potentialités qu’augure l’article
premier du Protocole n°1. Véritable socle, la jurisprudence le convoque afin d’étendre la
protection accordée aux biens. Pour le droit d’auteur, il s’agit là d’une aubaine dans la mesure
où le rattachement de la propriété intellectuelle à cette disposition s’inscrit dans la perspective
d’une protection plus diffuse. D’autant que la Cour ne s’en tient pas à la pétition de principe ou
à la pure symbolique mais admet la nécessité de restreindre la liberté d’expression, dans certains
cas, pour assurer le respect du droit d’auteur302. D’ailleurs, c’est précisément la qualité de droit
fondamental que revêt la propriété intellectuelle qui, au même titre, que la nature commerciale
de l’usage de la liberté d’expression en l’espèce, confère aux États membres une marge de
manœuvre importante.
En décidant que le droit d’auteur et la lutte contre la contrefaçon constituent des ingérences
proportionnées à la liberté d’expression, la Cour entend assurer l’application du droit d’auteur.
Elle semble mettre ici un terme à un courant jurisprudentiel, concurremment formé par la Cour
de justice, qui accordait, en filigrane - les condamnations pour contrefaçon continuaient d’être
prononcées malgré l’invocation de l’article 10 -, une supériorité à la liberté d’expression vis-à-
vis du droit d’auteur. Aussi, la décision Ashby Donald est de nature à dissiper certaines craintes.
L’importance de la marge d’appréciation laissée au juge national et la qualité de droit de
l’homme reconnue au droit d’auteur à l’échelle européenne y participent. Si le droit d’auteur
est potentiellement susceptible de constituer une ingérence pour un autre droit fondamental, il
est réciproquement protégé face aux ingérences injustifiées qu’il pourrait subir.
En conséquence, il est manifeste que le droit d’auteur peut tirer parti de son introduction
au sein de la sphère des droits fondamentaux. Par leur dynamique propre et les effets qu’ils
produisent, les droits fondamentaux interagissent les uns avec les autres et contribuent à définir
302 Ashby Donald, op. cit., note 230 : « Lorsque le but poursuivi est celui de la “protection des droits et libertés
d'autrui” et que ces “droits et libertés” figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses
protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les États à restreindre d'autres droits
ou libertés également consacrés par la Convention ».

66
les contours de chacun. Sous cet angle, ils se définiraient comme des garde-fous pour le droit
d’auteur vérifiant que sa finalité soit respectée et visant, ainsi, à en empêcher les abus. Si,
jusqu’à présents, les outils disponibles à l’échelle européenne étaient jugés insatisfaisants - la
Charte de 2000 reçoit souvent le reproche de son inintelligibilité -, l’article 1er du Protocole n°1,
par les virtualités qu’il présente, ouvre un large champ des possibles. Facteurs d’adaptabilité,
les droits fondamentaux seraient également vecteurs de légitimité. Or, l’utilisation qui en est
faite contredit souvent l’espérance qu’ils suscitent. Victimes de leur succès, les droits
fondamentaux sont appropriés à tort303. En l’espèce, la liberté d’expression est régulièrement
instrumentalisée afin de contrecarrer la mise en œuvre du droit d’auteur et, ainsi, invoquée sans
réelle justification. Incapables de jouer leur rôle de contrepoids, les droits fondamentaux se
muent en outils de déconstruction.
Au regard des incertitudes que fait naître le conflit entre droit d’auteur et liberté
d’expression, il apparaît bien délicat de déterminer avec précision le périmètre effectif du droit
d’auteur, droit anciennement souverain et dorénavant victime d’érosion puisque, rogné de
toutes parts, il est susceptible d’être privé d’un pan entier de son application. La neutralisation
envisageable des droits dont l’auteur est investi sous le coup de la liberté d’expression est une
fraction du phénomène d’élargissement que connaît la liberté d’expression. Une telle
émergence a inexorablement pour corollaire le déclin du droit d’auteur et la hiérarchie qui en
résulte est dommageable, d’autant que des alternatives demeurent d’actualité (B).
B. Un rapport de force incertain entre droit d’auteur et liberté d’expression :
dynamique et perspectives
La primauté de la propriété littéraire et artistique à l’égard des droits supposés
concurrents appartient à l’histoire. Suite à l’inversion du raisonnement, le principe s’est mué en
exception et l’exception d’autrefois - à savoir la liberté d’expression - en norme d’arbitrage.
Une fois habillé du langage cher à la matière, il apparaît que « la liberté d’expression est le
principe et le droit d’auteur une ingérence » 304. Si cette analyse est controversée au motif que
303 Pascal Puig, op. cit., note 146 : « Le contrôle de « proportionnalité privatisé » propose un « droit à la carte »,
un droit pour chacun qui l'emporte sur le droit pour tous. Il accentue l'égoïsme inhérent aux droits subjectifs
fondamentaux. À chacun son intérêt, à chacun son droit. Les intérêts privés tiennent, en quelque sorte, lieu de loi
à ceux qui s'en prévalent ». 304 Pierre-Yves Gautier et Alice Pézard, op.cit, note 54.

67
le droit d’auteur ne peut être toujours conçu comme enserré dans un système de principe et
d’exception(s), elle illustre avec précision les rapports contemporains entre droit d’auteur et
liberté d’expression qui s’inscrivent, de toute évidence, en défaveur du premier. Protéiforme,
la liberté d’expression connaît une pluralité de facettes et couvre un large spectre. Une fois
conjuguées, l’ensemble des manifestations de la liberté d’expression participent de
l’affadissement du droit d’auteur (1). À cet égard, une réflexion mérite d’être menée sur la place
réelle à accorder à celle-ci. Si son caractère indispensable ne fait guère de doute, elle ne saurait,
pour autant, prétendre à l’omnipotence (2).
1. L’affadissement progressif du droit d’auteur, conséquence de la montée
en puissance de la liberté d’expression
La confrontation entre droit d’auteur et liberté d’expression n’est pas circonscrite à un conflit
entre droits fondamentaux. Elle se matérialise sous une pluralité de formes, sans cesse
renouvelées, à l’image de facteurs sociaux et politiques parmi lesquels on retrouve le
déferlement du « tout-numérique », la promotion d’un idéal de gratuité et la défiance d’un
public rétif à la propriété intellectuelle. Ces pratiques et usages du public comme les nouveaux
modes de création, manifestations de la liberté d’expression, affectent tout autant le droit de
propriété intellectuelle que l’invocation de la liberté d’expression au sein de la masse du
contentieux. Révélatrices du retard qu’accuse la matière sur son temps (a), elles le conduisent
indubitablement à se repenser et faire peau neuve sous peine de se déliter (b).
a. L’obsolescence constatable du droit d’auteur à l’aune des œuvres transformatives
L’obsolescence du droit d’auteur est, à l’image d’autres comme la crise du droit
d’auteur, une thématique à répétition de la littérature de la propriété intellectuelle305. Très
prégnante, cette perspective se voit assigner plusieurs significations. À travers le prisme de
notre étude et, donc, de la dialectique entre droit d’auteur et liberté d’expression, elle désigne
l’inadéquation des règles du droit d’auteur avec les modes récents de création et de diffusion.
Ceux-ci exploitent pleinement les potentialités mises à disposition par la révolution numérique.
305 Anna Mancini, L’obsolescence du droit d’auteur et sa philosophie, Buenos Books International, 2006.

68
Cette dernière désigne l’essor d’une technique de transcription de l’information dont la force
réside dans sa capacité de dissolution : tout contenu, quelle que soit sa forme, peut être
décomposé, réduit et conservé avant d’être restitué bien plus tard306. Cette lame de fond,
phénomène technologique mâtiné de sociétal et de juridique, lance un défi à la propriété
littéraire et artistique depuis une vingtaine d’années. Le droit d’auteur y est confronté tant dans
sa philosophie que dans sa réalité. D’abord, ce sont des concepts très vastes, comme ceux de
territorialité et de propriété, qui ont volé en éclats. Ceux-ci, inadaptés à l’économie virtuelle et
à l’abondance culturelle, périclitent. Parallèlement, les nouvelles techniques de diffusion et de
communication détricotent et balayent l’héritage de la conception personnaliste du droit
d’auteur structurée autour de la personne de l’auteur, figure tutélaire. Ensuite, les normes
juridiques contemporaines apparaissent incapables d’appréhender les nouveaux usages qui
émergent et se généralisent de manière satisfaisante. Le phénomène de la création
transformative en constitue un exemple des plus remarquables. Elle nous intéresse tout
particulièrement dans la mesure où elle repose sur une conception entièrement renouvelée de
la liberté d’expression artistique dont se sont saisis avec avidité les internautes. À partir du
postulat que chacun est en mesure de créer, les internautes s’affirment progressivement comme
des créateurs de contenus incorporant des œuvres préexistantes. D’autant que certaines œuvres
transformatives ont déjà pénétré les tribunaux et donné lieu à contentieux.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 307. Si cet adage, attribué à
Lavoisier, a trait à la matière scientifique, force est de constater qu’il est susceptible de
s’appliquer à bien des domaines au sein desquels le droit et, plus particulièrement le droit
d’auteur, ne saurait faire exception. Et pour cause, on y trouve une transcription évidente chez
Desbois, celui-ci constatant que « dans le monde où nous vivons, les œuvres absolument
originales, c’est-à-dire celles qui n’ont tiré aucun aliment de créations préexistantes, ont un
caractère exceptionnel, théorique »308. Derrière ce postulat, transparaît l’idée, aisément
vérifiable, que l’emprunt et la transformation, en tant que pratiques artistiques, innervent et
stimulent la création et, cela, depuis tout temps. Déjà Montaigne intégrait une multitude de
fragments de textes dans ses Essais309. Des siècles plus tard, Duchamp mettait au point le
procédé du ready-made, reprenant à dessein la Joconde de De Vinci. « Selon cette tradition
306 Bruno Patino, Le devenir numérique de l’édition : Du livre objet au livre droit, La Documentation Française,
2008. 307 Antoine Lavoisier, Traité élémentaire de chimie, 1789, à la p 140. 308 Henri Desbois, Le droit d’auteur en France, 3è édition, Dalloz, 1978, à la p 32. 309 Montaigne, Essais, Hatier, Paris, 2012.

69
intellectuelle, qui voit dans l’art une réappropriation, une reconfiguration constante, aucune
œuvre ne sort toute armée de la pensée de son auteur »310. Tout texte est un « tissus nouveau
de citations révolues » affirmait d’ailleurs Barthes311.
Pour autant, la pratique de la transformation artistique n’est pas l’apanage d’artistes confirmés
au point, qu’aujourd’hui, une frange non négligeable du public s’y adonne sous l’effet de la
démocratisation de la culture et de la révolution numérique312. Cette tendance contemporaine
interroge ou ébranle notre rapport à l’art et est en tout point révélatrice de ce que Duchamp
souhaitait démontrer en soutenant que ce sont les « spectateurs qui font les images »313. Les
œuvres, dont l’accès est facilité, sont reconfigurées, transfigurées, adaptées, traduites mais aussi
questionnées ou valorisées. Pour preuve, les exemples d’appropriation d’œuvres préexistantes
pullulent : mash-up, fanvids, spin-off ou encore fan-fiction pour ne citer qu’eux. Une pluralité
d’illustrations donc qui nous éclaire tant sur la diversité314 de la pratique que sur son ampleur.
C’est précisément ce qui obstrue toute entreprise de définition. D’un genre nouveau, évoluant
parfois en périphérie du droit, l’œuvre transformative semble inclassable. Pourtant, les
implications du phénomène sont telles qu’il est urgent d’y apposer une qualification juridique,
premier préalable à l’application d’un régime afférent.
Quelle terminologie assigner, en effet, à cette « création d’une œuvre dynamique,
ouverte, et en perpétuelle évolution » 315 ? Sur ce point, l’indétermination est de mise. En
l’absence de consensus réellement établi, il convient de s’attacher à leurs traits caractéristiques.
Elles ont pour point commun de résulter d’une transformation volontaire et perceptible
d’œuvres dont elles sont tributaires316. En droit interne, un premier réflexe conduirait à les
assimiler aux œuvres composites, qui jouissent d’une assise législative et d’un régime propre.
310 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 71, à la p 4. 311 Roland Barthes, « Théorie du texte » (1973) Encyclopedia Universalis. 312 Pierre Henaff, « L’œuvre transformative - Sécuriser l’œuvre transformative sans remettre en cause le monopole
de l’auteur de l’œuvre préexistante », (2016) 4 Communication Commerce Électronique 176, à la p 176 : « Là où
l'avènement du numérique renouvelle en revanche l'approche de l'œuvre dérivée, pour qu'on en finisse par l'appeler
transformative, c'est au niveau de trois phénomènes récents qui changent la donne. Les possibilités techniques de
créer une œuvre transformative à l'ère du numérique ont tout d'abord été démultipliées, démocratisées [...] La
nouveauté réside aussi dans un développement quantitatif des œuvres transformatives accessibles par milliers,
millions sur Internet, sur des plateformes de diffusion, sur les réseaux sociaux ». 313 Thierry de Duve, Résonances du readymade. Duchamp entre avant-garde et tradition, Hachette, 2006, à la p
76. 314 Pierre Henaff, op. cit., à la p 176 : « L’œuvre transformative va de l’insignifiant au sublime ». 315 V-L., Benabou, op. cit, note 71, à la p 12. 316 Florence Meuris, « Les oeuvres transformatives : métamorphose du droit d'auteur ? », (2014) 11
Communication Commerce Électronique 2, à la p 2.

70
À première vue, pareil alignement pourrait être satisfaisant - les deux sont le siège de plusieurs
originalités -mais se révèle rapidement insuffisant au regard du particularisme et des spécificités
irréductibles aux œuvres transformatives. Et pour cause, celles-ci ne sont pas seulement
juridiques. Porteuses d’une certaine valeur symbolique317, les œuvres transformatives
véhiculent un idéal de gratuité318, font émerger la figure de l’amateur - qui supplante celle de
l’auteur - et accordent une place conséquente aux droits du public.
En l’absence d’un régime particulier, le droit d’auteur n’appréhende qu’indirectement l’œuvre
transformative, notamment à travers les dispositions relatives à la transformation ou à
l’adaptation. Selon le rapport rendu en 2013 sous la présidence de Pierre Lescure, « le statut
juridique de ces œuvres transformatives, qualifiées en droit français d’œuvres composites, reste
excessivement précaire » et rend indispensable une « clarification du statut »319. Des
exceptions, à l’image de la courte citation ou de l’analyse, pourraient leur servir de possibles
réceptacles mais, insuffisantes, elles appellent à une modernisation ou pour mieux les
accueillir : « si les exceptions du droit positif peuvent être mobilisées ici ou là dans quelques
situations données, y compris en élargissant le cas échéant leurs domaines respectifs, elles
semblent impropres à sécuriser de façon globale toute œuvre transformative »320. Pour autant,
l’adoption d’une exception ad hoc est-elle souhaitable ?
Bien que nécessaire pour beaucoup, elle s’avère particulièrement délicate comme l’illustre
l’exemple canadien dont le droit d’auteur a été, sur cet aspect, précurseur. La loi sur la
modernisation du droit d’auteur du 29 juin 2012321, visant à adapter le droit aux
bouleversements apportés par la révolution numérique, a introduit en droit canadien une
exception relative au contenu non commercial généré par l’utilisateur contenue dans son article
29.21322. Prônant une volonté d’équilibre, elle ambitionne d’accorder aux auteurs une
317 Pauline Léger, La recherche d'un statut de l’œuvre transformatrice. Contribution à l'étude de l’œuvre composite
en droit d'auteur, thèse, Université Paris-Sud, 2015 : L’auteur évoque, à ce titre, une « notion fonctionnelle ». 318 Tristan Azzi, « La gratuité en droit d’auteur », dans Célia Zolynski et Nathalie Martial-Braz, La gratuité, un
concept aux frontières de l’économie et du droit, Lextenso éditions, LGDJ, 2013, à la p. 239. 319 Pierre Lescure, Mission « Acte II de l'exception culturelle » - Contribution aux politiques culturelles à l'ère
numérique, 2013. 320 Pierre Henaff, op. cit., à la p 17. 321 Loi sur la modernisation du droit d’auteur, LC 2012, C42. 322 Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, C-42, art 29.21: « Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait,
pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci -
déjà publiés ou mis à la disposition du public - pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur
protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle,
d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions
suivantes sont réunies :a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou

71
protection plus effective tout en aménageant des exceptions au bénéfice des utilisateurs, parmi
lesquelles une a trait directement aux œuvres transformatives. Cette exception, fondée sur la
liberté de création et censée stimuler l’innovation, a pour effet de « légaliser des pratiques
consistant pour un utilisateur à incorporer à une œuvre qu’il aura créée des parties ou la totalité
d’une autre œuvre dont il n’est pas l’auteur »323. Dans les faits, l’exception permet de déroger
à l’obligation pour l’auteur de l’œuvre seconde d’obtenir une autorisation du titulaire des droits
sur l’œuvre première. Particulièrement large, elle couvre l’ensemble des actes prévus par le
monopole d’exploitation. Le régime une fois posé, celui-ci n’est pas exempt de toute
interrogation. D’aucuns estiment les conditions instaurées apparaissent, à certains égards,
dépourvues de pertinence et imprécises dans leur étendue, introduisant à dessein une analyse
économique324 quand d’autres se montrent plus péremptoires : « il reste qu’à l’arrivée le
législateur canadien s’est fendu d’un texte d’une complication extrême pour peu que l’on tente
d’en pénétrer les arcanes. Mais n’est-il pas vrai que l’enfer est aussi pavé de bonnes
intentions ? »325.
Il conviendrait de s’interroger quant à la pertinence d’une transposition de l’exception en droit
européen et, ainsi, en droit français. Dès 2009, la Commission européenne a dévoilé sa tentation
de consacrer une exception aux œuvres transformatives. Pour l’instant, ce souhait demeure à
l’état embryonnaire ; les institutions préférant étudier le phénomène dans toute son étendue
avant de légiférer. Au regard de l’environnement économique actuel, l’adoption d’une
exception en des termes similaires conduirait à « concentrer la valeur économique liée à la
diffusion de l’œuvre dans le chef des plateformes de diffusion, sans que les acteurs de la
création de cette valeur n’y soient aucunement associés »326. C’est là la manifestation d’un effet
pervers, couramment exprimé à travers la problématique du value gap ou partage de la valeur.
Enfin, plus généralement, l’éventualité d’une transposition se heurte au hiatus existant entre les
l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins ; b) si cela est possible dans les circonstances, la source
de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms
de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés ;c) la personne croit, pour
des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait
;d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif
important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation - actuelle ou éventuelle - de l’œuvre ou autre objet ou dela copie
de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’œuvre
ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer ». 323 Victor Nabhan, « L’exception de contenu non commercial généré par l’utilisateur en droit canadien » (2016) 3
Dalloz IP/IT 156. 324 Pauline Léger, op.cit, note 317, à la p367. 325 Victor Nabhan, op. cit., note 323. 326 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 71, à la p 88.

72
différentes conceptions du droit d’auteur. En effet, le droit canadien a pour ancrage le système
du copyright et revendique, à cet égard, le fair use. Une fracture avec le droit français qui tend
à se résorber sous l’influence mêlée de la liberté d’expression et du contrôle de proportionnalité.
En tout état de cause, l’émergence et le développement des œuvres transformatives,
objets juridiques d’un genre nouveau voire inédit, sont lourds de conséquences pour le droit
d’auteur à de multiples égards. Sous l’angle de la titularité, il apparaît que très souvent, les
créateurs contournent la nécessité d’obtenir l’autorisation de reprendre l’œuvre première.
Parallèlement, la capacité d’adaptation du droit d’auteur pose question. Ces œuvres tendent,
justement, à mettre en exergue l’absence de véritable droit d’adaptation en droit français.
Curieusement, en effet, le Code de la propriété intellectuelle ni ne le mentionne ni ne le
règlemente ; sûrement car il découle des grandes prérogatives patrimoniales et que le code s’en
tient à la conception synthétique. Or, le droit d’adaptation doit, tout de même, faire l’objet d’une
cession distincte. En réalité, la difficulté à appréhender l’œuvre transformative réside dans le
fait que cette dernière sollicite de manière simultanée les droits patrimoniaux et moraux. Cela
a pour effet d’en brouiller la distinction classique du droit d’auteur et d’entraîner leur
imbrication. Surtout, les œuvres transformatives exacerbent la liberté d’expression artistique,
la façonnent sous d’autres formes et la démultiplient. Face à cela, se débat un droit d’auteur
rabougri tombé en désuétude.
La problématique des œuvres transformatives, tangible et concrète en pratique, s’est
propagée aux tribunaux et représente, au terme d’un processus de judiciarisation, une part non
négligeable d’un contentieux qu’elle alimente sans interruption. L’arrêt Klasen déjà avait été
rendu au sujet d’une œuvre transformative. À ce titre, il fait le lien entre œuvre transformative
et liberté d’expression. Le phénomène de la création transformative, par sa pluralité, met aux
prises de nombreux acteurs, de l’artiste internationalement renommé à l’anonyme : « La
marque de fabrique de [la création transformative], c'est d'être fait par “monsieur tout le
monde”, à ce point indifférencié qu'on ne lui reconnaît pas directement la qualité noble de
l'auteur […] ainsi le générateur [du contenu] à cause de sa qualité d’amateur est traité souvent
comme un auteur de seconde catégorie, “au rabais”, moins légitime à opérer le piratage de
revenus »327. L’affaire Koons328 est particulièrement éclairante des évolutions récentes en la
matière.
327 Valérie-Laure Benabou, « Quelles solutions pour les UGC en France », (2015) 25 Jurisart 20. 328 Trib gr inst Paris, 9 mars 2017, 15/01086.

73
L’artiste avait réalisé une sculpture reprenant les caractéristiques des photographies de l’artiste
Jean-François Bauret, spécialisé dans la photographie de nus. Alors qu’une exposition, au cours
de laquelle la sculpture devait être présentée au public, allait se tenir, les ayants-droit du
photographe s’y opposèrent. L’arrêt, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, indique
que la contrefaçon par adaptation non consentie ne porte pas une atteinte disproportionnée à la
liberté d’expression. En l’occurrence, la contrefaçon réside dans la reproduction des catalogues
relatifs à l’exposition. L’adaptation litigieuse méconnaissait le droit au respect du photographe,
dans sa substance comme dans son esprit ainsi que son droit de paternité. Pour s’exonérer de
l’acte de contrefaçon allégué et justifier la reproduction postérieure, le défendeur, cherchant à
bénéficier de la jurisprudence Klasen, décide alors d’invoquer l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme, « comme instrument de contournement des dispositions
légales définissant les contours du droit exclusif et l'objet et les conditions des exceptions »329.
Un argument réfuté par le tribunal jugeant « qu’à défaut de justifier de la nécessité de recourir
à cette représentation d'un couple d'enfants pour son discours artistique sans autorisation de
l'auteur, la mise en œuvre du droit d'auteur des demandeurs ne constitue pas une atteinte
disproportionnée à la liberté d'expression ». A contrario, « l'invocation de la liberté de création
serait pertinente si la reprise de l'œuvre préexistante est nécessaire à l'artiste pour véhiculer son
discours. Selon cette approche, la liberté de création primerait la logique du droit d'auteur, si
l'œuvre empruntée possède une valeur iconique »330.
L’incapacité du droit d’auteur à se saisir efficacement de la création transformative,
emblème d’une liberté d’expression dont chacun entend se prévaloir est symptomatique de
l’inadaptation du régime juridique en l’état. Le professeur Valérie-Laure Benabou évoque, à ce
sujet, « l’imparfaite adéquation de ce phénomène de création avec les canons français de la
propriété intellectuelle »331. L’application des exceptions étant très fréquemment artificielle ou
dépourvue de pertinence, les droits fondamentaux s’y sont rapidement substitués en l’absence
d’alternatives envisageables. Le changement de paradigme à l’étude condamne l’équilibre
historique de la matière et implique d’en repenser de nombreux paramètres sans quoi le droit
d’auteur sera condamné à péricliter (b).
329 Frédéric Pollaud-Dulian, « Adaptation non autorisée. Photographie. Œuvre transformative. Liberté de création.
Parodie. Droit moral » (2017) 3 Revue trimestrielle de droit commercial 353. 330 Édouard Treppoz, « Retour sur la liberté de création : à propos de l’affaire Koons » (2017) 46 Jurisart 3. 331 Valérie-Laure Benabou, op. cit., note 327, à la p 20.

74
b. La liberté d’expression, catalyseur du déclin du droit d’auteur ?
À ce stade de notre étude, il est manifeste que la liberté d’expression augure des
bouleversements majeurs pour le droit d’auteur dont de nombreux ont déjà été amorcés.
L’obstacle qu’il rencontre est d’une telle ampleur qu’il est légitime de s’interroger quant à la
pérennité de la matière et à la possibilité de son maintien au regard des conditions actuelles
lesquelles sont révélatrices d’un contexte où l’acuité et la légitimité du droit d’auteur sont
battues en brèche.
À l’aube du troisième millénaire, le Professeur Pierre Sirinelli, assistant au recul (déjà)
de la propriété littéraire et artistique désormais « confronté à l’appréhension des nouvelles
techniques comme à la concurrence du copyright »332, essayait d’anticiper l’avenir du droit
d’auteur. Un droit d’auteur « présenté comme bousculé » et dont la mort était « parfois
annoncée, sinon souhaitée »333. Après avoir postulé - non comme une vue de l’esprit mais
comme une perspective envisageable - la disparition du droit d’auteur, encore était-il bon de
nous renseigner sur les causes qui l’expliquaient. « Dans cette hypothèse, la disparition du droit
d’auteur pourrait être le fruit d’une initiative brutale ou la conséquence d’une évolution
inéluctable »334. Cette thèse repose sur le postulat en vertu duquel le droit d’auteur constituerait
davantage une entrave qu’une récompense en tant, par exemple, qu’il rend impossible, sauf
autorisation, la réalisation d’œuvres dérivées dont la naissance est tributaire des prérogatives
que possèdent les titulaires sur leurs œuvres premières. L’identification de ceux-ci et l’obtention
de leur autorisation, démarche ô combien fastidieuse, peut, à certains égards, paraître bien
décourageante. Ainsi, incapable de se moduler, car trop sclérosé, pour parvenir à s’adapter à la
révolution numérique et à ses conséquences, le droit d’auteur aurait vocation à s’éteindre335. À
la lecture de ces développements précurseurs, la tentation d’établir un parallèle avec l’objet de
notre étude est grande. À titre de comparaison, l’initiative brutale mentionnée consisterait en
l’introduction, par la Cour de cassation, du contrôle de proportionnalité alors que l’évolution
332 Pierre Sirinelli, op. cit., note 9. 333 Ibid. 334 Ibid. 335 Ibid.

75
inéluctable tiendrait à l’invocation de la liberté d’expression comme limite externe,
conséquence obligatoire de son hypertrophie.
Pourtant, à l’origine, il est difficilement concevable de se demander « comment un texte,
voué à la sauvegarde des droits de l’homme, pourrait-il menacer un droit, le droit d’auteur,
considéré comme un droit de l’homme »336. Hypothétique, cette perspective apparaissait
hautement improbable. Pourtant, l’émergence et la généralisation des droits de l’homme - dont
l’usage a été systématisé en jurisprudence - produisent des conflits de façon incessante.
« Aucune discipline juridique ne semble pouvoir échapper au raz-de-marée provoqué par
l’émergence des droits de l’homme »337 relevait le professeur Christophe Caron. Force est de
constater que le droit d’auteur n’a pas été épargné.
À présent, affirmer que la liberté d’expression menace le droit d’auteur relève de l’évidence. Il
y a d’abord eu le droit à l’information, instituant à regret « une certaine équipollence entre le
concept d’œuvre et celui d’information »338, auquel la liberté de création a succédé au terme
d’un passage de témoin éclair. Le responsable est connu. Il était soupçonné de longue date :
« L’article 10.1 de la Convention pourrait renfermer en son sein une terrible virtualité qui lui
permettrait de paralyser le droit d’auteur français, de l’anéantir. On constaterait alors une
situation des plus paradoxales : la CESDH ferait sonner le glas d’un droit de l’homme, le glas
du droit d’auteur »339. La prophétie s’est réalisée. Elle était attendue à condition d’avoir à
l’esprit que « chacun des prétendus droits de l’homme est la négation d’autres droits de
l’homme »340.
Sous l’impulsion de l’invocation grandissante - n’est-elle pas amenée à devenir permanente -
de la liberté d’expression, le droit d’auteur se mue en exception. Comment ne pas y voir le
triomphe du deuxième alinéa de l’article 10 de la Convention en vertu duquel les droits d’autrui
et, ainsi, les prérogatives de l’auteur constituent une ingérence à la liberté d’expression. Certes,
l’article 17 de la même Convention est censé à agir comme soupape de sécurité de façon à éviter
que les droits et libertés ne soient invoqués par les justiciables pour faire échec ou abolir les
droits de l’homme. Pourtant, il est relativement délicat de soutenir que l’invocation de la liberté
336 Christophe Caron, op. cit., note 86, à la p 9. 337 Id., à la p 10. 338 Ibid. 339 Ibid. 340 Michel Villey, Droit et les droits de l’homme, PUF, Paris, 1990.

76
d’expression, en propriété intellectuelle, ne poursuit pas l’objectif de contrecarrer l’application
du droit d’auteur, non pas isolément mais de manière récurrente.
À cet égard, l’arrêt Klasen est une porte ouverte à la déliquescence du droit d’auteur en tant
qu’il facilite le recours à la liberté d’expression et la rend opposable au droit d’auteur hors du
champ initialement prévu à cet effet et consacré par les exceptions. À terme, « le droit d’auteur
risque implicitement de devenir un sous-ensemble de la liberté d’expression »341. Si le droit
d’auteur ne l’est pas encore, ce constat serait la conséquence du postulat, et adopté et relayé par
les cours européennes, selon lequel la liberté d’expression, si supposée d’égale valeur aux autres
droits fondamentaux, est, en réalité, considérée comme supérieure342. Ce renversement de
philosophie343 appelle à une restructuration substantielle du régime du droit d’auteur et à une
actualisation de ses règles.
Surtout, l’arrêt Klasen est conforté par le contexte dans lequel il s’inscrit. Depuis des
années, se développe un mouvement - autrefois souterraine, l’hostilité est devenue publique - à
connotations politique et sociologique, qui voit dans le droit d’auteur un frein à la création et à
l’accès à la culture. Parmi les points d’achoppements - nous ne les évoquerons pas de manière
exhaustive -, une tension permanente se greffe sur la question de la gratuité. La promotion de
la gratuité tend, en effet, à remettre en cause le droit d’auteur synonyme de réservation, de
monopole économique et de rémunération. Pour cela, les revendications portant un idéal de
gratuité se fondent massivement sur la liberté d’expression. Cela démontre à quel point les
différentes thématiques sont indissolublement liées et constituent les pièces d’une seule
mosaïque.
Cette thèse reçoit, en pratique, une bonne réception et emporte l’adhésion de beaucoup. Or, le
droit de propriété intellectuelle a pour objet la conciliation des intérêts des titulaires et des tiers.
Il demeure, à tous les égards, ce « droit exclusif sur l’exploitation de leurs activités, avec le
corollaire en vertu duquel son exercice doit, pour une pleine efficacité, être renforcé par la
collectivité »344. Ce qui pose nécessairement la question de la réception du droit d’auteur par le
corps social. Privé du renfort de la société, son efficacité et sa légitimité s’en trouvent
341 Pierre-Yves Gautier et Alice Pézard, op. cit., note 54, à la p 8. 342 Id., à la p 12. 343 Id., à la p 12 : « Un droit exclusif, qui est un droit fondamental depuis la Révolution française, devient une
ingérence-exception à la liberté de création ». 344 Pierre-Yves Gautier, op. cit., note 22, introduction.

77
inexorablement amoindries. La marginalisation du droit d’auteur menace donc. D’autant que
ces velléités ne se cantonnent pas au public mais infusent la réflexion des juridictions : « À une
période où la promotion de la liberté de création en tant que démembrement de la liberté
d’expression est incontestable, il est probable que la protection de cette liberté soit mieux perçue
et donc mieux reçue, par le juge au premier titre, que celle du droit moral […] droit de
barrage »345. En France, le désamour du droit d’auteur est d’autant plus ressenti que la tradition
personnaliste et jusnaturaliste tend à s’édulcorer devant les considérations économiques et
utilitaristes de la propriété littéraire et artistique346.
Aussi plus que le droit d’auteur dans son ensemble, ce serait la conception personnaliste
qui serait en passe d’être abandonnée. Ce serait le dessein humaniste de la discipline et le
triptyque entre l’auteur, l’œuvre et son droit auxquels on renoncerait. Jugée inadéquate, cette
vision de la matière connaît un net recul sous l’influence des logiques du copyright et de la
révolution numérique mais aussi, indubitablement, de la montée en puissance de la liberté
d’expression en tant que fondement de ceux-ci347. Pourtant, le droit d’auteur a, à de maintes
reprises, fait montre d’une capacité d’adaptation et d’une résilience impressionnantes. La
matière a connu de profonds bouleversements qu’elle a su intégrer au prix de contorsions
habiles, cela sans se délester des obligations et finalités qui sont les siennes. Pour cela, elle peut
se fonder sur les armes à sa disposition parmi lesquelles sa plasticité. Composé de notions-
cadres et, donc, malléables, le droit d’auteur se module avec aisance.
Dès lors, est-il justifié d’évoquer un droit d’auteur en crise348 ? Indécise compte tenu de
la vigueur de la matière, y compris quand elle fait face à des obstacles conséquents, la question
mérite d’être posée. Il est à parier que la réponse à apporter ne pourra être trouvée qu’en prenant
en considération l’essor de la liberté d’expression et ses multiples implications. Il nous
semblerait possible, en revanche, de formuler le constat que, pour reprendre les mots du
professeur Michel Vivant, « si l'Angleterre est sans doute toujours une île, la France a peut-être
cessé de l'être »349 (2).
345 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 16. 346 Carine Bernault, André Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, op. cit., note 1, à la p 50. 347 Pierre-Yves Gautier et Alice Pézard, op. cit., note 54, à la p 8. 348 Alexandra Bensamoun, « Portrait d’un droit d’auteur en crise » (2010) 224 Revue Internationale de Droit
d’Auteur 3. 349 Michel Vivant, « La balance des intérêts… enfin » (2015) 10 Communication Commerce Électronique 9.

78
2. Le rétablissement souhaitable de la liberté d’expression dans ses délimitations
d’origine
L’élargissement du champ de la liberté d’expression n’est pas innocent. Il reproduit,
certes, la logique d’expansion que l’expérience nous oblige d’assigner aux droits
fondamentaux mais témoigne également d’une forme d’instrumentalisation. La liberté
d’expression est dévoyée devenant ainsi, peu à peu, un appendice de son orbite d’origine (1).
Conscient de sa nécessité et de son acuité quand l’exercice de la liberté d’expression est
conforme à ses finalités intrinsèques, nous militons pour une prise en considération de celle-ci
sans qu’elle ne s’opère au détriment du droit d’auteur (2).
a. L’instrumentalisation regrettable de la liberté d’expression, cheval de Troie d’un fair use
européen
« Depuis une vingtaine d'années, la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme est devenue le Saint Jude ou la Sainte Rita des plaideurs en mal d'arguments légaux.
Le droit d'auteur n'échappe pas à ce phénomène : de plus en plus souvent, les défendeurs en
contrefaçon objectent des libertés à un droit qui est pourtant lui-même l'un des droits de
l'homme »350.
Entreprendre une tentative de délimitation des périmètres respectifs du droit d’auteur et
de la liberté d’expression semble s’imposer dès lors que le premier se conçoit désormais comme
une ingérence à la seconde. Mais n’était-il pas contraint d’en devenir une au regard de
l’élargissement de la liberté d’expression ? Autrefois, prise en considération à travers les
exceptions à des conditions très restrictives - le droit d’auteur est alors la matrice de base - elle
s’érige en limite externe, rétrécissant de fait le champ d’application dans une relation de vases
communicants. Ce déplacement du centre de gravité a pour conséquence que ce sont désormais
les restrictions imposées au motif de l’application du droit qui s’interprètent étroitement.
Admettre l’invocation par les justiciables de la liberté d’expression fait peser sur celle-
ci des risques d’instrumentalisation. Elle serait alors dévoyée de sa finalité par des artistes ou
350 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 263.

79
encore des intermédiaires techniques peu scrupuleux afin de contrecarrer le droit d’auteur et
d’en neutraliser les effets. Cela, alors que l’application du droit d’auteur serait légitime. En
effet, « quelle partie poursuivie cherchera encore demain à se prévaloir des exceptions et leurs
conditions strictes, si l’invocation du droit derrière l’exception permet d’échapper à la sanction
là où les exceptions ne l’auraient justement pas permis »351 ? Chaque contrefacteur pourra,
désormais, prétendre à un examen in concreto en invoquant sa liberté d’expression. S’en suit
une confusion au terme de laquelle le contrefacteur aurait le même droit, a minima d’égale
valeur, que sa victime. Pire, l’éventuel contrefacteur s’accaparerait un droit d’auteur infondé.
Pourtant, la liberté de créer n’équivaut pas à la liberté d’annexer l’œuvre d’autrui352.
Sur le plan théorique, cela participe d’une conception du droit d’auteur dite fonctionnelle où
l’objectif prend le pas sur l’acuité et la pertinence du droit353. Cette enchaînement de
conséquences indues puise directement dans la fondamentalisation : « L’irruption des droits
fondamentaux sur la scène juridique a fait évoluer la situation en donnant des armes à une
certaine doctrine plaidant pour un nouvel équilibre plus favorable »354. Le professeur André
Lucas, à l’aube de la fondamentalisation du droit d’auteur, avait d’ailleurs donné son sentiment,
pour le moins mitigé, à ce sujet. En y posant un regard rétrospectif, ses mots prennent tout leur
sens :
« Une telle consécration permet d’assurer la promotion du droit d’auteur au plan international, et on
peut nourrir l’espoir qu’elle contribue à asseoir sa légitimité auprès des utilisateurs qui n’en sont pas
spontanément convaincus. Il n’est pas certain, toutefois, qu’elle produise beaucoup de fruits. Il n’est
même pas à exclure que, de façon paradoxale, elle se retourne contre les auteurs eux-mêmes. La
« privatisation » des droits fondamentaux incite, en effet, les utilisateurs des œuvres à se réclamer
eux-mêmes des droits qui leurs sont reconnus à ce titre, à commercer par la liberté d’expression,
pour élargir la portée des exceptions au droit exclusif admises par la loi ou même pour en faire
admettre de nouvelles »355.
Les droits fondamentaux sont, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques irréductibles,
susceptibles de détournement. Le dévoiement dont ils font l’objet leur porte préjudice sans le
moindre doute. À l’origine, la liberté d’expression n’avait, probablement, pas vocation à être
invoquée à souhait dans des contentieux privés et à se muer en outil de neutralisation des droits
351 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 15. 352 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 263. 353 Pierre-Yves Gautier, op. cit., note 22, à la p 24 : « Il s’agit de chercher à atteindre un objectif coûte que coûte,
en instrumentalisant le droit d’auteur ». 354 André Lucas et Jane Ginsburg, op. cit., note 57, à la p 49. 355 Carine Bernault, André Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, op. cit., note 1, à la p 34.

80
subjectifs. Sa légitimité n’en est que réduite. La liberté perd de son intensité et de son effectivité.
« À trop souffler sur la flamme, on risque de l’éteindre »356.
Parallèlement, depuis longtemps, « le droit d’auteur violeur de Droits de l’Homme est un thème
ressource pour les défenseurs d’intérêts économiques particuliers qui veulent […] en réduire la
portée »357. En réalité, ces derniers appellent de leurs vœux l’admission d’un avatar de fair use.
Il est un euphémisme que de dire que le système fermé des exceptions ne fait pas
consensus et suscite de nombreuses réserves. Jugé insatisfaisant, des alternatives dans le sens
d’une plus grande souplesse lui ont été envisagées, à l’image de l’établissement d’une limite
externe au droit d’auteur directement fondée sur la liberté d’expression. Les développements
jurisprudentiels récents s’inscrivent dans le prolongement de cette idée. Une tendance qui,
rapidement, fait ressurgir au sein de la doctrine le spectre du fair use, cette fois converti aux
spécificités européennes : « Une tendance se fait jour en faveur d’une limite externe tirée de
l’article 10 de la CESDH impliquant la mise en œuvre d’un test de proportionnalité lequel
pourrait aboutir à une sorte de fair use européen »358.
Le fair use est, à l’origine, une création prétorienne de tradition anglo-saxonne. Depuis codifié
- il a été instauré aux États-Unis par l’article 107 du Copyright Act de 1976359 -, il désigne une
exception générale et ouverte dont l’application annule le caractère contrefaisant d’une
utilisation qui, en son absence, le serait. Les avantages et les inconvénients de ce système sont
connus de longue date. La flexibilité et la souplesse conférées ont pour pendant une forte
insécurité juridique : « Les critères, larges et flexibles, voire manipulables, donnent une grande
souplesse à l’appréciation du fair use, ce qui, d’une part, a permis à l’exception de s’adapter à
de nouveaux moyens d’expression et de communication d’œuvres, mais, d’autre part lui donne
un caractère parfois imprévisible »360.
Si l’on exclue la perspective récente d’une limite externe, le fair use apparaît profondément
antinomique du système européen. Là où les exceptions sont d’interprétation stricte, encadrées
par le triple test et revêtent un caractère exhaustif, le fair use permet d’en redessiner les contours
356 François Terré dans Rémy Cabrillac, op. cit., note 36, à la p 3. 357 Philippe Gaudrat dans Alexandre Zollinger, op. cit., note 10, préface. 358 André Lucas et Jane Ginsburg, op. cit., note 57, à la p 7. 359 US Copyright Act of 1976, Pub L No 94-553, 90 Stat 2541, art 107. 360 André Lucas et Jane Ginsburg, op. cit., note 57, à la p 11.

81
pour en moduler la portée de telle que, selon André Lucas, « on ne peut faire semblant de croire
qu’il est eurocompatible qu’à la condition de faire table rase de la tradition des pays de droit
d’auteur et la directive sur la société de l’information, laquelle a clairement pris parti pour un
système fermé »361. Les pays de tradition continentale sont, en effet, particulièrement rétifs à
l’introduction d’un fair use aux antipodes des logiques historiques de leurs droits respectifs :
« Il est préférable que le fair use reste au droit d’auteur ce que le gratin de patates douces à la
guimauve, incontournable de Thanksgiving, est à la gastronomie : une spécialité locale... »362.
Et si, sur ce point, les clivages, autrefois réputés intangibles, étaient à présent susceptibles d’être
dépassés sous l’impulsion de la Cour de cassation et de sa jurisprudence ?
L’arrêt Klasen est-il le cheval de Troie d’un fair use à l’européenne ? Difficile de se
prononcer en substance tant les modalités de la balance des intérêts et du contrôle de
proportionnalité qui l’opère demeurent, pour l’heure, inconnues. Une balance des intérêts qui,
par ailleurs, ne prétend pas au même usage que le fair use. Là où « le fair use tend à tend à
considérer le droit d'auteur comme une composante parmi d'autres de l'ordre juridique général
qu'il faut appréhender dans son ensemble »363, la balance des intérêts exige d’apprécier une
situation juridique à l’aune des droits fondamentaux. D’autant que l’argument tiré de
l’invocation de la liberté d’expression, si admis, n’a pas encore reçu de suite favorable par les
juges du fond. En l’état, l’absence de précisions supplémentaires sur les critères à manier - en
dehors du contexte dans lequel joue la liberté d’expression, variable d’ajustement de la marge
de manœuvre des États - par les juges fait échec à une éventuelle comparaison avec ceux du
fair use. Surtout que la liste des critères n’est pas définitivement arrêtée et, donc, susceptible
d’évoluer. Dans son arrêt Pirate Bay susmentionné, la Cour européenne des droits de l’homme
recommande d’intégrer à son appréciation l’ensemble des éléments de faits de nature à influer
sur la proportionnalité recherchée364. Ces éléments alimentent de nombreuses conjectures,
invérifiables pour l’heure.
Pour autant, le doute est permis et les éléments en présence ne sauraient le dissiper à l’image
de la proximité entre système ouvert et limite externe, entre usage raisonnable et usage
proportionné. Pire, ils produisent l’effet inverse à mesure que le curseur se déplace vers la
361 André Lucas, op. cit., note 4, à la p 131. 362 André Lucas, « Note sous U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 16 octobre 2015, The Authors Guild
et autres contre Google Inc » (2016) 58 Propriétés Intellectuelles 59, à la p 61. 363 Michel Vivant, op. cit., note 349. 364 André Lucas et Jane Ginsburg, op. cit., note 57, à la p 77.

82
liberté de création. Dès lors, sur le modèle du fair use américain, le contrôle de proportionnalité
induirait une protection aux frontières mouvantes et au champ d’application réductible. Ce
serait d’autant plus remarquable au regard de l’intransigeance du droit interne et de la réticence
à l’échelle européenne. La Cour de justice a, en effet, récusé l’idée de métamorphoser le triple
test en fair use. Selon André Lucas, si la proposition de recourir au fair use devait lui être
soumise, la Cour s’y refuserait, privilégiant de fait « une approche minimaliste consistant à
réserver le correctif de la liberté d’expression à des cas exceptionnels, par exemple lorsque le
droit d’auteur est brandi pour s’opposer à la diffusion d’un message à connotation politique »365.
Mais, « chassez le « fair use » par la porte (c'est-à-dire en refusant de retourner le sens du triple
test pour fonder ou élargir des exceptions), il revient par la fenêtre »366.
Ainsi, la liberté d’expression, au moyen d’une conception critiquable, est invoquée pour
déverrouiller le droit d’auteur, pour en desserrer l’étreinte367. Sous le besoin de souplesse,
légitime, s’abrite la volonté incontestable de contourner les règles posées par le législateur. Une
telle flexibilité incite à exploiter les marges de tolérance. La brèche a été ouverte, nombreux
sont ceux qui s’y engouffreront. Or, c'est, à notre sens, « un dévoiement de la liberté […] que
de l'opposer au droit d'auteur et d'en faire un instrument d'affaiblissement de ce dernier, alors
que la dialectique véritable entre les deux institutions est, au contraire, fondée sur leur
complémentarité »368 (b).
b. Plaidoyer en faveur d’un équilibre plus vertueux et pérenne entre droit d’auteur et liberté
d’expression
L’harmonie entre droit d’auteur et liberté d’expression s’est, manifestement, délitée369.
Partisans des deux camps s’affrontent vainement alors, qu’au sein des institutions, le débat est
phagocyté par l’activité de lobbys toujours plus envahissants. Les orientations prises sont de
natures éminemment politique et sociale, aspects prééminents qui tendent à édulcorer la
nécessité d’une bonne articulation juridique. D’autant que l’univers juridique, comme en atteste
365 André Lucas, op. cit., note 57, à la p 77. 366 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 263. 367 Bernard Edelman, op. cit., note 87 : « Il est inconcevable qu'on en appelle aux droits de l'homme pour
amoindrir sinon un autre droit de l'homme […] méga-droit de l’homme ». 368 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 263. 369 Philippe Pares, « La conception française du droit d’auteur » (1954) 1 Revue Internationale de Droit d’Auteur
3, à la p 3 : « Il est remarquable de constater que plus un pays s’élève dans le respect de la pensée créatrice, et plus
il attache d’importance à l’élément moral du droit d’auteur ».

83
le recours au contrôle de proportionnalité, se révèle de plus en plus poreux à l’égard des faits
sociaux et des démarches politiques. Ce ne sont pas là des souhaits d’épure que d’aspirer à un
meilleur équilibre qui garantirait l’effectivité du droit d’auteur et ménagerait des espaces
suffisants à la liberté d’expression tout en insistant sur la nécessité réciproque des deux.
La recherche d’une articulation capable de concilier les intérêts de chacun, souvent
antagonistes, est un exercice délicat, d’une rare complexité, qui doit être abordé avec la plus
grande prudence. Accorder une marge trop importante au droit d’auteur conduirait à brider la
liberté d’expression. La configuration inverse induirait une protection incertaine et relative des
œuvres.
La liberté d’expression se définit comme la pierre angulaire des démocraties modernes. Dans
les sociétés contemporaines, les démembrements successifs de la liberté d’expression - droit du
public à l’information, liberté de création et autres - répondent tous d’un besoin impérieux à tel
point qu’il s’agit, aujourd’hui, de déterminer si la liberté d’expression artistique est de même
niveau que la liberté d’expression politique qui jouit des faveurs que lui accordent les cours
européennes370.
À ce titre, la liberté de création est, évidemment, essentielle. « Tout acte de création est d’abord
un acte de destruction »371. De suite, nous viennent naturellement à l’esprit les variations de
Picasso à partir de réalisations de grands maîtres372. En art contemporain, le courant
appropriationniste revendique l’emprunt conscient d’œuvres préexistantes pour mieux s’en
affranchir et servir la réflexion proposée. « Dans ces hypothèses, la démarche créatrice de
l’artiste trouve son origine, son impulsion dans la déconstruction d’œuvres antérieures. Et si
pareille démarche déconstructrice est possible, c’est que la liberté de création offre une telle
latitude […] l’artiste s’inspire, puise dans les œuvres préexistantes, pour mieux s’en émanciper.
En quelque sorte, la personnalité de l’auteur s’imprime alors dans l’œuvre seconde par
contraste. La réutilisation devient un moyen de se démarquer, d’exprimer sa propre identité
artistique par opposition à celle de l’auteur de l’œuvre première et, partant de faire œuvre
originale »373.
370 Pierre-Yves Gautier et Alice Pézard, op. cit., note 54, à la p 14. 371 Christian Zervos, « Conversations avec Picasso », (1935), Cahiers d’Art 173. 372 Le Déjeuner sur l’herbe de Picasso s’inspire d’un tableau de Manet lui-même inspiré d’une œuvre de Giorgione
et du Titien. 373 Julie Groffe, op. cit., note 3, aux p 5 et 6.

84
Le droit d’auteur n’en est pas moins capital. Or, ces dernières années, a souvent été fait le
constat inverse, ce qui a conduit une frange de la doctrine à adopter une position de repli sur
soi. La prise en considération accrue de la liberté d’expression est concomitante à la
marginalisation du droit d’auteur, cible d’une hostilité farouche. C’est que le droit d’auteur a
perdu en intelligibilité et que son utilité échappe - à tort - à beaucoup. Et pour cause, la politique
menée en la matière, notamment à l’échelle de l’Union européenne qui s’est progressivement
érigée en centre de gravité, peine à démontrer une ligne directrice, un fil conducteur qui
garantirait la cohérence des directives successives374. Le législateur fait montre d’un réflexe
schizophrène qui consiste à promouvoir un principe ou poursuivre un objectif avant de
convoquer, peu après, des intérêts incompatibles ou de poser le principe contraire. Cela se
vérifie en droit d’auteur et, pour s’en convaincre, il suffit d’observer les lignes de force qui se
dessinent à l’échelle de l’Union : « la fascination pour l'évolution technologique ; l'idée que le
droit d'auteur n'est digne d'intérêt que parce qu'il appartient à un secteur économique important
; la volonté d'abolir les dispositions et pratiques à effet territorial ; l'hostilité latente à l'égard du
droit exclusif ; l'indifférence aux aspects extrapatrimoniaux […] la dimension consumériste,
qui lui permet de justifier une approche restrictive du droit d'auteur en même temps qu'une
faveur constante aux diffuseurs et prestataires de l'Internet »375. Difficile, en effet, d’entrevoir
un cap pour le droit d’auteur appréhendé souvent à des travers des prismes qui ne le concernent
qu’indirectement : économie numérique, libre concurrence, … D’ailleurs, le législateur
européen attribue souvent au droit de propriété intellectuelle une justification qui lui est
extérieure et, en conséquence, fragile376. Il en va de pair à l’aune des rapports entre droit
d’auteur et liberté d’expression. Le « rapport Reda »377 a pour objectif de remodeler le droit
d’auteur à partir de la figure du consommateur, nouvel épicentre. Considérant, au terme d’une
vision tronquée, le droit d’auteur comme superfétatoire, il prône une démultiplication des
exceptions et l’instauration d’un système analogue au fair use. Il était pourtant prévu que
l’harmonisation du droit d’auteur s’opère « par le haut » afin de garantir le niveau de protection
le plus élevé. Ce qui était encore une gageure risque de devenir chimère.
374 Frédéric Pollaud-Dulian, op. cit., note 196. 375 Ibid. 376 Ibid. 377 Julia Reda, Rapport sur l’évaluation et la révision de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur, 20 janvier
2015.

85
En droit interne, l’équilibre entre droit d’auteur et liberté d’expression était assuré par
le législateur à travers les exceptions, les limites classiques du monopole ou encore la
discrimination entre ce qui est protégeable et ce qui ne l’est pas. Les droits exclusifs, quant à
eux, étaient conférés, bien évidemment aux créateurs, mais également à ceux qui la rendent
possible en la finançant378. Ce sont là autant de manifestations de la prise en considération de
la liberté d’expression. Le Professeur Julie Groffe insiste sur cette volonté d’équilibre :
« Il ne s’est jamais agi en effet de considérer en ce domaine que les droits et libertés des tiers
devaient systématiquement s’effacer devant les prérogatives de l’auteur […] Quelle que soit
l’exception considérée, il s’agit toujours d’une logique similaire : faire primer, à titre dérogatoire, le
droit ou la liberté d’un tiers sur celle de l’auteur […] Simplement - et la nuance crée une différence
de taille -, c’est le législateur qui réalise, en amont, cet équilibre. C’est lui qui détermine, lorsqu’il
choisit d’introduire une nouvelle exception dans le paysage du droit d’auteur français (exceptions
sont de transposition facultative), de quel côté doit pencher la balance […] Et si les exceptions ne
permettent pas de faire échec au droit moral, ce n’est nullement un oubli de la loi mais, au contraire,
une volonté de ne pas faire céder le droit moral dans pareilles hypothèses. Cela signifie également
que tout ce qui n’entre pas dans le champ de l’exception implique par définition un retour au
principe, savoir que c’est le droit d’auteur qui l’emporter sur l’intérêt concurrent au terme de la
balance opérée par la loi »379.
L’articulation ordonnée par le législateur est, pour l’instant, toujours d’actualité mais se trouve
concurrencée par le principe de la proportionnalité et la balance des intérêts, voués à s’y
substituer. Or, son efficacité, par rapport aux exceptions n’est pas démontrée380. Le mécanisme
privilégie des solutions d’espèce qui feraient primer, selon chaque cas, droit d’auteur ou liberté
d’expression. La méthode est vivement contestée pour de nombreuses raisons lesquelles ont été
évoquées précédemment. Parmi celles-ci, est soulignée son incapacité à instaurer des relations
plus harmonieuses au profit d’une logique concurrentielle redoutable alors qu’elle recherche
paradoxalement un juste équilibre : « Aussi générale, une telle invocation de la liberté de
création serait excessive et à terme destructive de l’effet incitatif du droit d’auteur. Elle romprait
l’équilibre entre protection et création, au détriment de la protection et à long terme de la
création »381.
378 Isabelle Pignard, op. cit., note 6, p 490. 379 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 15. 380 Alain Strowel et François Tulkens « Équilibrer la liberté d’expression et le droit d’auteur. À propos des libertés
de créer et d’user des œuvres » dans Alain Strowel et François Tulkens, Droit d’auteur et liberté d’expression,
Regards francophones, d’Europe et d’ailleurs, Larcier, 2006, à la p 21 : « Même si une exception légale se doit,
en principe, d’être interprétée de manière restrictive, l’effet résultant d’une consécration législative semble avoir,
en pratique, plus de poids en faveur de la liberté d’expression qu’une disposition tout à fait générale en matière de
liberté d’expression. IL est donc loin d’être acquis que l’invocation des dispositions de nature constitutionnelle en
matière de liberté d’expression soit le meilleur moyen de mettre en œuvre les exigences découlant de la liberté
d’expression, et ceux qui estiment que le droit d’auteur devrait davantage tenir compte de la liberté d’expression
et plaident pour la constitutionnalisation de cette question ne proposent pas nécessairement le bon remède ». 381 Édouard Treppoz, « Faut-il repenser l’objet du droit d’auteur ? Faut-il repenser le contenu du droit d’auteur ? »
(2012) 82 Revue Lamy Droit de l’Immatériel 99.

86
Introduit par la Cour de cassation en droit d’auteur interne, le contrôle de
proportionnalité se caractérise par son irréversibilité. C’est-à-dire qu’il est hautement
improbable que la Haute juridiction décide à l’avenir de revenir sur cette méthode après avoir
intimé aux juges du fond de l’adopter et de la mettre en œuvre. D’autant que les exceptions,
alternatives en l’état, ne présentent pas davantage de garanties. L’abolition du contrôle de
proportionnalité entre droit d’auteur et liberté d’expression n’étant pas à l’ordre au jour, la
doctrine s’attelle à envisager des moyens de le rationaliser, de le fondre dans l’ensemble
homogène de la matière et non d’en faire une excentricité moderne. D’aucuns préconisent, à ce
titre, un cantonnement du contrôle de proportionnalité. À partir du constat selon lequel le droit
moral s’émousse avec le temps et, donc, de l’évolutivité du droit, le Professeur Julie Groffe
milite pour une application post-mortem auctoris du mécanisme382. Dans l’arrêt Les
Misérables, les juges avaient pris en considération dans leur analyse le fait que l’œuvre en
question soit tombée dans le domaine public en vertu du principe, sous-jacent, que l’écoulement
du temps rabaisse la force du droit moral. Dans le prolongement de cette jurisprudence, il
conviendrait de faire du facteur temporel le critère d’application du contrôle de
proportionnalité383.
La logique de cantonnement par le temps nous paraît, en l’espèce, difficilement applicable.
D’emblée, le contrôle de proportionnalité a vocation à s’appliquer de manière uniforme, peu
importe les droits en présence et les mutations qu’ils connaissent. De plus, cela reviendrait à
nier le caractère perpétuel du droit moral. Cette proposition s’inscrit dans un mouvement plus
général qui conseille de borner le contrôle de proportionnalité, d’apposer des limites à son
application. Du côté des requérants, il est légitime de se demander, au regard de la pluralité des
modes de création, qui sera fondé à se voir reconnaître sa liberté de création : l’artiste renommé
ou n’importe quel internaute qui se prête au jeu des œuvres transformatives. Nécessairement,
au fil du contentieux, la qualification juridique d’auteur percuterait la notion sociologique de
l’artiste384. Pareillement, il apparaît tentant de vouloir cantonner le contrôle de proportionnalité
à certaines œuvres. Un embryon de contrôle était déjà mis en œuvre par la jurisprudence dès
lors qu’elle avait à se prononcer sur les œuvres architecturales. Il en résulte que les
modifications apportées à une œuvre architecturales ne sauraient constituer une atteinte à son
382 Julie Groffe, op. cit., note 3, à la p 26. 383 Id., à la p 31. 384 Édouard Treppoz, op. cit., note 58.

87
intégrité à condition qu’elles répondent à des besoins nouveaux, se limitent à ce qui est
strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi385.
Il est devenu impossible, en pratique, de sanctionner l’ensemble des œuvres transformatives
qui seraient contrefaisantes. Le meme réalisé par un internaute pour ses proches a peu à voir
avec la reprise d’une œuvre par Jeff Koons. Mais, à moins de créer une exception pour couvrir
certains usages, il semble difficile de différencier les œuvres selon leurs modalités de création.
Cela participerait d’un droit d’auteur à deux vitesses qui ne garantirait plus une même
protection aux œuvres - c’est d’ailleurs le reproche susceptible d’être fait aux critères de
substituabilité et de renommé mis au point par la décision de la cour d’appel de renvoi dans
l’affaire Klasen - et la bonne foi, indifférente en matière de contrefaçon, ne peut être prise en
compte.
En définitive, la proposition d’un cantonnement n’est que la reformulation des limitations aux
exceptions fondées sur la liberté d’expression. Les exceptions, en effet, sont encadrées par les
principes qui les régissent et le triple test. Il en va de même pour l’abus de droit. Selon le
professeur André Lucas, « ces correctifs ont en commun d’être cantonnés à des hypothèses
exceptionnelles et faire céder le droit exclusif de l’auteur lorsque l’utilisateur prouve que son
exercice dégénère en abus à cause des restrictions illégitimes qu’il apporte à la liberté
d’expression »386.
Comment, dès lors, réinjecter de la sécurité juridique dans les relations entre droit
d’auteur et liberté d’expression tout en préservant les intérêts des titulaires et des tiers ? Cette
interrogation s’inscrit pleinement dans la mission dont est investi le droit d’auteur, droit
conciliateur. Pour l’heure, l’équation demeure insoluble. Le changement est source
d’inquiétudes et une refonte totale de la matière pour y accorder plus de place à la liberté
d’expression n’est pas à espérer. En vérité, la recherche d’un équilibre est affectée par la
conception « tyrannique » de la liberté d’expression que beaucoup défendent. Il s’agit d’en faire
une liberté exorbitante placée hors de toutes frontières et au champ d’application sans cesse
élargi. Pourtant, son hypertrophie répond à celle dont le droit d’auteur a été, à raison, souvent
accusé. Pendant longtemps, le droit d’auteur a démontré des velléités impérialistes. Il a fait
l’objet d’une inflation de son champ d’application sous l’impulsion combinée du délitement de
385 CE, 11 septembre 2006, 265174. 386 Carine Bernault, André Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, op. cit., note 1, à la p 363.

88
la notion d’originalité - permissive, elle ne remplit plus son rôle de gendarme et accorde la
protection à des œuvres qui ne la méritent pas387 - et de la reconnaissance de droits toujours
plus forts, toujours plus élargis au bénéfice des titulaires et leurs ayants-droit. C’était là le
triomphe d’une conception d’un droit enfermé dans sa tour d’ivoire, évoluant en silo. Pour ces
thuriféraires, le droit d’auteur devait « rester immunisé à l’encontre des revendications fondées
sur la liberté d’expression »388. D’une certaine manière, défendre une telle vision du droit
d’auteur présageait ce qui allait advenir389.
La sacralisation du droit d’auteur n’est plus aussi franche qu’avant, rompant sous les coups de
boutoir reçus. On s’en réjouirait si ce n’était pas synonyme d’affadissement pour la matière.
« La liberté d’expression ne devrait pas davantage être sanctifiée, particulièrement à une époque
où les revendications - sous couvert de liberté d’expression - sont souvent émises par des
opérateurs commerciaux pour travestir des intérêts plus vénaux »390. D’ailleurs, « il n’y a
aucune raison de penser qu’elle devrait toujours prévaloir sur les autres droits et libertés
civiles »391.
La logique d’expansion, fortement préjudiciable à l’idéal d’équilibre392, n’est-elle pas inhérente
aux droits fondamentaux ? « Cette évolution atteste une perpétuelle adjonction de droits tendant
à prolonger et à renforcer de précédentes conquêtes, à élargir de plus en plus la marge de liberté
de chacun. De ces excès, résultent pour la liberté les plus pernicieuses menaces »393. Dans cette
hypothèse, le phénomène de la fondamentalisation serait la cause des rapports antagonistes des
droits qu’ils adoubent successivement. « La nappe nouvelle de garanties s’accompagne de
contrôles juridictionnels tendant à recouvrir toutes les manifestations de la vie sociale dans un
387 Alexandra Bensamoun, « La protection de l’œuvre de l’esprit par le droit d’auteur : “qui trop embrasse mal
étreint” », (2010) Recueil Dalloz Sirey 2919 ; Valérie-Laure Benabou, « L’originalité, un Janus juridique. Regards
sur la naissance d’une notion autonome de droit de l’Union » dans Mélanges en l’honneur du Professeur André
Lucas, LexisNexis, 2014. 388 Alain Strowel et François Tulkens, op. cit., note 380, à la p 9 : « Il n’est acceptable que le droit d’auteur soit
placé par ses zélotes dans un sanctuaire et qu’il demeure intouchable et inaccessible ». 389 Bernt Hugenholtz, « Copyright and freedom of expression in Europe dans Niva Elkin-Koren and Neil
Weinstock.Netanel, The Commodification of Information, Kluwer, 2002 : soucieux de la problématique posée par
l’expansion du droit d’auteur, l’auteur se demande si la « marée montante » du droit d’auteur peut être stoppée par
la force contraire de la liberté d’expression. 390 Alain Strowel et François Tulkens, op. cit., note 380, à la p 10. 391 Ibid. 392 François Terré dans Rémy Cabrillac, op. cit., note 36, à la p 4 : « L’élargissement démesuré des prérogatives
multiplie les antagonismes, développe exagérément l’interdépendance des sphères individuelles et asphyxie
finalement la société globale ». 393 Ibid.

89
contexte qui finit par mettre en cause l’existence même du droit »394. Or, les droits
fondamentaux devaient concourir à régénérer le droit d’auteur en non à en postuler le
crépuscule.
Ce pourquoi, au terme de cette étude, il semble que, pour cantonner le contrôle de
proportionnalité, encore est-il préférable d’agir en amont et, de fait, de circonscrire les droits
dans leurs délimitations précises. À cette fin, il apparaît salutaire de se remémorer l’essence et
la finalité premières assignées à chaque droit : sa fonction essentielle, en somme. Cette
« fonction essentielle » est un concept manié par la doctrine mais aussi, parfois, par la
jurisprudence supranationale. Soucieuses de concilier les droits fondamentaux et n’hésitant pas
à faire émerger des notions autonomes, les cours européennes sont régulièrement amenées à
s’interroger quant à la fonction essentielle des droits dont se prévalent les parties au litige. La
fonction essentielle désigne une forme de « noyau dur » au-delà duquel le droit fondamental
excède sa finalité ou son champ d’application395. En pratique, il s’agit, par exemple, des limites
d’ordre public apportées à la liberté d’expression par la fameuse loi de 1881396. Elle fixe, en la
matière, un régime répressif en vertu duquel les citoyens peuvent librement exercer leur liberté
d’expression sauf dans le cas où le comportement adopté constituerait une infraction à l’image
de la diffamation ou de l’incitation à la haine.
Droit d’auteur et liberté d’expression abritent, chacun, une ou plusieurs fonctions essentielles.
Le droit d’auteur a vocation à accorder à l’auteur une protection morale sur l’œuvre et une
rémunération en récompense de l’effort créateur397. La liberté d’expression, quant à elle, a pour
fonction ostensible de permettre la communication des idées et informations. Cet aspect
transparaît avec force dans le droit du public à l’information, démembrement de la liberté
d’expression. Dans le cadre de la liberté de création, s’agrègent à l’idée de communication,
deux autres finalités. La première, évidente, est de créer, de concevoir. Non pas créer à
n’importe quel prix mais créer pour y imprimer son empreinte, y fixer sa personnalité. C’est là
le second pendant de la liberté de création, duale dans sa fonction essentielle398.
394 Id., à la p 3. 395 Arnaud Latil, op. cit., note 16, à la p 65. 396 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 397 TPICE, 10 juillet, 1991, T-69/89, att 70. 398 Arnaud Latil, op. cit., note 16, à la p 64.

90
Dès lors, il conviendrait de limiter l’exercice du droit au prolongement de sa fonction essentielle
pour lutter contre les débordements du droit d’auteur et de la liberté d’expression. Le droit
d’auteur n’a pas vocation à entraver la création, pas plus que la liberté d’expression n’a pour
objectif de lui faire échec. Des instruments s’attachent à procéder au cantonnement à l’image
de la théorie de l’abus de droit et des exceptions mais aussi, plus récemment, du contrôle de
proportionnalité. Ici, le fond doit primer sur la forme : un équilibre et des limites effectives
doivent être garantis indifféremment des modalités de leur mise en œuvre.
Aussi, nous considérons que le conflit entre droit d’auteur et liberté d’expression est
soluble pour peu que l’on cantonne chaque droit dans ses limites respectives.

91
Conclusion
Le droit d’auteur n’est plus seul. Plus que jamais, il est tenu de composer avec les
notions qui l’encerclent. Autrefois situés à sa périphérie - les seules entrées admises ayant été
autorisées par un législateur soucieux de ne pas se montrer trop généreux -, les droits
fondamentaux ont pénétré la sainte chapelle du droit d’auteur et sont, de toute évidence,
déterminés à y demeurer. « La coexistence en matière de propriété intellectuelle est un chemin
de croix »399.
La liberté d’expression se réjouit davantage de la cohabitation qu’on lui propose.
Très vite, elle prend ses marques, fait ses gammes dans les cours européennes et, forte du succès
que suscite sa seule invocation, décide de s’exporter à la Cour de cassation sous le regard
complaisant d’un juge empreint de bienveillance.
L’avenir n’en est que plus incertain pour le droit d’auteur à mesure que l’horizon
s’assombrit. Confronté directement à la perspective de son inapplication prochaine, le droit
d’auteur est sommé de se repenser, de faire peau neuve, quel qu’en soit le prix. D’expérience,
il s’en sait capable mais l’histoire ne se répète que trop. Comme s’il lui appartenait de démontrer
qu’il était encore légitime alors que l’anathème qu’on lui jette peine à convaincre.
Pour le droit d’auteur, ce seraient là les affres de la modernité qu’on lui prédisait
douloureuse. Or, la modernité qu’on reconnaît volontiers à ceux qui s’en revendiquent
pernicieusement ambassadeurs - munis des droits qu’ils s’arrogent, ils sont prêts à déconstruire
les fondations d’un édifice bâti de longue date -, serait davantage à mettre au crédit de ceux qui
aspirent à sauvegarder le droit d’auteur et à lui assurer un lendemain.
La modernité, enfin, voudrait qu’on embrasse les droits fondamentaux et qu’on boude
la loi. Or, « laisser un auteur sans le secours du législateur c’est indiscutablement l’affaiblir
[…] car dans le rapport du faible au fort, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère »400.
399 Marie-Christine Piatti, « La copropriété intellectuelle, une institution contrastée » (2007) 21 Revue Lamy Droit
des Affaires 68. 400 Pierre Sirinelli, op. cit., note 9.

92
Bibliographie
Législation
Textes internationaux et régionaux
Directive CE, Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information, [2001] JOUE, L 167/10.
Directive CE, Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,
[2000] JOUE, L 178.
Textes français
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789.
Code de la propriété intellectuelle, JO, 3 juillet 1992, 8801.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, JO du 14 mars 1957.
Loi n°2006-961 du 1er aout 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société
de l’information, JO du 3 août 2006.
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur
internet, JO du 13 juin 2009.
Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle, JO du 2 mars 2012.
Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine, JO du 8 juillet 2016.
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JO du 8 octobre 2016.
Textes canadiens
Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, C-42.

93
Loi sur la modernisation du droit d’auteur, LC 2012, C42.
Texte étasunien
US Copyright Act of 1976, Pub L No 94-553, 90 Stat 2541.
Jurisprudence
Jurisprudence française
Trib gr inst Paris, 7 janvier 1969.
Trib gr inst Paris, 23 février 1999.
Trib gr inst Paris, 12 septembre 2001.
Trib gr inst Paris, 11 janvier 2002.
Trib gr inst Paris, 30 avril 2002.
Trib gr inst Paris, 6 novembre 2002.
Trib gr inst Paris, 13 mars 2014.
Trib gr inst Paris, 25 février 2016.
Trib gr inst Paris, 9 mars 2017, 15/01086.
CA Paris, 28 février 1995.
CA Paris, 30 mai 2001.
CA Paris, 31 mars 2004.
CA Paris, 26 mars 2010.
CA Paris, 18 septembre 2013, 12/02480.
CA Paris, 25 septembre 2015, 14/01364.
CA Paris, 13 octobre 2015, 14/08900.
CA Versailles, 16 mars 2018.

94
Cass civ 1re, 22 novembre 1966.
Cass civ 1re, 29 octobre 1990.
Cass civ 1re, 12 juin 2001, 98-22.591.
Cass civ 1re, 13 novembre 2003 n° 01-14385.
Cass civ 1re, 25 mai 2004, n° 01-17805.
Cass civ 1re, 1 mars 2005, 02-17.391.
Cass civ 1re, 1 mars 2005, 02-17.393.
Cass civ 1re, 7 mars 2006, 03-18.360.
Cass civ 1re, 5 décembre 2006, 05-11.789.
Cass civ 1re 30 janvier 2007, n° 04-15543.
Cass civ 1re 2 octobre 2007, n° 05-14.928.
Cass civ 1re, 4 décembre 2013, 12-26.066.
Cass civ 1re 15 mai 2015, n° 13-27391.
Cass civ 1re 22 juin 2017, n° 15-28467.
Cass crim, 5 février 2008, 07-81.387.
Cons constitutionnel, 10 et 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, 84-181 DC.
Cons constitutionnel, 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française, 94-345 DC.
Cons constitutionnel, 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, 94-352 DC.
Cons constitutionnel, 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel, Rec 2004, 2004-499 DC.
Cons constitutionnel, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la
société de l'information, Rec 2006 88, 2006-540 DC.
Cons constitutionnel, 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, 2008-562 DC.
Cons constitutionnel, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur
internet, Rec 2009, 2009-580 DC.

95
Cons constitutionnel, 28 février 2014, 2013-370 QPC.
Cons d’État, 19 mai 1933, Benjamin.
Cons d’État, 11 septembre 2006, 265174.
Jurisprudence européenne
CEDH, 24 mai 1988, Müller et autres c Suisse, aff 10737/84.
CEDH, 15 février 2006, Anheuser-Busch, aff 73049/01.
CEDH, 4 mai 2006, Alinak c Turquie, aff 34520/97.
CEDH 29 janvier 2008, Balan c Moldavie, aff 19247/03.
CEDH, 13 juillet 2012, Mouvement raëlien suisse c Suisse, aff 16354/06.
CEDH 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c France, aff 36789/08.
CEDH 19 février 2013, Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi c Suède, aff 40397/12.
CJCE, 12 septembre 2006, Laserdisken ApS c Kulturministeriet, aff C 479/04.
CJUE 29 janvier 2008, Promusicae c Telefonica, aff C275/06.
CJUE 16 juillet 2009, Infopaq International as c Danske Dagblades Forening, aff C-435/12.
CJUE 24 novembre 2011, Scarlet Extended, aff C70/10.
CJUE 1er décembre 2011, Eva Maria Painer c Standard VerlagsGmbH et autres, aff C145/10.
CJUE, 16 février 2012, Sabam c Netlog NV, aff C360/10.
CJUE, 27 juin 2013, VG Wort, aff C-457/11.
CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff C-466/12.
CJUE 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien c Constantin Film Verleih, aff C314/12.
CJUE 10 avril 2014, ACI Adam BV e.a. c Stichting de Thuiskopie et autres, aff C-435/12.
CJUE, 3 septembre 2014, Deckmyn, aff C-201/13.
TPICE, 10 juillet 1991, T-69/89.

96
Doctrine : Monographies
Bernault, Carine, André Lucas et Agnès Lucas-Schloetter. Traité de la propriété littéraire et
artistique, 5e éd, Paris, LexisNexis, 2017.
Cabrillac, Rémy. Libertés et droits fondamentaux, 23e édition, Paris, Dalloz, 20177, à la p 486.
Caron, Christophe. Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd, Paris, LexisNexis, 2015.
Chagnollaud, Dominique et Guillaume Drago. Drago, Dictionnaire des droits fondamentaux,
Dalloz, Paris, 2006.
Duve, Thierry de. Résonances du readymade. Duchamp entre avant-garde et tradition,
Hachette, 2006.
Desbois, Henri. Le droit d’auteur en France, 3e éd, Paris, Dalloz, 1978.
Gautier, Pierre-Yves. Propriété littéraire et artistique, 10e éd, Paris, PUF, 2017.
Latil, Arnaud. Création et droits fondamentaux, LGDJ, 2014.
Léger, Pauline. La recherche d'un statut de l’œuvre transformatrice. Contribution à l'étude de
l’œuvre composite en droit d'auteur, Université Paris-Sud, 2015.
Lesueur, Justine. Conflits de droits, illustrations dans le champ des propriétés incorporelles,
Presses Univ. Aix-Marseille, 2009.
Lucas, André, Pierre Sirinelli, Alexandra Bensamoun. Les exceptions au droit d’auteur, État
des lieux et perspectives dans l’Union Européenne, Paris, Dalloz, 2012.
Mancini, Anna. L’obsolescence du droit d’auteur et sa philosophie, Buenos Books
International, 2006.
Marguénaud, Jean-Pierre. La Cour européenne des droits de l'homme, 5e éd., Dalloz, Paris,
2011.
Montaigne, Essais, Hatier, Paris, 2012.
Montesquieu. De l’Esprit des lois, Flammarion, 1993.
Patino, Bruno. Le devenir numérique de l’édition : Du livre objet au livre droit, La
Documentation Française, 2008.
Pignard, Isabelle. La liberté de création, Université Nice Sophia Antipolis, 2013.
Pollaud-Dulian, Frédéric. Le droit d’auteur, 2e éd, Economica, 2014.

97
Pouillet, Eugène. Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit
de représentation, 3e éd, Paris, Marchal et Billard 1908.
Strowel, Alain et François Tulkens, Droit d’auteur et liberté d’expression, Regards
francophones, d’Europe et d’ailleurs, Larcier, 2006.
Villey, Michel. Droit et les droits de l’homme, PUF, Paris, 1990.
Vivant, Michel. Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, 2e édition, Paris, Dalloz, 2015.
Vivant, Michel et Jean-Michel Bruguière. Droit d’auteur et droits voisins, 3e éd, Paris, Dalloz,
2015.
Wistrand, Hugo. Les exceptions apportées aux droits de l’auteur sur ses œuvres, Paris, Éditions
Montchrestien, 1968.
Zolinger, Alexandre. Droit d’auteur et droits de l’homme, LGDJ, 2008.
Doctrine : Articles
Aynès, Laurent. « Moins de règles et plus de principes ? Le nouveau rôle du juge » (2017) 2
Revue de Jurisprudence Commerciale 174.
Azzi, Tristan. « La gratuité en droit d’auteur » dans Célia Zolynski et Nathalie Martial-Braz,
La gratuité, un concept aux frontières de l’économie et du droit, Lextenso éditions, LGDJ,
2013.
Bailly, Olivier. « Proportionnalité : vers un nouvel office du juge ? » (2016) 7 La Semaine
Juridique Édition Générale 333.
Barthes, Roland. « Théorie du texte » (1973) Encyclopedia Universalis.
Benabou, Valérie-Laure. « Puiser à la source du droit d’auteur » (2002) 192 RIDA 3.
Benabou, Valérie-Laure. « Retour sur dix ans de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne en matière de propriété littéraire et artistique : les méthodes » (2012) 43 Propriétés
intellectuelles 140.
Benabou, Valérie-Laure. « L’originalité, un Janus juridique. Regards sur la naissance d’une
notion autonome de droit de l’Union » dans Mélanges en l’honneur du Professeur André Lucas,
LexisNexis, 2014.
Benabou, Valérie-Laure. « Quelles solutions pour les UGC en France » (2015) 25 Jurisart 20.
Benabou, Valérie-Laure. « Klasen : quand le contrôle de proportionnalité dégénère en contrôle
de nécessité des œuvres » (2018) 3 Dalloz IP/IT 300.

98
Bensamoun, Alexandra. « La protection de l’œuvre de l’esprit par le droit d’auteur : “qui trop
embrasse mal étreint” », (2010) Recueil Dalloz Sirey 2919.
Bensamoun, Alexandra. « Portrait d’un droit d’auteur en crise » (2010) 224 RIDA 3.
Bensamoun, Alexandra. « Réflexions sur la jurisprudence de la CJUE : du discours à la
méthode (2015) 55 Propriété intellectuelles 139.
Bensamoun, Alexandra, Pierre Sirinelli. « Droit d'auteur vs liberté d'expression : suite et pas
fin...» (2015) 29 Dalloz 1674.
Bernault, Carine. « Le droit d’auteur dans la jurisprudence de la CJUE. Propos introductifs »,
(2015) 55 Propriétés intellectuelles 119.
Bruguière, Jean-Michel. « L’absence d’examen circonstancié déjà dans l’arrêt Les
Misérables », (2016) 39 Jurisart 22.
Bruguière, Jean-Michel. « Affaire Peter Klasen, les attentes déçues de l’arrêt de renvoi » (2018)
18 La Semaine Juridique Édition Générale 513.
Caron, Christophe. « La Convention européenne des droits de l’homme et la communication
des œuvres au public : une menace pour le droit d’auteur ? » (1999) 1 Communication
commerce électronique 9
Caron, Christophe. « La publication d’une “suite” d’une œuvre littéraire tombée dans le
domaine public ne peut être interdite en son principe » (2007) 7 La Semaine Juridique Édition
Générale 10025.
Caron, Christophe. « Contrefaire, c’est exprimer illicitement » (2013) 6 Communication
Commerce électronique 26.
Chénedé, François. « Petite leçon de réalisme juridique » (2017) 4 Recueil Dalloz Sirey 663.
Cohen, Dany. « La liberté de créer » dans Rémy Cabrillac, Libertés et droits fondamentaux,
23e édition, Paris, Dalloz, 2017.
Conte, Philippe. « Le droit n’est plus le tennis » (2016) 52 La Semaine Juridique Édition
Générale 2409.
Daleau, Jeanne. « Dialogue des Carmélites : Le couperet est tombé » (2017) 10 Dalloz IP/IT
536.
Edelman, Bernard. « Du mauvaise usage des droits de l’homme (à propos du jugement du TGI
de Paris du 23 février 1999) » (2000) 29 Recueil Dalloz Sirey 455.
Fulchiron, Hugues. « Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode » (2017) 12
Recueil Dalloz Sirey 656.
Fulchiron, Hugues. « Cadrer le contrôle de proportionnalité : des règles hors contrôle » (2018)
9 Recueil Dalloz Sirey 467.

99
Galopin, Benoît. « Conséquences de la nature constitutionnelle et européenne du droit
d’auteur : retour sur quelques décisions récentes » (2015) 243 Revue Internationale de Droit
d’Auteur 174.
Gautier, Pierre-Yves. « Contre la "balance des intérêts" : hiérarchie des droits fondamentaux »
(2015) 38 Recueil Dalloz Sirey 2189.
Gautier, Pierre-Yves, Alice Pézard. « Nouvelle méthode de raisonnement du juge ? L’arrêt de
la Cour de cassation du 15 mail 2015 sur le « juste équilibre des droits » (2016) 57 Legicom
2016 5.
Geiger, Christophe. « Les droits fondamentaux garanties de la cohérence du droit de la propriété
intellectuelle » (2004) 29 La Semaine Juridique Édition Générale 1313.
Geiger, Christophe. « Droit d’auteur et droit du public à l’information » (2005) Recueil Dalloz
Sirey 104.
Geiger, Christophe. « Droit d’auteur et liberté de création artistique : un fragile équilibre »
(2007) 26 Revue Lamy Droit de l’Immatériel 59.
Girardet, Alain. « Le rôle de la Cour de cassation dans les évolutions du droit d’auteur et des
droits voisins » (2017) 1 Communication Commerce Électronique 7.
Groffe, Julie. « Droit moral et liberté de création » (2017) 43 Revue Internationale de Droit
d’Auteur 5.
Haas, Charles de. « Quelques réflexions sur les origines de l'irrésistible émergence du principe
de proportionnalité avec balance des intérêts in situ » (2016) 61 Propriétés intellectuelles 418.
Hugenholtz, Bernt. « Copyright and freedom of expression in Europe dans Niva Elkin-Koren
and Neil Weinstock.Netanel, The Commodification of Information, Kluwer, 2002.
Henaff, Pierre. « L'oeuvre transformative – Sécuriser l'oeuvre transformative sans remettre en
cause le monopole de l'auteur de l'oeuvre préexistante ? » (2016) 4 Contrat Commerce
Électronique 8.
Kahn, Anne-Emmanuelle. « Dialogues des Carmélites : atteinte disproportionnée au droit
moral » (2016) 39 Jurisart 32.
Latil, Arnaud. « Contrôle de proportionnalité en droit d’auteur » (2016) 39 Jurisart 18.
Louvel, Bertrand. « Réflexions à la Cour de cassation » (2015) Recueil Dalloz Sirey 1326.
Louvel, Bertrand. « Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation
doit adapter ses modes de contrôle » (2015) 1122 La Semaine Juridique Édition Générale 1908.
Lucas, André. « Représentation contrefaisante d’une photographie sur les offres d’abonnement
d’un magazine » (2004) 46 La Semaine Juridique Édition Générale 10170.

100
Lucas, André. « Droit d’auteur, liberté d’expression et "droit du public à l’information" (libres
propos sur deux arrêts des Cour de cassation belge et française) » (2006) dans Alain Strowel et
François Tulkens, Droit d’auteur et liberté d’expression, Regards francophones, d’Europe et
d’ailleurs, Larcier, 2006.
Lucas, André. « Note sous Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 13 octobre 2015 » (2016)
8 Propriétés Intellectuelles 42.
Lucas, André. « Note sous U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 16 octobre 2015, The
Authors Guild et autres contre Google Inc » (2016) 58 Propriétés Intellectuelles 59.
Lucas, André. Jane Ginsburg. « Droit d’auteur, liberté d’expression et libre accès à
l’information (étude comparée de droit américain et européen) » (2016) 249 Revue
Internationale de Droit d’Auteur 4.
Malaurie, Philippe. « Les droits respectifs de l’auteur et du metteur en scène sur une œuvre
destinée au spectacle » (2017) 33 Recueil Dalloz Sirey 1955.
Marino, Laure. « Les droits fondamentaux émancipent le juge : l'exemple du droit d'auteur »
(2010) 30 La Semaine Juridique Édition Générale 1523.
Meuris, Florence. « Les œuvres transformatives : métamorphose du droit d’auteur » (2014) 11
Communication Commerce Électronique 2.
Nabhan, Victor. « L’exception de contenu non commercial généré par l’utilisateur en droit
canadien » (2016) 3 Dalloz IP/IT 156.
Pares, Philippe. « La conception française du droit d’auteur » (1954) 1 Revue Internationale de
Droit d’Auteur 3.
Piatti, Marie-Christine. « La copropriété intellectuelle, une institution contrastée » (2007) 21
Revue Lamy Droit des Affaires 68.
Pollaud-Dulian, Frédéric. « Droits moral et droits de la personnalité » (1994) 15 La Semaine
Juridique Édition Générale 8.
Pollaud-Dulian, Frédéric. « Droit de représentation. Retransmission par câble d’une
télédiffusion d’œuvres par satellite. Installation d’une antenne parabolique collective. Public
distinct. Articles L. 122-2 et 132-20 du CPI. Libertés de communication ou de réception des
programmes satellitaires » (2005) 2 Revue Trimestrielle de Droit Commercial 302.
Pollaud-Dulian, Frédéric. « Droit moral post mortem. Adaptation. Suite d’une œuvre tombée
dans le domaine public. Liberté de création. Dévolution successorale. Intervention
d’organismes professionnels » (2007) 3 Revue Trimestrielle de Droit Commercial 354.
Pollaud-Dulian, Frédéric. « Droit à l’information. Droit de propriété. CEDH. Reproduction
illicite », (2008) 2 Revue Trimestrielle de Droit Commercial 78.
Pollaud-Dulian, Frédéric. « Liberté de création. Droit d’adaptation. Droit moral. CEDH »
(2015) 3 Revue Trimestrielle de Droit Commercial 515.

101
Pollaud-Dulian, Frédéric. « Quo vadis lex ? La législation française sur le droit d'auteur dans
les affres de la modernité » (2016) 4 Revue Trimestrielle de Droit Commercial 641.
Pollaud-Dulian, Frédéric. « Adaptation non autorisée. Photographie. Œuvre transformative.
Liberté de création. Parodie. Droit moral » (2017) Revue trimestrielle de droit commercial 353.
Puig, Pascal. « L’excès de proportionnalité » 1 (2016) Revue Trimestrielle de Droit Civil 70.
Terré, François. « Sur la notion de droits et libertés fondamentaux » dans Rémy Cabrillac,
Libertés et droits fondamentaux, 23e édition, Paris, Dalloz, 2017.
Thomas-Raquin, Carole. Martin Le Guerer. « Pratique contentieuse. Le contrôle de
proportionnalité en droit d’auteur devant la Cour de cassation » (2018) 1 Communication
Commerce Électronique 50.
Savatier, René. « Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui »
(1959) 342 Revue Internationale de Droit Comparé.
Sirinelli, Pierre. « Le droit d’auteur à l’aube du 3ème millénaire » (2000) 1 La Semaine Juridique
Édition Générale 13.
Stojanovic, Mihailo. « La raison d’être du droit d’auteur » (1979) 4 Revue Internationale de
Droit d’Auteur 3.
Strowel, Alain. François Tulkens. « Équilibrer la liberté d’expression et le droit d’auteur. À
propos des libertés de créer et d’user des œuvres » (2006) dans Alain Strowel et François
Tulkens, Droit d’auteur et liberté d’expression, Regards francophones, d’Europe et d’ailleurs,
Larcier 2006.
Treppoz, Édouard. « Faut-il repenser l’objet du droit d’auteur ? Faut-il repenser le contenu du
droit d’auteur ? », (2012) 82 Revue Lamy Droit de l’Immatériel 99.
Treppoz, Édouard. « Klasen : liberté de création en tension » (2016) 39 Jurisart 28.
Treppoz, Édouard. « Retour sur la dénaturation contextuelle du Dialogues des Carmélites »
(2017) 352 Légipresse 438.
Treppoz, Édouard. « Retour sur la liberté de création : à propos de l’affaire Koons » (2017) 46
Jurisart 3.
Verpeaux, Michel. « Rappel des normes de référence dans le contrôle effectué par le Conseil
sur la loi “Droit d’auteur” (2007) 16 La Semaine Juridique Édition Générale 34.
Verpeaux, Michel. « La liberté de communication avant tout. La censure de la loi Hadopi 1 par
le Conseil constitutionnel » (2009) 39 La Semaine Juridique Edition Générale 274.
Vigneau, Vincent. « Libre propos d’un juge sur le contrôle de proportionnalité » (2017) 3
Recueil Dalloz Sirey 123.

102
Vivant, Michel. « La balance des intérêts… enfin » (2015) 10 Communication Commerce
Électronique 9.
Waschmann, Patrick. « La liberté d’expression » dans Rémy Cabrillac, Libertés et droits
fondamentaux, 23e édition, Paris, Dalloz, 2017.
Zenati-Castaing, Frédéric. « La juridictionnalisation de la Cour de cassation » 3 (2016) Revue
Trimestrielle de Droit Civil 511.
Zervos, Christian. « Conversations avec Picasso », (1935), Cahiers d’Art 173.
Zollinger, Alexandre. « Droit d’auteur et liberté d’expression : nécessité d’une appréciation de
proportionnalité in concreto » (2016) 5 La Semaine Juridique Édition Entreprise 57.
Zollinger, Alexandre. « Droit d’auteur et liberté d’expression : le discours de la méthode »
(2013) 5 Communication Commerce Électronique 7.
Zollinger, Alexandre. « Droit d’auteur et liberté d’expression : comment procéder à la balance
des intérêts in concreto (2017) 4 Communication Commerce Électronique 14.
Zolynski, Célia. « L’élaboration de la jurisprudence de la Cour de justice en droit de la propriété
littéraire et artistique » (2014) dans Mélanges en l’honneur d’André Lucas LexisNexis 813.
Autres sources
Documentation européenne
CE, Livre Vert, Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance, 2008.
Reda, Julia. Rapport sur l’évaluation et la révision de la directive 2001/29/CE sur le droit
d’auteur, 2015.
Documentation française
Lescure, Pierre. Mission « Acte II de l'exception culturelle » - Contribution aux politiques
culturelles à l'ère numérique, 2013.
Benabou, Valérie-Laure. Rapport de la mission du CSPLA sur les œuvres transformatives,
2014.