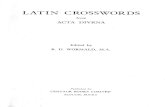Latin en Diacronia
-
Upload
emilio-zaina -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Latin en Diacronia
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
1/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
1
LCP1OP1Y : 25h 1er semestre
Olga SPEVAK : « Le latin en diachronie » (25H)
1er semestre, le lundi de 10h30 à 12h30
Présentation :
- Introduction : les âges du latin- Inscriptions : les premiers textes latins- Le latin archaïque et classique- Le latin « populaire » et le latin tardif- Évolution du latin vers les langues romanes
Bibliographie de base :- ERNOUT, A. 1957. Recueil de textes latins archaïques, Paris- HERMAN, J. 1970. Le latin vulgaire (Que sais-je 1247), Paris- VÄÄNÄNEN, V. 1981. Introduction au latin vulgaire, Paris
Exposés :L’authenticité de la Fibula Praenestina (Gordon, Arthur, The inscribed fibula, Berkeley/Los
Angeles, 1975, et www.linguistique-latine.org/html/fibule_preneste.html
Qui était l’auteur du Satiricon ? (article de R. Martin dans la Revue des Études latines)Égérie et son Journal de voyage (Pierre Maraval, Journal de voyage, Egérie (Itinerarium Egeriae), Sources chrétiennes 296, Paris, 1982)
1. IntroductionLes « âges » du latin
Le latin, tout comme d’autres langues, permet un découpage en trancheschronologiques (cf. français ancien, moyen, moderne).
1.1. Latin archaïque et pré-classiqueLe latin archaïque, depuis les origines à la fin du Ier siècle av. J.-C., nous est connu
grâce à des inscriptions, formules de lois, sénatus-consulte relatif aux Bacchanales 186. Versle 3e siècle avant J.-C., nous sommes à l’époque de la première et la deuxième guerre punique,la langue littéraire commence à se constituer : Livius Andronicus (285-204 traduction del’Odyssée en latin en vers saturniens), Naevius (270-200) et, plus tard, Ennius (239-169),Osque d’origine, qui a considérablement contribué à la généralisation de l’hexamètre dans lapoésie latine. Ces poètes archaïques nous sont connus seulement par des fragments.Heureusement, nous disposons de certaines œuvres intégrales de deux comiques, l’Ombrien
Plaute (254-181) et du Carthaginois Térence (190-159).
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
2/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
2
Des œuvres écrites en prose viennent plus tard et quelques unes sont conservées :Caton l’Ancien ou le Censeur (234-149) est l’auteur de Des origines (perdu), en sept livres, dela fondation de Rome jusqu’à 151, et d’un traité d’agriculture ( De re rustica).
Certains auteurs du 1er siècle avant J.-C., tels l’érudit Varron (116-27), auteur destraités de philologie ( De lingua Latina) ou d’agriculture ( Res rusticae), le poète épicurienLucrèce et le poète lyrique Catulle (87-54) sont comptés parmi les auteurs du latin pré-classique.
1.2. Latin classiqueLe latin classique, l’âge d’or du latin, désigne la période du milieu du 1e siècle av. J.-
C. jusqu’à (i) l’instauration du principat d’Octavien Auguste (-27) ou (ii) jusqu’à sa mort (14après J.-C.). L’apogée des lettres latines qui coïncide avec l’essor de la politique à cetteépoque. Le latin classique est une forme littéraire du latin qui se distingue d’un style élevé,d’une « norme syntactique », d’un vocabulaire exquis. Cette forme du latin, appréciée pour sa
perfection, est devenue référence pour des générations suivantes. Parmi les auteurs classiques,on compte les prosateurs : Cicéron (106-43), César (100-44), Salluste (86-35), et les poètes :Virgile (70-19), Horace (65-8 av.) et les poètes élégiaques Tibulle (54-19) et Properce (47-16/15).
Les partisans de la conception plus large du latin classique ajoutent l’historien de laRome antique Tite-Live (59-17 après J.-C.) et le poète Ovide (43-17 après).
1.3. Latin postclassiquePar le latin postclassique (âge d’argent), on désigne la période allant de la mort
d’Auguste (-14) à l’an 200 environ. C’est le « baroque » de la littérature latine qui, tout enrenouant avec le latin classique, à recours à l’affectation du style et à de nombreux empruntsd’éléments populaires et archaïques. Tel est le style, par exemple, de l’historien Tacite (56-117), le moraliste sentencieux Sénèque (4-65), Pline le Jeune (63-113). Or, à cette époque, il ya eu également des auteurs innovateurs : en particulier Pétrone (sous Néron, 14-66 ???) avecson Satiricon, et Apulée (sous les Antonins, 125-180) avec son récit fantaisiste( Métamorphoses ou l’Ane d’or ). En revanche, Quintilien (35-100)) cherche, avec son
Institution oratoire, à ramener l’éloquence à la pureté classique.
1.4. Latin tardifLe latin tardif (ou bas latin) est généralement situé entre l’an 200 environ et
l’avènement des langues romanes (7e /8e siècles). Cette période du latin mène jusqu’à la fin dela latinité proprement dite. À cette période remontent des œuvres des auteurs chrétiens : desdocteurs de l’église : l’Africain Tertullien (200), son compatriote saint Augustin (354-430), etle plus savants des Pères, st. Jérôme (340-420), connu pour sa traduction de la Bible appeléeVulgate en latin. D’autres textes, de caractère non-religieux ont été rédigés à cette époque :des grammaires, par exemple celle de Donat (4e siècle), précepteur de Jérôme, des traitéstechniques (militaires, vétérinaires...).
Du 6e siècle jusqu’à la réforme carolingienne au 8e siècle, le niveau littéraire et
grammatical baisse continuellement : œuvres d’histoire et d’instruction, textes de lois,d’ordonnances et d’actes sont rédigés en un latin plus ou moins barbare.
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
3/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
3
Comme la limite de la latinité, on considère le fait que le Concile de Tours de l’an 813confirme l’existence d’une rustica Romana lingua en laquelle les évêques seront dorénavanttenus de faire traduire les homélies, et qui sera placée sur le même plan que la Theotiscalingua (langue allemande). Cela est confirmé par les Serments de Strasbourg (Sacramenta
Argentariae), datant du 14 février 842. Il s’agit de l’alliance militaire entre deux des petits-filsde Charlemagne. Les serments ont été proférés (puis retranscrits) en deux langues, en langueromane (romana lingua) et en vieux haut allemand (teudisca lingua selon le texte latin) parchacun des deux monarques dans la langue de son frère, puis par leurs troupes, afin que tout lemonde se comprît : « Ac sic, ante sacramentum circumfusam plebem alter teudisca, alterromana lingua alloquuti sunt . Ils ont prêté serment devant le peuple, l’un en tudesque, l’autreen langue romane. » Ce document est un témoignage du fait que le latin n’était plus unelangue parlée à cette époque et représente, en même temps, le premier document de la langueromane. Le latin devient la langue de l’église et de la liturgie.
Nous n’allons pas nous occuper du latin classique qui représente la « norme » du latin,mais des phénomènes qui ne font pas partie de cette norme : en particulier, des élémentsarchaïques et populaires du latin.
2. Le latin archaïqueLe latin archaïque et ses caractéristiques nous sont connus grâce à plusieurs sources,
parmi elles des inscriptions, des fragments d’auteurs anciens et des témoignages faits par desgrammairiens et d’autres auteurs.
Les inscriptions représentent des témoins directs de la langue à l’époque de la
rédaction. Il s’agit de documents non-littéraires. Les textes conservés sur des inscriptionsprésentent certaines spécificités. Ils ont un caractère formulaire, stéréotypé ; il s’agit souventde clichés tout faits. Les inscriptions peuvent refléter des traits (à l’époque tardive desdérapages) phonétiques, syntaxiques et lexicaux de la langue parlée aussi bien que des fautes de leurs auteurs (commanditaires et lapicides). Une fois gravé, le texte ne peut pas êtrecorrigé. Les inscriptions peuvent être – et le sont assez souvent – dégradées ou endommagéeset présenter un texte partiellement.
Les inscriptions sont gravées sur des supports variés – métal, pierre –, et des fonctionsvariés. De la période archaïque, nous disposons en particulier des inscriptions votives etfunéraires ; les premières représentent des dédicaces aux dieux ou à des particuliers, les autresnous renseignent sur la vie d’une personne défunte.
1. Fibula Praenestina (600 av. J.-C.)
MANIOS MED FHE FHAKED NVMASIOI
Manius me fecit Numerio Manius m’a fait pour Numerius.
Inscription en caractères grecs, gravée de droite à gauche sur une fibule d’or trouvée à
Préneste en 1871. Mais voir A. E. Gordon, The inscribed Fibula Praenestina : Problems of Authenticity, Univ. of California Press, 1975.
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
4/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
4
Les particularités linguistiques :voyelles brèves sont maintenues en syllabe intérieure, au lieu de passer à i, e : fhefhaked,
Numasioi ;la désinence -os n’est pas encore devenue -us : Manios ;la diphtongue à premier élément long -ōi n’a pas perdu son -i final : Numasioi les consonnes finales sont notées : Manios, med, fhefhaked s intervocalique n’est pas encore sonorisé : Numasioi -d dans med (accusatif) d’origine obscure, pas de confusion de l’ablatif et de l’acc.
fhefhaked : forme de parfait dialectale, à redoublement et à désinence secondaire,correspondant à la forme romaine feced de l’inscription de Duenos.
Numasioi datif, encore la finale -ōi ; cf. l’inscription de Duenos : Duenoi et gr. lo/gw|.
1.2. L’inscription sur le Lapis nigerLe Lapis niger est un cippus (colonne basse ou stèle funéraire) de marbre noir trouvé
au Forum romain, devant le Comitium (un bâtiment circulaire où l’on rendait la justice et oùl’on célébrait des fêtes religieuses).
Cette pierre fait partie d’un sanctuaire du même nom, situé devant le Comitium et laCurie. La signification originale de ce sanctuaire est tombée dans l’oubli car il y avaitplusieurs légendes, parmi elles : le Lapis Niger marquait la tombe de Romulus, premier roi deRome – cette légende est rapportée par Festus, grammairien latin du 2e siècle après J.-C. :
« Lapis niger . La pierre noire marque dans la place des Comices un lieu funeste,
comme disent d’autres, destiné à la mort de Romulus ; mais il n’arriva pas qu’il y futenseveli. »
L’inscription gravée sur le cippus, très endommagé, est datée entre 570 et 550. Elleprésente des lettres proches des lettres grecques. Elle est écrite en boustrophédon (bous,strophé « action de tourner »), c’est-à-dire système d’écriture qui change de sens ligne aprèsligne :
→ BOUSTROFHDON
← NODHFORTSUOB
quoi hoi...... sakros esed sorm ...... ia . ias
5 regei ic ...... evamquos ri ......m kalato-rem hai ...
10 ... o iod iouxmen-ta kapia dotav ...
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
5/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
5
m ite ria ...... m quoi ha-velod nequ...
15 ... odiovestod ...
On reconnaît au moins certains mots : SACROS (sacer ), le subjonctif ESED (esset ),l’ancien datif sg. RECEI (regi), KALATOREM (calatorem) « héraut », dérivé de calo,proclamer, IOVXMENTA (iumenta) « bêtes de somme », KAPIA (capiat ) « prenne ».D’autres mots posent difficulté : QVOI (qui) ; SOR- peut refléter le degré o de serm-(*sormon- « parole »), IOVESTOD est probablement un équivalent de iusto « à justetitre ». On admet généralement qu’il s’agit d’une malédiction adressée à quiconque violera lesanctuaire. Les premières lignes seraient à interpréter ainsi : QUI HUNC (locum uiolauerit)SACER ESSET « Qui violera ce lieu sera maudit ». Selon Georges Dumézil, il s’agirait d’unordre absolu de dételer les animaux de trait devant le Comitium, lieu sacré. Le rejetd’excréments par les animaux attelés était considéré comme un présage funeste.
1.3. L’inscription dite « Duenos »Cette inscription est gravée sur un récipient composé de trois parties et date du 580-
570 avant J.-C.
Elle est gravée en trois lignes de droite à gauche, les mots ne sont pas séparés les unsdes autres. C’est une inscription qui a été beaucoup étudiée mais n’a pas pu être entièrementinterprétée. En particulier, la deuxième ligne n’est pas reste claire.
IOVESAT DEIVOS QOI MED MITAT NEI TED ENDO COSMIS VIRCO SIEDASTED NOISI OPETOI TESIAI PAKARI VOIS
DVENOS MED FECED EN MANOMEINOM DVENOI NE MED MALOS TATOD
Iurat deos, qui me mittit – ni in te (= erga te) comis uirgo sitast te nisi ??? ?Bonus me fecit in MANO(M) MEINOM bonō. Ne me malus tollitō.
« Celui qui m’envoie jure par les dieux, si la jeune fille n’est gentille envers toi
et si toi ??? Bonus m’a fait comme un bon cadeau pour un homme de bien. Qu’une personne malveillantene m’enlève. »
La première ligne est interprétable sans difficulté, sauf pour mitat . C’est un indicatif dela première conjugaison, et non pas un subjonctif.iouesat : sans le rhotacisme et conservation de la diphtonguedeiuos : forme ancienne de deōs, antérieure à la chute du u devant o et à la réduction de la
diphtongue ;qoi : qui (q note la labiovélaire qu) ; nei : nī ; endo : in (cf. indi-gena) ; sied : 3 pers. subj. opt.
de sum, à désinence secondaire -d pour siet et sit classiquecosmis présente le groupe consonantique sm avant sa réduction en cōmis
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
6/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
6
La deuxième ligne est problématique : noisi peut correspondre à nisi, le reste n’est pas
clair. Tesiai ( ?) sans rhotacisme. PACA RIVOIS est parfois interprété comme « pacifier parla libation » ou RIVOIS comme une métathèse du datif VIROIS « pacifier les hommes ».
La troisième ligne présente : Duenos > duonus > bonus ; l’accusatif med se réfère au vase ; feced : forme d’aoriste à degré
long de la racine *dhē - et à désinence secondaire -d : f ē cit MANOMEINOM permet de reconnaître manom : bonum (Varron, 6.4 : bonum antiquidicebant manum) ; meinom correspond à mūnus « devoir, ce qui est offert »d.enoi (texte altéré) est sans doute le datif duenoi de duenos « bon » ne... tatod peut être rattaché à t ā yazzi en hittite « voler ». Il s’agit d’un ordre négatif à la 3pers. sg. de l’impératif futur
1.4. Lapis Satricanus Le Lapis Satricanus, « pierre de Satricum » est une inscription gravée sur une pierre
qui formait la substructure du temple dédié à la Mater Matuta (« mère du petit matin », déesseitalique, protectrice de la maternité et du matin). Elle a été découverte récemment, en 1977 etest datable en 500 avant J.-C. Son texte est le suivant :
(SAL)IEI STETERAI POPLIOSIO VALESIOSIO SVODALES MAMARTEISalii stetērunt Publii Valerii sodales Marti« Les membres de la confrérie Salique de Publius Valerius ont érigé (cela) à Mars. »
(Sal)iei est une conjecture car l’inscription est abîméesteterai correspond à stet ē runt ; cette forme pose problème : on s’attendrait à la 3 e personne
pl. du parfait dont la finale était -ē re. Il pourrait s’agir également d’un datif de Stator.Poplisio Valesiosio sont des génitifs en -osio ; ce génitif n’est attesté que sur cette inscription
latine ; deux s sans le rhotacisme.suodales « membres d’une confrérie » : cette forme confirme l’étymologie *suod ālis qu’on
avait proposé pour le mot sōd ālis (*suedheh1 « coutume ». Mamartei est un théonyme redoublé
1.5. Éloge de Lucius Cornelius Scipio Barbatus (consul 298, censeur 290) Lucius Cornelius Scipion « le Barbu »), homme d’État et général romain, élu consul
en 298 av. J.-C. Il vainquit les Étrusques puis les Samnites, et soumit la Lucanie. Il est élucenseur en 280 av. J.-C., l’année de sa mort.
L’inscription gravée sur un sarcophage en pierre d’Albe, trouvé au delà de la porteCapène près de la voie Appienne, sur l’emplacement des tombeaux des Scipions. Cf. Cicéron,Tusc. 1, 7, 13 :
An tu egressus porta Capena cum Calatini Scipionum Seruiliorum Metellorum sepulcra uides,
miseros putas illos ?
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
7/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
7
« Quand, au sortir de la porte Capène, vous voyez les tombeaux de Calatinus, des Scipions,des Servilius, des Métellus, jugez-vous que ces gens-là soient misérables ? »
[L. CORNELI]O CN. F. SCIPIO
CORNELIVS LVCIVS SCIPIO BARBATVSGNAIVOD PATRE PROGNATVS, FORTIS VIR SAPIENSQUE
QVOIVS FORMA VIRTUTEI PARISVMA FVITCONSOL CENSOR AIDILIS QVEI FVIT APVD VOS
TAVRASIA CISAVNA SAMNIO CEPITSVBIGIT OMNE LOVCANAM OPSIDESQVE ABDOVCIT
L. Cornelius Cn. f. Scipio
Cornelius Lucius Scipio Barbatus Cornelius Lucius Scipio BarbatusGnaeo patre prognatus, fortis uir sapiensque fils de Gnaeus, homme fort et sageCuius forma uirtuti parissima fuit ; d’une apparence comparable à sa vertu.Consul, censor, aedilis qui fuit apud uos, Il fut consul, censeur et édile parmi vousTaurasiam, Cisaunam Samnio cepit, Il prit Taurasie, Cisaune en Samnium,Subigit omnem Lucaniam obsidesque abducit. soumit toute la Lucanie et ramena des
otages.
Inscription, postérieure à l’an 200, comportant 2 parties : titulus (qui faisaitprobablement partie d’un texte plus ancien) et 6 vers saturniens.Le vers saturnien est la forme la plus ancienne de vers de la poésie latine. Il est fondé
sur l’alternance de voyelles brèves et longues. L’exemple le plus souvent cité est un fragmentde Naevius :
dabunt malum Metelli Naevio poetae « les Metelli donneront du bâton au poète Naevius »
Le vers saturnien avait un nombre fixe de syllabes et de distinguait d’allitérations ; sastructure métrique du vers est la suivante (x brève ou longue) :
u - | u - | u - | x || - u | - u | - x
Toutefois, sa métrique était très irrégulière.
L’inscription présente les particularités suivantes :les diphtongues sont notées : Gnaiuod, aidilis, uirtutei, quei ; Taurasia, Cisauna, Loucanam,
abdoucit – mais Lucius.les consonnes ne sont pas redoublées : parisuma ;
-d final de l’ablatif est gardé : Gnaiuod ;
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
8/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
8
-m final n’est pas noté : Taurasia, Cisauna, omne – mais Loucanam (le mot suivantcommence par une voyelle) ;
-s final est noté : Cornelius (mais Cornelio dans le titulus), Lucius Barbatus, prognatus ; legroupe -ns- est noté : consol, censor (cf. l’inscription suivante)
Cornelius Lucius au lieu de Lucius Cornelius (à cause du rythme)Gnaiuod : Gnaeō, prognatus : filius (sens rare)quoius : forme du gén. issue de *quoi-os ; parisuma : éloge de la beauté témoigne d’une
influence des idées grecques et de la date assez tardive de l’inscription ;Taurasia : ville du Samnium (cf. Liv. 40, 38, 3) ; Cisauna (inconnu par ailleurs) ; Samnio :
acc. ou abl. ?subigit, abdoucit : présents surprenants, on attendrait subegit, abdouxit. omne Loucanam sc. terram.
1.6. Éloge de Lucius Cornelius Scipio (fils du précédent, consul en 259, censeur en 260) Lucius Cornelius Scipio a vaincu victorieux des Carthaginois lors de plusieurs
combats en Corse et en Sardaigne. Il a conquis la Corse, prenant de nuit la ville Alalia, qu’il aincendié et renommé Aleria.
L. CORNELIO L. F. SCIPIO [A]IDILES COSOL CESOR
HONC OINO PLOIRVME COSENTIONT R[OMAI]
DVONORO OPTVMO FVISE VIROLVCIOM SCIPIONE FILIOS BARBATICONSOL CENSOR AIDILIS HIC FVET A[PVD VOS]
HEC CEPIT CORSICA ALERIAQVE VRBEDEDET TEMPESTATEBVS AIDE MERETO[D].
L. Cornelius L. f. Scipio aedilis consul censor.
Hunc unum plurimi consentiunt Romae Selon l’opinion généralement partagée, celui-ci, Bonorum optimorum fuisse uirorum Lucius Scipio, était l’un des meilleurs hommes Lucium Scipionem. Filius Barbati à Rome. Fils de Barbatus, il était consul,Consul censor aedilis hic fuit apud uos. censeur, édile parmi vous.
Hic cepit Corsicam Aleriamque urbem, Il prit la Corse et la ville d’Aleria, il dédia Dedit Tempestatibus aedem merito. à juste titre, un temple aux déesses du Temps.
L’inscription se compose de deux parties : d’un titulus et d’un carmen plus récent ensaturniens, gravé sur le devant d’un sarcophage dont la partie droite est brisée, trouvé en1614.
Les particularités linguistiques :
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
9/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
9
o au lieu de u dans le titulus : Cornelio, cosol ; e au lieu de i : aidiles et maintient de ladiphtongue ; réduction de n dans -ns- : cosol, cesor ;
graphie inconséquente : cosentiont mais consol, censor ; oino mais Luciom ;honc de *hom+ce, > hunc ; oino > ūnum ; ploirume : plūrimī duonoro : bonorum ; duonoro optumo : bonorum optimum, imitation d’une tournure grecque
(Ernout), cf. kakw=n ka/kiste (Soph.), miserorum miserrumus (Plaut.) ;uiro gén. pl. en -om pour uirorum ;
fuet : e soit le e de la désinence secondaire -ed soit ĭ – fuet pour fuit ; hec pour hic, hésitation.Corsica Aleriaque urbe : accusatifs sans -m final.
1.7. Senatus consultum de Bacchanalibus (186 av. J.C.)Les bacchanales étaient des fêtes religieuses, liées aux mystères dionysiaques,
célebrées en l’honneur de Bacchus, dieu du vin. Ces cérémonies étaient des fêtes orgiaques
nocturnes de mauvaise réputation car elles conduisaient à l’ivresse provoquaient des licencessexuelles qu’elles provoquaient. Réservées aux femmes, elles se tenaient trois fois par an sousle contrôle de matrones respectables. Une affaire, « scandale des Bacchanales » s’est produiteà Rome en 186 avant J.-C. Elle nous est rapportée par Tite-Live (livre 39) et elle esttémoignée par un document officiel, le sénatus-consulte De Bacchanalibus gravé sur uneplaque de bronze, publié la même année. Ce document a été retrouvé dans le Bruttium en1640.
Une courtisane nommée Hispala Fecenia révéla le secret de ces pratiques à un jeunehomme qu’elle aimait, Publius Aebutius, et que la mère de celui-ci voulait initier aux
mystères de Bacchus. Elle voulait ainsi le protéger. Suivant les conseils de Hispala, Publiusrefusa de se faire initier aux mystères. Il fut alors chassé par sa mère et par le mari de celle-ci.Il alla se réfugier chez une de ses tantes qui lui conseilla de parler de cette histoire au consulPostumius. Le consul décida de mener une enquête secrète. Le sénat, craignant qu’il s’agissaitd’un complot contre la République, chargea les consuls de promettre des récompenses auxdélateurs et d’interdire les rassemblements des initiés. Le « scandale des Bacchanales » aconduit à une répression du culte où 7000 personnes environ furent condamnées à mort,emprisonnés ou bannis. Le sénatus-consulte interdit ce culte durant près d’un siècle et demi. Ilfut à nouveau autorisé par César.
Le document, le texte de la lettre des consuls adressée aux habitants de l’ AgerTeuranus notifiant le sénatus-consulte relatif aux Bacchanales, est le plus ancien témoignagedu latin non-littéraire d’une longueur importante :
1 [Q.] MARCIVS L. F., S. POSTVMIVS L. F. COS.SENATVM CONSOLVERVNT N. OCTOB.,APVD AEDEM 2 DVELONAI. SC. ARF. M.CLAVDI M. F., L. VALERI P. F., Q. MINVCI C. F.
DE BACANALIBUS QUEI FOIDERATEI 3
ESENT, ITA EXDEICENDVM CENSVERE :« NEIQVIS EORVM [B]ACANAL HABVISE
1 Q(uintus) Marcius L(uci) f(ilius), S(purius)Postumius L(uci) f(ilius) co(n)s(ules) senatum
consuluerunt n(onis) Octob(ribus), apud aedem 2
Bellonae. Sc(ribendo) adf(uerunt) M(arcus)
Claudi(us) M(arci) f(ilius), L(ucius) Valeri(us)
P(ubli) f(ilius), Q(uintus) Minuci(us) C(ai) f(ilius).
De Bacchanalibus (iis) qui foederati 3 essent, ita
edicendum (esse) censuere :
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
10/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
10
VELET. SEIQVES 4 ESENT, QVEI SIBEIDEICERENT NECESVS ESE BACANAL HABERE, EEIS VTEI AD PR. VRBANVM 5 ROMAM VENIRENT, DEQVE EEIS REBVS,VBEI EORVM V[E]R[B]A AVDITA ESENT, VTEI
SENATVS 6 NOSTER DECERNERET, DVM NEMINVS SENATOR[I]BUS C ADESENT, [QVOME]A RES COSOLERETVR.7 BACAS VIR NEQVIS ADIESE VELET CEIVISROMANVS NEVE NOMINVS LATINI NEVESOCIVM 8 QVISQVAM, NISEI PR. VRBANVMADIESENT, ISQVE [D]E SENATVOSSENTENTIAD, DVM NE 9 MINVSSENATORIBVS C ADESENT, QVOM EA RESCOSOLERETVR, IOVSISENT. CE[N]SVERE.
« Nequis eorum Bacchanal habuisse uellet. Siqui 4
essent, qui sibi dicerent necesse esse Bacchanal
habere, ii ut ad pr(aetorem) urbanum 5 Romam
uenirent, deque eis rebus, ubi eorum uerba audita
essent, ut senatus 6 noster decerneret, dum ne
minus senatoribus C adessent, cum ea resconsuleretur. 7 Bacchas uir nequis adiisse uellet,
ciuis Romanus neue nominis Latini, neue
sociorum 8 quisquam, nisi pr(aetorem) urbanum
adiissent, isque de senatus sententia, dum ne 9
minus senatoribus C adessent, cum ea res
consuleretur, iussisent. Censuerunt.
Traduction1 Les consuls Quintus Marcius, fils de Lucius, et Spurius Postumius, fils de Lucius,consultèrent le Sénat au temple de 2 Bellone, aux nones d’octobre (7 oct.). Marcus Claudius,fils de Marcus, Lucius Valérius, fils de Publius, et Quintus Minucius, fils de Gaius, assistèrentà la rédaction de la résolution.En ce qui concerne les Bacchanales, les sénateurs proposèrent 3 d’édicter ce qui suit àl’attention de tous ceux qui sont nos alliés :« Aucun d’eux ne doit avoir de lieu de culte dédié à Bacchus ; et si certains 4 prétendentdevoir conserver un tel lieu, ils doivent se présenter à Rome devant 5 le préteur urbain. Et
lorsque leurs requêtes auront été entendues, notre Sénat 6 prendra une décision à ce sujet, àcondition que le quorum soit d’au moins 100 sénateurs lorsque l'affaire sera examinée.7 Aucun citoyen romain, ni aucune homme ayant le statut de Latin ni aucun de nos alliés 8 nedoit s’associer avec les Bacchantes, à moins de se présenter devant le préteur urbain etd’obtenir de celui-ci son autorisation en accord avec l’avis du Sénat, le quorum étant 9 d’aumoins 100 sénateurs présents à la délibération ». Telle décision a été prise.
Les particularités linguistiques :ancien o maintenu en syllabe intérieure : consoluerunt, consoletur, tabolam ; il est passé à u
en syllabe finale : les nom. des thèmes en o sont en -us et les 3e pers. pl. en -unt .
les diphtongues sont notées avec exactitude, toutefois, on a aedem en face de aiquom ; ladistinction entre ī et ei est observée, cf. Latini (gén.) et foideratei (nom. pl., -ei < *oi), quei,ceiuis, nisei (nisī ), sibei (sibī )
les consonnes ne sont pas redoublées (la notation de doubles consonnes n’est attestée avant ledécret de Paulus Aemilius, 189 av. J.C.) ; l’aspirée x du grec n’est pas notée : Bacanal ;
le groupe du- subsiste dans Duelonai ( Bellona); le groupe qu est (à tort) introduit dans quoltod – confusions entre c, k, qu fréquentes dans les inscriptions.
le groupe -ns- tantôt conservé, tantôt réduit à -s- : cos, cosoleretur ; consoluerunt ;le groupe -sm- est maintenu : dismota ; le m du préfixe com se maintient dans comuouisse,
mais passe à n dans les autres cas : conspondise, conpromesise ;ad est remplacé par ar : arf(uerunt), arfuise, aruorsum (dialectalisme) ;
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
11/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
11
gén. sg. des thèmes consonantiques est en -us : nominus, celui des thèmes en u en -uos (et nonpas en -ūs) : senatuos ;
exdeicendum : la diphtongue du simple deico, rac. *deik-, ou la notation de ī ; participe en -endus et non -undus.
nei quis (en tête de phrase) en face de sacerdos ne quis eset : forme pleine vs. forme réduite ;habuisse uellet « que personne n’organise un Bacchanal » : avec l’infinitif parfait pour
exprimer une défense ;ques et quei : l’inscription distingue encore le nom. pl. de l’indéfini quis : ques < *queyes
(thème *qui-) et le nom. pl. du relatif quī < quei < *quoi (thème *quo-) ; en latin classique,distinction conservée au sg., mais supprimée au pl.
necesus : à l’origine, une forme composée de la nég. ne et de *cessus, substantif de la mêmeracine que cē d ō « se retirer » : ne cessus est « il n’y a pas de moyen d’échapper à » ; refaiten l’adjectif necessis, e ;
eeis : nom. pl. masc. de is, correspondant à iī ; eeis représente un nom. *eio-i auquel est ajouté
un -s ;utei : la diphtongue surprenant, car ut ĭ -nam ; peut-être l’influence de ubei ;après i, un autre i se différencie en e : adiese, adiessent ; on a e au lieu de i dans
compromesise (pour ī ) ;adiese : de *adi-is-se ;socium : gén. pl. correct-d final est maintenu, par affectation d’archaïsme : in agro Teurano est une addition d’une
autre main ne faisant pas partie du texte officiel ;
2. Textes latins archaïques2.1. Lois des douze tablesLa Loi des Douze Tables ( Lex Duodecim Tabularum) est le premier corpus de lois
romaines écrites. Partiellement fondée sur les lois athéniennes de Solon, elle est rédigée parles deux collèges de décemvirs dans la période de 462-449 et publiée sur le Forum romain surdouze tables en bronze. La rédaction de la loi représente le code légal qui guidait lesmagistrats et les juges dans leur décisions juridiques. Il s’agit de l’acte fondateur du droitromain, de la Constitution de la République et du mos maiorum « mœurs des anciens », lemode de vie et le système des valeurs ancestrales, pris comme une référence. Les tablesoriginales sont perdues, on ne connaît la loi que par citations – fragments conservés par desauteurs latins (Aulu-Gelle, Cicéron, Les lois, Festus, les juristes Ulpien, Gaius...).
Loi de douze tables, table 3 (Gell. 20.1.45)Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunto. Post deinde manus iniectio esto,in ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito autnervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito. Si volet, suovivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.
« Une fois la dette reconnue ou l’affaire jugée en procès légitime, que le débiteur ait 30 jours
pour payer. Après ce temps, qu’il y ait finalement main-mise sur lui. Qu’on le conduisedevant le juge. S’il ne satisfait pas au jugement ou si personne ne se porte garant pour lui en
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
12/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
12
justice, que le créancier le prenne, l’attache avec une corde ou des chaînes d’un poidsminimum de 15 livres, ou, s’il le veut, davantage. S’il le veut, qu’il (le débiteur) vive à sespropres frais. S’il ne vit pas à ses propres frais, que celui qui l’enchaîne lui donne une livre defarine par jour. S’il le veut, qu’il donne plus. »
2.2. Les témoignages du latin archaïquesLes grammairiens (Varron, Priscien...) et des auteurs tels Cicéron, Quintilien et Aulu-
Gelle nous ont laissé de nombreux témoignages des phénomènes typiques du latin archaïque.Cicéron, par exemple, est bien conscient de l’emploi des génitifs en -um dans certains cas (a),ou établit une correspondance entre bellum et duellum (b) ; Quintilien nous parle durhotacisme (c) et de la syncope (d) ; Varron nous parle du pronom ollus ; en outre, les génitifsarchaïques en -ai sont souvent signalés par des grammairiens (e).
(a) quid verum sit intellego; sed alias ita loquor ut concessum est, ut hoc vel pro deum dico
vel pro deorum, alias ut necesse est, cum trium virum, non virorum, et sestertium, nummum,non sestertiorum, nummorum, quod in his consuetudo uaria non est.« Je me rends compte de ce qui est régulier ; mais tantôt je m’exprime comme on le tolère, endisant soit pro deum, soit pro deorum, tantôt comme il est obligatoire, en disant trium uirum,et non uirorum, sestertium, nummum, et non sesteriorum, nummorum, parce que dans ces casl’usage est invariable. » Cicéron, L’orateur , 156
(b) nam ut duellum bellum et duis bis, sic Duellium eum qui Poenos classe devicit Belliumnominaverunt, cum superiores appellati essent semper Duelli.
« Comme de duellum on a fait bellum, de duis, bis ainsi le Duellius qui vainquit sur mer lesCarthaginois a été nommé Bellius, alors que ses ancêtres avaient toujours été appelés Duelli. »Cicéron, L’orateur , 151
(c) nam ut Valesii Fusii in Valerios Furiosque venerunt, ita arbos, labos, vapos etiam etclamos ac lasis fuerunt. Atque haec ipsa s littera ab his nominibus exclusa in quibusdam ipsaalteri successit...« Car, tout comme Valesii et Fusii sont devenus Valerii et Furii, l’on a eu autrefois arbos,labos, uapos, et même clamos et lases et asa. Cette même lettre s, disparue de ces mots, adans certains autres pris la place d’une autre lettre... » Quintilien, 1.4.13
(d) Sed Augustus quoque in epistulis ad C. Caesarem scriptis emendat, quod is calidum dicerequam caldum malit, non quia id non sit Latinum, sed quia sit odiosum. Quintilien, 1.6.19« Mais aussi Auguste dans ses lettres à C. Caesar critique le fait qu’il préfère calidus à caldus,non pas parce que ce ne serait pas latin, mais parce que c’est choquant. »
(e) Apud Ennium : olli respondit suauis sonus Egeriai. Olli ualet dictum illi ab olla et ollo.« Chez Ennius : Le doux son d’Égérie lui répondit. Olli équivaut à illi, le datif du nom fém.olla et masc. ollus. Varron, Langue latine, 7.42
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
13/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
13
3. Le latin parléLa langue qu’on appelle le latin classique était une langue littéraire pratiquée par une
petite partie de la société. On suppose qu’environ 10 % de la population savait lire et écrire àRome et dans ses environs. Le latin classique est devenu une langue littéraire qui représentaitun standard : elle a été codifiée dans des grammaires et a été véhiculée par des « gardiens dela langue » tels enseignants, hommes politiques, écrivains. Elle a fini par être reconnuecomme une norme qui caractérise une certaine couche sociale : une couche supérieure.
Le latin classique en tant que norme différait considérablement de la langue parlée.Cependant, il n’y a pas « une » langue parlée : le latin existait dans plusieurs variantes. Il yavait des différences dans le parler de groupes sociales et régionales. En outre, pendantplusieurs siècles, en Italie ancienne, des locuteurs étrusques, grecs, celtiques... étaient présentsqui influaient sur les variantes régionales du latin. La société romaine était divisée en classessociales dont le parler différait : d’un côté, classes supérieure et inférieure, de l’autre côté,classes urbaine et rustique. Pour la communauté parlant latin, on peut distinguer trois registres
ou styles de parler. C’est d’abord le latin standard, représenté par les œuvres de Cicéron, deCésar... Ensuite, le latin parlé de la société éduquée : sermo cotidianus ; ce registre peut êtreillustré par les Lettres de Cicéron et par les Satires et Lettres d’Horace. Enfin, le latin« populaire », auparavant appelé « vulgaire » (cf. sermo uulgaris chez Cicéron) : sermo
plebeius qui renferme plusieurs autres variantes : sermo urbanus, rusticus, militaris... Lesermo plebeius est bien représenté par le Banquet de Trimalchio de Pétrone.
Nous nous intéresserons ici au sermo plebeius ou latin « populaire » ou « vulgaire ». J.Herman le définit ainsi « latin vulgaire (= populaire) représente la langue parlée des couchespeu influencées ou non influencées par l’enseignement scolaires et par les modèles
littéraires ». Le latin populaire variait selon les époques, l’appartenance sociale, degré deculture, la provenance des sujets parlants.
Pourquoi a-t-on besoin d’étudier cette variante du latin ? La grammaire comparée deslangues romanes au 19e siècle (Fr. Diez, 1838-1843) découvrit que l’état de langue qui peutêtre considérée comme la source commune des langues romanes est – tout en étant du latin –sensiblement différent du latin dit classique. Cela vaut pour plusieurs aspects de la langue : laphonologie, la syntaxe, le lexique. Par exemple, pour la reconstitution de la « langue mère »dans le domaine de la phonétique, on observe que deux phonèmes distincts en latin classiquecorrespondent à un seul phonème des langues romanes :
ē et ĭ aboutissent à un résultat commun : t ē la, cr ē dere, pĭ ra (pl.) , f ĭ dem – toile, croire, poire, foi (it. tela, credere, pera, fede…) ; croire, credere repose sur e fermé
Dans le domaine du vocabulaire, le nom roman du « feu » ( feu, it. fuoco, esp. fuego, roum. foc) remonte à focus « foyer », le mot correspondant du latin classique, ignis, n’est représenténulle part. Pulcher classique est remplacé par bellus (bel/beau, it. bello…) et formosus d’oùesp. hermoso, roum. frumos).
Sources du latin populaire
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
14/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
14
Comme seul le latin écrit nous est parvenu, quelles sources peuvent nous renseignersur le latin populaire ?
La littérature latine manifeste parfois un style relâché s’approchant du parler de tousles jours – style épistolier de Cicéron : illum fecisse non belle « ce n’était pas chic de tapart » ; mi uetule « mon vieux ». Des éléments du latin populaire se rencontrent dans lescomédies de Plaute, dans les satires d’Horace, dans les épigrammes de Juvénal, dans roman« picaresque » de Pétrone, notamment dans l’épisode du festin de Trimalchion.
Les inscriptions latines témoignant du latin populaire sont en premier lieu desinscriptions inscriptions tracées au poinçon (graffiti) à Pompéi et Herculaneum. En outre, il ya d’autres inscriptions de l’époque tardive qui représentent des sources utiles : des dédicaces,des épitaphes et des actes publics. Les tablettes d’exécration (defixionum tabellae) présententdes formules gravées sur des lames de plomb. Ces documents sont des textes non-littéraires ;
dans la même catégorie appartiennent des papyrus contenant des textes privés.
Des traités techniques. Déjà Vitruvius (1er siècle avant J.-C), auteur d’un traitéd’architecture, s’excuse d’avoir peu de correction linguistique : « non architectus potest esse grammaticus ». À l’époque tardive remontent plusieurs traités techniques dont la langue estde plus en plus teintée d’éléments populaires : Mulomedicina Chironis, traité vétérinaire de la2e moitié du 4e siècle ; un demi-siècle plus tard Végèce a retouché certains vulgarismes enremaniant ce traité. Il y a également Apicius, De re coquinaria, livre de cuisine, et nombreuxd’autres traités (de pharmacologie, agriculture, arpentage…).
Pour les auteurs chrétiens, la langue était un instrument, prêt à donner expression àl’idéologie chrétienne. Ils écrivaient d’une manière accessible au peuple qui, souvent, n’avaitpas d’éducation. Les anciennes versions de la Bible (connu sous le nom collectif Itala ouVetus Latina) sont marquées d’expressions et de tours propres à la langue populaire. Latraduction de la Bible par saint Jérôme, Vulgata, a une allure plus littéraire, tout en gardant unnombre d’expressions populaires. Des éléments de la langue populaire se lisent dans leJournal de voyage d’Égérie (4e siècle), dans les vies de saints composées par Grégoire deTours, homme plus pieux que lettré.
Les grammairiens latins signalent et corrigent des prononciations et formesfautives. En premier lieu, l’ Appendix Probi – il s’agit d’une annexe au traité de grammaire deProbus (remontant à la période des Lombards). C’est un syllabus qui répertorie et corrige desfautes « dites…, ne dites pas… ». Il contient 227 mots réputés incorrects (une partie ne le sontpoint) : uetulus non ueclus ; calida non calda. Des formes protoromanes y sont attestées.
Des glossaires latins sont des vocabulaires rudimentaires, généralement unilingues,traduisant des mots considérés comme étrangers (glossae)1. Les Gloses de Reichenau (nom
1 Le plus ancien glossaire latin est celui de Verrius Flaccus, De uerborum significatione (sous Tibère), connupar un agrégé de Pompeius Festus (3e siècle après J.-C). Ce glossaire répertorie en particulier des archaïsmes.
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
15/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
15
d’abbaye, 9e siècle), très tardives, répertorient de nombreuses formes protoromanes, parexemple : pulcra : bella ; arena : sabulo ; isset : ambulasset (cf. aller et ambler ) ; in ore : inbucca (bouche) ; uespertiliones : calues sorices (chauve-souris).
Au 6e siècle remontent plusieurs traités d’histoire et des chroniques : ce sont desœuvres rédigées sans prétention littéraire, reflétant un latin entremêlé de vulgarismes et deréminiscences classique, par exemple la Historia Francorum de Grégoire de Tours (6e) ou lesChronicarum libri IV de Fredegarius (en réalité, écrits par plusieurs auteurs anonymes),histoire des Francs du 7e siècle, et d’autres.
Très tardifs sont lois, diplômes, chartes et formulaires où alternent de réminiscenceslittéraires avec des éléments populaires. En Gaule, des documents relatifs à la cour des roismérovingiens on été rédigés, en Italie, des édits rédigés sous les rois lombards, en Espagne,des textes provenant du royaume wisigothique.
4. Plaute (255-184)Plaute (255-184) venait de l’Ombrie (sa langue maternelle était alors l’ombrien, une
langue italique proche du latin) et a composé une quarantaine pièces de théâtre (vingtseulement nous sont parvenues) ; elles représentent des adaptations d’originaux grecs aupublic romain. Elles étaient destinées à une présentation orale devant un public sanséducation.Extrait : Asinaria, 664-677PH(ILAENIVM) : Da, meus ocellus, mea rosa, mi anime, mea voluptas,
Leonida, argentum mihi, ne nos diiunge amantis. 665 LE(ONIDAS) : Dic me igitur tuom passerculum, gallinam, coturnicem,agnellum, haedillum me tuom dic esse vel vitellum,prehende auriculis, compara labella cum labellis.AR(GYRIPPVS) : Ten osculetur, verbero? LE. Quam vero indignum visum est?at qui pol hodie non feres, ni genua confricantur. 670 AR. Quidvis egestas imperat: fricentur. dan quod oro?PH. Age, mi Leonida, obsecro, fer amanti ero salutem,redime istoc beneficio te ab hoc, et tibi eme hunc isto argento.LE. Nimis bella es atque amabilis, et si hoc meum esset, hodienumquam me orares quin darem: illum te orare meliust, 675 illic hanc mihi servandam dedit. ei sane bella belle.cape hoc sis, Libane.
PH(ILENIE) Donne, mon petit œil, ma rose, mon cœur, ma joie, Léonide, donne-moil’argent ; ne nous sépare pas nous et nos amours !LE(ONIDE) Appelle-moi donc ton petit moineau, ta poule, ta caille ; dis-moi que je suis tonpetit agneau, ton petit chevreau, ou même ton petit veau ! Prends-moi par les oreilles, unis tespetites douces lèvres aux miennes !
AR(GYRIPPE) Qu’elle te donne un baiser, pendard ?LE. Qu’est-ce qu’il y a là d’indigène ?
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
16/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
16
Et même, par Pollux, tu ne l’emporteras pas aujourd’hui, si on ne me caresse pas les genoux.AR. Nécessité fait loi : qu’on les lui caresse. Tu me donnes ce que je demande ?PH. Allons, mon cher Léonide, je t’en supplie, apporte le salut de ton maître amoureux !Rachète-toi par ce bienfait en sous-main et fais-en ton homme par cet argent.LE. Tu es trop gentille et trop aimable et, s’il ne tenait qu’à moi, aujourd’hui je ne melaisserais pas du tout prier sans te donner satisfaction. (montrant Liban) Il vaut mieux priercelui-là : c’est lui qui me l’a donnée à garder. Eh, va, ma gentille, gentiment. Prends ça, s’il teplaît, Liban !
Particularités linguistiques :meus ocellus : nominatif exclamatif concurrence fréquemment le vocatif (cf. mi anime) ; il aplus de forceamantis = amantes « nous qui nous aimons »
passerculum... labellis : on remarque ici la grande fréquence des diminutifs caressants,
caractéristiques de la langue parlée, souvent de forte couleur affectiveten et dan plus loin (dasne) aphérèse dans le parler allegro bella : bellus prend place de pulc(h)er dans la langue parlée ; nimis bella : équivalent d’unsuperlatif expressif (analytique)meliust : melius est au parler rapideillic n’est pas un adverbe mais ille + ce (particule déictique)ei = ī l’impératif de ī re, la voyelle longue étant notée à l’ancienne mode par ei.
La langue de Plaute se distingue par de nombreuses formes expressives – diminutifs et formes
renforcées (egomet, tute). La forme fréquentative des verbes est souvent utilisée : canto,negito « je dénie fréquemment ». Une telle préférence devait être caractéristique de la langueparlée de même que les formes préverbées au lieu d’un verbe simple (cf. confrico et frico dansl’extrait). En outre, Plaute manifeste une préférence pour des formes analytiques, par exemplecarens fui « je n’avais pas » ou des périphrases avec fuerat/fuisset.
5. PétroneLa datation du Satiricon de Pétrone et l’identité même de l’auteur de ce roman de
mœurs ont fait couler beaucoup d’encre sans toutefois lever tous les doutes.Traditionnellement, on considère que son auteur est T. Petronius Niger (14-66), consulsuffectus sous Néron, l’arbiter elegantiarum, d’où son cognomen Arbiter. Or, la théorie laplus probante semble être celle de R. Martin ( Etudes latines). L’une des parties conservées duSatiricon est la Cena Trimalchionis, un festin qui se déroule dans une villa des environs deNaples. Trimalcion, un affranchi parvenu, est dépeint avec beaucoup de saveur. Le parler desaffranchis rassemblés au banquet est une maîtresse parodie du sermo plebeius du 1er siècleaprès J.-C.
Extrait : Satiricon, 41.9-11Ab hoc ferculo Trimalchio ad lasanum surrexit. Nos libertatem sine tyranno nacti coepimus
invitare convivarum sermones. Dama itaque primus cum pataracina poposcisset: « Dies,inquit, nihil est. Dum versas te, nox fit. Itaque nihil est melius quam de cubiculo recta in
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
17/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
17
triclinium ire. Et mundum frigus habuimus. Vix me balneus calfecit. Tamen calda potiovestiarius est. Staminatas duxi, et plane matus sum. Vinus mihi in cerebrum abiit. »
« Après ce service, Trimalcion se leva pour aller à la selle. Nous les autres, ayant gagné notreliberté sans tyran, nous commençâmes à provoquer les dires des convives. Donc Dama, lepremier, après avoir demandé une tournée pour tout le monde : « Le jour, dit-il, c’est rien. Tute retournes un peu, il fait nuit. Donc il n’y a rien de mieux que d’aller tout droit du lit à latable. Et nous avons eu un joli froid. C’est à peine si le bain m’a réchauffé. Toutefois uneboisson chaude vaut une garde-robe. J’ai éclusé à la cruche et j’en suis grisé pour le bon. Levin m’a monté au cerveau. »
Particularités linguistiques :lasanum : emprunt de la/sanon « chaise percée »coepimus inuitare : coepi assure un inchoatif analytique qui tend à remplacer les verbes en –
sco pataracina : hapax peu clair, peut-être il vient d’une exclamation patara (doublet de patera)koina/ « une tournée pour tout le monde »dies nihil est l’attribut inanimé pour un sujet masculin est typique de la langue parléeuersas te tirant au clair le sens de moyen de uersaris est familier ; il ouvre la voie au réfléchiromande cubiculo : de prend place des prépositions ex et abrecta (uia) : adverbe, usuel dans la langue familièremundum « propre » est expressif au sens de « fort »
balneus : doublet masculin de bal(i)neum (ancien emprunt au grec) comme uinus de uinum ;élimination des neutrescalfecit : cal(e)fecit forme syncopée, tout comme cal(i)dus, continuée dans les languesromanesstaminatas (potiones) semble être dérivé (ad hoc ?) de stamno/j « cruche » ; notre buveur « aéclusé des gorgées (comme des) cruches », il boit « à tire-larigot »duxi : ducere « tirer à soi », « boire »matus est un doublet de syllabation de mattus < maditus « ivre » < grisé < humecté
6. InscriptionsÀ partir de la période classique, les inscriptions (murales, funéraires...) sont des
témoignages précieux de changements survenus sur le plan phonologique, morphologique etsyntaxique de la langue. Elles sont des manifestations spontanées de la langue pratiquée pardes gens sans éducation et révèlent des « fautes » par rapport à la langue normative. Cesfautes permettent de reconstituer la langue populaire.
6.1. Témoignage de PétroneAfin de bien interpréter les inscriptions découvertes à Pompéi, il convient tout d’abord
considérer les mentions d’inscriptions faites dans le Satiricon de Pétrone qui se déroule dans
une ville au golfe de Naples. En effet, les murs de la maison de Gaius Pompeius Trimalcion,un riche affranchi, semblent couverts d’inscriptions variées. Toutes disent la richesse, la
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
18/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
18
dignité et l’autorité du maître. Invité au banquet, le narrateur Encolpius arrive avec ses amischez Trimalcion. À gauche en entrant, un énorme chien enchaîné était peint sur le mur etpardessus on lisait en lettres capitales :
Caue canem (Sat . 29)« Gade au chien ! »
Encolpius arrive jusqu’au triclinium. Dans l’antichambre, il observe des faisceaux avec deshaches, dont l’extrémité se terminait par une sorte d’éperon de navire en bronze avec uneinscription :
C. Pompeio Trimalchioni, seuiro Augustali, Cinnamus dispensator. (Sat . 30)« À C. Pompeius Trimalcion, sévir augustal, Cinnamus son trésorier. »Les sévirs augustaux formaient un collège de six membres, chargés d’organiser le culte de
l’empereur.
Sur un mur, une inscription dit que :III et pridie Kalendas Ianuarias C. noster foras cenat (Sat . 30)« L’avant-veille et la veille des Calendes de janvier, notre maître Gaius dîne en ville. »
Ou encore, en parlant des affaires, l’un des affranchis à table, dit que quand ses affairescommenceront à baisser, il fera une affiche :
C. Iulius Proculus auctionem faciet rerum superuacuarum. (Sat . 38)« C. Julius Proculus vendra aux enchères le superflu de son mobilier. »
Au banquet, Trimalcion parle ses dernières volontés : il souhaite qu’après sa mort, on luidresse un monument ; aux pieds de sa statue doit être sa petite chienne, des couronnes, desparfums... ; sur le monument seront sculptés des vaisseaux, une urne sur laquelle un enfantversera des pleurs, une horloge au centre ; à sa droite, il y aura la statue de sa femmeFortunata. Un de ses affranchis sera préposé à la garde de son tombeau. Trimalcion a déjàcomposé son épitaphe que voici :
C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus hic requiescit. Huic seuiratus absenti decretus est.Cum posset in omnibus decuriis Romae esse, tamen noluit. Pius, fortis, fidelis, ex paruocreuit, sestertium reliquit trecenties, nec unquam philosophum audiuit. Vale – Et tu. (Sat . 71)« C. Pompeius Trimalcio Maecenatianus repose ici. Le sévirat lui fut décerné en son absence.Il pouvait être de toutes les décuries à Rome, mais il ne le voulut pas. Pieux, vaillant, fidèle, ilest parti de peu ; il a laissé trente millions de sesterces, et jamais ne suivit les leçons d’unphilosophe. Porte-toi bien. – Toi aussi. »Toi aussi est la réponse du voyageur qui, lisant l’inscription, arrive au salut adressé par lemort aux vivants qui passent : Vale.
6.2. Inscriptions de Pompéi
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
19/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
19
Les inscriptions étaient omniprésentes dans la vie des Romains. On peut bien sereprésenter cette réalité d’après les témoignages conservés à Pompéi, situé au golfe de Naples.Son nom officiel était Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, ainsi appelée depuis que ledictateur Lucius Cornelius Sylla y installa en 80 avant J.-C. les vétérans de ses armées etassocia son nom à celui de Vénus, la déesse chérie des Pompéiens, si souvent invoquée dansles inscriptions. C’est une ville entre deux catastrophes : le tremblement de terre de février 62après J.-C. et l’éruption du Vésuve qui a tout à la fois détruit et préservé à Pompéi. De cesannées datent les inscriptions retrouvées à Pompéi. Des villes voisines (Herculaneum,Stabiae) ont été également atteintes par l’éruption du Vésuve mais à Pompéi, les murs desmaisons étaient mieux préservés par la cendre ce qui a permis leur conservation.
Les inscriptions peuvent être divisées en deux grandes catégories : inscriptions tracéesà la peinture noire ou rouge, et graffiti. Les inscriptions peintes sont appliquées sur unesurface préalablement passée à l’enduit blanc par les soins de professionnels (en général lanuit, à la lueur de la lune ou d’une lanterne) ou plus rarement de peintres amateurs. Il s’agit de
programmes de jeux de gladiateurs, ou d’inscriptions électorales, appelant à voter pour uncandidat aux magistratures. Les graffiti, tracés à la pointe dure dans le stuc ou les enduitspeints, sous l’effet d’une émotion fugitive, de l’enthousiasme, de la colère, ou simplementpour noter des achats ou la liste de tâches à accomplir. Nous connaissons actuellementplusieurs centaines d’inscriptions pompéiennes ; elles ont été rassemblées dans plusieursfascicules du Corpus inscriptionum Latinarum (CIL).
L’inscription de Pompéi la plus connue est la suivante :
Quisquis ama valia, peria qui nosci amare, bis tanti peria, quisquis amare vota. (D 594)« Que vivent tous ceux qui aiment, que périssent tous ceux qui ne savent pas aimer ! Quedeux fois autant périssent ceux qui interdissent d’aimer. »
ama, ualia, peria : avec t perdu ; ea (hiatus) passe en ia noscit pour non scit , i. e. nescit qui disparaît de la langue parléetanti : pour tanto ; confusion du génitif et de l’ablatif de prixuota : forme ancienne et parlée de uetat
D’autres inscriptions sont par exemple :
M. Cerrinium Vatiam | aed. dignum rei p., Tyrannus cupiens | fecit cum sodales. (D 170)« M. Cerrinius Vatia pour édile, digne de (gouverner) l’État, Tyrannus l’a fait de son bonvouloir, ensemble avec les gars. »
aed. = aedilem
p. = publicae
C’est une affiche électorale, inscription peinte. Cum suivi de l’accusatif marque la désuétudedes formes en ibus, ce qui a facilité le syncrétisme acc./abl.
hec venatio pugnabet V. k. septembres | et Felix ad ursos pugnabet. (D 247)
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
20/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
20
« Cette troupe de chasseur luttera le 5e jour avant les Kalendes de septembre, et Felix lutteraavec les ourses »
C’est une affiche de spectaclehec pour haec (ou hic ? « ici »)uenatio « troupe de chasseurs de cirque »
pugnabet : au lieu de pugnabitur V. Väänänen ( Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes, 19592, p. 22) croit que et au lieu de it devait être, à cette époque et non pas laconfusion de e et i en latin tardif.V K. Septembres est plus court que a(nte) d(iem) V Kal(endas) Septembres = 26 aoûtad ursos « aux ours » : ad + accusatif peut prendre la valeur adversative de contra, aduersus(« à qui se battre »)
In his praedis insula Sertoriana bolo esse Aur. Cyriacetis filie meae cinacula n. VI, tabernas n.
XI et repossone subiscalire. Feliciter (D 436)« Dans cette propriété, je veux que l’immeuble Sertorien soit à ma fille Aurelia Cyriace,étages au nombre de 6, boutiques au nombre de 11 et une garde-robe sous l’escalier. À labonne heure !
Inscription peinte de Pompéi retrouvée à Rome en 1819
praedis pour praediisinsula Sertoriana pour insulam Sertorianam
bolo pour uolo Cyriacetis : flexion féminine en –tis du cognomen Cyriace, emprunté au gr. Kuriakh/ (lat.
Dominica)cinacula « étages » pour cenacularepossone pour repositionem subscalarem ; l’abstrait en –itio a pris ici la valeur concrète derepositorium, tout en étant écourté dans le langage pressé du peuple ; l’adjective atteste defaçon indirecte iscala, avec prothèse qui apparaît comme tel plus tard.
L. Istacidi at quem non ceno, barbarus ille mihi est. (D 641)« Lucius Istadicius, chez lequel je ne dîne pas, il est pour moi un barbare. »
anacoluthe : vocatif, explication relative, reprise énonciativeat (ad) quem pour apud
Or, toutes les inscriptions de Pompéi n’ont pas été écrites par des gens non éduqués. Legraffito suivant est une inscription métrique, un distique élégiaque. Son seul défaut estl’hypercorrection de pariens pour paries :
Admiror, pariens, te non cecidisse ruinis,
Qui tot scriptorum taedia sustineas (D 668)« Je m’étonne, ô mur, que tu ne sois pas tombé en ruine,
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
21/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
21
Puisque tu soutiens les niaiseries de tant de scribes !
Une autre série d’inscriptions pour s’amuser :Hic habitamus. Felices nos dii faciant. (CIL 4.8670)« Nous habitons ici. Que les dieux nous rendent heureux ! »
Heic uenatio pugnabit, V Kalendis Septembris. Felix ad ursos pugnabit. (CIL 4.1989)« Ici aura lieu, le cinquième jour avant les Calendes de septembre, un combat contre desanimaux, et Felix combattra contre les ours. »
Priscus Neronianus, VI uictoriarum, uicit.Herennius libertus, XIIX uictoriarum, periit. (CIL 4.1421)« Priscus, de l’équipe des Néroniens, six combats, vainqueur. Herennius l’affranchi, dix-huitcombats, mort. »
Cumis gladiatorum paria XX et eorum suppositicii pugnabunt Kalendis Octobribus, III, pridieNonas Octobres. Cruciarii, uenatio et uela erunt. Cuniculus scriptor Lucceio salutem. (CIL4.9983)« Vingt paires de gladiateurs et leurs doublures combattront à Cumes aux Calendes d’octobre,l’avant-veille et la veille des Nones d’octobre. Il y aura des crucifiés, une chasse et un pare-soleil. Cuniculus qui écrit ces mots salue Lucceius. »
Marcum Casellium et Lucium Albucium aediles oro uos faciatis. Statia et Petronia rogant.
Tales ciues in colonia in perpetuo. (CIL 4.3678)« Élisez édiles Marcus Casellius et Lucius Albucius. Statia et Petronia vous le demandent.Puisse-t-il y avoir toujours de tels citoyens dans notre colonie ! »
Liste d’achats (CIL 4.4000)Oleum libra asses IV Huile : la livre, 4 asPaleam asses V Paille : 5 asFaenum asses XVI Foin : 16 asDiaria asses V Ration d’un jour : 5 asFurfurem asses VI Son : 6 asViriam I asses III Un bracelet : 3 as
Numerius Popidius Numeri filius Celsinus aedem Isidis, terrae motu conlapsam, afundamento pecunia sua restituit. Hunc decuriones ob liberalitatem, cum esset annorum sexs,ordini suo gratis adlegerunt. (CIL 10.846)« Numerius Popidius Celsinus, fils de Numerius, a fait entièrement restaurer à ses frais lesanctuaire d’Isis, détruit par le tremblement de terre. En raison de sa générosité, les décurionsl’ont coopté gratuitement dans leur Ordre, bien qu’il n’eût que six ans. »
Hospitium. Hic locatur triclinium cum tribus lectis et commodis. (CIL 4.807)« Chambres d’hôtes. Ici on loue une salle à manger avec trois lits et toutes les commodités. »
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
22/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
22
13. Dies nundinae (CIL 4.8863) Jours de marché
Saturni Pompeis Samedi à PompéiSolis Nuceria Dimanche à NuceriaLunae Atella Lundi à AtellaMartis Nola Mardi à NolaMercurii Cumis Mercredi : à CumesIouis Putiolos Jeudi à PouzzolesVeneris Roma, Capua Vendredi à Rome, à Capoue
Arma uirumque cano Troiae qui primus ab oris« Je chante les combats et le héros qui, le premier, depuis les bords de Troie » (CIL 4.8831)
Quisque me ad cenam uocarit, ualeat (CIL 4.1937)
« Quiconque m’invitera à dîner, qu’il se porte bien ! »
Oppi, emboliari, fur, furuncule (CIL 4.1949)« Oppius, bouffon, voleur, petit voyou ! »
Marci Iuni insula sum (CIL 4.4429)« Je suis l’immeuble de Marcus Iunius. »
O felicem me (CIL 4.1262)
« Que je suis heureux ! »
Serena Isidorum fastidit (CIL 4.3117)« Serena en a asses d’Isidorus. »
Sarra, non belle facis, solus me relinquis (CIL 4.1951)« Sarra, tu te conduis mal, tu me laisses seul. »
In cruce figaris (CIL 4.2082)« Va te faire crucifier ! »
Caium Iulium Polybium aedilem uiis aedibus sacris publicis procurandisLanternari, tene scalam (CIL 4.7621)« Élisez Gaius Iulius Polybius édile chargé de l’entretien des rues et des bâtiments cultuels etpublics. Porteur de lanterne, tiens bien l’échelle. »
7. Tablettes d’exécrationDans la plupart des provinces de l’Empire romain (par exemple, à Bath en Grande
Bretagne), on a retrouvé des tabellae defixionum – tablettes d’exécration. Ce sont desinscriptions à caractère magique, la plupart datant du 2e ou du 3e siècle après J.-C., gravées
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
23/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
23
sur le plomb, par lesquelles on vouait à une divinité redoutée et malfaisante un rival, unennemi, un malfaiteur.
Dea Ataecina Turibrig(ensis) Proserpina per tuam maiestatem te rogo oro obsecro uti uindicesquot mihi furti factum est, quisquis mihi imudauit inuolauit minusue fecit eas [res] q.i.s.s.tunicas VI, paenula lintea II, indusium cuius [...] (ed. Audolent, 1904, A 122)« Déesse Ataecina Turibrigensis Proserpine, je te prie, je t’implore, je supplie de me vengerce qu’on m’a volé, qui que ce soit qui m’a subtilisé, m’a pris ou m’a soustrait les (choses) quisont écrites plus bas : 6 tuniques, 2 manteaux de lin, une chemise de laquelle... »
Cette tablette, datant de l’époque de Trajan, provient de Emerita Augusta – Mérida (sud-ouestde l’Espagne) et est destinée à Ataecina, déesse lusitanienne (de Turobriga) assimilée àProserpine.quot pour quod
imudauit probablement pour immutauit (avec sonorisation d’un t intervocalique), euphémismepour ‘voler’, tout comme inuolauit et minus fecit ; immutare avait déjà une connotationpéjorative (‘changer en mal’).q.i.s.s. quae infra scriptae sunt
paenula lintea est peut-être un neutre pluriel, si ce n’est paenula(m) lintea(m) avec II ajoutéaprès
8. Lettre d’un soldatLes lettres du soldat Claudius Terentianus datant du premier quart du deuxième siècle
après J.-C, sont un témoignage important du latin populaire de cette époque. ClaudiusTerentianus était soldat en Égypte et bilingue, il écrivait des lettres en latin ou en grec à sonpère. Écrites sur du papyrus, ses lettres sont des documents rares en son genre : des papyrilatin sont généralement peu conservés (400 environ en comparaison avec des milliers depapyrus grecs). Les lettres de Claudius Terentianus ont été retrouvées près d’Alexandrie.
Le jeune soldat vivait chez un oncle et une tante qu’il appelle ‘père’ et ‘mère’. Ilraconte à son père ses difficultés à se rendre à Alexandrie ; il devait s’embarquer pour l’Italieet accomplir son service militaire.
Dico illi ‘da mi’, dico, ‘aes paucum’. ‘Ibo’, dico, ‘ad amicos patris mei’. Item aculentiaminaque mi mandauit, nullum assem mi dedit. Ego tamen inc ebinde collexi paucum aesed ibi ad uaroclum et guiuan et emi pauca que expediui. Si aequm tempus es set se exiturumAlexandrie siluit . Item non mi dedit aes quam aureum matri mee in uestimenta. ‘Hoc est,inquit, quod pater tus mi mandauit’. Quo tempus autem ueni omnia praefuerunt et lana etmatrem meam aute praegnatam imueni.« Je lui dis ‘donne-moi’, je dis ‘un peu d’argent’. ‘J’irai’, je dis, ‘chez les amis de mon père’.Ainsi il m’envoya une aiguille et de la toile de laine ; il ne m’a pas donné un sou. Moipourtant j’ai ramassé de-ci de-là un peu d’argent et je suis allé chez V... et G... et j’ai achetépeu de choses dont j’avais besoin. S’il avait été un moment favorable, il se serait tué (sur
l’occasion) de partir à Alexandrie. De même, il ne m’a pas donné d’argent, seulement unaureus pour ma mère pour (m’acheter des) vêtements. ‘C’est ce que ton père m’a envoyé’,
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
24/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
24
dit-il. Mais au moment où je suis venu, tout était là ainsi que la laine, mais j’ai trouvé mamère avant l’accouchement. »
Particularités linguistiques :dico : répétition pléonastiqueille est le démonstratif le plus employé dans les lettres de Terentianus ; il remplace is.mi forme populaire à contraction
paucus au sens de « un peu » est familieritem : de la même manièreacu pour acumlentiamina pour linteamina « toile de lin », avec résolution du hiatus ea en iainc ebinde pour hinc abinde de ci, de làcollexi pour collegied ibi pour et iui ; bétacisme du u intervocalique ; la variation t/d est fréquente à la fin des
mots monosyllabiques. Il peut s’agir d’une sonorisation devant voyelle ou d’uneneutralisation en position finaleuaroclum et guiuan sont interprétés comme des noms d’amis dont le soldat parleque pour quaeexpediui peut être interprété comme expetiui avec sonorisation du t intervocalique
Alexandrie pour Alexandriae, locatif de direction fossilisésiluit reconstruction douteuseinquid : variation de t/d ou contamination avec quidtus pour tuus
quo tempus pour quo tempore : tempus tend à devenir une forme figéeautem est l’adversatif le plus fréquent chez Terentianus
praefuerunt au sens de « être présent », praesens praegnatam : contamination entre praegnans et natus
9. La Mulomedicina ChironisSous le pseudonyme de Chiron (allusion au fondateur mythique de l’art vétérinaire, le
centaure Chiron) se cache un vétérinaire qui, dans la deuxième moitié du 4e siècle a rédigédans un latin populaire un traité consacré aux maladies des chevaux, du gros bétail, desmoutons et des porcs. Il est l’une des sources principale de Végèce (vers 400 après) qui asystématisé la même matière et l’a exprimé dans une langue beaucoup plus soignée.
Si iumentum de uia coactum ueniet et suffusionem in pedibus habuerit... Pocionem datohanc... Si gems fuerit, calda fomentato, state autem frigida. Si tardius rectus factus fuerit,furfurem et resinam, hiis coctis dum feruet, in ungulis impones, non semel, sed aliquociensdiurnum, donec rectus ambulet. Si nec sanus factus fuerit, semissabis eum de ungulis.(Mulom. 158-159)« Si une bête (de somme) vient épuisée de fatigue après une course et a les pieds enflés...Qu’on lui donne la potion suivante... En hiver (on lui torche le mufle) avec de l’eau chaude,
en été avec de l’eau froide. Si elle se remet trop lentement, on doit lui appliquer du fromentbroyé et de la résine, encore chauds, après avoir été chauffés, sur les sabots ; et ceci pas
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
25/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
25
(seulement) une seule fois, mais à plusieurs reprises par jour, jusqu’à ce qu’elle marcheimpeccablement. Si elle ne se remet pas (ainsi), on lui fait une saignée aux ongles. »
Particularités linguistiqueshabuerit : l’emploi du futur II est fréquent dans la protase en latin tardif
pocionem pour potionem comme aliquociens assibilationgems pour (h)iems : palatalisation du y initial de iems calda pour calida avec syncope ; l’adjectif calida est utilisé comme substantivé : « l’eauchaude »state pour (a)etate : hypercorrection due à la tendance d’ajouter un e prothétique devant simpurum factus fuerit : subjonctif parfait passif avec l’auxiliaire au subjonctif parfait et non passubjonctif présentin ungulis pour in ungulas
diurnum est l’étymon du mot ‘jour’ dans plusieurs langues romanesde ungulis complément de relation construit avec de
Ce passage peut être comparé avec un passage de Végèce :Si equus, inquit, coactus de uia uenerit... si de labore itineris suffusio pedum forte prouenerit,... huiusmodi potionis usurus... Si hiems fuerit, tepida os ablues, aestate frigida ; si tardius [autnon] rectus ambulat, furfurem et resinam calentem ungulis imponis, non semel tantum sedaliquotiens, donec rectus incedat. Si uero ista non profuerint, semissabis eum, ut de ungulissagitta contactis competenter profluat sanguis. (Végèce, l’ Art vétérinaire, 1.36.5)
10. Itinerarium EgeriaeUn manuscrit unique (11e siècle, trouvé à Arezzo en 1884 par Gamurrini) nous a
conservé une relation de voyage en Terre Sainte, se distinguant tout particulièrement par savivacité. Le début et la fin – probablement deux tiers – de cet ouvrage étant perdus, c’est unelettre de Valerius de Bierzo qui, sous forme de laudatio nous atteste que l’auteur est unereligieuse de la région des Pyrénées, du nom de Egeria (et non Aetheria ou Silvia, comme onl’avait supposé). Le voyage aurait été entrepris entre 381 et 384 (Devos). Le texte a été écrit(ou dicté ?) sous l’impression directe des lieux visités.
La langue de ce récit est un exemple typique de style parlé, avec des répétitions, despléonasmes, des anacoluthes qui reflètent une passion pour la découverte des lieux bibliqueset le désir de communiquer les sentiments aux consœurs. C’est un témoin précieux du stylefamilier en usage à la fin du 4e siècle après J.-C. : les cas nominaux sont doublés et éclaircispar des tournures prépositionnelles, l’emploi des pronoms personnels (ego, nos) oudémonstratifs (ipse, ille) s’accroît visiblement, le parfait s’achemine vers les formes avec fuit ,
fuerat , les déponents passent à l’actif ou à l’usage réfléchi avec se et sibi, les propositionsinfinitives commencent à céder à l’avance de quod, quia, quoniam...
Interea ambulantes peruenimus ad quendam locum, ubi se tamen montes illi, inter quosibamus, aperiebant et faciebant uallem infinitam, ingens, planissima et ualde pulchram, et
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
26/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
26
trans uallem apparebat mons sanctus Dei Syna. Hic autem locus, ubi se montes aperiebant,iunctus est cum eo loco, quo sunt memoriae concupiscentiae. 2. In eo ergo loco cum uenitur,ut tamen commonuerunt deductores sancti illi, qui nobiscum erant, dicentes: « Consuetudoest, ut fiat hic oratio ab his qui ueniunt, quando de eo loco primitus uidetur mons Dei »: sicutet nos fecimus. Habebat autem de eo loco ad montem Dei forsitan quattuor milia totum perualle illa, quam dixi ingens.
« Entre temps, en marchant, nous arrivâmes à une place où les montagnes, entre lesquellesnous allions, s’ouvraient enfin et faisaient (naître) une vallée sans fin, immense, très plate etfort belle, et de l’autre côté de la vallée apparaissait Syna, la sainte montagne de Dieu. Et cetteplace, où les montagnes s’ouvraient, est jointe à la place où sont les Tombeaux de laconvoitise. Donc quand on arrive à cette place – du moins comme les saints guides qui étaientavec nous nous attirèrent l’attention, en nous le disant – il y a l’habitude que ceux qui yarrivent fassent une prière, quand on voit pour la première fois, depuis cette place, lamontagne de Dieux ; comme nous le fîmes nous-mêmes aussi. Et il y avait depuis cette place
jusqu’à la montagne de Dieux, peut-être, quatre milles tout au long de cette vallée, que j’ainommée immense. »
faciebant uallem au sens de efficere, le verbe simple pour le composé planissima sans m final (amenée par ingens, traité comme non déclinable, ici et plus loin)ingens employé comme synonyme de grandis et tam magnushabebat « il y avait », cf. esp. hay, habiatotum adverbial « tout, toujours »
Statim ergo ut haec audiui, descendimus de animalibus, et ecce occurrere dignatus est sanctuspresbyter ipsius loci et clerici ; qui nos statim suscipientes duxerunt suso ad ecclesiam. Ubicum uenissemus, statim iuxta consuetudinem primum facta est oratio, deinde lectus est ipselocus de libro sancti Moysi, dictus est etiam psalmus unus competens loco ipsi, et denuo factaoratione descendimus. Cum ergo descendissemus, ait nobis ille sanctus presbyter iam senioret de scripturis bene instructus : « Ecce ista fundamenta in giro colliculo isto, quae uidetis, haesunt de palatio regis Melchisedech. » ( Itinerarium, 14.1-2)
« Aussitôt donc que j’eus entendu ces paroles, nous sommes descendus de nos montures etvoici que le saint prêtre de cet endroit a daigné venir vers nous, avec ses clercs ; nous ayant
aussitôt accueillis, ils nous ont conduits au-dessus, à l’église. Arrivés là, aussitôt, selon notrehabitude, nous avons d’abord fait une prière, ensuite nous avons lu le passage du livre de saintMoïse, nous avons également récité un psaume approprié à cet endroit et, après avoir fait denouveau une prière, nous sommes descendus. Et lorsque nous fûmes descendus, ce saintprêtre, déjà passablement âgé et très savant dans les Ecritures, nous dit (…) : « Ces fondationsque vous voyez autour de ce tertre, ce sont celles du palais du roi Melchisédech. »
suso : le latin vulgaire connaît les doublets suso et susum pour la forme classique sursum (rsassimilé en ss puis simplifié après voyelle longue)
ubi cum uenissemus : ubi au lieu de quo locus de libro : de + abl. à la place du génitif ; partitif « extrait du livre »
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
27/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
27
de scripturis bene instructus : en latin classique, in + abl.ecce ista : forme renforcée du démonstratifin giro colliculo isto : in giro + abl.hae : f. pl., devrait être accordé avec fundamentade palatio regis : au lieu du génitif
Et incipient episcopo ad manum accedere singuli. Et postmodum de Anastasim usque adCrucem cum hymnis ducitur episcopus, simul et omnis populus vadet. Vbi cum perventumfuerit, primum facit orationem, item benedicet cathecuminos; item fit alia oratio, itembenedicit fideles. Et post hoc denuo tam episcopus quam omnis turba vadent denuo postCrucem et ibi denuo similiter fit sicuti et ante Crucem. Et similiter ad manum episcopoacceditur sicut ad Anastasim, ita et ante Crucem, ita et post Crucem. Candelae autem vitreaeingentes ubique plurimae pendent et cereofala plurima sunt tam ante Anastasim quam etiamante Crucem, sed et post Crucem. Finiuntur ergo haec omnia cum crebris. Haec operatio
cottidie per dies sex ita habetur ad Crucem et ad Anastasim. ( Itinerarium 24.7)
« Et chacun commence de venir à la portée de main de l’évêque. Après quoi, on conduitl’évêque, avec des hymnes, de l’Anastasis à la Croix, et tout le peuple l’accompagne. Quandon y est arrivé, il fait d’abord une prière, puis bénit les catéchumènes ; ensuite il fait une autreprière et bénit les fidèles. Après quoi l’évêque, avec toute la foule, va encore derrière la Croixet là encore, on fait comme devant la Croix. On s’approche à la portée de main de l’évêquecomme à l’Anastasis, et devant la Croix, et derrière la Croix. D’énormes lanternes de verresont suspendues partout en grand nombre, et les cierges sont nombreux aussi bien devant
l’Anastasis que devant et derrière la Croix. Tout cela se termine avec le crépuscule. Lesoffices ont lieu quotidiennement pendant six jours de la semaine à la Croix et à l’Anastasis. »
Similiter et tertia feria similiter omnia aguntur sicut et secunda feria. Quarta feria autemsimiliter itur de noctu ad Anastase et aguntur ea, quae semper, usque ad mane ; similiter et adtertiam et ad sexta ; ad nonam autem, quia consuetudo est semper, id est toto anno, quartaferia et sexta feria ad nona in Syon procedi, quoniam in istis locis, excepto si martirorum dieseuenerit, semper quarta et sexta feria etiam et a cathecuminis ieiunatur : et ideo ad nonam inSyon proceditur. Nam si fortuito in quadragesimis martyrorum dies euenerit quarta feria autsexta feria, † atque ad nona in Syon proceditur. ( Itinerarium, 27.5)
« De même, le mardi, tout se passe comme le lundi. Le mercredi ; on va de même de nuit àl’Anastasis et l’on fait comme toujours jusqu’au matin ; de même, à la troisième et à lasixième heure. Mais à la neuvième heure, comme c’est toujours l’usage, toute l’année, de seréunir à Sion le mercredi et le vendredi à la neuvième heure – car en ces lieux, sauf si desfêtes de martyrs tombent ces jours-là, on jeûne toujours le mercredi et le vendredi, même lescatéchumènes – à la neuvième heure donc, on se réunit à Sion. S’il arrive, pendant le carême,qu’une fête des martyrs tombe le mercredi ou le vendredi (...) et l’on se réunit à Sion à laneuvième heure. »
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
28/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
28
Les jours de la semaine2 Isidore de Séville, Etymologies 5.30.5-85 Dies dicti a diis, quorum nomina Romani quibusdam sideribus sacraverunt. Primum enimdiem a Sole appellaverunt... secundum a Luna... tertium ab stella Martis... quartum ab stellaMercurii... quintum ab stella Iovis... sextum a Veneris stella... septimus ab stella Saturni. 9Apud Hebraeos autem dies prima una sabbati dicitur, qui apud nos dies dominicus est, quemgentiles Soli dicaverunt. Secunda sabbati secunda feria, quem saeculares diem Lunae vocant.Tertia sabbati tertia feria, quem diem illi Martis vocant. Quarta sabbati quarta feria, quiMercurii dies dicitur a paganis. 10 Quinta sabbati quinta feria est, id est quintus a diedominico, qui apud gentiles Iovis vocatur. Sexta sabbati sexta feria dicitur, qui apud eosdempaganos Veneris nuncupatur. Sabbatum autem septimus a dominico dies est, quem gentilesSaturno dicaverunt et Saturni nominaverunt. Sabbatum autem ex Hebraeo in Latinum requiesinterpretatur, eo quod Deus in eo requievisset ab omnibus operibus suis.
« Les jours sont ainsi appelés d’après les dieux dont les noms ont été appliqués à certainesplanètes par les Romains. Ils ont nommé le premier jour d’après le Soleil, qui est le chef detoutes les planètes comme ce jour est le chef de tous les jours. Le second jour a été appeléd’après la Lune... le troisième d’après Mars, le quatrième d’après Mercure... le cinquièmed’après Jupiter... le sixième d’après Vénus... le septième d’après Saturne. 9 Or, chez les Juifs,le premier jour se dit sabbat , c’est chez nous dimanche, que les païens appelaient « jour duSoleil ». Le deuxième jour après le sabbat, c’est secunda feria que les séculaires appelaient« jour de la Lune ». Le troisième, tertia feria, jour qu’ils appelaient « jour de Mars ». Lequatrième, quarta feria, que les païens nomment « jour de Mercure ». 10 Le cinquième,
quinta feria, c’est à dire le cinquième jour à compter du dimanche, « le jour de Jupiter » chezles païens. Le sixième jour, sexta feria, appelé « jour de Vénus » par les païens. Le sabbat estle septième jour à partir du dimanche, dédié à Saturne par les païens et appelé d’après lui. Lemot « sabbat » se traduit par « repos » de l’hébreu en latin parce que le Dieu s’est reposé ce
jour-là après tous ses travaux. »
shabbat (ou chabbat ) signifie « abstention »
2
Les « semaines » chez les Romains étaient séparées par les nundinae (de nouem « neuf » et dies « jour »), les« nundines », ce qui était l’appellation des jours de marché, revenant tous les neuvièmes jours. Le diesnundinarum était consacré aux achats au marché et à l’arrangement des affaires variées. Le découpage ensemaines de sept jours est inspiré par la pratique juive et s’est répandu avec le christianisme au 3 e siècle après J.C. L’adoption du dimanche chrétien comme jour de repos, au lieu du samedi juif, est officialisé par un décret del’empereur Constantin 1er en 321. Or, l’église, en particulier catholique, répugnait aux appellations « païennes »romaines de Lunae dies, Martis dies, Mercurii dies... et a essayé de généraliser un système mettant en œuvre desappellations par l’ordre « deuxième, troisième, quatrième... jour » (à compter du samedi), dies dominica étant lepremier jour. Ainsi avait-on les appellations de secunda feria (= lundi), tertia, quarta, quinta et sexta feria, quisont à l’origine des termes de la liturgie catholique. Ce système n’est pas entré dans l’usage commun dans leslangues romanes (on a réintroduit les anciennes appellations de lundi, mardi... ou plus tard?, je ne sais pas). Cesappellations ne se sont maintenues qu’en portugais où on a segunda-feira (lundi), terça, quarta, quinta, sexta- feira. Cf. également les appellations en grec moderne : deute/ra, tri/th, teta/rth, pe/mpth. Cf. aussi les
appellations (d’origine liturgique) dans les langues slaves (avec un décalage, lundi compte comme le premier jour) : úterý (mardi, le « deuxième jour »), č tvrtek (jeudi, le quatrième), pátek (vendredi, le cinquième).
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
29/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
29
11. L’ Appendix ProbiUn palimpseste écrit autour de l’année 700 par les moines de Bobbio contient, en
annexe aux Instituta artium, manuel de morphologie attribué au grammairien Probus (1er siècle après J.-C.) mais en réalité, appartient au grammairien Palladius (4e siècle) – cinqappendices dont le troisième est connu sous le nom de l’ Appendix Probi. Il s’agit d’une liste
normative, œuvre d’un puriste qui essaie de recommander le bon usage en relevant les fautesles plus courantes et rencontrées dans les textes. Il semble être rédigé au 5e /6e siècle.
Toute la série de formes « fautives » est très significative pour la façon dont onécrivait et on prononçait le latin à basse époque. L’ Appendix Probi donne 227 formes« fautives » qui concernent des confusions vocaliques (i/e/ae ; o/u), consonantiques (c/ch ;qu/cu ; x/s), des formes syncopées, des assimilations consonantiques, n perdu devant s (ou saréfection hypercorrecte), bétacisme, sourdes/sonores, réfections de paradigmes, disparition de-bus, neutres en -a féminisées, diffusion des diminutifs, régularisations et ré-motivationsétymologiques, apposition au nominatif 3...
masculus non masclus (4) syncopehercules non herculens (19) hypercorrectionaquaeductus non aquiductus (22) i est une voyelle de liaison, cf. armiger pecten non pectinis (21) nominatif refait sur la déclinaison parisyllabiqueauus non aus (29) devant o/u, la semi-voyelle u tend à s’amuïralueus non albeus (70) bétacismeansa non asa (76) amuïssement de n devant dentaleauris non oricla (83) diminutif remplace le mot de base, auris suppellex non superlex (94) tentative de motiver un mot peu clairoculus non oclus (111) syncopeauctor non autor (154) perte de lien étymologique entre auctor et augeo ipse non ipsus (156) analogie d’après la déclination nominalenurus non nura (169) « bru » alignement sur les féminins en -aanus non anucla (172) « vieille femme » ; alignement, diminutiftolerauilis non tolerabilis (198) hypercorrection ; bétacismefebruarius non febrarius (208) perte de w en fin de groupe consonantiqueadhuc non aduc (225) amuïssement de h
3 Par exemple, uico capitis Africae non uico caput Africae (134).
-
8/17/2019 Latin en Diacronia
30/51
Le latin en diachronie Olga Spevak
30
12. Grégoire de ToursGrégoire de Tours (538-594), évêque de Tours, historien de l’Église, est auteur de
l’ Histoire des Francs en dix livres, source indispensable pour l’histoire de la Francemérovingienne. La langue des écrits de Grégoire de Tours témoigne de la décadenceculturelle de son époque : son style abonde en approximations phonétiques (confusionsvocaliques, syncopes, erreurs en finale de mot), en fautes morphologique (genre et cas), toursanalytiques dans la flexion du nom et du verbe, en ellipses et anacoluthes. Néanmoins, sonœuvre témoigne d’une influence de la tradition du genre littéraire : de la prose historique. Enoutre, il y a eu plusieurs œuvres de ce type à l’époque postérieure à Grégoire : des chroniqueset histoires (parmi eux, Frédégaire).
Extrait :Vnde factum est, ut Quintianus Rutenorum episcopus per hoc odium ab urbe depelleretur.Dicebant enim ei quia : ‘Desiderium tuum est, ut Francorum dominatio possideat terram
hanc’. Post dies autem paucos, orto inter eum et cives scandalum, Gothos, qui in hac urbemorabantur, suspitio attigit, exprobantibus civibus, quod velit se Francorum ditionibussubiugare ; consilioque accepto, cogitaverunt eum perfodere gladio. Quod cum viro Deinuntiatum fuisset, de nocte consurgens, cum fidelissimis ministris suis ab urbe Rutenaegrediens, Arvernus advenit. Ibique a sancto Eufrasio episcopo, qui quondam AprunculoDivionensi successerat, benigne susceptus est, largitisque ei tam domibus quam agris etvineis, secum retenuit.
Historia Francorum, 2.36
« Ainsi il arriva que Quintianus, évêque de Rodez, fut chassé de sa ville par haine des Francs.On lui disait en effet qu’il souhaitait voir les Francs occuper le territoire des Rutènes et yétablir leur pouvoir. Or peu de jours après une dispute éclate entre les habitants et lui ; lesGoths qui demeuraient dans cette ville conçurent le supçon que, si les habitants le blâmaient,c’est qu’il voulait les soumettre à la domination des Francs et ils projetèrent de le percer àcoups d’épée. Cela fut rapporté à l’homme de Dieu ; il se leva au cours de la nuit, prit avec luises plus fidèles serviteurs, sortit de Rodez et gagna Clermont. Là le saint évêque Euphrasius,qui avait jadis succédé à Aprunculus de Dijon, le reçut avec bonté ; il lui donna maisons,champs et vignes et le retint avec lui. »
dicebant quia : introduit un discours direct (tuum et non pas eius)orto... scandalum : construction participiale absolue avec le substantif à l’accusatifsuspitio (pour suspicio) : assibilation de ti en ci ; confusions prouintia pour prouincia, et
inversement iusticia pour iustitia ; cf. ditionibus pour dicionibus exprobantibus (pour exprobrantibus) : faute du copiste ou dissimilation r... r > r... øsuspitio attigit quod uelit : quod + subjonctif au lieu