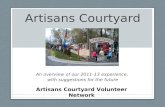LaRevueDurable - artisans de la transition
Transcript of LaRevueDurable - artisans de la transition

RENCONTRE JACQUES GRINEVALD :
Nicholas Georgescu-Roegen, dissident de l’Occidentet visionnaire de la décroissance
LaRe
vueD
ura
ble
LaRevueDurable
DOSSIER Agriculture locale et commerce équitable
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.–
: 9
.–
au Pérou et au mexique, la consommation équitable
débarque sur les marchés locaux
NUMÉRO 20 • AVRIL - MAI - JUIN 2006 • bimestriel
la paysannerie familiale
est capable d’intensifi er
la production agricole
DOSSIER
Des réponses au « Cauchemar de Darwin » :
AGRICULTURE LOCALE ET COMMERCE ÉQUITABLE
Dans l’Ouest français,le rad apporte des solutions
En Suisse et en France l’agriculture contractuelle explose

2
Jean-Yves, brasseur bio en Dordogne (24)
prêt n° 1052 de 13 720 €
pour le réaménagement de la brasserie du Canardou
société coopérativede finances solidaires
la Nef - 114, bd du 11 novembre 191869626 Villeurbanne Cedexfax : 04 72 69 08 79courriel : [email protected] www.lanef.com
1 PUB QUADRI 230x159 1 29/03/06 12:25:50
Adresse de réception de l’abonnement :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° : . . . . . . . Rue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Code postal :. . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offre valable jusqu’au 31/12/2006 pour un abonnement en France métropolitaine uniquement. Vous disposezd’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des données vous concernant auprès du WWF.
BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à WWF France, BP 201, 27102 Val de Reuil Cedex
�
15,80
Je règle par :� Chèque bancaire à l’ordre du WWF � Carte bancaire n° date de validité
signature :
� je désire recevoir une facture
P04DUR
€
ou abonnez-vous sur : www.wwf.fr
Pour une planète vivante
Avec panda magazineje protège la nature et je soutiens le WWF
Revue trimestrielle éditée par le WWF,40 pages passionnantes pour découvrir et protéger la nature
� OUI, je m’abonne à Panda magazine pour :� 2 ans au prix de 26 € seulement au lieu de 31,60 €pour 8 numéros� 1 an au prix de 15,80 € pour 4 numéros
� OUI, je souhaite faire un don de : ......................... €
LA PELUCHE GRENOUILLE,symbole du combat duWWF pour l’eau douce
seulement par an
+
230x159 10/03/06 13:32 Page 1

ÉDITORIAL
ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz
Les bons signaux
L’importance de la demande mondiale n’explique pas à elle seule la flambée actuelle des cours du pétrole et du gaz. Mais la plupart des autres facteurs qui interviennent pour faire grimper les prix – guerre en Irak, tensions en Iran, déstabilisation au Nigeria et ailleurs, catastrophes naturelles, spéculations bour- sières – masquent eux aussi l’imminence des pics pétroliers et gaziers. Ce qui en-courage les pays du G7 et leurs élites politiques à proposer des réponses avant tout guidées par le court terme : puiser dans les réserves stratégiques, réinvestir dans la production, augmenter les capacités de raffinage… comme si de rien n’était.
Bien sûr, de plus en plus de gens – y compris en haut lieu – comprennent que l’affaire n’est pas aussi simple, que le butoir est proche, qu’il faut trouver une al-ternative aux énergies fossiles et fissiles. Mais ces gens ne dépassent toujours pas une minorité sans levier politique à la hauteur de la situation. En attendant, le politique – qui fait bien trop peu pour aider cette minorité à grandir – se complaît à envoyer les mauvais signaux : continuons de faire comme si les réserves terres-tres étaient illimitées, comme si l’effet de serre n’était pas une donne considérable imposant un bouleversement du modèle de développement en vigueur, comme si le nucléaire était vraiment gérable à grande échelle et à long terme et, de plus, compatible avec la démocratie.
Dès lors, où trouver les bons signaux ? Là où ils ne sont pas attendus ! Au prin-temps 2005, les salles obscures en ont envoyé un lumineux. Avec son Cauchemar de Darwin, Hubert Sauper a réussi un très joli coup. Ce dossier exceptionnel-lement long de LaRevueDurable saisit la drôle de perche que ce documentaire tend à ses spectateurs pour envisager d’autres manières de s’alimenter (voir le dossier, page 15).
Manger les aliments cultivés (ou pêchés) près de chez soi est sans doute l’une des meilleures réponses structurelles à offrir à la crise du pétrole et à la crise énergétique globale. Pour réduire les « besoins » énergétiques et leur cortège de guerres du pétrole, d’effet de serre, d’amoncellement de déchets, y compris radioactifs, les voies à suivre ne se résument pas aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et à la sobriété : elles incluent aussi l’organisation de la société pour diminuer le plus possible la demande en énergie. Or, il est suicidaire de favoriser les échanges agricoles tous azimuts dès lors que les coûts écologiques que cette option implique sont aussi graves que la déstabilisation du climat et des tensions toujours plus effrayantes autour de l’or noir.
De leur côté, les défenseurs du nucléaire se serrent les coudes pour relancer cette filière en prétendant contrôler la prolifération. Vingt ans après le séisme de Tchernobyl, l’héritage de cet événement commence à peine à livrer sa pleine si-gnification : l’expansion du nucléaire met en péril la suite de l’aventure humaine. Et il est temps d’entendre cet autre signal essentiel : la nature de la croissance ac-tuelle mène le monde à l’abîme (voir l’interview de Jacques Grinevald, page 8).
La bonne nouvelle est qu’il y a d’autres voies. Certains s’emploient à les suivre. Puisse leur exemple inspirer de plus en plus de leurs concitoyens.
Une publication de CERIN SàrlRue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, SuisseTél. : + 41 26 321 37 10 ; fax : + 41 26 321 37 12 www.larevuedurable.com Rédacteurs responsables : Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz
Mise en page, iconographie et maquette de couverture : Jean-Christophe FroidevauxIllustrations : Tom TiraboscoCorrection : Anne PerrenoudCartographie : Marie-Claude Backe-Amoretti
Abonnements, marketing et publicité : Hélène Gaillard ; tél. : + 41 26 321 37 11 Tirage : 11 000 exemplaires Maquette : Nicolas Peter et Marc Dubois Impression : Atar Roto Presse SA, Genève Papier : 50 % recyclé, blanchi sans chloreAvec le soutien de la Banque Franck, Galland & Cie SA et de l’association Les amis de LaRevueDurable
LaRevueDurable N°20
ÉDIT
ORI
AL
3

w w w . p l e a 2 0 0 6 . o r g
PLEA 200623 rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON PASSIVE AND LOW ENERGY ARCHITECTUREGENEVA SWITZERLAND 6-8 SEPTEMBER 2006
La 23e conférence PLEA à Genève a pour but de valoriser les réflexions et les expériences propicesau développement d’un environnement construit intelligent, durable et à la portée de tous.
Thèmes � Leçons de l’architecture traditionnelle
� Stratégies et outils du projet
� Bien-être et confort à l'intérieur et à l'extérieur
� Confort intérieur dans les bâtiments vitrés
� Recherche et transfert de technologies
� Stratégies et outils d’aide pour la rénovation
� Enseignement de l’architecture pour une conception durable
� Projets à basse consommation d’énergie à l’échelle urbaine: exemples
� Etudes de cas
Pub l i c architectes, urbanistes, professionnels engagés dans la construction et le développement durable
Inscr ip t i on www.plea2006.org

SOM
MA
IRELaRevueDurable N°20 SOMMAIRE
20 Le réalisateur du « Cauchemar de Darwin » a fondamentalement raison
LRD
33 Le commerce équitable, outil de développement
et d’éducation GUY DURAND
52 Il faut manger moins de viande
LRD
54 L’association pour le maintien d’une agriculture paysanne passe la vitesse supérieure
LRD
57 En Suisse comme ailleurs, la souverai-neté alimentaire a besoin des consom-mateurs LRD
23 Ce que deviennent les usines de poisson du lac Victoria
EIRIK G. JANSEN
3 ÉDITORIAL
6 brèves
7 ANNONCE Attention, en Suisse uniquement
LaRevueDurable sort de kiosque
8 RENCONTRE JACQUES GRINEVALD : Nicholas Georgescu-
Roegen, dissident de l’Occident et visionnaire
de la décroissance
DOSSIER DES RÉPONSES AU « CAUCHEMAR
DE DARWIN » : AGRICULTURE LOCALE et commerce équitable
15 Éditorial et sommaire du dossier
16 Indicateurs
19 Vers des citoyens solidaires d’une agriculture de proximité
20 Le réalisateur du « Cauchemar de Darwin » a fondamentalement raison
23 Ce que deviennent les usines de poisson du lac Victoria
24 Comparaison entre libre-échange et souveraineté alimentaire
26 Les maîtres de la mondialisation de l’agriculture
28 Au Venezuela, la réforme agraire d’Hugo Chavez est en marche
30 Marché mondial et autosuffisance alimentaire, les pays du Sud ont une marge de manœuvre
33 Le commerce équitable, outil de développement et d’éducation
36 Au Pérou et au Mexique, la consommation équitable débarque sur les marchés locaux
39 Les agriculteurs du Burkina Faso pourraient nourrir leur pays
42 La paysannerie familiale est capable d’intensifier la production agricole
46 Le soja en Amérique du Sud ou le cauchemar de Humboldt
48 Dans l’Ouest français, le Réseau Agriculture durable apporte des solutions
52 Il faut manger moins de viande
54 L’association pour le maintien d’une agriculture paysanne passe la vitesse supérieure
57 En Suisse comme ailleurs, la souveraineté alimentaire a besoin des consommateurs
58 L’agriculture contractuelle se porte bien en Suisse
61 Guide sur l’agriculture
65 Bilan du cycle de 3 x 3 conférences inspirées du « Cauchemar de Darwin »
67 AGENDA
68 CORRESPONDANCE
70 brèves
26 Les maîtres de la mondialisation
de l’agriculture LRD
46 Le soja en Amérique du Sud
ou le cauchemar de Humboldt
MARC HUFTY
Dre
amst
ime/
Mila
n Ra
dulo
vic
Geo
rges
Bar
toli
- C
CFD
Mat
thew
Maa
skan
t
5

brèVES LaRevueDurable N°20
Brèves sur la consommation
Les bons réflexes des Français
Trois ménages français sur quatre affirment trier
leurs déchets, arrêter la veille de leur télévision, pren-
dre leur propre sac pour faire leurs courses et regarder
l’étiquette Energie lorsqu’ils achètent un appareil élec-
troménager. En revanche, peu d’entre eux déclarent
acheter des produits issus de l’agriculture biologique
(21 %) ou des ampoules basse consommation (15 %).
Faire attention à la quantité de déchets qu’implique
l’achat d’un bien est également peu répandu (17 %).
Ce sont là quelques conclusions d’une enquête de
l’Institut national des statistiques (Insee).
Dans l’ensemble, l’adoption de comportements
favorables à l’environnement est liée à une certaine
aisance sociale : les ménages propriétaires, vivant en
couple, dans lesquels la personne de référence, âgée
de plus de 30 ans, est diplômée, ont le geste écologi-
que plus facile, surtout s’ils habitent dans une petite
agglomération. Les habitants de la région parisienne
sont moins nombreux à avoir le réflexe écologique.
Quatre pages de l’Ifen n° 109, février 2006.
www.ifen.fr/publications/4pages/de109.htm
Les banques françaises avancent à reculons
Dans le cadre de leur campagne « Banques fran-
çaises : épargnez le climat ! », Les Amis de la Terre
attribuent des cactus et des roses. Il arrive parfois que
les mêmes institutions soient félicitées et épinglées. Le
groupe Crédit Agricole, qui a lancé au niveau national
une nouvelle offre en faveur de l’environnement, est
salué. Elle se compose de trois produits. Le premier
consiste en des prêts à des conditions favorables pour
les économies d’énergie et les énergies renouvelables
dans les logements. Le second est un fonds d’investis-
sement socialement et écologiquement responsable.
Le troisième est un fonds de 80 millions d’euros pour
investir dans des entreprises du secteur des éner-
gies renouvelables. Par ailleurs, une autre banque, la
Caisse régionale des Savoie, a lancé, début 2006, un
prêt pour le chauffe-eau solaire individuel qui est déjà
un succès.
« Nous demandons que les sommes disponibles
soient largement augmentées », précisent Les Amis
de la Terre. Les 80 millions d’euros du Crédit Agricole
semblent en effet dérisoires au regard des 3,5 milliards
d’euros de bénéfice que cette banque a réalisé en 2005.
Et le groupe est impliqué dans de nombreux
projets énergétiques controversés sur toute
la planète : les oléoducs Tchad-Cameroun
et Baku-Tbilissi-Ceyhan en mer Caspienne,
l’extraction pétrolière en Angola et le bar-
rage hydroélectrique géant de Nam Theun 2
au Laos.
La Société Générale est félicitée pour avoir mis sur
pied le premier produit boursier exclusivement con-
sacré à l’énergie solaire thermique et photovoltaïque :
le World Solar Energy (Solex). Mais ce n’est là qu’un
produit totalement isolé parmi les 1700 en majorité
orientés vers des activités qui aggravent le change-
ment climatique que la Société Générale propose.
« Banques françaises et environnement : presque
tout reste à faire », Les Amis de la Terre, mars 2006
www.amisdelaterre.org
Marketing poubelle
Nestlé et la Poste Suisse font du marketing au
mépris du bon sens. Chargé par Nestlé de relooker
l’emballage de sa marque de chocolat Frigor, l’archi-
tecte français Jean Nouvel a réussi à multiplier par
trois les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des
plaques de 100 grammes et par sept celles des petits
carrés. Pour accomplir une telle performance, il fallait
tout le génie de cette vedette parisienne : tripler le
poids de l’emballage et remplacer le carton recyclable
par du plastique qui finira à l’incinérateur.
Dans la même veine, la Poste Suisse a décidé
d’assombrir son image. Les 40 % de boîtes à lettres
suisses porteuses de l’autocollant « Pas de publicité »
lui gâchent le juteux marché des envois non adres-
sés. Pour récupérer une partie du gâteau publici-
taire, la Poste a envoyé 70 000 lettres aux habitants
de la région de Bâle pour leur proposer d’enlever ces
fâcheux autocollants en échange d’un petit cadeau.
La Fédération romande des consommateurs est mon-
tée au créneau pour dénoncer ces deux affaires.
Les autocollants « Non merci, pas de pub » sont en
vente auprès de la FRC : www.frc.ch
Réduire les poubelles
Pendant que certains créent avec succès
de nouveaux déchets, d’autres se démè-
nent pour qu’ils soient triés. Dès
le 29 mai, Corepile, organisme
chargé de la collecte et le recy-
clage des piles en France, distri-
buera plus de deux millions de petites boites vertes,
collecteurs de piles usagées, dans onze enseignes de
la grande distribution. Alors que 72 % des ménages
déclarent connaître un point de collecte proche de
leur domicile, 70 % des piles atterrissent… dans une
poubelle ordinaire. Or, les piles ne doivent pas être
incinérées, car elles contiennent des métaux très pol-
luants qui peuvent être avantageusement recyclés.
Corepile espère que les petits collecteurs trouveront
leur place dans les bureaux et autres lieux où l’on
consomme des piles et joueront leur rôle en aidant à
faire penser à les rapporter vers l’un des 20 000 points
de récupération.
www.corepile.fr
La main deux fois verte
Ce printemps, 700 produits sont en vente dans les
53 magasins de la chaîne Botanic de la partie Est de
la France pour encourager le jardinage écologique.
Des composteurs, des jarres pour récupérer l’eau de
pluie, un kit d’arrosage goutte-à-goutte et une sélec-
tion de livres des Editions Terre Vivante figurent en
bonne place de l’assortiment. La bouillie bordelaise et
le purin d’ortie ne sont pas oubliés. Des ateliers péda-
gogiques pour apprendre, par exemple, à choisir des
plantes adaptées à la sécheresse et la diffusion d’un
guide pratique sont organisés pour former personnel
et clients à l’art de la main verte… et écologique.
www.botanic.com
Vacances au vert
La dernière édition du très couru Guide des vacan-
ces écologiques est tout fraîchement sortie de presse.
Plus de 4200 adresses de gîtes, hôtels, écovillages, éco-
musées, manifestations culturelles, séjours militants,
restaurants biologiques et bien d’autres lieux encore
y sont référencés. De quoi choisir sa prochaine desti-
nation en toute connaissance de cause.
Guide des vacances écologiques 2006-2007,
Editions du Fraysse.
www.biovacances.net
6

1 Même si LaRevueDurable continuera d’être présente en kiosque en France et en Belgique,
ces suggestions sont évidemment valables pour les lecteurs de ces deux pays aussi.
canton de Genève
• Geneve
librairie du boulevardRue de Carouge 34 1205 Genève
AU MAGAS’Carl Vogt 7, 1205 Genève
MAG’GROTTESRue des Grottes 9 1201 Genève
SWISS ART RECYCLINGRue Ancienne 43 1227 Carouge
librairie de l’université D’UNIMAIL
1211 Genève 4
alna diététique et bioRue de Cornavin 3-5 1201 Genève
CANTON DE VAUD
• lausanne
librairie basta
UNIL - BFSH21015 Lausanne
librairie bastaRue du Petit-Rocher 4 1003 Lausanne
Planète nature WWFRue du Valentin 15 1004 Lausanne
MAGASIN DU MONDEPlace de la Riponne 5 1005 Lausanne
librairie la FontaineEPFL – Centre midi1015 Lausanne-EPFL
toPinambourRue Fraisse 9 1006 Lausanne
les sœurs boaRue Enning 1 1003 Lausanne
LES YEUX FERTILES9 Place de l’Europe 1003 Lausanne
• morGes
MAGASIN DU MONDERue de la Gare 9, 1110 Morges
• nYon
MAGASIN LA FONTAINE Chemin de la Fontaine 21260 Nyon
• rolle
TOURNESOLGrand Rue 31, 1180 Rolle
• veveY
ESPACE LIVRE SÀRLRue du Simplon 16 1800 Vevey
• montreuX
DIÉTÉTIQUE SONIA MARCHIONNO
Avenue des Alpes 25 1820 Montreux
• Yverdon
librairie Fahrenheit 451Rue du Lac 14, 1400 Yverdon
CANTON DE NEUCHÂTEL
• neuchÂtel
MAGASIN DU MONDERue de l’Hôpital 10 2000 Neuchâtel
cérès « autrement »Place des Halles 5 2000 Neuchâtel
• la chauX-de-Fonds
librairie la méridienneRue du Marché 6 2302 La Chaux-de-Fonds
• monteZillon
l’aubierLes murailles 5 2037 Montézillon
CANTON DU JURA
• delemont
MAGASIN DU MONDERue de la Préfecture 9 2800 Delémont
canton de FribourG
• FribourG
librairie albert-le-GrandRue du Temple 1, 1700 Fribourg
larevuedurableCerin Sàrl, Rue de Lausanne 911700 Fribourg
CANTON DU VALAIS
• sion
MAGASIN DU MONDERue de la Porte Neuve 141950 Sion
LE VERGER SOLAIREPlace du midi 39, 1950 Sion
• sierre
MAGASIN DIÉTÉTIQUE PUIPPERue du Bourg 4, 3960 Sierre
• martiGnY
librairie d’octodureAvenue de la Gare 31 1920 Martigny
canton de berne
• berne
STAUFFACHER LFNeuengasse 25-37, 3011 Berne
LaRevueDurable N°20 ANNONCE
ATTENTION, en SUISSE UNIQUEMENT,
LaRevueDurable sort de kiosque
Ce message est destiné surtout aux Helvètes qui se procurent LaRevueDurable en kiosque.
L’équipe de LaRevueDurable a décidé que, dès
le n° 21, la revue ne serait plus diffusée dans les
points de vente Naville en Suisse romande. Cet-
te démarche évite le gaspillage de papier pro-
voqué par les invendus des kiosques. Dès lors,
comment continuer à nous lire en Suisse ?1
En vous abonnant, car ainsi :
1. Vous économisez 15 % sur l’année
2. Vous soutenez LaRevueDurable (50 % du
prix de vente en kiosque revenait à Naville)
En continuant d’acheter LaRevueDurable
au numéro. Pour cela :
1. Inscrivez-vous à notre newsletter sur
www.larevuedurable.com et vous recevrez
une annonce et la présentation de chaque nu-
méro à paraître. Si le thème vous intéresse,
vous pourrez le commander et le recevoir dès
sa parution.
2. Commandez-le directement sur le site
www.larevuedurable.com
3. Découvrez, ci-dessous, la liste des lieux
où l’on peut se la procurer en Suisse. Cette
liste figure également sur www.larevuedura-
ble.com
Si vous avez une idée de lieu où la revue de-
vrait être en vente, nous vous serions très recon-
naissants de nous le faire connaître à l’adresse :
Lieux de vente de LaRevueDurable
en Suisse romande
7

RENCONTRE JACQUES GRINEVALD*:Nicholas Georgescu-Roegen, dissident de
l’Occident et visionnaire de la décroissance
RENCONTRE LaRevueDurable N°20
* Jacques Grinevald est professeur à l’Institut universitaire d’études du développe-
ment (IUED), à Genève, en Suisse. Il a enseigné à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne de 1980 à 2005 et au Département de science politique de l’Université de
Genève de 1987 à 2005.
Philosophe et historien, écologiste de la
première heure, Jacques Grinevald multi-
plie les centres d’intérêt autour de l’écologie
globale et l’histoire des sciences et des tech-
nologies. Mais un sujet lui tient particuliè-
rement à cœur : celui de la place et du rôle de l’œuvre de Nicholas
Georgescu-Roegen (1906-1994) au XXe siècle.
Mathématicien roumain formé en Europe, Georgescu-Roegen
s’initie à l’économie aux Etats-Unis. Lecteur assidu de la littérature
scientifi que, il intègre les lois de la physique à une nouvelle vision
de l’économie – la bioéconomie – et conclut à l’inéluctabilité de la
décroissance pour réduire l’impact de l’activité économique sur le
système Terre.
Ami de Georgescu-Roegen depuis 1974, Jacques Grinevald se con-
sidère comme lui un dissident et se fait le vibrant avocat de son
œuvre, dont la pertinence est plus que jamais d’actualité avec une
économie mondialisée qui transforme des quantités d’énergie et de
matière trop importantes pour pouvoir perdurer longtemps. Reste
à le faire entendre aux économistes « standards » et à la population.
LaRevueDurable : Dans l’introduction à la seconde édition de 1995 de La décroissance1, vous écrivez : « Nicholas Georges-cu-Roegen reste encore mal compris, quand il n’est pas tout simplement ignoré. » Le silence absolu qui a accompagné sa mort a confi rmé ce diagnostic. Pourtant, en 2006, la situation semble bouger. Un mouvement social revendique son héri-tage intellectuel en France. Cent personnes ont assisté à votre conférence donnée, à Genève, à l’occasion du centenaire de sa naissance, le 4 février. Et des ouvrages se réfèrent à ses thèses. Quelque chose est-il en train de changer ?Jacques Grinevald : Au niveau mondial, le silence reste quasi total. A Nashville, dans son université, il n’y a plus aucun souvenir de Georgescu-Roegen. Et pourquoi sa mort a-t-elle été entourée de ce silence ? Parce que les économistes pensaient qu’il était déjà
mort. D’une manière générale, il y a un refoulement dans le milieu académique. La plupart des professeurs d’écono-mie n’ignorent pas Georgescu-Roegen, mais n’en parlent pas. Un de mes étudiants a demandé à l’un d’entre eux : « M. Grinevald nous parle de Georgescu-Roegen, pourquoi pas vous ? » Réponse : « C’est très diffi cile, très compliqué, vous verrez ça quand vous serez en doctorat. » Ce n’est
pas totalement faux : Georgescu-Roegen est un auteur diffi cile. Quant à la mouvance sociale qui apparaît sous le label de la dé-croissance, il ne faut pas la surestimer : elle est très marginale.
LRD : Cela dit, des courants de recherche revendiquent l’héri-tage scientifi que de Georgescu-RoegenJG : C’est vrai. Deux courants de pensée très importants en plein essor s’inspirent de ses travaux. L’un est l’économie écologique, l’autre l’écologie industrielle. L’un des pères fondateurs de l’éco-nomie écologique est un ancien étudiant de Georgescu-Roegen, Herman Daly*, même si Georgescu-Roegen l’a accusé de plagiat et de ne pas répondre à ses critiques sur l’état stationnaire.
LRD : L’état stationnaire, c’est la croissance zéro.JG : Oui, pour Georgescu-Roegen, l’état stationnaire, cela veut dire que l’on peut rester riche. Or, les gens trop riches, estimait-il, doivent devenir moins riches. C’est ça la décroissance. Il n’a jamais dit que les pauvres devaient s’appauvrir, seulement qu’il faut mieux distribuer la richesse. Cela dit, la revue académi-que qui représente l’économie écologique2 cite abondamment Georgescu-Roegen.
LRD : Et l’écologie industrielle ?JG : Tous ses fondateurs ont lu, à côté des grands traités d’écolo-gie, des textes de Georgescu-Roegen, ne serait-ce qu’une confé-rence. Son infl uence sur ce courant existe donc, mais il faudra un certain recul historique pour lui donner sa vraie place.
LRD : Pourtant, la décroissance semble très peu présente dans les travaux de l’écologie industrielle3.JG: Si, elle l’est, et c’est même un de ses thèmes clefs, dans la mesure où la décroissance, c’est d’abord la diminution des fl ux de matières et d’énergie. Les tenants de la croissance économique ont pour astuce de dire qu’il faut réduire ces fl ux par rapport à la valeur, c’est-à-dire en termes relatifs. Pour Georgescu-Roegen et pour tous ceux qui sont au fait des limites d’une Biosphère humainement habitable, il faut les réduire de manière absolue. Pour l’économie écologique comme pour l’écologie industrielle, il est central de réduire l’impact physique de l’activité humaine sur les grands cycles biogéochimiques*. C’est une conséquence des travaux de Georgescu-Roegen publiés bien avant que les chan-gements climatiques entrent dans la discussion publique et les négociations internationales.
l’Occident et visionnaire de la décroissance
rement à cœur : celui de la place et du rôle de l’œuvre de Nicholas
le milieu académique. La plupart des professeurs d’écono-
vous verrez ça quand vous serez en doctorat. » Ce n’est
* Les auteurs ou les mots en italique et marqués d’un astérisque sont défi nis en page 13
8

uuu
Georgescu-Roegen chez les économistes
LRD : Mais lorsqu’on parle de croissance ou de décroissance, on se réfère à l’économie. Et là, le courant de l’écologie indus-trielle n’est pas en pointe.JG : Oui, mais il y a une équivoque. Car au fond, il y a deux dé-finitions de la croissance. L’une, monétaire, est la vitesse d’aug-mentation du revenu national d’une année à l’autre. L’autre est la mesure du volume physique des activités humaines en ter-mes de quantités d’énergie, de masse, etc. Par exemple, on peut évaluer le commerce mondial du pétrole en dollars : en valeur monétaire, sa part est de l’ordre de 5 %. On peut aussi l’éva-luer en poids physique : en tonnes, sa part est d’environ 40 %. Le pétrole est ainsi de loin la denrée la plus commercialisée dans le monde. L’économie et l’écologie donnent donc deux visions très différentes de la croissance. Le but est de les faire dialoguer.
LRD : Et c’est précisément ce dialogue que Georgescu-Roegen voulait instaurer.JG : Avant d’être économiste, Georgescu-Roegen est mathé-maticien et épistémologue. J’ai habité avec lui aux Etats-Unis, j’ai longuement discuté avec lui lorsqu’il a passé une année à Strasbourg, ma ville natale. Combien de fois m’a-t-il dit : « Les économistes ne me comprennent pas. Ils ne voient pas le problème, parce qu’ils sont enfermés dans les sciences sociales. » Son message est un pont sur le fossé qui sépare les sciences sociales des sciences naturelles.
LRD : Et il avait une idée du moyen de créer ce pont entre ces deux sphères du savoir ?JG : Pour bien le comprendre, il est utile de connaître son par-cours. Il accomplit ses études de mathématiques à une époque extraordinaire, les années 1920 et 1930. La logique est alors en plein développement. Georgescu-Roegen est docteur en sta-tistique à 24 ans, à la Sorbonne (sur les cycles en statistique), où il est l’élève d’Emile Borel, le grand spécialiste du calcul des probabilités. Il enchaîne sur deux ans à Londres chez Karl Pearson, le fondateur de la statistique mathématique et de la biométrie. Puis il passe les années 1935 et 1936 à Harvard, auprès de Joseph Schumpeter*.
LRD : Comment atterrit-il chez Schumpeter ?JG : Par le plus grand des hasards. A Harvard, il devait se perfec-tionner en statistique, mais son caractère et son génie rendent les choses difficiles. II faut dire que dès l’âge de dix ans, il publie des travaux de mathématique. Il sait qu’il n’est pas le premier venu. Aussi n’accepte-t-il pas la façon dont le professeur de statistiques à Harvard le traite. C’est alors qu’il apprend qu’un grand économiste d’Harvard, Joseph Schumpeter, cherche un
mathématicien pour l’aider à rédiger un livre sur les cycles des affaires. D’emblée, le contact est excellent. Emigrés tous deux d’Europe centrale, leurs affinités sont nombreuses.
LRD : Cette rencontre est donc un très heureux hasard.JG : C’est la bonne fortune de Georgescu-Roegen. D’autant qu’en suivant les cours d’économie de Schumpeter et de Was-sily Leontief*, qui deviendra lui aussi célèbre, il se fait des amis : Paul Samuelson* en particulier. Mais en 1936, il s’apprête à ren-trer en Roumanie lorsque Schumpeter l’interpelle :- Après les vacances, revenez à Harvard travailler avec nous.- La Roumanie a bien plus besoin d’un économiste que le dé-partement d’économie d’Harvard, répond Georgescu-Roegen avec un brin d’insolence.Né dans une famille modeste, orphelin de père à dix ans, il es-timait qu’il avait une dette vis-à-vis de son pays, qui lui avait donné des bourses pour faire ses études.
LRD : Pourtant, en faisant carrière à Harvard, il aurait pu créer une école de pensée.JG : Il aurait eu plus d’écoute, sans doute, mais à mon avis, il n’aurait pas été un penseur révolutionnaire, ni un dissident. Il aurait été un hétérodoxe à l’intérieur du mainstream, mais il n’aurait pas eu la distance critique qu’il a eue en rentrant en Roumanie pour y constater l’échec de l’économie néoclassique. Il a ainsi pu voir que cette théorie ne marche pas dans un pays avant tout agraire, très peuplé, qui a toutes les caractéristiques d’un pays « sous-développé ». Georgescu-Roegen a aussi été beaucoup marqué par les épreuves du fascisme, de la guerre et des Soviétiques. Enfuit clandestinement en février 1948, il passe un an à Harvard, accueilli par Leontief. Puis il accepte une chaire d’économie à l’Université Vanderbilt, à Nashville.
LRD : Sa décision de ne pas rejoindre Schumpeter en 1936 en-richit son parcours, mais coûte très cher à sa carrière acadé-mique.JG : Effectivement : il refuse la voie royale que lui proposait Schumpeter. La sienne sera plus difficile et plus novatrice.
La rivalité Georgescu-Roegen-Prigogine
LRD : Pour en revenir à sa recherche, comment parvient-il à faire ce que les économistes ne font en général pas, c’est-à-dire à lier l’économie à l’énergie et à la matière ?JG : Après la Deuxième Guerre mondiale, il suit de près les cou-rants de pensée qui ravivent la réflexion scientifique. Le petit livre Qu’est-ce que la vie? du physicien Erwin Schrödinger*4, joue pour lui comme pour d’autres un rôle décisif. Dans le cha-pitre sur la deuxième loi de la thermodynamique*, Schrödinger rappelle que la quantité d’énergie-matière ordonnée présente
9

RENCONTRE LaRevueDurable N°20
uuu
litaire dans sa démarche ? D’où vient l’incompréhension de ses collègues économistes ? Certes, c’était un virtuo-se, avec des bases scientifi ques très sérieuses, mais pourquoi si peu comprennent ce qu’il a compris ? Pourquoi son message, que vous portez aujourd’hui, n’est-il toujours pas entendu ?JG : Je vois au moins trois raisons. La première est que la commu-nauté scientifi que elle-même – divisée en de multiples disciplines spécialisées – n’a pas accepté les implications philosophiques de la découverte inattendue de l’entropie et de ses rapports avec le vivant, qui met par terre toute la vision mécaniste du monde. Au lieu d’admettre que cette loi dit quelque chose d’essentiel sur la réalité du monde – les philosophes parlent de son contenu « ontologique » –, on en fait un simple modèle d’interprétation de l’univers. Deuxième raison : Georgescu-Roegen n’est pas le seul à donner une dimension ontologique à la loi de l’entropie. Sur ce plan, son grand rival est Ilya Prigogine*.
LRD : Quels sont les points d’accord et de divergence entre Georgescu-Roegen et Prigogine ?JG : Tous deux admettent que la loi de l’entropie est une grande révolution de la philosophie naturelle occidentale, c’est-à-dire de la physique, de la chimie, de la biologie et de la théorie du système du monde. Dans la philosophie naturelle classique, le temps ne change rien : il peut tourner dans un sens ou dans l’autre, cela n’a aucune importance. C’est le temps réversible et chronométrique de la mécanique newtonienne et céleste : on peut inverser le mouvement des planètes, les équations restent les mêmes. La loi de l’entropie dit, au contraire, qu’il y a une dissymétrie du temps : la « fl èche du temps » est irréversible. On ne peut pas la retourner. Le passé et le futur ne sont pas équivalents. Le temps est créateur de nouveauté radicale et les processus naturels réels sont irrévocables. La nature n’est donc
dans un système isolé (qui n’échange rien avec l’extérieur) se dégrade avec le temps : on dit que l’entropie du système aug-mente. Et elle augmente jusqu’à un maximum synonyme de mort du système. Aussi Schrödinger demande-t-il : comment les organismes vivants font-ils pour échapper à la mort que prédit la loi de l’entropie ? Et répond : parce que ce ne sont pas des systèmes isolés, mais des systèmes ouverts, qui pompent de l’énergie-matière ordonnée – qu’il appelle de l’« entropie
négative » – dans leur milieu.
LRD : Au centre de la démarche de Georgescu-Roegen, il y a donc cette fameuse loi de l’entropie.JG : Oui, qu’il applique, dans son maître-livre La Loi de l’entropie et le processus économique5, à tout ce qui compose l’activité économique : les êtres vivants, les techniques, les systèmes écologiques à l’échelle de l’es-pèce humaine et de la planète. Or, cela bouleverse la conception mécaniste des rapports entre l’homme et la nature, qui considère que tous ces éléments sont isolés et hors du temps réel. En réalité, certains le sont (ils n’échangent ni énergie ni matière), d’autres sont
clos (ils échangent de l’énergie, mais pas de matière) et d’autres sont ouverts (ils échangent de l’énergie et de la matière)6. Geor-gescu-Roegen s’inscrit ainsi dans la tradition évolutionniste qui conçoit l’homme comme un être vivant parmi d’autres, à cette différence capitale près qu’il fabrique des outils, des machines et des machines pour fabriquer des machines. Les lois de la thermodynamique s’appliquent à ces machines autant qu’aux organismes vivants et aux écosystèmes.
LRD : Georgescu-Roegen a évolué dans un univers intellectuel extraordinaire, qui avançait sur la compréhension de la place de l’homme dans l’Univers. Pourquoi, dès lors, a-t-il été si so-
clos (ils échangent de l’énergie, mais pas de matière) et d’autres
Epistémologue et historien
Jacques Grinevald se défi nit comme épis-témologue et historien. Il est avant tout philosophe, travaillant au voisinage des scientifi ques et sur l’évolution des con-naissances. Pendant ses études, il lit « de A à Z » Gaston Bachelard, Alexandre Koyré, Thomas Kuhn, Serge Moscovici, Jean Piaget et Michel Serres, parmi les auteurs qui se distinguent en faisant la part belle aux sciences naturelles. « Mon esprit est encyclopédique au sens du XVIIIe siè-cle », confi e-t-il. Il est connu pour avoir approfondi la transition entre les XVIIIe et
XIXe siècles, lorsque la société européenne agraire bascule vers la civilisation thermo-industrielle, avec la machine à vapeur et le charbon, puis le pétrole.
Il rejoint l’Institut universitaire d’étu-des du développement (IUED) retour du Tchad, en 1973. « J’ai alors pris conscience d’appartenir avant tout à la culture judéo-chrétienne occidentale, témoigne-t-il, à une civilisation et à une religion parmi bien d’autres. Bref, j’ai découvert mon ethnocentrisme. » A l’IUED, des anthro-pologues l’aident à tenir compte des con-textes sociaux lorsqu’il fait son travail de
critique épistémologique. Cela lui permet de constater, notamment en donnant un cours sur l’histoire de la technique pendant vingt-cinq ans à l’Ecole poly-technique fédérale de Lausanne (EPFL), comment les ingénieurs voient le déve-loppement, le passé et l’avenir du monde. « Si, dans les milieux écologistes ou anthro-pologiques que je fréquente, observe-t-il, on remet en question l’idée occidentale de progrès, cela n’est généralement pas le cas des ingénieurs. Au contraire, ils y croient plus que jamais : l’avenir est selon eux aux nouvelles technologies. »
LRD
10

RENCONTRELaRevueDurable N°20
uuu
pas statique, elle est en devenir et l’humanité fait partie de ce devenir. Par opposition, la vision mécaniste n’est qu’une vision idéale, un modèle qui n’embraye pas sur la réalité, a fortiori depuis la Révolution thermo-industrielle.
LRD : Et les divergences ?JG : Les modèles physico-chimiques de Prigogine s’appliquent à des systèmes ouverts7. Georgescu-Roegen, en revanche, s’in-téresse à l’économie humaine dans l’environnement global où se situe cette activité : la surface de la Terre, qui reçoit de l’énergie solaire de l’espace, mais pas de matière. L’humanité vit donc dans un système clos, un « monde fi ni »qui impose des limites au développement de l’humanité. De plus, leurs rapports au politique, au pouvoir et à la société sont aux antipodes l’un de l’autre. Georgescu-Roegen est un économiste des pauvres. Il critique l’opulence de l’Occident, qui n’est pas la norme, mais l’exception. L’ensem-ble de l’humanité, estime-t-il, n’accédera jamais au niveau de vie des Etats-Unis : la planète Terre ne le permet pas. Prigogine ne partage pas cet avis. Même s’il plaide pour le dialogue des cultures, il semble convaincu que la richesse et la créativité de l’Occident sont la fi ne fl eur de l’évolution de l’humanité.
LRD : Un dialogue s’est-il instauré entre Georgescu-Roegen et Prigogine ?JG : Ce dialogue était espéré, mais c’est un clash qui a eu lieu. Georgescu-Roegen m’a raconté sa rencontre avec Prigogine au Texas, en 1978. Il défendait fi èrement son interprétation de la loi de l’entropie, qui inclut la dissipation de la matière utilisa-ble en plus de l’énergie. Mais Prigogine use d’une acception particulière du terme matière. La discussion était très serrée. Georgescu-Roegen raconte : « A un moment, Prigogine ne savait plus quoi répliquer et me sort d’un ton arrogant : entre nous deux, qui est Prix Nobel de thermodynamique ? » Face à un tel argument d’autorité, Georgescu-Roegen se vexe, se fâche et la discussion cesse.
LRD : De toute façon, Prigogine n’est pas économiste.JG : Certes, mais il se trouve qu’un économiste français, Re-né Passet*, a constamment invoqué Prigogine pour forger sa « bio-économie ». Au passage, aujourd’hui, en France, on tend à amalgamer Georgescu-Roegen et Passet : je crois qu’il faut éviter cette confusion.
LRD : Pourquoi Passet a-t-il retenu les travaux de Prigogine plutôt que ceux de Georgescu-Roegen ?JG : Lorsque Passet critique l’économie néoclassique et entre-voit une nouvelle description de l’économie qui intègre l’éco-logie, Prigogine est déjà connu en Europe, ce qui n’est pas le cas
de Georgescu-Roegen. Demain la décroissance, recueil de textes que j’ai rassemblé et traduit avec Ivo Rens dans les années 1970 est publié, après beaucoup de diffi cultés, en 1979, au moment même où Passet publie L’économique et le vivant8.
LRD : En très bref, que dit Passet ?JG : Il a très bien compris que l’économique est un système ouvert à la fois sur le social et sur la Biosphère. Sur le social, il cherche à réintroduire les institutions et les décisions politiques dans l’analyse économique. Ce qui n’est pas original. Des éco-nomistes l’ont toujours admis. A commencer par son maître
François Perroux*. En parallèle, grâce au Groupe des dix*, il découvre très tôt la nécessité de récon-cilier économie et écologie.
LRD : Dans la rivalité Prigogine-Georgescu-Roegen, c’est donc Prigogine qui « gagne » !JG : Pour l’instant oui, grâce à un élément fonda-mental : en permettant d’attacher plus d’intérêt
au rôle de l’innovation technologique dans la croissance éco-nomique, Prigogine aide à renouveler les théories de la crois-sance et la rhétorique du développement et du progrès.
Conséquences politiques de la bioéconomie
LRD : Quelle est la troisième source qui explique que les économistes sont restés sourds à l’œuvre de Georgescu-Roegen ?JG : Georgescu-Roegen prend en compte la grande nouveau-té des années 1960-70 : la Terre vue de l’espace. Cela l’incite à regarder l’activité économique mondiale à la surface de la planète, dans l’environnement global, ce que ne font pas les comptabilités et les analyses économiques usuelles. L’unité de mesure de la croissance, revenu national ou produit intérieur brut, c’est l’Etat-nation, soit une petite portion de territoire à l’intérieur d’un espace géographique prétendument illimité. La modernité occidentale en reste à la vision européenne de l’expansion et de la conquête du monde née il y a quelques siècles. La Terre paraissait immense et le genre humain petit. Puis, subitement, en 1969, la planète devient minuscule. La réa-lisation que l’humanité habite une petite Terre vivante, fragile, isolée dans un espace noir et glacial, hostile à la vie renouvelle la « conscience écologique ». Le seul espoir, c’est le Soleil qui réchauffe l’enveloppe habitable de la Terre, cette atmosphère avec son effet de serre que le développement moderne perturbe gravement. Les économistes font comme si ce tournant de la pensée humaine ne les concernait pas. En fait, ils ignorent la Biosphère. Il est vrai que la mythologie de la conquête spatiale, tout l’argent dépensé pour envoyer des engins dans l’espace ajouté au mythe du progrès technoscientifi que confortent les illusions de la croissance illimitée.
Les riches doivent
devenir moins riches
11

uu
RENCONTRE LaRevueDurable N°20
LRD : Les premiers responsables sont donc ceux qui font croire qu’il n’y a pas de limites.JG : Oui, et sur ce point, la communauté scientifi que et le monde des ingénieurs ne sont pas unanimes. Ils sont divisés et ambivalents. Beaucoup n’ont aucune sensibilité écologique. Les recherches sont souvent très liées à des projets d’ingénierie qui soutiennent la croissance fi nancière et l’expansion économi-que. On croit toujours que la science est là pour augmenter la richesse matérielle, individuelle et collective, que les problèmes d’environnement sont secondaires et qu’il vaut mieux être riche et puissant pour les résoudre. Hélas, les Nations unies défendent depuis le Rapport Brundtland l’idée que la pollution n’est pas due à la richesse industrielle, mais à la pauvreté préindustrielle. Il est pourtant scandaleux de pointer la pauvreté comme le grand responsable de la dégradation de l’environnement. En fait, c’est la puissance du monde militaro-industriel née de l’aventure his-torique de l’Occident, surtout depuis la Révolution thermo-in-dustrielle, qui menace l’intégrité et la stabilité de la Biosphère.
LRD : Parmi les obstacles à la compréhension des thèses de Georgescu-Roegen, il y a donc le refoulement de la crise éco-logique planétaire.JG : C’est bien celà le drame : la réception des idées écologiques se heurte à des intérêts gigantesques et à une formidable inertie culturelle et institutionnelle. Georgescu-Roegen est un Cassan-dre dont on refoule le « message terrestre » précisément parce que l’entendre contraint à tirer des conclusions politiques très pratiques à tous les niveaux et dans tous les domaines.
LRD : Lesquelles ?JG : Le monde occidental, qui a fait sa révolution industrielle
au XIXe siècle et entraîne aujourd’hui l’industrialisation de la planète, doit reconnaître qu’il s’est trompé de direction. L’in-dustrialisation à outrance, y compris de l’agriculture et de nom-breux services, n’est possible ni à long terme ni à l’échelle de la Biosphère. Georgescu-Roegen n’est pas contre toute l’industrie. Il est contre les excès et le gigantisme. Il n’est pas contre l’usage des métaux, puisqu’il faut bien des outils, pour l’agriculture
aussi. Mais il y a des limites. Il est explicitement post-malthusien. Il critique même Robert Thomas Malthus*, pour qui le problème réside seulement dans l’écart entre les taux de croissance des res-sources et de la démographie. Pour Georgescu-Roegen, il y a des limites ultimes et, à l’intérieur du cadre global que ces limites fi xent, c’est la distribution qui est essentielle. On ne résoudra
rien en plaçant toujours la croissance avant la distribution. Le problème de l’équité est à traiter en soi, indépendamment de la croissance. C’est même le problème primordial.
LRD : Une forte remise en cause du modèle de développement dominant a traversé les années 1970. Comment comprendre que cette contestation se soit très largement effondrée ?JG : Je confi rme : au début des années 1970, il y avait une véri-table fi èvre épistémologique. On pourrait comparer ces années au bouillonnement intellectuel et artistique des années 1920. J’ai bien peur qu’aujourd’hui s’ouvre une nouvelle période sombre de l’humanité, comparable à celle des années 1930.
LRD : Vous êtes très inquiet ?JG : Pourquoi le nier ? Avec mon collègue et ami Ivo Rens, j’ai donné pendant des années un séminaire à l’Université de Genè-ve sur les fonctions idéologiques du catastrophisme en relation avec l’essor de l’écologie politique. Nous redoutions cette pério-de sombre qu’on sentait venir depuis le « nouvel âge nucléaire »,né en 1945 à Hiroshima. Le point crucial est que l’Occident refuse de se remettre en question alors qu’il a tous les éléments pour le faire. Il y a suffi samment de penseurs profonds, qui nous intiment de réfl échir sur les racines théologiques et dogmati-ques de l’Occident : Pierre Legendre*, par exemple9.g
1 Nicholas Georgescu-Roegen. La décroissance. Entropie-écologie-économie, présentation et traduction de Jacques Grinevald et Ivo Rens, Sang de la Terre, Paris, 1995, en rééd. pour 2006 (1re éd. 1979).2 Journal of the International Society for Ecological Economics.3 Voir l’interview de Suren Erkman : L’écologie industrielle ramène l’économie sur terre, LaRevueDurable (12) : 6-10, 2004.4 Christian Bourgois, 1986 ; Seuil, coll. Points, 1993.5 Harvard University Press, 1971. 6 Distinctions du physico-chimiste Ilya Prigogine. 7 Qu’il appelle « structures dissipatives ». 8 Ed. Economica, Paris, 1996 (1re éd. Payot, Paris 1979). 9 Voir Ce que l’Occident ne voit pas de l’Occident, Editions Mille et une nuits, Paris, 2004.
L’Occident ne veut pas se remettre en question
Un dissident de l’OccidentComme son héros Georgescu-Roegen, Jacques Grinevald se défi nit « très clairement » comme un dissident. « J’en ai pris conscience le jour où, encore étudiant à l’Institut des hautes études internationales, à Genève, ma prof d’économie m’a traité d’écologiste exactement comme si elle m’avait traité de bolche-vik. J’accepte d’être un hérétique pour le monde moderne, occi-dental ou occidentalisé. On a beaucoup parlé des dissidents des pays de l’Est en oubliant qu’il y en a chez nous aussi. Ce sont des gens qui découvrent la monstruosité de ce que la technoscience a déjà inventé et prépare : des armes de destruction massive qui, tôt ou tard, seront employées. Une guerre nucléaire mon-diale pourrait être déclenchée par erreur. Et même sans cela, nous pouvons détruire la Biosphère par l’excès de nos activités techno-économiques. » LRD
12

Lexique des auteurs cités
Herman Daly (1938) : économiste états-unien, élève de Georgescu-Roegen à l’Université Vanderbilt, à Nashville. De 1988 à 1993, il travaille au département Environnement de la Banque mondiale, à Washington. Cofondateur de l’Interna-tional Society for Ecological Economics (1988) et coéditeur de son journal acadé-mique Ecological Economics.
Groupe des dix : rassemblement d’une vingtaine d’intellectuels travaillant, dans les années 1970, sur les rapports entre avancées scientifiques et monde politique. Outre son principal initiateur, le médecin et entrepreneur Jacques Robin, ce groupe incluait, entre autres, Henri Atlan, Joël de Rosnay, Henri Laborit, Edgar Morin et René Passet.
Pierre Legendre (1930) : Français, historien et anthropologue du droit, psy-chanalyste, fondateur de l’anthropologie dogmatique. Auteur, éditeur et même ci-néaste, son propos central est la viabilité anthropologique de la société industrielle occidentale et le rôle de l’Etat garant de la raison.
Wassily Leontief (1906-1999) : éco-nomiste états-unien d’origine russe. Il propose, dans La structure de l’économie américaine (1919-1939) (1941), une mé-thode d’analyse des systèmes productifs connue sous le nom d’ « inputs-outputs » (entrées-sorties). Prix Nobel d’économie en 1973.
Robert Thomas Malthus (1766-1834) : économiste classique britannique et pas-teur anglican. Dans son Essai sur le prin-cipe de population (1798), il soutient que la poussée démographique met en péril la survie du monde et recommande la res-triction volontaire des naissances par la morale sexuelle et le célibat.
René Passet (1926) : Français, écono-miste du développement, René Passet su-bordonne, dans L’économique et le vivant (1979), la sphère économique à la sphère sociale, elle-même incluse dans la sphère naturelle. Il préside aujourd’hui le conseil scientifique d’Attac, mouvement en faveur d’un contrôle démocratique des marchés financiers et de leurs institutions.
François Perroux (1903-1987) : éco-nomiste français influencé par l’œuvre de Joseph Schumpeter. Il introduit dans ses analyses les notions d’inégalité des agents économiques, de pouvoir et de domina-tion, mettant ainsi en cause la formulation orthodoxe des mécanismes de l’équilibre économique.
Ilya Prigogine (1917-2003) : chimiste et philosophe belge d’origine russe. Ses travaux aident à comprendre le rôle du temps en biologie et dans les sciences physiques, en particulier dans l’analyse de la dynamique des systèmes comple-xes. Il est ainsi le premier à appliquer la thermodynamique à l’étude des processus irréversibles dans des systèmes vivants et inanimés. Sa notion de « structures dis-sipatives » décrit les systèmes ouverts, qui échangent de la matière et de l’énergie avec leur environnement. Prix Nobel de chimie en 1977.
Paul Samuelson (1915) : économiste états-unien, l’un des principaux repré-sentants du courant de la synthèse entre l’analyse néoclassique et le keynésianisme. Ses apports majeurs touchent aux théories du consommateur, du commerce interna-tional et de l’équilibre. Prix Nobel d’éco-nomie en 1970.
Erwin Schrödinger (1887-1961) : phy-sicien autrichien qui renouvelle, en 1926, la formalisation de la théorie quantique, introduisant l’équation fondamentale à la base de tous les calculs de la spectrosco-
pie. Son livre Qu’est-ce que la vie ? (1944) convainc de nombreux physiciens de se tourner vers la biologie moléculaire. Prix Nobel de physique en 1933.
Joseph Schumpeter (1883-1950) : économiste autrichien, qui a mis en lu-mière le rôle de l’entrepreneur dans la vie économique. Son Capitalisme, socialisme et démocratie (1942) montre que l’évolu-tion du capitalisme sape les fondements sociaux et culturels de la société capitaliste et conduit à l’avènement du socialisme.
Lexique technique
Cycles biogéochimiques : la géochimie décrit la circulation des éléments chimi-ques à la surface de la Terre dans quatre « réservoirs » : lithosphère, hydrosphère, atmosphère et biosphère. La biogéochimie met en évidence le rôle des organismes vi-vants (la matière vivante) dans cette circu-lation planétaire de la matière, soulignant les interrelations de tous les cycles biogéo-chimiques, notamment ceux du carbone, de l’oxygène, de l’azote, du soufre et du phosphore dans l’écosystème mondial de la Biosphère.
Thermodynamique : théorie physique des rapports entre la chaleur et le travail née de la technologie des « machines à feu » de la Révolution industrielle qui, d’abord sous le nom de théorie mécani-que de la chaleur, devient la science de l’énergie. La thermodynamique a connu une évolution agitée et controversée, no-tamment à cause de son Second Princi-pe et du concept d’entropie. La crise de l’énergie, en 1973-74, a ravivé l’actualité épistémologique des grands principes de la thermodynamique. g
uuu 13

DOSSIER LaRevueDurable N°20
14

DOSSIERLaRevueDurable N°20
DOSSIER
Des réponses au « Cauchemar de Darwin » : agriculture locale et commerce équitable
14 Illustration
TOM TIRABOSCO
15 ÉDITORIAL DU DOSSIER
16 INDICATEURS
19 Vers des citoyens solidaires d’une agriculture de proximité
LRD
20 Le réalisateur du « Cauchemar de Darwin » a fondamentalement raison
LRD
23 Ce que deviennent les usines de poisson du lac Victoria
EIRIK G. JANSEN
24 Comparaison entre libre-échange et souveraineté alimentaire
LRD
26 Les maîtres de la mondialisation de l’agriculture
LRD
28 Au Venezuela, la réforme agraire d’Hugo Chavez est en marche
GREGORY WILPERT
30 Marché mondial et autosuffisance alimentaire, les pays du Sud ont une marge de manœuvre
CLAUDE AUROI
33 Le commerce équitable, outil de développement et d’éducation
GUY DURAND
36 Au Pérou et au Mexique, la consommation équitable débarque sur les marchés locaux
LRD
39 Les agriculteurs du Burkina Faso pourraient nourrir leur pays
GIL DUCOMMUN
42 La paysannerie familiale est capable d’intensifier la production agricole
MARC DUFUMIER
46 Le soja en Amérique du Sud ou le cauchemar de Humboldt
MARC HUFTY
48 Dans l’Ouest français, le Réseau Agriculture durable apporte des solutions
CHRISTIAN MOUCHET
52 Il faut manger moins de viande
LRD
54 L’association pour le maintien d’une agriculture paysanne passe la vitesse supérieure
LRD
57 En Suisse comme ailleurs, la souveraineté alimentaire a besoin des consommateurs
LRD
58 L’agriculture contractuelle se porte bien en Suisse
LRD
61 Guide sur l’agriculture
65 Bilan du cycle de 3 x 3 conférences inspirées du « Cauchemar de Darwin »
LRD
Inspiré par le documentaire choc Le cauchemar de Darwin, ce dossier, à l’instar du cycle de conférences qui l’a précédé, poursuit deux buts : com-prendre en quoi la mondialisation des échanges agricoles crée des désastres écologiques et sociaux partout dans le monde ; saisir comment réagir, freiner, voire éviter les déséquilibres qu’accroît ce commerce agricole. Se concentrer sur les échanges agricoles en partant du film d’Hubert Sauper se justifie pleinement, car ce sont eux qui ont le plus d’impact sur des vies humaines : les paysans composent aujourd’hui la moitié de la population mondiale.
La souveraineté alimentaire est aujourd’hui l’idée clef capable de redonner tout son sens à l’agriculture mondiale. Autour d’elle gravitent plusieurs solutions concrètes, pratiques et locales. Il s’agit essentiellement du commerce équitable, dont l’évolution logique est de tendre vers le local, au Nord comme au Sud, et l’agriculture contractuelle de proximité, qui s’épanouit en France et en Suisse. Troisième piste : réduire la consommation de viande, dont l’expansion actuelle est totalement contraire à l’objectif de nourrir de 8 à 9 milliards d’individus d’ici la moitié du XXIe siècle.
LRD
15

INDICATEURS LaRevueDurable N°20
LRD
Situation des agricultures dans le monde
Qui souffre de la faim (en % des 852 millions d’affamés)
La pauvreté extrême qui conduit à la famine épargne large-ment les pays industrialisés. En revanche, l’agriculture à plu-sieurs vitesses sévit partout.
La misère de la moitié du monde
La planète compte 2,5 milliards de paysans – 41 % de la population mondiale –, dont 1,3 milliard de paysans actifs. Ils se partagent 28 millions de tracteurs et 250 millions d’animaux de trait. La grande majorité des paysans n’a donc d’autre outil que machette, bêche, houe ou faux et d’autre force que son corps pour travailler la terre (Marcel Mazoyer, Développement agricole inégal et sous-alimentation paysanne. In : La fracture agricole et alimentaire mondiale, Universalis, 2005).
Au début du XXe siècle, l’exploitation mécanisée la plus perfor-mante produit 10 tonnes de céréales par an par travailleur contre 1 tonne en culture manuelle. En 2006, l’écart de production entre les fermes les plus marginales et les plus industrialisées est de 1 à 1000 ou à 2000 (Mazoyer, 2005). L’inégalité des moyens entre les agriculteurs du monde est donc plus marquée que jamais.
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Pays industrialisés
Pays en transition
Afrique
Amérique latine
Reste de l’Asie
Chine
Inde
C’est en 1995 que la tendance à la baisse du nombre d’affamés dans le monde s’inverse. De 1995 à 2000, les mal-nourris aug-mentent de 4 millions par an. En 2004, 852 millions de personnes souffrent de sous-alimentation. Chaque minute, neuf enfants en meurent (FAO, Rapport sur l’insécurité alimentaire, 2004).
Nombre de personnes qui souffrent de la faim en millions
La faim sévit surtout dans les campagnes, là où vivent les plus pauvres.
10 % Pêcheurs et pasteurs
20 % Pauvres urbains
20 % Paysans sans terre
50 % Petits paysans
Sources : FAO, 2004.
Source : Agence des Nations unies pour l’alimentation de l’agriculture (FAO), Résumé des statistiques mondiales sur l’alimentation et l’agriculture, 2005.
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Tracteurs/1000 ha de terres arables
EuropeAsieAmérique latine
Amérique du Nord
Afrique
3
25
1915
38
0
6000
12000
18000
24000
30000
36000
42000
48000
54000
60000
Production par travailleur agricole en dollars par an
EuropeAsieAmérique latine
Amérique du Nord
Afrique
5244100
670
8373
52182
Il est courant d’opposer les paysans pauvres du tiers-monde à leurs riches collègues européens ou états-uniens, gavés de sub-ventions. En réalité, trois mondes ruraux coexistent dans tous les pays (Estelle Deléage, Paysans malgré tout ! Ecologie et politique n° 31, 2005). Le premier comprend une minorité d’entrepre-neurs très compétitifs insérés dans l’économie agro-alimentaire. Très bien organisés pour défendre leurs intérêts au niveau local, national et mondial, ces agro-industriels utilisent des moyens de production industriels très modernes et jouissent de subven-tions publiques massives. Deuxième monde rural : l’agriculture familiale. Il se compose de familles qui subissent les pressions du complexe agro-industriel et cherchent à s’en sortir en misant sur l’agriculture biologique, la vente directe et l’hébergement à la ferme. Vient enfin le tiers-monde rural, constitué des paysans qui survivent dans les terres les plus marginales, qui ont à peine de quoi manger et sombrent dans la famine au moindre pépin. Ils sont abandonnés de toutes les politiques publiques.
La première forme d’agriculture a beau détruire l’emploi et être la plus polluante, partout dans le monde, les gouverne-ments la privilégient.
Tracteurs / 1000 ha de terres arables
Production par travailleur agricole en dollars par an
16

INDICATEURSLaRevueDurable N°20
Les inégalités criantes de la PAC
Dans l’Union européenne (UE) et aux Etats-Unis, les subven-tions sont liées au type de production et à la taille de l’exploita-tion. Conséquence absurde : plus l’exploitation est grande, plus la subvention est élevée. En France, la distribution des paiements ressemble à une coupe à champagne : les plus riches sont dans la partie supérieure de la coupe, les plus pauvres dans son pied.
1 %
9 %
24 %
66 %
Chaque tranche représente un quart des fermes françaises, les pourcentages, représentent la part du total des subventions agricoles
Source : calcul effectué à partir de Agir ici et Confédération paysanne, 2005
Au Royaume-Uni, les dix plus gros bénéficiaires des paie-ments directs reçoivent à peu près le même montant d’aides que les 25 000 plus petites fermes (Rural Payments Agency, Com-mon Agricultural Policy Subsidies Payments 2003-2004, Lon-dres, 2005). Les sept plus grands bénéficiaires des aides en Es-pagne encaissent 14,5 millions d’euros, montant que 12 700 des
plus petites fermes espagnoles se répartissent, et qui équivaut au revenu annuel de 90 000 Mozambicains (Goliat contra David : Quién gana y quién pierde con la PAC en España y en los países pobres, Intermon Oxfam, 2005).
Au Danemark, quatre membres de cabinets ministériels, plu-sieurs parlementaires et jusqu’au commissaire européen danois reçoivent des aides de la PAC qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros. Aux Pays-Bas, Cees Veerman, ministre de l’Agriculture, recevait 150 000 euros d’aide de la PAC (Aides agricoles : autop-sie d’un système inégalitaire, Agir ici et Confédération paysanne, 2005). Quelques têtes couronnées figurent parmi les heureux rentiers agricoles : la reine d’Angleterre, les princes Charles et de Monaco. En France, il est très difficile de savoir qui se cache derrière les sociétés qui reçoivent les dix plus fortes aides.
La palme de l’inégalité revient aux Etats-Unis. Seuls 40 % des exploitants agricoles y sont subventionnés. Et parmi eux, les 5 % plus riches en récoltent plus de la moitié, soit près de 470 000 dollars chacun (Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Rapport sur le développement hu-main 2005). L’attribution des subventions agricoles dans l’UE et aux Etats-Unis est encore plus inégale que la répartition des richesses au Brésil, deuxième pays le plus inégalitaire au monde (après le Guatemala) (PNUD, 2005).
Résultat, les 7,5 millions de petits exploitants européens pei-nent à survivre. Dans l’UE, une ferme disparaît chaque minute. Chaque année, 33 000 exploitations disparaissent en France et 37 000 en Espagne. De 2000 à 2005, un million d’emplois agrico-
Zsolt Simon
Albert II
cayetana Fitz James
Stuart
Elisabeth II
Sir Gerald CavendishNestlé UKtate & lyle
europe
bénéficiaire
Pays où la subvention
est donnée
royaume- Uni
royaume- Uni
royaume- Uni
royaume- Uni espagne slovaquie Monaco
Signes particuliers
troisième plus grand raffineur et commerçant de
sucre après cargill et louis dreyfus
Plus grande multinationale
alimentaire
Quatrième homme le plus
riche du pays (for-tune estimée à 6 milliards d’euros)
Reine d’Angleterre
Duchesse d’Albe, une des plus
grandes fortunes d’espagne
Ministre de l’Agriculture
Prince de Monaco
Montant annuel des aides
reçues en euros186 millions 17 millions 476 000 584 000 1,89 million 1,5 million 287 308
Source : Rural Payments Agency, 2005 ; Oxfam, 2004 et 2005 ; Agir ici et Confédération paysanne, 2005.
Disparités des aides agricoles en France
Quelques bénéficiaires des subventions européennes
17

INDICATEURS LaRevueDurable N°20
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 %
% de la défense dans le budget public en 1992
% de la défense dans le budget public en 2001
% de l’agriculture dans le budget public en 1992
% de l’agriculture dans le budget public en 2001
Asie du Sud
Afrique subsaharienne
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Amérique latine et Caraïbes
les ont été perdus dans l’Union à 25. Au Royaume-Uni, 100 000 emplois agricoles ont été détruits dans la décennie 1990-2000 et 50 % de la production agricole britannique provient de 10 % des exploitations. En France, 40 % des fermes tiraient en 1998 un revenu par actif familial à temps complet inférieur ou égal au Smic et 20 % inférieur au RMI (Agir ici et Confédération paysanne, 2005). En Italie, 8 % des fermes sont sous le seuil de pauvreté. En Espagne, 60 % des actifs des petites fermes ont un revenu inférieur à la moyenne nationale.
En Suisse, malgré une politique agricole plus égalitaire, 34 672 exploitations de moins de 20 hectares ont disparu depuis 1990 (Rapport agricole 2005, Office fédéral de l’agriculture). Corol-laire : les exploitations de plus de 50 hectares ont doublé.
Partout dans le monde, la situation est la même. En Argentine, 100 000 exploitations ont cessé en dix ans. Aux Philippines, 1,2 million d’emplois agricoles ont disparu en un an, de juillet 1999 à juillet 2000. Au Mexique, 4 à 5 millions des 8 millions de pay-sans voient pour seule option la migration aux Etats-Unis. Des gangsters chinois ont illégalement transféré des paysans chinois gagnant aussi peu que 2,8 euros par heure dans les champs et les usines de conditionnement de l’est de l’Angleterre. Certains ont payé jusqu’à 28 000 euros la promesse d’obtenir un emploi (Bill Vorley, Corporate Concentration from Farm to Consumer, UK Food Group, 2004).
Soutenir l’agriculture paysanne
Après avoir longtemps prêché en vain, les organisations pay-sannes qui défendent la petite agriculture familiale orientée vers les marchés locaux commencent enfin à attirer l’attention des organisations internationales (Michael Windfuhr and Jennie Jonsén, Food Sovereignty, Practical Action, 2005). Trois raisons fondent ce revirement.
Premièrement, les objectifs du millénaire de réduction de la pauvreté et de la faim conduisent les experts à s’intéresser aux paysans pauvres. Ils ont ainsi pu constater qu’il y a davantage d’enfants mal nourris dans les pays à surplus de céréales que dans les pays déficitaires en céréales. L’Inde, qui compte le plus d’affa-més au monde – 221 millions –, produit assez de nourriture, mais le manque de pouvoir d’achat et l’utilisation croissante de céréales pour le bétail privent les plus pauvres de nourriture suffisante. Conclusion : pour contrer la malnutrition, il faut aider les paysans les plus pauvres à augmenter leur production (UN Millennium Projet, Task Force on Hunger, 2005).
Ensuite, nourrir 8 ou 9 milliards d’humains en 2050 oblige à stimuler la production agricole. Or, les rendements dans les meilleures terres sont au maximum et se heurteront à des limites insurmontables. C’est donc dans les terres marginales qu’il serait possible de dégager une partie des surplus nécessaires pour nourrir
le monde (Pretty et Hine, L’agriculture paysanne durable peut rele-ver le défi alimentaire, LaRevueDurable n° 6, juillet-août 2003).
Enfin, l’agriculture paysanne reste majoritaire au niveau mondial. La surface de 85 % des 450 millions d’exploitations agricoles qui subsistent dans le monde ne dépasse pas 2 hectares. Il apparaît désormais clair que ne pas la soutenir ou la laisser périr revient à créer un désastre humain.
Des vivres plutôt que des armes
Les pays riches consacrent près d’un milliard d’euros par jour à subventionner leurs systèmes agricoles. Une fraction de ces dépenses suffirait à atteindre les objectifs du millénaire dans l’éducation, la santé et l’approvisionnement en eau. Mais pire qu’un manque de solidarité, ces subventions creusent la tombe des agricultures du monde.
De 2002 à 2003, le riz produit aux Etats-Unis à 415 dollars la tonne était exporté à 274 dollars la tonne. Tant pis pour les cultivateurs ghanéens, haïtiens, thaïlandais ou vietnamiens que ces exportations évincent de leur marché national. Les verse-ments aux 20 000 producteurs de coton états-uniens ruinent deux millions de petits producteurs maliens et burkinabés. L’UE exporte du sucre à un quart de son coût de production et du lait à la moitié de son coût.
Mais diminuer les subventions et les tarifs d’accès aux marchés du Nord qui empêchent le commerce international ne résoudra pas le problème. Au mieux, ces mesures favoriseront les agricul-teurs les plus productifs des pays les plus exportateurs. L’action doit porter au niveau des politiques agricoles nationales.
Or, les gouvernements investissent de moins en moins dans leurs campagnes. Dans les pays où 20 à 35 % de la population ne mangent pas à leur faim, les budgets agricoles représentent 5,2 % des dépenses gouvernementales en 1998 contre 7,6 % en 1992. Dans les pays où plus de 35 % de la population manquent de nourriture, la part de l’agriculture dans les budgets publics passe de 6,8 % en 1992 à 4,9 % en 1996. A chaque fois, il y a un décalage entre le poids de l’agriculture dans l’économie natio-nale et les ressources publiques qui lui sont allouées. Le Kenya et l’Ouganda, par exemple, consacrent moins de 5 % de leurs budgets publics à l’agriculture alors que 70 % de leurs popula-tions sont rurales. g
Source : Millennium Projet 2005
Investissements dans l’agriculture et dans la défense
18

DOSSIERLaRevueDurable N°20 DOSSIER
Les paysanneries
manquent d’appui
politique
Ce dossier s’appuie sur le cycle de 3 x 3 soirées publiques, tou-tes inspirées du docu-mentaire Le cauchemar de Darwin, que LaRevue-Durable a animé de jan-vier à mars dans trois villes de Suisse romande. Un an après sa sortie en salles, ce film continue de remuer les consciences et d’attirer forte-ment l’attention sur certaines injustices liées à la mondialisation.
L’idée de partir du Cauchemar de Darwin pour organiser ce cycle de conférences était de profiter du succès et de la notoriété de ce docu-mentaire pour souligner que le cas de la perche du Nil et des populations tanzaniennes proches du lac Victoria est un cas parmi d’autres. La globalisation du commerce de ce poisson est une manifestation particulière d’une injustice écologique et humaine qui prévaut pour l’en-semble des échanges à l’échelle planétaire. Des situations comme celle que décrit ce film, il en existe des milliers.
Le cauchemar de Darwin est accusé d’abuser d’artifices cinématographiques pour manipuler les spectateurs. Mais le plus important à retenir est que la thèse centrale de ce film est fonda-mentalement vraie : l’exportation de la perche du Nil ne profite pas aux populations les plus pauvres qui vivent au bord du lac Victoria. En revanche, ce documentaire se limite à montrer et à alerter : il ne permet pas de comprendre comment aider les personnes qu’il dépeint si bien à sortir de leur misère. C’est ainsi que, parmi d’autres initiatives, ce dossier prend, à la suite du cycle, le relais de cette dénonciation en proposant des éléments de solutions tournés vers l’action pratique et l’engagement.
Dès lors que les paysans composent la moi-tié de la population mondiale, ces solutions concernent au premier chef le secteur qui a le plus fort impact sur les vies humaines : l’agri-culture. Le cas du soja est exemplaire : il anéan-tit les écosystèmes forestiers sud-américains, tue la petite agriculture vivrière familiale et « nourrit » un modèle agricole non durable en Europe et ailleurs, dans lequel il est associé au maïs pour alimenter le bétail. Et si rien ne vient enrayer ce véritable « cauchemar de Humboldt »,
la consommation mondiale de soja devrait croître de plus de 50 % dans les quinze prochaines années. Une perspective pro-prement catastrophique pour
les écosystèmes sud-américains et ceux qui y vivent. Pourtant, ce modèle est soutenu par un système d’incitations qui, dans l’Union européenne, s’incarne dans la Politique agricole commune.
Face à des constats aussi accablants, la no-tion de souveraineté alimentaire apparaît plus que jamais fondatrice et fédératrice pour chan-ger d’orientation. Le modèle agricole ne sera tenable à terme que s’il s’adapte le plus possi-ble à la diversité des conditions géographiques et aux besoins alimentaires des populations lo-cales. Au Nord, une agriculture moins intensive est nécessaire pour y parvenir. Au Sud, où l’essentiel de la pression démographique s’exerce, l’agriculture vivrière peut et doit au contraire devenir plus intensive. Dans les deux cas, cette agriculture doit s’appuyer sur le respect des paysanneries et des écosystèmes.
Au Nord, après des décennies de produc-tivisme, des agriculteurs du Grand-Ouest, en France, mettent au point des systèmes herba-gers pour nourrir les vaches sans recourir au couple soja-maïs, transgéniques ou non. Au Sud, l’agriculture paysanne fait preuve d’une merveilleuse inventivité pour accroître la pro-ductivité sans nuire aux équilibres écologiques. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif n’est pas les seuls rendements à l’hectare, mais aussi la préservation des sols, de la biodiversité et des forêts, de même que des campagnes vivantes, héritières de leur patrimoine culturel et capa-bles de regarder l’avenir en confiance.
Sous la férule d’Hugo Chavez, le Venezuela met en œuvre une ambitieuse réforme agraire. Mais presque partout ailleurs, les paysanneries manquent d’appui politique. Une enquête dé-montre que les agriculteurs burkinabés seraient à même de nourrir leur pays si une politique agricole nationale volontariste les soutenait. Mais pétries de préjugés et poursuivant des intérêts privés, les autorités du Burkina Faso
en restent aux grandes cultures de rente, en l’occurrence de coton, qui subissent pourtant de plein fouet la concurrence sauvage des pays industrialisés à grands coups de subventions.
Ces politiques pourraient au moins, comme au Nigeria, faire au maximum usage de toutes les clauses de l’Accord sur l’agriculture de l’Or-ganisation mondiale du commerce (OMC) qui permettent, dans une certaine mesure, aux pays en développement de protéger leur agriculture vivrière. Mais pour que les politiques agricoles prennent une telle tournure, les paysanneries doivent pouvoir les influencer. C’est là que les
citoyens-consommateurs peu-vent intervenir, via deux moyens complémentaires : le commerce équitable et l’agriculture con-tractuelle de proximité.
Le commerce équitable est à concevoir comme un coin dans
la porte des règles commerciales internationa-les. Donner à des groupes de petits paysans un surcroît de revenu, d’espoir et, en fin de comp-te, de pouvoir, peut les mettre en position d’in-fluencer les politiques agricoles nationales ou supranationales. De plus, cette innovation n’a pas vocation à se limiter à l’international, elle s’applique aussi au local : c’est déjà au moins le cas en Amérique latine et aux Philippines. En devenant de plus en plus local, le commerce équitable affermirait le mouvement planétaire pour la souveraineté alimentaire.
L’agriculture contractuelle de proximité, qui fleurit en Suisse romande et en France, est un levier d’action qui va dans la même direction. En s’engageant concrètement sur l’année, une soixantaine de consommateurs suffisent à ren-dre viable une exploitation. Comment multi-plier ces initiatives ? C’est ce que cherchent à savoir la région Rhône-Alpes en France et le syndicat Uniterre en Suisse romande.
Une troisième voie s’impose également : la réduction de la consommation de viande. Manger des produits carnés, laitiers ou à base d’aliments carnés absorbe des quantités bien trop importantes de surfaces agricoles, d’éner-gie et d’eau, rendant l’extension de l’élevage incompatible avec l’objectif de nourrir de 8 à 9 milliards d’humains d’ici 2050. g
LRD
Vers des citoyens solidaires d’une agriculture de proximité
19

Mwanza
Kisumu
KAMPALA
Entebbe
Bukoba
Îs Sese
Î. Ukara
Î. Ukerewe
G. Speke
G. Winam
KENYA
OUGANDA
TANZANIE
LAC
VICTORIA
KAMPALANAIROBI
DAR ES SALAAM
KENYA
TANZANIE
OUGANDA
Océa
n In
dien
Le cauchemar de Darwin d’Hubert Sauper n’a pas attiré que des centaines de milliers de spectateurs, des prix et des récompenses en pagaille : il est aussi à l’origine d’une vive polémique. L’attaque la plus forte vient d’un historien, François Garçon, qui déploie dans la revue Les temps modernes de décembre 2005 un virulent réquisitoire contre ce fi lm, selon lui entaché de deux mensonges : l’exportation de la perche du Nil vers l’Union européenne, le Japon et les Etats-Unis serait créatrice de ri-chesses autour du lac Victoria et non de cette misère sur laquelle le fi lm s’arrête ; les avions-cargos qui emportent les poissons vers d’autres cieux n’arrivent pas les soutes remplies d’armes, comme le prétend le fi lm sans en apporter la preuve, mais vides.
Mensonges pour bobos
Pour en arriver là, François Garçon a lu des rapports de l’OCDE et de la Banque mondiale. Il a enquêté à Rungis, près de Paris, auprès des grossistes et a fait des recherches sur les coûts engendrés par l’affrètement des avions-cargos.
Dans une lettre ouverte incendiaire adressée à Hubert Sauper en décembre 2005, la responsable de l’Union interna-tionale pour la conservation de la nature (UI-CN) en Afrique de l’Est, Alice Kaudia, défend un point de vue très proche.
Des réactions convergentes qui ont conduit le journal Le Monde à dépêcher un journaliste, Jean-Philippe Rémy, non pas à Rungis, mais à Mwanza, là où Hubert Sauper a mis trois ans à tourner son fi lm. Son enquête l’amène aux mêmes conclusions que François Garçon et Alice Kaudia, et à épingler un troisième men-songe : les milliers de carcasses de poissons traitées sur le site qu’Hubert Sauper a choisi de fi lmer ne sont pas destinées aux humains, comme le soutient le fi lm, mais à des poulets et à des porcs d’élevage.
François Garçon et Alice Kaudia reprochent aussi à Hubert Sauper de peindre le diable sur la muraille, de faire des raccourcis simplistes entre l’exportation de la perche du Nil et la misère sociale qui règne à Mwanza – sida, dro-
gue, prostitution – et, pire que tout, d’inciter les spectateurs de son fi lm militant à boycotter ce poisson, ce qui ne résoudrait rien, bien au contraire. Les deux accusent fi nalement Hu-bert Sauper de se faire de l’argent sur le dos des Africains en vendant aux Occidentaux la vision misérabiliste de l’Afrique dont les bobos raffoleraient.
Face à toutes ces attaques, Hubert Sauper s’échine, depuis le lancement du fi lm, à ex-pliquer cet élément central de sa démarche : « l’idée, se défend-il dans Libération, n’est pas de dénoncer un scandale au lac Victoria. […] Tout ce que j’ai pu trouver dans cette région, je l’ai vu ailleurs. Dans les mines d’or à Bujumbura, les mines de diamant au Congo, les champs pétro-liers au Nigeria. » Pourquoi, demande Hubert Sauper avec force dans ce fi lm, là où il y a tant de richesses – or, diamants, pétrole, voire nour-riture comme dans le cas du lac Victoria –, tant de gens ne mangent-ils pas à leur faim ?
LRD
Le réalisateur du « Cauchemar de Darwin » a fondamentalement raison
DOSSIER LaRevueDurable N°20
Dans son fameux do--
cumentaire Le cau-
chemar de Darwin,
Hubert Sauper soutient
que l’immense richesse
que représente la per-
che du Nil ne profi te pas
à des pans entiers de la
population tanzanienne pauvre, qui vit près du lac Victoria. Et que les
avions-cargos qui chargent les fi lets de perches sur l’aéroport de
Mwanza arrivent remplis d’armes. Sur ces deux points, il est accusé
d’abuser d’artifi ces cinématographiques pour faire passer son mes-
sage sans apporter les preuves formelles de ce qu’il avance. Son fi lm
serait ainsi mystifi cateur. Or, les données de la recherche de terrain dis-
ponibles tendent à montrer que sur le premier point – de loin le plus
important – c’est bel et bien lui qui a raison sur ses contradicteurs.
20

DOSSIERLaRevueDurable N°20
Nouvelles preuvesLe réalisateur autrichien n’est évidemment
pas le premier à poser cette question sur un plan général. Il n’est pas non plus le premier à avoir réalisé un documentaire pour la formu-ler à propos du cas particulier de la perche du Nil du lac Victoria. Le premier documentaire à dénoncer la situation d’insécurité alimentaire autour de ce lac n’est en effet pas Le cauchemar de Darwin, mais Big Fish Small Fry (Gros pois-son petite friture) de David Campbell. Tourné en 1998, diffusé en 1999 et produit par nul autre que l’UICN, ce film aussi bref qu’efficace expose en trente minutes simples et convain-cantes ce paradoxe insupportable : sur les rives kenyanes du lac Victoria, sur fond d’indus-trialisation – pourtant très lucrative – de la pêche de la perche du Nil, 30 % des enfants présentent des retards de croissance et 50 % souffrent de déficience en vitamine A et autres micronutriments. Quant aux populations ri-veraines, leur situation se détériore.
L’un des conseillers techniques de Big Fish Small Fry est un chercheur norvégien, Eirik G. Jansen, à l’époque collaborateur à l’UICN. Aujourd’hui en poste à l’ambassade norvé-gienne à Dar es Salam, en Tanzanie, c’est lui qui, en 1997, avec Richard Abila, chercheur en économie sociale à l’Institut kenyan de re-cherche sur la pêche et la marine à Kisumu, a calculé le chiffre qu’Hubert Sauper ne manque jamais de citer : chaque emploi créé dans les usines de poisson en supprime six à huit dans l’économie informelle. Interrogé sur la situa-tion neuf ans après la parution de cette étude, Eirik G. Jansen confirme qu’elle reste de la plus haute actualité (voir son article, page 23).
Cet anthropologue, qui a vécu parmi les communautés de pêcheurs du lac Victoria durant les années 1970 et 1990, ajoute : « Le
cauchemar de Darwin est un film magnifique qui porte sur des aspects très importants des populations autour du lac Victoria. Ce docu-mentaire donne une vraie image de la situa-tion de nombreuses personnes marginalisées autour du lac. »
Dans sa lettre à Hubert Sauper, Alice Kaudia reconnaît que la situation de pauvreté des po-pulations riveraines du lac Victoria était vraie à la fin des années 1990, mais soutient que les choses ont changé. Et de citer une étude ougan-daise de Joyce Ikwaput Nyeko et de ses collabo-rateurs parue en 2004 qui, estime Alice Kaudia, démontre que les retombées économiques de la perche du Nil atteignent do-rénavant les populations les plus pauvres. Or, ses conclusions sont loin d’être aussi claires.
Cette étude révèle certes que les propriétaires de bateaux et les équipages perçoivent des revenus élevés, mais aussi que cela « aurait dû se tra-duire par une réduction de la pauvreté dans les communautés de pêcheurs. […] Gagner de l’argent issu de la pêche est une chose, rappelle le rapport, en faire bon usage pour supprimer la pauvreté en est une autre. Or, poursuit-il, il semble que sur le lac Victoria, les propriétaires de bateaux qui pêchent la perche du Nil ne sont pas des pêcheurs indigènes, mais la section la plus riche de la population, attirée par le boom de la perche du Nil. La plupart de ces pêcheurs ont monté des affaires sur les débarcadères ou dans les villes proches, où ils possèdent du patri-moine, tel que des bâtiments commerciaux. »
Le rapport poursuit : « D’autres membres de la communauté qui travaillent dans les services ont aussi profité de l’industrie d’exportation de la perche du Nil. Mais si les propriétaires de bateaux ont investi leurs revenus dans d’autres activités lucratives, la plupart des équipages les
dépensent au fur et à mesure qu’ils arrivent. Les équipages et le gros des pêcheurs n’ont pas pour habitude de faire des économies et, par conséquent, gaspillent ce qu’ils reçoivent en croyant qu’ils continueront demain d’aller au lac pour y gagner leur vie. »
Une autre étude récente (2003), de Richard Abila et au Kenya cette fois, révèle les limites des analyses de Joyce Ikwaput Nyeko et de ses collaborateurs. Sachant que les écarts techno-logiques jouent un rôle prépondérant dans la marginalisation des agriculteurs dans le mon-de, Richard Abila observe qu’au Kenya, les pê-cheurs équipés de bateaux à moteur avec filets dérivants sont plus puissants et détruisent les
filets des petits pêcheurs qui ne tiennent pas la concurrence, fau-te de posséder 4000 à 8000 dollars pour s’équiper à égalité.
En outre, alors que Joyce Ikwaput Nyeko et ses collabora-teurs ne regardent que l’impact
de l’exportation de la perche du Nil sur les communautés de pêcheurs, Richard Abila s’in-téresse aux non-pêcheurs (ceux qui traitent le poisson, le commercialisent, le consomment) – qui sont au centre du Cauchemar de Darwin – autant qu’aux pêcheurs. Et constate que les non-pêcheurs ont moins accès aux poissons devenus trop chers, que ce soit la perche du Nil, le tilapia ou le dagaa, les trois poissons dé-sormais pêchés au lac Victoria. Enfin, rappelle Richard Abila, les chiffres sur la pauvreté et la malnutrition indiquent qu’au Kenya, les po-pulations riveraines du lac Victoria sont beau-coup plus mal loties qu’ailleurs dans le pays.
Le « paradoxe de l’opulence »
Ces données ne permettent pas de nier que des milliers d’Africains profitent de l’exporta-tion de la perche du Nil, mais soulignent que les perdants sont sans doute plus nombreux enco-
Tout ce que j’ai vu ici, je l’ai vu ailleurs
21
21

re que les gagnants. En tournant sa caméra vers la misère qui règne à Mwanza, la prostitution, la drogue, le sida, Hubert Sauper n’a pas menti, il a choisi de s’arrêter sur la réalité qui le touche le plus. Par ailleurs, la polémique sur son film met en lumière ce que les altermondialistes déplorent et demandent de corriger au plus vite : il manque une évaluation solide, claire et globale des effets de la mondialisation. Puisse ce film concourir à ce qu’une telle évaluation, menée avec la plus grande rigueur, finisse enfin par voir le jour.
Peut-être – cela reste discutable – Hubert Sauper a-t-il malgré tout pris trop de liberté avec son documentaire. Mais cela lui a permis de toucher les consciences dans une société qui, comme l’analyse le philosophe Jean-Pierre Du-puy (2002) sur un plan général, ne parvient plus à croire ce qu’elle sait pourtant pertinemment. En l’occurrence, elle sait très bien que les rap-ports entre les pays riches et de très nombreux pays de l’hémisphère Sud, tout particulièrement en Afrique, atteignent un niveau de non-équité inacceptable. Et elle sait aussi parfaitement que les ventes d’armes vont bon train depuis ces mê-mes pays riches vers ces mêmes pays pauvres.
De fait, dans les pays pauvres en particulier, rares sont les mannes financières liées à une res-source naturelle qui profitent à l’ensemble des populations qui vivent autour de cette ressource. En général à cause du commerce des armes. Le « paradoxe de l’opulence » désigne ce phénomène – trop – répandu : des ressources qui pourraient en théorie apporter de la prospérité servent en pratique à financer l’achat d’armes pour faire la guerre (LaRevueDurable, 2003). La situation au Tchad, dont le gouvernement brave la constitu-tion pour accaparer les recettes du pétrole desti-nées à réduire la pauvreté, est le dernier exemple en date d’une interminable série dans ce registre. Son intention est évidente : il préférerait acheter du matériel militaire avec cet argent.
Si ce ne sont pas les Iliouchine et leurs pilotes russes ou ukrainiens qui apportent des armes à Mwanza, « ce sont donc leurs frères » sur un autre aéroport de la région, comme le confirme
d’ailleurs l’enquête de Jean-Philippe Rémy. Et il faut bien que l’argent pour les acheter vienne de quelque part. Or, le commerce de la perche du Nil rapporte d’énormes sommes à la région. Filmer la preuve formelle que les avions-cargos acheminent bien des armes sur l’aéroport de Mwanza n’a de ce point de vue rien de décisif. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les Gouver-nements d’Afrique – et d’ailleurs – dépensent considérablement plus pour leurs armées que pour l’agriculture et la pêche (voir les indica-teurs de ce numéro, page 18).
Quant au site où sont traitées des carcasses destinées à des animaux d’élevage plutôt qu’à des humains, Hubert Sauper rétorque dans Le Monde : « Qu’importe, il y a des dizaines et des dizaines de sites. » Et en effet, que ce soit d’un point de vue cinématographique ou non, qu’est-ce que cela change ? Le fait est qu’une partie de la population tanzanienne en est réduite à manger les rebuts de cette denrée que le pays exporte : si les carcasses en cause ne sont pas celles qui ont été filmées dans Le cauchemar de Darwin, même si celles qui sont consommées sont plus propres, elles n’en res-tent pas moins des carcasses.
Casser la barrière de l’indifférence pour dénoncer un problème bien réel, bien vérita-ble, ce n’est pas le moindre mérite du Cauche-mar de Darwin que d’y être parvenu avec tant d’éclat. Forcer le trait et prendre des libertés pour remuer les consciences, cela n’en vaut-il pas la peine alors qu’il y a urgence à créer plus d’équité dans un monde profondément injuste et non durable ?
Tous les contradicteurs du Cauchemar de Darwin jugent que boycotter la perche du Nil et arrêter son exportation n’est pas une solution. Mais Hubert Sauper n’a jamais prétendu que c’était là une solution et personne avec un brin de jugeote ne le prétend. Là n’est pas la réponse et ne l’a jamais été. La seule interrogation qui vaille à long terme est : comment gérer cette richesse et son commerce pour le profit du plus grand nombre et dans le respect des équilibres écologiques ? Il est dommage que le débat sur
ces points cède la place à une discussion – certes intéressante, mais beaucoup plus anecdotique – sur les droits du documentaire comme genre cinématographique. g
biblio Gra Phie
Abila R. Fish Trade and Food Security: Are they reconcilable in Lake Victoria? Report of the Expert Consultations on International Fish Trade and Food Security. Casablanca, Morroco, 27-30 January 2003. FAO Fisheries Report No. 708, Rome.
Briet S et Noualhat L. C’est Darwin qu’on assassine, interview de François Garçon et Hubert Sauper, Libération, 1er mars 2006.
Dupuy J.-P. Pour un catastrophisme éclairé ; quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, 2002.
Garçon F. Le cauchemar de Darwin : allégo-rie ou mystification ? Les Temps modernes, n° 635-636, pages 353-379, décembre 2005-janvier 2006.
Ikwaput Nyeko J. Co-Management and Value Chains: the Role of Nile Perch Exports in Poverty Eradication in Lake Victoria Fishing Communities, United Nations University, Fisheries Training Program, Reykjavik, 2004.
LaRevueDurable. Situation des conflits autour des ressources naturelles dans le monde, LaRevueDurable (4) : 12-13, 2003.
Rémy JP. Contre-enquête sur un cauchemar, Le Monde, 4 mars 2006.
POUR ALLER PLUS LOIN :
La version anglaise de Big Fish Small Fry peut être commandée en écrivant à :[email protected]
Une version française de Big Fish Small Fry est en préparation. Pour la commander, écrire à [email protected], qui transmettra.
DOSSIER LaRevueDurable N°20
22
22

A l’origine artisanales, les usines de poisson d’Afrique de l’Est se sont beaucoup transfor-mées en vingt-cinq ans. Sur les lacs de cette région et les rives de l’océan Indien, elles sont de plus en plus dominées par le capital natio-nal et international.
Du fait de l’explosion des prises de perches du Nil dans le lac Victoria au début des années 1980, ce site a jusqu’à présent subi les plus grands changements. Dans les années 1980 et au début des années 1990, 35 usines d’exportation de pois-son se sont établies sur les rives des trois pays qui le bordent : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. En vingt ans, la perche du Nil y a constitué de 40 à 60 % des 500 000 tonnes annuelles de prises totales de poisson.
De 80 à 90 % des prises de perches du Nil de plus de 1 kg sont exportées dans des pays du Nord. L’Union européenne (UE) reçoit 60 % de ces exportations. Les perches du Nil qui restent sur le marché local sont les petites, celles que les usines rejettent et les carcasses. Les populations locales traitent ces rebuts et les vendent sur les marchés locaux. Mais la chair qui subsiste sur les carcasses est de plus en plus transformée en nourriture pour animaux, surtout pour l’indus-trie du poulet.
Environ 30 % des prises totales du lac Victo-ria se composent de petites sardines (dagaa en swahili). Considérées comme la « nourriture du pauvre », le dagaa est riche en protéines, vitami-nes, zinc, fer, etc. : une cuillerée à soupe quoti-dienne couvre de nombreux besoins nutrition-nels de base d’un enfant qui grandit. C’est une
source alimentaire bienvenue dans une région où la moitié des enfants sont mal nourris. Dans de nombreux hôpitaux et cliniques autour du lac, l’Unicef et d’autres donateurs distribuent des pilules de vitamines et de protéines importées du Nord. Jusqu’à récemment, la moitié du dagaa pêché dans le lac était transformé en nourriture pour animaux. Mais un marché d’exportation de nourriture pour animaux fabriquée à partir de dagaa est en développement.
Les usines déménagent
Les Gouvernements kenyan, ougandais et tanzanien et les banques internationales de dé-veloppement ont soutenu l’essor de l’industrie d’exportation du poisson du lac Victoria. L’UE a aidé à faire en sorte que le poisson exporté soit conforme aux standards d’hygiène en vigueur dans l’UE. En revanche, ces différentes instances s’intéressent peu aux pêcheurs locaux, aux dizai-nes de milliers de femmes qui traitent et vendent le poisson et aux consommateurs locaux.
Des recherches menées au Kenya (Abila et Jansen, 1997) montrent que pour chaque emploi créé dans l’industrie de l’exportation, le secteur informel en perd six à huit. Ceux qui perdent leur emploi sont avant tout les dizaines de milliers de femmes qui, à petite échelle, traitent et vendent le poisson. Le poisson devient plus cher et plus difficile à trouver. Beaucoup de pêcheurs qui, auparavant, possédaient leur bateau de pêche et leur équipement, et pouvaient donc en user à leur gré, sont maintenant liés aux usines par des rela-tions de crédit et, dès lors, ne reçoivent que des salaires minimaux.
La surpêche est une préoccupation majeure dans les usines de poisson du lac Victoria et les
indices s’accumulent pour montrer que les prises diminuent. Inquiets, les propriétaires des usines en établissent de nouvelles sur les berges du lac Albert, en Ouganda, et des projets ont cours pour en installer d’autres sur les lacs Kyoga en Ougan-da et Tanganyika en Tanzanie.
Jusqu’à il y a peu, il était interdit d’exporter le poisson des régions côtières de Tanzanie : seuls les homards, crevettes et pieuvres étaient expor-tés. Sous la pression de l’industrie d’exportation, cet interdit a été levé sur une base d’essai. Plu-sieurs usines exportent en ce moment du poisson depuis la côte et l’on s’attend à ce que d’autres s’y installent.
Pendant plus de dix ans, la Norvège a sou-tenu le parc marin Mafia sur les eaux côtières de la Tanzanie. Avec la division de la pêche du Ministère des ressources naturelles de Tanzanie, l’ambassade de Norvège à Dar es Salaam a dé-cidé de suivre l’impact de la levée de l’interdit sur l’exportation de poisson. Ce suivi adoptera une approche holistique, évaluant l’impact en termes de durabilité des ressources de poisson et la situation des populations locales. g
Afr
ican
ow
DOSSIERLaRevueDurable N°20
* Eirik G. Jansen est fonctionnaire à l’ambassade de Norvège,
à Dar es Salam, en Tanzanie.
biblio Gra Phie
Abila RO et Jansen EG. From Local to Global Markets: The Fish Exporting and Fishmeal Industries of Lake Victoria - Structure, Strategies and Socio-economic Impacts in Kenya, IUCN Publications Series on « Socio-economics of the Lake Victoria Fisheries », IUCN, East African Regional Office, Nairobi, 1997. Des nouvelles sur les usines de poisson sur le lac Victoria sont disponibles sur le site :www.lake-victoria.info/
23
Démarrée voilà une vingtaine d’an-
nées, l’industrialisation de la pêche
dans le lac Victoria se poursuit, s’éten-
dant désormais à d’autres lacs de la
région et à la côte tanzanienne. Les
retombées pour la population locale,
en particulier pour les femmes qui
vivaient du commerce de ce poisson,
ne sont guère réjouissantes.
Eirik G. Jansen*
Ce que deviennent les usines de poisson du lac Victoria

Logique : La production de nour-riture est une activité purement marchande qu’il s’agit de rentabiliser au maximum. Pour y parvenir, chaque pays se focalise sur la matière agricole qu’il produit le mieux et achète les autres denrées sur le marché international. Chacun produit au moindre coût et tout le monde s’approvi-sionne au prix les plus bas. La France devrait ainsi se spécialiser dans la culture du blé et la Suisse… cesser toute agriculture.
Type d’agriculture : La production se concentre dans de grandes fermes gérées de manière industrielle. De fait, la taille moyenne des exploitations des grandes puissances agricoles ne cesse d’augmenter depuis les années 1980. Un choix qui détruit l’emploi : un seul actif très mécanisé assure la gestion courante de 200 à 300 hectares.
L’agriculture mise en outre sur une homogé-néisation à outrance des plantes. La moitié des calories végétales consommées dans le monde provient ainsi du blé, du riz et du maïs. En France, quatre variétés de blé produisent 70 % de la récolte (Situation de la biodiversité agri-cole dans le monde, LaRevueDurable n° 12, sep-tembre-octobre 2004).
Pour l’agriculteur, l’affaire est risquée, car une variation du taux de change ou de la conjonc-ture internationale et ses produits ne trouvent plus preneurs.
moindre. En ce moment, l’Union européenne (UE) subit des rétorsions commerciales pour plus de 100 millions d’euros par an des Etats-Unis et du Canada pour son refus d’importer du bœuf aux hormones. Et une plainte contre l’UE est ouverte à l’Organisation mondiale du com-merce pour forcer le passage des organismes génétiquement modifi és dans ses pays membres qui n’en veulent pas.
Qualité : Les fruits qui voyagent perdent leurs vitamines. Et cela fait longtemps que les tomates achetées dans la grande distribution n’ont plus aucun goût.
Coûts (et pertes) : Le consommateur, qui fait ses courses à moin-dres frais, est censé être le grand gagnant du système. Mais les faits n’étayent pas cette thèse :la livre de café s’échange en 2006 sur le mar-ché international à un tiers de son prix de 1998, mais le prix du café sur les rayons des super-marchés ne bouge pas. Cela alors même que le consommateur-contribuable subit des coûts indirects majeurs : chômage, perte de la biodi-versité culturelle et biologique, accumulation d’infrastructures de transport et ses nuisances corollaires : dépense énergétique, pollution et destruction des paysages.
Choix : Plus de produits apparaissent sur les étalages, mais toujours les mêmes variétés et de qualité
Consommation
Production
Libre-échange
agricole en vigueur Agriculture industrielle
Provenance : Allemagne
Provenance : Espagne
Provenance : Espagne
Provenance : Israel
Provenance : France 2x
Provenance : Canada
LRD
24
DOSSIER LaRevueDurable N°20

DOSSIERLaRevueDurable N°20
Ø Logique : La nourriture renvoie en premier lieu à une série de droits fondamentaux et est aussi, secondaire-ment, une marchandise. Droit des petits paysans de vivre de leur activité. Droit des populations ou des pays de définir leurs politiques agricoles et ali-mentaires, de protéger et de réguler la production et les échanges agricoles intérieurs, d’opter pour une agriculture saine, sûre et écologique. Droit de chacun de participer à la construction du système agricole dont il se nourrit. Chaque pays cultive une diversité de produits et complète, au besoin, sa production par des importations.
Ø Type d’agriculture : Les exploitations conservent une taille familiale, ce qui maintient l’emploi agricole et la vie sur les territoires. La souveraineté alimentaire passe
ØCoûts (et gains) : Les prix des produits agricoles sur un marché local reflètent la situation économique, clima-tique et agronomique du pays ou de la région. Une agriculture locale et biologique a des consé-quences positives sur toute la société : conserva-tion des sols et des ressources en eau, beauté du paysage, vivacité culturelle, vitalité des régions, sécurité de l’approvisionnement.
ØChoix : Suivre le rythme des saisons peut paraître con-traignant. Mais cela oblige à varier son alimen-tation tout au long de l’année, ce qui est jugé bon pour la santé.
Ø Qualité : Les légumes de saison et de proximité ont sou-vent plus de goût et de vitamines. Et un agri-culteur qui produit pour des consommateurs qu’il connaît tend à lui proposer des aliments de meilleure qualité.
par une agriculture plus écologique fondée sur une grande diversité génétique. Un pays peut choisir démocratiquement de don-ner plus de poids à l’agriculture biologique, par exemple, ou bannir les organismes géné- tiquement modifiés.
Consommation
Production
L’alternative de la souveraineté alimentaireAgriculture paysanne
Provenance : Ferme biologique du Falbringen à Bienne (CH)
25

LaRevueDurable N°20
LRD
Les maîtres de la mondialisation de l’agriculture
Part des supermarchés dans les ventes alimentaires au détail
0
20
40
60
80
100
Kenya
1992
2002
Europe centraleChine (zone urbaine)Amérique du Sud
Source : The State of the Food Insecurity in the World 2004, FAO.
Les dix plus grandes chaînes de supermarchés
Pays d’origine Chiffre d’affaires en milliards de dollars
Wal-Mart Stores Etats-Unis 245
Le chiffre d’affaires de ces dix entreprises
équivaut au PIB de l’Afrique
Carrefour France 65
Ahold Pays-Bas 59
Kroger Etats-Unis 52
Metro Allemagne 49
Tesco Royaume-Uni 40
Costco Etats-Unis 38
Albertsons Etats-Unis 36
Rewe Allemagne 35
Aldi Allemagne 34
Source : Concentration of Agricultural Markets, Université du Missouri, 2005.
Quelques grandes multinationales alimentaires
Siège Chiffre d’affaires en milliards de dollars
Cargill Etats-Unis 71
Ces sept entreprises totalisent
un chiffre d’affaires équivalant au PIB
de la Norvège
Nestlé Suisse 70
Archer Daniels Midland Etats-Unis 36
Altria (Philipp Morris + Kraft Foods) Etats-Unis 34 (alimentation uniquement)
Bunge Limited Etats-Unis 24
Louis Dreyfus France 20
Sara Lee Etats-Unis 11 (alimentation uniquement)
Source : sites internet des différentes entreprises et indicateurs de la Banque mondiale.
Un tiers de tous les échanges internationaux a lieu entre fi liales d’une même multinatio-nale. Dans leur ensemble, les multinationales généreraient 75 % du commerce international de matières premières. Leur infl uence sur le commerce agricole est énorme. Ancien vice-président de Cargill, Dan Amstutz est réputé pour avoir rédigé le texte de base de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce. Il l’aurait écrit à l’époque du Gouvernement Reagan, lors de son passage au Bureau du représentant états-unien au commerce, sorte de ministère du commerce. Aujourd’hui, il est chargé de la reconstruction de l’agriculture en Irak.
La Banque mondiale estime que la pression des multinationales sur les prix fait perdre 100 milliards d’euros par an aux producteurs agri-coles. Les multinationales alimentaires sont les entreprises qui paient le plus d’amendes (85 %
des amendes imposées par les Etats-Unis et l’UE) pour ententes contraires à la concurren-ce. La concentration de pouvoir se manifeste aussi en amont de la chaîne de production : deux multinationales, DuPont et Monsanto,
détiennent 65 % du marché des semences de maïs et 40 % des semences de soja. Aux Etats-Unis, six entreprises détiennent 74 %de tous les brevets sur des technologies liées à l’agriculture. g
Le poids des multinationales dans le commerce agricole mondial
Le poids des supermarchés dans la vente au détail dans le monde
L’emprise des supermarchés sur les ventes alimentaires s’étend à vitesse grand V. Les gros producteurs sont les mieux placés pour répon-dre à leurs standards de qualité et à leurs bas prix. Au Kenya, 70 % des légumes destinés aux supermarchés européens provenaient de petits agriculteurs il y a vingt ans contre 18 % actuellement.
26
DOSSIER

DOSSIERLaRevueDurable N° 20
biblio Gra PhiePower Hungry. Six Reasons to Regulate Global Food Corporations. Action Aid, 2005.
Vorley B. Food, Inc. Corporate Concen tration from Farm to Consumer, UK Food Group, 2003.
Bases de données de la FAO.
27
27
blé
soja
viande
café pêche
UNION EUROPÉENNE
CHINE
VIÊT NAMTHAÏLANDE
AUSTRALIE
JAPON
ALGÉRIE
NORVÈGE
FRANCE
TROIS PREMIERS EXPORTATEURS
TROIS OU QUATRE PREMIERS IMPORTATEURS
CANADA
ÉTATS-UNIS
MEXIQUE
COLOMBIE
BRÉSIL
ARGENTINE
Principales denrées échangées
Céréales : blé, riz, maïs, orge, sorgho, avoine, seigle, millet, etc.Elles représentent 12,4 % en valeur des expor-
tations agricoles mondiales. De toutes ces cé-réales, 40 % servent à nourrir les humains, 44 %les animaux, 16 % à des usages industriels.
La production de céréales est celle qui re-çoit le plus de subventions au sein de l’agri-culture mondiale. Le riz est la céréale la plus importante pour la consommation humaine, mais la plus échangée sur le marché interna-tional est le blé : 21 % du blé cultivé dans le monde est exporté.
Trois multinationales contrôlent plus de 80 % du commerce des céréales : Cargill, Louis Dreyfus, Archer Daniels Midland.
Oléagineux (huiles végétales) : soja, palme, colza, tournesol, arachideIls représentent 10 % en valeur des expor-
tations agricoles mondiales. Le soja est le plus
important des oléagineux : l’huile extraite de sa graine est utilisée dans l’agroalimentaire et ce qui reste sert à nourrir le bétail.
Trois multinationales contrôlent 80 % du commerce de soja : Bunge Limited, Archer Daniels Midland, Cargill.
Café, thé, cacao et épicesCes denrées représentent 6,4 % en valeur
des exportations agricoles mondiales. Elles sont une source importante de revenus pour plus de 80 pays en développement. Le café est la plus importante d’entre elles.
Trois multinationales contrôlent 45 % du commerce du café : Philipp Morris, Nestlé, Sara Lee.
Fruits et légumes Ils représentent 17,2 % en valeur des ex-
portations agricoles mondiales. De ce total, les agrumes (15 %), les bananes (6 %) et les pom-mes (3,5 %) sont les fruits les plus exportés. Selon la classifi cation de la FAO, les tomates et
les oignons sont les « légumes » les plus expor-tés. Ce sont les chaînes de supermarchés qui dirigent ce marché.
Viande (viande rouge, poulet)Elle représente 10,5 % en valeur des expor-
tations agricoles mondiales. Environ 22 % du bétail abattu est exporté.
PêcheEn valeur, elle représente 12,4 % des ex-
portations agricoles mondiales, tout comme le commerce des céréales. De ce total, 80 % sert à la consommation humaine et le reste à nourrir des animaux.

DOSSIER LaRevueDurable N°20
Des médecins cubains qui travaillent dans les barrios de Caracas en échange de pétrole pour le régime castriste, des conseils de quartier qui décident des investissements, des coopéra-tives destinées à lutter contre le chômage. Avec sa « révolution bolivarienne », Hugo Chavez n’a de cesse d’aller à l’encontre des politiques cou-rantes. En matière d’agriculture, son gouverne-ment prône et met en place une réforme agraire et une politique qui se réclame explicitement du principe de la souveraineté alimentaire. Pas étonnant que tous ceux qui rêvent d’un autre modèle agricole suivent de près ce véritable la-boratoire social.
L’histoire d’une illusion
Dès la découverte du pétrole vénézuélien au début du XXe siècle, le pays délaisse son secteur agricole, l’afflux de dollars servant à importer
de la nourriture meilleur marché de l’étranger. Résultat, le pays est très urbanisé – 12 % de la population est rurale contre 16 % au Brésil ou 23 % en Colombie –, importe 75 % de son ali-mentation et sa production agricole ne repré-sente que 5 % du produit national brut (PNB).
Lorsque Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1999, il est assez clair que l’une de ses premières priorités sera la réforme agraire. La nouvelle constitution, approuvée par référendum en dé-cembre 1999, instaure l’obligation à l’Etat de mener une réforme agraire et de promouvoir le développement agricole. Pour avoir les cou-dées franches dans sa politique internationale, Chavez veut reconquérir une certaine indépen-dance alimentaire.
Concrètement, chaque citoyen entre 18 et 25 ans peut demander à recevoir une parcelle de terre. S’il la fait fructifier trois ans, il a droit au titre de propriété de cette parcelle. Mais cela ne lui donne pas tous les droits sur cette terre :
il ne peut pas la vendre, mais uniquement la transmettre à ses héritiers. Après un lent dé-marrage, les choses sérieuses commencent en 2003, lorsque Hugo nomme son frère Adan à la tête du plan de distribution des terres. En deux ans, l’Institut national des terres (Inti) distribue 2 millions d’hectares à 10 000 familles. En 2006, il compte en distribuer 1,5 million de plus.
Un bilan mitigé
Les organisations paysannes relativisent ces bons chiffres. Elles affirment qu’une grande partie des terres redistribuées ne sont rien d’autre que la reconnaissance d’implantations informelles. Le titre de propriété assure certes au paysan que personne ne peut le déloger de la parcelle qu’il cultive, mais il reste beaucoup de paysans sans terres et de terres cultivables non utilisées. Et la réforme agraire a encore très peu affecté les latifundistes, car plus de 95 % des terres redistribuées appartenaient à l’Etat.
Les grands propriétaires se sentent néan-moins menacés. Environ 130 paysans sont tombés aux mains de tueurs à gages à cause de disputes autour de la terre. Plus importante organisation de défense des droits humains au Venezuela, Provea note que les tueurs sont des assassins loués, ce qui constitue un changement significatif par rapport aux années pré-Chavez, les tueurs appartenant alors surtout aux for-ces de sécurité du gouvernement. Provea se lamente, toutefois, que ces assassinats fassent rarement l’objet d’enquêtes et de l’insuffisance des mesures prises pour défendre les paysans au nom de leurs leaders.
La réforme agraire et l’effort du gouverne-ment pour diversifier l’économie ont permis à la production agricole au Venezuela de passer de 5 à 6 % du PNB depuis que Chavez est prési-dent. Les efforts les plus marquants ont consisté à ré-établir la production de haricots, de maïs et de sucre, produits pour lesquels le Venezuela pourrait en théorie être autosuffisant.
Les blocages
Le gouvernement central a privilégié l’as-pect le plus visible et controversé de la réforme : la redistribution de la terre. Or, une réforme agraire ne saurait se limiter à juste donner de
Gregory Wilpert*
Au Venezuela, la réforme agraire d’Hugo Chavez est en marche
Avoir une parcelle de terre à cultiver. Pour satisfaire ce besoin vital, des millions
de paysans se sont battus dans le passé et continuent de le faire aujourd’hui.
Au Venezuela, se déroule en ce moment la plus ambitieuse réforme agraire
d’Amérique latine et, peut-être, du monde. Mais redistribuer la terre n’est pas
tout. Encore faut-il la faire fructifier.
* Gregory Wilpert est sociologue et écrivain indépendant,
à Caracas, au Venezuela.
Les populations délaissent les campagnes et se massent dans des bidonvilles, ici à l’ouest de Caracas
28

DOSSIERLaRevueDurable N°20
la terre à des paysans, il s’agit aussi de créer les conditions d’une exploitation familiale réussie. Et tandis que d’importantes terres ont été attribuées en un délai plutôt court, les deux agences chargées de soutenir la production agricole traînent les pieds. Explication : une majorité des fonction-naires gouvernementaux étaient en pla-ce avant l’arrivée de Chavez et nombre d’entre eux s’opposent politiquement à la révolution bolivarienne. En outre, la corruption est aussi à l’œuvre.
De plus, même si la loi oblige les banques à dédier un certain pourcentage de leurs prêts au secteur agricole, ces prêts atteignent plutôt les grands agriculteurs que les petits paysans. Et dans les cas où ils atteignent ces derniers, il est souvent trop tard : ils ont déjà raté l’occasion d’acheter des semences pour pouvoir les planter à temps dans la saison.
Pour compliquer encore un peu plus les choses, les organisations paysannes vénézué-liennes sont très faibles, à l’évidence à cause du délitement du secteur agricole. Du coup, beaucoup de ceux qui pourraient profiter de la réforme agraire manquent des connaissances ou des ressources nécessaires pour faire valoir leurs droits. Ils sont aussi moins en mesure de s’organiser politiquement. Et lorsqu’une orga-nisation voit le jour, elle est souvent attirée dans l’orbite d’une faction politique, rendant la col-laboration avec d’autres groupes difficile.
Ainsi, même si le gouvernement est bien in-tentionné à leur égard, ces organisations ne sont pas en position de faire pression sur lui pour qu’il mette totalement en œuvre la réforme. Si le Venezuela avait des organisations paysannes plus fortes, il est probable qu’elles pourraient beaucoup mieux superviser le processus de la réforme agraire. Et une pression plus forte si-gnifierait une application plus solide de la loi lorsqu’il s’agit de débusquer et de poursuivre les assassins des leaders paysans.
Le contraste est total avec le Brésil, où le Mouvement des paysans sans terre (MST) ac-complit la réforme agraire bien que le Gou-vernement Lula, et encore moins le précédent gouvernement, n’aient exprimé le moindre intérêt pour une réforme agraire sérieuse. Na-
POUR ALLER PLUS LOIN :
Wilpert G. Changing Venezuela by Taking Power: The History and Policies of the Chavez Presidency, Verso Books, à paraître.
Gregory Wilpert anime le site : www.venezuelanalysis.com
geant à contre-courant, le MST a réussi à transformer la réalité de plus d’un million de personnes en occupant plus de 8 millions d’hectares de terres appartenant à la petite noblesse propriétaire absentéiste. Il a pu le faire grâce à la force de cette organisation,
mouvement paysan le plus organisé au monde.
Pétrole contre nourriture
L’un des principaux ennemis de l’agricul-ture vénézuélienne est le pétrole qui, avec son afflux de dollars, attire les importations ali-mentaires. Le boom du cours du pétrole, qui l’a conduit à quasiment quadrupler durant la présidence de Chavez (de 10 dollars en 1998 à 40 dollars le baril de brut vénézuélien en 2005) ne fait qu’exacerber le problème. A moins que le gouvernement ne subventionne les produits agricoles locaux et/ou les protège contre les im-portations, il est peu probable que ces produits pourront être vendus à un bon prix sur les mar-chés domestiques.
Le mouvement international d’agriculteurs et de paysans la Via Campesina, qui conseille le Gouvernement Chavez, lui propose de suppri-mer les importations alimentaires au rythme de 5 à 10 % par an, avec un plan cohérent élaboré avec les organisations paysannes vénézuélien-nes pour qu’elles reçoivent les crédits, la terre et les autres services nécessaires pour compenser chaque année le déficit. Le gouvernement est en train d’appliquer cette politique, mais à un rythme très lent.
La stratégie pour atteindre cette autonomie s’appuie sur la « Mission Mercal », qui fait partie d’une série de programmes sociaux gouverne-mentaux introduits en 2003 et 2004. Ils consis-tent à fournir de la nourriture aux pauvres via un réseau de milliers de marchés alimentaires subventionnés. D’ores et déjà, 43 % des Véné-zuéliens font leurs achats alimentaires dans les
magasins Mercal. La plupart de la nourriture vendue dans ces magasins étant encore impor-tée, le gouvernement cherche à y augmenter la proportion d’aliments issus du pays. Disposer d’un tel réseau de distribution place le gouver-nement dans une situation idéale pour soute-nir les petits producteurs agricoles qu’il est en train de créer avec la réforme agraire.
Hugo Chavez a donc quelques atouts. Mais mettre une agriculture sur pied prend des dé-cennies. Il faudrait pouvoir longtemps con-tinuer cette politique. Or, en l’absence d’un mouvement paysan fort et d’un consensus social, la perspective à long terme apparaît fragile. g
29

DOSSIER LaRevueDurable N°20
Claude Auroi*
Marché mondial et autosuffisance alimentaire,les pays du Sud ont une marge de manœuvre
Contrairement à une idée reçue tenace, l’Accord sur
l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) laisse une importante marge de manœuvre aux
pays en développement pour protéger leur agriculture.
L’Indonésie, qui ne l’utilise pas, en fait les frais. Le Nigeria,
qui le met à profit, voit sa production de riz augmenter.
Vers le milieu des années 1980, la paysanne-rie de nombreux pays latino-américains et de certains pays africains aurait pu devenir four-nisseur privilégié de denrées alimentaires sur les marchés internes. Mais elle s’est heurtée à la crise de la dette internationale et aux Program-mes d’ajustement structurels ou PAS.
En 1994, la crainte est que les accords de Marrakech créant l’OMC aggraveront la situa-tion des paysanneries du Sud, car le commerce agricole, jusqu’alors exclu de la dérégulation internationale, sera libéralisé. Mais ces accords arrivent alors que les PAS ont déjà déployé leurs effets en Afrique et en Amérique du Sud, et ne tarderont pas à le faire en Asie. Les PAS signi-fient « moins d’aide de l’Etat à l’agriculture » dans une perspective néo-libérale de « laisser-faire » en faveur des avantages comparatifs. Les produits compétitifs sur les marchés interna-tionaux sont privilégiés, les autres sont aban-donnés et la paysannerie doit se reconvertir.
En réalité, l’Accord sur l’agriculture de l’OMC conserve et même introduit de nombreuses rè-gles (boîte verte, mesures de sauvegarde, sub-ventions aux intrants, règle de minimis, qui autorise les pays en développement à soutenir les prix de leurs produits agricoles jusqu’à 10 % de la valeur de la production interne, etc.) pour que les pays du Sud protègent leur paysannerie. Ces pays utilisent toutefois peu ces marges, de peur de subir les reproches de l’Organisation et des pays du Nord. A cet égard, dans un cadre international de concurrence, de pression sur les prix, de politiques d’ajustement structurel et de libéralisation, l’Indonésie et le Nigeria ont
fait des choix politiques contrastés sur la voie de l’autosuffisance en riz (Pnue, 2003).
L’Indonésie jette l’éponge
Grand pays de 200 millions d’habitants, l’Indonésie devient autosuffisante en riz en 1984, puis exportatrice nette de 1985 à 1987, et en 1993. Pour y parvenir, le Gouvernement Suharto consent de grands investissements en infrastructures agricoles et aménagements hydrauliques. Les paysans reçoivent des sub-ventions pour les engrais et pesticides et les prix sont garantis. Produit sur de petites par-celles d’environ un quart d’hectare par près de la moitié des ménages du pays (23 millions de familles en 2002), le riz est presque l’uni-que source de protéines et de calories (Pnue, 2005a). Ainsi est garantie une production par tête importante, de plus de 145 kg par habitant de 1984 à 1996, et la baisse régulière du taux de pauvreté rurale et urbaine.
Mais cette amélioration s’arrête avec l’ad-hésion à l’OMC en 1995 : les subventions aux engrais et pesticides sont abolies. Les importa-tions gonflent à cause d’un tarif d’imposition zéro sur les importations de riz en 1998, qui remonte quand même ensuite à 30 %. L’Indo-nésie a le droit d’imposer un tarif de 140 % sur le riz importé, mais elle ne le fait pas. Il est aussi prévu que les importations seront de plus en plus libéralisées dans le cadre d’accords régionaux.
Les politiques de libéralisation et de déré-gulation conduisent, après 1994, à la baisse des prix au producteur de 20 à 30 % et à la hausse des coûts des intrants. Conséquence : les petits producteurs rencontrent des difficultés, les ren-dements baissent, le nombre et la proportion
de pauvres augmentent dans les campagnes, provoquant exode rural et ventes de terre. « Au total, le taux de conversion des terres à Java at-teint 6,91 % par an de 1990 à 2000, et si cette tendance continue à ce rythme, il est probable que dans vingt ans, toute la surface agricole de l’île sera convertie à des usages non agricoles, surtout à des immeubles, bureaux, écoles, cen-tres commerciaux et usines » (Pnue, 2005a).
Le Nigeria tient bon
Au Nigeria, plus grand pays d’Afrique de l’Ouest, le sorgho et le mil sont beaucoup plus consommés que le riz. Mais avec l’urbanisation accélérée des années 1980, le prestige du riz aug-mente. L’extension de sa culture devient alors une priorité nationale. La stratégie du pays vers l’autosuffisance en riz commence en 1985, lors-qu’il se retrouve exsangue suite à la chute des prix du pétrole (l’or noir représente 90 % des recettes d’exportation du pays) (Pnue, 2005b). Le gouvernement interdit l’importation de riz et, en parallèle, laisse la monnaie nationale se dévaluer pour décourager les autres importa-tions alimentaires et promouvoir la diversifica-tion des exportations non pétrolières.
Les denrées agricoles autres que le riz ne dé-passeront jamais 5 % des exportations, mais les effets sur l’agriculture sont positifs. La produc-tion agricole croît de 3 % par an, celle du riz de 7 % par an de 1986 à 1993. La production natio-nale fait un bond d’un million de tonnes en 1980 à près de 3 millions en 1995. Une progression surtout due au triplement des surfaces cultivées. Avec l’entrée en vigueur des accords de l’OMC en 1995, le pays, qui ne peut plus interdire les importations, impose des tarifs douaniers très hauts – de 50 à 150 % selon les périodes – pour barrer l’accès aux importations de riz.
* Claude Auroi est professeur à l’Institut universitaire d’étude
du développement (IUED), à Genève, en Suisse.
30
DDC/Toni Linder

Le problème est en nous A l’occasion des dix ans de l’OMC, Alliance Sud, coalition des œuvres d’entraide suisses, a consulté ses partenaires au Sud pour comprendre ce qui cloche dans le commerce inter-national. Les 57 organisations non gouvernementales (ONG) qui ont répondu à son appel s’en prennent sans surprise à la politique des grandes puis-sances industrialisées, à l’OMC et au FMI mais, de façon plus surprenante, insistent davan-tage sur les insuffisances de leurs gouvernements à gérer leurs relations commerciales (Alliance Sud 2005).
Les ONG accusent les groupes au pouvoir dans leurs pays d’élitisme, d’être coupés de la réalité et de la vie des popu-lations qu’ils connaissent peu ou mal, de manquer de vision à long terme, en particulier en matière d’agriculture. Par aveuglement, faiblesse face à la contrainte ou par idéologie, les gouvernements de nom-breux pays en développement ont pris le train en marche des politiques de libéralisation. Certains même, comme dans le cadre de l’Accord de libre-échange Etats-Unis-Amérique centrale, « se sont engagés à
aller beaucoup plus loin que ce qui est envisagé à l’OMC en matière de libéralisation des services ».
Parmi d’autres causes d’échec évoquées figurent la corrup-tion, la concentration de pou-voir, la mauvaise gestion, le pillage des ressources publi-ques et l’absence de transpa-rence et de démocratie. Est aussi mentionnée l’absence de compétences techniques des négociateurs, dépassés par les dossiers très complexes de l’OMC. LRD
biblio Gra Phie
Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue). Integrated Assessment of Trade Liberalization and Trade-Related Policies. Synthesis Report, Genève, 2003.
Pnue. Integrated Assessment of the Impact of Trade Liberalization, a Country Study of the Indonesian Rice Sector, Genève, 2005a.
Pnue. Integrated Assessment of the Impact of Trade Liberalization, A country Study of the Nigerian Rice Sector, Genève, 2005b.
Quel commerce pour quel développement ? Dossier Global Plus n° 4, mai 05, Alliance Sud.
POUR ALLER PLUS LOIN :www.alliancesud.ch
Global Plus n° 19, printemps 2006, Alliance Sud.
En 2002, le président annonce l’autosuffi-sance pour 2004 et une position d’exportateur net en 2005, mais ce vœu ne se réalise pas. La production nationale poursuit sa progression, mais les importations aussi, malgré la hausse des tarifs douaniers et la dépréciation du taux de change. Elles passent de 100 millions de dol-lars en 1995 à 300 millions en 2000. La forte croissance de la population, l’urbanisation et le changement de modèle alimentaire expliquent cette hausse. La production interne n’y fait face qu’en partie à cause de bas niveaux de tech-nologie et d’irrigation et des rendements très moyens de 2 tonnes par hectare.
Au bilan, les mesures de protection de la production nationale avant l’adhésion à l’OMC
(interdiction des importations) et après cette adhésion (hausse des tarifs autorisés) ont sou-tenu et étendu la sécurité alimentaire en riz. A l’avenir, l’intensification des rendements permettra sans doute au Nigeria d’atteindre l’autosuffisance, voire de devenir exportateur net. Mais cela à condition d’imposer des res-trictions à la concurrence des importations de riz en jouant serré avec les marges et mesures qu’autorise l’OMC, voire en les transgressant.
Protéger ne suffit pas
Ces deux cas et quelques autres, notamment ceux du Sénégal et de la Colombie, montrent qu’il est difficile aux pays du Sud de mener des politiques d’autosuffisance alimentaire
sans protéger leur production de denrées de base. Dans le contexte mondial de subven-tionnement des prix à l’exportation des pays du Nord, il est urgent que ces pays utilisent les marges de manœuvre qu’autorisent les accords de l’OMC.
Toutefois, se protéger des importations ali-mentaires a un effet temporaire sur la produc-tion locale. Sans politique agricole d’aide à la production, les importations reprendront et concurrenceront une agriculture locale incapa-ble de se développer. g
L’autosuffisance en riz est un atout précieux
31
31
DOSSIERLaRevueDurable N°20
fairtrade media / Harlmut Fiebig

32

Le commerce équitable n’est pas à même de résoudre tous les problèmes de développe-ment et de préservation de la planète. Cepen-dant, il est porteur d’une avancée fondamen-tale : montrer comment le commerce peut être un outil de développement et de réduc-tion de la pauvreté. Pourtant, il suscite force polémiques, en France en particulier. Aussi est-il éclairant, avant d’évoquer les rôles bé-néfiques du commerce équitable, de passer en revue les débats et les critiques qui traversent ce mouvement en France.
Les critiques
Les deux filières du commerce équitableIl existe deux filières du commerce équita-
ble qui se posent trop souvent en rivales. La première, historique, est celle d’Artisans du monde en France et des Magasins du monde en Suisse. Elle établit un rapport direct entre des producteurs au Sud et des consommateurs au Nord en misant sur des rapports de confiance mutuelle et un réseau de distribution indépen-dant des supermarchés. Cette filière ne conçoit l’économie équitable que comme alternative à 100 %.
Née avec Max Havelaar, la seconde filière, dite labellisée, émerge un peu plus tard pour mettre les produits équitables à portée de tous. Pour cela, ils doivent avoir accès aux grands réseaux de distribution, c’est-à-dire aux super-marchés. Un organisme certificateur, la Fair Trade Labelling Organization (FLO), consigne dans un cahier des charges les conditions d’at-tribution du label.
Les tenants de la filière non labellisée visent l’équité sur toute la chaîne de production. Ils n’écartent aucun maillon et s’interrogent sur les conditions de travail des salariés des bateaux qui transportent la marchandise et des grandes surfaces qui la vendent. Les défenseurs de la fi-lière labellisée, de leur côté, cherchent à écouler le plus possible de produits pour aider avant tout les coopératives de producteurs. Et comme la grande majorité de la popula-tion – plus de 90 % en France – font leurs courses en grande sur-face, ils incluent ce canal de dis-tribution.
Ces deux formes de commer-ce équitable présentent des avan-tages et des inconvénients. Mais à en juger par la vitalité des réseaux de boutiques spécialisées, tout porte à croire que loin d’être concurren-tes, elles se complètent. Il n’est en effet pas rare que des consommateurs de café ou de sucre qui découvrent ces produits équitables en grande surface deviennent ensuite clients des produits des Artisans et des Magasins du Monde, voire des coopératives biologiques.
Commerce équitable et justiceLe commerce équitable offre de meilleurs
prix aux producteurs, finance d’avance la ré-colte et stabilise l’écoulement de la production et les prix, autant d’avantages énormes pour les conditions de production et de vie à long terme des paysans. Pourtant, des voix s’élèvent pour dénoncer le rapport déséquilibré entre les riches acheteurs du Nord et les pauvres pro-ducteurs du Sud.
Le commerce équitable labellisé est né au Mexique, mais globalement, les cahiers des charges étaient établis dans les pays du Nord. Aussi, pour rééquilibrer la situation, la FLO
intègre des représentants de producteurs aux groupes de travail qui fixent les règles pour cha-que produit.
Les exigences de qualité rendent difficile l’accès au label à bien des producteurs du Sud. Ce qui peut créer des injustices entre les or-ganisations de producteurs qui ont accès à ce marché et celles qui n’y ont pas accès. Les orga-nisations non gouvernementales qui travaillent avec les petits paysans pour les aider à atteindre les normes de qualité corrigent en partie cette situation d’exclusion.
Commerce équitable et environnementLa garantie d’un prix stable et élevé peut
conduire à intensifier la production agricole. Pour éviter cela, les cahiers des charges incluent des critères écologiques tels que le bannisse-ment des organismes génétiquement modifiés
et de certains pesticides. Et ils incitent à protéger les sols et à mettre en œuvre des pratiques agronomiques écologiques. Ain-si, plus de la moitié des produits labellisés équitables sont certifiés biologiques.
Le commerce équitable est aussi accusé de favoriser les importations aux dépens des pay-sans et des artisans locaux. La large majorité du commerce équitable concerne des produits de toute façon importés (café, thé, cacao, coton, fruits exotiques), mais la certification équitable des fleurs, par exemple, soulève ce problème. Une étude comparative montre toutefois que, malgré une distance d’acheminement plus lon-gue, l’impact écologique des fleurs importées du Kenya est plus faible que celui des fleurs im-portées des Pays-Bas. Il est vrai que la culture des fleurs aux Pays-Bas utilise beaucoup d’éner-gie fossile pour chauffer les serres. Reste que le commerce international de fleurs est ques-tionnable en soi, qu’elles viennent du Kenya ou des Pays-Bas, car il repose sur l’utilisation de beaucoup trop de pesticides très toxiques.
La pédagogie du commerce équitable
Dans les pays producteurs, le commerce équitable aide les paysans à s’organiser et à de-venir acteurs des politiques agricoles. Dans les
* Guy Durand est professeur à l’Ecole nationale supérieure
agronomique de Rennes, en France. Il est l’un des fonda-
teurs de Max Havelaar France et a été son premier président
(1992-1996).
Accusé de ne pas être toujours juste ni véritablement alternatif, le com-
merce équitable est l’objet de fortes critiques en France. Traversé de contra-
dictions et de paradoxes, il n’en reste pas moins un outil très précieux, voire
unique pour questionner les pratiques des consommateurs et affermir le
pouvoir de négociation des petits producteurs.
Guy Durand*
Le commerce équitable, outil de développement et d’éducation
33
Des avantages énormes
pour les paysans
DOSSIERLaRevueDurable N°20

TerrEspoir Cameroun, source d’ « empowerment »
DOSSIER LaRevueDurable N°20
pays importateurs, ses produits interpellent les consommateurs sur leurs habitudes.
Commerce équitable et politiques agricolesLe commerce équitable est un outil de sou-
tien aux paysanneries « abandonnées ». Et ce soutien ne se limite pas à l’économie. Le but est d’aider ces populations à mieux s’organiser pour défendre leurs intérêts et leurs points de vue. De faire en sorte que les coopératives de producteurs puissent prendre part à l’élabora-tion de politiques agricoles favorables à la petite paysannerie.
Depuis quelques années, l’association Agro-nomes et vétérinaires sans frontières évalue l’impact du commerce équitable sur les pro-
ducteurs de café des piémonts andins en Bo-livie et au Pérou. Entre autres avantages, elle constate un renforcement des coopératives de producteurs. Les 22 organisations affiliées à la Fédération des caféiculteurs exportateurs de Bolivie (Fecafeb) sont chaque année un peu plus attractives. Le nombre moyen de membres augmente d’environ 20 % depuis deux ans.
La fédération s’est impliquée dans l’élabora-tion d’une proposition émanant de l’ensemble du secteur caféier bolivien pour une nouvelle politique caféière du pays. Au nom de la Bolivie, la Fecafeb a organisé une rencontre régionale caféière en novembre 2004, à laquelle ont par-ticipé la Junta Nacional del Café du Pérou et la Corporation équatorienne des producteurs de
café. Il en est sorti la création de la Commission andine des producteurs de café, la Cancafe, dont l’objectif est de renforcer la représentation des caféiculteurs andins sur le marché mondial. La Cancafe prend position sur l’ouverture des mar-chés agricoles et le café transgénique, et s’engage aux côtés d’Oxfam dans la campagne de lobbying international sur le prix du café (Avsf, 2005).
Consommation citoyenneTous les consommateurs de produits équi-
tables ne sont pas consomm’acteurs. Mais la notoriété croissante du commerce équitable stimule le débat social au Nord comme au Sud. Désormais, trois Français sur quatre connais-sent le commerce équitable et un sur deux re-connaît le label Max Havelaar. Des données qui
Chaque semaine, plus de trois ton-nes d’ananas, papayes, mangues, avocats, fruits de la passion et bana-nes, frais, secs ou sous forme de confiture arrivent à l’aéroport de Zurich en provenance de Yaoundé. C’est la production de TerrEspoir, coopérative de commerce équitable de l’Ouest camerounais, qui écoule ses produits à travers un réseau de paroisses, de privés et des Magasins du Monde en Suisse romande.
Le commerce équitable de Terr-Espoir se fonde sur un discours aux antipodes de celui du commerce
conventionnel : il prône la transpa-rence des prix, des contrats à long terme, le préfinancement, les grou-pements ou organisations de petits producteurs et productrices, l’auto-gestion, la participation aux déci-sions, les projets collectifs, l’écolo-gie. Au total, plus de mille personnes profitent des retombées positives TerrEspoir : environ 130 familles de producteurs, les sécheurs de fruits, sept personnes chargées du condi-tionnement des produits pour le fret et une unité de production de cartons de six personnes.
Plus encore qu’une source de finan-cement, TerrEspoir est un moyen d’«empowerment» des paysans qui y participent. L’organisation les pousse à mieux comprendre la société pour élaborer leurs propres stratégies de survie. Au Cameroun, les membres de TerrEspoir calcu-lent leurs coûts de production pour chaque produit, connaissent les prix des fruits et les exigences de qua-lité (de la production agricole au fruit mûr, prêt pour l’exportation), savent comment les commandes se répartissent entre eux. Ils cotisent à un fonds de solidarité qui leur
donne accès à des crédits pour payer la scolarité de leurs enfants ou tenir en cas de coup dur.
La terre et ses produits (re)prennent de la valeur aux yeux des membres de TerrEspoir grâce à de meilleurs prix et parce qu’en Suisse, des gens achètent les fruits de TerrEspoir et les trouvent excellents. Cela favo-rise chez eux la perception de leurs compétences dans leur domaine de production ou dans le séchage des fruits.
Mais le fait d’appartenir à une orga-nisation ou à un réseau ne suffit pas, même s’il s’intègre au tissu social d’une région : les membres de l’as-sociation doivent aussi se l’appro-prier. Au Cameroun, ils ont franchi une étape lorsque, chiffres à l’appui, ils se sont rendu compte que ce sont
eux qui paient les salaires des per-manents et que, par conséquent, ils sont patrons… et responsables !
Des formations sur le fonctionne-ment associatif ont été organisées. Un atelier de planification partici-pative a permis de définir un plan d’activités sur cinq ans. Les grou-pes régionaux ont eux aussi défini leurs stratégies de diversification des marchés et de transformation de produits. Une stratégie où le marché local figure en bonne place, car les deux camions achetés avec un crédit des partenaires suisses servent à écouler les fruits dans les centres urbains de la région.
Michèle ZuffereyFondation TerrEspoir
34

DOSSIERLaRevueDurable N°20
interpellent les collectivités publiques. Le com-merce équitable devient une valeur de débat sur la solidarité internationale. Jamais aupara-vant une initiative n’avait autant fait parler des rapports Nord/Sud de façon constructive, en plaçant la discussion sur la question de l’équité et non plus de la charité.
Le commerce équitable pose des questions qui dépassent les seuls produits équitables et s’étendent à d’autres pratiques vertueuses : produits biologiques, économies d’énergie, transport doux. Il questionne également les pratiques alimentaires et véhicule une critique de la « malbouffe » : MacDo, la restauration collective dans les écoles, les entreprises, etc.
Pot de fer contre pot de terre
Le commerce équitable veut faire du com-merce un instrument de développement. Que pèse cette idée face à la libéralisation en cours ? Le Réseau international du commerce équita-ble (Fine) a pu faire entendre son point de vue au récent sommet de Hong Kong. Même s’il reste minoritaire, le Fine donne de la voix aux critiques de la libéralisation qui prive les Etats d’instruments de contrôle de leur économie et déclenche une spirale à la baisse des prix, entraînant un dumping social et écologique.
Le Fine a rappelé que de 1 à 2,5 milliards de petits paysans dépendent de l’exportation de matières premières agricoles telles que café, ca-cao, canne à sucre, etc. Pour ces denrées, le Fine demande que soit reconnu le besoin de gérer l’offre mondiale pour éviter la chute des prix et la création d’un fonds international pour la diversification agricole.
Pour corriger les déséquilibres et aider les plus pauvres, il faut profondément réformer les politiques publiques nationales et la régu-
lation du commerce mondial. Et pour cela, il faut une organisation de producteurs à même de les défendre et une alliance stratégique avec les autres secteurs sociaux au Sud et au Nord. C’est en jetant les bases d’une telle organisation d’acteurs que le commerce équitable joue un rôle modeste, mais croissant. g
biblio Gra Phie
Agronomes et vétérinaires sans fron-tières (AVSF). Projet de renforcement des organisations économiques paysannes des Yungas de La Paz, Bilan 2004, 2005.
POUR ALLER PLUS LOIN
L’association Agronomes et vétérinaires sans fron-tières (AVSF) travaille avec FLO et Max Havelaar France et Belgique à construire un système de mesure des impacts économiques, sociaux et envi-ronnementaux du commerce équitable. Le but est de montrer l’efficacité pour les producteurs du système FLO-Max Havelaar et d’influencer le cadre réglementaire européen pour éviter que la certification ne devienne un business au détri-ment des familles paysannes. AVSF vient de réa-liser un documentaire de trente minutes sur son travail avec des petits caféiculteurs en Bolivie, « Le café, graine de développement dans le Yungas », qui peut être commandé au prix de 10 euros.
www.avsf.orgwww.terrespoir.comDoña Sofia et sa famille, de la coopérative équitable Prodecoop, au Nicaragua
Alb
erto
Var
gas
Tri du café à la coopérative Union, à Oromia, en Ethiopie
Tran
sFai
rUSA
35

DOSSIER LaRevueDurable N°20
LRD
Au Pérou et au Mexique, la consommation équitable débarque sur les marchés locaux
Après avoir inspiré de nouveaux rapports commerciaux au niveau mondial, les
paysans mexicains sont en passe de les influencer dans leur pays. Ils ont poussé
le café « justo » sur les étalages de magasins biologiques et de quelques épiceries.
Au Pérou, les associations de producteurs créent leurs propres magasins de vente
directe. Un vent d’ingéniosité sociale balaie l’Amérique latine.
36
Le Mexique exporte du café labellisé Max Havelaar depuis vingt ans, mais ce n’est qu’en 2004 que Comercio justo Mexico (CJM), orga-nisation de commerce équitable pour le marché national, est admise à la Fairtrade Labelling Or-ganization (FLO). Cet organisme international détermine les critères du commerce équitable pour chaque produit et attribue le label Fair-trade. CJM est la première organisation de commerce équitable à voir le jour dans un pays exportateur de produits labellisés.
Le Mexique boit à la santé de ses paysans
« L’initiative naît en 1999 d’un groupe de coopératives qui produisent pour l’exportation et veulent vendre leur café sous leur propre
marque dans leur pays », explique Fabiola Oso-rio, responsable de la communication à CJM. Contrairement au café équitable exporté sous forme de grain vert, le café équitable local est torréfié, moulu et emballé dans les coopérati-ves, ce qui leur permet d’intégrer toute la chaîne de valeur ajoutée. Sur les 50 coopératives qui produisent pour le marché national, seules huit exportent.
Le miel équitable, que le Mexique exporte, sortira bientôt sur le marché local, mais une version nationale du jus d’orange équitable n’est pas encore à l’ordre du jour. « Le démar-rage est difficile, avoue Fabiola Osorio. Nous avons commencé à vendre notre produit dans dix boutiques de café gourmet », raconte- t-elle. Les gens ayant de la peine avec le prix
plus élevé, le café équitable rejoint le segment des cafés haut de gamme pour consommateurs exigeants.
Le café équitable a ensuite investi les bouti-ques de produits biologiques, qui suscitent un engouement certain au Mexique. Certifié bio-logique, il a trouvé sa clientèle naturelle dans ces « Green Corners », comme les Mexicains les appellent. « En revanche, les grands supermar-chés sont très réticents à proposer des produits plus chers », constate Fabiola Osorio. Prochai-nement, Superama, chaîne de 50 magasins, l’in-tégrera néanmoins à son assortiment.
Les six marques de café équitable mexicain sont désormais présentes dans 85 points de vente. Et de 4 tonnes en 2001, la vente est pas-sée à 45 tonnes en 2005. Un bilan encourageant, même s’il reste loin des 1500 tonnes écoulées en
Sur l’île de Negros, aux Philippines, l’Eper (Entraide protestante suisse) soutient depuis le milieu des années 1990 l’organisation Bind (Broad Initiative for Negros Development). Bind est spécialisée dans la recher-che, le développement et la promo-tion de l’agriculture biologique. L’un des programmes de Bind consiste à former des petits paysans à des méthodes de culture respectueuses de l’environnement et moins coû-teuses. L’idée est double : promou-voir la sécurité alimentaire par la diversification des produits (riz, légumes, élevage de petits animaux, bois, etc.) et une bonne planifica-tion des récoltes, augmenter ensuite le revenu des personnes en vendant à un prix juste les excédents sur les marchés locaux et dans les magasins
bio et équitables de Bacolod, ville principale de l’île.
Bind exploite son propre maga-sin dans cette ville, où sont vendus des produits biologiques à un prix équitable : riz, légumes, confitures et produits artisanaux. Pour stimuler la demande et assurer un bon écou-lement des produits, Bind soutient également la création de magasins de village, gérés par des organisations de base. A ce jour, quelque 500 pay-sannes et paysans ont participé à des cours de formation et de perfection-nement, et vu leurs conditions de vie et celles de leur famille s’améliorer.
Lieu d’échanges et de démonstra-tion, le Centre de recherches agri-coles de Campo Berde forme la
colonne vertébrale de l’agriculture durable et de la sécurité alimen-taire sur l’île de Negros. Ses activités regrou-pent la recherche et la promotion de métho-des de culture écologiques (amé-lioration du sol par le compost, élevage de petits animaux, systè-mes d’irrigation) et la production de semences. Grâce aux méthodes écologiques et à la culture de nou-velles sortes de riz et de légumes, les paysans obtiennent des récol-tes plus abondantes. La création de pépinières, l’aménagement de haies et la plantation sur les rives fluviales pour protéger de l’érosion font également partie des activités de ce centre.
Avec le soutien de l’Eper, une dou-zaine de femmes se sont regroupées à travers Bind en une organisation, Hope (Homeopathic Producer’s Enterprise). Elles produisent des médicaments à base de plantes et les vendent à un millier de patients et patientes. Des herboristeries ont été ouvertes dans onze villages en collaboration avec les communautés locales.
Corinne Henchoz PignaniSecrétaire romande Eper (Entraide
protestante suisse)
Aux Philippines, le commerce bio, équitable et local

POUR ALLER PLUS LOIN
www.camari.org
www.comerciojusto.com.mx/
www.eper.ch
Le Pôle de socio-économie solidaire (PSES) est un réseau mondial de débat entre des acteurs de terrain, chercheurs et personnes engagées dans le commerce équitable et l’économie solidaire, sur-tout en Amérique latine et en Afrique : www.socioeco.org/fr/index.php
37
Ces apiculteurs mexicains en pleine récolte pourront bientôt vendre leur miel équitable sur le marché localfairtrade media / Kay Maeritz
Suisse en 2004 ou des 3800 tonnes en France. « Mais cela fait plus de vingt ans que le com-merce équitable progresse en Europe alors que nous n’y travaillons que depuis six ans », rappelle Fabiola Osorio.
A bas les intermédiaires
Ailleurs en Amérique latine, le Brésil est en discussion avec FLO pour mettre en place un label. Mais la voie de la labellisation n’est pas la seule possible. A Chiclayo, au nord du Pérou, des producteurs ont fondé la « Petite maison de la solidarité ». Des produits agricoles frais et transformés de la région y côtoient de l’ar-tisanat. Café, bananes, miel et quinoa arborent le label de FLO, car ils proviennent de coopé-ratives qui en exportent. Mais la plupart des produits sont sans label. De même à Puno, sur les rives du lac Titicaca, où la boutique se mute en un véritable centre culturel : cafétéria, salle d’exposition avec programme de conférences-discussions sur le commerce équitable. Cha-cune de la dizaine de ces boutiques qui sont apparues dans le pays est autonome, fondée et gérée par un groupe local de producteurs.
« Le commerce équitable au Pérou ne peut pas se traduire par des prix plus élevés, car il n’y a pas le pouvoir d’achat. Ce qu’il faut, c’est éliminer les intermédiaires », remarque Al-fonso Cotera, qui préside le Réseau péruvien de commerce équitable (Gresp), coalition de 200 organisations de producteurs, de syndicats paysans et d’œuvres d’Eglises qui poussent le
commerce équitable local depuis 2001. Le cœur de son projet est la vente directe par tous les moyens. Outre encourager la création de nou-velles boutiques solidaires, le Gresp multiplie sa présence sur les foires et les marchés.
« Par opposition au Mexique, qui exporte surtout des produits équitables alimentaires, il y a au Pérou beaucoup d’artisanat équita-ble », relève Alfonso Cotera. Vendu dans les boutiques d’Artisans du monde en France ou les Magasins du monde en Suisse, cet artisa-nat n’est pas labellisé. Son caractère équita-ble repose sur des rapports de confiance entre producteurs et importateurs. « Au Pérou, nous voulons faire un système dans lequel tous les produits qui sont rémunérateurs pour les pro-ducteurs et bons pour l’environnement trou-vent leur place », précise Alfonso Cotera.
Une autre idée, déjà pratiquée au Brésil et en Uruguay pour des produits biologiques, est la certification participative : des producteurs et des consommateurs fixent les critères à remplir pour qu’un produit soit équitable et contrôlent ensemble s’ils sont respectés. « L’expérience de l’éducation populaire et de l’autogestion en-seigne que seule l’implication dans les projets amène les gens à en prendre soin et à se sen-tir responsables », note Alfonso Cotera. Les producteurs sont preneurs d’un autre système que FLO. Certains ressentent de la frustration à avoir si peu à dire sur les critères de cette ins-titution et s’irritent de la certification d’un café équitable Nestlé, qu’ils peinent à comprendre.
Un vent du Sud
Secrétaire du groupe de travail du commer-ce équitable pour l’Amérique latine, Alfonso Cotera observe la situation sur le continent. Au Chili, des magasins équitables écoulent du café péruvien labellisé. En Bolivie, les maga-sins communautaires autogérés marchent bien. Mais c’est l’Equateur qui lui fait le plus envie. Créés par une fondation de l’Eglise catholique équatorienne en 1981, les magasins Camari suppriment les intermédiaires, transporteurs et prêteurs de tous ordres qui abusent des paysans. Aujourd’hui, 6500 familles de petits paysans et d’artisans vendent leurs produits via les points de vente des grandes villes du pays et des ventes en gros à des hôpitaux, hôtels et prisons. « Ils n’appellent pas cela « commerce équitable », mais c’est la même chose », commente Alfonso Cotera. g

38
…pour changer bien des choses. Récupérer
l’eau de pluie, c’est d’abord faire des
économies. C’est aussi soigner son jardin
avec une eau qui lui convient bien
mieux que l’eau du robinet. Enfin, et
surtout, c’est participer à son échelle à
un enjeu très important pour les années
à venir. Ressource naturelle indispensable
à la vie, l’eau n’est pas inépuisable. C’est
pourquoi il devient urgent de savoir mieux la
consommer. En commençant au jardin, par exemple.
d’une goutteIl suffit
d’eau…
Chez botanic, les produits vous permettant de jardiner de façon écologique sontdésormais facilement repérables. Tout comme ce récupérateur d’eau, ils ont étésoigneusement sélectionnés avant de recevoir l’appellation éco-jardinier botanic.Pour en savoir plus sur la gamme éco-jardinier ou sur botanic, entreprise familialenée en région Savoie, et pour connaître l’adresse de la jardinerie la plus prochede chez vous, tapez botanic.com ou téléphonez au 04 50 31 28 28.
botanic. Le jardin, une seconde nature.GA
LLIE
R &
ASS
OC
IÉS
- Il
lust
rati
on :
Aur
ore
de l
a M
orin
erie

LaRevueDurable N°20 DOSSIER
L’indépendance alimentaire du Burkina Faso se dégrade, mais les autorités regardent ailleurs : le Gouvernement burkinabé n’a d’yeux que sur le cours international du coton, dont la chute menace de causer la faillite de millions de pay-sans. Les responsables de la politique agricole de ce pays devraient davantage considérer leur marché interne. Le coton représente le principal du revenu de l’Etat, mais il n’est pas la première source d’entrées monétaires des ruraux, qui retirent des revenus monétaires trois fois plus
De l’agriculture de subsistance à la production marchande
Dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté, le ministre de l’Agriculture burkinabé propo-sait en 2002 de créer des exploitations de 100 à 150 hectares en plaçant à leur tête des techni-ciens. Selon lui, les fermes familiales inférieures à dix hectares seraient incapables de sortir de l’autosubsistance. Il faut donc les remplacer.
Une tout autre image ressort de l’enquête menée auprès de 540 fermes de trois régions agroécologiques distinctes du Burkina Faso : la région traditionnellement excédentaire en céréales de Dédougou, à 200 km à l’ouest de la capitale, celle à l’équilibre céréalier précaire de Fada N’Gourma, à 250 km à l’est de la capitale, et celle en général défi citaire sur le plan vivrier de Kaya, à 100 km au nord-est de Ouagadou-gou. L’étude a mis en évidence une agriculture qui dégage des surplus importants vendus sur les marchés urbains.
Excepté à Dédougou, où le coton est la prin-cipale source de revenus monétaires de trois exploitations sur quatre, ce sont les ventes de vivres qui rapportent le plus de liquidités aux paysans. Extrapolé au niveau national, les ven-tes alimentaires annuelles des agriculteurs bur-
Gil Ducommun*
Les agriculteurs du Burkina Fasopourraient nourrir leur pays
* Gil Ducommun est professeur en économie rurale et déve-
loppement à la Haute école suisse d’agronomie HESA de
Zollikofen/Berne, en Suisse.
Loin d’être incapables de produire
de grandes quantités de nourriture,
les agriculteurs burkinabés seraient
au contraire à même de nourrir leur
pays si une politique agricole natio-
nale volontariste les soutenait. C’est
ce que démontre une enquête unique
menée dans trois régions du Burkina
Faso qui prouve du même coup – une
fois de plus – qu’au-delà des contrain-
tes agro nomiques, la production agri-
cole dépend avant tout de la volonté
politique.
importants de leur production vivrière. C’est là l’une des conclusions majeures d’une large en-quête que des chercheurs suisses et burkinabés
ont menée pendant quatre ans sur le terrain (Ducommun et coll., 2005).
Contrairement aux préjugés des autorités, les paysans ne se contentent pas de cultiver pour vivre, mais dégagent des excédents qu’ils écoulent dans les centres urbains. Et ils pour-raient assurer l’autosuffi sance du Burkina Faso en céréales si seulement ce pays optait pour une politique agricole allant plus loin que le seul soutien à la culture du coton.
Le marché alimentaire de Ouagadougou représente un pouvoir d’achat d’environ 300 millions d’euros par an. C’est là un formi-dable pouvoir disponible immédiatement qui, orienté vers les agriculteurs et l’industrie agroalimentaire nationaux, améliorerait les conditions de vie des paysans et des artisans locaux. Tous les pays européens ont pratiqué une politique de stabilisation et de protection des prix pour augmenter leur production ali-mentaire jusqu’à ce qu’elle devienne excéden-taire. De même, les pays du sud et du sud-est de l’Asie ont commencé par développer leur marché intérieur de masse tout en le proté-geant contre les importations.
importants de leur production vivrière. C’est là l’une des conclusions majeures d’une large en-quête que des chercheurs suisses et burkinabés
ont menée pendant quatre ans sur le terrain (Ducommun et coll., 2005).
Contrairement aux préjugés des autorités, les paysans ne se contentent pas de cultiver pour vivre, mais dégagent des excédents qu’ils écoulent dans les centres urbains. Et ils pour-raient assurer l’autosuffi sance du Burkina Faso en céréales si seulement ce pays optait pour une politique agricole allant plus loin que le
tes agro nomiques, la production agri-
cole dépend avant tout de la volonté
politique.
OUAGADOUGOU
Bobo-Dioulasso
Koudougou
Ouahigouya
Dédougou
Kaya
Tenkodogo
Fada-N’Gourma
Banfora
Lac de BagréLac de la
Kompienga
Mouhoun
NIGERMALI
CÔTE D’IVOIRE
GHANA TOGO
BÉNIN
200 km
39G
il D
ucom
mun

DOSSIER LaRevueDurable N°20
kinabés sont trois fois supérieures à celles du coton. Ce qui contredit le discours officiel sur la faible capacité de production des agriculteurs et leur mentalité trop peu commerciale.
Autre constat majeur : la très forte différen-ciation des fermes. Dans l’échantillon étudié, 10 % d’entre elles assurent 40 % des ventes, tandis que celles du quart qui vendent le moins sont à la limite de la survie. Elles ne dégagent pas de surplus agricole : ayant impérativement besoin d’argent, elles vendent à la fin de la ré-colte, mais doivent sans doute racheter de quoi se nourrir plus tard. Sans revenus annexes ou non agricoles de membres de la famille, ces agriculteurs souffrent de la faim.
Pour aider les exploitations moins perfor-mantes à améliorer leur production, il est né-cessaire de démêler les causes de ces écarts.
Des bœufs, s.v.p.
Un premier facteur peut être écarté : la disponibilité de main-d’œuvre, qui n’affecte guère la production commerciale. La taille des fermes, en revanche, joue un rôle indé-niable. Les surfaces cultivées moyennes sont de 4,4 hectares à Fada, 4,7 hectares à Kaya, 7,4 hectares à Dédougou. Ainsi la taille des fermes influence-t-elle les quantités de pro-duits commercialisés, mais en partie seule-ment. A Dédougou, la taille moyenne des ex-ploitations des deuxième et troisième quarts est la même alors que les ventes de produits alimentaires varient du simple au double en tonnes et de 1 à 2,5 en valeur. Même constat à Kaya, où les tailles moyennes des fermes des deux premiers quarts sont identiques alors que les recettes des ventes triplent dans le deuxième quart.
Un autre facteur est fortement lié aux ventes alimentaires : le nombre de bœufs de labour et de charrues par ferme. A Dédougou, 65 % des fer-mes disposent de bœufs de labour, contre 39 % à Fada et 34 % à Kaya. Ce qui met sur la piste d’un facteur décisif : les moyens financiers des fermes. Dédougou est mieux doté en bœufs de labour grâce à des systèmes de crédit disponi-bles aux exploitations cotonnières. L’impact du crédit d’investissement agricole – ici, le « crédit-coton » de la Sofitex – sur le niveau technologi-que des exploitations est clair au Burkina Faso. En dehors des producteurs de coton, l’accès au crédit institutionnel est faible : de 10 à 15 % des unités de production agricole dans chacune des trois régions.
Cette donnée lève le voile sur un paradoxe apparent : ce sont les fermes de la région co-tonnière de Dédougou qui dégagent le plus de surplus vivriers commercialisables. Au point que les ventes alimentaires du quart des fer-mes aux plus fortes ventes dépassent largement celles du coton. Très orientées vers le marché, elles ont dû sentir le vent tourner, délaissant le coton pour se concentrer sur des cultures plus rémunératrices.
De plus, consultés sur les freins à leur pro-duction, les paysans citent la traction animale et la fumure organique et/ou minérale comme principaux facteurs limitants, ce qui démontre leur lucidité sur leur situation.
Créer un climat de stabilité du marché
Ces constats suggèrent qu’un système de crédit d’investissement agricole aiderait à ac-croître la production et les ventes des agricul-teurs. Il financerait des investissements pro-ductifs des exploitations agricoles à moyen terme (4-6 ans) à un taux d’intérêt subven-tionné par l’Etat. Le crédit d’investissement a prouvé son efficacité en Europe pour encou-rager la modernisation des exploitations et améliorer leur production. Avec ce système, la plupart des agriculteurs accéderaient à la culture attelée : deux boeufs, charrue, charret-te, multiculteur. Avec une chaîne de traction animale, chaque producteur peut accroître, en deux à trois ans, d’au moins 50 % les surfaces cultivées par unité de travail.
Quart des fermes qui
vendent le moins
Quart suivant
Quart suivant
Quart des fermes qui
vendent le plus
DédougouCoton 125 317 444 540
Vivrier 34 132 327 1120
Fada N’Gourma
Coton - 0,5 84 224
Vivrier 36 126 401 1460
KayaCoton 3 0,5 15 6
Vivrier 34 103 283 833
Ventes en euros /an
Ventes alimentaires en tonnes de graines : céréales (maïs, mil, sorgho, riz), protéagineux (niébé, soja, pois de terre) et oléagineux (sésame et arachide)
0
1
2
3
4
5
6KayaFada N’GourmaDédougou
Quart des fermes qui vendent le plus
Quart suivantQuart suivant Quart des fermes
qui vendent le moins
Gil
Duc
omm
un
Couleurs locales au marché de Dédougou
40

DOSSIERLaRevueDurable N°20
la sauce du tô est plus chère que celle qui ac-compagne le riz et, surtout, sorgho et mil sont beaucoup plus longs à préparer que le riz. En outre, le riz importé gagne du terrain sur le riz local : plus déshydraté, il gonfle plus à la cuisson et sa couleur très blanche est plus attirante.
« Passer du tô au riz blanc importé est un saut de statut social », déclare un observateur à Ouagadougou. Pain blanc, riz blanchi importé et farine de maïs blanc symbolisent un statut so-cial et culturel plus élevé. Cette tendance pose de sérieuses questions de santé publique car, com-parés aux céréales traditionnelles, ces aliments sont pauvres en protéines, en sels minéraux et en fibres. Par ailleurs, la bière de malt importée est en passe d’évincer la bière traditionnelle, le dolo, à base de sorgho rouge.
Ainsi, les mesures de politique agricole doi-vent se doubler d’une stratégie de transforma-tion des céréales locales pour proposer aux con-sommateurs urbains des produits plus adaptés à leurs besoins : aliments faciles à cuire, pâtes alimentaires fabriquées à base de mil ou de sor-gho, dolo pasteurisé, etc.
Mais au Burkina Faso, les grandes fortunes se font dans l’import-export et l’immobilier. En dehors du coton, l’agriculture familiale importe peu aux dirigeants politiques et économiques, d’ailleurs souvent issus des mêmes familles. Les chercheurs suisses et burkinabés ont présenté les résultats de cette enquête et leurs recommanda-tions de politique agricole et agroalimentaire à l’Assemblée nationale, aux autorités, aux or-ganisations paysannes et syndicats début 2005. Depuis, rien ne se passe. g
Mil, sorgho et séchage du sorgho après la récolte
Pour fonctionner, un tel système suppose que l’agriculteur puisse calculer ses revenus à moyen terme. Or, la désorganisation des marchés empêche toute planification. Les prix sont d’une volatilité inouïe due en partie à un régime des pluies irrégulier et l’exploitant ne peut pas savoir combien il pourra retirer de sa récolte. Une année de disette peut succéder à une bonne année qui a vu les prix s’écrouler. En agriculture, une surproduction de 5-10 % par rapport à la demande peut faire s’effondrer le prix de 30 %, ce qui est catastrophique. D’où le besoin urgent d’organiser le marché vivrier burkinabé au même titre que celui du coton, en garantissant des prix minimaux. Survient alors un autre impératif : assurer l’écoulement des produits agricoles.
A Ouagadougou, le riz des fermiers locaux est compétitif avec le riz provenant des Etats-Unis : leurs prix sont semblables, de 0,35 à 0,5 euro/kg. Mais les commerçants réalisent des marges supérieures et plus faciles avec le riz importé et ne commercialisent de ce fait que rarement du riz local.
Pour corriger cette situation, le gouverne-ment devrait introduire une taxe variable à l’importation des céréales et produits dérivés. Cela donnerait un revenu supplémentaire à l’Etat et réduirait les marges des importateurs. Ils seraient alors plus enclins à commercialiser des céréales nationales, tandis que le prix aux consommateurs resterait inchangé. Les pro-ducteurs burkinabés pourraient ainsi vendre
Abolir la rente des importateurs
Certains paysans seraient déjà en mesure de produire plus : ils ont des épargnes sous forme de bétail qu’ils pourraient transformer en capi-tal plus productif. Mais ils ne le font pas, car ils craignent de ne pas pouvoir écouler leur pro-duction en cas d’excédents, à cause des impor-tations agroalimentaires en pleine croissance.
En moyenne des années 2000 à 2002, le Bur-kina Faso a importé pour 60 millions d’euros de céréales. Et depuis dix ans, sa facture alimentaire s’alourdit. De 1992-1994 à 2000-2002, il a plus que doublé ses importations de riz (passant de 82 000 à 169 000 tonnes par an en moyenne), augmenté de 40 % ses achats de blé (de 32 000 à 45 000 tonnes) et multiplié par huit ses impor-tations de maïs (de 2600 à 19 000 tonnes).
En 2001 et 2002, les récoltes céréalières re-cord n’ont pas empêché les importations de maïs et de riz d’atteindre des volumes histo-riques. Les greniers des paysans étaient pleins, mais les vivres importés affluaient en masse. Huit à neuf années sur dix, le Burkina Faso produit suffisamment ou trop de céréales com-paré à la demande intérieure.
leurs céréales de base à un prix minimal ré-munérateur.
Cette protection modérée de la production agricole nationale face à un marché mondial subventionné ne coûterait rien à l’Etat ni aux consommateurs et réduirait la facture d’im-portation. Seuls les importateurs de céréales, de farines et de pâtes alimentaires en pâtiraient en subissant une baisse de revenu. En revan-che, les agriculteurs et les PME agroalimen-taires bénéficieraient de revenus supérieurs ou du moins stabilisés. Auprès de l’Organisation mondiale du commerce, cette protection mo-dérée de la production vivrière nationale serait présentée comme une légitime compensation des subventions agricoles et à l’exportation des pays exportateurs.
Le désintérêt des élites
Cependant, une taxe sur les importations ne résoudrait pas tous les problèmes d’écoulement des produits locaux. Car les produits importés séduisent de plus en plus les Burkinabés ur-bains. En ville, la population se détourne du tô, plat traditionnel à base de la farine de mil ou du sorgho, au profit du riz. Pour deux raisons :
Gil
Duc
omm
un
41
biblio Gra Phie
Ducommun G et coll. Commercialisation vivrière paysanne, marchés urbains et options politiques au Burkina Faso. Rapport final de synthèse du projet de recherche Tasim-Ao, Haute école suisse d’agronomie, Zollikofen/Berne et Cedres (Centre d’études, de docu-mentation et de recherche économiques et sociales), Université de Ouagadougou, 2005.
Disponible sur : www.shl.bfh.ch (taper « tasim-ao » dans la rubrique « recher-che rapide »).

DOSSIER LaRevueDurable N°20
Marc Dufumier*
La paysannerie familiale est capable d’intensifier la production agricole
Nourrir 9 milliards d’hommes d’ici 2050, le défi est de taille. Pour le relever,
les paysanneries du tiers-monde font preuve d’une grande créativité pour
intensifier leur production tout en préservant l’environnement. Mais la
recherche et les politiques agricoles ne valorisent pas assez cette inventivité
pourtant cruciale pour l’avenir.
Plus des deux tiers des 852 millions de person-nes qui ne mangent pas à leur faim vivent dans une famille paysanne qui cultive une toute petite exploitation. Ces familles sont équipées d’outils uniquement manuels et leurs systèmes de cul-ture et d’élevage ne suffisent pas pour qu’elles puissent se nourrir elles-mêmes ou s’offrir des achats alimentaires. Appauvri ou endetté à l’ex-trême, le tiers restant s’entasse dans les bidon-villes sans y trouver d’emplois rémunérateurs. C’est donc en accroissant la productivité et les revenus agricoles des paysans les plus pauvres que l’on réduira la prévalence de la faim et de la malnutrition dans le monde. Or, des exemples en Afrique et en Asie montrent que ces paysan-neries possèdent le savoir-faire pour intensifier l’agriculture par la voie biologique.
par habitant ne diminuent quasiment pas du-rant cette période. Les paysans intensifient leur production en cultivant maïs, haricots, patates douces, manioc, taros, courges, ricin, etc. dans la même parcelle. Ces espèces présentant en général des ports et des enracinements complé-mentaires et des durées de cycle très différents, elles se concurrencent peu pour la lumière, l’eau et les éléments minéraux du sol. La densité des feuillages, de toutes tailles et hauteurs, intercepte au mieux l’énergie solaire. Les travaux agricoles sont aussi mieux répartis sur l’année et les terres sont en permanence protégées.
Bien sûr, la réduction des surfaces pâturées et la diminution corollaire du nombre des ru-minants réduit les apports en déjections ani-males sur les terres de plus en plus intensément cultivées. Mais là encore, les paysans ont trouvé la parade : planter des arbres qui puisent les mi-néraux dans les couches plus profondes du sol. Ces nutriments se retrouvent dans les feuilles de ces arbres. Lors de leur chute, elles se dé-composent et fertilisent la couche arable. Les feuilles de l’arbre Grevillea et de bananier, de même que les résidus du pressage des bananes pour l’extraction du jus destiné à la fabrication de bière fertilisent notamment des plantations de caféiers. Ainsi, les terres assolées n’ont pas encore connue une véritable crise de fertilité malgré les prélèvements accrus d’éléments mi-néraux dont elles font l’objet.
De l’abattis-brûlis aux « agro-forêts » indonésiennes
Dans les années 1970-80, en très peu de temps, des pays structurellement déficitaires (Viêt Nam, Indonésie, Philippines) devien-nent autosuffisants en riz, parfois même ex-portateurs. Mais le défi reste entier pour le Sud-Est asiatique : faire vivre plus de 500 mil-lions d’habitants sur seulement 4,5 millions de km2 alors que des régions montagneuses occupent 70 % de la superficie.
Les populations se concentrent dans les vallées, les plaines et les deltas, où la rizicul-ture inondée est aisée. Mais de nombreuses régions montagneuses restent le siège d’une agriculture pluviale sur abattis-brûlis. Ce sys-tème consiste à brûler la forêt pour débrous-sailler la parcelle et fertiliser la terre avec les cendres. La parcelle est cultivée pendant deux ans puis laissée à l’abandon. Pendant la pé-riode de repos, les essences repoussent et le couvert forestier est rétabli.
* Marc Dufumier est professeur à l’Institut national agrono-
mique de Paris-Grignon, en France.
L’intensification dans la région des Grands Lacs
Sur les hautes terres de l’Afrique des Grands Lacs, la densité démographique, d’environ 100 habitants/km2, fait plus que doubler de 1960 à 1990. La production vivrière suivant une pro-gression similaire, les disponibilités alimentaires
Ce type d’agriculture est viable tant que les densités démographiques restent faibles. Sur les surfaces laissées en friche après deux ou trois années de mise en culture, les recrûs spontanés sont d’âge variable et hébergent des espèces végétales et animales fort différentes. La biodiversité y est bien plus ample que dans les forêts denses aux alentours. Mais lorsque les populations sont obligées de diminuer la durée des recrûs à moins de quinze ans, les terres deviennent des savanes et la forêt ne re-pousse plus. Il ne reste plus qu’à en faire des pâturages. La pression démographique con-duit aussi à étendre les zones d’abattis-brûlis aux dépens des forêts primaires.
Jean
de
La T
our
Kawthoolei, en Birmanie : les ouvertures dans la forêt signalent la proximité d’un village
Jeunes cacaoyers à l’ombre de bananiers ;en bas à gauche, jardins boisés en Haïti
42M
arc
Duf
umie
r
Mar
c D
ufum
ier

DOSSIERLaRevueDurable N°20
La question agite les experts. Laquelle est la plus productive : la petite agriculture familiale ou les grandes exploitations mécanisées ? L’évidence va dans les deux sens, selon le type de culture (Cotula et coll., 2006). Les cultures de céréa-les, de canne à sucre ou de soja, par exemple, se prêtent bien à la mécanisation et ont un meilleur rendement dans les grandes exploi-tations. En revanche, les cultures pérennes (vigne, café, cacao, etc.), les fruits et les légumes nécessi-tent beaucoup de main-d’œuvre et limitent les possibilités de mécani-sation. Pour ce type de cultures, les petites structures sont plus effica-
ces, car les agriculteurs sont plus motivés que les salariés des gran-des exploitations et les ressources sont mieux utilisées.
En Indonésie, 80 % du caoutchouc naturel et 95 % des fruits provien-nent des vergers de petits paysans. Au Brésil, l’agriculture familiale génère 40 % de la production agri-cole (en valeur) et 77 % de l’em-ploi agricole sur seulement 30 % des terres cultivées alors qu’elle ne reçoit que 25 % des crédits agricoles (PCFS, 2006). Et les petits paysans gèrent leur capital naturel, dont dépend leur survie, bien mieux que les autres. Aux Etats-Unis,
les petits agriculteurs consacrent 17 % de leurs exploitations aux zo- nes boisées, contre 5 % dans les gran-des exploitations. Les petites exploi-tations consacrent près de deux fois plus de terres à des cultures qui protègent et enrichissent le sol.
Malheureusement, les rapports commerciaux pénalisent les petites fermes. Les acheteurs préfèrent trai-ter avec quelques gros fournisseurs qu’avec une myriade de petits. Le centre de distribution de Carrefour de Sao Paolo dispatche des melons dans tous les points de vente de la chaîne française au Brésil et dans les centres de distribution de 21
autres pays. Ce centre, qui dessert un marché de 50 millions de con-sommateurs, s’approvisionne en melons auprès de trois producteurs ! Toujours au Brésil, les douze plus grands transformateurs de lait ont biffé 75 000 petits producteurs de leurs listes de fournisseurs de 1997 à 2001, les précipitant probable-ment dans la faillite. En Thaïlande, la principale chaîne de supermar-chés a ramené ses fournisseurs de légumes de 250 à 10 en moins de cinq ans (FAO, 2004). Les petits ne peuvent tenter de tenir qu’en s’or-ganisant en coopératives.
LRD
Small is beautiful but difficult
A Sumatra et aux Célèbes, deux îles indo-nésiennes, certaines paysanneries ont réussi à intensifier leur agriculture et nourrir une po-pulation croissante sans savanisation ni ouvrir de fronts pionniers dans la forêt vierge. Leur stratégie s’appuie, comme dans la région des Grands Lacs, sur la complémentarité entre cultures vivrières et plantations arboricoles pérennes qui remontent les nutriments depuis les couches profondes du sol. Ces paysanneries protègent et favorisent le développement de certaines espèces spontanées au sein des recrûs forestiers après la dernière récolte de plantes
vivrières annuelles. La friche arbustive puis arborée s’enrichit peu à peu en espèces utiles, très régulièrement exploitées aujourd’hui.
Ainsi en est-il, par exemple, de diverses car-damomes, du mûrier à papier, des aliboufiers à benjoin, de nombreux palmiers, etc. Autant d’arbres qui apportent des revenus : l’écorce du mûrier à papier sert à fabriquer du papier de luxe, la cardamome est une épice et une plante médicinale. Dans certaines régions de Suma-tra, de véritables « agro-forêts » à hévéas ou à damar se développent désormais sur les terres
exondées à côté des rizières. Ces systèmes s’ac-commodent de densités de 150 habitants/km2.
Au sein même des zones de rizières, des agri-
culteurs au centre du Cambodge et du sud de la Thaïlande sont parvenus à embocager leurs terroirs en établissant des palmiers à sucre sur les diguettes. Leur sève est exploitée pour en extraire du sucre. Leurs racines explorent des couches du sol situées en dessous de celles des plants de riz.
Des systèmes de cultures annuelles sous
couvert de parcs arborés de légumineuses sont
Jean
de
La T
our,
2x
Culture du riz sur brûlis à Kawthoolei : des concombres et du coton s’intercalent entre les rangs de riz
La culture sur brûlis est un fait culturel pour des milliers de paysans
43

DOSSIER LaRevueDurable N°20
pratiqués dans plusieurs régions semi-arides de l’Inde, au Rajasthan, dans le Gujarat et sur le plateau du Deccan. Dans ces zones, les agri-culteurs s’accordent pour respecter certaines règles communes sur la gestion des finages villageois, la conduite des animaux et la pro-tection des jeunes arbres, avec parfois la mise en défens provisoire de quelques espaces. Ici encore, les arbres sous la frondaison desquels il est possible de cultiver des plantes annuelles remplissent diverses fonctions : fourniture de bois de chauffe et de fourrages, fixation bio-logique de l’azote de l’air, apports de matières organiques lors de la chute des feuilles, brise-vent, ombrage, etc.
En Thaïlande et aux Philippines, les sesbanias sont des légumineuses parfois cultivées au sein des rizières, en général en contre-saison (après la récolte du riz), parfois en pleine saison rizicole en association avec le riz : elles ont pour avantage de fixer l’azote de l’air grâce à des nodules si-
tués sur leurs tiges et non sur les racines, qui ne peuvent avoir accès à l’air dans des rizières inondées.
L’Acacia albida au secours du Sahel
La mise en œuvre de systèmes de produc-tion agricole intensifs et diversifiés paraît bien plus difficile dans les régions intertropicales semi-arides où les écosystèmes originels sont eux-mêmes beaucoup moins riches en espèces et variétés. Mais ici encore, il faut reconnaître une très grande diversité de situations, avec par endroits des sociétés agraires capables de produire tous les ans des céréales et des légu-mineuses alimentaires sur les mêmes surfaces de terrain sans avoir à les laisser périodique-ment en friches.
Une telle intensification des systèmes de culture est possible dans les quelques régions de l’Afrique sahélo-soudanienne où sont en-tretenus des parcs arborés d’Acacia albida qui, grâce à leur production fourragère et leur ap-port de matières organiques qui maintient le taux d’humus et la fertilisation des sols en élé-ments minéraux, permettent d’associer étroi-tement l’agriculture et l’élevage.
De l’ordre des légumineuses, ces arbres, dont l’enracinement puissant peut atteindre la nappe phréatique, prélèvent du calcium, du phosphate et de la potasse dans les cou-ches profondes du sol tout en développant un feuillage riche en azote pendant la saison sèche. Ils perdent leurs feuilles en tout début de sai-son des pluies, fertilisant la couche superficielle des sols au plus grand profit des cultures cé-réalières qui n’ont plus à craindre un ombrage excessif. La présence d’Acacias albida dans les champs cultivés permet souvent de doubler le rendement des céréales (mil, sorgho, etc.) se-mées sous leur frondaison, comparé à celles implantées dans les espaces interstitiels.
En partie élagué en saison sèche, le feuillage des Acacias albida procure un fourrage parti-culièrement riche en protéines aux bovins qui circulent librement sur les terrains soumis à la vaine pâture. Ce pâturage aide à multiplier ces arbres : le passage des graines dans le tube digestif des bovins qui s’alimentent des gousses pendues aux arbres lève leur dormance. Dans les régions peuplées par les Sérères au Sénégal, les Mossis au Burkina Faso et les Haoussas au Niger, les paysans sédentaires sont ainsi très vite parvenus à entretenir des bovins dans leurs unités de production sans avoir à les confier à des éleveurs transhumants.
Ces régions comptent parmi les plus den-sément peuplées de l’Afrique sahélo-souda-nienne, avec souvent plus de 80 habitants/km2. Mais les troupeaux éprouvent de grosses dif-ficultés à ne pas surexploiter le parc d’Acacia albida avec un émondage trop intense et trop
précoce des branches, avant que les graines ne soient totalement formées. Les sociétés concer-nées affrontent des problèmes de détérioration des écosystèmes avec une baisse sensible de la fertilité des sols et une diminution inéluctable des rendements de mil, sorgho et légumineuses alimentaires, qui peinent aujourd’hui à dépas-ser les 500 kg/ha.
Les parcs arborés à karité, néré et tamari-nier protègent les sols de l’érosion et entre-tiennent leur fertilité dans certaines régions de savanes soudaniennes au sud du Mali et du Burkina Faso. Ils fournissent une grande gamme de produits utiles aux sociétés rurales, mais font de l’ombre aux cultures annuelles et ne servent pratiquement pas de fourrage pour les animaux.
Repenser la recherche agronomique
Longtemps, toutes les inventions agricoles étaient le fait des paysanneries elles-mêmes. Cela a commencé par la sélection des espèces, races animales et variétés végétales les plus adaptées aux écosystèmes dans lesquels on a voulu privilégier leur croissance et leur déve-loppement pour répondre aux besoins de la so-ciété. Aujourd’hui encore, de nombreux paysans du monde s’efforcent, avant chaque cycle de production, de sélectionner les semences et les animaux reproducteurs dont ils peuvent espérer que la descendance réponde aux besoins des po-pulations ou aux exigences du marché (valeur boulangère, qualités organoleptiques, longueur des fibres textiles, etc.) compte tenu de l’écologie des systèmes de culture ou d’élevage.
A gauche, Sesbania rostrata ; à droite, Acacia albida (Mali)
44M
arc
Duf
umie
r, 2x

DOSSIERLaRevueDurable N°20
Depuis le néolithique et durant des siècles, les agriculteurs ont ainsi créé de très nom-breuses races et variétés, chacune adaptée à un écosystème particulier. Il en résulte une très grande diversité génétique adaptée à une large panoplie d’écosystèmes, une multitude de va-riétés ou races qui portent souvent le nom de leurs localités d’origine.
Les exemples ne manquent pas de situations où les paysans ont su mettre au point des systè-mes de production agricole hautement diversi-fiés, à l’opposé des systèmes mis en œuvre dans
les grandes exploitations capitalistes à salariés et les exploitations familiales soumises à la « ré-volution verte ». Mais les instituts de recherche et de développement officiels publics et privés étudient trop peu ces systèmes.
biblio Gra Phie
Cotula L, Toulmin C, Quan J. Policies and Practices For Securing and Improving Access to Land. International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (Icarrd), 2006. Disponible sur: www.icarrd.org
Organisation des Nations unies pour l’a-griculture et l’alimentation (FAO). State of food Insecurity in the World, Rome, 2004.
Planning Committee for Food Sovereignty (Pcfs). Agrarian Reform in the Context of Food Sovereignty, the Right to Food and Cultural Diversity: Land, Territory and Dignity, Icarrd, 2006.
Les citoyens de chaque pays ou groupe de pays devraient avoir le droit et les moyens de produire en leur sein la plus grande part de leur alimentation, avec un véritable contrôle conjoint des Etats, des paysans et des consom-mateurs sur la production et la qualité des produits. Les prochaines négociations inter-nationales au sein de l’Organisation mondiale du commerce devraient consacrer le droit des peuples à appliquer le principe de précaution dans les échanges agroalimentaires et à pro-mouvoir la vente de « produits de terroirs ». L’alimentation est une chose beaucoup trop sérieuse pour rester sous l’emprise des seules « lois » du marché, a fortiori quand on sait que ce sont de grandes firmes en position de quasi-monopoles qui les dictent. g
Dans ce jardin, une communauté karen, en Birmanie, cultive des palmiers à noix de coco
et des plantes médicinales
Jean
de
La T
our
45
Un gratuit dans les campagnes africaines
Au Kenya comme ailleurs, la publicité des multinationales de la chimie et du génie généti-que inonde les journaux agrico-les. Pour informer les paysans sur les avancées de l’agricul-ture biologique, le Centre international pour l’étude des insectes (Icipe), basé à Nairobi, a créé un journal gratuit, The Organic Farmer (Tof). Tous les mois depuis avril 2005, 12 000 exemplaires d’un cahier de huit feuilles A4 en couleurs et en anglais irriguent les cam-pagnes du pays. Le bouche-à-oreille a fonctionné jusqu’en Tanzanie, en Ouganda et au Zimbabwe, où des groupes de paysans se sont abonnés. Au Kenya, 980 groupes de paysans le reçoivent. La diffusion se fait aussi via les écoles agricoles, les dépendances de l’Icipe et les églises. Les éditeurs estiment que 70 000 paysans lisent Tof.
Journaliste de 63 ans, cor-respondant pour l’Afri-que du journal zurichois Tages Anzeiger de 1994 à 2004, Peter Baumgartner est la cheville ouvrière de Tof. En 1996, il fonde un foyer pour orphelins du sida dans un bidon-
ville de Nairobi. Aujourd’hui, il édite Tof avec son collègue kenyan Peter Kamau. « En général, les petits paysans uti-lisent peu de chimie dans leurs parcelles parce qu’ils sont pau-vres et sceptiques. Notre rôle est de leur donner toutes les informations utiles pour qu’ils puissent augmenter leur pro-duction sans nuire à l’homme ni à l’environnement », indi-que Peter Baumgartner.
Le journal regorge de con-seils pratiques. Pour trouver des réponses à des questions urgentes, les lecteurs peuvent envoyer des SMS au journal. Selon une enquête réalisée en mars, les lecteurs de Tof exploitent en moyenne de 0,5 à 2 hectares de terre. Ils se disent très satisfaits, mais réclament davantage de photos et de des-sins techniques. Une majorité
souhaite lire le journal dans sa langue, mais cela paraît difficile vu la richesse linguis-tique du pays. La demande de conseils pratiques est telle que Tof compte en fournir sur les énergies renouvelables, car la raréfaction du bois de chauffe préoccupe beaucoup ses lec-teurs.
Le journal ne se limite en outre pas à informer. Conscients que l’union fait la force, ses éditorialistes invitent les pay-sans à se rassembler pour dis-cuter du contenu du journal, expérimenter de nouvelles méthodes, commercialiser des produits. Pour fêter sa première année, Tof offre à dix groupes de paysans la certification bio-logique. Pendant trois ans, une centaine de paysans auront droit à des conseils techniques et leurs frais de certification réglés. En parallèle, Tof a négo-cié des accords de commer-cialisation avec trois chaînes de supermarchés locales pour écouler leur production à un prix plus élevé que ceux des produits conventionnels.
LRD
POUR ALLER PLUS LOIN
Dufumier M. Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, Paris, Karthala, 2004.
The Organic Farmer est une lecture pleine de fraî-cheur et d’espoir. Tous les numéros sont consulta-bles sur le site : www.biovision.ch
Bio
visi
on

Marc Hufty*
Le soja en Amérique du Sudou le cauchemar de Humboldt
En apparence, la culture du soja
est une chance pour l’Argentine,
la Bolivie, le Brésil et le Paraguay.
Elle apporte à ces pays une manne
financière bienvenue. Mais ses con-
séquences pour la forêt, le sol, la
biodiversité, l’eau et – surtout – les
populations locales rendent cette
réussite économique dérisoire.
Quelques mouvements d’opposi-
tion tentent de faire entendre leur
voix, mais ils restent démunis face à
la demande mondiale de soja.
DOSSIER LaRevueDurable N°20
* Marc Hufty est enseignant-chercheur à l’Institut universi-
taire d’études du développement (IUED), à Genève.
La technique est impressionnante d’effica-cité : deux bulldozers avancent de front reliés par une chaîne d’acier qui arrache toute végé-tation sur son passage, y compris des arbres centenaires. Plus tard, le feu sera mis et ce qui reste sera dégagé pour faire place à un champ de soja à perte de vue.
Le soja est une « plante miracle ». Sa fève contient jusqu’à la moitié de protéines et don-ne une huile qui entre dans la composition d’une multitude de produits alimentaires et industriels. Un quart des huiles alimentaires consommées dans le monde en provient et le bétail européen se nourrit de soja en com-plément du maïs (voir l’article de Christian Mouchet, page 48). Cette légumineuse con-naît un tel succès qu’une augmentation de la demande mondiale de 50 % est attendue dans les quinze prochaines années. Pour la seule Amérique du Sud, si la tendance reste constante, une surface égale à quatre fois la Suisse sera convertie au soja.
En réponse à cette demande, principa-
lement européenne et chinoise, quatre pays d’Amérique du Sud – Brésil, Argentine, Para-
guay et Bolivie – sont devenus d’importants producteurs de soja. De presque nulle en 1960, sa production est passée à près de 100 millions de tonnes en 2005. Le Brésil et l’Argentine sont aujourd’hui les deuxième et troisième produc-teurs mondiaux après les Etats-Unis. Plus de 40 millions d’hectares de terres sud-américai-nes sont désormais consacrés à cette mono-culture. En Argentine, elle occupe plus de la moitié des terres cultivées.
Le boom du soja génère d’importants reve-nus aux gouvernements de ces pays. Il leur a permis le retour à la croissance, le rembourse-ment des dettes et le financement de mesures sociales. La culture du soja est aussi très ren-table pour les agriculteurs qui peuvent, dans de bonnes conditions, avoir un rendement de 35 à 50 % par an. Les attraits du soja ne manquent donc pas. Mais le soja a aussi une face sombre : il génère de graves problèmes environnementaux et sociaux.
Le soja contre la forêt
L’appétit pour le soja provoque une défo-restation à grande échelle : au Brésil, en 2002, il a causé la suppression de 700 000 hectares de forêt. En l’absence d’aménagement du territoi-re, l’avancée de la frontière agricole ne respecte
qu’une loi, celle du plus fort. Les terres pour la culture du soja sont gagnées essentiellement sur la forêt atlantique du Brésil et du Paraguay, les savanes arborées du Cerrado brésilien, le chaco argentin et paraguayen, les yungas argentines et la forêt chiquitana bolivienne, véritables trésors mondiaux de diversité biologique.
Acclimatée aux conditions tropicales par les chercheurs brésiliens, la production de soja ga-gne désormais le bassin amazonien. Alexandre von Humboldt, savant et explorateur prussien qui, le premier, a répertorié la biodiversité du continent sud-américain dans les années 1799-1804, doit se retourner dans sa tombe : ce sont des millions d’années d’évolution naturelle qui sont balayées sous l’effet de l’explosion du commerce mondial du soja.
Si le soja brésilien est à 70 % conventionnel, le soja argentin est presque entièrement trans-génique, ce qui, outre les risques spécifiques liés à ce type de culture, entraîne des problèmes d’épandage des herbicides. Le soja est généti-quement modifié pour tolérer un herbicide to-tal, le glyphosate de la marque Roundup Ready. Les pulvérisations aériennes de cet herbicide tuent toutes les plantes sauf celles qui ont été génétiquement modifiées pour le tolérer. Les haies vives de trente mètres de large séparant les
Georges Bartoli - CCFD
46

DOSSIERLaRevueDurable N°20
champs de soja conformément à la loi ne peu-vent résister sur la durée à un tel traitement : elles périclitent petit à petit. La culture du soja transgénique transforme le paysage en déserts biologiques dédiés à cette monoculture.
En Argentine, de mauvaises herbes tolé-rantes au glyphosate étant apparues, les agri-culteurs ont dû multiplier les épandages de désherbant. Sous l’effet de l’agrandissement de la surface cultivée en soja et des toléran-ces accrues des plantes sauvages, les quantités utilisées ont décuplé, passant de 14 millions de litres en 1997 à 150 millions en 2003. Cette augmentation est associée à de nombreux cas d’empoisonnements des populations riverai-nes et de dommages aux cultures traditionnel-les des petits paysans.
Les chercheurs du Groupe d’écologie du paysage et de l’environnement (Gepama) de l’Université de Buenos Aires étudient l’expan-sion de la culture du soja depuis l’autorisation des organismes génétiquement modifiés en 1996. Ils observent la déforestation, en particu-lier celle de l’écorégion du Chaco, immense plaine chaude et sèche dotée d’une végétation d’épi-neux, qui s’étend de la Bolivie au Paraguay et à l’Argentine sur plus d’un million de kilomètres carrés. Hostile à la vie humaine, le Chaco abrite une importante diversité biologique, et de nombreux groupes autochtones persécutés y ont trouvé refuge. C’est aujourd’hui une des frontières agricoles que le soja ne cesse de faire reculer.
Le manque de données empêche d’évaluer les conséquences écologiques de la disparition ou de la fragmentation de ces écosystèmes, estime le Gepama. L’impact de l’utilisation des herbicides sur les nappes phréatiques ou sur les sols n’est pas connu. La déforestation avance plus vite que les capacités d’identifier les nombreuses espèces non répertoriées. Des études en cours dans la province de Salta ré-vèlent que la surface cultivée en soja s’accroît régulièrement, mais que la production stagne, ce qui signifie une baisse de productivité des terres, malgré les fertilisants. Ces terres fragiles risquent de se convertir à terme en désert. Ces scientifiques demandent une pause dans cette
déforestation aveugle ou, tout au moins, une planification permettant de maintenir intacts des écosystèmes représentatifs, ne fut-ce qu’à titre de valeur d’option.
Le soja contre les pauvres
Quelques grands acteurs dominent la pro-duction, la transformation et le commerce du soja. Quatre multinationales contrôlent les ex-portations sud-américaines : Archer Daniels Midlands, Bunge, Cargill et Dreyfus. Pendant les années 1980, des exploitations de 30 hecta-res dans le sud du Brésil profitaient du boom. Depuis, le centre de gravité de la production s’est déplacé vers le centre-ouest (Matto Gros-
so et Goias), où les unités de plus de 1000 hectares sont la norme. Une entreprise, Andre Maggi, cultive à elle seule 150 000 hec- tares. Cette agriculture indus-trielle est surtout intensive en capital et fait disparaître les em-plois ruraux. Elle ne nécessite
qu’une personne pour 200 hectares alors que la petite agriculture de cette même plante de-mande une personne pour huit hectares.
A vrai dire, le boom du soja remplace les agriculteurs par des investisseurs financiers. A l’aide d’intermédiaires, ils achètent les terres, plantent du soja et engrangent des bénéfices allant jusqu’à 50 % par an. Demain, ils s’en iront vers d’autres produits plus rentables, lais-sant derrière eux une catastrophe écologique et sociale. La culture du soja provoque ainsi un bouleversement social, la terre devient objet de spéculation, les investisseurs font leurs affaires alors que les petits paysans sont dépossédés de leurs terres.
D’innombrables petits paysans ont dû abandonner leurs terres. Souvent illettrés, sans titres de propriété, méconnaissant le droit qui
autorise la possession d’une terre valorisée du-rant plus de dix ans, menacés, trompés, ils vont grossir les rangs des miséreux aux abords des villes ou s’exilent sur des terres encore moins productives. Quelques-uns ont décidé de ré-sister et s’opposent par la force à leur éviction. D’importants mouvements sont nés de cette résistance : le mouvement paysan de Santiago del Estero (Mocase), au nord de l’Argentine, compte plusieurs milliers de membres et fait partie de réseaux internationaux comme Via Campesina.
Au fur et à mesure de l’expansion de cette culture, des voix mettent en question le modèle du « tout soja ». Des chercheurs font part de leurs doutes, des groupes d’opposants s’organi-sent et des solutions sont discutées. Mais tou-tes sont dépendantes de la demande en soja en Europe et en Chine. En attendant, des récoltes record de soja se préparent pour 2006. g
Gre
enpe
ace/
Bel
tra47
Le soja crée un désert
biologique et social
POUR ALLER PLUS LOIN
Centres de recherche :www.gepama.com.ar
Plate-forme soja régionale : www.plataformasoja.org.brwww.agropecuaria.org
Voir, page 61, la campagne « Le soja contre la vie ».

DOSSIER LaRevueDurable N°20
Christian Mouchet*
Dans l’Ouest français, le Réseau Agriculture durable apporte des solutions
Le modèle de l’agriculture productiviste instauré en France durant la seconde
moitié du XXe siècle a permis d’accroître fortement les rendements à l’hectare,
mais au prix de coûts humains et écologiques très lourds. Pour apporter une
réponse viable à cette dérive, des agriculteurs du Grand-Ouest, en France,
se rassemblent en groupes de réflexion et d’innovation au sein du Réseau
Agriculture durable (Rad). Une démarche encore timide, mais encourageante.
Spécialisée dans l’élevage, l’agriculture dans l’Ouest français figure parmi celles qui sont al-lées le plus loin dans la modernisation à marche forcée qui démarre en Europe après 1950. Cet-te industrialisation de l’agriculture répond au choix d’augmenter la productivité pour baisser les prix alimentaires et libérer de la main-d’œu-vre pour construire les villes.
De 1950 à 1980, la forte réduction des effec-tifs de paysans va de pair avec la concentration des moyens de production et la désertification rurale. En 1955, la France totalise environ 2,5 millions d’exploitations. En 2006, il n’en reste que 600 000. Certaines atteignent une superfi-cie de 200 à 300 hectares ou un quota laitier de 400 000 litres, des chiffres encore inimaginables en 1970.
Pour faire basculer ainsi le monde agricole, les nouveaux systèmes mis en place sont en rupture radicale avec le passé. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la très jeune génération d’agriculteurs étant peu formée, il est décidé de ne pas lui inculquer les principes d’une gestion compliquée et difficile de la natu-re, mais les règles de son artificialisation. Plutôt que de la former aux subtilités de la pousse de l’herbe dans les pâturages, il est jugé plus rapide de lui transmettre des « packages » semences-engrais-pesticides très faciles à utiliser.
Ces systèmes nouveaux ont quatre carac-téristiques fondamentales : l’apport massif d’intrants chimiques (engrais, produits phy-tosanitaires, énergie) et génétiques (semences, souches animales) ; une forte consommation
d’aliments pour bétail provenant de l’extérieur des exploitations d’élevage ; le recours au capi-tal, c’est-à-dire à des machines qui remplacent la main-d’œuvre ; la spécialisation des exploita-tions et l’artificialisation des modalités de pro-duction, de plus en plus distantes de la nature et des ressources qu’elle fournit.
L’exemple emblématique : le maïs
Le prototype du système conçu pour s’abs-traire des contraintes naturelles s’articule autour d’une plante « assurantielle » miracle, le maïs. Elle permet aux vaches qui, en principe, man-gent de l’herbe, de ne parfois jamais en voir un seul brin dans le Grand-Ouest. Le problème est le suivant : sans pluie, l’herbe ne pousse pas, la vache mange moins… et produit moins de lait. Ce qui est incompatible avec les intérêts de l’in-dustriel équipé pour traiter et convertir chaque jour en fromage des dizaines de milliers de litres
de lait. Planté en début d’année, le maïs garantit une récolte de 8 à 12 tonnes de matière sèche à l’hectare. C’est ainsi que, tous les jours de l’an-née, les vaches peuvent manger la même quantité d’aliments et produire la même quantité de lait. Au point que les agriculteurs gèrent leur quota de production annuelle à 1000 litres près.
Toutefois, le maïs contenant peu de protéi-nes, le système ajoute du soja, qu’il faut acheter, car on ne peut pas le fabriquer dans l’exploi-tation. Un accord passé entre les Etats-Unis et le marché commun européen dans les années 1960 interdit de fait le développement des cul-tures de protéagineux en Europe. Les éleveurs importent ainsi de très fortes quantités d’ali-ments pour bétail. Premier pays exportateurs de céréales de l’Union européenne (UE) et troi-
Le visage le plus connu du Réseau Agriculture durable du Grand-Ouest est celui d’André Pochon, paysan charismatique auteur de nombreux livres grand public. De 1954 à 1970, il expérimente avec d’autres agriculteurs des Côtes-d’Ar-mor diverses méthodes de production. Ils découvrent que les prairies produisent davan-tage sans les engrais chimiques qui détruisent le trèfle blanc, légumineuse qui fertilise le sol. Puis ils diffusent leur trouvaille à l’encontre de ce que prône la
recherche officielle, incapable d’accepter le savoir émanant des agriculteurs eux-mêmes.
Dans les années 1970, l’arrivée du maïs relègue les prairies au placard. « Si tu ne faisais pas du maïs, tu étais un attardé », témoigne un cofondateur du Rad. Mais conscients des dégâts que le maïs cause, André Pochon et ses confrères revien-nent à la charge. En 1982, ils créent le Centre d’étude pour le développement (Cedapa). Leur objectif : montrer com-
ment vivre sur de plus petites fermes, installer plus d’agri-culteurs et polluer moins. Des groupes similaires nais-sent dans d’autres régions du Grand-Ouest. En 1994, onze d’entre eux créent le Rad, qui favorise les échanges entre les différents groupes de paysans et fédère leurs revendications. Agronome et sociologue, Estelle Deléage raconte les origines, le parcours et les positions du Rad dans un excellent ouvrage, Paysans de la parcelle à la pla-nète, paru en 2004. LRD
Les origines du Rad
* Christian Mouchet est professeur d’économie rurale
à l’Agrocampus de Rennes, en France.
48

DOSSIERLaRevueDurable N°20
sième exportateur mondial de blé, la France dé-pend des marchés étrangers pour alimenter ses élevages, en particulier du soja.
Deuxième inconvénient majeur : le maïs est une vraie catastrophe écologique. Il néces-site énormément de biocides – notamment de l’atrazine – qui polluent l’air, le sol et l’eau. Il laisse les sols nus l’hiver, favorisant le lessivage des engrais qui partent dans l’eau. De plus, la forte mécanisation dégrade les sols. Et les va-ches nourries au maïs semblent vivre moins longtemps à cause de pathologies du foie. En-fin, le coût énergétique est élevé : il faut envi-ron trois tonnes de pétrole pour fabriquer une tonne d’engrais azoté.
Cette agriculture très polluante et très dé-pendante produit en outre d’énormes excé-dents. Huit des quatorze millions de cochons français vivent en Bretagne, qui compte aussi deux millions de bovins et des centaines de millions de volailles : poulets, dindes, etc. En équivalent déjection, un porc = cinq humains, un bovin = sept humains. Soit, au total, 54 millions équivalents humains de matière orga-nique. Ajouté aux trois millions de Bretons, la pression sur les sols de Bretagne est très forte : ils reçoivent l’équivalent des déjections de près de la population française entière. Tandis qu’en Beauce, où les vaches se font rares, les agricul-teurs manquent de matière organique : ils doi-vent épandre des engrais.
Les agriculteurs ne sont pas les seuls respon-sables de cette situation. La modernisation de l’agriculture est le fruit d’une volonté collec-tive. L’Institut national de la recherche agro-nomique (Inra), créé en 1946, a fourni un ef-fort considérable pour produire des variétés de maïs cultivables en Bretagne, où cette plante ne pousse pas spontanément. Et la Politique agri-cole commune (Pac) va dans le même sens : chaque hectare de maïs donne droit à 350 euros de paiements directs. Résultat : dans les années 1960, il y a moins de 1000 hectares de maïs en Bretagne ; en 2006, il y en a 400 000, soit un quart de la surface totale cultivée.
Ce système transforme une grande partie de la production céréalière, excédentaire, en pro-duits animaux, surtout en porcs et en volailles. Ce qui gaspille les ressources alimentaires. En
fait, le rôle de l’animal dans la société est à re-penser (voir l’article de LRD, page 52) : il fau-drait produire moins de viande, mieux entrete-nir le territoire et gérer les cycles biologiques. De plus, le système délocalise les productions, implique des transports sur de grandes distan-ces et la désaisonnalisation.
Au bilan, cette forme d’agriculture pollue, épuise les ressources, instaure une perte de sens, déséquilibre l’économie à l’intérieur (excédents de céréales et élevages, déséquilibres nutrition-nels) et à l’extérieur (importation de soja). Le résultat est une agriculture non durable, qui puise dans les ressources naturelles de façon quasi minière, économiquement inefficace (excédents, aides) et créatrice de déséquilibres territoriaux. En prime, elle renforce les diffi-
fauteurs de trouble, les producteurs de porcs et de volaille. Leurs exploitations ressemblent en revanche à celles du « modèle classique » en termes de structures : dimension en surfaces et en bâtiments, main-d’œuvre familiale pour l’essentiel, moyens de production équivalents, terres et quotas similaires.
L’objectif du Rad est d’instaurer des sys-tèmes durables dans les conditions actuelles, étant entendu que les évolutions seront fortes dans un futur proche. Cela signifie une recher-che de durabilité agro-écologique, économi-que, sociale et éthique. Dans les conditions des élevages de ces régions, le Rad capitalise les expériences de terrain pour promouvoir des systèmes herbagers économes et respectueux de l’environnement.
Maïs, engrais chimiques et soja (ici importé à
Lorient), piliers d’un modèle agricole non viable…
… auquel les paysans du Rad (ici en Mayenne) cher-
chent à échapper
Ces agriculteurs fondent leur démarche sur au moins quatre principes.
1. Autonomie dans l’approvisionnement de la ferme pour éviter le plus possible le soja, les engrais, les pesticides, les antibiotiques. Le but n’est pas l’autarcie, mais une alternative.
2. Autonomie de décision face aux conseillers qui construisent des systèmes « clefs en main » dans le secret de leurs bureaux et de leurs ordinateurs puis viennent dire aux agricul-teurs ce qu’ils doivent faire. Chacun veut trouver la solution la plus adaptée à son ex-ploitation et à ses ressources. Refus, donc, de tout modèle unique.
cultés des paysanneries du Sud en se mettant en concurrence avec elle et en important des produits de cultures industrielles implantées à la place des forêts et des cultures vivrières (voir l’article de Marc Hufty, page 46).
L’alternative du Rad
Les agriculteurs du Rad s’opposent à cette dérive. Rassemblés en une trentaine de grou-pes organisés en réseau, pour l’essentiel dans l’ouest de la France, ils possèdent une struc-ture centrale à Rennes, où quatre animateurs produisent des études et des publications. Ses membres sont surtout des producteurs de lait et de viande bovine. Rares sont les principaux
julie
nfau
queu
r.com
/pho
to/
49

Les exploitations du Rad produisent moins… et rapportent plus L’herbe, c’est bon pour le bétail, c’est mieux pour l’envi-ronnement, ça crée davantage d’emploi et ça rapporte plus aux agriculteurs que l’affou-rage maïs/soja. La comparai-son des résultats économiques des exploitations du Rad avec ceux d’exploitations « classi-ques » donne une image très positive du Rad (Le Rohellec et Mouchet, 2005). Les deux types de fermes sont des exploita-tions laitières de 54 à 56 hec-tares en Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Sur les 74 fermes de l’échantillon du Rad, treize ont le label Agriculture biologique.
Les fermes du Rad dégagent en moyenne 30 801 euros de résultat contre 20 653 pour les fermes conventionnelles alors que les premières reçoivent 700 euros de subventions de moins que les autres. Ces 10 000 euros de différence viennent de ce que les fermes du Rad ne cherchent pas à obtenir le maximum de lait par vache, mais visent le meilleur équilibre entre pro-duction et coûts. Ainsi produi-sent-elles un peu moins, mais dépensent aussi nettement moins que les autres. Les prai-ries de trèfle blanc sont idéales pour économiser, car le trèfle synthétise l’azote de l’air et,
puisque les vaches y pâturent, elles fertilisent directement le sol avec leurs bouses. Lupin, féverole et pois remplacent avantageusement le soja.
Résultat : les fermes du Rad dépensent 3000 euros de moins pour les engrais, 1500 de moins pour les traitements chimiques, 1000 de moins pour les semen-ces et 4500 de moins pour les ali-ments concentrés. Renoncer au maïs économise 4000 euros en frais de mécanisation. En revan-che, les coûts salariaux sont plus élevés dans les fermes du Rad, qui emploient en moyenne 13 % d’effectifs en plus. LRD
DOSSIER LaRevueDurable N°20
3. Rétablissement d’un lien au territoire sur les plans agronomique et humain. L’idée, alors que de nombreux agriculteurs n’ont pas de salariés et que leur compagne trouve un reve-nu d’appoint hors de la ferme, est de collabo-rer avec l’extérieur pour éviter l’isolement.
4. Recherche de conditions de travail et de vie satisfaisantes : se réaliser dans le travail, déga-ger du temps pour les loisirs, rendre l’activité moins pénible, améliorer sa santé et obtenir une rémunération équivalente à celle des autres agriculteurs, voire meilleure. Le tout accompagné d’une recherche de sens alors que l’agriculture moderne fait des agricul-teurs de simples exécutants.
Le bonheur est dans le pré
Un agriculteur qui souhaite rejoindre le Rad réalise, au sein d’un groupe si possible, un dia-gnostic de durabilité de son exploitation. En général, l’outil employé pour cela est une grille d’indicateurs. Pour les aspects agroécologiques, économiques et sociaux, chacune de ses prati-ques reçoit une note : fait-il des rotations, quels engrais met-il, a-t-il de bons revenus, son ex-ploitation est-elle transmissible, aggrave-t-elle les déséquilibres Nord-Sud, etc. ? Ces grilles res-pectent deux conditions. L’agriculteur doit pou-
pose au moins 150 mètres de haies par hectare. Quand il y en a moins, il les replante, ce qui em-bellit le paysage. Ses conditions de travail sont meilleures : moins de travail et moins de tâches
pénibles. Les animaux sont en bonne santé. Le bilan est très positif.
La Pac défavorise ces agricul-teurs qui, comme les produc-teurs biologiques, ont pourtant un impact positif sur l’environ-
nement, le milieu social et le paysage. Les aides importantes sont attribuées uniquement aux productions de céréales et un peu à la viande bovine. Jusqu’en 2003, aucune aide n’est prévue pour les fourrages classiques comme l’herbe, la luzerne, la betterave fourragère. Un agricul-teur qui diminue ses hectares de maïs perd 350 euros par hectare supprimé. En contrepartie, il ne récupère quasiment rien, car dans les faits, seuls les agriculteurs de montagne peuvent re-cevoir une aide à l’herbe.
Au prix d’un cahier des charges très restrictif, les membres du Rad ont réussi à faire recon-naître que leur pratique donne droit aux aides « agro-environnementales » : ils ont le droit d’appliquer un traitement fongicide et un insec-ticide pour une récolte de céréales alors qu’en moyenne, les traitements sont trois ou quatre fois plus nombreux. S’ils respectent ce cahier, ils ne perçoivent que 137 euros par hectare.
Barrages et limites
L’expérience du Rad comporte de nom-breux éléments positifs, mais aussi des limi-tes. D’abord, elle touche un nombre très faible
voir faire les calculs et les interpréter seul pour que la démarche soit transparente et pédagogi-que. Et l’idée n’est pas de le sanctionner sur la base de ses résultats, mais de localiser ce qui ne va pas pour élaborer une stratégie qui améliore sa situation.
Cette stratégie conduit le plus souvent à limiter le maïs en reve-nant à des principes connus, mais qui ont été écartés. Par exemple, le fait d’associer des graminées (de l’herbe) à des légumineuses (du trèfle blanc) fonctionne très bien localement : cela donne à la vache à la fois l’énergie et les protéines dont elle a besoin. Comme elle mange à l’air libre, il n’est pas nécessaire de lui apporter le fourrage récolté et, surtout, le fait qu’elle fasse ses bouses sur place économise beaucoup de carburant.
L’agriculteur ne peut dès lors pas nourrir autant de bétail, mais il s’en sort, car il produit du lait à moindre coût en réduisant ses charges de fertilisation, ses frais de vétérinaire, ses vo-lumes de produits phytosanitaires et ses coûts énergétiques. Un agriculteur du Rad s’interdit en outre d’avoir des sols nus en hiver pour re-tenir les nutriments. Il pratique des rotations culturales longues (prairies pendant plusieurs années et cultures les années suivantes), s’im-
Le maïs est une
catastrophe
Groupement agricole d’exploitation en commun
à Hillion, dans les Côtes-d’Armor
Rése
au a
gric
ultu
re d
urab
le
50

DOSSIERLaRevueDurable N°20
biblio Gra Phie
Deléage E. Paysans de la parcelle à la planète. Socio-anthropologie du Réseau agriculture durable, Syllepse, Paris, 2004.
Le Rohellec C, Mouchet C. Evaluation de l’efficacité économique d’exploitations lai-tières en agriculture durable. Une comparai-son aux références du Réseau d’information comptable agricole. Rad et Agrocampus de Rennes, 2005.
Pochon A. Les champs du possible. Plaidoyer pour agriculture durable, La Découverte et Syros, Paris, 1998.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Le diagnostic de durabilité du Rad et le guide pour l’appliquer sont disponibles sur le site de l’associa-tion. En répondant à 22 questions, tout chef d’ex-ploitation peut évaluer la situation de sa ferme et entrevoir des mesures pour améliorer ses résultats. Des documents techniques sont en vente sur le site : www.agriculture-durable.org/
Il y a aussi beaucoup de documentation sur le site du Cedapa, qui propose aussi des visites des fer-mes « durables » dans les Côtes-d’Armor : www.cedapa.com
d’agriculteurs : environ 2000 sur un bassin de 150 000. Ensuite, elle ne fait pas l’objet d’aides suffisantes et la recherche agronomique ne fait pas d’effort pour approfondir les techniques qui pourraient améliorer ces systèmes. Il n’y a rien de comparable au gigantesque effort con-senti pour améliorer le maïs.
La recherche agronomique en France, fon-damentale comme appliquée, est hyperspécia-lisée. Une vache qui pâture dans un champ est un objet très complexe. Or, la complexité étant difficile à aborder, elle est délaissée au profit de thèmes très étroits. Une part importante des fonds de la recherche agronomique provient
des groupes semenciers, ceux-là mêmes qui vendent les semences de maïs et n’ont aucun intérêt à ce qu’on puisse s’en passer. Il y a aussi une carence dans l’appui technique à ces ex-ploitations.
Une autre limite du Rad est qu’elle s’ap-plique plutôt aux systèmes de polyculture et d’élevage de ruminants. Très nombreux dans l’Ouest, très dépendants et souvent polluants, les systèmes hors-sol sont peu mobilisés. Il n’y a donc presque pas d’éleveurs de porcs et de volaille, ni de viticulteurs, pourtant eux aussi confrontés à d’importants problèmes de dura-bilité économique et écologique.
Troisième limite : la démarche du Rad n’est alternative que jusqu’à un certain point. Elle re-met moins en cause l’artificialisation de l’agri-culture que les agriculteurs biologiques, qui repensent entièrement leur rapport à la nature. Les agriculteurs du Rad ne reconsidèrent pas non plus les modalités de commercialisation : l’agriculteur livre à un industriel laitier. Certes, il est difficile d’envisager la vente directe lors-qu’on produit 250 000 litres de lait par an, mais cette question mérite d’être explorée. Or, elle ne fait l’objet d’aucune recherche prioritaire. La portée de la critique du modèle agricole do-minant reste donc encore mesurée. g
Le trèfle blanc porte bonheur aux vaches
51

DOSSIER LaRevueDurable N°20
LRD
Il faut manger moins de viande
La production massive de viande dans le monde n’est pas durable : l’alimenta-
tion carnée ou à base d’aliments carnés ou de produits laitiers nuit à la santé,
nécessite des quantités bien trop importantes de surfaces agricoles utiles,
d’énergie et d’eau. Et de toute façon, son extension est incompatible avec
l’objectif de nourrir de 8 à 9 milliards d’humains d’ici 2050.
Question : si 90 % du soja cultivé dans le monde sert à nourrir des animaux qui seront ensuite débités sous forme de steaks, comment faire pour enrayer la progression des surfaces de soja et leur lot de nuisances ? Aussi éviden-te que soit la réponse, elle risque de rester en travers de la gorge de plus d’un amateur de viande. Les appels à interdire le tabagisme dans les lieux publics, à tempérer la con-sommation d’alcool ou à réduire la vitesse au volant sont vécus comme d’insupportables priva-tions dans une société de plus en plus fâchée avec la notion de limite. Pourtant, à l’instar des arguments en faveur d’une modé-ration de la consommation de tabac et d’alcool et d’une diminution de la vitesse sur les routes, ceux en faveur d’une diète moins carnée sont aussi variés que puissants.
Plus sains avec moins de viande
En Suisse, tandis que la consommation de pommes de terre a chuté de plus de moitié de 1950 à 1989, celle de viande par habitant a plus que doublé durant la même période, passant de 40 à 85 kilos par an. Et la même évolution a cours partout, y compris, avec du retard, dans les pays en développement. De quoi faire exploser les coûts de la santé partout dans le
monde : la viande, les produits de la viande et les produits laitiers totalisent la plus forte part de graisses saturées. Or, les nutritionnistes s’ac-cordent à dire qu’elles contribuent à l’essor de plusieurs maladies qui atteignent aujourd’hui les proportions d’une épidémie.
Tous les avis informés insistent sur le besoin de réduire la consommation de produits ani-maux et d’augmenter celle de céréales riches en fibres, de fruits frais et de légumes pour di-minuer l’incidence des maladies du cœur, du diabète et de 30 à 40 % des cancers. L’obésité, l’épidémie du siècle, est elle aussi liée à la con-sommation de produits d’origine animale, mê-me s’il est difficile d’identifier leur responsabi-lité exacte dans cette maladie. Plusieurs études montrent que les végétariens sont en moyenne
plus minces que les non-vé-gétariens, avec une prévalence moindre de l’obésité.
La diète méditerranéenne, tant vantée pour ses effets po-sitifs sur la santé, est plutôt éco-nome en viande rouge et élevée
en légumes, céréales et fruits, avec aussi du poisson. En moyenne, au regard de ce qui est recommandé, la population mange deux fois trop de graisses, sucres et aliments d’origine animale (viande, fromage, œufs, poissons), de-vrait consommer un peu plus de céréales, pâtes alimentaires, pommes de terre, légumineuses et beaucoup plus de fruits et légumes.
Rouler pour moins de viande
Ceux qui pensent aider la planète en ache-tant une voiture « écologique » devraient songer à devenir végétaliens, observent Gidon Eshel et Pamela Martin, de l’Université de Chicago. Ils ont comparé la quantité d’énergie fossile né-cessaire pour cultiver et traiter divers aliments,
faire rouler les machines agricoles, fabriquer les engrais nécessaires pour faire pousser la nourriture pour animaux, la moissonner, la transformer et la transporter. Ils ont compta-bilisé les émissions de méthane dues à la fer-mentation dans l’estomac des ruminants et les émanations d’oxyde nitreux du fumier.
La diète typique aux Etats-Unis, dont en-viron 28 % proviennent de sources animales, génère l’équivalent de près de 1,5 tonne de dioxyde de carbone (CO2) de plus par person-ne par an qu’une diète végétalienne d’autant de calories. Par comparaison, la différence en émissions annuelles entre un conducteur de voiture standard et un conducteur de voiture hybride est à peine supérieure à une tonne de CO2. Le végétalisme est une option extrême dé-conseillée, notamment pour les enfants. Mais ce calcul prouve qu’il est possible de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en privi-légiant certains produits et en évitant d’autres produits.
Expert en émissions de ces gaz, Jean-Marc Jancovici a calculé celles dues à différents produits. Pour visualiser les différences, il les compare à des kilomètres parcourus en voi-ture. Ainsi, 1kg de viande de veau émet autant de gaz à effet de serre qu’un trajet de 220 km en voiture ; 1 kg de bœuf, c’est déjà mieux : 80 km ; 1 kg de gruyère : 60 km ; 1 kg de porc : 20 km ; 1 kg de poulet : 10 km. Les mêmes produits d’origine biologique sont nettement moins polluants, car ils économisent l’énergie des engrais. Le kilo de veau passe à 150 km, celui de bœuf à 50 km et le kilo de gruyère à 40 km. Quant au kilo de pommes de terre ou de blé, il équivaut à peine à sortir la voiture du garage. Au niveau global, le cheptel mondial est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète.
Faire de la place à tout le monde
Les causes de faim dans le monde sont avant tout le manque d’accès à la terre et d’argent pour acheter de la nourriture. Mais cela pourrait changer, car il faudra produire de plus en plus pour nourrir une population qui devrait atteindre 8 à 9 milliards d’ici 2050. Et il sera impossible de la nourrir s’il faut ali-menter les 22 milliards d’animaux d’élevage
52
1 kg de veau = 220 km
en voiture

vivant actuellement. En 2006, la moitié des surfaces agricoles servent à nourrir ces ani-maux. Avec une très mauvaise efficacité éner-gétique puisqu’il faut environ 10 kg de four-rage pour produire 1 kg de viande de bœuf ou 2 kg de viande de porc.
La consommation de viande de l’Union européenne n’est possible que parce qu’ailleurs dans le monde, l’équivalent de sept fois la surface des terres agricoles européennes est consacré à produire des aliments pour son cheptel (Shiva, 1999). Au fur et à mesure que d’autres nations atteindront un niveau de vie et une consommation de viande comparables, la planète ne pourra plus nourrir autant de gens qu’aujourd’hui. La Chine importe d’ores et déjà 85 % du soja argentin pour compen-ser son déficit en soja. Qu’adviendra-t-il si la demande mondiale de viande augmente en-core d’un tiers pour atteindre 327 millions de tonnes en 2020 comme le prévoit la Banque mondiale ?
Le nombre de personnes nourries par an par hectare est de 22 pour les pommes de terre, 19 pour le riz… deux pour le mouton et une pour le bœuf. Il serait faux de conclure qu’une diète à base de riz ou de pommes de terre uni-quement procurerait tous les micronutriments nécessaires à la santé humaine, mais ces chiffres indiquent clairement que pour nourrir ceux qui ont faim, il ne faut pas tendre vers une diète en grande partie fondée sur la viande.
Il n’y a pas de statistiques définitives sur le volume d’eau nécessaire pour produire dif-férentes nourritures animales, mais aucun observateur bien informé ne nierait qu’il est bien plus grand que le volume nécessaire pour cultiver des plantes directement destinées à la consommation humaine. Produire une livre de bœuf nécessite 20 à 80 fois plus d’eau que pro-duire une livre de maïs. Spécialiste de l’eau à l’Université Cornell, David Pimentel pense que c’est là une sous-estimation notoire et penche plutôt pour 100 000 litres d’eau par kilo de
bœuf, soit 100 fois plus d’eau que pour pro-duire un kilo de blé. Et les déjections qui pol-luent l’eau et les sols sont un autre problème majeur de la surpopulation de bétail.
Au total, environ un milliard de person-nes sont végétariennes, dont beaucoup sont des Indiens. Au Royaume-Uni, 5 % de la po-pulation ne mangent pas de viande. Cela ne signifie pas qu’il faut bannir les animaux do-mestiques de la face de la terre. Ils sont utiles pour leur engrais et permettent l’agriculture biologique. Mais comme le dit Paracelse : « Rien n’est poison, tout est poison : seule la dose fait le poison. » g
Dreamstime/Matthew Collingwood
biblio Gra Phie
La principale source de cet article est le rapport : Gold M. The Global Benefits of Eating Less Meat, Compassion in World Farming Trust, 2004. Disponible sur: www.ciwf.org.uk
Eshel G, Martin P. Diet, Energy and Global Warming, The University of Chicago, 2005.
Jancovici JM. Combien de gaz à effet de serre dans notre assiette ? Article sur www.manicore.com
Office fédéral de la santé, Office fédéral de l’agriculture, Bureau fédéral de la con-sommation. Programme national Interactions positives entre l’alimentation, le mouvement et la production agricole, 2004. Disponible sur : www.apug.ch
Shiva V. Stolen Harvest, South End Press, Cambridge, 1999.
Un régime pour la planèteEn 1999, l’Agence suédoise de protection de l’environnement a calculé une diète qui, mise en œuvre, réduirait la consomma-tion d’énergie dans la produc-tion alimentaire de 30 %, l’uti-lisation de fertilisants artificiels de 20 % à 40 % et les hectares né-cessaires pour produire la nour- riture. Il ne s’agit pas d’un ré-
gime à suivre à la lettre, mais des limites à ne pas dépasser pour la bonne santé de la planète.
Diète plus écologique en gram-mes par jour :Pain 200Céréales 45Pommes de terre 270Légumes 340
Fruits 175Sandwich/bonbons 140Boissons gazeuses 80Margarine, beurre, huile 50Produits laitiers 300Fromage 20Oeufs 10Poisson 30Viande, volaille, saucisse 35 LRD
53
53

DOSSIER LaRevueDurable N°20
LRD
L’association pour le maintien d’une agriculture paysanne passe la vitesse supérieure
Pousser la logique le plus loin possible avec un noyau de convaincus ou se
rendre accessible au plus grand nombre en adoucissant la formule ? En région
Rhône-Alpes, le mouvement pour des contrats directs entre un agriculteur
et des consommateurs est à la croisée des chemins. Un questionnement qui
émerge ailleurs en France.
Ils ont entre 25 et 50 ans, ont un niveau de formation supérieur à la moyenne, sont en ma-jorité cadres supérieurs ou exercent des profes-sions libérales. Leurs revenus sont plutôt bas au regard de leur statut socioprofessionnel. Leur point commun ? Avoir passé un contrat avec un paysan pour qu’il produise leurs fruits et légumes, parfois aussi leurs œufs, viande, lait, fromage et miel avec les méthodes de l’agri-culture biologique. Entre eux, ils s’appellent « amapiens », néologisme dérivé du mot Amap, acronyme d’Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.
L’Amap est la grande innovation de ces der-nières années en France pour renouer le contact entre consommateurs et paysans. Dans cette forme de vente directe, les consommateurs s’engagent sur une saison complète avec un agriculteur en lui payant à l’avance sa récolte à un prix jugé rémunérateur. Leur engagement se prolonge dans l’animation de l’association sur les lieux de distribution, la diffusion de recettes de cuisine et jusqu’à une participation ponc-tuelle aux travaux de l’exploitation.
Comparées à la vente directe classique, les Amaps instaurent un rapport de solidarité plus fort entre un groupe de consommateurs et un producteur. Dans ce partenariat, les premiers assument une partie du risque agronomique du second, préfinancent son activité et se chargent de gérer ses ventes pour éviter d’ajouter cette lourde tâche au travail d’agriculteur. En échange, le paysan accepte que les consommateurs inter-viennent dans le choix des denrées qu’il cultive, aient leur mot à dire sur les méthodes agricoles qu’il applique et fixent les prix avec lui.
Depuis la création de la première Amap en France, à la ferme Le Jardin des Olivades, près de Toulon, en mai 2001, l’idée fait tache d’huile
sur le territoire de l’Hexagone. Mi-avril 2006, environ 272 Amaps sont identifiées dans vingt et une régions. La Provence-Alpes-Côte d’Azur tient la corde avec 79, suivi par Midi-Pyrénées avec 45 et 10 en formation. Quatrième du clas-sement après l’Ile-de-France, la région Rhône-Alpes, 29 Amaps et 15 en cours, a voulu savoir jusqu’où ce système s’adresse à un public de convaincus et à quelles conditions il pourrait devenir un modèle agricole alternatif. Avec l’Alliance paysans-écologistes-consommateurs
(Pec) de Rhône-Alpes, qui promeut les Amaps, la Région a commandé une étude à l’Ecole d’ingénieurs en agriculture, alimentation, dé-veloppement rural et environnement de Lyon (Isara-Lyon). Mission : comprendre qui sont les adhérents des Amaps et comment les consom-mateurs « ordinaires » perçoivent ce système (Mundler et coll., 2006).
Des consommateurs engagés
Le premier constat du rapport de l’Isara est sans surprise : l’amapien type est un citoyen engagé. Le plus souvent, il milite à Attac, l’Asso-ciation pour la taxation des transactions finan-cières. Attac est la locomotive du mouvement, qui est également très lié au syndicat La Confé-dération paysanne. Les membres d’associations écologistes sont aussi nombreux. Autre signe du militantisme des amapiens, ils boudent la grande distribution et sont adeptes des repas à la maison, y compris à midi.
Les raisons d’adhérer à une Amap relèvent d’une combinaison d’égoïsme et d’altruisme. Côté égoïsme, l’amapien satisfait son désir de convivialité lorsqu’il fait ses courses et son besoin de se rassurer sur son alimentation, sa provenance et son mode de production. Côté altruisme, il concrétise sa volonté de soutenir les petits producteurs. Il pratique ainsi une for-me de commerce équitable avec les agriculteurs qu’il perçoit comme une population à aider. Cette sensibilité prolonge souvent son adhésion aux produits équitables d’outre-mer tels que café, thé et chocolat.
Ils n’ont pas fait d’étude de marché ni de « focus groupe ». Ils se sont jetés à l’eau con-vaincus qu’il y a une clientèle désireuse de produits de la ferme livrés de façon simple. Six jeunes Lyonnais – de 22 à 28 ans – viennent de lancer Alter-Conso, coopérative qui gère les abonnements, fait la tournée des producteurs pour remplir les paniers, organise les distributions et collecte les
paiements. Ils proposent sept types de paniers : légumes, fruits, viandes, produits lai-tiers, pain, goûter, vins et biè-res artisanales. Chacun peut s’abonner à un ou plusieurs paniers, tous disponibles en trois tailles : individuel, petite famille, grande famille. La méthode est hybride entre la vente directe et l’Amap. « La totalité du prix du panier est reversé au producteur », expli-
que Vincent Bleuzet, l’un des six intrépides. Alter-Conso se rémunère sur une cotisation fixe et spécifique que chaque adhérent verse par mensua-lités. L’abonné s’engage pour six mois, mais peut se désister à tout moment s’il trouve un remplaçant. Date de la pre-mière distribution : le 16 mai 2006. Bonne chance !
LRD
Alter-Conso ou six jeunes et leurs sept paniers
54

DOSSIERLaRevueDurable N°20
Paris
Bretagne
Centre
Corse
Limousin
Auvergne
Rhône-Alpes
Bourgogne
Champagne Ardennes
Picardie
Lorraine
Alsace
Nord-Pas de Calais
Franche-Comté
Midi-Pyrénées
Aquitaine
Pays de Loire
PoitouCharentes
LanguedocRoussillon
Provence-Alpes Côte d’Azur
Basse Normandie
Haute Normandie
Ile de France
Brest
Nantes
Bordeaux
ToulouseMarseille
Orléans
Strasbourg
Lyon
Lille
Manche
Mer Méditerranée
OcéanAtlantique
52
55
44
79
4
6
2
4
1
1
1
1
1
2
21
1
2
1
5
7
0
Trop contraignant pour les autres
Les auteurs du rapport ont animé trois « focus groupes » pour tester la perception des Amaps auprès d’un échantillon de la popula-tion en dehors des réseaux habituels. Un focus groupe est un groupe de discussion réuni pour comprendre les opinions et attitudes des gens face à une idée ou à un produit existant, nou-veau ou en phase de développement. Les per-sonnes interrogées au cours de ces réunions présentent un profi l différent des adhérents types des Amaps, notamment leurs niveaux de formation et de revenus. En revanche, ils partagent un intérêt marqué pour la qualité de leur alimentation, se traduisant par la recher-che de produits ayant du goût, frais et d’ori-gine identifi able.
Plus fon-damentalement, la notion de contrat rebute les consommateurs qui se sentent d’autant plus contraints que sa durée leur apparaît longue. Cer-tains semblent penser qu’une fois cet engagement signé, ils perdront toute liberté de choix (« c’est comme France Loisirs »).Ils sont attachés à la notion de liberté de choix. Faire ses cour-ses, c’est exercer son pouvoir de « libre arbitre », décider d’acheter tel ou tel produit sur tel ou tel circuit selon des critères jugés importants (qualité, fraîcheur, prix…). Confi er l’intégralité de ses achats de légumes à un producteur revient à lui transférer ce pouvoir d’arbitrage et de gestion du budget.
Les participants évoquent aussi spontané-ment de possibles aléas climatiques qui se tra-duiraient par de mauvaises récoltes et donc une diminution de la taille du panier ou une moin-dre qualité des légumes. La plupart des person-nes interrogées ont une vision essentiellement marchande de la relation producteur-consom-mateurs et peinent à imaginer les notions de partage des risques (accepter d’avoir un plus petit panier) et de compensations ultérieures (un plus gros panier à venir).
Des entorses pour sortir du cercle des convaincus
Aux yeux de la plupart des consommateurs questionnés, l’Amap apparaît comme une idée séduisante à condition de la nettoyer de ces trois contraintes : l’engagement à long terme, les pa-niers types et le partage des risque. En somme, tout ce qui fonde la spécifi cité des Amaps par rapport aux autres formes de vente directe. Pourtant, en dépit de ces entorses majeures à l’idée originale, le système resterait intéressant, car il favorise une exploitation diversifi ée (ma-raîchage, verger multi-espèces, petite production de volailles…) et une soixantaine de familles ad-hérentes suffi rait pour qu’une ferme y trouve son équilibre. En outre, l’association production végétale-petite production animale serait très complémentaire sur le plan écologique.
De telles exploitations feraient vivre des fa-milles sur de petites surfaces, notamment en zone périurbaine, et permettraient d’installer de jeunes agriculteurs dans des systèmes moins exigeants en capital de départ, notamment foncier. Les données du recensement agricole montrent que de nombreux agriculteurs ins-tallés sur de petites et moyennes exploitations partiront bientôt à la retraite. Or, leur déten-teur voit souvent ces exploitations comme sans avenir. Même au rabais, des Amaps leur don-neraient un deuxième souffl e, les sauvant au passage de la rurbanisation.
Ainsi, la région Rhône-Alpes voudrait don-ner aux agriculteurs les moyens de prendre les devants sans attendre que de nouveaux groupes de consommateurs les sollicitent. Une deuxiè-me étude démarrera sous peu pour évaluer les avantages des Amaps pour les agriculteurs qui la pratiquent déjà et aboutir à un guide à l’inten-tion de ceux qui souhaitent s’y lancer. L’Alliance Pec Rhône-Alpes n’a en revanche pas encore décidé des orientations à prendre. « Il apparaît clair qu’en Rhône-Alpes, une forme moins en-gagée de marché de proximité est appelée à se développer », commente Ludovic Mamdy, ani-mateur de l’Alliance. Reste à savoir si l’Alliance contribuera à activer cet élargissement.
Le mouvement des Amaps est à la croisée des chemins. L’un mène vers un plus grand nombre de consommateurs et donc un plus
De façon générale, les participants à ces focus groupes voient dans ce système la possibilité de s’approvisionner en produits de qualité en étant sûrs qu’ils sont de saison et cultivés de façon tra-ditionnelle. Certains soulignent les possibilités d’échange que ce système offre avec l’agriculteur et les autres adhérents. D’autres se montrent sen-sibles à sa dimension solidaire. Mais les blocages pratiques sont nombreux. Au premier chef, l’in-surmontable habitude, si immuable. Ensuite, le fait d’avoir un rendez-vous fi xe hebdomadaire pour récupérer son panier apparaît trop contrai-gnant. Beaucoup de gens, en particulier les re-traités, aiment faire leurs courses tous les jours, aller au marché, choisir les aliments au gré de leurs envies, déterminer les quantités selon le nombre variable de convives.
Nombre d’Amaps en fonctionnement
ou en cours de constitution par région
selon le site : http://alliancepec.free.fr
Dre
amst
ime/
Mila
n Ra
dulo
vic
55

DOSSIER LaRevueDurable N°20
Bernard Buet est un éleveur de porcs pas tout à fait comme les autres. Dans sa ferme Les Pifandais, à Quevert, dans les Côtes-d’Armor, il fait du « porc durable ». Ses truies, qui sont moins nombreuses que dans une exploitation intensive, profitent d’une litière de paille, mangent de moins en moins de soja, en tout cas jamais trans-génique, et se passent le plus possible d’antibiotiques.
La litière de paille absorbe leurs déjections et, en quelques mois, se transforme en fumier qui enrichit le sol. C’est un avantage majeur sur les exploi-tations conventionnelles, dans lesquelles les déjections tom-bent dans une fosse pour for-mer ce fameux lisier qui pol-lue l’eau au point de la rendre impropre à la consommation humaine. A Quimper, dans le Finistère, Alain Jacob suit les mêmes principes, ceux du Réseau Cohérence. Dans tout le Grand-Ouest, ce réseau réunit plus d’une centaine d’associa-tions de consommateurs, pro-tecteurs de la nature, paysans, artisans et acteurs de la santé qui, tous ensemble, poussent
pour des pratiques agricoles écologiques et équitables.
« J’attendais une occasion pour faire mieux dans mon exploita-tion », témoigne Bernard Buet. Avec cent collègues, il adhère au projet d’améliorer l’exploi-tation porcine en Bretagne sans tout chambouler d’em-blée. Des mois de discussions entre eux et avec les autres acteurs du réseau, un voyage en Allemagne pour voir d’autres pratiques leur permet d’arriver à un socle en quatre points : litière sur paille, pas d’organis-mes génétiquement modifiés, moins de porcs par hectare et moins d’antibiotiques. Des adaptations cosmétiques dans une agriculture très indus-trielle ? A ce jour, seuls six agriculteurs ont obtenu l’iden-tifiant Cohérence. C’est dire si ce n’est pas si simple.
« Ce qui freine le plus les collè-gues est la litière en paille, car elle ajoute du travail », raconte Alain Jacob. « Nous ne voulons pas nous enfermer dans les ques-tions techniques d’un cahier des charges. Notre but est éthique », continue Julien Pondaven, ani-mateur de Cohérence à Lorient (Morbihan). « Nous disons aux producteurs : vous voulez faire des efforts ? Nous sommes d’ac-cord de vous aider, à condi- tion d’avoir notre mot à dire. » L’aide, c’est cet identifiant Co-hérence, distinction qui valo-rise le produit de l’agriculteur.
L’attribution de l’identifiant est donc participative, selon une méthode importée du Brésil.
« Lorsque l’agriculteur est prêt, on fixe le jour d’une visite. Des représentants d’associations membres du réseau, notam-ment de consommateurs, se joignent à l’animateur de Cohérence pour passer au crible les pratiques de l’agri-culteur. Ils interrogent, véri-fient, discutent avec l’éleveur et jugent, après débat, s’il a droit à l’identifiant. « Je l’ai eu, mais les visiteurs m’ont demandé de faire plus d’efforts pour diminuer les pesticides », commente Bernard Buet. Il y travaille : « J’ai acheté une herse à étrilles pour désherber mécaniquement et appliquer moins d’herbicides. Et pour les fongicides, j’utilise mainte-nant les mêmes produits que les agriculteurs biologiques », poursuit-il. Rendez-vous est pris pour dans deux ans. Et il aimerait montrer qu’il avance.
Bernard Buet est impatient d’écouler une partie de sa pro-duction dans la restauration collective, ce qui lui garantirait une meilleure rémunération. Mais il est déjà content. « Ce qui me plaît dans le porc durable, c’est que tout le monde y trouve son compte », déclare-t-il. Alain Jacob, lui, a déjà le label rouge, qui lui assure des débouchés rentables. « J’ai suivi la démar-che de Cohérence par convic-tion personnelle », commente-t-il. Cette année, il plante des féveroles, car il aimerait sortir au plus vite du soja. « Une cul-ture qui détruit les petits pay-sans », lâche-t-il.
LRD
Dans le Grand-Ouest, le Réseau Cohérence promeut le porc durable
POUR ALLER PLUS LOIN
www.alter-conso.org/comment.htm
www.reseau-coherence.org
Pour trouver l’Amap la plus proche : http://alliancepec.free.fr
biblio Gra Phie
Mundler P et coll. Fonctionnement et reproductibilité des Amaps en Rhône-Alpes, Isara, Lyon, 2006. Disponible sur : www.alliancepec-rhonealpes.org/site-all/
fort impact sur l’agriculture locale. L’autre conduit vers une économie alternative. « Ici comme en Ile-de-France [où 52 Amaps ont vu le jour], le mouvement prend le premier chemin. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il penche pour le second, tissant des rapports avec les autres secteurs de l’économie soli-daire. Avec des débats à la clef, il se montre plus actif et plus festif, relève Ludovic Mamdy. Quoi qu’il en soit, les agriculteurs ne doivent pas perdre de vue que tout tourne autour de la qualité de leurs produits. Les Amaps qui marchent le mieux sont celles qui offrent les meilleurs produits », avertit-il. g
Mat
thew
Maa
skan
t
Paul
-and
ré B
elle
-isle
56

Il reste en Suisse 6 % de popu-lation agricole, un record com-paré aux pays limitrophes, l’Allemagne (2 %), la France (3 %) et l’Italie (4 %). A la faveur d’une votation popu-laire en 1996, les paiements directs accordés aux paysans sont conditionnés au respect d’un minimum de conditions écologiques. Les résultats sont clairs. L’agriculture biologi-que couvre 11 % de la surface agricole du pays, soit le troi-sième score européen après le Liechtenstein et l’Autriche. Le reste des surfaces est en « pro-
duction intégrée », méthode d’exploitation proche de l’agri-culture biologique. La con-sommation de produits phyto-sanitaires a reculé de 38 % de 1990 à 2004 et celle d’engrais de deux tiers. Les animaux sont en général mieux traités qu’ailleurs. Et une votation populaire a décidé en novem-bre 2005 que les champs suis-ses resteraient libres d’organis-mes génétiquement modifiés au moins encore cinq ans.
Sur le plan social, en revanche, le bilan est terne. L’écart entre
les revenus des agriculteurs et ceux du reste de la population se creuse. En 1990, le salaire de référence dans le secteur agri-cole équivaut à 70 % du salaire de référence dans les autres secteurs. En 2004, il tombe à 60 %. Et le pouvoir de négo-ciation des paysans avec les transformateurs et les grandes surfaces s’érode. Ainsi, les prix à la production agricole bais-sent de 24 % de 1990 à 2004 alors que les prix aux consom-mateurs augmentent de 11 % (Ofag, 2005). LRD
DOSSIERLaRevueDurable N°20
La multifonctionnalité de l’agriculture
Le modèle agricole suisse est souvent cité comme exemple
d’agriculture écologique à taille humaine. Mais la pression des
négociations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
pourrait saborder cette réputation. Le syndicat paysan Uniterre
compte sur les consommateurs pour défendre le droit des
Suisses à se nourrir le plus possible des fruits de leur territoire.
Il se fait le moteur de l’agriculture contractuelle.
Lopin bleu, Panier à pattes, Agrihotte, leurs noms rivalisent de fantaisie où sont plus terre à terre, tel Le Jardin potager ou Saveurs de sai-sons. Mais toutes ces coopératives poursuivent le même rêve : rapprocher les consommateurs des agriculteurs pour décider de concert quoi produire, comment le faire et partager les risques de l’agricul-teur. Cela s’appelle l’« agriculture contractuelle ».
Pendant vingt-cinq ans, les Jardins de cocagne à Genève et la Clef des champs dans le Jura sont restés des pionniers bien isolés de cette forme d’agriculture. Et puis, en 2003, l’Affaire Tour-nerêve a réussi à susciter l’intérêt de 1000 fa-milles qui ont commandé à l’avance leurs pro-duits de garde. Le côté ludique, festif, joyeux a plu. Peut-être aussi la prise de conscience que l’alimentation est une affaire beaucoup trop importante pour la déléguer entièrement aux grandes surfaces. Depuis, les associations d’agriculture contractuelle bourgeonnent par-tout en Suisse romande : six nouvelles initiati-ves ont vu le jour depuis 2005. Autour de 2000 familles ont un contrat avec un agriculteur ou un jardinier pour produire leurs fruits et légu-mes ou leurs produits de longue durée.
Sonderfall Romandie
Un phénomène qui, en Suisse, reste canton-né à la Romandie. Hansjorg Ernst, producteur de la Clef des champs et initiateur de Saveurs de saisons est très actif en maraîchage biologique. Lors d’une récente assemblée de Bio Suisse, il a voulu expliquer l’agriculture contractuelle à ses collègues suisses allemands. « Je n’ai suscité aucune réaction. Je crois que les gens n’ont tout
simplement pas compris de quoi il s’agit », témoigne cet originaire de Bâle, que son flop laisse encore perplexe. L’intervention suivante, sur un système de commandes
à domicile par internet, a en re-vanche passionné l’assistance.
La mouvance biologique est très active dans la vente directe en Suisse allemande, mais pas question de rapprocher trop les consommateurs des pro-
ducteurs. « L’expression souveraineté alimen-taire y est incon nue », poursuit Hansjorg Ernst. Pourtant, depuis 1981, la coopéra-tive Agrico opère près de Bâle sur le modèle des Jardins de cocagne. Pour Peter Dester et
les trois autres producteurs d’Agrico, les af-faires tournent puisqu’ils livrent 650 paniers par semaine. Mais l’esprit d’origine se perd. « Nous avons toujours plus de clients qui vi-sent des produits de qualité, mais qui ne veu-lent pas travailler dans l’exploitation ni s’enga-ger d’une quelconque autre manière », déclare Peter Dester.
La différence entre les deux régions linguisti-ques s’explique sûrement en partie par l’activité du syndicat romand Uniterre, le plus ardent dé-fenseur du principe de souveraineté alimentaire
Six nouvellesinitiatives
depuis 2005
57
LRD
En Suisse comme ailleurs, la souveraineté alimentaire a besoin des consommateurs

DOSSIER LaRevueDurable N°20
LRD
L’agriculture contractuelle se porte bien en Suisse romande
en Suisse. C’est lui qui pousse fortement pour des alliances nouvelles entre consommateurs et producteurs.
Front uni contre la libéralisation
« Nous ne pensons évidemment pas que toute la production suisse pourrait être écoulée dans le cadre de la vente directe ou des jardins contractuels. Mais cette forme de consomma-tion est un formidable outil de questionnement sur les échanges commerciaux », clarifie Nicolas Bezençon. Ces projets offrent l’opportunité de rétablir un contact étroit entre consommateurs et producteurs et de discuter sur les types de production possibles, la qualité, les risques, les prix et la commercialisation. Ils stimulent une nécessaire réflexion de fond sur la notion de prix rémunérateur et sont donc utiles à toute la filière. Uniterre voit dans l’agriculture con-tractuelle un moyen d’ouvrir le dialogue avec les consommateurs et de faire réfléchir sur le rôle et la place des grandes surfaces.
OMC oblige, l’agriculture suisse doit se rap-procher du marché international. La protection aux frontières va baisser et les prix des produits alimentaires aussi. Pour continuer d’exercer, les paysans suisses devront diminuer leurs coûts de production et devenir concurrentiels. Voilà le menu de la réforme en discussion, qui devrait entrer en vigueur en 2011. Et qui pourrait dé-cimer le monde paysan. Des simulations mon-trent que jusqu’à 40 % des agriculteurs de mon-tagne pourraient mettre la clef sous le paillas-son. Tisser un partenariat fort avec la société est une question de survie pour les paysans : seul un front élargi peut empêcher la libérali-sation de l’agriculture. Uniterre s’y attelle. Elle a convoqué les premières rencontres Jonction ville-campagne à Genève en avril. Cette réu-nion est le point de départ d’une coordination romande de l’agriculture contractuelle. Reste à espérer qu’une nouvelle vague de lopins bleus et de Tournerêves déferlera bientôt sur les campa-gnes romandes. g
biblio Gra PhieOffice fédéral de l’agriculture (Ofag). Rapport agricole, 2005. Disponible sur www.blw.admin.ch
www.uniterre.ch
Les Jardins de cocagne
Région : canton de GenèveDate de création : 1978Nombre d’adhérents : 400 famillesType de produits : fruits et légumes de pro-
duction biologique, anciennes variétés dans la mesure du possible.
Livraison : hebdomadaire, dans 43 points de distribution.
Prix : la grande part (famille de deux adul-tes + deux enfants) varie de 1140 à 1500 francs selon les revenus du ménage. La petite part (2/3 de la grande part) de 840 à 1200 francs. Chaque nouveau membre doit acheter au mi-nimum une part sociale de la coopérative d’un montant de 50 francs et effectuer des demi-journées de travail (4 heures) : quatre par an pour les grandes parts et trois pour les petites parts. Les demi-journées non effectuées sont facturées 65 francs.
La liste d’attente pour adhérer aux Jardins de cocagne étant longue, une deuxième coopé-rative pourrait voir le jour.
www.cocagne.ch
L’affaire Tournerêve
Région : canton de GenèveDate de création : 2003Nombre d’adhérents : 1300 familles.Type de produits : céréales en grain et en
farine, huile, jus de fruit, lentilles, haricots, miel et saucisse. Quelques producteurs sont en agriculture biologique.
Livraison : deux fois par an, en octobre et novembre dans cinq points de distribution.
Prix : 170 francs ou 178 (avec saucisse). www.terre-avenir.chRubrique « agriculture contractuelle »
le Panier à pattes
Région : canton de GenèveDate de création : 2006Nombre d’adhérents : en lancementType de produits : pommes, poires, jus de
fruits, un poulet, une terrine de bison, un bon de 50 francs à échanger dans une ferme qui élève des moutons et des agneaux.
Livraison : une fois par an, en octobre. Le bon peut être échangé à la convenance du con-sommateur.
Prix : en discussion. Nicolas Bezençon : [email protected]
La période de semailles arrive… C’est le moment de commander de déli-
cieux produits de proximité en Suisse romande. Passage en revue des dix ini-
tiatives d’agriculture contractuelle qui existent dans cette région du monde,
dont huit ont vu le jour depuis un an. Deux types de paniers sont proposés :
ceux qui contiennent essentiellement des fruits et légumes, ceux qui con-
tiennent des produits de garde. Les deux sont complémentaires.
58

DOSSIERLaRevueDurable N°20
59
JURA
NEUCHÂTEL
VAUD
GENÈVE
Porrentruy
Bienne
Neuchâtel
Lausanne
Pully
Echallens
Genève
Nyon Châteaud’Oex
Vevey
Fribourg
FRIBOURG
VALAIS
BERNE
Monthey
Lac Léman
L. de N
euch
âtel
L. deBienne
FR
AN
CE
le jardin potager
Région : Lausanne et environs (triangle entre Nyon, Echallens et Pully)
Date de création : 2006Nombre d’adhérents : 105 familles.Type de produits : fruits et légumes de sai-
son, production biologique.Livraison : tous les jeudis, à sept points de
distribution à Lausanne et dans cinq autres villes de l’agglomération.
Prix : le grand panier (6 kg) 1250 francs, le petit (4,5 kg) 850. En outre, chaque membre doit acquérir deux part sociales de la coopéra-tive au prix de 100 francs chacune et se rendre disponible pour trois ou quatre demi-journées de travail au champ par an.
www.lejardinpotager.ch
L’Agrihotte
Région : Vevey et environsDate de création : 2005Nombre d’adhérents : 150 familles.Type de produits : huile, courges, oignons,
pommes de terre, carottes, pommes, saucis-sons, tommes et vinaigre.
Livraison : deux fois l’an, en janvier et octobre.Prix : petite hotte, 82 francs (107 francs
avec cinq litres de jus de raisin), grande hotte 160 (185 francs avec le jus de raisin).
www.lagrihotte.chSur ce site fi gure aussi la liste de tous les dé-
taillants du district de Vevey qui vendent des produits locaux.
association pour le dévelop-pement du Pays-d’enhaut
Région : Pays-d’EnhautDate de création : 1995L’Association pour le développement du
Pays-d’Enhaut (ADPE) promeut le commerce local par différents moyens : un label régional de terroir, la production contractuelle de porcs entre l’Association des producteurs de porcs et deux artisans bouchers de Château-d’œx, des commerces et restaurants de la vallée ambassa-deurs de produits authentiques et un répertoire d’adresses de vente directe.
www.pays-denhaut.ch
le lopin bleu
Région : canton de Neuchâtel et environs
Date de création : 2005Nombre d’adhérents :
155 familles.Type de produits : le panier
classique contient de l’huile, des pommes de terre, des pommes, oignons, farine de blé, jus de fruit, miel, noix et fromage (du gruyère). Le panier découverte in-clut des poires à cuire, de la farine d’épeautre, de seigle et de sarrasin, du vin et du raisiné.
Livraison : fi n no-vembre lors de la foire de Bio Neuchâtel.
Prix : 100 francs pour le panier classique, 60 pour le panier découverte.
www.lopinbleu.ch
l’abbaye de Fontaine andré
Région : ville de Neuchâtel et environsDate de création : 2005Nombre d’adhérents : 40 famillesType de produits : légumes biologiques.Livraison : tous les jeudis de mai à décem-
bre, une fois par mois de décembre à avril. Sept points de livraison en ville et autour de Neuchâtel.
Prix : 500 francs pour le demi-panier (une à deux personnes), 800 pour le panier entier (trois à quatre personnes).
Urs Weber : 032 724 47 79
la clef des champs
Région : canton du Jura Date de création : 1980Nombre d’adhérents :130 familles.Type de produits : légumes d’agriculture
biologique. Depuis peu, il est aussi possible d’avoir de la viande (5 kg tous les deux mois) et des fruits.
Livraison : tous les jeudis, de fi n avril à dé-but décembre, une fois par mois de décembre
à avril. Il existe cinq points de livraison répar-tis dans le canton.
Prix : 720 francs pour la part standard (fa-mille avec deux enfants) et 1030 pour la grosse part (famille avec trois adolescents). Chaque membre doit en outre s’acquitter d’une part sociale de la coopérative d’une valeur de 100 francs et fournir six demi-journées de travail par an ou payer 15 francs/heure de travail non effectué.
www.clef-des-champs.ch
Saveurs de saisons
Région : canton du Jura et Jura bernoisDate de création : 2006Nombre d’adhérents : en lancement.Type de produits : huile, farines de diverses
céréales, fromages, pommes, jus de pomme, confi ture, sirop, miel, tisane, courgettes en conserve aigre-doux. Des saucisses et de la viande séchée sont en option. Il est aussi pos-sible de s’inscrire pour un panier de viande fraîche qui contient des saucisses à rôtir et des morceaux de viande à choix. Les produits sont issus de l’agriculture biologique.
Livraison : en une fois, fi n octobre.Prix : 150 francs pour le panier de base, 180
avec les carnés. Le panier de viande fraîche coûte 200 francs.
www.saveurs-de-saisons.ch g

Madame Monsieur Nom Prénom
Adresse Code postal Localité / Pays
Date et signature
Je commande les numéros suivants :
au prix de 9 E ou 13 fr.s. pour les abonnés au prix de 11 E ou 15 fr.s. pour les non-abonnés / frais d’envoi inclus
Accompagnez cette commande d’un chèque impérativement libellé à l’ordre de CERIN Sàrl (uniquement pour la France) ou attendez de recevoir votre facture avec mention de toutes les autres possibilités de paiement.
Pour commander ces numéros, renvoyez-nous ce coupon à :
Cerin Sàrl rue de Lausanne 91, CH-1700 Fribourg
ou faxez-le au + 41 (0)26 321 37 12, ou téléphonez au + 41 (0)26 321 37 10
ou remplissez-le sur internet : www.larevuedurable.com/commander-des-numeros.html
numéro 1
Maîtriser la consommation d’électricité au Nord
septembre-octobre 2002
numéro 2
Cultiver les savoirs pour mieux cultiver les sols
novembre-décembre 2002
numéro 3
Qualité de l’air : comment lutter contre la pollution
janvier-février 2003
numéro 4
Préserver les ressources naturelles et la paix
mars-avril 2003
numéro 5
Rendre les villes durables grâce à leurs habitants
mai-juin 2003
numéro 6
Agriculture : de la nécessité des peuples de se nourrir eux-mêmes
juillet-août-septembre 2003
numéro 7
L’eau est l’affaire de tous
octobre-novembre 2003
numéro 8
Education et déve lop pement durable : le vrai chantier
décembre 2003-janvier 2004
numéro 9
Adapter les bâtiments au froid et aux canicules
février-mars 2004
numéro 10
Ecologie et emploi :un mariage de raison
avril-mai 2004
numéro 11
Quel tourisme pour une planète fragile ?
juin-juillet-août 2004
numéro 12
Vive la biodiversité agricole!
septembre-octobre 2004
numéro 14
Vivre ensemble en mégalopole février-mars 2005
numéro 15
Faire face aux changements climatiques avril-mai-juin 2005
numéro 16
Touche pas à mon littoral juillet-août 2005
numéro 17
Le bois, une alternative au pétrole et au béton septembre-octobre 2005
numéro 18
Sur la piste d’une mobilité différente novembre-décembre 2005- janvier 2006
numéro 19
Des technologiesappropriées
février - mars 2006
Plus de 40 pages sur les thématiques essentielles du développement durable. C’est ce que proposent les dossiers de LaRevueDurable.
Complétez votre collection!
Agriculture : de la nécessité des peuples nécessité des peuples de se nourrir eux-mêmesde se nourrir eux-mêmes
Maîtriser la d’électricité
pour mieux cultiver les sols
comment lutter contre la pollution
Préserver les ressources naturelles et la paix
Rendre les villes durables grâce à leurs habitants
Adapter les bâtiments au froid et aux canicules
Ecologie et emploi :un mariage de
Education et déve lop pement durable :le vrai chantier
L’eau est l’affaire de tous
pour une planète fragile ?
agricole!agricole!
ensemble ensemble en mégalopoleen mégalopole
à mon littoral
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.– €
: 9
.–
L
1
8
7
1
7
-
1
6
-
F
:
9
,
0
0
€
-
R
D
LaRe
vueD
ura
ble
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
LaRevueDurable
DOSSIER TOUCHE PAS À MON LITTORAL
DOSSIER TOUCHE PAS À MON LITTORAL NUMÉRO 16 • JUILLET - AOÛT 2005 • BIMESTRIEL
PERSPECTIVEGEORGE MONBIOT Equilibrer le pouvoirdans le monde
RENCONTRE DOMINIQUE PESTRE :Nous vivons dans des sociétés de la connaissance très particulières
MINIDOSSIERHiroshima :soixante ans après
Les autoroutes de la mer,transport simple et écologique
Le Conservatoire du littoral court contre la montre depuis trente ans
En Somalie, le tsunami fait ressortir un trafic de déchets toxiques
aux changements clim avril-mai-juin 2005
mobilité différente janvier 2006
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.– €
: 9
.–
L
1
8
7
1
7
-
1
8
-
F
:
9
,
0
0
€
-
R
D
LaRe
vueD
ura
ble
LaRevueDurable
DOSSIER Sur la piste d’une mobilité différente
DOSSIER
PERSPECTIVE
GEORGE MONBIOT
Pour une organisation mondiale du commerce équitable
RENCONTRE MATHIS WACKERNAGELLe monde vit au-dessus de ses moyens écologiques
Des entreprises aident leurs employésà laisser leur voiture à la maison
NUMÉRO 18 • DÉCEMBRE 2005 - JANVIER 2006 • BIMESTRIEL
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
LAREVUEDURABLE PRÉSENTE :CYCLE DE CONFÉRENCES Quelles réponses au « Cauchemar de Darwin » ?
Test : Les différents moyens de se déplacer en villeVers des quartiers sans voiture
SUR LA PISTE D’UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE
COUP DE PROJECTEUR
Appel à soutenir l’EcoZACdu XIIIe arrondissement de Paris
numéro 13
Briser un tabou :réduire la consommation novembre-décembre 2004- janvier 2005
alternative au pétrole et au béton
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.– €
: 9
.–
L
1
8
7
1
7
-
1
7
-
F
:
9
,
0
0
€
-
R
D
LaRe
vueD
ura
ble
LaRevueDurable
DOSSIER Le bois, une alternative au pétrole et au béton
DOSSIER
PERSPECTIVEGEORGE MONBIOT Remplacer le FMI et la Banque mondiale
RENCONTRE CYRIA EMELIANOFF :L’urbanisme durable est en gestation en Europe
Mieux prévenir les feux de forêts, phénomène de société
Les réseaux de chauffage à distance au bois tissent leur toile
NUMÉRO 17 • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2005 • BIMESTRIEL
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
LE BOIS, UNE ALTERNATIVE AU PÉTROLE ET AU BÉTON
MINIDOSSIER ENQUÊTE EXCLUSIVE : Les consommateurs suisses et français face au commerce équitable
DOSSIER Energie : comparaison entre le pétrole et le bois
Construire en bois,c’est bon pour le climat
appropriées
février - mars 2006
LaRe
vueD
ura
ble
LaRevueDurable
DOSSIER Des technologies appropriées pour la construction, l’eau et la santé
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.– €
: 9
.–
L
1
8
7
1
7
-
1
9
-
F
:
9
,
0
0
€
-
R
D
Le neem, arbre à miracles qui tue les moustiques vecteurs du paludisme
NUMÉRO 19 • FÉVRIER - MARS 2006 • BIMESTRIEL
Récupérer l’eau qui tombe du ciel
Des maisons chaudes et bon marché en paille
POUR LA CONSTRUCTION, L‘EAU ET LA SANTÉ
DESTECHNOLOGIESAPPROPRIÉES
MINIDOSSIER La publicité harcèle les enfants, et peu de parents s’en rendent compte
RENCONTRE BERNADETTE BENSAUDE-VINCENT :Les citoyens ont leur mot à dire sur la recherche scientifi que
DOSSIER
Des toilettes sèches pour économiser l’eau et fabriquer du compost
60

DOSSIERLaRevueDurable N°20
61
nées aux présidents généraux de Louis Dreyfus négoce et Cargill France, les enjoignent à re-médier aux effets négatifs du soja, commerce dont ils sont les principaux acteurs au niveau mondial.
Les cartes sont à télécharger sur : www.sojacontrelavie.org
Moisson de revues
La campagne « Le soja contre la vie »est l’occasion de faire connaître les moyens de sortir l’Europe de sa dépendance au soja. La revue Transrural Initiatives se demande, dans un dossier très bien fi celé, si l’élevage peut s’af-franchir du soja. Il montre que la raréfaction du soja non transgénique – 40 % des surfaces de soja cultivées dans le monde – déclenche des démarches pour carrément se passer du soja. C’est le cas en Basse-Normandie, où le collec-tif Inpact étudie comment revenir à un élevage fondé sur l’herbe. Une autre source de protéi-
Guide sur l’agriculture
nes se profi le dans les sous-produits du colza et du blé utilisés pour produire des biocarburants dans l’UE.
Transrural Initiatives, n° 304, 28 février 2006. www.transrural-initiatives.org
Campagnes solidaires,
le mensuel de la Con-fédération paysanne, consacre son numéro de mars à La folie du soja. Il donne la parole à des membres de syn-dicats qui, en Argentine, au Brésil et au Paraguay remettent en cause le dé-lire sojatique. L’occasion aussi de pester contre la Politique agricole commune, qui porte une lourde responsabilité dans l’emballement de cette monoculture.
Campagnes solidaires, n° 205, mars 2006. www.confederationpaysanne.fr
Le dossier de jan-vier-février de la revue Faim développement magazine expose de manière très pédagogi-que les ravages du soja. Le journaliste Patrick Piro y livre une foison de témoignages et d’informa-tions fraîchement recueillis sur la route du soja, au Brésil.
Faim développement magazine, n° 209-210, janvier-février 2006.
Ces trois dossiers sont disponibles sur : www.sojacontrelavie.org
Campagnes solidaires,
. Il donne la parole à des membres de syn-dicats qui, en Argentine, au Brésil et au Paraguay remettent en cause le dé-lire sojatique. L’occasion aussi de pester contre la Politique agricole
g
La campagne « Le soja contre la vie »est l’occasion de faire connaître les moyens de sortir l’Europe de sa dépendance au soja.
Transrural Initiatives se demande, dans Transrural Initiatives se demande, dans Transrural Initiatives
expose de manière très pédagogi-que les ravages du soja. Le journaliste Patrick Piro y livre une foison de témoignages et d’informa-tions fraîchement recueillis
ISS
N N
°07
60-6
443
- M
EN
SU
EL
FaimN° 209-210 / Janvier-Février 2006 / 3 €
C O M I T É C A T H O L I Q U E C O N T R E L A F A I M E T P O U R L E D É V E L O P P E M E N T
Développement
www.ccfd.asso.fr
Maga z i n e
NIGERI
La malnutrition
Un scandale
permanent
PARADIS FISCAUXI
Quand les capitaux
fuient leurs
responsabilités
DOSSIER SPÉCIAL > CAMPAGNE « LE SOJA CONTRE LA VIE »I
Brésil : une graine à la conquête du mondeRésister
à l’empire du soja
SOJA
Le soja ou la vie
Protégés par la police et des paramilitaires, des cultivateurs de soja transgénique d’origine brési-lienne attaquent, le 24 juin 2005, la communauté paysanne de Teko-joja, dans le département de Ca-aguazu, au nord du Paraguay. Bilan :deux personnes tuées, 270 expulsés, de nombreux blessés, 54 maisons et plantations brûlées. Auparavant, en fé-vrier, dans l’Etat du Para, au Brésil, la religieuse Dorothy Stang est assassinée. Le même mois, à Sol de Mayo, au nord de l’Argentine, des policiers agressent bruta-lement des paysans et arrêtent plusieurs d’entre eux.
S’opposer au soja dans les pays produc-teurs d’Amérique du Sud est suicidaire. Les valeureux qui tentent de résister à son avan-cée font preuve d’un courage admirable. Ils méritent que le consommateur européen vien-ne à leur secours. Le soja qu’exportent l’Argen-tine, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay est en effet en majorité consommé en Chine et dans l’Union européenne (UE). Seule l’Europe peut donc démocratiquement s’engager à mettre des limites au massacre.
La campagne « Le soja contre la vie » que lancent cinq associations françaises – le Comité catholique contre la faim et pour le développe-ment, le Réseau Cohérence, la Confédération paysanne, l’association de solidarité et de coo-pération internationale Gret et le Réseau Agri-culture durable – avec le soutien de 19 autres associations est donc fort bienvenue. L’objectif est d’informer sur le désastre en cours (voir l’article de Marc Hufty page 46) et de proposer des sorties.
La campagne invite les citoyens à écrire à Thierry Breton, ministre français de l’Eco-nomie et des fi nances, pour lui demander de « veiller à ce que la France n’approuve plus de fi nancement pour des opérations liées à l’ex-pansion du soja », via ses droits de vote au sein de la Société fi nancière internationale, fi liale de la Banque mondiale. Deux autres cartes, desti-

DOSSIER LaRevueDurable N°20
62
soja (suite)
Les vaches qui mangent de l’herbe se portent très bien
Wim Govaerts a étudié ce qui arrive aux va-ches qui font sans soja. Conclusion : avec un régime à base de protéines cultivées localement, les vaches produisent tout autant de lait, voire plus. Plus respectueuse de l’animal et de l’en-vironnement, cette méthode ménage aussi le compte en banque du fermier. Greenpeace Bel-gique résume les expériences de Wim Govaerts, consultant pour les élevages laitiers biologiques en Flandre depuis dix ans.
Lait respectueux de l’environnement. Eviter les OGM en cultivant autrement. Greenpeace, 2005.
www.greenpeace.org/belgium
Les hommes se portent mieux si les vaches mangent de l’herbe
Le lait et la viande issus d’élevages herbagers sont meilleurs pour la santé humaine. L’Union of Concerned Scientists a sorti en mars la pre-mière étude complète qui confirme que le bœuf et le lait provenant d’animaux élevés entière-ment dans des pâturages ont des niveaux plus hauts en oméga-3, acides gras bénéfiques, que les bœufs et les vaches laitières élevés de façon conventionnelle. Le lait produit à partir d’herbe tend à avoir un taux plus élevé en l’oméga-3 ap-pelé acide alpha-linoléique, dont il est démon-tré qu’il réduit le risque de maladies cardiaques. Les bœufs et les vaches laitières élevés sur les
pâturages ont aussi un niveau plus haut en un autre acide gras, dont les études sur animaux montrent qu’il protège de certains cancers.
www.ucsusa.org
A table avec Cargill et McDo
L’entreprise Cargill achète du soja produit dans des fermes illégales gagnées sur la forêt amazonienne, l’achemine depuis un port qu’elle a illégalement fait construire vers celui de Liver-pool, au Royaume-Uni. Là, l’éleveur industriel Sun Valley, filiale de Cargill, nourrit avec ce soja des animaux destinés à devenir des Chicken McNuggets redistribués dans les restaurants McDonald’s d’Europe. Dans son rapport « Eating up the Amazon », Greenpeace deman-de l’assainissement de cette filière mafieuse.
www.greenpeace.org.uk/mcdonalds/loggi nit.html
Coop : pas de déforestation dans mon assiette
En Suisse aussi, les animaux d’élevage con-somment du soja issu de cultures qui contri-buent à la déforestation. En Amérique du Sud, une surface équivalente à celle du canton de Fribourg est dévolue à la culture de soja exporté vers la Suisse. Le WWF et la Coop collaborent pour s’assurer de la provenance de ce soja. Avec le soutien de la Coop, le WWF étudie les me-sures à prendre pour établir une filière 100 % durable pour le soja de fourrage. On ne peut que souhaiter bonne chance à ces deux parte-naires, tant ils avancent sur un terrain miné.
www.wwf.chwww.responsiblesoy.org
SANTÉ : GARDER LA PÊCHE
Manger frais
Plus les fruits et légumes proviennent de régions proches des consommateurs, plus ils sont frais, nutritifs et bons pour la santé. C’est pourquoi le Programme santé environnement de l’Office fédéral de la santé promeut l’agricul-ture et de proximité. Se nourrir au rythme des saisons introduit une diversité très bénéfique dans l’alimentation : plus elle est variée, plus el-le couvre les besoins du corps en nutriments.
Mais les vitamines sont filles capricieuses qui n’aiment ni le stockage, ni le transport, ni l’air, ni la lumière. Les fruits et légumes sont donc à manger les plus frais possible. Chaque jour passé au frigo et c’est 25 % de vitamine C qui s’évaporent des légumes à feuille (épinards, salades, etc.). Pour garder les vitamines, il faut laver fruits et légumes brièvement et éviter de le faire à l’eau courante. Il ne faut évidemment pas les laisser dans l’eau, les couper le moins possible et uniquement au moment de les cuire ou de les manger. Les mixer détruit les vitamines. Si on les cuit, il vaut mieux le faire à la vapeur et le moins longtemps possible. Autre recommandation : consommer les plats tout de suite. Les restes doivent aller le plus rapidement possible au réfrigérateur et n’en sortir que pour être définitivement mangés. La Société suisse de nutrition n’est pas avare en conseils pour mieux se nourrir. Sur les vitami-nes, consulter le n° 2/2004 de sa revue Tabula, accessible en ligne.
www.sge-ssn.ch
Plus de fruits et légumes
C’est une bonne chose que de faire attention à la fraîcheur et à la manipulation des fruits et légumes. Mais le plus important est d’en man-ger suffisamment. Une alimentation équilibrée, incluant cinq portions de 120 grammes de lé-gumes et de fruits chacune par jour contribue à la santé et au bien-être. La Fédération romande des consommateurs a conçu une brochure sim-ple, cinq par jour, qui détaille les menus d’un jour et donne des conseils pratiques pour rester en forme en mangeant.
www.frc.ch

DOSSIERLaRevueDurable N°20
63Et puisque la majorité de la popula-
tion ne mange plus à la maison à midi, il est intéressant de repérer les restaurants et cantines qui portent le logo Fourchette verte, car ils prêtent attention à l’équilibre des menus.
www.fourchetteverte.ch/
MANGER MOINS DE VIANDE
Journée sans viande
Après les Journées sans voiture, sans télé, sans achat, voici la Journée sans viande. Chaque année, le 20 mars, des milliers de végétariens à travers le monde organisent des actions pour informer le public sur le mode de vie végétarien et les raisons qui motivent leur choix. Cette an-née, des manifestations ont eu lieu dans treize villes françaises et deux villes suisses. Toute l’année, il est possible de contacter l’un de ces groupes pour demander des conseils ou poser des questions.
www.journee-sans-viande.info/
Guide gastronomique
Pour manger sain dans plus de vingt villes de France, le Guide des restaurants végétariens de France et ses plus de 250 adresses est une bonne entrée. Pour chaque restaurant, il fournit un descriptif, les horaires d’ouverture, ce qu’on peut y manger, à quel prix et le pourcentage en approvisionnement bio des ingrédients utilisés en cuisine. Cette maison d’édition publie aussi des livres de recettes bio fort appétissantes.
www.laplage.fr
CONSOMMATION
L’huile de palme
L’huile de palme a plusieurs points communs avec le soja : ses usages sont multiples et elle détruit la forêt. Plus de 80 % de la production mondiale provient de Malaisie et d’Indonésie, où les rangées de palmiers à huile remplacent des forêts tropicales. Et puisque la demande reste forte, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Colombie s’y mettent. Le grand distributeur suisse Migros cherche à créer, avec le WWF, une
filière d’ap-provisionne-ment d’huile de palme qui ne contribue pas à la déforestation et respecte les normes sociales. Ils sont à la base de la « Table ronde sur l’huile de palme durable » (RSPO).
En novembre, l’organisation non gouver-nementale la Déclaration de Berne (DB) s’était fait l’écho des syndicats de travailleurs agricoles qui dénoncent, parmi les critères de « durabi-lité », l’absence d’interdiction du paraquat. Cet herbicide, largement utilisé dans les plantations d’huile de palme, tue chaque année des milliers de paysans. Depuis, les critères ont été modifi és. « Ce n’est pas une victoire à 100 %, mais un bon point de départ pour aboutir à l’interdiction du paraquat en 2008 », s’est réjouit François Meienberg, de la DB.
www.evb.ch/fr/p25005750.htmlwww.sustainable-palmoil.org
REVUE
La disparition des paysans réjouit certains philoso-phes français, qui les assimilent à un con-servatisme hostile au progrès et rebelle à la démocratie. Dans un ar-ticle de la revue Ecologie
et Politique, Yves Dupont décrypte ce discours et détaille pourquoi il faut, au contraire, pleurer ces paysans qui disparaissent. Dans l’introduc-tion au dossier qu’elle coordonne sur les pay-sans, Estelle Déléage résume à merveille les abî-mes qui séparent l’agrobusiness mondialisé de la paysannerie. L’article de Christian Mouchet et Catherine Darrot sur l’agriculture polonaise, où travaille encore 19 % de la population active du pays, est passionnant.
Paysans malgré tout ! Ecologie et Politique, 31, 2005.
LIVRES
Fin de vie
A Jorwerd, la dispa-rition des paysans et du monde qui va avec est allé très vite lors du dernier de-mi-siècle. Dans ce village ty-pique de Frise, aux Pays-Bas, le supermarché a remplacé la vente à la ferme, la voiture le vélo, les farines animales l’herbe, les trayeuses automatique les garçons de ferme. Et au bout du compte ? Rien qui vaille. Il ne subsiste qu’un seul paysan dans le village dont la population a fondu de 620 à 330 habitants de 1950 à 1995. Et il n’est pas rare que les vaches donnent naissance par césarienne, car le veau
qu’elles portent, d’une race à viande, est trop

DOSSIER LaRevueDurable N°20
64LA PÉDAGOGIE PAR L’EXEMPLE (et le Palais)
Chaque soirée du cycle de conférences de LaRevueDurable était précédée d’un buffet composé en majorité de produits biologiques et locaux. En plus d’agrémenter les soirées, ces buffets ont attiré les gens une heure avant le début de la confé-rence, leur donnant le temps de se rencontrer et de se renseigner sur les stands des organi-sations. En tout, envi-ron 790 repas ont été servis. A Lausanne, Fabrizio Ilardo a dû faire face à une avalanche de demandes pour dévoiler la recette de sa soupe à la courge et à la vanille. Et sa compagne Sinika Bohnet lui a fait une rude concurrence avec un succulent plat de lentilles. A Genève, le couscous végétarien d’Imane Lauraux et son équipe de bénévoles hypermotivées ont fait les délices du public qui ne peut que regretter que ce Lo’13’to (pronon-cer l’aut’ restau) soit ouvert uniquement sur demande. A Neuchâtel, on ne pouvait qu’être surpris qu’une seule ferme, celle de Danielle Rouiller, puisse fournir autant de céréales, fro-mages, charcuteries et légumes différents. Des victuailles mises en valeur par le délicieux pain bio de la ferme Le Chat noir, où il est en vente.
Pour ceux qui désirent reprendre l’idée, voi-ci les adresses des restaurateurs qui ont nourri les discussions :
Fabrizio Ilardo, Grande-Rue 511373 Chavornay, tél. : 079 365 75 68
Sinika Bohnet, La Cafetière verte, rue de laBarre 18, 1005 Lausanne, tél. : 076 318 19 40
Association Lo’13’to, 17-19, rue des Gares1201 Genève, tél. : 022 733 71 20
Danielle Rouiller, Aurore 62053 Cernier, tél. : 032 853 78 06
Ferme Le Chat noir, Murwww.lechatnoir.ch
Et pour la vaisselle compostable : www.pacovis.ch g
grand pour naître naturellement. Geert Mak relate avec sensibilité et force détails les derniè-res années d’une culture qui perdurait depuis des siècles et ne vit plus aujourd’hui que dans le souvenir de ses derniers représentants.
Geert Mak. Que sont devenus les paysans ?1950 – 2000. Jorwerd, village-témoin, Paris, Autrement, 2005.
Nourrir le monde
L’analyse, chiffres à l’appui, de Mar-cel Mazoyer et de Laurence Roudart, agronomes et spé-cialistes des échanges agricoles, sur l’urgence qu’il y a à soutenir les petits paysans pour vaincre la faim et la pau-vreté dans le monde reste l’une des plus so-lides qui soit. La relire sera toujours profi -table. D’autres articles plus « mainstream »complètent cet ouvrage collectif sur les pers-pectives pour nourrir des humains toujours plus nombreux.
Marcel Mazoyer et Laurence Roudart (sous la direction de). La fracture agricole et ali-mentaire mondiale, Universalis, Paris, 2006.
Bandes dessinéesLa nouvelle bande dessinée
du Grad raconte deux histoires bien connues des altermondialistes.
L’une est celle des poulets européens qui coulent les producteurs camerounais. L’autre met en scène Lee, paysan sud-coréen qui s’est suicidé pendant la réunion de l’Organisation mondiale du commerce de Cancun. Mais elle n’en reste pas aux tristes réalités et imagine un futur meilleur. Un dossier pédagogique et des jeux fi gurent à la fi n de l’album.
Une deuxième bande dessinée de cette col-lection aborde le commerce équitable illustré par la vie de travailleurs dans différents en-droits du globe.
Des bulles sur les mar-chés agricoles, Grad.
Des bulles dans lecommerce, Grad.
www.grad-france.org www.grad-suisse.org
ci les adresses des restaurateurs qui ont nourri les discussions :
Des bulles sur les mar-

DOSSIERLaRevueDurable N°20
LRD
Bilan du cycle de 3 x 3 conférencesinspirées du « Cauchemar de Darwin »
Le cycle de neuf soirées que LaRevueDurable a organisé sur l’agriculture avait deux buts ma-jeurs. D’abord informer sur l’impact social et écologique des règles actuelles du commerce agricole. Essayer ensuite de comprendre quoi faire et comment s’y prendre dès lors que l’on a compris que ces règles injustes poussent l’agriculture sur une pente non durable. Le but n’était donc pas d’animer des débats contra-dictoires, mais de rassembler des gens qui par-tagent des préoccupations et des intérêts com-muns, d’assumer un rôle éducatif dans l’esprit d’une université populaire, en outre tournée vers l’action grâce à la présence, tout le long du cycle, d’organisations engagées.
Les soirées 1 avaient pour thème la destruc-tion des écosystèmes et des petits paysans par les cultures d’exportation, en l’occurrence du soja en Amérique du Sud (Marc Hufty) et di-verses cultures de rentes en Asie du Sud-Est (Marc Dufumier). Les soirées 2 portaient sur la réorganisation des marchés agricoles du mon-dial au local (Claude Auroi) et le commerce équitable comme outil de développement et de justice sociale (Guy Durand). Les soirées 3
traitaient de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso (Gil Ducommun) et de l’agricul-ture durable dans le Grand-Ouest en France (Christian Mouchet) en rapport avec l’agricul-ture contractuelle de proximité.
Un public nombreux et diversifié
Au total, environ 550 personnes ont assisté à la première soirée, 500 à la deuxième et 410 à la troisième. Et malgré la fidélité de plusieurs centaines d’ « habitués » aux trois soirées, il y a eu un grand roulement au cours du cycle. Le public des conférences était plutôt hétérogène, mélange d’étudiants avancés, de personnes dans la force de l’âge et de retraités. De façon intéressante, les soirées 2, surtout à Lausanne et à Neuchâtel, ont attiré une très forte pro-
portion de jeunes. Sans doute cela atteste-t-il leur très fort intérêt pour tout ce qui touche au commerce international. Il faut dire aussi que les deux « fées » de LaRevueDurable ont beaucoup usé de l’affiche et du courriel pour attirer ce public-là.
Même si le gros de l’assistance était com-posé de non-spécialistes, les milieux agricoles étaient très présents sur les trois soirées. Les conférences sur l’Asie du Sud-Est et le Burkina Faso ont attiré des agronomes, des membres d’organisations non gouvernementales de dé-veloppement et des personnes actives dans la coopération. A Genève 3, parmi quelques Afri-cains, plusieurs Burkinabés sont venus.
Pour les organisateurs, la grande leçon de ce cycle est qu’il est impossible de faire une soirée sur un thème limité. Le cas de la soirée 1 à Lau-sanne sur les aspects écologiques et sociaux des dégâts dus au soja est éclairant. Lors de la table ronde, des questions insistantes sont venues sur le capitalisme, le néolibéralisme, la dépendance de l’Europe aux protéines vé-gétales étrangères. Or, il n’est pas possible de
prétendre, comme nous l’avons fait ce soir-là : « Revenez en soirée 2, car nous évoquerons la réorganisation des marchés agricoles. Et re-venez aussi en soirée 3, car nous aurons un spécialiste de l’agriculture durable. » Les gens veulent des réponses sur-le-champ.
Cela n’a toutefois pas empêché les deux buts majeurs de LaRevueDurable d’être at-teints : informer le public dans l’esprit d’une université populaire et appuyer les organisa-tions qui œuvrent pour un commerce agricole plus juste, une agriculture plus écologique et de proximité. Il est impossible de chiffrer l’im-pact réel du cycle, mais malgré ses imperfec-tions, environ 1000 personnes sont venues au moins une fois et 400 deux ou trois fois. Cela prouve que la thématique intéresse, qu’il y a
une demande à laquelle LaRevueDurable a pu au moins apporter des éléments de réponse.
Un lieu de rencontre
Plusieurs des six orateurs ont reçu des solli-citations pour présenter leurs travaux ailleurs. Et la plupart des représentants d’organisations qui tenaient des stands et ont participé à une table ronde ont manifesté leur enthousiasme. Catherine Morand (Swissaid) nous félicite « pour le nombreux public que [nous] avons réussi à drainer. Surtout des jeunes d’ailleurs. » Tobias Frey (Helvetas) et Martin Rohner (di-recteur général de la Fondation Max Havelaar Suisse) ont regretté l’absence d’initiative simi-laire en Suisse allemande.
Du côté de l’intérêt manifesté aux stands, Aline Clerc (FRC) a eu de « très bons re-tours, beaucoup d’intérêt ». Jean-Claude Huot (secrétaire permanent à la Déclaration de Berne) a reçu des signatures. Pierre Flatt, du centre de documentation de l’Alliance Sud, a rencontré « un public sensibilisé [et] différent de nos usagers habituels. Cer-tains nous ont rendu visite par la suite ». Et Jean-Claude Huot et Pierrette Rey (WWF) ont noté un public « mixte et diversifié », pas composé que d’habitués.
Le Lopin bleu a engrangé de l’intérêt et Le Jardin potager quelques nouveaux contrats. Rudi Beerli (Uniterre) conclut que la soirée a fait connaître le syndicat Uniterre. Et Jac-ques Roura (Amaps Haute-Savoie) « a fait beaucoup de contacts intéressants au stand ». Enfin, Martin Rohner a apprécié qu’une revue ait pris l’initiative d’un tel cycle, car c’est une entité plus neutre que les œuvres d’entraide ou l’administration fédérale. De même, de très nombreux participants ont remercié la revue d’avoir « fédéré » un tel cycle.
Plusieurs intervenants ont trouvé que La-RevueDurable n’avait pas assez préparé les tables rondes, laissant notamment trop la discussion partir en direction des orateurs principaux. Cependant, nombreux sont ceux, et souvent les mêmes, qui nous suggèrent de récidiver ou sont partants pour participer si une telle récidive a lieu. g
65

66
100% EcologiqueEclairages lumière du jour à très basse
consommation
• Consomme 70 fois moins d'énergie qu'une lampe
halogène classique pour la même puissance• Durée de vie garantie de 11 ans en service continu
• Délivre une lumière blanche proche de celle du soleil
• Rendement supérieur à 95%, ne chauffe pas
• Totalement étanche à l'eau et n'émet aucun
rayonnement électromagnétique• Réalisation en « Bio-résine » 100% biodégradable
Conception et fabrication en France par: Quality- Teknos BP n°2 , F- 12330 Salles la source
Tél: +33 (0) 565 781 394 E-mail : [email protected]
94.5x134+5_vecto 30.3.2006 11:16 Page 1
Renvoyer le talon-réponse à : Les Verts NE, Secrétariat cantonal, rue de la Côte 39, 2400 Le Locle, ou par courriel en mentionnant comme sujet « pré-inscription Uni d’été 2006 »: [email protected]
Renseignements complémentaires: 032 852 07 26 ou 032 855 14 53
Le Camp à Vaumarcus (NE) (entre Yverdon et Neuchâtel, http://www.lecamp.ch)
Prix : Fr. 200.-, tout compris, pension complète, en dortoir (supplément en chambres avec literie : de 10.- à 16.- / p) Garderie dans maison séparée : organisée sur demande.
ATTENTION : le nombre de places est limité à 100 personnes! Un programme détaillé vous parviendra ultérieurement.
Pour des raisons d’organisation une pré-inscription est instamment demandée(La priorité sera donnée aux personnes qui passent les deux nuits !) Prix réduit sur demande, le prix ne doit pas être
un obstacle à la participation
La Fondation pour une Terre Humaine subventionne les projets associatifs de défense de l’environnement visant à changer les comportements individuels.
Nous nous intéressons notamment à l’agriculture respec-tueuse de l’environnement, à la prévention des risquesliés aux pollutions qu’elles soient d’origine chimi-que, génétique, électromagnétique ou nucléaire, à la défense des animaux, aux matériaux écologiques, aux énergies renouvelables…
Les projets sont examinés par le conseil de fondation, qui se réunit trois fois pas an, en mars, en juillet et en novembre.
FINANCEZ VOTRE PROJETASSOCIATIF
DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT
FONDATION POUR UNE TERRE HUMAINE
15 route de Fribourg, CH-1723 Marly 2tél : + 41 26 435 33 70fax : + 41 26 435 33 71
C
M
J
CM
MJ
CJ
CMJ
N
FTH-Quadri.pdf 12.12.2005 20:32:42

67
AGENDALaRevueDurable N°20
MONDE
Festival de la terreLe Festival mondial de la terre est une grande célébra-
tion de la planète. Elle a lieu du 19 au 25 juin dans trente
pays sur les cinq continents. Thème de cette année :
l’eau. L’événement repose sur les initiatives d’individus
et d’associations qui, partout, proposent des manifesta-
tions. Lors de la première édition, en 2005, des anima-
tions ont eu lieu dans trente départements français.
En Suisse, l’association NiceFuture relaie cette ini-
tiative. Du 21 au 25 juin, elle organise concerts, exposi-
tions et spectacles humoristiques au Flon, à Lausanne.
Des personnalités de tous bords y sont attendues pour
faire leur déclaration d’amour à la planète. Tout un
chacun est invité à prendre des initiatives partout en
Suisse romande.
www.festivaldelaterre.org
www.nicefuture.com
FRANCE
le Grand Palais. Le week-end des 3 et 4 juin sera festif
avec l’inauguration du parc Jean Baptiste Lebas et un
programme de visite de jardins privés. Le 4 juin, une
balade urbaine aura pour thème « la place de la nature
dans la ville dense ».
Tél. : + 33 (0)3 20 15 93 72
Journée de débats Le Centre d’études sur le transport et l’urbanisme
(Certu) organise le 30 mai, à Lyon, une journée de
conférences et débats sur « quelle mobilité après le
pétrole...? » Sept conférenciers, dont Jean Laherrère et
Jean-Luc Wingert, évoqueront le pic du pétrole et son
impact sur les transports.
www.certu.fr
Foire Biocybèle, la foire aux produits de l’agriculture
biologique et aux alternatives du Grand Sud-Ouest,
se tient cette année les 4 et 5 juin à Gaillac (parc
Foucaud). Placée sous le thème du pain, cette 24e édi-
tion accueillera, le temps d’une conférence, le profes-
seur Belpomme, cancérologue et président de l’asso-
ciation Artac.
Semaine du développement durableLa Ville d’Orléans organise, les 10 et 11 juin, la
Fête du développement durable. Des conférences,
des animations de rue, 150 exposants prendront
leurs quartiers sur les bords de la Loire et place de la
République pour offrir aux visiteurs les moyens de
s’informer et d’agir.
RencontresLe Salon Habis sur la construction saine et les éner-
gies renouvelables a lieu les 10 et 11 juin à Landogne,
près de Pontaumur, dans l’ouest du Puy-de-Dôme.
Tél. : + 33 (0)4 73 79 90 06
Agenda
SUISSE
Fête du développement durable à Genève
Genève fête le développement durable les 10 et
11 juin. Evénement unique en Suisse, à ne rater sous
aucun prétexte. Toutes les informations figurent au dos
de cette revue.
ExpositionLa biodiversité des espèces, des écosystèmes et des
cultures de Suisse s’expose au Muséum d’histoire natu-
relle de la Ville de Genève. Toile de vie ! Exposition du 4
avril au 24 septembre 2006.
1, route de Malagnou, 1208 Genève
Entrée libre. Ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 17h.
Pour des informations sur les activités qui entou-
rent cette exposition, qui se déroule en parallèle à
celle du Musée d’histoire naturelle de Berne :
www.biodiversite.ch
Semaine de réflexionComment concevoir la ville durable ? En quoi les
projets de renouvellement urbain peuvent-ils y contri-
buer ? Ce sont les thèmes de réflexion que proposent
la Ville de Lille et ses partenaires, du 29 mai au 4 juin, à
l’occasion d’une semaine « Nouvel art de ville, nouvel
art de vivre », qui s’inscrit dans la Semaine nationale
du développement durable et de la campagne de cette
année « Lille Ville Nature ».
Les 29, 30 et 31 mai, le colloque « Du rêve écolo-
gique et culturel à la réalisation de la ville durable »
réunira élus, universitaires, techniciens, acteurs locaux
et habitants venus de toute l’Europe. Du 31 mai au
2 juin, les Assises européennes du paysage occupent
Assemblée de LaRevueDurable
L’Assemblée annuelle de l’association Les
amis de LaRevueDurable se réunit jeudi 1er juin,
à Fribourg. Elle est ouverte à tous ceux qui veu-
lent soutenir la revue.
Ecrire à [email protected]
pour recevoir la convocation. Les lecteurs de la
revue qui souhaitent adhérer à l’association, mais
qui ne peuvent pas venir à l’assemblée, sont aussi
invités à s’annoncer.

68 A propos de l’interview de Mathis Wackernagel,
« Le monde vit au-dessus de ses moyens écologiques »,
LaRevueDurable n° 18.
Mon père est un pianiste virtuose qui interprète la
(très belle) musique des compositeurs français (Ravel,
Debussy, Saint-Saëns…) aux quatre coins du monde.
Mais voilà, à force de prendre l’avion chaque semaine,
j’ai calculé que son empreinte écologique est de treize
planètes ! Je n’ai encore jamais osé en parler avec lui.
Comment aborder avec nos proches le thème de la
modification des comportements sans qu’il soit perçu
comme une intrusion déplacée dans la vie privée et
avec une chance d’être entendu ? Il doit bien y avoir des
« techniques » !
Pourquoi pas une rubrique dans LaRevueDurable
(avec exemples de dialogues à l’appui) ?
Benjamin Rogé,
Lille, France
Cher Benjamin Rogé,
Le propos de l’Empreinte écologique n’est pas de
dire aux gens combien ils sont mauvais ou qui a tort.
Il s’agit d’un instrument de mesure qui rend visible
ce qui est (de combien de nature disposons-nous et
combien en utilisons-nous) et aide ceux qui veulent
prendre des initiatives contre notre possible mort
écologique.
Notre approche est en premier lieu un engage-
ment pour la qualité de vie des gens. Des empreintes
écologiques plus grandes aident parfois à l’améliorer.
Bien manger et disposer d’un habitat sûr et conforta-
ble nécessite des ressources. Mais le point central est
que la nature nous procure seulement les ressources
d’un budget : en moyenne globale, 1,8 hectare d’es-
pace bioproductif par personne. Si notre demande
collective en ressources devient si importante qu’elle
se met à excéder la capacité régénératrice de la bios-
phère, alors nous minons la capacité écologique de la
Terre à satisfaire les besoins de tous.
Ce que les résultats de l’empreinte écologique
montrent est que nous avons à l’heure actuelle un
problème – un problème collectif. Nous avons besoin
d’inviter le plus possible de gens à mettre leur énergie
créative à comprendre ce que nous pouvons faire pour
surmonter ce défi du dépassement écologique. Dite
clairement, la question prépondérante est la suivante :
comment pouvons-nous donner du bien-être aux
gens avec, en moyenne, moins de 1,8 hectare d’es-
pace bioproductif par personne ou 1,2 si nous passons
à une population globale de 9 milliards ? Et même
encore moins si nous voulons laisser assez d’espace
aux espèces sauvages pour qu’elles survivent et s’épa-
nouissent.
Qu’est-ce que cela signifie pour votre père ? Il joue
du piano pour augmenter la qualité de vie de per-
sonnes – et vous reconnaissez que cela nécessite des
ressources. Les sociétés peuvent choisir d’avoir plus de
concerts de piano et moins d’autres choses. Peut-être,
la société est-elle satisfaite avec ce choix de concerts,
peut-être cela vaut-il les ressources nécessaires. Ou
peut-être que ce que vous voulez réellement, c’est par-
tager avec votre père votre préoccupation pour l’ave-
nir et votre inquiétude à propos des contraintes qui
nous lient. En jouant du piano pour d’autres, votre
père leur apporte quelque chose de la façon la plus
merveilleuse qu’il connaisse. Dès lors, la question de
la transformation revient vers vous : êtes-vous prêt à
vous engager avec lui pour l’aider à rendre sa vie encore
plus merveilleuse et satisfaire une gamme encore plus
large de besoins ? Etes-vous capable de faire preuve de
tant de compassion et d’attention à son égard qu’au
bilan il veuille mettre son énergie créatrice à aider à
trouver des moyens pour que l’humanité s’éloigne du
dépassement écologique ?
Mathis Wackernagel
www.footprintnetwork.org
Lien : www.grist.org/advice/ask/2005/12/14/foot-
print/index.html?source=daily
Bonjour Benjamin,
Merci de votre lettre et de la question fondamen-
tale qu’elle soulève. Malheureusement, il n’y a pas de
solution « clef en mains » au problème que vous nous
soumettez. S’il existait des « trucs » simples pour con-
vaincre ses proches, famille ou amis, il est vraisem-
blable que cela se saurait. Nous-mêmes, rédacteurs
de LaRevueDurable, ne savons pas comment convain-
cre nos proches qu’il est nécessaire de réorienter nos
comportements collectifs pour moins peser sur les
ressources fragiles et limitées de la biosphère.
Celles et ceux qui sont conscients de la crise écolo-
gique se heurtent souvent au désintérêt de leurs pro-
ches, mais chaque cas reste particulier et relève de la
sphère privée. Peut-être, si vous avez la motivation,
pouvez-vous l’exposer et l’expliquer en détail à un
tiers compétent et formé en tant que médiateur qui
pourrait intercéder entre vous et votre père.
Une autre possibilité serait d’offrir à votre père un
« billet climatique » pour son prochain anniversaire.
Ce billet, au prix de 5 euros par heure de vol, « com-
penserait » ses émissions de dioxyde de carbone (CO2).
Compenser l’ensemble de ses déplacements aériens
serait trop onéreux, mais vous pouvez acheter ce billet
pour un concert qui lui tient particulièrement à cœur,
par exemple. Cela vous permettrait de lui montrer que
le problème est si grave que des organisations essaient
d’y répondre, et de vous sentir ainsi moins accablé par
son empreinte écologique.
www.co2solidaire.org
www.myclimate.org
LRD
CORRESPONDANCE LaRevueDurable N°20

CORRESPONDANCELaRevueDurable N°20
69
Prochains dossiers de LaRevueDurable :
Juillet-août 2006 :
La montagne
Septembre-octobre 2006 :
Les déchets
Consultez notre site www.larevuedurable.com
ou appelez le + 41 (0)26 321 37 10
pour connaître le point de vente de LaRevueDurable
le plus proche de votre domicile
A propos de l’article « Pas à pas, le marcheur peut
reconquérir l’espace urbain », de Sonia Lavadinho et
Yves Winkin, LaRevueDurable n° 18.
Madame, Monsieur,
Les jardins éphémères aménagés au mois d’août sur
les berges de la Seine paraissent idylliques vus de loin.
Pour les Parisiens cela l’est beaucoup moins, ce sont des
« jardins électoraux » pour le maire de Paris, sans plus.
Ces jardins coûtent, de l’aveu même de M. Delanoë,
700 000 euros à la Ville. Avec cet argent, il serait plus intel-
ligent de construire des jardins permanents sur d’autres
berges, Rive gauche par exemple, mais ça ne ferait pas
mousser M. Delanoë. Je rappelle pour mémoire que les
voitures ne passant pas sur la voie sur berges passent
sur les quais Ponts et y créent des embouteillages d’où
une pollution aggravée. Quand on sait qu’une voiture
à vitesse stabilisée sur les berges pollue quatre fois moins
que la même sur les quais Ponts, on peut se demander où
est le bénéfice pour les Parisiens, mais on voit très bien
où il est pour le maire. Cela en bon français s’appelle du
racolage électoral et de la démagogie. J’ajoute pour finir
que je n’ai pas de voiture et que j’utilise les transports en
commun, ce qui me permet de juger cette « amélioration
de la vie » selon M. Delanoë.
Recevez mes salutations,
Gabriel Pagny
Paris
Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de
nous lire et de nous faire part de vos commentaires
sur les aménagements éphémères des berges de la
Seine. Les opérations éphémères, comme les actions
immatérielles, peinent à trouver une légitimation à
l’égard des opérations infrastructurelles qui sont fai-
tes pour durer. Le coût-bénéfice de l’éphémère versus
le durable fait l’objet de maints débats avant, pen-
dant et après le déroulement de l’opération, au sein
du monde politique et parmi les citoyens.
Beaucoup de villes, néanmoins, font le choix
d’investir dans des actions éphémères, en Europe
et ailleurs dans le monde. Des jeux olympiques aux
expositions universelles, des carnavals aux fêtes de
la musique, des cérémonies religieuses aux jeux de
cirque, l’Evénement est indissociable de la Cité. Cette
tendance est plus que jamais d’actualité. La ville évé-
nementielle fait écho à une lame de fond sociétale
qui est également perceptible dans les médias, les
nouvelles technologies de la communication, l’or-
ganisation même de nos agendas quotidiens. Ce qui
fait événement est connoté positivement par une
majorité de citoyens qui va croissant, ce qui, nous
en convenons, ne reflète pas pour autant la totalité
de la population.
La fonction symbolique des aménagements éphé-
mères est d’autant plus importante qu’ils restent, jus-
tement, une parenthèse hors du temps de la ville. Dans
le cas particulier de Paris-plage, l’aspect saisonnier
joue un rôle majeur. A l’instar des vraies plages, la
saison d’été est celle qui convient le mieux aux plages
d’illusion. Où serait l’intérêt d’un Paris-plage perma-
nent, hiver comme été ?
Votre suggestion de construire des jardins perma-
nents pour l’agrément des Parisiens est tout à fait per-
tinente, mais elle répond à un autre besoin. Il y aurait
donc une pesée d’intérêts à faire entre un éphémère
cyclique qui maximise les bénéfices du pic de la saison
chaude et des aménagements peut-être moins visibles,
aux incidences plus locales, mais apportant des béné-
fices constants au quotidien des habitants. Trancher
n’est pas aisé. C’est justement dans cette marge d’ac-
tion que résident les choix du politique, les choix du
vivre ensemble en société.
Dans un contexte urbain où la ressource « sol » se
fait de plus en plus rare, et les conflits d’usages tou-
jours plus pressants entre les besoins de qualité de
vie et de mobilité, cette valorisation différenciée de
l’espace public au rythme des saisons nous semble
tirer parti en finesse des potentialités des berges de
la Seine.
Sonia Lavadinho et Yves Winkin

brèVES LaRevueDurable N°20
Brèves générales
Barroso, roi du 4x4
Une dizaine de militants de l’association belge 4x4
info ont rendu visite à leur premier ministre et à leur
ministre de l’Environnement pour protester contre la
procrastination des fabricants de voitures. Afin d’évi-
ter des normes ayant force obligatoire, l’Association
des constructeurs automobiles européens faisait en
1998 la promesse auprès de la Commission euro-
péenne de réduire les émissions moyennes de dioxyde
de carbone (CO2) à 140 g/km d’ici 2008. Or, en 2005,
les voitures des constructeurs européens émettaient
en moyenne 160 g de CO2/km, soit seulement 1 % de
moins qu’en 2004.
Ils en ont profité pour se plaindre du président
de la Commission européenne, José Manuel Barroso,
qui roule en 4x4. Et pas n’importe lequel : il a choisi
une Volkswagen Touareg, celle-là même qui a gagné
le Prix Tuvalu du dérèglement climatique. Selon le
Réseau Action climat (Rac), qui décerne le prix, ce
modèle rejette 346 g de CO2/km et consomme 17,9
litres aux 100 kilomètres.
http://webage.be/4x4info/photos.htm
Mine d’or
On la croyait à l’abri. La montagne de Kaw, site
d’une biodiversité exceptionnelle nichée au cœur de
la forêt tropicale, se trouve dans le périmètre du Parc
naturel régional de Guyane et jouit de plusieurs sta-
tuts de protection nationale et internationale. Son
malheur est de ne pas abriter que des plantes et des
animaux de grand intérêt, mais aussi de l’or. Un tré-
sor que la multinationale canadienne Cambior se
propose d’exploiter en ouvrant une gigantesque mine
à ciel ouvert.
Une coalition d’associations coordonnées par le
Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques
et le collectif « Quel orpaillage pour la Guyane » font
la liste de toutes les menaces. L’exploitation de ce site
entraînera une déforestation et une pollution néfastes
pour la faune et la flore. Sur la durée du projet (sept
ans), plus de 9 millions de tonnes de roches seront
broyées et mélangées à 30 000 tonnes de produits
chimiques (cyanure, chaux...). Sans compter qu’un
accident industriel est évidemment possible. Le fleuve
Comté, d’où la ville de Cayenne tire son eau, serait
alors pollué au cyanure.
L’argument de Cambior ? La création de plus de
300 emplois. Le collectif n’est pas convaincu. Il cal-
cule que les retombées économiques pour la Guyane
se résument à 50 euros par kilo d’or. Une pétition est
à signer en ligne.
www.collectifor.ouvaton.org
Oléoduc au large du lac Baïkal
Le 21 avril, une foule défile à Moscou sous les slo-
gans « Plutôt le Baikal que le pétrole » et « Pour que
vive le Baikal ». Les associations écologistes dénon-
cent le projet de Transneft, compagnie d’Etat russe,
qui prévoit de faire passer un oléoduc à 800 mètres
du lac. Et voilà que cinq jours plus tard, Vladimir
Poutine annonce à la télévision que le tracé de l’oléo-
duc, qui acheminera le pétrole depuis la Sibérie vers
le Pacifique, a été revu : il passera à 40 kilomètres au
large du lac.
Pour les plus de 100 000 citoyens russes qui ont
signé la pétition contre le premier projet, les associa-
tions écologistes et l’Unesco, c’est le soulagement. Ils
s’étaient émus de voir ce bijou, classé au Patrimoine
mondial, menacé de marée noire à la première rup-
ture de tuyau. Situé au sud-est de la Sibérie, le lac
Baïkal, d’une superficie de 3,15 millions d’hectares,
est le plus ancien (25 millions d’années) et le plus
profond (1700 m) lac du monde. Il contient 20 % des
eaux douces non gelées de la planète. Son ancienneté
et son isolement ont produit l’une des faunes d’eau
douce les plus riches et originales de la planète, ce
qui lui vaut le surnom de « Galapagos de Russie ».
Familières des manigances du pouvoir en place, les
associations restent néanmoins méfiantes.
www.greenpeace.org/russia/en/
Pas de politique contre le bois illégal
Le baromètre de l’abattage de bois illégal annonce
un avis de tempête. Le WWF a regardé à la loupe
la politique de 23 pays européens concernant l’abat-
tage de bois illégal. Le Royaume-Uni occupe la tête
du hit-parade du baromètre, suivi des Pays-Bas, du
Danemark, de la Lettonie et de la Belgique. La France
arrive 7e, la Suisse 13e. Mais, selon le rapport, aucun
pays n’a de politique satisfaisante.
www.panda.org/barometer
Des cantons plus écolos que d’autres
Action commune de Greenpeace, du WWF et du
Fonds Bruno-Manser, Foretsanciennes.ch a enquêté
auprès des cantons suisses pour connaître la durabilité
de leurs achats en bois et papier. Seuls les cantons de
Genève, Neuchâtel, Vaud, Bâle-Ville et Zurich veillent
à s’approvisionner en bois et en papier durables. Les
autres, qui n’ont pas de politique en la matière, sont
complices de la destruction des forêts anciennes.
www.foretsanciennes.ch
Pétition
« Arrêter les études sur le réservoir de Charlas et
étudier les solutions alternatives » est le titre d’une
nouvelle pétition du Comité contre Charlas, pour la
sauvegarde de la Garonne, qui s’oppose à la création
d’un barrage destiné à capter l’eau pour arroser le
maïs. La pétition demande que plus aucun denier
public n’aille dans des études pour la construction du
barrage et que les fonds soient investis dans d’autres
solutions pour mieux gérer l’eau dans l’agriculture.
www.uminate.asso.fr
Anniversaire et bilan
Le droit de recours des organisations fête ses 40
ans en Suisse. Combien d’années lui reste-t-il à vivre ?
La question se pose dès lors que 25 propositions trai-
tant du sujet ont été déposées aux Chambres fédéra-
les. La plupart demandent l’affaiblissement, voire la
suppression du droit des associations de plaider la
cause de l’environnement et du patrimoine naturel
et culturel. Pourtant, les statistiques montrent que ce
droit est utilisé à bon escient. Sur 100 000 autorisa-
tions de construire délivrées chaque année en Suisse,
seulement 244 ont fait l’objet d’un recours pour des
questions écologiques. Sur ces 244 cas, 84 % ont été
réglés sans l’intervention de la justice et 60 % très
rapidement. Les organisations environnementales
ont été désavouées dans seulement 18 % des cas.
Encyclopédie
L’Association 4D lance le projet d’Encyclopédie
du développement durable : plus de 200 articles écrits
par des personnalités qualifiées feront le point des
enjeux, débats et orientations souhaitables sur les dif-
férentes problématiques du développement durable.
La souscription est ouverte.
70

Je paie francs suisses euros pour abonnement(s)
Par virement bancaire pour la Suisse : C.C. CERIN Sàrl, No 25 01 088.753-01, à la Banque Cantonale de Fribourg ; CCP de la BCF 17-49-3
Par virement bancaire pour la France et la Belgique : C.C. CERIN Sàrl, BNP Paribas d’Annemasse - RIB 30004 00683 00010071962 93 - IBAN FR76 3000 4006 8300 0100 7196 293 - BIC : BNPAFRPPANC
Par carte Eurocard/Master Card ou Visa
No de la carte
Date d’expiration Signature du titulaire Par chèque bancaire (uniquement pour la France) libellé à l’ordre de CERIN Sàrl
Je souhaite recevoir une facture
Bulletin à renvoyer • par la poste : CERIN Sàrl, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, Suisse• par fax : + 41 (0)26 321 37 12 • par tél. : + 41 (0)26 321 37 10 • par courriel : [email protected] à remplir sur : www.larevuedurable.com
Je désire m’abonner / me réabonner
pour une année (6 numéros) Au prix de 80 francs suisses ou 50 euros
pour deux ans (12 numéros) Au prix de 150 francs suisses ou 92 euros
Au tarif spécial pour les élèves, les apprentis, les étudiants et les personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité*: Fr. 60.– ou 40.– pour une année, Fr. 120.– ou Ð 80.– pour deux ans
Au tarif spécial pour les enseignants* (excepté les professeurs d’université) : Fr. 70.– ou Ð 45.– pour une année, Fr. 130.– ou Ð 82.– pour deux ans
*sur présentation d’un justificatif.
Je désire soutenir LaRevueDurable en m’abonnant pour une année au prix de Fr. 100.– ou Ð 70.– au prix de Fr. 150.– ou Ð 100.– au prix dedeux ans au prix de Fr. 200.– ou Ð 140.– au prix de Fr. 300.– ou Ð 200.– au prix de
Madame Monsieur Société
Nom Prénom
Profession ou domaine d’activité
Adresse
Code postal Ville Pays
Date et signature
40 pages de dossiers, clairs et bien documentés l’actualité internationale du développement durable des débats et des opinions d’acteurs engagés
Retrouvez LaRevueDurable tous les deux mois :
J’ai connu la LaRevueDurable par le biais de :
Je souhaite recevoir ma correspondance par courriel à l’adresse : @
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.– €
: 9
.–
L
1
8
7
1
7
-
1
8
-
F
:
9
,
0
0
€
-
R
D
LaRe
vueD
ura
ble
LaRevueDurable
DOSSIER Sur la piste d’une mobilité différente
DOSSIER
PERSPECTIVE
GEORGE MONBIOT
Pour une organisation mondiale du commerce équitable
RENCONTRE MATHIS WACKERNAGEL :Le monde vit au-dessus
de ses moyens écologiques
Des entreprises aident leurs employésà laisser leur voiture à la maison
NUMÉRO 18 • DÉCEMBRE 2005 - JANVIER 2006 • BIMESTRIEL
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
LAREVUEDURABLE PRÉSENTE :CYCLE DE CONFÉRENCES
Quelles réponses au « Cauchemar de Darwin » ?
Test : Les différents moyens de se déplacer en ville
Vers des quartiers sans voiture
SUR LA PISTE D’UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE
COUP DE PROJECTEUR
Appel à soutenir l’EcoZACdu XIIIe arrondissement de Paris
LaRe
vueD
ura
ble
LaRevueDurable
DOSSIER Des technologies appropriées pour la construction, l’eau et la santé
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.– €
: 9
.–
L
1
8
7
1
7
-
1
9
-
F
:
9
,
0
0
€
-
R
D
Le neem, arbre à miracles qui tue les moustiques vecteurs du paludisme
NUMÉRO 19 • FEVRIER - MARS 2006 • BIMESTRIEL
Récupérer l’eau qui tombe du ciel
Des maisons chaudes et bon marché en paille
POUR LA CONSTRUCTION, L‘EAU ET LA SANTÉ
DESTECHNOLOGIESAPPROPRIÉES
MINIDOSSIER La publicité harcèle les enfants, et peu de parents s’en rendent compte RENCONTRE BERNADETTE BENSAUDE-VINCENT :Les citoyens ont leur mot à dire sur la recherche scientifi que
DOSSIER
Des toilettes sèches pour économiser l’eau et fabriquer du compost
RENCONTRE JACQUES GRINEVALD :Nicholas Georgescu-Roegen, dissident de l’Occidentet visionnaire de la décroissance
LaRe
vueD
ura
ble
LaRevueDurable
DOSSIER Agriculture locale et commerce équitable
savoirs • sociétés • écologie • politiques publiques
ISS
N 1
66
0-3
19
2
CH
F :
15
.– €
: 9
.–
L
1
8
7
1
7
-
1
9
-
F
:
9
,
0
0
€
-
R
D
Au Pérou et au Mexique, la consommation équitable
débarque sur les marchés locaux
NUMÉRO 20 • AVRIL - MAI - JUIN 2006 • BIMESTRIEL
La paysannerie familiale est capable d’intensifi er la production agricole
DOSSIER
Des réponses au Cauchemar de Darwin : AGRICULTURE LOCALE
ET COMMERCE ÉQUITABLE
Dans l’Ouest français,le RAD apporte des solutionsEn Suisse et en France
l’agriculture contractuelle explose
71