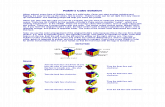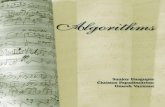Jessica_farvet_memoire_marketing_interculturel
-
Upload
jessica-farvet -
Category
Documents
-
view
108 -
download
5
Transcript of Jessica_farvet_memoire_marketing_interculturel


Mémoire de Master 2012-2014
IIInnntttééégggrrraaatttiiiooonnn dddeeesss dddiiiffffffééérrreeennnccceeesss
cccuuullltttuuurrreeelllllleeesss lllooorrrsss dddeee lllaaa ssstttrrraaatttééégggiiieee
ddd’’’iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallliiisssaaatttiiiooonnn
JJJeeessssssiiicccaaa FFFAAARRRVVVEEETTT
111111000999555666666 ––– 222000000999---222000111444
Spécialisation de 5ème Année : COMMERCE INTERNATIONAL
Tuteur de Mémoire : M. Guillaume DETCHENIQUE

2
Attestation
Je, Mademoiselle Jessica FARVET, certifie que le contenu de ce Mémoire de master n’a pas
déjà ou ne fait pas l’objet d’une soumission dans le cadre d’un autre diplôme.
Je certifie que toutes les sources documentaires sur lesquelles s’appuie ce travail sont de
manière explicite portées à la connaissance du lecteur.
Je certifie que ce Mémoire de Master respecte les conditions de fond et de forme définies par
l’ESSCA.
L’ESSCA n’entend donner ni approbation, ni improbation
aux opinions émises dans ce Mémoire de master.
Ces opinions doivent être considérées comme propres
à leur auteur.

3
Remerciements
Je tiens à remercier les personnes qui ont partagé avec moi leur expérience et leurs
connaissances, me permettant d’avancer dans ma réflexion et de découvrir ce marché
passionnant, méconnu et pourtant omniprésent dans notre vie quotidienne.
Tout d’abord, mon tuteur de Mémoire, Monsieur Guillaume DETCHENIQUE, pour son suivi
et son aide. Outre ses remarques et ses conseils concernant mon travail, je souhaite le
remercier pour la confiance qu’il m’a accordée lors du choix de mon sujet et son traitement.
Merci aussi aux autres professeurs de l’ESSCA, qui m’ont conseillée sur l’orientation, la
rédaction, et le traitement des données de ce Mémoire.
Ensuite, les professionnels du milieu qui ont pris le temps de répondre à mes questions pour la
phase qualitative, et de m’expliquer leur travail avec patience, précision et passion : Mme
Caroline BIBRE, M. Jérémy DELCHIAPPO, M. Brice JUIGNE, Mme Julia LAGREE, M.
Amaury NOGIER, Mme Moriane MORELLEC, M. Thibaut PUPAT, et M. Emmanuel TURC.
Je tiens enfin à remercier tous les anonymes qui m’ont permis de réaliser une ébauche de
phase quantitative pour aller plus loin dans mes recherches.

4
Sommaire
ATTESTATION ................................................................................................................................................. 2
REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................... 3
SOMMAIRE ........................................................................................................................................................ 4
INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 8
A. MARKETING, MONDIALISATION ET STRATEGIES D’INTERNATIONALISATION : ENTRE ADAPTATION ET
STANDARDISATION .............................................................................................................................................. 8 B. PRESENTATION DE LA QUESTION PRINCIPALE DE RECHERCHE ET TERRAIN D’INVESTIGATION .............. 9 C. ADAPTATION DES EMISSIONS TELEVISEES ............................................................................................... 10 D. OBJECTIFS DU MEMOIRE ET METHODE ................................................................................................... 11
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE ......................................................................................................... 13
I-‐ COMPRENDRE LA DIVERSITE CULTURELLE ............................................................................... 14
A. QU’EST-‐CE QUE LA CULTURE ? ................................................................................................................. 14 B. LES DIFFERENCES CULTURELLES .............................................................................................................. 16 C. L’EMERGENCE ET L’EVOLUTION DES CULTURES ...................................................................................... 20 D. L’IMPORTANCE DES VALEURS AU SEIN D’UNE CULTURE ......................................................................... 21
II-‐ PROBLEMES POSES PAR LA DIVERSITE CULTURELLE ........................................................... 22
A. L’IMPACT DE LA CULTURE SUR L’ORGANISATION ................................................................................... 22 §1. RELATIONS INTRA-‐ENTREPRISES ............................................................................................................................ 22 §2. RELATIONS INTER-‐ENTREPRISES ............................................................................................................................ 24 B. L’IMPACT DE LA CULTURE SUR L’OFFRE DE L’ENTREPRISE : PROBLEMATIQUE ..................................... 25 §1. UN “VILLAGE GLOBAL” DE CONSOMMATEURS ? .................................................................................................... 25 §2. LES DIFFERENCES CULTURELLES ............................................................................................................................ 26
III-‐ LE MARKETING CROSS-‐CULTUREL : STANDARDISATION VERSUS ADAPTATION ....... 29
A. D’UN MARCHE LOCAL A UN MARCHE GLOBAL : L’INTERNATIONALISATION ........................................... 29 §1. DEFINITION DE L’INTERNATIONALISATION .......................................................................................................... 29 §2. LES STRATEGIES D’INTERNATIONALISATION ........................................................................................................ 30

5
B. LA STANDARDISATION, OU MARKETING GLOBAL .................................................................................... 32 §1. LA NOTION DE CONSOMMATEUR GLOBAL .............................................................................................................. 32 §2. LES CARACTERISTIQUES DE LA STANDARDISATION ............................................................................................. 32 §3. LES AVANTAGES DE LA STANDARDISATION ........................................................................................................... 34 §4. STANDARDISATION : EXEMPLES .............................................................................................................................. 35 §5. LES LIMITES DE LA STANDARDISATION .................................................................................................................. 38 C. LA STRATEGIE D’ADAPTATION, OU MARKETING LOCAL .......................................................................... 41 §1. LES OBJECTIFS DE LA STRATEGIE D’ADAPTATION ................................................................................................ 41 §2. LES FACTEURS FAVORISANT L’ADAPTATION ......................................................................................................... 42 §3. LES DIFFERENTS DOMAINES D’ADAPTATION ........................................................................................................ 43 §4. ADAPTATION : EXEMPLE ........................................................................................................................................... 44 §5. LES LIMITES DE L’ADAPTATION ............................................................................................................................... 46 D. LA STRATEGIE DE STANDARDISATION ADAPTEE, OU MARKETING GLOCAL ........................................... 46 §1. LES AVANTAGES DE LA STANDARDISATION ET DE L’ADAPTATION .................................................................... 46 §2. L’EMERGENCE D’UNE STRATEGIE CONTINGENTE ................................................................................................. 48 §3. STANDARDISATION ADAPTEE : EXEMPLES ............................................................................................................ 50 §4. CONCLUSION ............................................................................................................................................................... 52
IV-‐ PROPOSITIONS DE RECHERCHE ................................................................................................... 54
CHAPITRE 2 : CADRE EMPIRIQUE .......................................................................................................... 56
I-‐ METHODOLOGIE UTILISEE POUR L’ETUDE EMPIRIQUE ......................................................... 57
A. CHOIX DE LA METHODOLOGIE .................................................................................................................. 57 B. TERRAIN D’INVESTIGATION : LE MARCHE DE L’AUDIOVISUEL ............................................................... 57 §1. DESCRIPTION DU MARCHE FRANÇAIS ..................................................................................................................... 57 §2. LES ACTEURS DU MARCHE AUDIOVISUEL FRANÇAIS ............................................................................................ 58 §3. LES EMISSIONS DE FLUX : ENTRE STANDARDISATION ET ADAPTATION ........................................................... 60 §4. LE CHOIX DU TERRAIN D’INVESTIGATION .............................................................................................................. 62 C. LES REPONDANTS ..................................................................................................................................... 63 §1. LES ENTRETIENS ........................................................................................................................................................ 63 §2. LES QUESTIONNAIRES ............................................................................................................................................... 67 D. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES PRINCIPALES : LES ENTRETIENS ......................................... 68 §1. METHODE DE COLLECTE DES DONNEES ................................................................................................................. 68 §2. TEST DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE .............................................................................................................. 69 E. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES SECONDAIRES : LE QUESTIONNAIRE .................................... 69 §1. METHODE DE COLLECTE DES DONNEES ................................................................................................................. 69

6
§2. TYPE DE DONNEES COLLECTEES .............................................................................................................................. 70 F. SYNTHESE DE LA PREMIERE PARTIE ........................................................................................................ 71
II-‐ APPORTS DES ENTRETIENS ............................................................................................................ 72
A. LA CIBLE .................................................................................................................................................... 72 §1. LE PUBLIC FRANÇAIS ET SES CARACTERISTIQUES CULTURELLES PARTICULIERES ......................................... 72 §2. LE PUBLIC DES EMISSIONS DE DIVERTISSEMENT : PLUSIEURS SEGMENTS DISTINCTS ................................... 73 B. LE CHOIX, LA REALISATION ET LA DIFFUSION DES EMISSIONS ................................................................ 75 §1. UN CHOIX POUR DEMEURER COMPETITIF .............................................................................................................. 75 §2. LA SPECIALISATION DES CHAINES, CANAUX DE DIFFUSION ................................................................................ 76 §3. LA CIBLE ET SES ATTENTES : L’ADAPTATION AU CONSOMMATEUR FRANÇAIS ET AU CONTEXTE SOCIO-‐
ECONOMIQUE .......................................................................................................................................................................... 77 §4. LE MOMENT DE DIFFUSION : UN ELEMENT-‐CLE POUR S’ADRESSER A DES PUBLICS DIFFERENTS ................ 78 C. LES CONTRAINTES ..................................................................................................................................... 78 §1. LE CSA FIXE DES CONTRAINTES LEGALES A RESPECTER… ................................................................................ 78 §2. … AUXQUELLES VIENNENT S’AJOUTER DES CONTRAINTES CONTRACTUELLES… ............................................ 79 §3. … ET LE COUT DES EMISSIONS, UN FREIN MAJEUR A LA PRISE DE RISQUES ..................................................... 80 D. SYNTHESE ................................................................................................................................................. 81
III-‐ TEST DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE ............................................................................... 82
A. PROPOSITION DE RECHERCHE 1 : L’ADAPTATION SEMBLE CHERCHER A REPONDRE AVANT TOUT A DES
CARACTERISTIQUES ET BESOINS PRECIS DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS ................................................... 82 B. PROPOSITION DE RECHERCHE 2 : LA STRATEGIE DE STANDARDISATION ADAPTEE SEMBLE LA PLUS
PRATIQUEE, POUR LES EMISSIONS DIFFUSEES SUR LES PRINCIPALES CHAINES (AVEC LE PLUS DE PARTS DE
MARCHE) ........................................................................................................................................................... 84 C. PROPOSITION DE RECHERCHE 3 : LA STANDARDISATION EST RENDUE POSSIBLE PAR UNE SIMILARITE
AU SEIN DES CONSOMMATEURS ........................................................................................................................ 85 D. SYNTHESE ET MISE EN LIEN AVEC LA LITTERATURE ............................................................................... 86
IV-‐ APPORTS DES QUESTIONNAIRES ................................................................................................. 88
A. RESULTATS OBTENUS ............................................................................................................................... 88 §1. LES MOTIVATIONS ...................................................................................................................................................... 88 §2. LES STRATEGIES D’INTERNATIONALISATION DES EMISSIONS VISIONNEES ..................................................... 88 B. APPORTS ................................................................................................................................................... 90
V-‐ LIMITES DE CETTE ETUDE ............................................................................................................... 91

7
A. LIMITES DE L’ETUDE PAR LES ENTRETIENS ............................................................................................. 91 B. LIMITES DE L’ETUDE PAR LES QUESTIONNAIRES .................................................................................... 92
VI-‐ CONCLUSION : REPONSE A LA QUESTION PRINCIPALE DE RECHERCHE, ET
RECOMMANDATIONS MANAGERIALES ................................................................................................ 94
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 100
I-‐ REVUES ACADEMIQUES ET OUVRAGES ....................................................................................... 100
II-‐ SITES INTERNET ............................................................................................................................... 106
III-‐ ARTICLES NON ACADEMIQUES ................................................................................................... 107
IV-‐ VIDEOS ................................................................................................................................................ 108
ANNEXES ....................................................................................................................................................... 109
A. GUIDE D’ENTRETIEN ............................................................................................................................... 109 B. MATRICE D’ANALYSE DES ENTRETIENS ................................................................................................. 111 C. QUESTIONNAIRE ..................................................................................................................................... 131
RESUME DU MEMOIRE ET MOTS-‐CLES ............................................................................................... 134

8
Introduction
"Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit
disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c'est-à-dire de le
divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons […], c'est
du temps de cerveau humain disponible. […] Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette
disponibilité. C'est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence
les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où
l'information s'accélère, se multiplie et se banalise"
Patrick Lelay, ex-Président Directeur Général de TF1, 2007
A. Marketing, mondialisation et stratégies d’internationalisation : entre adaptation et standardisation
Le degré jusqu’auquel une entreprise doit standardiser sa stratégie de marketing international,
et où elle doit commencer à s’adonner à l’adaptation, a reçu une attention considérable durant
la seconde moitié du XXème siècle. La mondialisation des marchés a créé de nouvelles
opportunités et menaces qui redessinent le commerce international.
Le terme de mondialisation (ou globalisation) désigne le processus d'intégration des marchés
qui résulte de la libéralisation des échanges, de la concurrence accrue et des conséquences des
technologies de l'information et de la communication à l'échelle internationale. Elle donne
naissance à une interdépendance croissante des économies et l’accroissement des interactions
humaines et des échanges. Pour Théodore Levitt (1983), il s’agit de « la convergence des
marchés qui s’opère dans le monde entier ».
Les développements récents en matière de technologies d’information et de communication
qui ont accompagné le courant de mondialisation, l’économie volatile et la compétition accrue
obligent à réexaminer la question de stratégie marketing internationale, ou plus précisément la
question standardisation/adaptation. Ces évolutions ont accentué la pression qui pèse sur les

9
entreprises en ce qui concerne la réalisation des objectifs financiers. La décision de
standardisation/adaptation est par conséquent devenue vitale pour le succès des entreprises
qui opèrent sur le marché international.
Le but de la revue de littérature de ce Mémoire est d’examiner les facteurs qui pèsent dans
cette décision, et qui permettent aux entreprises de décider jusqu’à quel niveau elles
souhaitent adapter/standardiser leur offre pour être efficientes et permettre une meilleure
performance. Les différents éléments identifiés seront ensuite étudiés dans un contexte bien
particulier : les émission de divertissement télévisées.
B. Présentation de la question principale de recherche et terrain d’investigation
Ce Mémoire a pour objectif de déterminer dans quelle mesure une entreprise doit adapter son
offre à la culture de son marché cible, dans une stratégie d’internationalisation. Notre question
principale est donc : « Face à une mondialisation de plus en plus importante, comment les
organisations ayant une dimension internationale doivent-elles se comporter face à la diversité
culturelle de leurs différents marchés cibles ? ». Le but de ces résultats est d’identifier, pour
les entreprises souhaitant se lancer à l’export ou à l’import dans un contexte culturel différent,
les éléments qui pourront leur permettre d’adapter efficacement leur offre et de choisir une
stratégie d’internationalisation adaptée au marché et aux attentes des consommateurs.
Cette étude a été menée dans le domaine des divertissements audiovisuels, et plus
particulièrement des émissions de divertissement télévisées (jeux, variété et téléréalité).
En constituant le cadre théorique de ce Mémoire, et en cherchant des applications au domaine
des divertissements audiovisuels, il est apparu qu’il existait un réel manque dans la littérature
pour ce qui est des stratégies d’internationalisation des formats1 télévisés. Pourtant, depuis la
1 Les formats d’émission sont des cadres et consignes particuliers qui vont permettre la réalisation d’une
émission télévisée ; en d’autres termes, il s’agit de l’idée elle-même, sans qu’elle ait encore été appliquée à un

10
première publicité de marque diffusée en France le 1er octobre 1968 sur la première chaîne de
l’ORTF, la télévision est devenu un moyen de communication primordial pour les entreprises.
Les programmes diffusés attirent les téléspectateurs, chaque chaine cherchant à avoir son
public bien défini, de façon à pouvoir vendre des écrans publicitaires à des annonceurs
particuliers, tout en pouvant leur assurer la présence du public ciblé. Le choix des
programmes est donc primordial pour assurer la pérennité de la chaîne.
Mais comment sont choisi ces programmes ? La diversité culturelle internationale est-elle
source d’adaptations des programmes ? Comment se déclinent les différents éléments de
standardisation et d’adaptation identifiés dans la revue de littérature ?
C. Adaptation des émissions télévisées
Un exemple de format télévisé ayant été adapté à plusieurs cultures différentes est l’émission
connue sous le nom de Koh-Lanta en France, diffusée sur TF1. Bien qu’on connaisse souvent
son équivalent américain Survivor créé en 2000, il est plus rare que l’on sache que l’émission
d’origine était « Expédition Robinson », émission suédoise de 1997. Il est possible de
comparer Survivor et Koh-Lanta sur un certain nombre d’éléments qui permettront de
comprendre l’adaptation culturelle qui a eu lieu avec ce format. Nous développerons
davantage ce point dans la présentation de notre terrain d’investigation.
On peut donc constater des adaptations, propres à chaque culture, pour un même concept
d’émission. Et il ne s’agit pas d’un exemple isolé, les émissions de télé crochet sont
nombreuses à être importées et exportées d’une culture à l’autre, tout en subissant parfois des
modifications, ou en appliquant un formats parfaitement standardisé (La France a un
incroyable talent / Britain’s got talent). On a aussi l’exemple de The Voice, format
initialement parfaitement standardisé, qui a connu des adaptations au cours des années : à
quoi sont dues ces adaptations ? Les émissions évoluent-elles dans tous les pays de la même
manière ?
contexte particulier dans sa réalisation. Un autre terme souvent employé est celui de « flux », qui désigne plus
spécifiquement les jeux et la téléréalité.

11
Il est aussi à noter que certaines séries télévisées voient leurs droits achetés de façon, soit à les
traduire, soit à créer un « remake », comme cela a été par exemple le cas pour Baby Boom.
Cet exemple illustre parfaitement le conflit entre standardisation et adaptation que nous allons
étudier dans ce Mémoire.
D. Objectifs du Mémoire et méthode
Le principal objectif de ce Mémoire est de comprendre comment sont choisis, et le cas
échéant modifiés, les formats d’émissions télévisées, de façon à s’adapter à la culture locale.
Quels sont les éléments qui permettent de choisir entre une simple traduction linguistique, et
l’adaptation d’éléments de façon à susciter l’adhésion des téléspectateurs ? Dans le cas d’une
adaptation, quels sont les éléments à modifier pour s’adapter au mieux à la culture française ?
L’augmentation exponentielle d’émissions de téléréalité et de divertissements en France ces
dernières années indique-t-elle une évolution de la demande, et plus généralement de la
culture, française ?
Pour répondre à ces questions, une démarche qualitative a été retenue, car l’objectif est
d’obtenir des perceptions, sentiments, opinions, attitudes et informations de la part de
l’interviewé sur le domaine étudié dans ce Mémoire. Ces informations ont ensuite été
analysées pour répondre aux questions abordées ci-dessus, du point de vue des acteurs qui
opèrent dans ce domaine. Pour ce faire, les entretiens ont été retranscrits en (page 117), de
façon à réaliser une matrice d’analyse en fonction des différents thèmes identifiés dans la
revue de littérature. Cette matrice est elle aussi disponible en annexe (page 194).
Parallèlement, des questionnaires ont été administrés à un échantillon de téléspectateurs, de
façon à confronter les habitudes de consommation déclarées à la perception des
professionnels. Le nombre de questionnaires pour cette seconde analyse étant réduit, l’objectif
n’est pas d’en tirer des conclusions mais de proposer des pistes de réflexion pour une étude
davantage axée sur la consommation et non la production et diffusion.
Pour atteindre les objectifs de ce Mémoire de Master, nous commenceront par une revue de
littérature avec la présentation des différents concepts et théorie qui se rapportent à notre

12
problématique : en premier lieu, la présentation du concept de culture, ensuite les problèmes
que la culture peut poser au niveau de l’entreprise dans un contexte de mondialisation, et
enfin la présentation des différentes stratégies d’internationalisation (adaptation,
standardisation, et standardisation adaptée). Les éléments-clés et des exemples de succès et
d’échecs de chaque stratégie seront présentés, de façon à mesurer l’importance d’un choix
pertinent de stratégie d’internationalisation.
Dans un second temps, nous présenterons notre étude empirique, qui sera appliquée au
domaine des divertissements audiovisuels. Huit professionnels issus de fonctions variées dans
le milieu des divertissements audiovisuels ont été interviewés de façon à étudier l’influence
de divers éléments sur la stratégie employée. Des anonymes ont aussi été interrogés au moyen
de questionnaires de façon à étudier leurs habitudes de consommation, et apporter à cette
étude de nouveau axes de réflexion.

13
Chapitre 1 : Cadre théorique

14
Dans ce premier chapitre, nous allons étudier la littérature scientifique portant sur les notions
de culture et différence culturelle d’une part, et de stratégies d’internationalisation d’autre
part. L’objectif va être de mettre ce deux concepts en relation, de façon à dégager des
propositions de recherche pour la problématique que nous avons dégagée : face à une
mondialisation de plus en plus importante, comment les organisations ayant une dimension
internationale doivent-elles se comporter face à la diversité culturelle de leurs différents
marchés cibles ?
I- Comprendre la diversité culturelle
A. Qu’est-ce que la culture ?
Le terme de « culture » est utilisé dans un sens figuratif, avec deux sens distincts. Le premier
est celui de « civilisation », comprenant une éducation, des manières, un art, un savoir-faire et
des produits distincts. Le second est un dérivé de l’anthropologie sociale, avec la façon dont
les gens pensent, agissent, ainsi que ce qu’ils ressentent. Geert Hofstede (1980-2001) définit
cela comme « la programmation collective de l'esprit distinguant les membres d'un groupe ou
d’une catégorie des personnes d’un ou d’une autre ». Le terme de « catégorie » peut aussi bien
référer à une nation, qu’à une religion, une région, une ethnicité, un genre, une organisation
ou une profession. Selon les travaux d’Hofstede, c’est le second sens qui va prévaloir, dont
une définition plus simple serait « les règles non écrites du jeu social ».
L’étude de Kluckhohn et Strodtberck (1961) considère que la culture est basée sur trois points
principaux :
1. La relation à la nature
a. Contemplation de la nature (la nature est-elle dominante, ou l'homme en
fait-il partie ?)
b. Harmonie avec la nature (l’osmose entre l'homme et la nature qui amène à
un épanouissement et un développement spirituel)
c. Domination sur la nature (maîtrise afin qu'elle ne soit pas hostile, l’homme
n’en fait pas partie)

15
2. La relation au temps : le temps est-il cyclique ou linéaire, et quelle est l’importance
accordée au passé ?
3. La relation à la personne : quelle est la place occupée en tant qu'individu ?
Pour Cluche (1996), la culture n’est pas « naturelle », elle n’est pas biologiquement
héréditaire. Au contraire, elle est acquise dès la naissance au cours d’un processus de
socialisation, souvent inconscient. Ainsi, la culture se transmet d’un individu à un autre, ce
qui explique sa lente évolution malgré une évolution rapide de l’environnement.
Linton (1986) propose une définition qui se veut davantage liée à l’environnement : "une
culture est lu configuration des comportements appris et de résultats, dont les éléments
composants sont partagés et transmis par les membres d'une société donnée", autrement dit
une expression de l’adaptation d’un groupe d’individus à un milieu naturel.
Les travaux de Fons Trompenaars et Charles Hampden-Turner (1997) reposent sur ceux de
Kluckhohn et Strodtberck (1961), et définissent la culture simplement comme « la façon dont
les gens résolvent les problèmes ». Leur modèle d’analyse propose d’étudier la culture selon
sept dimensions, afin de déterminer les différences entre les sociétés :
1. Universalisme / particularisme (y a-t-il une importance majeure des règles ou des
relations ?)
2. Individualisme / collectivisme (fonctionne-t-on en tant que groupe, ou en tant
qu'individu ?)
3. Neutralité / affectivité (affichage des émotions)
4. Degré d'engagement (limite / diffus) (niveau d’implication vis-à-vis d'une personne ou
d'une situation)
5. Statut attribué / statut acquis (faut-il faire ses preuves pour acquérir un statut, ou le
statut est-il attribué par les autres ?)
6. Orientation temporelle
a. Orientation passé / présent / futur (accorde-t-on plus d’importance au passé, au
présent, ou au futur ?)
b. Temps séquentiel / temps synchronique (fait-on une seule chose à la fois, ou
plusieurs en même temps ?)

16
7. Orientation interne ou externe (contrôle de l’environnement par l’Homme, ou
l’environnement est-il subi par l’Homme)
Ces dimensions vont permettre de comparer les cultures, de façon à trouver des points
communs et des différences, qui seront à prendre en compte lors de l’élaboration des
stratégies d’internationalisation.
B. Les différences culturelles
La culture se décomposerait en 3 couches distinctes (Trompenaars et Hampden-Turner, 1997),
chacune plus « profonde » et par conséquent moins visible par un observateur extérieur que la
précédente. La première couche comporte les produits explicites et artefacts, qui sont
composés de tous les objets spécifiques à la culture ; la seconde est composée des normes et
valeurs que partagent les individus (une culture est dite « stable » lorsque les normes reflètent
les valeurs partagées par le groupe) ; enfin, le cœur regroupe les assomptions basiques,
éléments implicites partagés par l’ensemble des membres d’une même culture.
Les différentes couches de la culture (Trompenaars et Hampden-Turner, 1997)

17
Pour comprendre une culture, il faut comprendre ses assomptions basiques, qui vont se
décliner à travers les normes et les valeurs, elles-mêmes s’exprimant par les produits et
artefacts du groupe considéré. Une culture est donc bien plus que ce qu’on voit au premier
abord, et il faut s’assurer, lorsque deux groupes présentent les mêmes caractéristiques
« extérieures », que leurs valeurs respectives sont bien identiques ou similaires.
Rogers, Hart et Miike (2002), dans leur étude, rappellent les différences culturelles selon
Edward Hall (1976). Pour lui, les cultures sont divisées en deux groupes, celles à « fort
contexte » et celles à « faible contexte ». Dans les cultures à « fort contexte », il existe de
nombreux éléments contextuels qui aident à comprendre les règles. Ainsi, beaucoup de choses
sont considérées comme évidentes et acquises. Cela peut s’avérer délicat pour quelqu’un qui
n’arrive pas à interpréter les éléments « non écrits » de la culture. Dans les cultures à « faible
contexte », très peu de choses sont considérées comme évidentes et acquises, ce qui laisse
moins de place à l’incompréhension lorsqu’elles sont confrontées à une culture différente.
Les principaux éléments sur lesquels les cultures vont être comparées sont :
Élément Fort contexte Faible contexte
Ouverture des messages
Beaucoup de messages
couverts et implicites, avec
l’utilisation de métaphores et
de lecture entre les lignes
Beaucoup de messages
ouverts et explicites, qui sont
simples et clairs
Situation du pouvoir et
attribution de l’échec
Pouvoir interne et acceptation
personnelle de l’échec
Pouvoir externe et rejet de
l’échec sur les autres
Utilisation de la
communication non verbale
Beaucoup de communication
non verbale
Focus sur la communication
verbale plutôt que sur le
langage corporel
Expression de la réaction Réservé, réactions orientées
vers l’intérieur
Visible, externe, réactions
orientées vers l’extérieur
Cohésion et séparation des
groupes
Distinction forte entre
l’intérieur et l’extérieur du
Schémas de groupes flexibles
et ouverts, qui changent selon

18
groupe, fort sens
d’appartenance familiale
les besoins
Liens interpersonnels
Liens interpersonnels forts
avec une affiliation à la
famille et à la communauté
Les liens interpersonnels sont
fragiles avec un faible sens
de loyauté
Degré de dévotion aux
relations
Dévotion forte aux relations
de long terme, les relations
sont plus importantes que les
tâches
Faible dévotion aux relations,
les tâches sont plus
importantes que les relations
Flexibilité du temps
Le temps est flexible, le
processus est plus important
que le produit
Le temps est très organisé, le
produit est plus important que
le processus
Les dimensions de la culture selon Hall (Rogers, Hart et Miike, 2002)
Hall était aussi concerné par la perception du temps, qui pouvait être mono chronique (une
chose à la fois) ou poly chronique (plusieurs choses à la fois), et la perception de l’espace
(forte territorialité, généralement observée chez les cultures à faible contexte, ou faible
territorialité, généralement observée chez les cultures à fort contexte).
Le modèle d’Hofstede (Hofstede, 2001) compare les cultures sur cinq dimensions, très
proches de celles de Hall (1976) :
- la distance hiérarchique (le degré d’acceptation des inégalités de statut et de pouvoir),
- le contrôle de l’incertitude (le degré de tolérance pour l’incertitude des évènements
futurs),
- l’individualisme et le collectivisme (le degré de liberté d’un individu par rapport au
groupe),
- la dimension masculine/féminine (le degré de sensibilité à des facteurs émotionnels, et
le degré de séparation des tâches),
- et l’orientation à court ou long terme.
Selon les travaux d’Hofstede (1994-2001), la culture se décline en plusieurs niveaux : le
niveau national, le niveau organisationnel, le niveau du métier et le niveau du genre. La

19
culture nationale est partagée par tous les membres d’une même nation. La culture
organisationnelle, elle, va être présente au sein d’une organisation, et émerger de l’histoire
propre à cette organisation. Tout comme la culture nationale, elle possède ses héros et ses
mythes, ses traditions, ses rituels, et ses artéfacts. La culture au niveau du métier, bien que se
rapprochant de la culture organisationnelle, va être propre à une fonction particulière au sein
de l’entreprise ou de l’organisation. Le dernier niveau de culture, plus particulier, réside dans
le genre ; selon Hofstede toujours, il est possible d’expliquer les différences entre les genres
par une culture qui leur serait propre, avec des symboles, héros, et rituels différents. Ce
dernier niveau de la culture ne sera pas traité dans ce Mémoire, car il ne se rapporte pas
directement au fonctionnement des entreprises et à leur offre. Cette approche nous indique
qu’un même individu peut posséder plusieurs cultures, en fonction du contexte dans lequel on
l’observe. Elle souligne aussi le fait que différentes cultures sont sans cesse en cohabitation,
contrairement à l’idée qui voudrait que ce phénomène ne soit dû qu’à la mondialisation.
Il est important de considérer les différents aspects d’une culture lors de l’élaboration de son
offre (Mahran Et Gallego, 2012). La culture du marché cible va définir l’adhésion, ou le rejet,
du consommateur au produit, lui-même dépendant de la culture du marché source. Les
traditions pouvant avoir un impact très fort sur la relation du consommateur, il convient de les
prendre en compte lors de la mise en œuvre du marketing mix. Le consommateur va avoir une
perception positive ou négative du produit, qui va être définie par les codes culturels que ce
dernier va véhiculer.

20
Mécanisme des différences culturelles entre les marchés, issu de Mahran et Gallego (2012),
source : Croué (2006, p. 90)
C. L’émergence et l’évolution des cultures
L’histoire de chaque groupe d’individus, depuis son évolution de chasseurs-cueilleurs à nos
jours, détermine les valeurs propres à ce groupe, qui elles-mêmes vont être la base de la
culture de ce groupe (Hofstede, 1980-2001). L’évolution en groupes de ces populations a
entrainé une amélioration de nos capacités sociales et intellectuelles, mais nous n’avons pas
pour autant perdu les éléments de notre comportement qui nous définissent comme
mammifères sociaux. Ce sont ces éléments qui vont déterminer la culture propre à chaque
groupe d’individus. Plusieurs groupes d’individus vont présenter des cultures similaires car ils
vont partager un passé commun et donc des valeurs communes, par exemple, les pays
partageant des racines latines.
Ainsi, pour Fons Trompenaars et Charles Hampden-Turner (1997), les normes et valeurs de
chaque culture sont fondées sur des connaissances et assomptions basiques de la vie. Elles en

21
découlent de façon logique, et donnent elles-mêmes naissance à des objets et artéfacts. Ceux-
ci vont évoluer avec les avancées technologiques et l’évolution des valeurs. Néanmoins,
chaque « couche » de culture va évoluer à son propre rythme, la plus rapide étant les produits
et artéfacts, suivie par les normes et valeurs, et enfin les assomptions basiques sur la vie. Par
conséquent, des groupes d’individus partageant les mêmes assomptions basiques mais ayant
évolué de façon séparée vont parfois présenter des cultures qui semblent différentes.
D. L’importance des valeurs au sein d’une culture
Selon la théorie des valeurs universelles (Schwartz, 1994), il existe dix valeurs de base que les
individus reconnaissent comme telles dans toutes les cultures. Si la structure des valeurs est
similaire dans des groupes appartenant à des cultures différentes, cela permet de penser qu’il
existe une organisation universelle des motivations humaines. Néanmoins, les personnes et les
groupes présentent différentes « hiérarchies » ou « priorités » de valeurs, ce qui justifie les
différences de valeurs culturelles.
Hampden-Turner et Trompenaars (2000) proposent des solutions aux managers de façon à
tourner le choc culturel en un avantage compétitif. Pour eux, des valeurs qui semblent au
premier abord opposées, peuvent être en réalité complémentaires. Ils proposent au managers
d’intégrer les valeurs de la culture locale, plutôt que de polariser les valeurs selon leur culture
d’origine, de façon à prendre de meilleures décisions. D’autre part, ils soutiennent la thèse
selon laquelle la création de valeur serait due à la réconciliation de valeurs en conflits les unes
avec les autres. Dans leurs travaux de 1997, Hampden-Turner et Trompenaars définissent les
valeurs comme la couche intermédiaire de la culture, à partir de laquelle vont être élaborés les
objets et artéfacts. Les valeurs sont donc une composante essentielle qu’il est important que
les entreprises prennent en compte lors de l’élaboration de leur offre.

22
II- Problèmes posés par la diversité culturelle
A. L’impact de la culture sur l’organisation
§1. Relations intra-entreprises
Hofstede (1980-2001) définit la culture organisationnelle comme un programme mental
collectif appliqué aux différents individus composant une organisation. Si les cultures
nationales diffèrent en majeure partie par leurs valeurs, Hofstede note que les cultures
organisationnelles se différencient par les pratiques qui leur sont propres.
La formulation « culture d’entreprise » est plus ancienne que celle de « culture
organisationnelle ». Selon Cluche (1996), cette formulation rappelle le paternalisme et la
conception familiale de l’autorité. Selon Hofstede (1980-2001), la culture organisationnelle
est composée d’un ensemble de valeurs, symboles, héros et rituels qui permettent à
l’entreprise de se différencier, et d’assurer une cohésion pour la survie du groupe. Les
différents éléments qui vont permettre de définir et de construire la culture organisationnelle
sont :
-‐ la culture nationale, régionale et locale
-‐ la culture professionnelle des salariés ou du secteur d’activité dans lequel ils opèrent
-‐ la personnalité des fondateurs de l’entreprise
-‐ l’histoire de l’entreprise : les différents éléments importants depuis sa création
-‐ les valeurs portées par les dirigeants charismatiques.
Ces éléments vont permettre à l’entreprise de construire ses propres mythes et héros,
organisant ses rituels, et contribuant ainsi à la création d’un système de coordination informel
qui vient renforcer le système de contrôle hiérarchique traditionnel. Cette culture
organisationnelle va permettre de renforcer la performance économique, en réduisant les coûts
engagés dans le contrôle et l’incitation. Chaque individu va se voir offrir le choix d’adhérer
ou non à la culture d’entreprise, mais un refus risque d’entrainer une exclusion.
Un problème se présente lors de la fusion/acquisition d’une première entreprise par une
seconde, lorsque leurs cultures diffèrent : qu’advient-il de chaque culture ? Fusionnent-elles
en une troisième culture, ou l’une d’entre elle prend-elle le pas sur la seconde ?

23
Barmeyer (2002) donne des pistes sur deux types de management international : le
management « convergent » qui vise à atteindre une certaine homogénéité plus aisée à
manager, et le « divergent » qui permet davantage l’émergence de nouvelles idées.
Convergence Divergence
Postulat Les différences vont
disparaître
Les différences vont rester voire
augmenter
Conséquences Homogénéité culturelle Hétérogénéité culturelle
Risques La négation de la culture peut
causer des incompréhensions
et des conflits
La surestimation de la culture peut
devenir le principal élément de
conflit
Management Les méthodes de management,
universelles, peuvent être
transférées et appliquées à
différents contextes
Les méthodes de management sont
marquées par leur culture d’origine,
elles rencontrent des résistances dans
d’autres contextes
Fusions/acquisitions Les cultures vont se mélanger
et se diffuser : la culture la
plus forte aura le plus
d’influence et sera appliquée
Les cultures vont résister au
changement : des ajustements et des
compromis interculturels vont devoir
être réalisés
Les deux types de management international (Barmeyer, 2002)
Lors des fusions/acquisitions, les différences culturelles ne donnent pas uniquement lieu à des
difficultés, elles peuvent aussi permettre d’apporter un regard nouveau sur les marchés cibles.
Il conviendra alors de choisir entre deux modes de management, un « convergent » visant à
effacer les différences, et un « divergent » visant à les exploiter.
Barmeyer et U. Mayrhofer (2008) soulignent que les différences culturelles doivent être
considérées avec précaution, puisqu’elles peuvent mener à des incompatibilités culturelles
aux impacts négatifs. Bien que la culture soit souvent considérée comme un obstacle aux
fusions/acquisitions, la distance culturelle peut améliorer les performances en donnant accès à

24
des informations propres à la culture locale. Cela reviendrait à une acculturation, « processus
de contacts et d’interpénétrations entre 2 (ou plus) groupes culturels ».
§2. Relations inter-entreprises
Un article par P. Franklin intitulé Differences and difficulties in intercultural management
interactions étudie les principales différences et difficultés observées en pratique par les
managers dans les interactions interculturelles. Les principales observations sont qu’aucun
travail seul d’étude classique des différences culturelles (comme celles de Hall, Hofstede et
Trompenaars) ne peut prédire et expliquer les difficultés que les managers peuvent rencontrer
dans leurs intégralité : les managers devraient aussi se référer à des études comparatives sur
les différentes cultures, et à des travaux sur les standards culturels. D’autre part, les
différences interculturelles ne seraient pas aussi difficile pour tous les managers, et de
nombreuses difficultés pourraient être résolues par une formation car elles dépendent plus de
la communication que de la culture elle-même.
Certaines notions « basiques » peuvent être interprétées différemment selon les cultures en
présence. La communication et la formation permettraient de palier à une méconnaissance des
différentes interprétations de ces normes, mais une autre solution consisterait à utiliser des
valeurs différentes selon les cultures tout en les ramenant à une valeur commune.
P. Dupriez et S. Simons (2000) proposent des analyses d’études de cas dans lesquelles on
découvre des cultures aux normes différentes, de façon à comprendre l’importance d’une
bonne connaissance de l’autre, et la compréhension des différentes approches managériales.
G. Fink et S. Meierewert (2004) expliquent l’importance que la notion de « temps » dans les
entreprises aujourd’hui, et comment un certain nombre de concepts tels que le « Just in time »
peuvent être interprétés différemment selon les cultures. Il propose aussi certaines solutions
pratiques pour résoudre les principales difficultés généralement rencontrées, telles que
l’utilisation de valeurs différentes en fonction des équipes, ramenées à une valeur commune.
Y. Barel (2006) indique que la question qui se pose dans le phénomène d’internationalisation
de la stratégie de développement n’est pas seulement de savoir quels éléments de sa culture et

25
de ses modes de gestion moduler pour qu’ils soient acceptés par la culture de l’autre, mais
également de trouver un effet de levier dans la culture nationale de l’entreprise partenaire.
J. Aritz et R. C. Walker (2010) proposent une méthode –l’analyse du discours- pour observer
ce qui se passe réellement en termes de pratiques de communication dans les réunions
interculturelles de prises de décision. Contrairement aux études précédents qui suggèrent que
les différences de communication devraient être attribuées aux différences de pouvoir ou de
maitrise du langage, leur étude suggère que les différents styles de conversation seraient à
attribuer à des problèmes d’identité « intergroupe ».
Au niveau managérial, la véritable richesse du management interculturel résiderait dans le
juste équilibre entre la standardisation et l’adaptation, de façon à obtenir le maximum de
chaque culture. Bien que ces questions ne constituent pas le cœur de ce Mémoire, il serait
intéressant d’avoir davantage d’études sur le sujet.
B. L’impact de la culture sur l’offre de l’entreprise : problématique
§1. Un “village global” de consommateurs ?
L’expression « village global » ou « village planétaire » était très employé jusqu’au 11
septembre 2001 (Hofstede, Pedersen et Hofstede, 2002). Ce terme de « village global » a été
rendu populaire par Marshall McLuhan dans ses livres The Gutenberg Galaxy: The Making of
Typographic Man (1962) et Understanding Media (1964).
Pour McLuhan, les technologies électriques et la mondialisation ont transformé le monde en
un grand village, induisant un mouvement instantané d’information d’un point à un autre de la
planète, et créant ainsi une communauté unifiée, où il n’y aurait plus qu’une seule culture
commune à tous. Le « village global » présente quatre caractéristiques majeures :
-‐ interactivité : forte disponibilité d’informations, faible délai de réponse, faible coût
d’échange d’informations ;
-‐ communauté unique : même canal, même langage, mêmes références, lieux
d’échanges communs ;

26
-‐ variété d’information : mots, images, sons ;
-‐ vitalité : renouvellements (émergences) ; actions collectives et décisions.
Cet échange d’informations au sein d’une communauté planétaire a aussi des conséquences :
-‐ un renforcement des identités (tribalité) ;
-‐ en parallèle, le développement d’un bilinguisme ;
-‐ une captation des décisions ;
-‐ des prises de conscience planétaires (petitesse de la Terre, limitation des ressources).
Le terme de « village global » a été abandonné par McLuhan lui-même dans ses dernières
publications, reconnaissant que l’uniformité et la tranquillité n’étaient pas des propriétés
propres à la communauté en question, ce qui était souligné par le renforcement de la tribalité.
Au contraire, il développera le terme de « théâtre global » pour souligner le rôle des différents
acteurs.
Aujourd’hui, ce terme de « village global » est utilisé pour décrire Internet, mais a été
abandonné en ce qui concerne la description des consommateurs ; il s’est en effet avéré qu’il
existait trop de différences entre les divers groupes d’individus pour pouvoir considérer un
« consommateur global ».
§2. Les différences culturelles
Les différences culturelles, parfois qualifiées de « barrières culturelles », sont des écarts de
nature entre les comportements de différents groupes, justifiés par des différences en matière
de valeurs (Trompenaars et Hampden-Turner, 1997).
Avec la mondialisation des marchés, les entreprises se retrouvent confrontées à un nouvel
obstacle auquel elles n’avaient jamais eu à faire auparavant : les barrières issues de la
diversité culturelle. Un premier aspect de ce nouveau challenge a été évoqué ci-dessus, en ce
qui concerne la diversité culturelle lors du fonctionnement de l’entreprise elle-même, que ce
soit en interne ou lors des relations avec d’autres entreprises.
Les entreprises doivent aussi choisir une stratégie d’internationalisation au niveau marketing,
qui prenne en compte tant les aspects économiques en compte (économies d’échelle par
exemple) que les aspects marketing (réponse aux besoins des consommateurs). Trois grandes

27
stratégies d’internationalisation, développées ci-après, peuvent être envisagées. Chacune
présente des avantages et des inconvénients, et les auteurs sont divisés quant au choix de la
méthode. De Mooij et Hofsede (2010) proposent d’utiliser le modèle d’Hofstede pour étudier
les différences culturelles entre les différents marchés, et adapter correctement sa
publicité/communication selon les différentes valeurs relevées. Pour eux, les valeurs
culturelles ne doivent pas être considérées comme un facteur extérieur, mais bien une partie
intégrante du consommateur et de sa personnalité. Pour eux, il faut que le consommateur soit
au centre du développement de la communication de l’entreprise pour que celle-ci soit
efficace. Par conséquent, il convient de prendre en compte les différences culturelles lors de
l’élaboration de son marketing mix, car ces différences, si elles existent, vont motiver une
stratégie d’adaptation, et si elles sont absentes entre les deux marchés considérés, vont
justifier une stratégie de standardisation.
Comprendre les valeurs culturelles des consommateurs (De Mooij et Hofstede, 2010)

28
Hofstede et De Mooij placent le consommateur et ses valeurs culturelles au centre du
processus de communication. Ses valeurs vont affecter tant le processus mental que le
processus social qui s’opère en chaque individu, définissant la réaction à avoir à un type de
communication particulier. Il convient par conséquent pour l’entreprise d’adopter une
stratégie de communication qui permette de recevoir des réponses positives de la part des
consommateurs.
Bien que De Mooij et Hofstede n’étudient ici que l’aspect « communication » du mix
marketing, les mêmes problèmes se posent au niveau du produit, de son prix, et de sa
distribution.
Ce Mémoire de Master a pour objectif d’apporter des éléments de réponses à la problématique
suivante : Face à une mondialisation de plus en plus importante, comment les organisations
ayant une dimension internationale doivent-elles se comporter face à la diversité culturelle de
leurs différents marchés cibles ? Nous étudions ici l’aspect marketing de l’internationalisation
(produit, prix, communication, distribution), et ses différentes stratégies.
Nous étudierons dans un premier temps la stratégie de standardisation, puis la stratégie
d’adaptation, et enfin une troisième stratégie d’internationalisation appelée « standardisation
adaptée » et qui cherche à concilier les deux stratégies précédentes. Nous essayerons de
présenter les éléments qui permettent de choisir entre ces stratégies, les différents domaines
qu’il est possible de standardiser/adapter, et en quoi chaque stratégie permet à l’entreprise de
rechercher la performance. Nous tâcherons de donner, pour chaque stratégie
d’internationalisation, un exemple concret d’une entreprise ayant appliqué avec succès cette
stratégie.

29
III- Le marketing cross-culturel : standardisation versus adaptation
A. D’un marché local à un marché global : l’internationalisation
§1. Définition de l’internationalisation
Selon Pasco-Berho (2002), l’internationalisation est une succession d’étapes qui permet à une
entreprise de réaliser un apprentissage progressif des marchés étrangers. L’expression
« internationalisation » fait appel à deux dimensions majeures. La première est celle de
demande, qui va être évaluée au niveau mondial avec des différences locales, et celle d’offre,
avec des produits et services de plus en plus standardisés et une concurrence qui ne se ferait
plus au sein des différents marchés, mais directement au sein du globe.
Adler et Ghadar (1990) proposent un modèle du processus d’internationalisation en 4 étapes.
Au début du phénomène de mondialisation, les entreprises proposaient des produits
extrêmement standardisés, du fait de l’absence de concurrence au niveau mondial : ce n’était
pas à elles de s’adapter à la culture locale, mais aux consommateurs locaux de s’adapter à
eux. Avec le développement de la concurrence, des entreprises, qui auparavant ne
commercialisaient leur produit que sur le marché local, ont ressenti le besoin de
commercialiser, voire produire, dans des marchés étranger. Pour ce faire, une sensibilité à la
culture locale a dû être développée. La troisième étape voudrait que l’accroissement de la
concurrence sur les marchés internationaux fasse perdre de vue les questions culturelles, pour
se concentrer sur une guerre des prix et des process. Enfin, la dernière étape est atteinte
lorsque l’entreprise, tout en cherchant à conserver une compétitivité par les coûts, se recentre
à nouveau sur les besoins locaux de ses clients potentiels. La stratégie de marketing
international à adopter va donc dépendre de ces différentes étapes.
Néanmoins, ces adaptations locales entrainent parfois des coûts conséquents, rendant
l’entreprise moins compétitive. La question se pose donc toujours en ce qui concerne le choix
entre une stratégie de standardisation et une stratégie d’internationalisation.

30
§2. Les stratégies d’internationalisation
En matière de marketing international (ou cross-culturel), deux stratégies majeures
s’opposent, donnant elles-mêmes naissance à une troisième stratégie, chacune étant défendue
par différents auteurs dans la littérature. Il s’agit d’une part de la standardisation, qui cherche
à répondre à la pression qu’exercent les forces économiques sur l’entreprise, en réalisant des
économies d’échelle pour augmenter la performance et compétitivité de l’entreprise. La
seconde est l’adaptation, qui va se concentrer sur les opportunités du marché, en différenciant
son offre en fonction des pays et en s’adaptant aux nouvelles tendances de consommation.
Enfin, la troisième stratégie à laquelle elles vont donner naissance est la stratégie de
« standardisation adaptée », qui va viser à adapter son offre pour des groupements de
segments de différents marchés, tout en standardisant ces offres de façon à continuer de
réaliser des économies de coûts : « Think globally, act locally ».
Les trois stratégies d’internationalisation du marketing mix (Source : l’auteur)
Ainsi, en accord avec ces trois stratégies, la segmentation internationale va se décliner en trois
démarches distinctes : le regroupement des pays, la recherche de segments supranationaux, ou
l’orientation vers des segments différents dans chaque pays (Takeuchi et Porter, 1986). Le

31
regroupement des pays s’opèrera par la stratégie de standardisation, celle de recherche de
segments supranationaux par la stratégie de standardisation adaptée, et celle d’orientation vers
des segments différents dans chaque pays par la stratégie d’adaptation.
Stratégie de positionnement international (Blanche, 1987)
Blanche (1987) propose trois politiques produit en fonction de l’importance constatée des
différences culturelles. La première est celle de « produit existant », où le produit va être le
même sur tous les marchés, à l’exception de la langue et de l’étiquetage. La seconde est celle
de « produit adapté », où le produit basique sera le même, mais des modifications y seront
apportées, en matière de couleur et de packaging par exemple. La troisième politique produit
considérée est celle de « produit nouveau », où le produit sera spécialement conçu pour
rencontrer les besoins de chaque pays. Cette théorie tend à prouver qu’un certain degré
d’adaptation des produits et/ou de la stratégie de communication est presque toujours
nécessaire. Le (1) indique une stratégie de standardisation. Les (1bis) indiquent une stratégie
de standardisation produit avec adaptation du marketing. Les (2) indiquent une stratégie
d’adaptation, et le (3) indiquent une stratégie de création d’une nouvelle offre. Cette dernière
stratégie ne sera pas traitée dans ce Mémoire.
Selon Ghoshal et Nohria (1993), le type de stratégie internationale qu’il conviendra
d’appliquer va dépendre des caractéristiques des marchés concernés. Ces caractéristiques vont
se décliner en deux dimensions distinctes : les forces locales qui vont jouer en faveur de

32
l’adaptation, et les forces globales qui vont pousser à la standardisation. Chaque marché va
être soumis à ces deux types de forces, mais à des niveaux d’intensité qui vont différer.
B. La standardisation, ou marketing global
§1. La notion de consommateur global
La standardisation repose sur un principe de base, qui est que les consommateurs vont avoir
des besoins similaires. Bien que les préférences puissent différer, les besoins des
consommateurs ont été homogénéisés au niveau mondial en parallèle avec le développement
des technologies, rendant les multinationales obsolètes et les entreprises globales
incontournables. D’autre part, il ne faut pas oublier que les préférences elles-mêmes ne sont
pas immuables, contrairement à certaines idées reçues. Les différences culturelles et les goûts
et standards nationaux sont des vestiges du passé (Levitt, 1983). Dans le même ordre d’idées,
Fatt (1967) soutien qu’avec l’homogénéisation des marchés, il devient primordial pour les
entreprises de se concentrer sur les similarités entre les consommateurs.
Ainsi émerge la notion de « consommateur global », sur laquelle repose la théorie de
standardisation : tous les consommateurs ayant des besoins identiques, l’adaptation ne serait
pas à l’ordre du jour, il faudrait au contraire privilégier la compétitivité de l’entreprise.
L’existence d’un tel consommateur serait un réel avantage pour les entreprises, leur
permettant de proposer une offre unique sur l’ensemble des marchés.
§2. Les caractéristiques de la standardisation
La standardisation est une stratégie de marketing international consistant pour une entreprise à
proposer un produit aux caractéristiques identiques aux différents segments de
consommateurs, pour répondre à des besoins homogènes (Levitt, 1983). Cette stratégie
permet des économies d’échelle.
La standardisation possède 4 caractéristiques clés :

33
-‐ un niveau d’investissement élevé ;
-‐ un potentiel d’économies d’échelles élevé : produire un produit/service avec des
caractéristiques standardisées permettra de faire des économies qu’il n’aurait pas été
possible de faire en adaptant le produit/service ;
-‐ une demande suffisamment homogène : les consommateurs doivent avoir des besoins
similaires pour qu’un produit/service avec des caractéristiques standardisées puisse
être adopté par tous ;
-‐ des coûts d’approche non rédhibitoires : l’avantage principal de la standardisation
étant les économies de coûts, il ne faut pas que l’accès au marché présente un coût
trop important, où l’internationalisation pourrait s’avérer coûteuse.
La standardisation se décline sur trois axes majeurs, qui sont les 3 dimensions des attributs du
produit, selon la définition marketing :
-‐ les attributs physiques (poids, taille, couleur, etc.) : leur standardisation permet des
économies d’échelle conséquentes lors de la production. Ils affectent de façon France
la décision entre adaptation et standardisation ;
-‐ les attributs liés au service : ils diffèrent de manière importante entre les différents
pays, car la majorité des services sont en relation directe avec les consommateurs
locaux, par conséquent ils sont difficiles à standardiser ;
-‐ les attributs symboliques : ils sont généralement issus de l’interprétation par le public
des attributs physiques, du nom de marque et de l’origine du produit.
Lage, Lage et Abrantes (2007) ont défini différents facteurs favorisant la standardisation
d’une entreprise :
-‐ l’orientation est ethnocentrique ;
-‐ l’autorité pour établir les politiques et allouer les ressources est centralisée ;
-‐ les marchés sont au même stade de développement du produit ;
-‐ il existe un lien fort entre la filiale et la compagnie mère ;
-‐ l’entreprise se concentre sur des produits industriels plus que sur des produits de
consommation courante, facilitant ainsi la standardisation ;
-‐ les coûts sont réduits grâce aux économies d’échelle lors de la production, le
marketing, et la R&D ;

34
-‐ il existe des similarités entre les goûts des consommateurs et les schémas de
consommation entre les différents marchés, ainsi qu’entre les niveaux de revenus et
de croissance économique.
Selon les études de Quelch et Hoff (1986) et de Rau et Preble (1987), il semblerait que la
stratégie de standardisation soit à mettre en étroite relation avec la taille du marché du pays
étudié, et que les économies d’échelles sont elles aussi reliées à la taille du marché considéré.
Il est donc préférable d’avoir recours à une stratégie de standardisation lorsqu’on a affaire à
des marchés de tailles importantes.
Pour Solberg (2000), la tendance à centraliser le contrôle qu’on retrouve au sein des
multinationales doit avoir un rôle important sur le degré de standardisation des activités
marketing. Selon Vignali (2001), les éléments du mix marketing qui sont les plus faciles à
standardiser sont le nom de marque, les caractéristiques des produits, le packaging, et
l’étiquetage.
§3. Les avantages de la standardisation
Les produits standardisés au niveau global proposent quatre avantages majeurs :
- ils sont fonctionnels : ils ont pour unique objectif de répondre à un besoin commun
aux différents segments de consommateurs ;
- ils sont plus avancés : le fait de ne pas avoir à développer de nombreux
produits/services adaptés à différents segments de consommateurs permet de
concentrer sa R&D sur le produit/service standardisé de façon à améliorer ses
caractéristiques ;
- ils sont fiables et de bonne qualité ;
- ils sont proposés à bas prix (économies d’échelles), ce qui permet à l’entreprise
d’avoir une meilleure compétitivité sur le marché.
Par conséquent, les produits standardisés permettent de séduire tous les types de
consommateurs, avec une offre complète à bas prix.

35
Des entreprises et produits plus compétitifs
La notion de standardisation apparaît dans les pays industrialisés dans la première moitié du
XIXème siècle. Henry Ford (1843-1947), reprenant les principes de Taylor, soutient le principe
de production en grandes séries de produits non différenciées de façon à réaliser des
économies d’échelle. Ford a appliqué ce principe par la standardisation des pièces de ses
véhicules, chaque véhicule étant doté des mêmes pièces exactement, permettant de les
échanger à volonté. Cela a permis non seulement un gain de coût, mais aussi un gain de temps
car plus aucun ajustement de la pièce lors de son montage sur le produit final n’était
nécessaire.
S’attirer la préférence des consommateurs
Seules les entreprises avec une stratégie globale seront viables sur le long terme, en se
concentrant sur ce que tous les consommateurs veulent, au lieu de ce que chaque
consommateur pense pouvoir aimer. Si les entreprises proposent des produits moins chers et
de meilleure qualité, ils préfèreront ces produits standardisés. Pour cette raison, la stratégie de
standardisation produit doit aller de paire avec une stratégie de compétition par les coûts pour
s’approprier la préférence du consommateur. Les compétiteurs globaux chercheront la
standardisation à tout prix, et s’ils doivent y renoncer pour un temps pour une raison ou une
autre, ils chercheront toujours à y retourner (Levitt, 1983).
§4. Standardisation : exemples
Exemples de succès
IKEA est le premier distributeur mondial de meubles et d’accessoires pour la maison. Quand
l’entreprise a été créée en 1943 en Suède, elle avait pour cible des consommateurs locaux aux
revenus élevés. Mais avec le processus d’internationalisation, l’entreprise a revu son

36
positionnement pour devenir plus compétitive, tout en tâchant de standardiser au maximum
pour effectuer des économies de coûts2.
Burt, Johansson et Thelander (2008) proposent une analyse de l’entreprise IKEA et de sa
stratégie de standardisation. Leur étude souligne les points suivants :
-‐ IKEA a réalisé une standardisation de son nom de marque ;
-‐ 95% des produits sont les mêmes d’un pays à l’autre ;
-‐ la stratégie de compétition est une compétition par les prix dans tous les pays ;
-‐ dans la majorité des pays (sauf la Chine), le catalogue constitue la base de la
communication ;
-‐ dans la majorité des pays (sauf la Chine), les magasins sont situés à l’extérieur de la
ville.
Ikea effectue aussi une standardisation au niveau des pièces utilisées pour la réalisation de
chaque meuble, de façon à effectuer des économies d’échelle au niveau des coûts de
production3. Au début des années 1990, pour rendre sa stratégie d’internationalisation plus
rapide et efficace sur ce marché prometteur, Ikea a décidé de standardiser totalement sa
production.
Les deux seuls éléments qui ont été adaptés, sans pour autant qu’on puisse qualifier cette
stratégie de stratégie d’adaptation, sont la publicité (qui va chercher à être en accord avec
l’humour et les goûts locaux), et l’arrangement des pièces de démonstration, qui vont être
meublées et décorées en fonction des tendances et goûts locaux. Néanmoins, malgré ces deux
éléments, on peut constater qu’IKEA applique une stratégie globale de standardisation, bien
qu’une adaptation au marché chinois a été nécessaire pour séduire les consommateurs de ce
marché.
2 AGAESSE Marion, JULLIEN Gaëlle, LEBLANC Delphine, TOUBOULIC Damien, « Marketing
Opérationnel, Analyser le Marketing et la communication, IKEA »,
3 Patrick Chabert, « Ikea cache bien son extrême standardisation »

37
Exemples d’échecs4
Suite au succès d’une promotion composée de bonus et cadeaux promotionnels aux Etats-
Unis, le fabriquant danois LEGO a voulu en faire de même au Japon. Cependant, la tactique
n’a pas fonctionné, et une enquête ultérieure a démontré que ce genre de promotions était jugé
inutile, coûteux et peu attrayant par les japonais.
Un autre exemple, toujours concernant LEGO, est celui du pilotage automatique : une
standardisation du marketing a été effectuée, partant du principe que « les enfants sont les
mêmes partout dans le monde ». Aux Etats-Unis, les responsables marketing avaient demandé
au siège l’autorisation d’emballer leurs jouets dans des seaux en plastique, pratique réalisée
par leur concurrent Tyco et rencontrant un grand succès car cela facilite le rangement. Dans
un premier temps, le siège a refusé, car cela les aurait fait passer d’innovateur à suiveur, ce
qui aurai été contre la politique de standardisation du marketing de LEGO. Cependant,
d’importantes pertes sur le marché américain à Noël 1988 les convainquirent de revenir sur
leur décision, et d’introduire les seaux à l’échelle internationale.
Le cas de Hallmark doit aussi être évoqué. Cette carterie américaine propose des cartes de
vœux contenant déjà des textes, pour éviter d’avoir à prendre un stylo et de cherche
l’inspiration. Mais ce concept n’a pas marché en France, le concept de carte non personnalisé
étant peu apprécié, et les textes semblant naïfs.
Un dernier exemple, est celui de Polaroïd, lors du lancement du SX-70. Convaincue que le
plaisir de la photo était un plaisir universel, la firme a voulu que les filiales du monde entier
appliquent la même stratégie publicitaire que celle présentée aux Etats-Unis. Or, ces spots
publicitaires rencontrèrent un faible impact dans le reste du monde. Par la suite, Polaroïd
changea de stratégie et passa d’une standardisation à une standardisation adaptée : s’inspirant
d’un spot publicitaire suisse, l’entreprise le testa sur différents marchés européens, puis laissa
le soin aux filiales d’adapter la campagne aux goûts locaux.
Ainsi, ces exemples d’échec soulignent le fait qu’il faut savoir être flexible et sacrifier les
normes internationales au profit d’adaptations locales, en accord avec la concurrence et les
opportunités constatées.
4 Kamran Kashani (1990), « Les pièges du marketing international », Fabien Renou (2011) « Les flops des
grandes marques »

38
§5. Les limites de la standardisation
Les conditions à remplir
Selon certains auteurs, il existe des conditions à remplir pour que la standardisation d’un
produit au niveau international améliore le profit. Parmi ces conditions, on retrouve : une forte
homogénéité de la demande internationale, un fort potentiel d’économie d’échelle
internationale, un fort coût de modification de produit, une forte élasticité prix de la demande
internationale, une erreur de perception minime des managers et une forte qualité d’exécution
stratégique (Schmid & Kotulla, 2011).
Schilke, Reimann et Thomas (2009) proposent des critères semblables : selon eux,
standardisation ne serait pas toujours synonyme de performance. Cinq variables permettraient
de définir le lien entre la standardisation et la performance : la taille de l’entreprise, la
stratégie de domination par les coûts, la coordination des activités marketing, la présence sur
le marché international, et l’homogénéité des produits. Il ne faut considérer une stratégie de
standardisation qu’en présence de ces facteurs à des niveaux élevés. Sans ces conditions
remplies, il faudra que l’entreprise songe à une autre stratégie pour une conquête efficace du
marché international.
Douglas et Wind (1987) soutiennent qu’une standardisation de tous les éléments du marketing
stratégique et du marketing opérationnel est rarement possible. Le but ne serait non pas
d’avoir une gamme uniforme de produits à travers le monde, mais plutôt d’avoir une gamme
de produits standardisés autant que possible tout en reconnaissant que des adaptations locales
sont parfois nécessaires et souhaitables. Cette stratégie marketing, appelée « standardisation
adaptée », est développée plus bas.
Pour d’autres auteurs, le choix entre la standardisation et l’adaptation dépend de facteurs liés
davantage au produit lui-même et à sa distribution. Parmi ces facteurs, on retrouve la gamme,
la qualité du produit, le cycle de vie du produit, le changement des produits/marques, les
modes de promotions, les décisions de mise en place des promotions, les réductions et remises
à l’export, le contrôle des canaux de distribution, les réseaux de distribution sur place, la taille
de la base de clients étrangère, et la compétition au sein du marché cible (Sustar, 2001).

39
Une homogénéisation des concurrents
D’autres auteurs formulent des critiques à l’égard de la stratégie de standardisation. Par
exemple, la standardisation de sa communication, bien que permettant des économies de
coûts, risque de pousser de consommateur à ne se concentrer que sur les caractéristiques
objectives de l’offre, et par conséquent ne pas se différencier des concurrents. Des
consommateurs avec le même revenu, le même niveau d’éducation et le même type d’emploi
vont présenter les mêmes besoins. Cependant, en fonction des cultures, les consommateurs ne
vont pas accorder la même importance aux différentes caractéristiques de l’offre (Kaynak &
Mitchel, 1981).
D’autre part, comme Quelch et Hoff (1986) l’ont suggéré, le principal moteur de la
globalisation ne serait pas simplement le souci d’économies d’échelle permises par la
standardisation, mais plutôt la volonté d’exploiter une bonne idée à l’échelle mondiale. Cette
constatation mène à se demander si la stratégie d’adaptation ne permettrait pas elle aussi
d’exploiter cette idée, mais avec une performance accrue, en permettant de se différencier des
concurrents et de s’adapter davantage à ses consommateurs.
L’adaptation : plus performante ?
Une étude de Schuiling (2002) tend à démontrer que les marques dites « locales » (ou
« adaptées ») possèdent une réelle force face aux marques dites « globales ») (ou
« standardisées »).
Dans la continuité, une étude de Schuiling et Kapferer (2004) a mis en exergue que cette force
serait la confiance accrue générée par les marques locales, en comparaison avec les marques
globales. Cette étude mène à penser que la stratégie d’adaptation, expliquée ci-après, serait la
stratégie la plus efficace.
Solberg (2002) a réalisé une étude sur des exportateurs Norvégiens, et qui va dans ce sens : la
connaissances des conditions du marché semblerait mener à une standardisation produit plus
forte, en particulier lorsque le pouvoir et les décisions sont centralisées, mais cette
centralisation semble provoquer des réactions négatives. Au contraire, laisser les décisions
aux responsables locaux permet de prendre davantage de distance avec la standardisation, et
d’avoir des meilleurs résultats au niveau organisationnel, et par conséquent favorise la
performance.

40
On a aussi souligné, dans l’exemple d’IKEA, qu’il était très difficile de standardiser la totalité
de sa stratégie : des ajustements sont souvent nécessaires, en particulier au niveau de sa
communication.
Outre la compétition et l’action des partenaires, il existe des forces en faveur et en défaveur de
la standardisation, qui vont permettre de définir le degré jusqu’auquel l’entreprise doit
poursuivre sa stratégie de standardisation, ce sans quoi elle risque une diminution de sa
performance.
Facteurs permettant la définition du degré de standardisation à poursuivre par l’entreprise
(Source : l’auteur)

41
C. La stratégie d’adaptation, ou marketing local
L’adaptation est une stratégie de marketing international consistant pour une entreprise à
proposer des produits aux caractéristiques différentes à chaque segment de consommateurs,
pour répondre à des besoins différents (Levitt, 1983).
Cette stratégie permet d’acquérir de plus grandes parts de marché grâce à une meilleure
adhésion de la part des consommateurs, qui ont la sensation que l’entreprise comprend leurs
valeurs, culture, et besoins.
§1. Les objectifs de la stratégie d’adaptation
Des consommateurs aux besoins variés
Selon le Robert (1974), le besoin est « une exigence de la nature ou de la vie sociale ». Abbott
(1955) propose une distinction entre les besoins dits « génériques » et les besoins dits
« dérivés ». Le besoin dérivés seraient une « réponse technologique particulière (le bien)
apportée au besoin générique ». Les auteurs qui soutiennent la stratégie d’adaptation
cherchent à prouver que les différences culturelles entre les pays ont une importance critique.
Contrairement à l’idée que certaines offres et leur communication pourraient être
standardisées en raison de leur réponse à des besoins universels, en fonction des cultures les
consommateurs vont accorder plus d’importance à une caractéristique spécifique de l’offre
(Green, Cunningham & Cunningham, 1975). Bien qu’au niveau macroscopique, la possession
d’un même produit dans différents pays semble semblable, l’utilisation de ce produit a
tendance à diverger entre les pays, et les caractéristiques annexes de l’offre prennent aussi une
place importante dans le processus de décision du consommateur. Avec le temps, ces
divergences de consommation ont tendance à rester stable ou croitre.
Le modèle développé par Hofstede permet d’expliquer la plupart des variations en ce qui
concerne la consommation et l’attitude des consommateurs entre les différents pays, et permet
de mesurer les effets de la culture (De Mooij, 2003). Boddewyn (1986) affirme que les
différences nationales en matière de goûts, habitudes, règles et nécessités techniques sont les
barrière majeures de la standardisation.

42
T. Grosbois (2010) propose une analyse de l’européanisation d’une firme américaine, General
Motors, à travers sa stratégie industrielle et commerciale locale. En effet en matière
d’automobile, outre un protectionnisme croissant pendant la période étudiée, il y a des
différences entre les critères de choix américains et ceux européens (voitures plus petites par
exemple), qui découlent de la culture locale. Sa stratégie a été d’européaniser ses marques, en
investissant dans des filiales européennes, de façon à proposer des marques européennes aux
populations locales, trouvant ainsi une façon de contourner le protectionnisme européen.
Cette stratégie d’adaptation au marché local s’est avérée payante pour l’entreprise.
Une recherche de performance
La performance d’une entreprise se mesure grâce à la création nette de valeur réalisée, et
s’articule autour de ce qui contribue à l’amélioration du couple valeur-coût. Ce concept
intègre aussi la notion d’efficacité (mener une action jusqu’à son terme) et la notion
d’efficience (les moyens utilisés pour atteindre les buts l’ont été dans un soucis d’économie).
Pour des entreprises issues d’une industrie particulière (en particulier les firmes qui opèrent
sur des marchés mondiaux et possèdent des possibilités de standardisation similaires), les
entreprises qui vont appliquer une stratégie d’adaptation de leur offre auront une performance
accrue (Samiee & Roth, 1992). Cette performance se justifie par des parts de marché accrues
par rapport à la stratégie de standardisation : en séduisant davantage de consommateurs,
l’entreprise va pouvoir augmenter son volume de vente, et ainsi rembourser les coûts
d’adaptation.
§2. Les facteurs favorisant l’adaptation
Les partisans de l’adaptation soulignent aussi que le but principal de l’entreprise devrait être
le profit à long terme, atteint grâce à des ventes plus importantes, qui elles-mêmes sont
réalisées grâce à une meilleure compréhension des besoins des consommateurs, et non grâce
aux économies de coûts réalisées grâce à la standardisation au niveau global (Rosen, 1990 ;
Onkvisit et Shaw, 1990 ; Whitelock et Pimblett, 1997 ; Theodosiou et Leonidou, 2003).

43
Prenant ces études précédentes comme base, Lage, Lage et Abrantes (2007) ont défini
différents facteurs favorisant l’adaptation :
-‐ l’organisation est polycentrique ;
-‐ l’état de maturité des marchés pour un même produit est différent ;
-‐ la stratégie d’adaptation est suivie par les concurrents ;
-‐ il existe des variations dans les achats des consommateurs ;
-‐ les substituts nationaux sont indépendants et nationaux, ce qui leur permettrait de
développer leurs propres produits ;
-‐ l’autorité est décentralisée ;
-‐ il existe des différences culturelles en terme de traditions, langages, goûts, et
habitudes de consommation ;
-‐ les gouvernements présentent des règles différentes, en matière des standards, lois,
politiques de taxation, et contenu ;
-‐ l’entreprise se concentre sur les produits à destination des consommateurs, qui sont
plus susceptibles d’être influencés par les goûts individuels, ce qui favorise
l’adaptation ;
-‐ la possibilité de réaliser des profits plus importants en prenant en compte les
variations dans les besoins des consommateurs, et les conditions d’utilisation.
§3. Les différents domaines d’adaptation
Les caractéristiques clés de l’adaptation sont les suivantes : l’existence de barrières
administratives et de normes, l’hétérogénéité des goûts et des usages, ainsi que les
caractéristiques du produit. Par conséquent, différents aspects de l’offre peuvent être adaptés.
Un des domaines qu’il est possible d’adapter au contexte culturel local est le nom de marque.
Cette situation s’observe lorsque la concurrence, le pouvoir d’achat et l’intensité de
distribution sont élevés (Alashabn, Hayes, Zinkhan & Balazs, 2002).
L. Lessassy (2008) souligne un autre aspect du choc des cultures, par l’exemple des produits
ethniques qui se développent petit à petit dans les canaux de grande distribution, mais qu’ils
ne satisfont pas encore la clientèle à cause de nombreux dysfonctionnements dans ces canaux.

44
À travers une enquête menée auprès d’acteurs des achats, approvisionnements, et de la vente
de ces produits, l’auteur cherche à mettre en évidence que les principaux problèmes
rencontrés viennent d’une logique d’ordre culturel importée en Occident. Par conséquent, un
second domaine de la stratégie marketing qu’il est possible d’adapter est la distribution.
De façon plus générale, tous les éléments du mix marketing peuvent être adaptés pour
répondre aux attentes des consommateurs : non seulement le nom de marque et la distribution
comme montré précédemment, mais aussi les caractéristiques du produit (taille, couleur,
fonctions secondaires) comme l’indique Usunier (2004). La communication autour du produit
va elle aussi pouvoir être adaptée, en transmettant des symboles propres à chaque culture.
Enfin, il ne faut pas négliger la variable prix qu’il est possible d’ajuster en fonction des
niveaux de revenus locaux, tout comme la promotion.
§4. Adaptation : exemple
Exemples de succès
Un exemple de stratégie d’adaptation est celui de Nokia sur le marché africain. Nokia, créé en
1865, opère dans l’industrie des téléphones portables.
À cause du développement inégal des marchés, entre les marchés européen et nord-américain,
et Africain, l’entreprise a dû adapter son offre, proposant sur le marché africain des
téléphones basiques, à un prix abordable, alors que les téléphones proposés sur les autres
marchés sont très évolués (smartphones) et plus chers5. En Inde, au Pakistan et au
Bengladesh, Nokia a développé un téléphone résistant à la poussière, qui peut aussi servir de
lampe de poche.
Ainsi, l’entreprise s’adapte aux marchés dans lesquels elle décide de s’implanter. Néanmoins,
on ne peut omettre de constater une certaine standardisation des produits, par regroupement
de segments de marchés (comme pour les pays en voie de développement/pays développés).
Par conséquent, cette stratégie d’adaptation de la part de Nokia sur chaque marché
5 « Marketing strategies used by Nokia », http://www.ukessays.com/essays/marketing/marketing-strategies-used-
by-nokia-marketing-essay.php

45
s’apparente aussi à la troisième stratégie d’internationalisation expliquée plus bas, la stratégie
de standardisation adaptée.
Exemple d’échec6
Comme échec de stratégie d’adaptation, on peut prendre l’exemple de la Logan en Inde. La
Logan, une voiture low-cost spécialement conçue par la filiale Dacia de Renault pour vendre
dans les pays émergents, n’a pas rencontré le succès escompté en Inde. Ses ventes avaient
pourtant très bien marché au Maroc, en Russie, en Iran et en Colombie.
Commercialisée à partir de 2007, cette voiture, pensée pour être adaptée au marché émergent,
a souffert tout d’abord de la crise, puis d’une mesure fiscale prise par le gouvernement indien
en 2008. Cette mesure, assujettissant les véhicules supérieurs à une certaine longueur à une
taxe de 24%, a rendu la Logan trop chère pour une voiture low-cost, et trop petite pour
prétendre rivaliser avec les véhicules plus luxueux.
Le coup de grâce sera apporté en janvier 2009, quand le groupe Tata dévoilera sa Nano, la
voiture la moins chère du monde : 2 000 dollars contre 8 000 dollars pour une Logan.
Le principal problème, outre les événements fortuits, vient d’une difficulté d’adaptation et de
réaction, et d’une perception du marché complètement différente suivant la culture : pour la
culture occidentale, la Logan paraissait être une voiture low-cost, alors que pour un employé
indien de classe moyenne, elle représentait près de trois fois un salaire annuel. Cette voiture
était destinée à un segment de marché encore très restreint en Inde, la voiture étant trop chère
pour les pauvres, pas assez luxueuse pour les riches, et la classe moyenne indienne n’étant pas
très développée. De plus, bien que cette voiture soit partie d’une volonté d’adaptation, de
nombreux éléments standardisés ont freiné sa réussite en Inde : des clignotants à gauche du
volant, un pare-brise inadapté à la conduite à gauche.
Cet exemple souligne le fait qu’une stratégie d’adaptation doit être pensée dans les moindres
détails. Si certains éléments sont standardisés, ne répondant pas à la culture locale, le but
recherché risque de ne pas être atteint, même si le concept lui-même a été parfaitement adapté
au marché cible.
6 Benjamin Pelletier (2010) « Pourquoi Renault a échoué en Inde avec la Logan ? »

46
§5. Les limites de l’adaptation
Pour Theodosiou et Leonidou (2003), l’idée selon laquelle il faudrait adapter son produit à
tout prix à un marché donné est fausse, bien que l’adaptation à un marché local soit souvent
une nécessité. Dans certains cas, un produit parfaitement standardisé pourra convenir à
différents marchés ou segments de marchés.
Néanmoins, cette situation est assez rare, et le produit qu’il est possible de standardiser tout
en restant adapté aux différents marchés doit être considéré comme un hasard avantageux. Les
entreprises doivent cependant toujours prendre en considération les besoins et caractéristiques
des consommateurs pour voir s’il est possible de créer un produit globalement standardisé.
Cependant, quand ces caractéristiques et besoins ne convergent plus, il devient nécessaire
pour l’entreprise d’adapter le produit, sans négliger les coûts que cela implique.
D. La stratégie de standardisation adaptée, ou marketing glocal
§1. Les avantages de la standardisation et de l’adaptation
Les deux stratégies de marketing internationales présentées auparavant (standardisation et
adaptation) présentent toutes deux des avantages, résumés ci-dessous (Usunier, 2004). Les
avantages de chacune peuvent permettre d’améliorer la performance de l’entreprise, sur
différents axes.
AVANTAGES COMPARES DE LA STRATEGIE DE STANDARDISATION ET DE
LA STRATEGIE D’ADAPTATION DE L’OFFRE INTERNATIONALE
AVANTAGES DE LA STANDARDISATION
AVANTAGES DE L’ADAPTATION
Décisions simplifiées Plus grande part de marché possible

47
Facilité de mise en œuvre Accroissement de la probabilité de rachat
Uniformité du produit physique Nécessité réglementaire
Image de marque mondiale et uniforme
Service consommateur cohérent et homogène
Meilleur contrôle qualité
Flexibilité
-‐ tarifaire (variation de la politique de
prix à travers les marchés)
-‐ de production (variation possible de
la quantité et de la qualité à travers
les marchés)
Facilite le reporting Meilleure identité locale du produit
Communication locale plus efficace
Suppression des doublons
Fragmentation des marchés limitée
Séries courtes à moindre coût (automatisation, économies d’échelles par regroupement de segments de marché)
Suppression de la confusion parmi les employés, distributeurs, et/ou consommateurs
Réponse adaptée à la fragmentation croissante des marchés
Economies (coûts de production, marketing et légaux) : efficacité opérationnelle
Efficace avec les produits culture-bound
Efficace pour les couples produit/marché transnationaux mondiaux et aux cibles mobiles
Efficace pour les produits « culture-free »
(Source : Usunier, 2004)
Il est donc du ressort de l’entreprise de définir quels sont ses principaux objectifs, et d’adopter
une stratégie de marketing international qui coïncide avec ces objectifs. Néanmoins, il ne faut
pas oublier que la stratégie n’est pas nécessairement fixée dans le temps, et peut évoluer en
fonction des nouveau objectifs de l’entreprise.
Toujours selon Usunier (2004), en prenant en compte les attributs physiques, de service et
symboliques de chaque produit, il est possible de les décliner en arguments en faveur de et
contre l’adaptation :

48
Facteurs influençant ou non l’adaptation d’un produit (Usunier, 2004)
Cependant, ces avantages ne semblent pas exclusifs. Un troisième courant théorique va
envisager la possibilité de profiter tant des avantages de la standardisation que des avantages
de l’adaptation, en adoptant une stratégie contingente.
§2. L’émergence d’une stratégie contingente
Cela mène à envisager une troisième stratégie, qui permettrait de profiter des avantages des
deux stratégies précédents (standardisation et adaptation).
Une nouvelle notion est alors proposée, celle de standardisation adaptée, qui se trouve à mi-
chemin entre la standardisation et l’adaptation. L’approche contingente soutient que les
différences locales doivent être prises en considération, mais que néanmoins un certain degré

49
de standardisation est possible et désirable (Onkvisit and Shaw, 1990). La standardisation
adaptée est une stratégie de marketing international consistant pour une entreprise à proposer
des produits aux caractéristiques différentes aux différents segments de consommateur, en
regroupant les segments similaires, pour répondre à des besoins différents (Levitt, 1983).
Cette stratégie permet non seulement des économies d’échelle, mais aussi d’acquérir de plus
grandes parts de marché.
Theodosiou et Leonidou (2003) résument la stratégie de standardisation adaptée de la façon
suivante :
-‐ les stratégies de standardisation et d’adaptation ne doivent pas être considérées
comme exclusives ;
-‐ la décision de standardiser ou adapter sa stratégie marketing est spécifique à la
situation, et le marché doit être analysé avec précaution pour faire un choix qui soit
approprié à un moment précis ;
-‐ le niveau approprié de standardisation/adaptation doit être évalué en fonction de son
impact sur la performance de l’entreprise sur le marché international.
En d’autres termes, chaque entreprise doit étudier le marché sur lequel elle opère de façon à
déterminer le degré de standardisation/adaptation qu’il convient de réaliser. Une stratégie
marketing adaptée à un contexte environnemental (contraintes légales, intensité et vitesse
technologiques, coutumes et tradition, caractéristiques des consommateurs, intensité
concurrentielle, et stage du cycle de vie du produit) influe sur la performance d’une
entreprise, indiquant jusqu’où la standardisation doit se poursuivre (Katsikeas, Samiee et
Theodosiou, 2006).
La stratégie de standardisation adaptée propose donc de bénéficier des avantages liés à
l’homogénéisation, tels que la mondialisation de l’image, le contrôle de la communication, et
l’implication des équipes locales. Bien que certaines entreprises proposent des lignes de
produits permettant à s’adapter à certains segments du marché local, elles vont profiter des
besoins mondiaux homogènes pour trouver d’autres segments similaires à travers le monde et
ainsi réaliser des économies d’échelle. Le monde doit être perçu comme composé de quelques
marchés standardisés plutôt que de multiples marchés adaptés (Levitt, 1983).
Les marques « locales » (adaptées) sont appréciées lorsque l’identité culturelle est forte, et les
marques « globales » (standardisées) lorsque l’identité culturelle est faible. Les marques «

50
globales » peuvent ne pas s’avérer efficaces avec de larges segments de consommateurs, et il
est parfois préférable d’avoir un portfolio de marques dites « locales » (Steenkamp et De
Jong, 2010). On peut alors qualifier cette stratégie de stratégie « glocale » : une même marque
« locale » va être utilisée dans plusieurs marchés, sur des segments aux besoins similaires.
Les économies de coûts seront ainsi toujours présentes, mais l’entreprise aura une meilleure
réponse aux besoins spécifiques des consommateurs de chaque segment.
§3. Standardisation adaptée : exemples
McDonald’s est l’exemple type de la stratégie de standardisation adaptée. De nombreuses
études de cas ont été réalisées sur ce sujet, parmi lesquelles celle de Vignali (2001) et de Ram
(2004). McDonald’s est la plus grande chaine de fastfood internationale, avec plus de 30 000
restaurants implantés dans 120 pays.
Le succès de McDonald’s à l’international est principalement attribué à son système de
franchise. En accordant des franchises à des locaux, ces derniers ont adapté les éléments qui
pouvaient être interprétés comme « culturellement américains » à la culture locale, que ce soit
en termes de produits ou de service.
Pour ce qui est de l’adaptation produit, McDonald’s a développé des spécialités en fonction
des pays, par exemple le McBaguette en France, ou la suppression des menus avec du porc
dans les pays avec une majorité de musulmans, ou des menus avec du bœuf dans les pays
avec une majorité d’hindouistes, sans oublier le shrimp McNuggets, en accord avec les
préférences chinoises. Aux Philippines, les menus seront plus épicés pour s’accorder avec les
préférences locales. Le CEO Jim Cantalupo résume cela très simplement : « McDonald’s a un
nouveau patron… ce n’est pas moi… c’est le client ».
Mais on constate aussi des adaptations au niveau des services. En France, l’entreprise a
amélioré ses décors pour rivaliser avec l’ambiance des cafés locaux, en transformant par
exemple ses restaurants de montagnes en intérieurs de chalets, ou ses restaurants situés près
de complexes sportifs avec des motifs correspondants. En Arabie Saoudite, les hommes sont
séparés des femmes dans la salle de déjeuner. Si une femme souhaite manger, elle doit avoir
l’accord d’un homme de sa famille.

51
Un troisième domaine d’adaptation se situe dans le fonctionnement de l’entreprise : dans les
pays à majorité musulmane, le restaurant ferme plusieurs fois par jour de façon à permettre
aux employés de prier. En Arabie Saoudite, tous les travailleurs sont des hommes. La
communication, elle aussi, va dépendre des pays, en cherchant à s’adapter aux valeurs et
traditions des consommateurs.
Mais bien qu’il existe de nombreux domaines d’adaptation, certains éléments restent
parfaitement standardisés : le nom de la marque, l’offre produit « basique », et la mascotte par
exemple.
Ainsi, McDonald’s a su exporter son offre vers différents pays, en adaptant les éléments
nécessaires à sa compétitivité.
Un autre exemple de stratégie de standardisation adaptée est celle de Coca-Cola. The Coca-
Cola Company a été créée en 1886, et est aujourd’hui le leader mondial en matière de
manufacture, marketing et distribution de concentrés de boissons non alcoolisées et de sirops.
L’entreprise opère actuellement dans 200 pays.
Bien que les marques « globales » de Coca-Cola soient principalement standardisées, un
certain nombre d’adaptations prennent place. Pour Vrontis et Sharp (2003), bien que
l’entreprise souhaite réaliser une approche parfaitement standardisée, menée par les
économies d’échelle. Cette adaptation passe par l’étiquetage, le nom de marque (parfois
traduit dans la langue locale), la communication, mais aussi parfois la recette pour d’adapter
aux lois locales, tout en essayant de garder un goût « standardisé ». La standardisation, elle,
va s’appliquer entre autres à la variable prix, qui va rester la même à travers le monde.
Ainsi, la stratégie de standardisation adaptée est souvent adoptée par les grands groupes, car
elle semble tenir tant ses promesses en matière d’économies d’échelle, qu’en matière
d’augmentation des parts de marché grâce à l’adhésion des consommateurs à une marque qui
intègre leurs valeurs. Bien que localement, la stratégie adoptée semble être une d’adaptation,
il s’avère quand on considère l’entreprise dans son ensemble que c’est bien la stratégie de
standardisation adaptée qui a été mise en œuvre.

52
§4. Conclusion
Ainsi, il est difficile de trancher entre les différentes stratégies d’internationalisation. Selon
Solberg et Durrieu (2008), la standardisation permet de réduire les coûts et de donner une
image de marque mondialement reconnaissable. Néanmoins, l’adaptation s’avère parfois
indispensable en raison des différences entre consommateurs locaux et consommateurs
étrangers.
Par conséquent, la stratégie contingente de standardisation adaptée présente de nombreux
avantages, permettant de s’adapter selon différents degrés au marché cible et aux objectifs de
l’entreprise. Cette stratégie semble permettre de diminuer grandement les risques liés au
marché tout en contrôlant les coûts engagés.
Standardisation, adaptation et standardisation adaptée : critères de choix (Source : l’auteur)
Selon Solberg (2000), le choix entre standardisation et adaptation a des aspects
organisationnels qui sont trop souvent négligés dans la littérature. Bien que la dimension

53
organisationnelle ne relève pas de ce Mémoire, il s’agit là d’un élément qu’il ne faut pas sous-
estimer.

54
IV- Propositions de recherche
Ma question centrale de recherche est la suivante :
« Face à une mondialisation de plus en plus importante, comment les organisations
ayant une dimension internationale doivent-elles se comporter face à la diversité
culturelle de leurs différents marchés cibles ? »
Mes deux sous questions de recherche sont :
-‐ Peut-on exporter n’importe quel produit/service vers une culture différente, sous
réserve d’un canal de diffusion, d’un nom de marque et d’une communication
adaptés ?
-‐ Quels éléments permettent de faire un choix entre la standardisation de son offre, sa
communication et son positionnement à l’échelle mondiale et l’adaptation aux
cultures locales dans un souci de performance ?
Grâce aux travaux des différents chercheurs qui ont étudié le sujet qui nous intéresse, et à la
suite des éléments et théories exposés en première partie, pour le domaine des divertissements
télévisés, nous pouvons proposer les propositions de recherche suivantes :
1. L’adaptation semble chercher à répondre avant tout à des caractéristiques et besoins
précis des consommateurs français ;
2. La stratégie de standardisation adaptée semble la plus pratiquée, pour les émissions
diffusées sur les principales chaines (avec le plus de parts de marché) ;
3. La standardisation est rendue possible par une similarité au sein des consommateurs.
On définira la stratégie de standardisation dans les émissions de divertissement comme la
simple traduction de l’émission, la standardisation adaptée comme la réalisation d’une
émission en changeant les participants et quelques éléments mineurs lors de la réalisation, et
l’adaptation comme la conservation du principe général mais la modification de l’ensemble de
la réalisation ou du concept.
Lors de la seconde partie de ce Mémoire, dite empirique, ces propositions de recherche seront
confrontées aux données du terrain grâce à des guides d’entretien préétablis (voir annexes,
page 115), de façon à les valider ou à les réfuter pour le secteur qui nous intéresse.

55
Comme indiqué précédemment, ce Mémoire a pour objectif de combler un manque dans la
littérature, qui ne compte pas encore de recherche sur l’adaptation et la standardisation dans le
milieu des formats télévisés. Suite aux résultats de cette étude, il serait intéressant de mesurer
de manière objective la performance des différentes stratégies d’adaptation en matière de
formats d’émissions télévisées.
Pour les acteurs du secteur de la production et diffusion de formats télévisés, cette étude a
pour objectif de donner des éléments de choix entre la stratégie d’adaptation des formats, la
stratégie de standardisation, et la stratégie de standardisation adaptée.
Le entretiens ayant été très riches en information, d’autres thèmes que ceux proposés en
propositions de recherche seront abordés dans l’analyse.

56
Chapitre 2 : Cadre empirique

57
I- Méthodologie utilisée pour l’étude empirique
A. Choix de la méthodologie
La première partie de ce Mémoire a pour objectif de cerner les points clefs de la recherche, de
façon à élaborer des propositions de recherche auxquelles il nous faudra donner des réponses
par la suite, lors de l’étude terrain.
La question principale de recherche et nos propositions de recherche nous amènent à nous
orienter vers une démarche qualitative, car nous cherchons à définir les éléments qui influent
sur la réussite de l’import/export d’un produit/service dans un contexte culturel différent, et
les méthodes qui permettent d’optimiser la réussite à l’import/export (standardisation,
adaptation et standardisation adaptée). Il s’agit de définir des attentes, des contraintes, des
motivations, des jugements de valeur, et des méthodes d’adaptation, qui ne sont pas
quantifiables.
Par conséquent, nous avons choisi de nous orienter vers une démarche qualitative, en nous
entretenant avec huit professionnels opérant dans ce domaine, et en nous aidant d’un guide
d’entretien (voir annexe, page 115) dans lequel se trouvent les principaux thèmes à aborder de
façon à répondre au mieux à notre problématique.
Nous avons aussi décidé d’administrer des questionnaires à un échantillon réduit de
téléspectateurs (97), pour connaître leurs choix de divertissements télévisuels en fonction de
leur profil, et leurs motivations. Cette seconde démarche a pour but de comparer les réponses
des téléspectateurs au ressenti des professionnels interrogés, et de définir d’autres axes de
recherche qui pourraient être intéressants.
B. Terrain d’investigation : le marché de l’audiovisuel
§1. Description du marché français
Le 26 avril 1935, la première émission télévisée est diffusée en France. Depuis, et jusqu’en
1980, le paysage audiovisuel s’est articulé autour de 6 grandes chaines télévisées. Par la suite,
la concurrence s’est accrue entre les chaines de télévision, la demande pour les contenus étant

58
moins dynamique que l’offre7, et de nouvelles chaines émergeant pour proposer de nouveaux
types de programmes.
Entre 2008 et 2012, la télévision s’est affirmée comme premier média, avec une augmentation
sensible pour atteindre 35% de part de marché en 20128. Les français regardent la télévision
en moyenne 3 heures 47 par jour9.
En 2012, la quasi-totalité des foyers français (98,3%) est équipée d’au moins un poste de
télévision, et les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 50 minutes par
jour, durée en augmentation depuis 2010. Ce marché a donc su continuer de susciter l’intérêt
des consommateurs malgré la crise économique. Les trois principaux acteurs actuels de la
télévision française (selon leurs parts d’audience annuelles) sont TF1 (22,7%), France 2
(14,9%) et M6 (11,2%). À ces trois principaux acteurs viennent s’ajouter les chaines de la
TNT gratuite (hors chaines locales) qui ont atteint en 7 ans 22% des parts d’audience
annuelles.
§2. Les acteurs du marché audiovisuel français
Le marché audiovisuel français est composé de cinq acteurs principaux.
Le premier est les sociétés de production indépendantes. Celles-ci vont avoir pour objectif de
vendre aux chaînes de télévision des programmes correspondant à leurs attentes, en fonction
de leur cible, et de les produire, ou de vendre les droits pour laisser le soin aux chaines de
produire elles-mêmes. Leur portefeuille de programmes est constitué d’émissions créées par
leurs soins, ou d’émissions/de droits sur des émissions achetés à d’autres sociétés de
production.
Les chaines de télévisions vont donc choisir ces programmes en fonction du succès
commercial envisagé pour leur cible de téléspectateurs. Chaque chaine ayant un public bien
7 https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/371974
8 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles/Les-chiffres-cles-de-l-audiovisuel-francais-Edition-
du-1er-semestre-2013
9 Source Médiamétrie

59
particulier, toutes ne choisiront pas les mêmes programmes, même s’il peut arriver que deux
chaines se disputent un format. Ces chaines de télévision vont parfois posséder leur propre
société de production, chargée de réaliser les programmes dont la chaine a fait acquisition au
près de sociétés de production externes, ou de créer leurs propres programmes. Il arrive que
les chaînes coproduisent des programmes avec des sociétés de production externes.
Le troisième acteur est les téléspectateurs, le public. Il va varier en fonction des chaines, mais
aussi en fonction d’autres paramètres tels que le moment de la journée. C’est le fait pour les
chaines de télévision de pouvoir garantir leur présence devant le petit écran qui va permettre
de vendre des écrans publicitaires au quatrième acteur, les marques et entreprises souhaitant
promouvoir leurs produits ou services. Il est à noter que le public passant le plus de temps
devant le petit écran est les séniors.
Enfin, les programmes diffusés sont contrôlés par le CSA, le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel, autorité de régulation de l’audiovisuel en France. Il veille à la bonne
application de la loi, dans le but de protéger le public, et au respect de la liberté de la
communication.
Schématisation du marché de l’audiovisuel français (source : l’auteur)

60
§3. Les émissions de flux : entre standardisation et adaptation10
Les émissions télévisées de façon générale constituent un produit très particulier du marché :
immatérielles, elles ne consistent pas pour autant en un service.
Les émissions dites « de flux » dans le milieu de la télévision sont les émissions de téléréalité,
les magazines, les émissions de divertissement, les émissions de variété et les jeux.
Entre mars et juillet 2011, dans le cadre de sa réflexion sur les émissions de téléréalité, la
Commission de réflexion sur l’évolution des programmes a réalisé un cycle de 24 auditions.
Lors de ces auditions, des associations on fait entendre leurs craintes en ce qui concerne les
valeurs véhiculées par ce type de formats télévisés. François Jost met en exergue ici un
paradoxe, qui est que bien que ces émissions paraissent amorales, elles reposent sur un socle
implicite de valeurs traditionnelles qui sont issues des contes ou encore des romans
traditionnels.
Le succès de ce genre de formats télévisés est dû à plusieurs éléments, dont :
-‐ l’identification de la part du spectateur,
-‐ mais aussi la distanciation rassurante lors de situations humiliantes ou ridicules,
-‐ la confiance en les anonymes et leurs pairs,
-‐ les émotions changeantes véhiculées,
-‐ leur dimension sociale et leur symbolique « démocratique »,
-‐ le plaisir, bien qu’ambigu, que trouve le public à regarder ce genre d’émissions.
Bien qu’il ne s’agisse dans cet exemple que des émissions de téléréalité, cela soulève une
réelle question en matière de standardisation et d’adaptation des émissions de divertissement
télévisées, pour ce qui est des valeurs véhiculées.
10 Pour plus d’informations sur les émissions de flux, et plus particulièrement de téléréalité et de jeux télévisés,
les références d’une vidéo explicative du marché à travers le succès du producteur de Big Brother et de The
Voice est disponible en annexe : « John de mol, l'homme qui a inventé la télé-réalité », émission Le Tube du
10/05/2014.

61
Pour ce qui est des séries par exemple, on constate de nombreux exemples de séries rachetées
par des pays étrangers de façon à en faire des « remakes ». Les Etats-Unis et l’Angleterres ont
acheté les droits pour les séries françaises Hard et Les Revenants de Canal+ par exemple. On
parlera ici de stratégie d’adaptation, qui est apparentée dans ce cas à de la création, à la
différence de la stratégie de standardisation qui consisterait à simplement traduire la langue.
Un exemple de format télévisé ayant été adapté à plusieurs cultures différentes est l’émission
connue sous le nom de « Koh-Lanta » en France, diffusée sur TF1. Bien qu’on connaisse
souvent son équivalent américain « Survivor » créé en 2000, il est plus rare que l’on sache
que l’émission d’origine était « Expédition Robinson », émission suédoise de 1997. Il est
possible de comparer « Survivor » et « Koh-Lanta » sur un certain nombre d’éléments qui
permettront de comprendre l’adaptation culturelle qui a eu lieu avec ce format.
Tout d’abord, la construction d’un épisode est la même : le résumé de l’épisode précédent, le
générique, un point sur la situation des deux équipes (ou de l’équipe), une épreuve de confort,
un nouveau point sur la situation, une épreuve d’immunité, un point avant le conseil, le
conseil pendant lequel l’animateur pose quelques questions aux participants avant que ceux-ci
ne votent, le dépouillement, et le départ de la personne désignée par le vote. Les deux
émissions vont aussi utiliser le procédé qui consiste à interroger un concurrent sur un
événement qui vient d’être présenté à l’écran, pour recueillir ses impressions.
En France cependant, on constate un ajout de signaux explicatifs : en plus des images, du son
et de la musique, une voix-off décrira et réexpliquera tout ce qui est en train de se produire,
mais sans ajouter aucun élément nouveau. Cette méthode peut donner une impression
d’émission très redondante, là ou les réalisateurs de Survivor vont considérer qu’un simple
montage d’images avec de la musique se suffit à lui-même. Il faut aussi noter que les
montages sont beaucoup plus soignés dans l’émission américaine que dans l’émission
française. On remarquera également la présence, toujours en France, de panneaux explicatifs
qui apparaissent en bas de l’écran pour résumer la situation. Un autre élément, est l’absence
de l’utilisation du nom des équipes par la voix-off, dans la version française : on parlera
toujours des « jaunes » et des « rouges ». Dans la distribution aussi, on va pouvoir constater
des différences : aux Etats-Unis, les participants vont avoir de fortes personnalités, de façon à
donner aux spectateurs un spectacle sulfureux avec des personnalités antagonistes qui doivent
cohabiter. Bien souvent, on pourrait penser qu’il ne s’agit que d’acteurs chargés de réaliser un
véritable spectacle en parallèle de l’émission, en jouant des rôles de personnages fictionnels ;
la mise en scène joue un rôle primordial. En France, on aura affaire non pas à des personnages

62
mais à des personnes : les caractères sont plus discrets, et si la distribution cherche à mettre en
contact des caractères forts et antagonistes, les réactions seront bien souvent plus mesurées et
moins spectaculaires qu’en France. Enfin, si la récompense aux Etats-Unis est d’un million de
dollars, en France elle ne sera que de 100 000 €, ce qui va inciter les participants à parler
d’expérience humaine plus que de concours.
On peut donc constater des adaptations, propres à chaque culture, pour un même concept
d’émission. Et il ne s’agit pas d’un exemple isolé, les émissions de télé crochet sont
nombreuses à être importées et exportées d’une culture à l’autre, tout en subissant parfois des
modifications, ou en appliquant un formats parfaitement standardisé (« La France a un
incroyable talent » / « Britain’s got talent »).
§4. Le choix du terrain d’investigation
Pour toutes ces raisons, le domaine des émissions de flux nous a paru être un domaine
extrêmement riche en matière d’exemples de standardisation et d’adaptation à la culture
locale. Le paysage audiovisuel des différents pays semble très varié, alors que le besoin
pourrait sembler, au premier abord, standard et commun à toutes les cultures. D’autre part, les
émissions télévisées sont des produits que presque tous les français regardent, et il nous a
semblé intéressant d’étudier un produit s’adressant au grand public.
De plus, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un terrain encore peu étudié dans la littérature en
matière de stratégies d’import, et qu’il pouvait se révéler riche d’enseignements : confirme-t-
il les affirmations présentes dans la littérature étudiée ?
Il nous a paru important de recentrer nos recherches sur un type d’émissions en particulier : il
était impossible de traiter et les films, et les séries, et la téléréalité, et les magazines, et les
émissions de variété, et les jeux. Nous avons donc choisi de traiter les émissions de jeux
télévisés, de variété, et de téléréalité, aussi appelées « émissions de flux » ou « émissions de
divertissement ». La frontière entre les différentes catégories est parfois fine, et il arrive qu’un
programme ne soit pas spécifiquement de l’un ou l’autre type. Par conséquent, il nous a
semblé judicieux de les traiter ensemble, tout en faisant la différence dans certaines questions

63
lorsque cela paraissait pertinent, ou que les professionnels nous indiquaient des divergences à
prendre en compte.
C. Les répondants
§1. Les entretiens
Les répondants professionnels avec lesquels nous nous sommes entretenus se divisent en deux
groupes distincts : d’une part, il y a les répondants opérant du côté télévision, dont la mission
est principalement le choix et l’analyse des émissions télévisées ; d’autre part, il y a des
professionnels opérants dans des sociétés de production d’émissions télévisées, qui sont plus à
même de nous fournir des informations sur la conception même de ces émissions. Il y a aussi
des profils mixtes, ayant travaillé dans les deux types de structures, et ayant une vision plus
large mais parfois moins spécialisée du domaine. La combinaison de ces deux perceptions a
pour objectif de nous permettre d’une part d’identifier les éléments qui vont permettre de
choisir entre standardisation et adaptation de l’offre, et d’autre part les éléments qui vont
différer lors de la production de l’émission.
Nous avons effectué huit entretiens comme ci-suit :
-‐ Entretien 1 : le 07/01/2014, Moriane Morellec, ex-traductrice à AB Groupe (groupe
audiovisuel français, production et édition d’émissions télévisées) ;
-‐ Entretien 2 : le 12/01/2014, Caroline Bibré, chargée d’audiences à TF1 (chaîne de
télévision nationale généraliste française, première chaîne européenne en termes
d’audience et de masse salariale) ;
-‐ Entretien 3 : le 14/01/2014, Jeremy Delchiappo, responsable de la veille
internationale à TF1 ;
-‐ Entretien 4 : le 22/01/2014, Emmanuel Turc, conseiller aux programmes de
téléréalité à TF1 ;
-‐ Entretien 5 : le 24/01/2014, Thibaut Pupat, conseiller aux programmes de jeux et
divertissement à TF1, et ancien producteur à Endemol (groupe de production de
télévision néerlandais, spécialisé dans le production d’émissions de flux : téléréalité,
magazines, divertissements et jeux) ;

64
-‐ Entretien 6 : le 28/01/2014 Amaury Nogier, programmation de M6, Série Club,
Paris Première et TF6, chaines du groupe M6 (chaîne de télévision généraliste
nationale française commerciale privée, 3ème chaine la plus regardée en France
derrière TF1 et France 2) ;
-‐ Entretien 7 : le 17/03/2014, Brice Juigne, directeur divertissements et jeux à ITV
(groupe audiovisuel britannique), ex-producteur artistique à Endemol ;
-‐ Entretien 8 : le 18/03/2014, Julia Lagrée, ex-assistante développement/création à
FremantleMedia (filiale de production de programmes télévisés de RTL Group,
présente dans 20 pays comme producteur –un des plus gros producteurs de télévision
mondiaux, et dans 40 grâce à la vente de formats).
Nature de
l’entretien
Date Qualité
répondant
Nom Société Code
Face à face 07/01/2014 Ex-traductrice Moriane Morellec Ex-AB Groupe Prod1
Face à face 12/01/2014 Chargée
d’audiences
Caroline Bibré Groupe TF1 Chai1
Face à face 14/01/2014 Responsable
veille
internationale
Jeremy
Delchiappo
Groupe TF1 Chai2
Face à face 22/01/2014 Conseiller aux
programmes de
téléréalité
Emmanuel Turc Groupe TF1 Chai3
Face à face 24/01/2014 Conseiller aux
programmes de
jeux et
divertissements
Thibaut Pupat Groupe TF1 ProdChai1
Face à face 28/01/2014 Programmation Amaury Nogier Groupe M6, ex-
Groupe TF1
Chai4
Téléphone 17/03/2014 Directeur
divertissement
Brice Juigne ITV, ex-Endemol ProdChai2

65
et jeux, ex-
producteur
artistique
Face à face 18/03/2014 Ex-assistante
développement/
création
Julia Lagree Ex-
FremantleMedia
Prod2
Codage : Chai = chaînes télévisées, Prod = sociétés de production, ProdChai = profil
travaillant ou ayant travaillé dans les deux types de structures.
Nous avons cherché à interroger des professionnels aux profils variés, qui puissent nous
donner des points de vue différents, qu’ils soient spécialisés dans les jeux ou dans la
téléréalité, ou qu’ils soient du côté production ou diffusion.
Quelques exemples de programmes français créés, produits, ou vendus par les sociétés de
production que représentent les interviewés de ce Mémoire :
Société de production Programmes
AB Production (AB Groupe) Séries avec Dorothée et le Club Dorothée
Séries avec la famille Girard-Garnier
Endemol Loft Story
Secret Story
Star Academy
Money Drop
Fear Factor
Attention à la Marche
La Ferme Célébrités
FremantleMedia X Factor
Le Bigdil

66
Le Juste Prix
Mot de Passe
Une Famille en Or
C’est du Propre !
L’Amour est dans le Pré
Super Nanny
Nouvelle Star
Studios 89 Production (Groupe M6) Un Diner Presque Parfait
Pékin Express
TF1 Production (Groupe TF1) Danse avec les stars saisons 1 et 2 (co-
production avec la BBC)
Hell’s Kitchen VF
Les entretiens comportent des questions communes, et des questions plus ciblées en fonction
du poste, de l’expérience, ou des réponses fournies par l’interviewé. Il arrive que l’ordre des
questions ait été modifié, ou que certaines aient été supprimées du fait d’une réponse
précédente.
De façon générale, la trame est la suivante :
-‐ Courte introduction expliquant le but du Mémoire ;
-‐ Question : parcours de l’interviewé ; pour mieux comprendre ses réponses, et avoir
une idée précise du recul que peut avoir l’interviewé, et du type et de la précision des
informations qu’il peut fournir ;
-‐ Question : choix des émissions ; pour connaître les différentes raisons qui poussent
les sociétés de production et les chaines de télévision à choisir un format plutôt qu’un
autre ;
-‐ Question : adaptation des émissions ; pour cerner les éléments généralement adaptés
ou standardisés, et les raisons du choix de l’une ou l’autre des méthodes d’import ;

67
-‐ Question : type de public ; pour connaître le consommateur final, et ses attentes ;
pour étudier aussi la positionnement de ces émissions par rapport au public
majoritairement représenté devant la télévision ;
-‐ Question : différences spécifiques du public français ; pour connaître d’après les
interviewés, s’il y en a, les caractéristiques culturelles propre au public, et qui influe
sur le choix et l’adaptation ou la non-adaptation des émissions ;
-‐ Remerciements.
Le guide d’entretien est disponible en annexe (page 1175.
§2. Les questionnaires
Les téléspectateurs auxquels nous avons administré les questionnaires sont des étudiants, de
jeunes actifs et des adultes. Nous avons ainsi collecté un total de 96 questionnaires.
Il s’est avéré lors de nos entretiens que chaque type de format correspond à une cible en
particulier : la téléréalité serait pour les 15-24 ans, et par extension les 25-34 ans, alors que les
divertissements et les émissions de variété seraient destinées à des publics plus larges et
familiaux. Par conséquent, nous avons cherché à interroger tous les types de profils
concernés, tout en conservant une part plus importante de 15-24 ans.
Notre population est donc répartie selon le schéma suivant (pour un total de 96
questionnaires) :
-‐ 15-24 ans : 59 questionnaires (61,46%)
-‐ 25-34 ans : 21 questionnaires (21,88%)
-‐ 35-44 ans : 10 questionnaires (10,42%)
-‐ 45-54 ans : 3 questionnaires (3,13%)
-‐ 55-64 ans : 2 questionnaires (2,08%)
-‐ 65 ans et + : 1 questionnaire (1,04%)
La population étudiée est majoritairement composée d’actifs (49 questionnaires, 51,04%) et
de lycéens ou étudiants (45 questionnaires, 46,88%).

68
Comme indiqué par les professionnels, le public visé par ce type d’émissions étant davantage
féminin, les femmes vont représenter 61,46% de notre échantillon, contre 38,54% pour les
hommes.
Notre questionnaire, disponible en annexe (page 213), a pour but de permettre de relier un
type de profil à un genre d’émission. Les émissions choisies ont comme particularité qu’elles
vont généralement par plusieurs, avec des formats standardisés et des formats adaptés sur un
concept similaire. Un tableau analytique indique dans quelle catégorie chacune est placée,
pour permettre un traitement facile des données.
D. Collecte et traitement des données principales : les entretiens
§1. Méthode de collecte des données
Après avoir effectué et enregistré les différents entretiens avec les professionnels, nous les
avons retranscrits pour ensuite procéder à une analyse thématique de contenu.
Nous avons repéré les thèmes communs aux différents entretiens, de façon à obtenir des
sentiments, opinions, attitudes, perceptions ou plus généralement informations de la part de
l’interviewé. Le but était de comprendre ce que ces professionnels pensent sur le sujet/thème
abordé, d’approfondir les points importants, et d’instaurer un réel partage de connaissances.
Les résultats des questionnaires ont été résumés et analysés pour tenter d’en dégager des
tendances propres à un certain profil de répondants, ou à tous les profils. Les verbatims
relevés, pour permettre l’analyse, ont été classés par thèmes et sous-thèmes dans une matrice,
disponible en annexe (page 194) de ce Mémoire.
Les données ainsi collectées et traitées ont pu être résumées et confrontées aux propositions
de recherche qui ont été exposées dans la première partie de ce Mémoire, et rappelée ci-après,
mais aussi aux différentes théories présentes dans la littérature étudiée.

69
§2. Test des propositions de recherche
Les trois propositions de recherche étudiées sont les suivantes :
1. L’adaptation semble chercher à répondre avant tout à des caractéristiques et besoins
précis des consommateurs français ;
2. La stratégie de standardisation adaptée semble la plus pratiquée, pour les émissions
diffusées sur les principales chaines (avec le plus de parts de marché) ;
3. La standardisation est rendue possible par une similarité au sein des consommateurs.
Les questions posées lors de l’entretien cherchent donc à aborder les différents thèmes
présents dans ces propositions de recherche. Elles visent à déterminer quels sont les éléments
pris en compte lors du choix entre les différentes stratégies d’internationalisation, leur
hiérarchisation en ordre de priorité, et la façon d’y répondre. L’objectif sera ensuite de les
comparer aux théories présentes dans la littérature étudiée.
E. Collecte et traitement des données secondaires : le questionnaire
§1. Méthode de collecte des données
Le questionnaire a été administré par email à des profils sélectionnés aléatoirement parmi
plusieurs populations : 15-24 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans et 65 ans et plus.
La collecte des données s’est faite d’une part sous forme de questionnaires papiers sans
intervention extérieure, et d’autre part sous forme de questionnaires internet disponibles en
ligne sous Google Analytics. Tous ces questionnaires ont été traités de la même manière, sans
tenir compte de la méthode de collecte.
Après avoir choisi un échantillon représentatif, selon les indications des professionnels sur le
type de public visé, et les habitudes de visionnage moyennes du public français, les données
ont été retranscrites et analysées dans un fichier Excel, au moyen de tableaux croisés
dynamiques.

70
Pour constituer l’échantillon représentatif tout en respectant le profil de téléspectateur
identifié par les professionnels, les proportions de 15-24 ans, 25-34 ans, et de femmes ont été
sur-représentées par rapport aux autres segments de la population.
§2. Type de données collectées
Deux types de données ont été collectés, dans le but d’étudier la répartition des émissions
standardisées, standardisées adaptées, et adaptées, dans la consommation d’un échantillon-
type. Le questionnaire est disponible en (page 213).
Les données du premier type concernent le profil même du répondant, de façon tout d’abord à
pouvoir sélectionner des profils de façon à constituer un échantillon représentatif, puis à
analyser les réponses en fonction du type de profil. Ces questions concernaient :
-‐ l’âge ;
-‐ le sexe ;
-‐ la situation professionnelle ;
-‐ la fréquence de visionnage télévisuelle.
Ces questions étaient fermées, sans possibilité de choisir une autre réponse que celles qui
étaient prédéfinies.
Les données du second type concernent les habitudes de consommation en matière
d’émissions de divertissement télévisées. Ces questions ont été davantage centrées sur les
émissions de variété et de téléréalité, car lors des entretiens, un professionnel nous a indiqué
que les émissions de type jeux étaient extrêmement standardisées.
La première question est une liste d’émissions, dans laquelle le répondant doit indiquer celles
qu’il a déjà regardées plus de deux fois. Cette notion de plus de deux fois permet de s’assurer
que ce ne soit pas un pur hasard, mais une volonté de la part du répondant de regarder
l’émission. Ces émissions sont regroupées par concept, avec des émissions standardisées,
adaptées, et standardisées adaptées. L’objectif est de déterminer si un type de profil est plus

71
réceptif à une certaine méthode d’internationalisation, ou si certaines méthodes
d’internationalisation sont plus populaires. Cette question était fermée elle aussi, car le but
était de se concentrer sur certaines émissions.
La seconde question concerne les raisons qui poussent les consommateurs à regarder ce type
d’émissions. Cette question avait des réponses prédéfinies, mais permettait aussi de saisir une
réponse propre au cas où il existe des raisons non envisagées lors de l’élaboration du
questionnaire.
F. Synthèse de la première partie
Cette étude empirique repose donc sur une méthode qualitative, qui consiste à interroger huit
professionnels du milieu audiovisuel au cours d’entretiens semi-directifs. Ces professionnels
présentent des profils variés, tous en rapport avec la production, le choix, l’analyse ou la
diffusion d’émissions de divertissement télévisées, dans le but d’identifier les facteurs
impactant le choix de la stratégie d’internationalisation de ce type de produits. Les données
ainsi collectées seront analysées de manière scientifique en suivant une méthode de codage
(matrice disponible en annexe, page 194). Les deux parties suivantes présentent les résultats
de ces recherches.
Cette étude empirique a été complétée par un questionnaire réalisé auprès de téléspectateurs,
pour comparer les affirmations des professionnels à la réalité du marché. Le nombre réduit de
questionnaires ne permet pas de garantir l’exactitude des données collectées. Cette partie de
l’étude a simplement pour but de proposer d’autres pistes de réflexion. Les questionnaires ont
été rapidement traités au moyen d’Excel, et les résultats sont disponibles dans la quatrième
partie de ce chapitre.

72
II- Apports des entretiens
Ces résultats permettent de nuancer les différentes conditions de succès des stratégies
d’internationalisation, décrites en première partie de ce Mémoire.
La variété des professionnels interrogés, au niveau des fonctions exercées, a permis de croiser
les réponses, en vérifiant si tous les acteurs du secteur d’entendaient sur un sujet, ou si leurs
avis divergeaient à cause de leur propre perception du marché.
Les éléments relevés ont été classés par thème, de façon à analyser chaque thème de façon
précise, et à observer la relation particulière de chaque élément avec le choix de la stratégie
d’internationalisation.
Les affirmations propres à chaque thème ont été résumées dans cette partie. La partie suivante
aura pour but de résumer l’impact des différents éléments étudiés dans les thèmes sur le choix
de la stratégie d’internationalisation, en testant les propositions de recherche.
A. La cible
§1. Le public français et ses caractéristiques culturelles particulières
Theodosiou et Leonidou (2003) indiquent qu’il n’est pas toujours nécessaire d’adapter un
produit, car les besoins des consommateurs sur les différents segments de marché sont
souvent similaires. Cependant dans certains cas, sur des marchés locaux, l’adaptation s’avère
tout de même nécessaire lorsque les caractéristiques et les besoins ne convergent plus. La
même théorie est soutenue par Green, Cunningham et Cunningham (1975) selon lesquels,
bien qu’un produit puisse répondre à des besoins universels, en fonction des cultures les
consommateurs vont accorder plus d’importance à une caractéristique spécifique de l’offre.
Selon De Mooij (2003), bien qu’au niveau macroscopique, la possession d’un même
produit/service dans différents pays semble semblable, l’utilisation de ce produit/service a
tendance à diverger entre les pays. Avec le temps, ces divergences de consommation ont
tendance à rester stable ou croitre.

73
Contre toute attente, il semblerait que les attentes du public en matière de télévision, et plus
précisément, d’émissions de divertissement télévisées, ne soient pas les mêmes dans tous les
pays. La culture semble grandement impacter la demande, et c’est le principal élément auquel
les chaînes devront s’adapter lors du choix et de la réalisation d’un programme.
Les professionnels s’entendent à dire que le public et la culture français se différencient de ce
qu’on peut trouver dans les autres pays : « la culture française est différente de ce qu’on peut
trouver à l’international ». Ces différences amènent à chercher d’office à se différencier de
l’international dans l’offre de formats, excluant donc la stratégie de standardisation : « comme
par défaut le public français est très particulier, on se dit qu’il faut qu’on soit différenciant de
l’étranger, d’office ».
Par conséquent, le succès d’une émission à l’international, même dans plusieurs pays, ne
garantit pas le succès de cette même émission en France : « On peut avoir des formats qui
cartonnent à l’étranger, et se dire qu’en France, ça ne marchera pas », « Le carton à l’étranger
ne garantit pas un carton en France ».
Une caractéristique du public et du marché français qui revient chez plusieurs professionnels
interrogés, est l’exigence : « on est très élitistes en France » (Prod1), « les français sont plus
exigeants » (Chai1), « par certains aspects on est plus stricts que dans certains pays » (Prod2).
Les émissions de téléréalité, par exemple, sont souvent perçues par le public français comme
des émissions bas-de-gamme. Il va donc falloir les adapter, de façon à offrir une promesse qui
parle aux téléspectateurs, et qui sorte des codes habituels de ce type de programmes : « Je
trouve que la téléréalité sur TF1, sur les grandes chaines comme ça, le niveau s’est un peu
élevé ».
§2. Le public des émissions de divertissement : plusieurs segments distincts
Les émissions de divertissement télévisées sont réparties en plusieurs catégories, chacune
s’orientant vers un segment de public distinct : « le public de la téléréalité et le public des
divertissements sont deux segments différents, et méritent donc d’être distingués ». Cela
explique pourquoi certaines chaînes donnent plus dans un certain type d’émissions : c’est
pour répondre aux attentes de leur cible. Cependant, pour ne pas être trop élitistes, les grandes

74
chaînes telles que TF1 vont proposer une variété de programmes permettant de répondre aux
attentes de plusieurs segments, mais pas nécessairement au même moment : « on vise tous les
publics mais pas forcément tout le temps » ; cette volonté a bien été comprise par les sociétés
de production : « les boites de production comme AB ne cherchent pas une émission qui va
plaire à tout le monde, mais plutôt plusieurs émissions qui vont toucher les 15-20, les 20-25,
etc. ».
La téléréalité va s’adresser à un public plutôt féminin, entre 15 et 24 ans, et par extension 15
et 34 ans. Pour les émissions de divertissement telles que les jeux, le public va être plus large
et plus âgé, entre 25 et 59 ans environ. Cependant, ces catégories d’âge vont varier en
fonction du format et de la chaîne : certains jeux tels que Money Drop vont être réalisés pour
répondre aux attentes d’un public plus familial, d’autres tels que Question Pour Un Champion
vont permettre de rassembler un public plus âgé, et les séniors. Les émissions de
divertissement orientées vers l’art de vivre et le bien-être sont davantage destinées aux
responsables des achats, soit un public féminin entre 25 et 55 ans.
Cependant, on remarque depuis quelques temps que les émissions ne donnent plus seulement
dans une seule catégorie, mais souvent dans deux ou trois : on va mélanger par exemple, la
variété et la téléréalité avec Secret Story. On remarque donc que les émissions proposées
cherchent à être plus rassembleuses, pour atteindre une cible plus large « Par contre les
divertissements adaptés, comme The Voice, c’est fait pour tout public, pour les petits et les
séniors ».
Un élément intéressant à noter est que la téléréalité et une grande partie des émissions de
divertissement télévisées ne s’oriente pas vers le public le plus présent devant le petit écran,
qui est les séniors : « Les personnes qui regardent la télévision au global, ce sont les
retraités ». De plus, les professionnels constatent une fuite du public jeune vers les émissions
à la demande sur internet : « quand on regarde le nombre de jeunes qui regarde la télévision, il
a chuté […] car maintenant ils vont vers l’ordinateur », « on se retrouve face à un public qui
est vieux ». Cela explique la volonté de diversification des chaînes, avec des émissions
appartenant à plusieurs catégories, de façon à s’adresser à un public familial et à être plus
rassembleuses, mais aussi à s’orienter parfois vers un public plus âgé : « Certaines téléréalités
vont permettre d’augmenter un peu le public plus âgé ».

75
B. Le choix, la réalisation et la diffusion des émissions
§1. Un choix pour demeurer compétitif
Selon la littérature, une concurrence élevée pousse à une plus grande adaptation au marché
local (Alashabn, Hayes, Zinkhan & Balazs, 2002). Cette adaptation va passer par le choix du
format, mais aussi par sa réalisation.
Avec le développement des chaînes gratuites de la TNT, il est devenu plus difficile de séduire
et conserver les téléspectateurs. La grande variété de programmes incite le public à changer
régulièrement de chaîne, pour visionner le programme répondant le plus à ses attentes. Nous
sommes bien loin de l’époque ou l’offre était réduite, et les programmes peu étudiés ou
peaufinés dans leur choix et leur réalisation. Il s’avère, après avoir interrogé les
professionnels, que la concurrence a un impact non négligeable sur le choix d’un programme :
« le choix d’un flux se fait aussi par la concurrence ».
Chaque chaîne va chercher à proposer des programmes de qualité pour attirer et retenir le
public : « Après, le but de TF1, c’est d’avoir des programmes forts, comme avec 4 Mariages
Pour 1 Lune De Miel, on cherche à avoir un Access puissant ». Mais cette recherche du
programme fort amène à des situations dans lesquelles plusieurs chaînes se positionnent pour
l’achat d’un même programme : « nous quand on a vu ce programme arriver sur le marché, il
a fallu qu’on se positionne, comme tous nos concurrents, pour l’avoir ». Il ne faut pas non
plus négliger, lors de l’achat d’un programme, ce qui se fait déjà chez les concurrents : si
l’offre dans un certain domaine est déjà trop riche, le programme pourrait ne pas réussir à
séduire le public. Actuellement, le marché est saturé par des émission de variété et de cuisine ;
les chaînes vont chercher à proposer d’autres programmes, avec des concours non plus
uniquement de chant mais de talents plus généraux, ou des émissions de jardinage et de
couture, de façon à avoir une offre différenciée.
Une fois ce programme acheté, la réalisation va aussi être impactée par la concurrence. La
première chaîne nationale, TF1, va mettre un point d’honneur à investir dans une réalisation
grandiose, car les téléspectateurs, lorsqu’ils se tournent vers cette chaîne, s’attendent à des
programmes de qualité. D’autres chaînes vont investir dans une réalisation plus jeune, et
d’autres encore sont plus orientées vers la responsable des achats. La concurrence va donc
amener chaque chaîne à se différencier des autres par son offre et son positionnement.

76
§2. La spécialisation des chaînes, canaux de diffusion
Pour Sustar (2001), le degré jusqu’auquel une entreprise va devoir adapter un produit va
dépendre du contrôle qu’elle exerce sur les canaux de diffusion. Dans le cas particulier étudié,
l’entreprise s’avère être son propre canal de diffusion, et le contrôle est donc important.
Néanmoins, un canal de diffusion s’oriente vers un certain segment de consommateurs, et les
chaînes vont devoir en tenir compte. Lessassy (2008) souligne l’importance d’adapter la
stratégie de distribution au produit considéré. Ici, il s’agit davantage de choisir un produit en
fonction du canal de distribution.
Il s’avère que le choix d’un programme et son degré d’adaptation va dépendre de la chaîne,
canal de diffusion : « Le profil d’un programme ne dépend pas que d’un programme, mais
aussi de la chaîne sur laquelle il est diffusé ». En fonction de la chaîne, un même programme
va donc pouvoir être adapté de plusieurs façons différentes. Chaque chaîne va s’orienter vers
un public particulier, et donc avoir une certaine spécialité : « Chaque chaîne va avoir son
propre public ».
Un programme représentant l’image de la chaîne, son choix doit être fait de manière
particulièrement rigoureuse : « Un programme, ça constitue l’image de marque de la chaîne,
donc on ne peut pas faire n’importe quoi ». Cela va amener certaines chaînes à renoncer à des
programmes qui pourraient rencontrer un succès auprès du public français, mais pas auprès du
public particulier de la chaîne en question (« qui pourrait fonctionner peut-être sur les services
publics mais pas chez nous »), ou encore par exemple à des programmes qui pourraient plaire
mais donner une image trop bas-de-gamme pour le leader français qu’est TF1 (« ça a continué
de marcher mais c’était trop négatif par rapport aux valeurs de la chaîne, ça ne pouvait plus
continuer »).
Le canal de diffusion, dans le cadre des émissions de divertissement télévisées, semble donc
avoir un impact non négligeable sur le choix et la réalisation d’un programme, et donc sur la
stratégie d’internationalisation adoptée.

77
§3. La cible et ses attentes : l’adaptation au consommateur français et au contexte socio-économique
Kaynak et Mitchel (1981) soulignent dans leurs travaux qu’en fonction des cultures, les
consommateurs ne vont pas accorder la même importance aux différentes caractéristiques de
l’offre. Il convient donc d’adapter son offre au consommateur local, et à ses attentes.
Même si chaque chaîne s’oriente vers un public particulier, certaines tendances sont
communes à tous les publics. Le contexte socio-économique semble avoir un impact sur les
attentes du public français en matière d’émissions de divertissement télévisées. La tendance
serait donc à la « feel good tv », une télévision basée sur le bien-être : « c’est toujours
d’actualité, la feel good tv ». Les effusions d’argent sont bannies, pour ne pas choquer les
téléspectateurs, et les artistes cherchent à se rapprocher du public en montrant qu’ils sont eux
aussi issus de la classe populaire.
Un élément intéressant que nous souhaitons évoquer, et le fait que les sociétés de production
et le chaînes ne soient pas nécessairement d’accord sur ce qui peut fonctionner sur le marché
français : outre les divergences qu’elles rencontrent en matière de réalisation, l’exemple de
The Apprentice a été cité par un interviewé de TF1 comme un programme qui ne pourrait pas
fonctionner sur une chaîne française, et par un interviewé d’Endemol comme un programme
qui allait être très bientôt adapté. Les opinions semblent donc diverger au niveau des attentes
présumées du public.
Les programmes vont donc devoir répondre à ces attentes dans leur choix et leur réalisation :
contrairement à ce qu’on pouvait trouver il y a quelques années, les jurys d’émissions de
coaching ne font que des critiques sympathiques et constructives, les gains sont modérés, et
les artistes parlent de leur vie d’anonyme. Les formats choisis à l’international, aux Etats-Unis
par exemple, sont adaptés pour répondre à ces attentes, entre autres en diminuant les dotations
et les budgets de réalisation pour ne pas choquer un public français au quotidien difficile.
Les chaînes vont réaliser des pilotes et des études qualitatives, pour s’assurer qu’un
programme soit adapté à la cible et réponde aux attentes du public : un épisode va être tourné,
puis soumis à un échantillon représentatif du public visé, de façon à prendre connaissance de
leurs retours. Ces retours pourront amener à l’abandon du programme, à la diffusion telle
quelle, ou à une adaptation plus poussée du produit au marché ciblé.

78
Les attentes de la cible sont donc largement prises en compte lors du choix et de la réalisation
d’un programme.
§4. Le moment de diffusion : un élément-clé pour s’adresser à des publics différents
Une des spécificités du marché audiovisuel, est qu’outre la variation du public en fonction de
la chaîne (canal de diffusion), le public varie aussi en fonction du moment. Les chaînes ont
donc découpé leur grille de programmation par périodes, chacune s’adressant à un profil de
téléspectateur particulier. Il s’agira ensuite de remplir cette grille avec des programmes
adaptés, répondant aux critères fixés en matière de longueur et de public.
En fonction de l’heure, le public se trouvant devant le petit écran n’est pas le même. Il
convient donc pour les chaînes de proposer des programmes adaptés au profil considéré, en
les plaçant sur une grille de programmation suivant les attentes des téléspectateurs. Par
exemple, le public en milieu de journée est plus âgé que le public en début de soirée ; il
conviendra donc de proposer des programmes plus familiaux pendant le prime.
Par conséquent, lors du choix d’un programme à l’international pour sa réalisation et sa
diffusion en France, il va falloir prendre en compte la grille de programmation de la chaîne.
C. Les contraintes
§1. Le CSA fixe des contraintes légales à respecter…
Katsikeas, Samiee et Theodosiou (2006) indiquent qu’il convient de prendre en compte les
contraintes légales du marché sur lequel une entreprise souhaite opérer, pour connaître le
degré de standardisation ou d’adaptation qu’il convient de réaliser.
Tous les répondants s’accordent à dire que le CSA est un élément principal dans le paysage
audiovisuel français. Cette entité fixe de nombreuses règles, limitant la marge de manœuvre
des chaînes et sociétés de production en matière de choix et de réalisation.

79
Contrairement à d’autres pays, les chaînes françaises ne peuvent pas diffuser ce qu’elles
souhaitent : en fonction des horaires et de la chaîne, la diffusion de certains programmes aux
contenus jugés inappropriés va être restreinte. Cela force les chaînes à diffuser des
programmes dont le contenu est adapté au moment de diffusion, ce qui présente aussi une
motivation à la modification du format original.
D’autres règles vont vouloir qu’un certain pourcentage des émissions diffusées soit des
programmes français, produits en France, ou encore que chaque chaîne fasse appel à un
certain nombre de producteurs différents. Pour avoir un certain programme fort, il faudra à la
chaîne faire des concessions sur d’autres programmes. Le choix des émissions et leur
réalisation ne se font donc pas librement.
Les règles fixées par le CSA sculptent ainsi le paysage audiovisuel français, et le forcent à se
différencier de ce qui peut se faire à l’international : « En France on a quand même
énormément de barrières à cause, ou grâce, au CSA, on le voit comme on veut : et ces
barrières font que nous n’avons pas la même culture audiovisuelle ».
§2. … auxquelles viennent s’ajouter des contraintes contractuelles…
Aux contraintes fixées par le CSA, viennent s’ajouter des contraintes propres aux contrats
conclus lors de l’achat d’un format.
Lorsqu’un format est créé, il va être déposé et les droits d’adaptation vont ensuite être vendus
par les ayant-droits sur le marché international. Lors de la vente, tous les droits ne sont pas
nécessairement donnés à l’acheteur, certaines contraintes de mise en scène, ou de réalisation,
doivent être respectées : « un format c’est charté, et on n’a pas le droit de toucher au décor ou
à quoi que ce soit ».
Les négociations vont donc consister à acheter un format « clé en main » pour lequel la
réalisation devra être respectée, ou simplement un concept qui laissera une plus grande marge
de manœuvre en matière d’adaptation.
Parfois, ces contrats forcent l’acheteur à acheter plusieurs programmes au vendeur, pour
s’assurer d’obtenir le programme fort qu’il vise.

80
Ces contraintes contractuelles vont tendre à s’assouplir avec le temps, permettant plus de
latitude dans la réalisation du format, et plus d’adaptation.
§3. … et le coût des émissions, un frein majeur à la prise de risques
Selon Levitt (1983), un des majeurs avantages de la standardisation est qu’elle permet de
réaliser des économies d’échelle. Cette idée est aussi soutenue par Lage, Lage et Abrantes
(2007), qui indiquent que la standardisation permet de réduire les coûts.
Il s’est avéré au cours des entretiens que cette question de coûts occupe une place très
importante lors des décisions de création et de diffusion d’un format. Les programmes en
France coûtent très cher, et la tolérance de l’échec semble proche de zéro : « les Etats-Unis,
Big Brother, c’est un prime par semaine. Donc si ça se plante, ma foi, c’est une heure, ce n’est
pas très grave, même si c’est cher. Nous, si ça se plante, c’est une catastrophe ».
Cependant, bien qu’une standardisation pure permettrait de réduire drastiquement les coûts,
les grandes chaînes s’y refusent car elles tiennent à leur image de qualité.
En raison de ces coûts, contrairement à d’autre pays, la France va très peu diffuser de
nouveautés internationales, et ne va pas créer ses propres formats : « Il y a très peu de création
en France, on est assez frileux pour lancer des nouveautés, des choses qui n’ont jamais
existé ». Les chaînes ont peut d’un échec d’un format dont le succès n’aurait pas été prouvé
ailleurs, ce qui entrainerait une déprogrammation et une parte financière importante.
Les chaînes vont donc préférer une stratégie de standardisation adaptée, mais ce n’est pas le
coût de création du programme en lui-même qui va sembler motiver ce choix, plutôt la marge
de risque. Il semblerait en effet que le coût de réalisation d’une création, et donc d’une
stratégie d’adaptation, ne soit pas très différent du coût d’une stratégie de standardisation
adaptée. Les diffuseurs vont simplement préférer un programme dont le succès a été prouvé
dans d’autres pays, à un programme complètement novateur : le risque financier est moins
important.
Pour ces produits particuliers, la stratégie de standardisation adaptée ne semble donc pas
proposer d’économies d’échelle considérables par rapport à une stratégie d’adaptation. Seule

81
la stratégie de standardisation semble confirmer ces économies, mais demeure une stratégie
peu employée : « Sur les plus petites chaines, souvent on n’adapte pas, car ils n’ont pas le
budget, et ce sont des micro-audiences, c’est souvent pas très gros du coup ils travaillent
moins leur adaptation », « la traduction pure et dure, ça ne se fait plus trop. C’est quelque
chose qu’on fait quand on est une chaine qui n’a pas beaucoup d’argent ».
D. Synthèse
Les éléments qui impactent la stratégie d’internationalisation d’un programme sont donc :
-‐ Les caractéristiques culturelles propres aux téléspectateurs français, et les attentes du
public français ;
-‐ la concurrence sur le marché français ;
-‐ la spécialisation de la chaîne (canal de diffusion), et par conséquent sa cible, et le
moment de diffusion qui va permettre de s’adresser à des segments de téléspectateurs
variés ;
-‐ les contraintes légales fixées entre autres par le CSA ;
-‐ les contraintes contractuelles à l’achat du format ou du concept ;
-‐ le risque financier en cas de déprogrammation.
Ces éléments vont inciter les chaînes et sociétés de production à s’orienter vers l’une ou
l’autre des stratégies d’internationalisation.
Nous verrons dans la partie suivante le test des propositions de recherche liées à ces
différentes stratégies. Nous avons aussi mis à disposition en annexe (page 222) un cas concret
décryptant quelques différences du format à succès international The Voice.

82
III- Test des propositions de recherche
Avant de traiter ces propositions de recherche, nous souhaitons rappeler que le vocabulaire
employé par les professionnels interrogés, et que l’on retrouve dans les entretiens et la matrice
d’analyse, ne correspond pas toujours à celui fixé pour ce Mémoire. Certains professionnels
parleront d’adaptation ou des standardisation pour des stratégies de standardisation adaptées,
et de création pour des stratégies d’adaptation.
Suivant le contexte, les verbatims ont été correctement classés dans la matrice d’analyse. Pour
cette partie de test des propositions de recherche, dans un souci de clarté, certains mots dans
les citations ont été corrigés pour répondre aux définitions fixées précédemment.
Nous rappellerons les définitions que nous avons fixées :
• La stratégie de standardisation est la traduction par voice-over de formats tournés à
l’international ;
• La stratégie de standardisation adaptée est l’achat d’un format pour un tournage en
France avec des participants français ;
• La stratégie d’adaptation est la création d’un nouveau format à partir d’un concept
identifié à l’étranger.
A. Proposition de recherche 1 : L’adaptation semble chercher à répondre avant tout à des caractéristiques et besoins précis des consommateurs français
Cette proposition de recherche semble être confirmée par les entretiens avec les
professionnels.
L’adaptation peut se faire de deux manières : directement avant la diffusion (« il y a aussi des
programmes qu’on adapte directement dès le début »), ou au fur et à mesure des saisons. Dans
les deux cas de figure, le but est de répondre aux attentes du téléspectateur français : « on va
commencer avec une standardisation adaptée, on va aller petit à petit vers l’adaptation car
chaque année on va adapter [le format] et l’incrémenter au goût du public ».

83
L’adaptation, appelée « création » dans le milieu audiovisuel français, consiste à identifier un
concept étranger, et à l’utiliser pour réaliser une émission aux mécaniques légèrement
différentes. « On avait aussi toute une partie […] d’émissions qui pouvaient trouver une
résonnance en France ; ce n’était pas forcément pour acheter le format ».
L’adaptation des émissions télévisées en France permet de se plier à la législation parfois plus
stricte que dans d’autres pays, ou aux contraintes des différents diffuseurs : « le format doit
être adapté aux standards télévisuels français ». Ces contraintes vont varier en fonction des
chaines, et la spécialisation des chaines va créer une variété au niveau des programmes
diffusés, par exemple des jeux et très peu de téléréalité sur les chaines de France Télévisions,
et un mélange des deux sur les chaines du groupe TF1. Chaque chaine va donc choisir des
stratégies correspondant au type de format considéré.
Cette stratégie semble être répandue dans les émissions de jeux télévisés : « c’est pour ça qu’il
y a énormément de créations de jeux sur France Télévisions par les boites de production,
parce que souvent les mécaniques internationales ne vont pas forcément correspondre aux
missions de service public et aux contraintes du service public ». Néanmoins, d’autres
professionnels viennent nuancer cette affirmation, car selon eux si la stratégie d’adaptation est
plus répandue au niveau des jeux qu’ailleurs, la stratégie prédominante dans ce type de
formats demeure la standardisation adaptée : « la particularité d’un programme de jeu c’est
qu’on peut changer des choses mais pas révolutionner l’affaire ». Certains iront même jusqu’à
dire que c’est le type de format pour lequel il y a le moins de raisons d’adapter : « J’ai envie
de dire que les jeux, c’est ce qu’il y a de plus international. Généralement, pour les jeux, un
gros format comme Qui Veut Gagner Des Millions, Money Drop, on ne bouge absolument
rien d’un format qui fonctionne ».
Cependant, bien que permettant de répondre aux caractéristiques du marché et du public
français, cette stratégie est peu utilisée de façon générale dans les émissions de
divertissement, à cause du risque qu’elle représente : le succès du produit créé paraît encore
moins sûr qu’une émission ayant été déjà diffusée avec succès dans un autre pays. « « Il y a
très peu de création en France, on est assez frileux pour lancer des nouveautés, des choses qui
n’ont jamais existé ». En effet, bien que créées pour répondre à des attentes particulières du
public français, il semblerait que les attentes du public ne soient pas parfaitement connues des
chaines : « « Maintenant c’est vrai qu’on reste dans une chaine « frileuse » de toute manière,
et à cause de notre charte, on va très peu sur des créations. On travaille, les équipes artistiques
chez TF1 travaillent beaucoup là-dessus, mais c’est vrai que le public français est très

84
compliqué ». Les coûts engagés pour réaliser ce type de stratégie sont souvent trop élevés face
au risque qu’elle représente : « Et un programme en plus ça a un coût, qui est très élevé »,
« Nous si ça se plante, c’est une catastrophe ».
B. Proposition de recherche 2 : La stratégie de standardisation adaptée semble la plus pratiquée, pour les émissions diffusées sur les principales chaines (avec le plus de parts de marché)
Cette proposition de recherche a largement été confirmée par les professionnels : « tout ce qui
est à l’antenne, ce sont des [standardisation adaptées] de formats ». Bien que, comme indiqué
précédemment, la stratégie de création soit plus répandue au niveau des jeux qu’ailleurs, pour
répondre aux contraintes du marché français, selon les professionnels interrogés la majorité
des formats de divertissement sont issus de stratégies de standardisation adaptée.
On va retrouver des programmes similaires, adaptés localement pour répondre aux attentes du
public : « aujourd’hui on a l’habitude de voir un peu partout plus ou moins la même chose » ;
« on l’a adapté pour correspondre au public français ». L’adaptation aux attentes des
téléspectateurs semble être un des critères phares lors de l’importation d’un format en France :
« La tendance est d’adapter au public français le plus possible. Même si un format a bien
marché à l’international, on va chercher à l’adapter encore plus pour la France ». L’adaptation
au public semble donc être un élément inconditionnel lors de l’import d’une émission de
l’international vers la France. Le problème soulevé par les professionnels est que la téléréalité
n’est pas perçue en France comme dans les autres pays ; elle a été rapidement qualifiée de
« bas-de-gamme », et chaque programme doit être repensé pour permettre de sortir des codes
prédéfinis de la téléréalité, et de faire ressortir des valeurs auxquelles le public pourra
s’identifier : « En fait en téléréalité, il y a souvent un gros travail d’adaptation. Il faut sortir
des codes. Dans le reste du monde, un Big Brother, c’est un Big Brother. On assume le fait de
filmer, ils assument complètement le fait de les regarde vivre. Nous en fait, on ne fait jamais
ça, on dit que s’ils sont enfermés, ce n’est pas pour les regarder vivre, c’est pour vire une
aventure, une expérience ».

85
La partie adaptation de la stratégie de standardisation adaptée est rendue nécessaire donc par
les attentes du public français, mais aussi par la législation française en matière de diffusion,
et les grilles de programmes dans lesquelles les émissions doivent s’intégrer : « Il y a la durée.
[…] Il y a aussi la problématique du nombre de semaines ».
Cependant, bien que certains éléments doivent être indispensablement adaptés pour répondre
aux contraintes de diffusion, il ne semble pas exister de règle en ce qui concerne la façon
d’adapter : « ça a fonctionné, l’adaptation est bonne, et pour ça il n’y a pas forcément
d’éléments ». Mais la standardisation adaptée rencontre aussi des limites contractuelles en
matière d’adaptation : « On doit respecter un certain nombre de règles ; on ne pourra pas
changer le format en fait ». Les formats doivent donc être pris au cas par cas, en étudiant
chaque élément : « L’adaptation va vraiment se faire point par point, il ne va pas y avoir
d’élément différenciant ».
Cette stratégie présente aussi un avantage, qui est qu’elle peut s’appliquer sur la durée,
modifiant chaque saison certains éléments pour permettre une amélioration du format, et en
choisissant sur quels points et jusqu’où le produit doit être adapté. Dans certains cas, ces
modifications viennent de formats étrangers et ont déjà été expérimentées dans d’autres pays,
ce qui permet encore une fois de limiter le risque financier d’un potentiel échec : « Après au
fur et à mesure des années, les différents territoires, avec leurs bonnes idées, incrémentent la
version de base. Et ça crée une sorte de « pot commun » où les gens vont venir piocher,
puisqu’à la base c’est le même format ».
Ainsi, cette stratégie semble être un compromis entre les attentes du marché, les limites
contractuelles à l’achat du format, et le risque financier lié à l’introduction d’un nouveau
produit sur le marché.
C. Proposition de recherche 3 : La standardisation est rendue possible par une similarité au sein des consommateurs
Cette proposition de recherche n’a pas été validée par les professionnels. Ceux-ci indiquent
que même s’il existe des similarités au sein des consommateurs, par principe les chaines ne
reprendront pas un format tel quel : « par principe, on n’ira pas au copier-coller ».

86
Nous avons vu dans la partie précédente que la concurrence avait un impact sur le choix du
type de réalisation, et donc de la stratégie d’internationalisation. Chaque chaîne va chercher à
réaliser un programme qui corresponde à son identité. Cet objectif ne coïncide donc pas, ou
peu, avec une stratégie de standardisation, où la seul façon d’avoir un programme en phase
avec sa chaîne va être un choix drastique à la sélection.
La stratégie de standardisation semble n’être utilisée que par souci d’économies, par des
chaines n’ayant pas beaucoup de budget ni d’audience : « Sur les plus petites chaines, souvent
on n’adapte pas, car ils n’ont pas le budget, et ce sont des micro-audiences, c’est souvent pas
très gros du coup ils travaillent moins leur adaptation ». Ce n’est donc pas la stratégie
d’internationalisation employée pour les programmes vers lesquels la majorité des
téléspectateurs s’oriente. De plus, il semble que cette stratégie d’internationalisation, dans le
domaine des divertissement télévisés, soit de plus en plus délaissée : « Le voice-over, ça
n’existe quasiment plus, c’était au tout début de la TNT ».
Les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes à travers le monde, et il est donc
difficile de conserver un même format partout : « on a rarement un format de divertissement
pur qui va pouvoir parcourir le monde ». La standardisation n’est rendue possible que quand
le format provient d’un pays culturellement proche de la France : « culturellement, on a des
pays qui nous ressemblent plus que d’autres ».
De plus, le succès dans des pays étrangers, même similaires culturellement parlant, ne semble
pas être un gage de succès en France : « Le carton à l’étranger ne garantit pas un carton en
France ».
D. Synthèse et mise en lien avec la littérature
Ainsi, la stratégie de standardisation, conformément à ce qui a été dit dans la littérature
étudiée, permet de réaliser des économies de coûts, et s’applique dans le cas d’une similarité
entre les consommateurs. Cette stratégie n’a pas été retenue dans le cadre des émissions de
divertissement télévisées, car les attentes des différents publics divergent.
La stratégie d’adaptation est très peu utilisée elle aussi, car elle représente un risque financier
important en cas de déprogrammation : le succès de l’émission n’ayant pas été testé dans

87
d’autres pays, le risque d’échec est plus conséquent. Il est dit dans la littérature qu’elle est
utilisée pour s’adapter à des caractéristiques précises du marché français. Dans le cas d’une
stratégie d’adaptation dans le milieu des émissions de divertissement télévisées, ce sont les
contraintes législatives qui semblent motiver le choix ; cependant, il s’avère que la
méconnaissance des attentes précises du public français en matière d’émissions de
divertissement télévisées ne permette pas de privilégier cette stratégie, faisant peser dessus
risque financier trop important.
La stratégie de standardisation adaptée semble donc se positionner comme un compromis
entre risque financier dû à la nouveauté, et adaptation au public et aux contraintes locaux.
C’est cette stratégie qui est le plus souvent choisie, mais il n’existe pas de règle qui indique
quels éléments précis, ou jusqu’où un format doit être adapté, ce qui rejoint ce que nous avons
pu lire dans la littérature. Il s’agit aussi d’une stratégie qui permet une évolution petit à petit
vers un produit de plus en plus adapté au marché, en implémentant au fil des saisons des
modifications pensées ou choisies pour correspondre au public français.
Par conséquent, il semble que le milieu de l’audiovisuel, dans le contexte de mondialisation
actuel, s’oriente principalement vers une stratégie de standardisation adaptée lors de l’import
de produits sur le marché français.

88
IV- Apports des questionnaires
A. Résultats obtenus
Les données collectées ont servi à analyser les motivations des téléspectateurs lorsqu’ils
regardent ce type d’émissions, et la stratégie d’internationalisation employée par les émissions
qu’ils déclarent regarder.
§1. Les motivations
89% des personnes interrogées regardent ces émissions dans le but de se divertir. 24% leur
attribuent une fonction sociale, c’est-à-dire qu’elles leur donnent un sujet de discussion avec
des amis, des collègues, ou de la famille. Une plus petite proportion (10%) trouvent à ces
émissions une fonction éducative, et les visionnent pour apprendre des choses.
Toutes ces motivations sont connues des professionnels, qui cherchent à y répondre avec une
offre ciblée et diversifiée, en particulier grâce à l’actuelle « Feel Good TV » qui vise à
proposer une télévision basée sur le bien-être, mais aussi grâce au développement des lé
télévision interactive avec réactions en direct sur les réseaux sociaux.
§2. Les stratégies d’internationalisation des émissions visionnées
Pour étudier les stratégies d’internationalisation les plus répandues parmi les émissions
visionnées, les données ont été synthétisées dans un tableau indiquant le pourcentage
d’émissions de chaque type en fonction de l’âge.
Du fait du faible nombre de répondants de 45 à 65 ans, leurs réponses ont été traitées
ensemble dans la catégorie « 45 ans et + ».

89
Âge Adaptation Standardisation
adaptée
Standardisation
15-24 13% 72% 11%
25-34 7% 85% 8%
35-44 17% 78% 6%
45 ans et + 3% 91% 6%
Type d’émissions regardées selon l’âge – résultats non pondérés
Les émissions étudiées étaient réparties comme ci-suit :
-‐ standardisation : 30 émissions
-‐ standardisation adaptée : 33 émissions
-‐ adaptation : 6 émissions.
Par conséquent, les données du tableau ci-dessus vont être pondérées et donner les scores
suivants :
Âge Adaptation Standardisation
adaptée
Standardisation
15-24 2,17 2,18 0,37
25-34 1,17 2,58 0,27
35-44 2,83 2,36 0,20
45 ans et + 0,5 2,76 0,20
Type d’émissions regardées selon l’âge – scoring pondéré
On remarque que ce sont les émissions avec une stratégie d’internationalisation de type
standardisation adaptée qui semblent être les plus plébiscitées par le public, tous âges
confondus.

90
Bien qu’il soit difficile de déterminer des tendances précises du fait du faible nombre de
questionnaires, les résultats semblent indiquer que les publics plus jeunes sont plus réceptifs à
la stratégie de standardisation.
En ce qui concerne la stratégie d’adaptation, elle semble rencontrer un succès comparable à la
stratégie de standardisation adaptée chez les 15-24 ans et chez les 35-44 ans.
B. Apports
Cette partie du Mémoire a pour but de faire un premier rapprochement entre les affirmations
des professionnels, et les réalités du terrain.
Au cours des entretiens, les professionnels ont indiqué que la principale motivation des
téléspectateurs lorsqu’ils visionnent ce type d’émissions est de se divertir.
D’autre part, les professionnels interrogés ont indiqué que la stratégie de standardisation était
très peu employée, contrairement à la stratégie de standardisation adaptée. Ils ont aussi
souligné le fait que les créations 100% françaises (autrement dit, la stratégie d’adaptation)
étaient très peu présentes sur le marché. Le but était de voir si cette offre correspondait aux
habitudes de visionnage des téléspectateurs interrogés.
Le public interrogé confirme l’idée selon laquelle la principale motivation est le
divertissement, mais la fonction sociale semble elle aussi importante.
En ce qui concerne les stratégie d’internationalisation, les premières observations semblent
confirmer le fait que c’est la stratégie de standardisation adaptée qui rencontre le plus grand
succès auprès du public, tous âges confondus, bien que la stratégie d’adaptation semble aussi
séduire le public. La stratégie de standardisation est, elle, sous-représentée, et ce de façon de
plus en plus marquée lorsqu’on s’intéresse à des publics de plus en plus âgés.

91
V- Limites de cette étude
Chacune des deux parties de cette étude présente des limites qui lui sont propres, que ce soit
dans la façon de collecter ou de traiter les données. Il convient de prendre en compte ces
limites lors de la lecture des résultats de cette étude, pour mesurer la pertinence des résultats
présentés.
Quelle que soit la partie de l’étude, une première limite se pose déjà à ce travail : la définition
qu’il a été faite des différentes stratégies d’internationalisation dans le milieu concerné. En
effet, nous avons indiqué au début de notre travail que dans le milieu des émissions de
divertissements télévisés, la standardisation consistait à appliquer un simple voice-over, la
standardisation adaptée à reproduire le même format dans un contexte local, en changeant
éventuellement quelques éléments pour approfondir l’adaptation, et que l’adaptation
consisterait à conserver un concept en réalisant un tout nouveau format. Il se peut que ces
définitions ne soient pas les plus appropriées, et que d’autres chercheurs ou professionnels
souhaitent définir les différentes stratégies d’internationalisation pour ce secteur particulier
d’une façon différente.
A. Limites de l’étude par les entretiens
Bien qu’ayant été menée de la façon la plus rigoureuse possible, la partie de cette étude
relative aux entretiens rencontre plusieurs limites.
Tout d’abord, le nombre de professionnels interrogés est limité, du fait de la difficulté à
obtenir des profils pertinents pour répondre aux questions, et de nos contraintes de temps car
cette étude a été menée dans un délai relativement court. Les professionnels interrogés
proviennent principalement des mêmes entreprises, et la culture et les objectifs d’une
entreprise influent grandement sur les résultats ; des professionnels venant d’une autre
entreprise pourraient avoir des avis divergents sur les différents sujets abordés.
De plus, cette étude qualitative ne prend en compte que l’avis de professionnels, sans
s’intéresser à la demande constatée sur le marché de façon quantitative. Les questionnaires
administrés à des téléspectateurs avaient pour but de fournir de nouvelles pistes de réflexion,

92
sans pour autant avoir la prétention de répondre aux questions posées du point de vue des
consommateurs.
D’autre part, le choix d’effectuer des entretiens semi-directifs en lui-même présente des
limites : il se peut que la personne chargée de collecter les données ne comprenne pas toutes
les subtilités et les détails du domaine dans lequel travaillent les professionnels, et
l’interprétation qu’elle en fait peut donc être biaisée.
Enfin, le codage dans la matrice de résultats est soumis à interprétation du codeur, et peut en
ce sens relativiser la validité des résultats obtenus.
B. Limites de l’étude par les questionnaires
La principale limite de cette partie de l’étude relative aux questionnaires, est le nombre de
questionnaires réalisés : seulement 96. En effet, le but n’était pas de déterminer des tendances
précises, mais d’identifier des pistes de réflexion pour des travaux ultérieurs.
De plus, du fait que ce Mémoire ne soit pas axé sur cette étude précise, le nombre d’émissions
et les caractéristiques du profil des enquêtés ont été réduites au minimum, ou sélectionnés de
façon à permettre une analyse pertinente même sur un faible nombre de personnes
interrogées. Les jeux télévisés, notamment, n’ont pas été traités ici. Les émissions de type
standardisées ont été sous-représentée par rapport aux émissions adaptées ou aux émissions
standardisées adaptées ; par conséquent, malgré la pondération réalisée sur les résultats, la
marge d’erreur reste importante. Néanmoins, les professionnels au cours des entretiens
avaient indiqué que le nombre d’émissions standardisées était faible, car c’était une stratégie
employée par les chaines n’ayant pas beaucoup d’argent.
Cela soulève aussi un point important qui peut avoir un impact sur cette étude : si les
émissions regardées dépendent de l’offre des chaines, et que ce ne sont pas les émissions
proposées qui dépendent de la demande, alors il est naturel que les tendances observées soient
en accord avec les affirmations des professionnels du milieu.
De plus, les émissions listées dans le questionnaire ont été choisies de façon aléatoire, tout
essayant de proposer pour un même concept une émission adaptée, et une émission

93
standardisée, lorsque c’était possible. Il se peut qu’il manque un certain nombre d’émissions,
parmi les émissions sélectionnées pour l’analyse, qui aurait pu inverser les tendances.
Enfin, le champ d’analyse permis par Excel est plus limité que celui sur Spad par exemple, ne
permettant pas d’observer en détails la corrélation entre plusieurs variables. Notre contrainte
de temps ne nous a malheureusement pas permis d’étudier ces données de façon plus
approfondie.

94
VI- Conclusion : réponse à la question principale de recherche, et recommandations managériales
Malgré les limites exposées ci-dessus, il nous semble que cette recherche est cohérente dans
son ensemble, et nous a ainsi amenés à valider ou infirmer nos propositions de recherche. Le
sujet abordé nous a permis de mieux comprendre le contexte d’internationalisation dans le
domaine des divertissements télévisés, et les nombreux éléments qui vont permettre
d’effectuer un choix entre les différentes stratégies d’internationalisation.
Nous avons soulevé dans la première partie de ce Mémoire la montée en puissance du
phénomène de Mondialisation, et les questions managériales qui en découlent en matière de
stratégie d’internationalisation.
Le terme de « mondialisation » (aussi appelée « globalisation ») désigne le processus
d'intégration des marchés qui résulte de la libéralisation des échanges, de la concurrence
accrue et des conséquences des technologies de l'information et de la communication à
l'échelle internationale. Elle donne naissance à une interdépendance croissante des économies
et l’accroissement des interactions humaines et des échanges. Selon Théodore Levitt (1983), il
s’agit de « la convergence des marchés qui s’opère dans le monde entier ».
Selon McLuhan (1962), les technologies électriques et la mondialisation ont transformé le
monde en un grand village, induisant un mouvement instantané d’information d’un point à un
autre de la planète, et créant ainsi une communauté unifiée, où il n’y aurait plus qu’une seule
culture commune à tous. Cependant, lui-même a abandonné cette idée à la fin de ses
publications : la mondialisation semble bien loin d’avoir créé une culture homogène à travers
la planète, au contraire ; elle a parfois renforcé la tribalité de certains peuples.
Ce phénomène de mondialisation et la diversité culturelle qui demeure amènent les
entreprises à devoir se repositionner dans un contexte international, lors de l’import ou de
l’export de leurs produits. Quelle attitude adopter face à ces divergences culturelles ? Quelle
stratégie d’internationalisation semble la plus pertinente ?
Comme l’indiquent Solberg et Durrieu (2008) dans leurs recherches, chaque stratégie
d’internationalisation étudiée présente des avantages et des inconvénients. Il convient donc,

95
pour chaque secteur d’activité et chaque entreprise, de considérer ces avantages et
inconvénients, par rapport aux objectifs envisagés, pour déterminer la stratégie
d’internationalisation la plus pertinente et la plus prometteuse.
La stratégie de standardisation se veut une solution économique en matière de coûts, mais
destinée à être utilisée dans le cas où les besoins des différentes cibles seraient identiques.
Cette stratégie permet de centraliser les processus de décision, mais se retrouve limitée
lorsque les évolutions des différents marchés diffèrent.
La stratégie d’adaptation, permettant de répondre localement, et de façon spécifique, à des
besoins divergents, induit néanmoins des coûts d’adaptation non négligeables. Cette stratégie
est utilisée principalement lorsque la concurrence sur le marché cible est forte, et où la
fidélisation du consommateur est essentielle.
Enfin, la stratégie contingente de standardisation adaptée se veut une solution économique,
tout en permettant de répondre à des nuances dans les besoins de chaque cible locale. Tout en
permettant de centraliser les processus de décision, elle permet une marge de manœuvre
locale dans la réalisation.
Cette étude met en évidence que la stratégie la plus employée dans le domaine des
divertissements télévisés est la stratégie de standardisation adaptée : les formats sont choisis à
l’international pour leur succès, et son ensuite adaptés à la culture française, très particulière.
Cependant, pour ce secteur particulier, cette stratégie ne semble pas moins chère que la
stratégie d’adaptation : elle permet simplement de garantir des succès précédents à
l’international, donc un plus faible risque financier en cas d’échec. Elle peut aussi se
poursuivre au cours de plusieurs années, l’adaptation d’un format relativement standardisé
intervenant touche par touche au cours des saisons, en fonction des attentes constatées du
public ciblé.
Pour la domaine des divertissements télévisés, il a été confirmé que la stratégie de
standardisation permet une économie de coûts, mais cette stratégie est souvent délaissée,
d’une part car elle est synonyme de peu de moyens financiers, ce qui n’est pas bon pour
l’image de la chaîne, et d’autre part car elle ne permet pas de s’adapter aux besoins précis des
consommateurs français. C’était une stratégie utilisée au tout début de la téléréalité,
maintenant abandonnée pour la standardisation adaptée et l’adaptation.

96
Lors des interviews avec les professionnels, et en particulier ceux qui travaillent ou ont
travaillé dans une société de production, il s’avère que chaque chaîne ayant une spécialité, il
semble possible d’importer sur le marché français n’importe quelle émission. Les chaînes
télévisées jouent ici le rôle de canaux de diffusion ; chacune s’oriente vers un public bien
précis, et est à la recherche de programmes particuliers. Avec la TNT et l’augmentation du
nombre de chaînes, et par conséquent la segmentation du marché, il semble parfaitement
possible d’importer n’importe quelle émission étrangère sur le marché français, sous réserve
de choisir la bonne chaîne et d’adapter le format aux contraintes du marché local.
Cependant, les contraintes légales et contractuelles ne doivent pas être omises dans
l’application de cette stratégie d’internationalisation. Nous venons de dire que les émissions
devront être adaptées aux contraintes du marché français, car en effet outre la grille de
programmation qui oblige déjà souvent à une première modification du format, les
réalisateurs et diffuseurs n’ont pas le droit de diffuser ce qu’ils souhaitent ; ils doivent
respecter certaines caractéristiques du format d’origine, comme prévu dans le contrat, et les
règles fixées par le CSA dans le but de protéger le consommateur et l’industrie français.
La concurrence elle aussi joue un rôle important dans le choix de la stratégie
d’internationalisation : si elle est forte, et que plusieurs chaînes visent un même public, il va
falloir proposer un format répondant au mieux aux attentes des consommateurs, pour
s’assurer qu’il n’y ait pas une fuite vers l’autre chaîne.
En résumé, les éléments à considérer lors du choix de la stratégie d’internationalisation des
émissions de divertissement télévisées sont, d’après l’étude empirique : la culture et les
attentes locales, la concurrence, la grille de programmation, les contraintes légales et
contractuelles, le canal de diffusion (chaîne) et le segment de consommateurs auquel il
s’adresse, et le risque financier. Tous ces éléments sont à prendre en compte pour une
stratégie d’internationalisation performante.
D’après la littérature, plusieurs éléments doivent être pris en compte pour définir le degré
jusqu’auquel l’adaptation d’un produit doit se poursuivre. Selon Katsikeas, Samiee et
Theodosiou (2006), ces éléments sont les contraintes légales, l’intensité et la vitesse
technologiques, les coutumes et tradition, les caractéristiques des consommateurs, l’intensité
concurrentielle, et le stage du cycle de vie du produit.

97
Ces éléments ont bien été identifiés lors de l’étude empirique, à l’exception du stage de vie du
produit. Cependant, on remarque aussi des éléments non évoqués dans la littérature, qui
semblent impacter le degré de standardisation des émissions de divertissement télévisées en
France : le canal de diffusion, et le risque financier.
La question des coûts a été abordée par Solberg et Durrieu (2008) : selon eux, une stratégie de
standardisation permet des économies de coûts, mais un certain degré d’adaptation doit quand
même être réalisé.
La question du canal de diffusion, quant à elle, a été abordée par Sustar (2001), le degré
jusqu’auquel une entreprise va devoir adapter un produit dépendant selon lui du contrôle
qu’elle exerce sur les canaux de diffusion. Dans le cas particulier étudié, l’entreprise s’avère
être son propre canal de diffusion, et le contrôle est donc important. Néanmoins, un canal de
diffusion s’oriente vers un certain segment de consommateurs, et les chaînes vont devoir en
tenir compte. Lessassy (2008) souligne l’importance d’adapter la stratégie de distribution au
produit considéré.
L’industrie télévisée française doit faire face à des nombreux changements dans les habitudes
de consommation. Les séniors ont toujours été le public le plus présent, mais avec le
développement de la télévision à la demande sur internet, les jeunes tendent à se retrouver de
moins en moins devant le petit écran. Or tout un segment des émissions de divertissement
télévisées, la téléréalité, très populaire depuis les années 2000, était à destination de ce public
entre 15 et 34 ans. Par conséquent, il a fallu faire évoluer ce type de programmes vers un
public plus âgé, et familial, de façon à rassembler à nouveau les français.
Il s’est aussi avéré dans ce Mémoire que chaque segment des émissions de divertissement
télévisées (téléréalité, jeux, variété, etc.) doivent être pris séparément car ils ne s’adressent pas
au même public. Par conséquent, ils ne connaissent pas les mêmes évolutions, ni
nécessairement les mêmes stratégies d’internationalisation.
Enfin, il semble important d’étudier le poids du « feeling », du ressenti, dans le choix d’un
programme ou son adaptation : « parfois il y a des formats qui ne marchent pas à 100% mais
on essaye quand même car il y a quelque chose qui se passe, il y a un feeling ».

98
Bien que certains professionnels semblent se fier essentiellement aux données factuelles
(pilotes, audiences chiffrées, etc.), d’autres évoquent cette variable comme un motif de choix,
même si certains produits n’ont pas fait leurs preuves : « il y a des émissions qui cartonnent
dans certains pays mais qui ne marchent pas forcément dans d’autres, je pense à Danse Avec
Les Stars, qu’on a quand même choisi d’adapter et qui a marché. Je pense qu’il y a là une
question de feeling ».
Cette question de feeling semble aussi intervenir dans le cas contraire, lorsqu’un programme
marche à l’étranger, mais que l’adapter ne semble pas approprié : « Et le problème, c’est que
des fois, quand quelque chose cartonne à l’étranger, on est très facilement tenté de l’adapter,
même si on se dit que ça ne marchera pas ».
Un question peut se poser : est-ce que ce « feeling » viendrait compenser une certaine
méconnaissance des attentes du marché ?
Ce Mémoire a pour objectif de fournir des informations sur un marché encore peu étudié dans
la littérature. Ce travail pourra servir de base pour des recherches futures, indiquant des pistes
de réflexion.
Cette étude semble mettre en avant une certaine méconnaissance des attentes précises du
marché, ce qui accroît le risque d’échec lors de l’introduction d’un nouveau format, et limite
donc grandement l’innovation sur le marché français. Nous pensons qu’il serait intéressant
d’étudier d’où vient cette méconnaissance, si elle est due à une évolution constante de la
demande de la part du public, ou plus simplement à la complexité des différents publics
considérés.
D’autre part, les professionnels ont indiqué que les différents segments des émissions de
divertissement télévisées mériteraient d’être distingués, car ils ne s’adressent pas aux mêmes
segments de consommateurs. Il serait donc intéressant d’étudier chacun de ces segments et de
leurs stratégies d’internationalisation séparément ; en effet par exemple pour les jeux, il
semblait y avoir des divergences d’opinions entre les professionnels en ce qui concernait le
choix de stratégie : certains soutenaient qu’il y avait énormément de créations, et d’autres que
c’était le format le plus standardisé.
De plus, il pourrait être intéressant d’étudier les mêmes questions pour d’autres types de
programmes, tels que les films ou les séries télévisées. Il semblerait que pour ce type de

99
formats, la standardisation (changement de langue) soit de mise, mais on peut aussi visionner
sur le petit écran des créations purement françaises.

100
Bibliographie
I- Revues académiques et ouvrages
ABBOTT Lawrence (1955), Quality and Competition: an essay in economic theory,
Columbia University Press, New York, pp. 39-80
ADLER Nancy J., GHADAR Fariborz (1990), International Strategy from the Perspective
of People and Culture: The North American Context, Research in Global Strategic
Management: International Business Research for the Twenty-First Century: Canada’s New
Research Agenda, Greenwich, conn. JAI Press, Vol. 1, pp. 179-205
ALASHBAN Aref A., HAYES Linda A., ZINKHAN George M., BALAZS Anne L.
(2002), International Brand-Name Standardization/Adaptation: Antecedents and
Consequences, Journal of International Marketing, Vol. 10 n°3, pp. 22-48
ARITZ Jolanta, WALKER Robyn C. (2010), Cognitive Organization and Identity
Maintenance in Multicultural Teams : A Discourse Analysis of Decision-Making Meetings,
Journal of Business Communication, Vol. 47, n°1, pp. 20-41
BAREL Yvan (2006), Fusions-acquisitions internationales : le choc des cultures, La Revue
des Sciences de Gestion, n°218, pp. 53-60
BARMEYER Christoph (2002), Le management interculturel : facteur de réussite des
fusions-acquisitions internationales ?, Gerer et Comprendre, n°70, pp. 24-33
BARMEYER Christoph, MAYRHOFER Ulrike (2008), The contribution of intercultural
management to the success of international mergers and acquisitions : An analysis of the
EADS group, International Business Review, Vol. 17, pp. 28-38

101
BLANCHE Bernard (1987), Le marketing global : paradoxe, fantasme ou objectif pour
demain ?, Revue Française du Marketing, n°114
DE MOOIJ Marieke (2003), Convergence and divergence in consumer behaviour:
implications for global advertising, International Journal of Advertising, Vol. 22, n°2, pp.
183-202
DE MOOIJ Marieke, HOFSTEDE Geert (2010), The Hofstede model: Applications to
global branding and advertising strategy and research, International Journal of Advertising,
Vol. 29, n°1, pp. 85-100
DOUGLAS Susan P., WIND Yoram (1987), The Myth of Globalisation, Columbia Journal
of World Business, pp. 19-29
DUPRIEZ Pierre, SIMONS Solange (2000), La résistance culturelle : Fondements,
applications et implications du management interculturel, Sciences Humaines, n°106
FATT Arthur C. (1967), The Danger of “Local” International Advertising, Journal of
Marketing, Vol. 31, n°1, pp. 60-62
FINK Gerhard, MEIER-EWERT Sebastian (2004), Issues of time in international,
intercultural management: East and Central Europe from the perspective of Austrian
managers, Journal for East European Management Studies, Vol. 9, n°1
FRANKLIN Peter (2007), Differences and difficulties in intercultural management
interaction, Handbook of Intercultural Communication, pp. 263-‐284
GHOSHAL Sumantra, NOHRIA Nitin (1993), Horses for Courses : Organizational Forms
for Multinational Corporations, Sloan Management Review, Vol. 34, n°2, pp. 23-35
GREEN Robert T., CUNNINGHAM William H., CUNNINGHAM Isabella C. M.
(1975), The Effectiveness of Standardized Global Advertising, Journal of Advertising, Vol. 4,
n°3, pp. 25-29

102
GROSBOIS Thierry (2010), La stratégie européenne de General Motors, de l’adaptation au
protectionnisme à la mise en place du marché unique (1920-1993), Revue du Nord, n°387, pp.
857-876
HAMPDEN-TURNER Charles, TROMPENAARS Fons (2000), Building Cross-Cultural
Competence: How to Create Wealth from Conflicting Values, Yale University Press
HOFSTEDE Geert (1984), Culture's consequences : international differences in work
related values, Sage, 327 p.
HOFSTEDE Geert (2001), Culture's Recent Consequences: Using Dimension Scores in
Theory and Research, International Journal of Cross-Cultural Management, Vol. 1, n°1, pp.
11-17
HOFSTEDE Gert Jan, PEDERSEN Paul B., HOFSTEDE Geert (2002), Exploring
Culture : Exercises, Stories and Synthetic Cultures, Yarmouth, Maine: Intercultural Press,
234 p.
HOLDEN Len (2005), Fording the Atlantic: Ford and Fordism in Europe, Business History,
Vol. 47, n°1, pp. 122–127
KATSIKEAS Constantine S., SAMIEE Saeed, THEODOSIOU Marios (2006), Strategy
Fit and Performance: Consequences of International Marketing Standardization, Strategic
Management Journal, Vol. 27, pp. 867-890
KASHANI Kamran (1990), Les Pièges du Marketing International, Harvard l’Expansion,
pp. 6-13
KAYNAK Erdener, MITCHEL Lionel A. (1981), Analysis of Marketing Strategies Used in
Diverse Cultures, Journal of Advertising Research, Vol. 21, n°3, pp. 25-32
KLUCKHOHN Florence R., STRODTBECK Fred L. (1961), Variations in Value
Orientations, Ed. Row Peterson, pp. 1-48

103
LAGES Luis Filipe, ABRANTES José Luis, LAGE Cristiana Raquel (2007), The
Stratadapt Scale: A Measure of Marketing Strategy Adaptation to International Business
Markets, Journal of Business Research, Vol. 60, pp. 960-964
LESSASSY Léopold (2008), Les produits ethniques dans les petits formats de vente : Les
difficultés des canaux de distribution, La Revue des Sciences de Gestion, n° 229, pp. 65-74
LEVITT Theodore (1983), The Globalization of Markets, Harvard Business Review, Vol. 61
n°3, pp. 92-102
LINTON Ralph (1945), The Cultural Background of Personality, Ed. Appleton-Century,
New York, p. 33
NASIR V. Aslihan, ALTINBASAK Ipeck (2009), The standardization/adaptation debate :
creating a framework for the new millenium, Strategic Management Review, Vol. 3, n°1, pp.
17-50
ONKVISIT Sak, SHAW John (1990), Global Advertising: Revolution or Myopia, Journal
of International Consumer Marketing, Vol. 2, n°3, pp. 97-112
PASCO-BERHO Corinne (2002), Marketing International, Ed. Dunod, Paris, N°4, p. 38
QUELCH John A., HOFF Edward J. (1986), Customizing Global Marketing, Harvard
Business Review, n°3, pp. 59-68
RAM Uri (2004), Glocommodification: How the Global Consumes the Local – McDonald’s
in Israel, Current Sociology, Vol. 52, n°1, pp. 11-31
RAU Pradeep A., PREBLE John F. (1987), Standardisation of Marketing Strategy by
Multinationals, International Marketing Review, pp. 18-28
ROGERS Everett M., HART William B., MIIKE Yoshitaka (2002), Edward T. Hall and
the history of intercultural communication: the United States and Japan, Keio Communication
Review, n°24, pp. 3-26

104
ROSEN Barry Nathan (1990), Global Products: When Do They Make Strategic Sense?,
Advances in International Marketing, Vol. 4, pp. 57–71
SAMIEE Saeed, ROTH Kendall (1992), The influence of global marketing standardization
on performance , Journal of Marketing, Vol. 56, n°2, pp. 1-17
SCHILKE Oliver, REIMANN Martin, THOMAS Jacquelyn S. (2009), When Does
International Marketing Standardization Matter to Firm Performance, Journal of International
Marketing, Vol. 17, n°4, pp. 24-46
SCHMID Stefan, KOTULLA Thomas (2011), 50 years of research on international
standardization and adaptation: From a systematic literature analysis to a theoretical
framework, International Business Review, Vol. 20, n°5, pp. 491-507
SCHUILING Isabelle (2002), La force des marques locales et ses déterminants spécifiques
par rapport aux marques internationales, Presses Universitaires de Louvain
SCHUILING Isabelle, KAPFERER Jean-Noël (2004), Real Differences between Local and
International Brands : Strategic Implications for International Marketers, Journal of
International Marketing, Vol. 12, n°4, pp. 97-112
STEENKAMP Jan-Benedict E.M., DE JONG Martijn G. (2010), A Global Investigation
into the Constellation of Consumer Attitudes Toward Global and Local Products, Journal of
Marketing, Vol. 74, n°6, pp. 18-40
SOLBERG Carl Arthur (2000), Standardisation or Adaptation of the International
Marketing Mix: The Role of the Local Subsidiary/Representative, Journal of International
Marketing, Vol. 8, n°1, pp. 78-98
SOLBERG Carl Arthur (2000), Educator Insights: Standardization or Adaptation of the
International Marketing Mix: The Role of the Local Subsidiary/Representative, Journal of
International Marketing, Vol. 8, pp. 78-98.

105
SOLBERG Carl Arthur (2002), The Perennial Issue of Adaptation or Standardization of
International Marketing Communication: Organizational Contingencies and Performance,
Journal of International Marketing, Vol. 10, n°3, pp. 1-21
SOLBERG Carl Arthur, DURRIEU François (2008), Strategy development in
international markets: a two tier approach, International Marketing Review, Vol. 25, n°5, pp.
520-543
SUSTAR Boris (2001), Characteristics of the Product Standardization/ Adaptation in the
International Environment, The Marketing Review, Vol. 4, n°1, pp. 47-71
TAKEUCHI Hirotaka, PORTER Michael E. (1986), Three Roles of International
Marketing in Global Strategy, Ed. M. E. Porter, Competition in Global Industries, Harvard
Business School Press
TROMPENAARS Fons, HAMPDEN TURNER Charles (1997), Riding the waves of
culture, Ed. Mc Graw-Hill, Ch. 1-3-11
USUNIER Jean-Claude (2004), Marketing International, HEC Lausanne, Ch. 3
VIGNALI Claudio (2001), McDonald’s: think global, act local - the marketing mix, British
Food Journal, Vol. 103, n°2, pp. 97-111
VRONTIS Demetris, SHARP Iain (2003), The Strategic Positionning of Coca-Cola in their
Global Marketing Operation, The Marketing Review, Vol. 3, pp. 289-309
VRONTIS Demetris (2003), Integrating Adaptation and Standardisation in International
Marketing, The AdaptStand Modelling Process, Journal of Marketing Management, Vol. 19,
pp. 283-305
WESTJOHN Stanford A., SINGH Nitish, MAGNUSSON Peter (2012), Responsiveness to
Global and Local Consumer Culture Positioning: A Personality and Collective Identity
Perspective, Journal of International Marketing, Vol. 1, n°1, pp. 58-73

106
WHITELOCK Jeryl M., PIMBLETT Carole (1997), The Standardization Debate in
International Marketing , Journal of Global Marketing, Vol. 10, n°3, 1997, pp. 45–66.
II- Sites internet
Geert and Gert Jan Hofstede website, http://www.geerthofstede.nl (consulté le 18/10/13),
articles sur la culture
Site internet des papiers de recherche du GREGOR http://panoramix.univ-
paris1.fr/GREGOR (consulté le 23/10/13) : GIARD Vincent, « Analyse économique de la
standardisation des produits », 1999-2013
Site internet du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) http://www.csa.fr (consulté le
10/01/2014)
Site internet de la société de production Endemol http://www.endemol.fr (consulté le
17/02/2014), entreprise d’un des répondants
Site internet du Groupe M6 http://www.groupem6.fr (consulté le 15/01/2014), entreprise
d’un des répondants
Site internet du Groupe TF1 http://www.groupe-tf1.fr (consulté le 20/12/2013), entreprise
de plusieurs des répondants
Site internet des chaines d’AB-Groupe http://www.abweb.com (consulté le 20/12/2013),
entreprise d’un des répondants
Site internet de la société de production FremantleMedia http://www.fremantlemedia.fr
(consulté le 17/02/2014), entreprise d’un des répondants

107
III- Articles non académiques
AGAESSE Marion, JULLIEN Gaëlle, LEBLANC Delphine, TOUBOULIC Damien,
« Marketing Opérationnel, Analyser le Marketing et la communication, IKEA », disponible à
http://cadres.apec.fr/download?type=ESPACE_PERSO&fileName=109369/Marketing_Ikea.p
df.ESPACE_PERSO52775.pdf (consulté le 01/11/2013)
BURT Steve, JOHANSSON Ulf, THELANDER Asa (2008), « Standardized marketing
strategies in retailing? IKEA’s marketing strategies in China, Sweden and the UK », Paper
accepted for presentation at the 1st Nordic Retail and Wholesale Conference in Stockholm
Commission de réflexion sur l’évolution des programmes, « Réflexion sur les émissions
dites « de téléréalité » : Synthèse des auditions et bilan de la réflexion » (2011),
téléchargeable sur le site du CSA (consulté le 20/12/2013)
CHABERT Patrick, « Ikea cache bien son extrême standardisation », Capital.fr, 13/05/2013,
disponible à http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/ikea-cache-bien-son-extreme-
standardisation (consulté le 01/11/2013)
FEREC Jérôme, « Koh-Lanta vs. Survivor », Front de Libération Télévisuelle, 03/10/2011,
disponible à http://www.a-suivre.org/flt/koh-lanta-vs-survivor.html (consulté le 04/11/2013)
LAURENT Patrick, The Voice : « Nous sommes meilleurs en Belgique », LaLibre.be,
27/02/2012, disponible à http://www.lalibre.be/culture/medias-tele/the-voice-nous-sommes-
meilleurs-en-belgique-51b8e664e4b0de6db9c5a476 (consulté le 07/05/2014)
MAHRAN Meskeh, GALLEGO Virginie (2012), Cahier de recherche « Le retailing Mix à
l’international : standardisation ou adaptation ? Le cas des hypermarchés francais au Moyen-
Orient », CERAG, Unité mixte de recherche CNRS / Université Pierre Mendès France
Grenoble 2

108
PELLETIER Benjamin, « Pourquoi Renault a échoué en Inde avec la Logan ? »,
07/05/2010, disponible à http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/pourquoi-
renault-a-echoue-en-inde-avec-la-logan/ (consulté le 12/01/2014)
RENOU Fabien, « Les flops des grandes marques », 06/06/2011, disponible à
http://www.journaldunet.com/management/marketing/flop-des-marques/cartes-
hallmark.shtml (consulté le 13/01/2014)
ROBERT Thomas, The Voice : Le (joli) salaire des jurés de TF1, télé-loisirs.fr, 05/01/2012,
disponible à http://the-voice.programme-tv.net/the-voice-1/news/20994-joli-salaire-jures-tf1/
(consulté le 07/05/2014)
« Marketing strategies used by Nokia », disponible à
http://www.ukessays.com/essays/marketing/marketing-strategies-used-by-nokia-marketing-
essay.php (consulté le 01/11/2013)
Comportement du public français en matière de visionnage de la télévision, communiqué
de presse Médiamétrie, disponible à http://www.mediametrie.fr/television/communiques/l-
audience-de-la-television-en-2011.php?id=583 (consulté le 07/01/2014)
IV- Vidéos
Reportage « John De Mol, l'homme qui a inventé la télé-réalité », émission The Tube de
Canal +, disponible à http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid6427-c-le-tube.html
(visionnée le 10/05/2014) : explication du marché de la téléréalité à travers le succès de John
De Mol

109
Annexes
A. Guide d’entretien
Objectifs de l’entretien :
- Obtenir des perceptions, sentiments, opinions, attitudes et informations de la part de
l’interviewé sur le domaine étudié dans ce Mémoire ;
- Comprendre et analyser ce que les interviewés pensent ou peuvent penser sur ce sujet
de Mémoire ;
- Obtenir plus d’informations et approfondir les points importants de ce Mémoire ;
- Mettre en place une démarché participative et d’échange entre les interviewés et
l’intervieweur.
On définira la stratégie de standardisation dans les émissions de divertissement comme la
simple traduction de l’émission, la standardisation adaptée comme la réalisation d’une
émission en changeant les participants et quelques éléments lors de la réalisation, et
l’adaptation comme la conservation du principe général mais la modification de l’ensemble de
la réalisation ou du concept.
Thèmes clés Exemples de questions Pourquoi ce thème
Choix du format
Comment sont choisis les formats
pour la télévision française ?
Tous les formats peuvent-ils
convenir à la télévision française ?
Connaître les motivations de
l’entreprise lors du choix d’un
format pour la télévision
française.
Diversité
culturelle
Quels sont les principaux domaines
qui diffèrent au niveau des
divertissements audiovisuels en
matière de culture ?
Quelles sont les principales barrières
Obtenir des informations sur le
ressenti de la diversité culturelle
entre les différents pays, et des
éléments culturels à prendre en
compte dans l’élaboration de la

110
culturelles que présente le public
français ?
stratégie d’internationalisation.
Adaptation /
standardisation /
standardisation
adaptée
Quels éléments permettent de choisir
entre standardisation, standardisation
adaptée et adaptation ?
Quelle est la stratégie le plus
utilisée ?
Quelle est la cible visée pour
chacune de ces stratégies ?
Quels éléments de la culture sont pris
en compte pour l’adaptation ?
Quels sont les éléments types qu’il
faut adapter au public français ?
Comment les émissions
standardisées suscitent-elles
l’adhésion du public ?
Comprendre la stratégie
d’internationalisation en matière
de formats télévisés : les
éléments de choix, les éléments
à modifier, l’adhésion du public.
Le marché
Quel est le type de public visé ?
La demande a-t-elle évolué, en
matière de contenu ?
Quel type d’émission est
actuellement demandé par le public ?
Quelles sont les similitudes entre les
demandes des différents marchés ?
Collecter des ressentis sur la
situation et l’évolution du
marché, mesurer les résultats et
effets des différentes stratégies.

111
B. Matrice d’analyse des entretiens
Culture
(A)
Différences
culturelles (A1)
Prod1xA1xB « je pense que ça ne pourrait pas être adapté à la
télévision française »
Prod1xA1 « En France, on est plutôt sur du concours, on est très
élitistes en France »
Chai1xA1 « La plupart des programmes viennent des Etats-Unis, et
on n’a pas du tout la même notion de libéralisme qu’aux Etats-Unis, et
ça se voit dans beaucoup de domaines, notamment dans le travail »
Chai1xA1 « les français sont plus exigeants »
Chai1xA1xC « Les sujets abordés aussi sont importants, parce qu’on
n’a pas forcément les mêmes affinités »
Chai1xA1 « Quand on voit un programme d’un autre pays, que la
culture n’est pas tout à fait la même, on ne va pas forcément se
reconnaître »
Chai2xA1 « culturellement, on a des pays qui nous ressemblent plus
que d’autres »
Chai2xA1 « qui eux, ont des choses très particulières et qu’on va
parfois avoir du mal, nous, à importer. […] La France est un peu à mi-
chemin »
Chai2xA1xB2 « La version anglaise, c’est un rythme particulier, du
coup je pense qu’ils vont avoir beaucoup de travail pour l’adapter à la
culture française, au rythme français »
Chai2xA1xC « Ce qui va être compliqué, c’est quand il va y avoir un
contexte historique, qui va vraiment dépendre de la culture et de
l’histoire du pays »
Chai2xA1xB2 « Ce n’est pas parce qu’il y a certains caractères
présents dans la version de base qu’on va rechercher les mêmes, on
va faire aussi par rapport à ce qu’il y a dans notre casting, et notre
casting c’est le reflet de la société »
Chai3xA1 « Les différences elles sont plutôt culturelles, parce que la
culture française est différente de ce qu’on peut trouver à
l’international »
Chai3xA1xB2 « qui vont avoir certains formats qu’on va avoir du mal
à adapter »

112
Chai3xA1 « Après, nous on regarde beaucoup ce qui se passe aux
Etats-Unis et en Angleterre, qui sont des marchés où en termes de
goûts et de sensations, correspondent à ce que nous on peut
chercher sur TF1. En France, on va trouver des chaines pour tout,
mais culturellement, certaines choses ne passeraient pas. […] Là-
bas, ça fonctionne bien, car c’est dans leur mentalité : le self-made
man, la réussite. En France, on n’a pas la même approche au travail,
donc je ne pense pas que ça marcherait »
ProdChai1xA1 « Il y a des tendances partout, ce n’est pas pour
autant qu’on va les faire car le public français est très particulier, ça
n’a rien à voir avec un autre public »
ProdChai1xA1xB2 « Encore une fois, comme par défaut le public
français est très particulier, on se dit qu’il faut qu’on soit différenciant
de l’étranger, d’office »
Chai4xA1 « On peut avoir des formats qui cartonnent à l’étranger, et
se dire qu’en France, ça ne marchera pas. […] si on compare la
France à tout ce qui se fait, on en est très loin »
Chai4xA1 « je pense que le côté ultra-show comme ça de X Factor,
avec une ambiance un peu électrique, ça ne parle pas au public
français »
Chai4xA1 « Il y a tellement de traits culturels. Effectivement, il y a la
problématique de l’argent, qui est tabou, on en a déjà parlé. Il y a
aussi la problématique de format : si un programme a cartonné en
France, et qu’on arrive derrière avec un format qui ressemble, ça ne
marchera pas »
Chai4xA1 « Il y a aussi des caractéristiques de programmation, c’est-
à-dire qu’il y a des choses qui sont faites aux Etats-Unis et qui ne
pourraient pas être faites en France.[…] En France, on a l’habitude
d’avoir des quotidiennes, c’est important pour le public de pouvoir
suivre le feuilleton tous les jours, mais ça ne se fait pas forcément
dans tous les pays »
Chai4xA1 « Après, la téléréalité n’a pas la même ampleur dans les
différents pays, et c’est aussi à avoir en tête »
Chai4xA1 « C’est très difficile d’être dans son époque, et chaque
pays a une époque différente »
Chai4xA1 « C’est pour ça qu’on va pouvoir avoir des programmes
comme The Apprentice, qu’en France on ne pourra pas. Ce n’est pas

113
cette culture-là »
Chai4xA1 « Des fois, on voit des programmes qui cartonnent à
l’étranger, mais on se dit qu’en France ça ne marchera jamais, ce
sont des choses improbables »
Chai4xA1 « Le carton à l’étranger ne garantit pas un carton en
France »
Prod2xA1 « Ça va dépendre d’une culture audiovisuelle locale »
Prod2xA1 « il est certain que par certains aspects on est plus stricts
que dans certains pays »
ProdChai2xA1 « là où on va franciser le programme, c’est à travers
les questions, et à travers le casting des candidats »
Législation (A2)
Chai1xA2 « en France, la télévisions est chapeautée par le CSA »
Prod1xA2 « En France, pour la diffusion des programmes, il faut qu’il
y ait x% de programmes réalisés en France qui soient diffusés à la
télé française »
Chai2xA2xC « Il y a des formats anglo-saxons qu’on ne pourrait pas
faire, je pense. Déjà, il y a un problème de législation »
Chai2xA2 « il y a le CSA qui nous donne une fréquence, et on a un
cahier des charges à respecter »
Chai3xA2 « Il y a aussi des contraintes fixées par la CSA, un cadre
légal qu’il faut qu’on respecte, que ce soit pour les horaires ou les
contenus »
Chai4xA2 « il y a toujours des règles à respecter. Pour les fictions
françaises, il y a des règles fixées par l’Autorité de la Concurrence,
qui font qu’on est obligés d’avoir un certain nombre de producteurs
différents »
Chai4xA2 « c’est beaucoup autour de l’argent, du sexe aussi, c’est-à-
dire qu’on ne peut pas montrer des scènes trop crues en prime parce
que derrière il y a le CSA. Il y a tout un tas de règles à respecter. […]
Donc à partir de là, on est assez limités »
Prod2xA2 « En France on a quand même énormément de barrières à
cause, ou grâce, au CSA, on le voit comme on veut ; et ces barrières
font que nous n’avons pas la même culture audiovisuelle »
ProdChai2xA2 « En France, on a un organisme qui est le CSA, qui a
mis son nez tout de suite dans la téléréalité contrairement aux autres

114
pays »
ProdChai2xA2 « Alors que nous en France, évidemment, on ne peut
pas faire ça, on aurait les syndicats sur le dos qui nous diraient que
c’est injuste. Donc on a des contraintes à respecter »
Valeurs et
attentes (A3)
Prod1xA3 « Je pense que culturellement, la télévision française ne
permettra pas la diffusion de n’importe quel format »
Prod1xA3xB2xB3 « Il faut adapter les émissions à son public étant
donné que le public a quand même une demande »
Chai1xA3 « la France n’est pas un public qui est prêt à regarder du
« trop trash » »
Prod1xCxA3 « ils vont surtout chercher à répondre à une demande »
Chai1xA3xC « par rapport aux mœurs aussi, si on met un
programme qui va choquer le public, on risque de perdre nos
téléspectateurs, et pas seulement sur ce programme-là »
Chai1xA3 « il faut qu’ils se reconnaissent dans un programme »
Chai2xA3xC « Il y a aussi à un moment un temps : il y a des choses
qui sont dans l’air du temps à un moment »
Chai1xA3xC2 « La téléréalité, donc les moins de 35 ans, et on va
dire carrément les 15-24 ans, je pense qu’ils veulent voir des potins,
des histoires d’amour, des fights, des clashs, des buzz, ils aiment
bien voir aussi que des anonymes réussissent en ne faisant rien. Les
jeunes ont plaisir à voir que dans la téléréalité, on peut ne rien faire et
puis tout te tombe dans le bec, et la vie de souris, ça les fait rêver je
pense. Ça leur plait d’imaginer que ça pourrait être eux, puisque ce
sont des anonymes qui réussissent. Je pense qu’il y a aussi le plaisir
de se moquer. Et surtout, je pense que les jeunes qui regardent ce
type de programmes, ce qu’ils attendent après, c’est de pouvoir en
parler dans la vie sociale. […] Tandis que les divertissements, le
public est déjà un peu plus vieux, on élargit aux 25-59 ans, qui vont
chercher à se divertir, à regarder quelque chose de qualité, à passer
un bon moment devant la télévision, à voir des gens qu’ils aiment
bien »
Chai1xA3 « les émissions qui marchent très bien, ce sont les
émissions où il y a une notion de mérite »
Chai2xA3xC « il y a des problèmes de mœurs »

115
Chai2xA3 « la télévision ça permet de créer du lien social »
Chai3xA3 « Et en travaillant sur différents univers, on s’est rendu
compte que l’univers du mariage, qui est un univers qui fait rêver, très
féminin, permettait de décliner à la fois une approche « lifestyle »
avec le dîner, la robe, la soirée, l’ambiance etc. Cela pouvait répondre
aux goûts de notre public sur ce type de cases »
Chai3xA3xC « on va avoir tendance à s’adapter à une certaine
demande, mais c’est dur de la connaître, parce qu’elle est très
évolutive »
Chai3xA3 « en ce moment, en France, c’est la crise. Donc lorsqu’ils
regardent des émissions de divertissement, les gens vont chercher de
la légèreté, des formats qui vont faire rêver »
Chai3xA3 « c’est ça aussi qui fait le succès des émissions, parce que
les gens se disent « ça pourrait être moi » »
ProdChai1xA3 « C’est pour être en adéquation avec ce que pensent
les français, pour ne pas choquer »
Chai4xA3xC3 « Notre théorie, c’est que les gens n’attendent pas ce
genre de programmes sur M6, ça dépend donc du public »
Chai4xA3 « il faut s’assurer que le format est en adéquation avec les
attentes du public »
Chai4xA3 « Après, les éléments de culture jouent aussi. En fait, tout
ce qu’on estime qui pourra choquer le public français, on ne le fera
pas »
Chai4xA3 « Typiquement en ce moment, les français, avec la crise,
ne veulent pas voir une effusion d’argent. Tous les programmes qui
pouvaient marcher à l’époque, où on voyait les riches et tout ça, ça ne
fonctionnera plus, il n’y a pas moyen qu’on le fasse »
Chai4xA3 « Les gens veulent voir du positif. Mais peut-être que
demain ça va changer »
Chai4xA3 « La ménagère elle veut s’identifier »
Chai4xA3 « cette problématique de tendances est vraiment très
importante »
Chai4xA3 « En fait il faut savoir que la télé, contrairement à ce qu’on
peut penser, au fil des années, s’est extrêmement assagie »
ProdChai2xA3 « ils vont faire une étude qualitative »

116
ProdChai2xA3 « le public français a catalogué la téléréalité comme
un produit plutôt bas de gamme, plutôt trash, des programmes qui
sont plutôt mauvais dès le départ. Donc dès qu’on va adapter une
téléréalité en France, il va falloir amener des valeurs, on ne va pas
mettre en avant ce qui fait les fondamentaux de la téléréalité »
ProdChai2xA3 « Du moment où le public n’assume plus de le
regarder, on va perdre le programme »
ProdChai2xA3 « dans les valeurs du programme, on retrouve
exactement la même chose dans chaque pays »
ProdChai2xA3 « On a longtemps parlé de « Feel Good », et c’est
toujours d’actualité, la feel good tv […] on est très rassembleurs, il n’y
a pas de différence entre l’élite et la France du peuple »
ProdChai2xA3 « c’est un phénomène de crise, les artistes ont besoin
de montrer qu’ils sont des gens comme les autres pour surtout ne pas
se couper de leurs bases »
ProdChai2xA3 « il faut qu’il y ait un terrain de « feel good », et un
terrain d’accomplissement personnel »
Méthodes
d’import
(B)
Concept Réalisation
Standardisation
(B1)
Chai1xB1xB2 « ce sont des concepts étrangers qu’on a racheté »
Chai1xB1 « la traduction pure et dure, ça ne se fait plus trop. C’est
quelque chose qu’on fait quand on est une chaine qui n’a pas
beaucoup d’argent »
Chai2xB1 « Le voice-over, ça n’existe quasiment plus, c’était au tout
début de la TNT »
Chai2xB1 « Sur les plus petites chaines, souvent on n’adapte pas,
car ils n’ont pas le budget, et ce sont des micro-audiences, c’est
souvent pas très gros du coup ils travaillent moins leur adaptation »
ProdChai1xB1 « par principe, on n’ira pas au copier-coller »
ProdChai2xB1 « on a rarement un format de divertissement pur qui
va pouvoir parcourir le monde »
Standardisation
adaptée (B2)
Chai2xB2 « Il y a peut-être très longtemps, au tout début, on
n’adaptait pas beaucoup »
Chai2xB2 « aujourd’hui on a l’habitude de voir un peu partout plus ou
moins la même chose »

117
Chai2xB2 « Au début, on copiait les formats. Après il y a eu une
législation, on en est arrivés à acheter les formats, et puis maintenant
on les adapte »
Chai2xB2xC « je n’ai pas de souvenir d’un format qui n’aurait pas pu
être adapté, à part celui-ci et aussi un autre »
Chai2xB2 « Tout peut se travailler, et après il y a une manière de le
faire »
Chai2xB2 « dans le format de The Voice, il y a quelques petites
adaptations, mais quand on regarde dans tous les pays, ça se
ressemble quand même beaucoup »
Chai2xB2 « Et puis on a des formats qui sont quand même assez
différents, et qu’on adapte beaucoup ; les jeux par exemple ça peut
être pareil, avec La Roue De La Fortune quand on l’a remis à
l’antenne, bien sûr on retrouvait les éléments principaux comme la
roue avec les lettres à trouver et on gagnait de l’argent avec les
sommes sur la roue, mais on l’a dépoussiérée dans plein d’éléments
avec le décor, l’animation, des fois ce sont des choses qui ne
paraissent pas énormes mais qui font que l’émission passe à un
stade différent »
Chai2xB2 « ça a fonctionné, l’adaptation est bonne, et pour ça il n’y a
pas forcément d’éléments »
Chai2xB2 « La première chose, déjà, quand on achète un format,
c’est que souvent ça n’a pas la durée d’un Prime français »
Chai2xB2 « Il y a la question du décor, mais le décor dépend du
décor original, l’animation va dépendre de l’animateur, même si ce
qu’on voit à l’étranger peut aussi influer sur l’animateur qui va
correspondre à un certain type de formats »
Chai2xB2 « c’est souvent le cas dans les jeux, où il y a des règles et
tout, ça peut être assez standardisé, même si après ça peut être
adapté »
Chai2xB2 « Si le programme nous plait tel qu’il est, il n’y a pas de
raison de l’adapter. […] ça dépend vraiment des formats, mais il n’y a
pas de nécessité à tout changer. Quand c’est bien, et qu’on pense
que ça correspond à notre public, il n’y a pas de raison de changer »
Chai1xB2 « Il y a des contrats qu’on est obligés de respecter, mais
on va parfois les adapter en rajoutant des choses en plus en accord
avec la boite de production, pour améliorer le programme quand les

118
conseillers artistiques estiment qu’il y en a besoin »
Chai2xB2 « Evidemment, il y avait une couche d’adaptation à donner
à ce format, et ça a été très bien fait en France, mais il n’y a pas de
raison que les éléments constitutifs du format ne soient pas
suffisamment forts pour en faire un format puissant en France. »
Prod1xB2 « on peut vendre des droits, qui vont être des droits de
diffusion en anglais avec les droits d’adaptation en français »
Prod1xB2 « je pense que l’adaptation se fait d’abord avec les
personnages […] par rapport à des caractères »
Chai3xB2 « le format à succès type The Voice qui est une
standardisation adaptation […] parce que c’est un programme qui a
eu du succès dans un, deux territoires « majeurs » on va dire.
Typiquement The Voice, c’est un programme où quand tu l’achètes,
tu as zéro marge de manœuvre en termes d’adaptation. C’est un
produit que tu prends en standard. La première version qu’on a vue
sur TF1, c’est la même que celle qu’on trouvait aux Etats-Unis. Après
au fur et à mesure des années, les différents territoires, avec leurs
bonnes idées, incrémentent la version de base. Et ça crée une sorte
de « pot commun » où les gens vont venir piocher, puisqu’à la base
c’est le même format »
Chai3xB2 « 70% de choses qui sont adaptées des numéros qu’on
aura vus dans d’autres pays, donc des copiés-collés de ce qu’on a vu
ailleurs et qui a fonctionné »
Chai3xB2 « On est partis d’un format […] anglo-saxon, leader
commercial qui faisait environ 40-45 minutes en Angleterre, et qui
n’était pas sous la forme de strip »
Chai3xB2 « ce n’était pas quelque chose qu’on pouvait scanner, qui
arrive en succès international comme The Voice ou comme Master
Chef. […] Du coup il fallait l’adapter pour que ça devienne
généraliste »
Chai3xB2 « ce programme-là, on a travaillé la version anglo-
saxonne, qui est une matière très brute, et on l’a travaillé avec une
approche de fiction. Et on a réussi à en faire un succès sur TF1, et
aujourd’hui le distributeur-producteur, Shine International, distribue le
format sur sa version française. On a adapté la version UK pour en
faire une version qui correspondait au marché français, mais
visiblement c’est ce qui est recherché et proposé à l’international, ce

119
que nous avons adapté de cette façon-là »
Chai3xB2 « On a cherché à modifier l’émission de façon à ce qu’elle
corresponde à une cible plus large, pour que ça marche sur TF1 »
Chai3xB2xC6 « Nous on a le budget pour adapter les émissions
donc on va le faire. Après, pour un gros format, on ne choisit pas.
Quand ça marche à l’étranger, on se demande pourquoi on
changerait la formule. On va préférer faire la même chose, donc c’est
ce qu’on va faire. Après, il faut parfois s’adapter au contexte socio-
économique du pays »
Chai3xB2 « pour ce qui est de l’adaptation, en général c’est la
longueur qu’on va devoir modifier »
Chai3xB2xC5 « En période où le marché est tendu, on a tendance à
minimiser les risques, et donc aller vers la standardisation. Par
exemple, on va faire The Voice, on va faire les grosses marques, les
grosses franchises qu’on trouve à l’étranger et qui fonctionnent bien.
Après, quand on a un marché dans lequel il y a une certaine
concurrence, on ira peut-être prendre plus de risque et aller
davantage vers l’adaptation »
Chai3xB2 « on va commencer avec une standardisation adaptée, on
va aller petit à petit vers l’adaptation car chaque année on va l’adapter
et l’incrémenter au goût du public concerné »
Chai3xB2 « Et puis ça n’est pas toujours la peine non plus, un
programme qui marche très bien à l’étranger, on en va pas avoir
forcément besoin de le modifier pour le diffuser à la télévision
française. On va le modifier par petites touches, d’une année sur
l’autre, si on se rend compte que quelque chose a été fait dans un
pays, que ça marche bien, et que ça pourrait bien marcher chez nous
aussi. Mais ça marche dans l’autre sens aussi, parfois les autres pays
vont voir une adaptation chez nous, et vont l’appliquer aussi, et c’est
notre version qui est revendue. Comme ça, les programmes évoluent
petit à petit, au fil des années »
ProdChai1xB2 « prendre un programme, l’adapter et le développer
en France, le développer avec les producteurs, choisir les animateurs,
choisir les mécaniques de jeux, intervenir sur le choix des décors, le
choix des habillages, tout ce qui est un peu artistique »
ProdChai1xB2 « Dans le jeu, c’est très différent de la téléréalité où
on peut instaurer de nouvelles choses etc, dans le jeu c’est très

120
codifié, il y a un cadre qui est très difficile à bouger, on a aussi des
contraintes de format, ça on pourra y revenir après, mais la
particularité d’un programme de jeu c’est qu’on peut changer les
choses mais pas révolutionner l’affaire »
ProdChai1xB2 « tout ce qui est à l’antenne, ce sont des adaptations
de formats »
ProdChai1xAxB2 « nous c’est vrai qu’on a un véritable travail
d’adaptation pour l’adapter au public français qui est particulier »
ProdChai1xB2xC4 « on essaye de faire les mécaniques, en tout cas
celles du programme idéal, et après ce sont les producteurs qui vont
défendre cette version auprès des ayant-droits »
ProdChai1xB2 « , ce n’est pas pour autant qu’il faut tout détruire, s’il
y a un format qui existe et qui a fait ses preuves à l’étranger, c’est
qu’il y a une bonne idée derrière, et le but c’est de toujours respecter
l’ADN du projet »
ProdChai1xB2 « sur la longueur du format déjà, il va falloir que ce
soit adapté à nos stratégies de grilles »
ProdChai1xB2 « C’est vrai que nous après notre boulot, c’est
d’adapter à la réalité et au contexte français. […] On adapte tout,
aussi bien la taille du plateau, que l’affichage de ce qu’on va donner
en termes de sous, on adapte tout au contexte économique français »
Chai4xB2 « ils vont acheter des formats étrangers et les adapter,
c’est le cas de Rising Star »
Chai4xB2xC1 « M6 va être très alerte sur ce qui marche à l’étranger,
et va tout de suite l’adapter »
Chai4xB2xC4 « Ensuite, quand on achète un format, on ne peut pas
tout faire. On doit respecter un certain nombre de règles ; on ne
pourra pas changer le format en fait »
Chai4xAxB2 « Quand on adapte un format, il faut regarder quelle est
la tradition du pays, car la tradition en France est extrêmement
importante »
Chai4xAxB2 « Il y a la durée. Nous en France, le prime, il dure deux
heures. Aux Etats-Unis, il dure une heure par programme. […]Il y a
aussi la problématique du nombre de semaines »
Chai4xA3xB2 « On peut négocier des petits détails comme ça, mais
on va être très vite limités en réalité. En fait, il faut justifier à chaque

121
fois du fait qu’on ne peut pas le faire, ça va choquer les français »
Chai4xB2 « La tendance est d’adapter au public français le plus
possible. Même si un format a bien marché à l’international, on va
chercher à l’adapter encore plus pour la France »
Chai4xB2 « On l’a adapté pour correspondre au public français »
Prod2xB2xC3 « Notre travail au service développement de
Fremantle, c’était d’identifier les formats qui pouvaient peut-être être
adaptables en France, identifier les chaines pour lesquels c’était
adaptable »
Prod2xB2 « il y a un gros travail par rapport à la longueur de
l’émission […] donc il faut trouver des mécaniques qui soient
suffisamment importantes pour qu’on puisse remplir ces 52 minutes,
par exemple »
Prod2xB2 « Quand on fait une addition, on la dépose, et ensuite on
va acheter cette addition quelque part. C’est un véritable commerce,
donc toute innovation peut se déposer et être adaptée »
ProdChai2xB2 « J’ai envie de dire que les jeux, c’est ce qu’il y a de
plus international. Généralement, pour les jeux, un gros format
comme Qui Veut Gagner Des Millions, Money Drop, on ne bouge
absolument rien d’un format qui fonctionne »
ProdChai2xB2 « aujourd’hui on est souvent dans un gros copié-
collé »
ProdChai2xB2 « L’adaptation va vraiment se faire point par point, il
ne va pas y avoir d’élément différenciant »
ProdChai2xA3xB2 « Baby Boom, qui est un format anglais au
départ, il y a eu un gros travail d’adaptation. Le but c’était de ramener
ça à quelque chose de moins cru, de plus raconté, de plus thématisé,
de plus poétique, autour de la joie d’être parents et ainsi de suite »
ProdChai2xA3xB2 « En fait en téléréalité, il y a souvent un gros
travail d’adaptation. Il faut sortir des codes. Dans le reste du monde,
un Big Brother, c’est un Big Brother. On assume le fait de filmer, ils
assument complètement le fait de les regarde vivre. Nous en fait, on
ne fait jamais ça, on dit que s’ils sont enfermés, ce n’est pas pour les
regarder vivre, c’est pour vire une aventure, une expérience. Et
généralement, ce que la chaine nous demande toujours, c’est la
promesse. « Pourquoi on leur fait faire ça ? », il faut toujours qu’il y ait

122
une réponse. »
ProdChai2xB2 « ils ont revu le fond, le dépassement de soi, le fait de
vouloir gagner, montrer qu’ils sont positifs, ça a marché tout au long
de la saison, les gens sont de plus en plus venus, et maintenant ça
marche de mieux en mieux car ils ont un casting de plus en plus fort,
une mise en scène de plus en plus forte, et un rendu incroyable »
Adaptation (B3)
Prod1xB2xB3 « le format doit être adapté aux standards télévisuels
français »
Chai2xB3 « soit on change le concept et du coup, ça ne va pas être
la même émission, et c’est une possibilité »
Chai3xB3 « Le reste c’est de la création de numéro. […] C’est une
success story en termes d’adaptation, de vraie adaptation j’entends »
Chai3xB3 « il y a aussi des programmes qu’on adapte complètement
dès le début »
ProdChai1xB3 « Il y a très peu de création en France, on est assez
frileux pour lancer des nouveautés, des choses qui n’ont jamais
existé »
ProdChai1xAxB3 « Maintenant c’est vrai qu’on reste dans une
chaine « frileuse » de toute manière, et à cause de notre charte, on va
très peu sur des créations. On travaille, les équipes artistiques chez
TF1 travaillent beaucoup là-dessus, mais c’est vrai que le public
français est très compliqué »
Chai4xB3 « où on va créer des formats, comme La Meilleure Danse
par exemple qui était une création M6, Ice Show, qui est une
création »
Prod2xB3 « et aussi créer de nouveaux formats et de nouvelles
émissions »
Prod2xB3 « On avait aussi toute une partie pas exactement
d’adaptation, mais d’émissions qui pouvaient trouver une résonnance
en France ; ce n’était pas forcément pour acheter le format »
Prod2xA2xB3xC3 « c’est pour ça qu’il y a énormément de créations
de jeux sur France Télévisions par les boites de production, parce
que souvent les mécaniques internationales ne vont pas forcément
correspondre aux missions de service public et aux contraintes du
service public »

123
Prod2xB3 « Il faut savoir qu’en France on est extrêmement frileux, et
que la France n’est pas un pays dans lequel on crée des formats. En
fait il y a des formats qui sont créés en France, on ne va pas le
négliger, mais ce n’est pas un pays créateur. […] Pourquoi ? Parce
qu’en France nos diffuseurs sont beaucoup plus frileux, et ça
s’applique dans tous les domaines »
Prod2xC3 « Les diffuseurs eux-mêmes le disent, quand on vient avec
un format, ils veulent qu’on leur montre que le format a marché
ailleurs. Si on vient avec un format qui n’a jamais été testé avant, qui
est tout neuf, ça leur plait beaucoup moins »
Choix des
formats
(C)
Audiences et
performance
(C1)
Prod1xC1 « ils vont faire des sondages »
Chai1xC1 « dans un premier temps on analyse les audiences à
l’étranger, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas »
Chai1xC1 « Je pense qu’il y a là une question de feeling, une
question de performance »
Chai1xC1 « c’est le poids de la marque à l’étranger et les bonnes
audiences. Après, il faut nuancer ce terme de « bonnes audiences »,
ce n’est pas forcément de bonnes audiences dans tous les pays »
Chai2xC1xC3 « On regarde ces formats, si les audiences sont
bonnes, et on essaye de voir si elles ont un potentiel pour TF1 ou
pour une des chaines du groupe »
Chai2xAxC1 « Un programme qui marche bien à l’étranger, il ne
marchera pas forcément en France. […]La seule vraie règle, c’est que
quand ça marche partout, normalement ça marche aussi en France »
Chai3xBxC1 « d’analyser les audiences des différentes émissions
pour déterminer si ça marche ou non, ce qu’il faut changer ou
garder »
Chai3xC1 « on regarde si ça marche à l’étranger, en particulier aux
Etats-Unis et en Angleterre »
Chai3xAxC1 « Si c’est un gros format, repris par plein de pays, et qui
fait une bonne audience dans des territoires similaires comme
l’Angleterre ou les Etats-Unis, il n’y a pas de raison que ça ne marche
pas chez nous »
ProdChai1xC1 « être très vigilant sur ce qui se fait à l’étranger, il y a
une véritable veille nationale et internationale »

124
ProdChai1xC1 « parfois il y a des formats qui ne marchent pas à
100% mais on essaye quand même car il y a quelque chose qui se
passe, il y a un feeling »
ProdChai1xC1 « Au niveau du choix, ça va être les audiences à
l’étranger »
Chai4xC1 « Et le problème, c’est que des fois, quand quelque chose
cartonne à l’étranger, on est très facilement tenté de l’adapter, même
si on se dit que ça ne marchera pas »
Public ciblé (C2)
Prod1xC2 « jeunes de 15-25 ans, qui sont extrêmement actifs sur les
réseaux sociaux et sur Twitter en particulier, urbains pour la plupart »
Prod1xAxC2 « je pense qu’il y a aussi une volonté de diversification
avec les contenus qui s’orientent davantage vers les ménagères de
25 à 50 ans »
Prod1xC2 « aujourd’hui les émissions sont tellement pointues
qu’elles vont toucher un public cible mais pas forcément le reste »
Prod1xC2 « les boites de production comme AB ne cherchent pas
une émission qui va plaire à tout le monde, mais plutôt plusieurs
émissions qui vont toucher les 15-20, les 20-25, etc. »
Chai1xC2 « ce sont les moins de 35 ans qui sont visés par les
émissions standardisées. Pour les émissions standardisées adaptées,
ce sont les ménagères. […] Par contre les divertissements adaptés,
comme The Voice, c’est fait pour tout public, pour les petits et les
séniors »
Chai1xC2 « le public de la téléréalité et le public des divertissements
sont deux segments différents, et méritent donc d’être distingués »
Chai2xC2 « on vise tous les publics mais pas forcément tout le
temps »
Chai2xC2 « La télé d’enfermement pure et dure, comme Secret
Story, c’est plutôt pour un public jeune. Après, ça s’adresse aussi à la
ménagère. Ce qui est sûr, c’est qu’après il y a un âge où on bascule
en-dehors de la cible, mais quel âge ? »
Chai2xC2 « Après si on prend quelque chose de plus large comme
L’Amour Est Dans Le Pré, est-ce qu’on va considérer que c’est de la
téléréalité, c’est la première question, et les sujets sont plus mixes,
donc ça va parler à un public un peu plus élargi, et les thèmes vont

125
aussi être plus adultes »
Chai3xC2 « Il va falloir répondre aux attentes des spectateurs, mais
aussi choisir des formats qui correspondent aux différents moments
de diffusion »
Chai3xC2xC3 « Donc le choix des programmes, il dépend aussi de la
chaine, car chaque chaine a un public particulier, et à une heure
particulière va correspondre un certain type de programme qu’on va
chercher à mettre »
Chai3xBxC2 « On voit de tout, au niveau de l’adaptation ou non-
adaptation. Je pense que ça va dépendre des cibles et qu’on ne peut
pas le quantifier »
Chai3xC2 « Nous chez TF1, on est condamnés à viser le plus large
possible, donc il faut que le programme s’adresse à tout le monde.
Après pour les divertissements télévisés de ce genre, ça va être un
public de moins de 50 ans, et principalement les femmes. Après, en
téléréalité, le cœur de cible ce sont les femmes de 15-24 ans, et par
extension les 15-24 ans, et encore par extension les 15-35 ans.
Certaines émissions visent la RDA qu’avant on appelait « ménagère
» »
Chai4xC2 « Les personnes qui regardent la télévision au global, ce
sont les retraités. […] Et la téléréalité, par définition, ce sont les
jeunes : les 15-34 ans »
Chai4xC2 « Certaines téléréalités vont permettre d’augmenter un peu
le public plus âgé »
Prod2xC2 « Chaque émission a son public. De manière générale, les
jeux touchent plutôt le public familial, les femmes, ce qu’on appelle la
« responsable des achats » même si certains emploient encore le
terme de « ménagère » »
Prod2xC2 « Pour ce qui est de la téléréalité, c’est très variable [le
public visé] »
Prod2xC2 « Le public français est très complexe. En plus, on est
dans une période où le public français change énormément »
Prod2xC2 « on n’a que des vieux qui regardent la télévision »
Prod2xC2 « quand on regarde le nombre de jeunes qui regarde la
télévision, il a chuté […] car maintenant ils vont vers l’ordinateur »
Prod2xC2 « on se retrouve face à un public qui est vieux »

126
ProdChai2xC2 « à chaque type de programme, téléréalité,
divertissements ou jeux, ce ne sont pas les mêmes typologies »
Spécialisation et
image des
chaines (C3)
Chai1xC3 « chaque chaine a une spécialité »
Chai1xC3 « Un programme, ça constitue l’image de marque de la
chaine, donc on ne peut pas faire n’importe quoi »
Prod1xA3xC3 « aujourd’hui les spectateurs ont le choix et je pense
que c’est pour ça aussi que les chaines proposent des offres aussi
diversifiées »
Chai1xC3 « Le profil d’un programme ne dépend pas que d’un
programme, mais aussi de la chaine sur laquelle il est diffusé »
Chai2xC3 « il y a beaucoup de nouveautés, il y en a qu’on évacue
car elles ne correspondent pas à la ligne éditoriale de TF1, même si
elle n’est pas figée et qu’on peut toujours faire rentrer des choses qui
a priori n’avaient pas l’air d’être dans la ligne éditoriale de TF1 »
Chai2xC3 « Le premier filtre de TF1 c’est « est-ce que ça peut
intéresser tout le monde ? ». Si c’est trop segmentant, il y a un
problème »
ChaixC2xC3 « D’ailleurs on peut voir, sur la plupart des chaines de la
TNT, que ce sont des chaines jeunes qui ont des formats jeunes »
Chai2xAxC3 « il y a des flux que je ne considère pas pour la France
ou, du moins, pour TF1 »
Chai2xC3 « qui pourrait fonctionner peut-être sur les services
publiques mais pas chez nous »
Chai2xA3xC2xC3 « les émissions, elles doivent cadrer avec des
besoins de la grille des programmes de TF1 en l’occurrence, et on les
choisit aussi en fonction de terrains thématiques qu’on a envie
d’explorer parce qu’on pense qu’ils peuvent correspondre au goût et
aux attentes de notre public »
Chai3xC3 « Chez TF1, on est obligés de choisir des programmes qui
conviennent au plus grand nombre, car on reste une chaine
généraliste, contrairement par exemple à NRJ12 »
Chai3xC3 « N’importe quoi ne va pas n’importe où »
Chai3xC3 « Pour certaines chaines comme NRJ12, la cible première
ce sont les gens qui regardent la téléréalité. Pour TF1 c’est plutôt un
cœur de cible. Après, on va être obligés de prendre des fluxs de plus

127
en plus spécialisés car c’est ce qui se fait de nos jours, vu que l’offre
est de plus en plus importante, mais comme je l’ai dit, TF1 c’est une
chaine généraliste, donc on va rester dans du contenu accessible à
tous »
ProdChai1xC3 « Pour la partie jeux, qui est particulière, on a une
véritable charte éditoriale chez TF1, c’est-à-dire qu’on ne choisit pas
n’importe quel format »
Chai4xC3 « Le choix dépend vraiment de chaque chaine. Chaque
chaine va rechercher un format très particulier. Tout ce qui va
intéresser M6 ne va pas forcément intéresser TF1. […] Ce n’est pas
du tout les mêmes produits en fonction des chaines »
Chai4xC3 « En fait TF1 est vraiment une chaine large, qui vise tout le
monde. Pour résumer, ils visent tout le monde. Ils vendent leurs
écrans publicitaires sur la ménagère, même si ça commence à être
un peu moins le cas, mais c’est toujours le cas, mais pour autant ils
doivent afficher une puissance »
Chai4xC3 « Donc pour TF1, il faut pouvoir séduire tout le monde,
c’est très important pour eux »
Chai4xC3 « Chaque chaine va avoir son propre public »
Prod2xC3 « elles vont d’abord voir ce que le format peut apporter à la
chaine, s’il correspond à l’image de la chaine, et comment cela peut
s’articuler dans une grille de programmation »
Prod2xC3 « on savait qu’ils étaient capables de faire des choses qui
étaient biens, donc qui correspondaient à l’image de TF1 »
Prod2xC3 « Parfois il y a plein de choses auxquelles on pense pour
une certaine chaine, et ça ne marche pas pour une autre […] ça ne
correspondait pas à l’image de la chaine »
ProdChai2xBxC3 « ils vont visionner les programmes et en identifier
certains, et qui vont les soumettre en interne pour savoir si on va les
proposer à la chaine lors du brief ou non »
ProdChai2xC1xC3 « du côté de la chaine, il y a la même cellule mais
qui s’appelle « veille internationale », qui va éplucher tous les formats
qui se créent à l’étranger, regarder les audiences, et regarder si eux
aussi ça peut coller avec leurs attentes »
ProdChai2xC3 « Globalement, quand on propose un format à une
chaine, c’est parce qu’on se dit que ça passe sur la chaine. Chaque

128
chaine est supposée incarner des valeurs, ou du moins les
promouvoir »
ProdChai2xC3 « ça a continué de marcher mais c’était trop négatif
par rapport aux valeurs de la chaine, ça ne pouvait plus continuer »
Contrats (C4)
Chai1xC4 « il y a aussi parfois des questions contractuelles […] on
est peut-être obligés de leur acheter des programmes étrangers »
Chai2xBxC4 « Il y a déjà une première règle, qui est la latitude qu’on
a sur le format. Le meilleur exemple, qui date un peu mais qui pour le
coup est très bon, c’est Qui Veut Gagner Des Millions. Cette
émission, qu’on la regarde en France, en Italie, au Japon, c’est un
peu partout pareil. À un moment au début, je me rappelle que c’était
compliqué d’avoir une animatrice plutôt qu’un animateur, qu’il fallait
que l’animateur soit dans une certaine tranche d’âge, c’était très
réglementé. Ça s’assouplit après, ça c’est bien au début quand ça
marche très bien de ne pas changer la mécanique, mais cette
mécanique a fini par changer dans plein de pays ; mais au début
c’était vraiment très charté »
Chai2xBxC4 « il y a le producteur et le distributeur qui vont être plus
ou moins souples et qui peuvent déterminer que leur format, il est
comme ça, et quand on l’achète on ne pourra pas changer grand-
chose. Il y en a où on peut acheter un concept où il y a une grande
marge d’adaptation, ça c’est de la négociation »
Chai3xC4 « [adapter complètement ou non une émission], ça va
dépendre de la marge de manœuvre que la production nous a laissé
lors des négociations »
ProdChai1xC4 « Eux [les producteurs], viennent avec des idées et
des contraintes qui sont de respecter le format original, ou en tout cas
qui sont en accord avec leurs négociations avec les ayant-droits »
Chai4xC4 « quand c’est en externe, il y a des contrats à respecter »
ProdChai2xB2xC4 « un format c’est charté, et on n’a pas le droit de
toucher au décor ou à quoi que ce soit »
Concurrence
(C5)
Chai1xC5 « le choix d’un flux se fait aussi par la concurrence »
Chai2xC5 « Je pense qu’on a des pays qui sont structurés
différemment, des pays ont une offre dans certains domaines qui est
déjà très riche donc un nouveau format ne marcherait pas chez eux
alors que chez nous le même format aurait l’attrait de la nouveauté,

129
ou quelque chose qu’on n’a pas fait qui aurait un aspect positif, et à
l’inverse il y a des choses qu’on a déjà fait ici et qui ne fonctionnent
plus trop, mais qui marcheraient bien à l’étranger »
Chai2xC5 « il y a des choses à un moment T, on sent que ça marche
et que c’est dans l’air du temps, on regarde comment c’est chez les
autres, on voit que ça marche »
Chai3xC5 « nous quand on a vu ce programme arriver sur le marché,
il a fallu qu’on se positionne, comme tous nos concurrents, pour
l’avoir »
Chai3xC5 « Après, le but de TF1, c’est d’avoir des programmes forts,
comme avec 4 Mariages Pour 1 Lune De Miel, on cherche à avoir un
Access puissant »
Coût (C6)
Chai1xC6 « Et un programme en plus ça a un coût, qui est très élevé,
et on ne peut pas se permettre de lancer quelque chose qui va
choquer »
ProdChai1xC6 « Après, généralement, on n’a pas le même budget
que les américains, leurs budgets font rêver, et en termes de studio et
de décors ils n’ont pas du tout les mêmes contraintes que nous, on
n’est pas du tout dans la même économie »
Chai4xC6 « Ce sont des produits qui coûtent très cher, et que M6 n’a
pas les moyens de produire. Par exemple, M6 a refusé The Voice, car
c’était trop cher »
Chai4xC6 « Mais en France, si le programme ne marche pas, on est
partis pour un an »
Chai4xC6 « les Etats-Unis, Big Brother, c’est un prime par semaine.
Donc si ça se plante, ma foi, c’est une heure, ce n’est pas très grave,
même si c’est cher. Nous, si ça se plante, c’est une catastrophe »
Chai4xC6 « Sauf que quand on déprogramme une émission comme
ça, ça veut dire déprogrammer des heures et des heures en
quotidienne, en prime, ça a un coût financier énorme »
Prod2xC6 « Maintenant, on assiste de plus en plus avec les talk
shows à des programmes qui se terminent tôt. La télé coûte cher, et
donc on coupe les coûts »
ProdChai2xC6 « les gros formats réduisent tout de suite le champ,
on sait très bien que potentiellement il n’y a que deux chaines qui

130
peuvent se payer un gros format »

131
C. Questionnaire
Le questionnaire suivant a pour vocation de mieux connaître les habitudes du public français
en matière de visionnage d’émissions de divertissement, et d’étudier le profil du public propre
à chaque type d’émissions (téléréalité, variété, jeux…).
Il prend environ 5 minutes, et est anonyme. Les données traitées serviront à l’analyse du
marché lors de la rédaction d’un Mémoire de Master.
Merci pour votre participation.
Profil
Sexe :
o Homme o Femme
Âge :
o 15-25
o 25-35
o 35-45
o 45-55
Situation professionnelle :
o Etudiant
o Actif
o Au foyer
o Chômeur
Fréquence de visionnage de télévision (en moyenne) :
o Moins d’1 heure par jour
o Entre 1 et 3 heures par jour
o Entre 3 et 4 heures par jour
o Plus de 4 heures par jour
Habitudes de visionnage
en matière d’émissions télévisées

132
Parmi les émissions suivantes, quelles sont les émissions de divertissement que vous
regardez/avez regardé plus de 2 fois ?
o Pékin Express
o Koh-Lanta
o Total Wipeout version française
o Total Wipeout version US
o Première compagnie
o Le pensionnat
o Mon incroyable fiancé
o L’île de la tentation
o Opération séduction
o Bachelor, le gentleman célibataire
o Love and Bluff
o L’amour est aveugle
o L’amour est dans le pré
o Séduis-moi si tu peux
o La Belle et ses princes presque
charmants
o Coup de foudre au prochain village
o Age of love : génération séduction
o Popstars
o À la recherche de la Nouvelle Star
o The Voice
o X Factor
o La France a un incroyable talent
o Pop job
o The biggest loser : le grand perdant
o Les déménageurs de l’extrême
o Démoniaques
o Face off
o Gueules noires
o Howie vous piège
o Miami ink
o Paris Hilton : une amie pour la vie ?
o Péril en haute mer
o Projet haute couture
o Les vraies housewives
o Top Chef version française
o Top Chef version US
o MasterChef
o Cauchemar en cuisine
o Un dîner presque parfait
o Hell’s kitchen
o Loft Story
o Secret Story
o Dilemme
o Carré Viiip
o La ferme célébrités
o Je suis une célébrité, sortez-moi de
là !
o Top Model
o Danse avec les stars
o Zéro de conduite
o Relooking extrême
o Splash : le grand plongeon
o Gloire et fortune
o Pimp my ride version française
o Pim my ride version US
o Le convoi de l’extrême
o Ma maison de star
o The moment of truth : le prix de la
vérité
o Bad girls club
o La beauté et le génie : beauty and the
geek
o Cops
o Loveloosers : les apprentis séducteurs
o Queer eye

133
o Rock of love
o Pêcheurs d’or
o Trois vœux
o Tu crois que tu sais danser
o Sister wives
o Top coiffure
Pourquoi regardez-vous ces émissions ?
o Pour me divertir
o Pour apprendre des choses, me
documenter
o Car elles me font rêver
o Pour leur fonction sociale
(visionnage avec des amis/en
famille et commentaire)
o Autres :

134
Résumé du Mémoire et mots-clés
Dans le contexte actuel de globalisation des marchés, les entreprises se doivent de
s’adapter à la diversité culturelle à laquelle elles sont confrontées. Il leur faut pour cela
connaître leurs clients ou consommateurs, et de suivre une stratégie produit et
communication adaptée aux secteur et aux principaux objectifs de l’entreprise. Trois
principales stratégies se proposent alors aux entreprises : la stratégie de standardisation
(ou marketing global), la stratégie d’adaptation (ou marketing local) et la stratégie de
standardisation adaptée (« glocalisation »).
Ce Mémoire de Master a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à la
problématique suivante : « Dans quelle mesure faut-il intégrer les différences culturelles
à son offre ? ». Pour ce faire, il cherchera à déterminer les barrières culturelles qui
peuvent exister à l’import/export d’un produit, ainsi que leur impact sur le succès d’une
entreprise ; déterminer et comprendre les éléments qui permettent de choisir entre
l’adaptation et la standardisation de son offre dans un contexte culturel différent ;
déterminer, dans le cas d’une adaptation, les éléments que celle-ci doit prendre en
compte. Les résultats serviront à identifier, pour les entreprises souhaitant se lancer à
l’export ou à l’import dans un contexte culturel différent, les éléments qui pourront leur
permettre d’adapter efficacement leur offre. Il sera appliqué au domaine des émissions
de divertissement télévisées (téléréalité, variété, jeux télévisés, etc.).
Ce Mémoire a pour but de synthétiser ces différentes théories, et de déterminer celle qui
a été retenue dans le milieu des émissions de divertissements télévisées françaises de
façon à susciter l’adhésion du public.
Stratégie d’internationalisation, standardisation, adaptation, standardisation adaptée,
marketing global, marketing local, marketing glocal, marketing cross-culturel, barrières
différences culturelles, culture globale, culture locale, village global, valeurs culturelles,
mix marketing, télévision, téléréalité, jeux, divertissements télévisés, audiovisuel