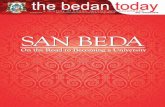Etude de l'induction de la triploïdie chez les mollusques...
Transcript of Etude de l'induction de la triploïdie chez les mollusques...
,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE PARIS-GRIGNON
Rapport de stage
ETUDE DE L'INDUCTION DE LA TRIPLOÎDIE CHEZ LES
MOLLUSQUES BIVALVES
Maitre de Stage : André GERARD
Unité de Recherche en Génétique et Ecloserie Ronce les Bains, BP 133 17390 La Tremblade
Claire CORNILLIER Septembre 1992
IFREMER Biblioth6que de Il Trembllde
1 11111111111111111111111111111111111111111 OLR 00511
SOMMAIRE
1. -INTRODUCTION ................................................................................................................... 2
2. -PROGRAMME DE CyTOGENETIQUE .................................................................................. 5
2.1 . -Objectifs .......................................................................................................... 5
2.2. -Enjeux socio-économiques et scientifiques ...................................................... 5
2.3. -Bases scientifiques .......................................................................................... 5
2.4. -Programme ..................................................................................................... 6
2.5. -Partenaires et coopérations internationales ..................................................... 6
3. -MATERIELS ET METHODES ................................................................................................ 8
3.1. -Production de phytoplancton ........................................................................... 8
3.2. -Origine,maintien et maturation des géniteurs ................................................... 8
3.3. -Ponte .............................................................................................................. 8
3.3.1. -Stimulation des géniteurs .................................................................... 9 3.3.2. -Prélèvement des gamètes .................................................................. 9
3.4. -Induction de la triploïdie .................................................................................. 9
3.4.1. -Principe .............................................................................................. 9 3.4.2. -Traitement à la cytochalasine B .......................................................... 12 3.4.3. -Traitement au 6-DMAP ....................................................................... 12
3.5. -Contrôle et détermination de la ploïdie ............................................................ 15
3.5.1. -Par caryologie .................................................................................... 15 3.5.2. -Par imagerie numérique ..................................................................... 15
3.6. -Elevage larvaire .............................................................................................. 16
3.7. -Micronurserie .................................................................................................. 21
3.8. -Contrôle des performances biologiques en milieu naturel et en laboratoirre ..... 21
4. -DEROULEMENT DU PROGRAMME ..................................................................................... 23
4.1. -Résultats sur l'induction de la triploïdie ............................................................ 23
4.2. Résultats du contrôle de performance ............................................................... 23
4.2.1. Evolution des paramètres biométriques ............................................... 26 4.2.2. Evolution des paramètres biochimiques ............................................... 26
5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES .................................................................................... 31
BIBLIOGRAPHIE
2
1. -INTRODUCTION
Sur le littoral charentais, la conchyliculture revêt une importance considérable avec deux
grands bassins, le bassin ostréicole de Marennes Oléron et le bassin myticole de la baie d'Aiguillons.
La région produit chaque année en moyenne prés de 400001 d'huîtres, 80001 de moules
et 2001 de palourdes. Le chiffre d'affaire à l'exportation dépasse le milliard de francs. Cette activité
génère en Charente Maritime plus de 10000 emplois directs permanents. Ainsi par son chiffre
d'affaire et le nombre d'emplois qu'elle crée, la conchyliculture occupe la première place du secteur
primaire de la Charente Maritime.
D'autre part, si sur les zones découvrantes les possibilités d'extension sont faibles, les
marais sont eux actuellement sous exploités.
C'est dans le cadre du maintien, de l'amélioration, et du developpement de l'activité
conchylicole que la station d'IFREMER de La Tremblade trouve toute sa place.
Cette station dispose de 4 unités de recherche:
• l'Unité de Recherche sur les Ecosystèmes Aquacoles (UREA),
• l'Unité de Recherche Régionale en Aquaculture (URRA),
• l'Unité de Recherche en Pathologie, Immunologie et Génétique Moléculaire (URPIGM),
• l'Unité de Recherche en Génétique et Ecloserie (URGE)
Ces 4 unités de recherche sont regroupées en une structure unique, le Laboratoire de
Biologie et d'Ecologie des Invertébrés Marins (LABEIM).
Le stage a été effectué dans l'Unité de Recherche en Génétique et Ecloserie.
L'équipe de cette unité est constituée de :
• - 2 cadres: André GERARD et Yamama NACIRI,
• - 3 techniciens: Jean-Marie PEI GNON, Pascal PHELIPOT et Christophe LEDU,
• - 1/3 secrétaire: Yvette SIMIAN,
• - 1/2 entretien des locaux et gestion des achats: Ginette CAILLETEAU,
3
• - 1/3 comptable: Martine GRASSET,
• - 1/4 documentaliste: Yvonne FA VI NO.
L'écloserie comprend:
• - 1200 m2 de bâtiment aquacole divisé en 6 salles, une salle d'algues dans
laquelle est produit le phytoplancton, une salle de maturation, une salle d'élevage larvaire, une salle
de micro-nurserie, une salle de quarantaine, un laboratoire, une pièce d'informatique et une serre,
• - 22 points de pompage,
• - 1 station de stérilisation des eaux de rejet (schéma éclose rie IFREMER de La Tremblade).
Le Développement des recherches dans le domaine de la génétique quantitative et de la
cytogénétique des mollusques bivalves doit surtout viser l'obtention de méthodes et de produits
présentants des caractéristiques intéressantes pour la profession conchylicole. L'objectif au niveau
socio-économique est de contribuer à l'émergence de nouveaux pôles productifs créateurs ou
stabilisateurs d'emplois. Les principaux objectifs sont l'obtention de souches résistantes aux maladies,
la création de lignées ou de souches présentant de meilleures performances de croissance et de
qualité de chair, l'acclimatition de nouvelles espèces et l'hybridation pour limiter les risques liés à la
monoculture. Pour essayer de répondre à ces objectifs les programmes actuels de l'unité sont:
• sélection de souches d'huître plate résistantes aux parasitoses,
• obtention de lignées pures et recherche de marqueurs génétiques,
• introduction d'espèces nouvelles et hybridation,
• polyploïdisation des principales espèces commerciales.
Le sujet de stage, étude de l'induction de la triploïdie chez les mollusques bivalves,
s'inscrit dans le programme de cytogénétique de polyploïdisation.
i ~
1
/." ,/", ':
/" ':'. . ::
~ -';~~Ôf~i,;~i-W:!f.~J~; '~''','~'T~"\rr;A·~;'C;''!''.':T-!' '
1 ECLOSERIE IFREMER DE LA TREMBLADE
,
. .:::.~~ i~, ~·~/*~~~:~4:~:4 .. ~7:::J.' I: .. ·'.~~.f}\:!.z\ '~",',' f'~.t ']Jf.',-: .-;-1':::
" .. '~.'-. ,}.,r" .J...:\Jy'~ " '\
/
CIRCUIT HYDRAULIQUE
23 POMPES
)
~
/
,( /
/', /
/ /
BUREAUX ET LABORATOIRES
,/
''--0~~~~~U ~'I 'r",ë;o;-~~1~'~':" ~~[t ":~,f~éR,~~~~, cl, ;b]":;'. /
SALLES HUMIDES ET LABORATOIRE 1200 m2
LOCAUX TECHNIQUES
1'1 \ li ". ,; ~'~-i;~ -:1. ~ ~ '. ,.~, .;............ ,.~ ,.,{·~-.A·:"'~ ~ r . _'_ ~ . '1,F"l., .... "'1--,$-"\- . '-..... ,: ":')~:':,:' ...... ,.~.,
'-- ./
,
l'!'~" ________ _ - - - - - - - - - - - ___ 9 ________________ _
,',:,'~~~
fa., r.t:;.j.,,' I·i t:!':!:..~":."d' . d ,1'
;..;.)'''l'':.,..y:;r....>::7.,Y''" """-r: ~ '}..~ .. ~o:VA'e'.f~", ~'i:t , ~,,:~ ~
• >. ~.r",,"-' -p •. r. ~', ~.v·'::1 ~ ~,:'" ~S: .. ,.,...t:.~~;Ç.(w~~x \, ........ ""\
~,,/~·,v,..~....:';~~\:;"': --\
~é? ~/l -,
ij~ '1:'-"" ~i.t;;r: ,~ty· ,j
$:' \;";'" .f...
~ .. @;
" . ')
5
2. -PROGRAMME DE CYTOGENETIQUE (FIG 1)
2.1. -Objectifs
Les essais d'obtention de souches conchycoles performantes par polyploïdisation portent
sur les principales espèces françaises d'intérêt commercial: (anonymes, 1992)
• Crassostrea gigas (l'huître creuse),
• Ostrea edulis (l'huître plate),
• Ruditapes philippinarum (la palourde du pacifique),
• Ruditapes decassatus (la palourde autochtone).
2.2. -Enjeux socio-économiques et scientifiques
L'application des techniques génétiques de polyploïdisation aux mollusques bivalves
d'élevages est susceptible, par l'intermédiaire des écloseries, de déboucher sur la production de
populations stériles qui pourraient avoir pour avantage:
• d'améliorer les rendements (croissance et qualité),
• de mieux contrôler les risques de développement d'épizootie (populations plus résistantes aux stress),
• de permettre une commercialisation des produits conchylicoles tout au long de l'année,
• d'être un facteur de rentabilité pour les éclose ries de bivalves.
2.3. -Bases scientifiques
L'effort de reproduction chez les mollusques bivalves est prioritaire sur la croissance
somatique, il monopolise le métabolisme énergétique dès le printemps pour la gamétogénèse
induisant un retard de croissance et une modification des qualités organoleptiques de la chair (chute
du taux de glycogène). Il est notamment responsable d'une perte d'énergie de 63% chez l'huitre
Crassostrea gigas agées de 2 ans (Héral et Deslous-Paoli, 1983).
La triploïdisation est une des premières techniques de cytogénétique à déboucher sur
des applications aquacoles, surtout dans le domaine piscicole (Chevassus et al., 1984). Chez les
6
mollusques, les recherches ont surtout été menées aux Etats Unis sur plusieurs espèces :
Crassos/rea virginiea, Crassos/rea gigas, Argopee/en irridians, Haliolis diseus. Ces expériences ont
mis en évidence, notamment chez Crossos/rea gigas (Allen et Downing, 1986 ), une stérilité partielle
des individus triploïdes accompagnée d'une amélioration des performances de croissance et des taux
de survie supérieurs que ces auteurs interprètent comme étant une conséquence d'une meilleure
condition physiologique que leur confèrent leurs abondantes réserves glucidiques.
2.4. -Programme
Le programme se déroule en 3 étapes:
• mise au point de techniques de triploïdisation appliquées aux principales espèces d'intérêt commercial,
• production de populations diploïdes et triploïdes en vue du contrôle de leurs performances,
• contrôle des performances biologiques des différentes populations dans les eaux littorales françaises et en laboratoire.
2.5. -Partenaires et coopérations internationales
Les partenaires sont:
• le réseau génétique IFREMER,
• CNRS-ENSL,
Des coopérations internationales sont actuellement développées avec:
• Plymouth Marine Laboratory (Angleterre),
• Centre Océanographique de Rimouski (Canada),
• Institute of Marine and Costal Science (Etats-Unis),
• Université de Grenade (Andalousie).
7
fig.'\: PROGRAMME DE CYTOGENETIQUE
Demande de la profession 1.... 1 Exemples; Glgas aux USA conchyllcole Salmonidés en France
CONTRAINTES TECHNIQUES • Mise au point des techniques d'Induction pour chaque espèce
• Contrôle du taux de polyploïdie
dans les élevages
IFREMER 1 URGE Programme
POL YPLOIDIE
Soutfen des Réglons Poitou-Charentes
Pays de Loire
CONTRAINTES BIOLOGIQUES • Maîtrise de la reproduction et du conditionnement des géniteurs • Maîtrise des élevages larvaJres
et postlarvalres .
. ~_/
Bilan énergétique
Résistance aux maladies
Essais de production 1'" Recherches complémentaires de polyploïdes
/ , Contrôle des ~
performances , Bilan scientifique ,
IAbandon 1
non
. 1 TETRAPLOIDES 1 o~'-wo ___ IIIIIIIdI_
,..-----"
* COLLABORA nONS - Réseau génétique IFREMER - Participation du CREAA - UBO Brest
8
3. -MATERIELS ET METHODES
3.1. -Production de phytoplancton
Le phytoplancton, aliment des mollusques, conditionne, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, la croissance et la survie des élevages. Il est produit sur place, à partir de cultures
monospécifiques d'algues unicellulaires sur milieu de Conway (Walne, 1974), selon la méthode
classique: culture aseptique des souches en erlenmeyers de 500ml; ensemencements successifs de
2, 10, 20, 300 litres, dans lesquels sont atteintes, en 5 jours environ, les concentrations souhaitées,
entre 5 et 20 millions de cellules par ml selon espèce considérées. L'eau utilisée est pompée à 100m
de profondeur. Elle présente les caractéristiques chimiques de l'eau de mer. De plus, elle est limpide,
aseptique, et de qualité constante. Elle est, en revanche, riche en fer, on emploie donc de l'eau de
mer pour la production d'algues destinée à l'élevage larvaire. Les principales souches utilisées sont:
.Skeletonema costatum,
• Chaetoceros calcitrans (clône pumilum),
• Pavlova lutheri,
• Isochrysis sp.,
• Tetraselmis suecica.
3.2. -Origine,maintien et maturation des géniteurs
La période naturelle de reproduction, juin-juillet-août, étant trop courte pour les travaux
de recherche effectués dans l'écloserie, les géniteurs, fournis par des exploitations locales, sont
prélevés dès le mois de février dans le milieu naturel. Ils subissent une maturation artificiellement
dans de l'eau de mer renouvelée, à 22"C, enrichie en phytoplancton et sont nettoyés
quotidiennement, pendant une durée minimale d'l mois.
3.3. -Ponte
L'objectif est de réaliser une fécondation controlée (fécondation au moment voulu,
concentration connue des différentes gamètes pour effectuer des rapports spermatozoïdes/ovules
9
précis, vérification de l'état des gamètes ... ).Pour obtenir des gamètes, 2 méthodes actuellement sont
utilisées (planche photo 1).
3.3.1. -Stimulation des géniteurs
Des stress physiques (variations thermiques, mise à sec, augmentation de turbidité ... ) ou
chimiques (variation de pH, de salinité, injection de KCI ... ) réalisés sur les géniteurs peuvent induire
l'émission des gamètes. La ponte intervient 1 à 4h après les premiers chocs. Les ovules et les
spermatozoïdes sont récoltés séparément, et filtrés sur tamis, afin d'éviter des fécondations
incontrolées et d'éliminer des impuretés.
3.3.2. -Prélèvement des gamètes
La deuxième méthode, dite de " stripping", consiste à scarifier la gonade des animaux à
l'aide d'un scapel. Elle a pour avantage de supprimer la phase de stimulation de la ponte et celle
d'allente d'expulsion des gamètes, et qui perment d'obtenir des ovules parfaitement matures à un
stade d'évolution méïotique bien synchrone et avec l'assurance d'une absence totale de fécondations
incontrolées. Elle a pour inconvénient de sacrifier les géniteurs et donc d'en nécessiter un stock
important. Il faut noter que, d'autre part, celle technique est impossible à réaliser chez les espèces
larvipares comme Ostrea edulis.
3.4. -Induction de la triploïdie
3.4.1. -Principe
Un individu est triploïde lorsqu'il possède 3N chromosomes. Chez les mollusques, les
ovocytes sont bloqués en prophase ou métaphase de la première division méïotique. L'achèvement
de la méïose, qui se concrétise par l'expulsion de 2 globules polaires, ne peut être provoquée que par
la pénétration d'un spermatozoïde (planche photo Il).
10
PLANCHE PHOTO 1
1- Spermatozoïdes.
2- Ovules non fécondés à vésicule genninative (VG) centrale visible.
3- Expulsion d'un globule polaire (GP) après fécondation.
4- Formation du lobe polaire (début du stade 2 cellules).
5- Stade 2 cellules.
PLANCHE PHOTO II
1- Ovule non fécondé.
2- Ovule fécondé (présence d'un spermatozoïde SPZ).
3- Condensation du génome maternelle.
4- Expulsion du premier globule polaire (GPI)
ô génome paternel
ç génome maternelle
5- Expulsion du deuxième globule polaire (GP2), avant caryogamie.
6- Fonnation du lobe polaire (LP). Anaphase de la première division mitotique.
11
12
L'induction de la triploïdie est actuellement obtenue par rétention d'un des deux globules
polaires en soumettant les oeufs, quelques minutes après la fécondation, à des chocs physiques
(température, pression) ou à un traitement chimique (fig.2).
La technique d'induction chimique à la cytochalasine B, et plus récemment, au 6 DMAP
a été retenue (Desrosiers et al, soumis). L'efficacité dépend de la concentration, de la température,
de la durée et du moment d'application du traitement. Ces paramètres qui sont fonction de la biologie
et du développement embryonnaire doivent être déterminés pour chaque espèce (fig.3).
3.4.2. -Traitement à la cytochalasine B
Les cytochalasines résultent du métabolisme de certains chàmpignons. Elles modifient le
degré de polymérisation des molécules d'actine en empêchant leur addition aux filaments, sans
toutefois inhiber la mitose. Appliquées avant l'expulsion d'un des deux globules polaires, elles
désorganisent simultanément le réseau de filaments qui permet la migration des chromosomes et
l'anneau fibrillaire qui opère normalement une constriction du fragment cytoplasmique constituant le
globule polaire.
Le traitement appliqué est adapté de la méthode de Downing et Allen (1987). Il utilise la
cytochalasine B (CB), qui est un produit dangereux, cancérigène, tératogène et couteux (60000F/g). Il
comporte 2 étapes, l'immersion des oeufs dans une solution de CB puis un rinçage dans une solution
de DMSO (diméthylsulfoxyde). La CB, dissoute dans du DMSO à une concentration de 1 mg/l, est
mise en contact avec les oeufs pendant 15min, qui sont recueillis ensuite sur un tamis de 1IJm et
rinçés.Les oeufs sont placés dans un bain de DMSO de 0.1 % durant 20min afin de les débarasser de
la CB résiduelle, puis en incubation dans un bac de 30 litres.
3.4.3. -Traitement au 6-DMAP
Le 6-diméthylaminopurine (6-DMAP) ne perturbe pas la synthèse des protéines mais
seulement l'activité phosphorylatrice (Néant et Guerrier, 1988) des protéines kinases, entraînant ainsi
la décondensation de la chromatine; les chromosomes métaphasiques donnent alors des noyaux au
repos et le fusEjau 'est détruit par dépolymérisation de la tu bu Ii ne.
,1
OVOCYTE
Fig. : Induction de la triploïdie chez les mollusques bivalves
FECONDATION O::Pl..A.SION GP1 EXPV..s'ON GP2 CARYOQA.MIE
~H {:H)CuGJ8 DIPLOIDE
~H C:0cv~fj~) TRIPLOIDE PAR RETENTION DU GP1
G~)Czj TRIPLOIDE PAR RETENTION DU GP2
GPl : Premier globule polaire GP2: Second globule polaire
/
13
1ereDfIItS.K>N
iH
H+
rH
w <!l ~ Z W Ü cr: ::;) o 0.
w <!l
~ z w Ü cr: ::;) o 0.
w <!l ~ Z W Ü cr: ::;) o 0.
Crassostrea gigas Développement embryonnaire à 18"C
lOOT'----------------~~~' .. H.,.L·~·H-H .. -.... -./-... -.~-.-::-.... -ru
'-'._, ... 90" o GPl
80 '" GP2 70-1························· • 60-1············ 1
2cel
l:/H~r·· /-/.
o 10 20 3J 40 50 00 70 80 90 TEMPS POST-FECONDATION (min)
100 110
Crassostrea gigas Développement embryonnaire à 20"C
l00T'--------------------------------------, •
90 j ........................................ . 8(lHH. / 07"
:L:l·~2?CHL. 50-1·········
40
30"··
20 •
10 .. ··················
i ....................................
...............
......... , ....... :
01 , , ? , , , • , , , 1 o 10 20 3J 40 50 00 70 80 90 100 110
TEMPS POST-FECONDATION (min)
Crassostrea gigas Développement embryonnaire à 25"C
... GPl
'" GP2
• 2CB!
1 :lH.HHHH.Hl~.~HHH.. .HHHj ~ -e-
GP2
---................... , 2 Cel.
-+-
4 CeL
o 1 '/, eS' , ,.t., ,.,c , , , , 1
o 10 20 3J 40 50 00 70 80 90 100 110
TEMPS POST-FECONDATION (min)
1 14
15
Le traitement est appliqué selon le protocole de Gérard (1991) avec une concentration
de 300 fJMII administrée 15min après la fécondation pendant 20min.
L'avantage de ce produit par rapport à la CB est qu'if pourait être moins dangereux, qu'if
coûte moins cher et que son effet est réversible: il suffit en effet de laver les oeufs avec de l'eau de
mer pour que les protéines se rephosphorylent, que les chromosomes se recondensent, et que les
microtubules se reforment.
3.5. -Contrôle et détermination de la ploïdie
Un des principaux problèmes de la méthode chimique d'induction de la triploïdie est le
résultat partiel de la polyploïdie. Une détermination de la ploïdie des individus ou du pourcentage de
triploïdes dans les lots obtenus après manipulation et élevage est donc nécessaire. Deux méthodes
existent, la première longue et ne pouvant être effectuée que sur des larves, a été remplacée
récemment par la deuxième plus rapide et adaptable à tous les stades de la vie de l'animal.
3.5.1. -Par caryologie
Les jeunes larves trocophores sont immergées 4h après la fécondation dans une solution
de colchicine (0.2g/1 d'eau de mer) pendant 2h afin de bloquer les chromosomes en métaphase. Un
choc hypotonique (eau de mer/eau douce: 1/3) de 20min induit un gonflement des cellules qui permet
de mieux distinguer les chromosomes. Les larves sont ensuite fixées dans 3 bains sucessifs de
Carnoy (éthanol/acide acétique: 3) à 4 'C. Les cellules embryonnaires sont dissociées par agitation
pendant 10min dans de l'acide acétique dilué à 50% et déposées sur une lame préchauffée à 45'C
environ. Enfin les lames sont colorées 10min par une solution de Giemsa (4%) à pH 7 (tampon
phosphate). L'observation microscopique permet de compter le nombril de chromosomes sur 50
métaphases prises au hasard.
3.5.2. -Par imagerie numérique
La technique d'analyse de la ploïdie chez les Mollusques bivalves par imagerie
numérique a été mise au point par Gérard et al. (1991). Deux protocoles existent en imagerie
16
numérique: l'un effectué sur des individus par l'intermédaire d'une empreinte branchiale (figA) et
l'autre sur des populations cellulaires (fig.5 et 6). Dans ce dernier cas, il est nécessaire d'avoir des
cellules bloquées au même stade de synthèse d'ADN. Pour qu'il en soit ainsi, on utilise un
antimitotique, l'aphidicoline, à une dose de 5Ilg/ml.
L'analyseur d'image, composé d'un microscope, d'une caméra et d'un micro-ordinateur
(fig.7) est un appareil de mesure photométrique qui permet de déterminer le degré de ploïdie suivant
la quantité d'ADN (Gérard et al. 1991/b). Les noyaux des cellules sont colorés par la réaction de
Feulgen Rosaniline. L'hydrolyse acide des ponts ribose-purine de l'ADN donne des résidus aldéhydes
qui, réagissant spécifiquement avec le réactif de Schiff, donnent une coloration rose. La densité
optique que mesure l'analyseur sera d'autant plus importante qu'il y aura d'ADN. L'analyseur donne le
rapport de la densité optique intégrée existant entre le témoin diploïde et le sujet étudié. Ce rapport
est de 1 si l'animal est diploïde de 0.5 s'il est haploïde et de 1.5 s'il est triploïde.
3.6. -Elevage larvaire
Les oeufs, environ 100 par ml, sont incubés à 25°C dans des bacs cylindro-coniques de
30 litres remplis d'eau de mer filtrée à 11lm et légèrement agitée par un bullage à la base. Au bout de
24h, les larves nageuses sont recueillies sur un tamis de 451lm et comptées afin:
• d'ajuster les lots à une concentration de10 larves par ml,
• de chiffrer le taux d'éclosion,
• de dénombrer éventiellement le taux de larves anormales (planche photo III).
Celte opération, répétée tous les 2 jours, s'accompagne d'un contrôle de croissance, et
de survie, jusqu'au transfert en nurserie. A chaque renouvellement d'eau, un antibiotique
(chloramphénicol) est ajouté, pour limiter le développement bactérien.
L'alimentation phytoplanctonique, généralement obtenue par mélange de 3 espèces, est
donnée quotidiennement à des concentrations de 20 celluleS/ill par espèces.
Figure 4- Contrôle de la ploïdie sur individus adultes. Individu diploïde en haut, tri.ploïde en bas.
17
Référence externe : ATD1 (1. 00)
Nombre de cellules 120
96
72
48
24
oL c 4c 6'c
Référence interne
Nombre de cellules 50
40
30 .
20
10 .
oL~ , , 2c 4c 6c
Echantillon analysé A42 1 ATD1 (1.00)
Indice ADN (lA)
% de cellules 60
50
40
30
20
10
0 2c 4' c {;::---Tc--lô c
Nombre de cellules analysées
Degré de ploïdie (DP) Degré Q'hyperploïdie (DH) Indice de prolifération (IP)
56
100.0 % 0.0 % O. 0 % (NU 1)
L __ .. ____ . --'-- . ___ _
Référence externe : ATDl (1.00)
Nombre de cellules 120
96
72
48
24
0L--Référence interne
Nombre de cellules 50
40
30
20
10
c
o , , , 2c 4c 6c
/
.. _.- .. _----,
Echantillon analysé
Indice ADN (lA)
A43 1 ATDl (1.00)
% de cellules 70
60
50
40
30
20
10
o l , 2c 4c bc
Nombre de cellules analysées:
Degré de ploïdie (DP) Degré d'hyperploïdie (DH) Indice de prolifération (IP):
45
-100.0 % 0.0 % 0.0 % (Nul)
! ,
l
Figure 5 Analyse d'une population cellulaire.
Référence externe : t2n (1.00)
Nombre de cellules 50
40
30
20
10
o '" 2c 4'c
Référence interne
Nombre de cellules 50
40
30
20
10
0 2c 4c
6'c
6'c
Echantillon analysé
Indice ADN (lA)
~8
CB20' / t2n (1.00)
% de cellules 30
20
10
o 1 <s
c 4 c b c Nombre de cellules analysées:
Degré de ploïdie (DP) Degré d'hyperploïdie (DH) Indice de prolifération (IP):
186
-64.6 % 0.0 % o . 0 % (Nu 1)
___________ ~J
Figure 8 Décomposition en gaussiennes de la même population cellulaire.
1 Fré~~~e~c~ ~ (%)
40
30
20
10 2N 17%
3N 83%
01 ,D'1 ,YI\J ,I l,II 1 1,1'--;-., rr=l o 4000
"
8000 12000 16000 20000 24000 28000 D.O.I.
Fig . ..,: CONFIGURATION DU . SYSTEME SAMBA 2005
Camera
Microscope
Processeur de prétraitement
Moniteur
Processeur de
commande et de
gestion de l'acquisition
Moniteur
Processeur de
traitement et
d'analyse des données
Imprimante
'l' 1
. 1 1 i"
-19
21
3.7. -Micronurserie
Après une période d'environ 20 jours d'élevage larvaire, la métamorphose intervient: les
larves cessent de nager et cherchent un support pour s'y fixer définitivement. Aprés filtration sur un
maillage de 250 ~m, elles sont placées dans des tamis de 100~m dont le fond est tapissé de brisure
de coquilles et les bords paraffinés afin d'éviter leur fixation sur ce support. Tant qu'il n'a pas atteint
une taille de quelques millimètres, le naissain doit être maintenu dans un environnement contrôlé,
l'eau doit être enrichie en nourriture, chauffée à 20"C, et renouvelée à un débit d'environ 300 à 400
litres/heure.
3.8. -Contrôle des performances biologiques en milieu naturel et en laboratoirre
Ce contrôle met à contribution plusieurs unités de recherche (fig.8).
Deux sites naturels ont été retenus: La Tremblade et Ouistreham. L'URRA et le
Laboratoire Régional d'Ouistreham assurent le suivi de l'élevage, le contrôle des différents
paramètres de croissance, la mortalité, la maturation et l'analyse des les constituants biochimiques.
Le contrôle de la ploïdie est assurée par l'URGE. Une étude histologique de la reproduction est
effectuée par l'Université de Bretagne Occidentale associée à l'URGE pour le contrôle de la ploïdie.
2.'2.
Fig. 9: CONTROLE DES PERFORMANCES DES POPULATIONS DIPLOIDES ET TRIPLOIDES DE Crassostrea glgas
Contrôle des performances Contrôle des performances
dans le milieu naturel: au laboratoire:
La Tremblade - Ouistreham La Tremblade
1 1 1 1 Biométrie, Biochimie 1 1 Reproduction 1 1 Physiologie 1
1 1 1 Contrôle de la ploïdle Contrôle de la ploidie Obtention de lots diploïdes • URGE-La Tremblade • URGE-La Tremblade et triploïdes purs par
1 1 biopsie et analyse d'Images
.URGE-La Tremblade Données blométrlques : Etude histologique
• URRA La Tremblade de la reproduction: 1 • Ouistreham • Université de
Bretagne Occidentale Bilan énergétique:
1 • UREA-La Tremblade
Analyses biochimiques:
1 • URRA La Tremblade ~ ... _--
'"
23
4. -DEROULEMENT DU PROGRAMME
Par simplification et du fait de l'impact économique de l'huitre creuse dans le bassin de
Marennes·Oléron, les résultats présentés porteront uniquement sur cette espèce.
4.1. -Résultats sur l'induction de la triploïdie
L'efficacité des techniques d'induction de la triploïdie est jugé essentiellement sur la base
du pourcentage de triploïdes obtenu, de la toxicité du traitement, et de son coût. D'importantes
améliorations ont été réalisées depuis 1990. La méthode à partir du 6-DMAP semble la mieux
convenir. Actuellement, une bonne manipulation doit donner 80 à 90% de triploïdes (fig.9 et 10).
Théoriquement, la triploïdie, jouant sur le développement sexuel, ne devrait pas apporter
des modifications dans la croissance larvaire. Les résultats obtenus expérimentalement confirment
cette hypothèse (fig. Il).
En revanche, le traitement d'induction, par ses effets toxiques, semble intervenir sur la
viabilité des larves (fig.12)
4.2. Résultats du contrôle de performance
Ce contrôle, débuté en Mars 91, est donc loin d'être terminé.
Sur le site de la Tremblade, l'élevage en claire a été retenu , afin d'accélérer les
processus de première maturation, qui doivent théoriquement entraîner des différences de
performances entre les lots diploïdes et triploïdes. Sur le site d'Ouistreham, l'élevage se fait sur
l'estran. La croissance étant moins rapide sur l'estran qu'en claire, les résultats présentés ici
concernent uniquement ceux obtenus à la Tremblade. Il faut signaler que de gros problèmes
d'infrastructures ont été rencontrés; une réfection des claires a été nécessaire en cours d'expérience,
obligeant à transférer provisoirement les huîtres dans un autre site. La dégration du milieu s'est
traduite par de très fortes mortalités dans les lots diploïdes et triploïdes, et par une distorsion dans les
performances biologiques enregistrées.
(f)
'" 01 <Il
100
C '" 50 2 :J o
CL
Fig. 9 : Taux d'éclosion et pourcentage de triploïdes 1 dose de 6-DMAP
oV~/~~/~/~(l:>.~(
(f)
'" 01 <Il
100
~ 50 2 :J o
CL
o
Téfroi, 150 ).JM;I 300 I-IMA 450 }JMJ1 600 IJM;1
Doses de 6-DMAP
Fig.10: Induction de la triploïdie par le 6-DMAP et la CytochaJasine B
Témo'n 6CMAP 6CMAP cs cs 150JJM/1 300).J~Vl O.5rrçA 1 rn;J11
/
2.4
lrn€s <rerrrdes
% trÇbïdes
25
Fig. 11 ~ Elevage larvaire CG3N9117 CROISSANCES COMPAREES
350T,----------------------------------,
(j) 300 z o a: ~ 250~·····
2: z w a: :J W
200 ... ····
:J 150~ .. " C) z o -'
100~" .
50 1 j Il! 1 1 j 1 i i 1 i III i 1 i 1 IIi III Iii II 1111
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
JOURS
-+--
Témoin 2N
----3N 1 6DMAP-150
--..t.--
3N26DMAP-300
-e-
3N3 CS-0.5mg
----3N4 CS-1mg
Fig.12.: Elevage larvaire CG3N9117 MORTALITES RELATIVES f TEMOIN
"" o
z w w > a: :J (J)
100"'~
50~"
o! 1 i Iii i Iii i i Iii 1 Iii 1 i 1 1 1 Iii 1 i Iii 1 i 1
o 2 4 6 8 10121416182022 24 26 28 30 3234
JOURS
/
-A-
3N26DMAP-300
--El-
3N3 CS-0.5mg
---3N4 CS-1mg
26
4.2.1. Evolution des paramètres biomètriques
La croissance des huitres a été satisfaisante. D'un poids moyen d'environ 3.5g au mois
de février, elles ont aUeint 41g au mois de novembre pour le lot de diploïdes, et 53g pour le lot de
triploïdes. La différence entre les 2 lots n'est sensible qu'après la période estivale (fig.13).
L'évolution du poids sec de chair et de l'indice de condition (fig.14 et 15) renseigne un
peu mieux sur les différentes phases d'élevage. Les 2 premiers prélèvements, février et mars,
correspondent à la fin du prégrossissement dans l'écloserie de La Tremblade, l'indice de condition
juste avant le transfert en mer étant particulièrement élevé.
Du mois d'avril à la fin juin, les prélevements ont été realisés dans les claires. Le poids
sec de chair, qui n'évolue plus, et l'indice de condition, qui chute, sont de bons indicateurs d'un stress
nutritif. Une amorce de reprise de croissance est toutefois enregistrée à partir de la mi-juin.
C'est à partir de juillet que sont enregistrées les premières différences entre les lots
triploïdes et diploïdes. Entre juillet et novembre, l'indice de condition fluctue très peu chez les
triploïdes (entre 65 et 75). Pendant la même période, chez les diploïdes, 2 phases peuvent être
distinguées: une phase de maturation entre juillet et début août, pendant laquelle l'indice monte
jusqu'à 90, suivie d'une phase d'émission des gamètes entre le début et la mi-août durant laquelle
l'indice chute brutalement.
Les résultats histologiques de la reproduction, quand ils seront connus, permettront de
vérifier ces hypothèses, et également de voir si, chez les triploïdes, la faible augmentation de l'indice
de condition observée pendant la première quinzaine d'août, et sa diminution progressive entre
septembre et novembre, correspondent réellement à une maturation et à une vidange de produits
gamétiques, phénomène déjà signalé par Allen et Downing (1990).
4.2.2. Evolution des paramètres biochimiques
Les résultats obtenus, si l'on excepte la période de stress trophique, sont dans
l'ensemble conformes à ceux déjà connus.
Ol c Ql
Fig.13: POIDS TOTAL MOYEN 6OT,-------------------------------------------,
60"'
40"······ ................... .
U) 30"'" u o
CL 20"'"
10
o l , , , , , 1
Z1
-G-
Témoin 2N
-,ok
Triploïdes
Jan-91 Mar-91 Mai-91 Jul-91 Sep-91 Nov-91 Jan-92
Fév-91 Avr-91 Jun-91 Aoû-91 Oct-91 Déc-91
Fig.~+! POIDS SEC DE CHAIR 1.4, , 'r----------,
1.2"
Ol c 0.8"'" Ql U)
U ,) 0.6" CL
0.4
0.2"'" ...
o l , , , , , 1
-G
Témoin 2N
-,ok
Triploïdes
Jan-91 Mar-91 Mai-91 Jul-91 Sep-91 Nov-91 Jan-92
Fév-91 Avr-91 Jun-91 Aoû-91 Oct-91 Déc-91
"
2S3
Fig.15: INDICE DE CONDITION Psi (Pt-Pc) 100 1 1 ri ------,
90
BO
70~··
60~·
50
40
30 l , , , , , 1
---El-
Témoin 2N
-.0.
Triploïdes
Jan-91 Mar-91 Mai-91 Jul-91 Sep-91 Nov-91 Jan-92 Fév-91 Avr-91 Jun-91 Aoû-91 Oc\-91 Déc-91
Fig.16: TENEUR EN GLYCOGENE 200 1 il\ 1 ri ----
1 BO~··
160~··· .
140~··· Dl --- ............ ~ .. . Dl 120~······ E c 100~ ... (j)
U)
Ll o
D...
BO~
60~··· ..
40~·
20 .... ··
...• ~~ ••••••••••••.....
01 l ,,'t~, 1 1
-El-
Témoin 2N
...... -Triploïdes
Jan-91 Mar-91 Mai-91 Jul-91 Sep-91 Nov-91 Jan-92 Fév-91 Avr-91 Jun-91 Aoû-91 Oc\-91 Déc-91
/
29
On obtient un pic des teneurs en protéines pendant la gamétogénèse, aux mois de juin
et juillet. Le phénomène inverse est enregistré pendant le stress à la fin du printemps (fig.17).
Les teneurs en lipides (fig.18) ont un cycle plus normal. Les teneurs maximales, atteintes
en juillet pour les diploïdes, correspondent à la fin de la gamétogénèse, la ponte entrai na nt ensuite
une forte diminution. Les triploïdes présentent également un pic légèrement décalé au mois d'août.
les résultats de l'étude histologique devraient permettre de savoir si ce maximun doit être relié à une
activité gonadique.
Pour résister aux mauvaises conditions trophiques du printemps, les huîtres diploïdes
comme triploïdes, ont épuisé leurs réserves glucidiques (fig.16 et 19). Dès que les conditions se sont
améliorées, à partir de la mi-juin, la teneur en glycogène des huîtres triploïdes remonte rapidement
alors qu'elle reste proche du zéro pour les diploïdes pendant la phase de gamétogénèse. Ce résultat
très important confirme, qu'en absence de stress trophique, la réduction de la gonadogénèse chez
l'huître triploïde entraîne une amélioration de la qualité de la chair, qui se traduit par une teneur
élevée en glycogène. Après la ponte, les teneurs en glucides totaux et en glycogène chez les
diploïdes augmentent progressivement pour rejoindre au mois de novembre celles des triploïdes.
~ E c " ~ " "0 a.
Fig.17'; TENEUR EN PROTEINES 400 1 1 c, ----,
-G
Témoin~
-.0.
Trlplofdes
Jan-91 Mar-91 Ma/...gt Jul-91 Sep-91 NoV-9t Jan-92
Fév-91 Avr-flt Jun--91 AOÛ-91 QC[-91 OéC-91
Flg.18; TENEUR EN LIPIDES 1101 1 r'------,
100
-e
Témoin 2f\J
-.0.
Triploïdes
01 90 ... ·· ê1, E c " ~ " "0 a... 70 ... ··
(J) ~ (J)
E C
" ~ " "0 a.
/
Jan-91 Mar-gt MaHl1 Jul-91 Sep-9t NoV-9t Jan-92
Fév-91 Avr-gt Jun-91 Aoû...g1 OCt-91 OéC-91
Fig.1g; TENEUR EN GLUCIDES 250
2CO
150
100
o l, " 1
-B
Témoin 2'\j
-*Triploïdes
Jan-91 Mar-Q1 Mai-91 Jul-91 Sep-91 NoV-91 Jan-92
Fév-91 Avr-91 Jun-91 AOÛ-91 Oct-gt Déc-Ol
3l
31
5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les résultats. présentés jusqu'à présent. sont l'aboutissement des recherches menées en
1989, 1990, et 1991. Les systèmes expérimentaux ont été mis en place. Des techniques de
triploïdisation ont été acquises, et des populations de triploïdes viables produites. Un contrôle de la
ploïdie a été mis au point. Le contrôle des performances biologiques a maintenant débuté.
Désormais, les recherches sont portées, essentiellement, sur l'amélioration des
techniques de triploïdisation. L'utilisation de nouveaux produits d'induction moins toxiques et plus
économiques, comme le 6-DMAP, donne déjà des résultats. Mais la mise au point de techniques de
tétraploïdisation semble la voie la plus prométeuse. En effet, l'obtention de géniteurs tétraploïdes
viables, croisés avec des géniteurs diploïdes, serait susceptible de fournir des populations à 100%
triploïde. Le contrôle de ploïdie, jusqu'à présent obligatoire, ne serait plus systématiquement
nécessaire.
L'induction de la tétraploïdie pourrait être obtenu par:
• la rétention des 2 globules polaires précédée d'une inactivation du stock
chromosomique du spermatozoïde (tétraploïdie gynogénétique),
• la suppression de la première division mitotique (tétraploïdie endomitotique).
Diverses techniques sont essayées, traitements chimiques, chocs de pression, chocs
thermiques, électrofusion ...
Aucun individu tétraploïde viable chez les mollusques bivalves n'a encore pu être
obtenu. Mais les réussites obtenues dans le domaine piscicole, laissent espérer et croire à de belles
perspectives pour l'appplication de cette nouvelle méthode à des souches conchylicoles.
32
BIBLIOGRAPHIE
ANONYMES,1992. Cahiers d'objectifs et de programmes 1992-1995, LABEIM.
ALLEN, S.K., JR., and DOWNING, S.L., 1986. Performance of triploid Pacific oysters,
Crassostrea gigas (Thunberg). 1 Survival, growth, glycogen content, and sexual maturation in
yearlings. J.Exp.Mar.BioI.Ecol., 102197-208.
ALLEN, S.K., JR., and DOWNING, S.L., 1987. Triploidy in the Pacific oyster,
Crassostrea gigas: optimal treatments with cytochalasin B de pend on temperature. Aquaculture, 61:
1-15.
ALLEN, S.K., JR., and DOWNING, S.L., 1990. Performance of triploïd Pacific oysters,
Crassostrea gigas: Gametogenèsis. Cano J. Fish. Aquat. Sci., 47,1213-1222.
CHEVASSUS, B., QUILLET, E. et CHOURROUT, D., 1984. La production de truites
stériles par voie génétique. La pisciculture française n'78.
DESROSIERS, R.R., GERARD, A, PEIGNON, J.M., NACIRI, Y., DUFRESNE, L.,
MORASSE, J., LEDU, C., PHELIPOT, P., GUERRIER, P., and DUBE, F .. A novel method to produce
triploid embryos in bivalve molluscs by the use of 6-dimethylaminopurine. Soumis à J. Exp. Mar. Biol.
Ecolo.
GERARD, A, PEIGNON, J.M., et CHAGOT, D., 1991. Contrôle de la ploïdie par
imagerie numérique dans les expériences d'induction de la triploïdie chez les mollusques bivalves.
Congrès CIEM La Rochelle. PAPAE C. M. 1991/F: 12 Réf. K., Mariculture Committee, 6p.
GERARD, A.,1991. Obtention de souches conchylicoles performantes par
polyploïdisation (2ème partie). Rapport interne de la Direction des Ressources Vivantes de
L'IFREMER, station de La Tremblade, URGE, 37p.
GERARD, A, PEIGNON, J.M., PHELIPOT, P., NOIRET, C., BODOY, A, HEURTEBISE,
S., GARNIER, J. 1992. Obtention de souches conchycoles performantes par polyploïdisation (3ème
33
partie). Rapport inteme de la Direction des Ressources Vivantes de l'IFREMER, station de La
Tremblade, URGE, URRA, 36p.
HERAL, M., et DESLOUS·PAOLl, J.M., 1983. Valeur énergétique de la chair de l'huître
Crassostrea gigas estimée par mesure microcalorimétriques et par dosages biochimiques. Oceanol.
Acta, 1983,6,2: 193·199.
NEANT, 1. and GUERRIER, P., 1988. 6·dimethylaminopurine blocks starfish oocy1e
maturation by inhibiting a relevant protein kinase activity. Exp. Cell Res 176/68·79.
WALNE, P.R., 1974. Culture of bivalves molluscs, 50 years experience at Conway.
Fishing Nexs (books). West byfleet, 173p.