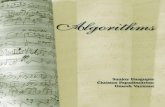economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
Transcript of economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
1/258
N I V E R S I T S F R A N C O P H O N E S
UNIVERSITES
A LB ER T O N D O O SS A
Economiemontaireinternationale
( I U P E L F - U R E F
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
2/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
3/258
CONOMIE MONTAIREINTERNATIONALE
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
4/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
5/258
ECONOM IE MONETAIREINTERNATIONALE
A lbert O N D O O S S AA grg des Facults des S ciences conomiques et de GestionProfesseur la Facult de D roit et des S ciences conomiques de L ibreville
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
6/258
E c o n o m i e m o n t a i r e i n t e r n a t io n a l eI S B N 2 8 4 3 7 1 0 2 7 8 1 99 9, d i t io n s E S T E MToute reprsentation ou reproduction, intgrale ou partielle, faite sans leconsentement de l'auteur, ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illici-te, aux termes de la loi du 11 mars 1957, alina 2 et 3 de l'article 4 1. Cettereprsentation ou reproduction par quelque procd que ce soit, constitue-rait une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du CodePnal.ESTEM ditions Scientifiques, Techniques et Mdicales7, rue Jacquemont, 75017 ParisT l . : 01 53 06 94 94 - Fax : 01 5 3 06 95 00
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
7/258
L a diffusion scientifique et tec hn iqu e est un facteur essentiel du d ve -loppement. A ussi, ds 1988, l 'A ge nc e francophone pour l 'enseignem entsuprieur et la recherche (A UPE L F-UR E F), mandate par les S ommetsfrancophones pour produire et diffuser revues et livres scientifiques, acr la collection Universits francophones.Lieu d'expression de la communaut scientifique de langue franaise,Universits francophones vise instaurer une collaboration entre ensei-gnants et chercheurs francophones en publiant des ouvrages, coditsavec des diteurs francophones, et largement diffuss dans les pays duSud, grce une politique tarifaire prfrentielle.Quatre sries composent la collection :- Les usuels : cette srie didactique est le cur de la collection. Elles'adresse un public tudiant et vise constituer une bibliothque derfrence couvrant les principales disciplines enseignes l'universit.-A ct u al it scientifique : dans cette srie sont publis les actes de col-loques organiss par les rseaux thmatiques de recherche de l 'UR E F.-Prospectives francophones : s'inscrivent dans cette srie des ouvragesde rflexion donnant l'clairage de la Francophonie sur les grandesquestions contemporaines.- Savoir plus Universits : cette nouvelle srie, dans laquelle s'inscrit leprsent ouvrage, se compose de livres de synthse qui font un pointprcis sur des sujets scientifiques d'actualit.N otre collection, en proposant un e app roche plurielle et singulire de lascience, adapte aux ralits multiples de la Francophonie, contribue effi-cacement promouvoir l'enseignem ent suprieur et la recherche dans l'es -pace francophone et le plurilinguisme dans la recherche internationale.
Pro fes s eu r M IC H EL G U ILLOUD irecteur gnral de l 'A UPE L FR ect eu r d e l ' U R EF
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
8/258
mon predcd le 28 avril 1997.
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
9/258
SOMMAIREPREMIRE PARTIE : LA BALANCE DES PAIEMENTSET LES OPRATIONS DE CHANGEChapitre 1 : La balance des paiementsSection 1 : D finition de la balance des paiementsS ection 2 : tude comptable de la balance des paiements
Section 3 : tude conomique de la balance des paiementsS ection 4 : L 'apprciation globale de la balancedes paiementsChapitre 2 : Les oprations de changeSection 1 : Le march de changeS ection 2 : L a gestion du risque de changeSection 3 : Les dterminants du taux de changeDEUXIME PARTIE : L'QUILIBRE DES OPRATIONSCOURANTESChapitre 1 : L'quilibre par les prix internationauxSection 1 : La formation des prix internationaux
S ection 2 : L a variation des prix internationauxSection 3 : Prix internationaux et termes de l'changeChapitre 2 : L'quilibre par les variations du revenu globalSection 1 : L'quilibre macroconomiqueen conomie ouverteSection 2 : L e m ultiplicateur du comm erce extrieurSection 3 : Le multiplicateur d'investissement
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
10/258
Sommaire
TROISIME PARTIE : L'QUILIBRE DES OPRATIONSEN CAPITAL ET DES MOUVEMENTSFINANCIERS
Chapitre 1 : Les mouvements internationaux de capitauxSection 1 : La morphologie des mouvements internationauxde capitauxSection 2 : Les dterminants des mouvements interna-tionaux de capitauxSection 3 : Mouvements internationaux de capitaux etentranement de croissance
Chapitre 2 : Rgime de change et O rganisation financireinternationaleSection 1 : L es rgimes de changeSection 2 : L'volution du Systme Montaire InternationalSection 3 : Le F.M.I, et l'organisation financire internatio-naleQUATRIME PARTIE : L'AJUSTEMENT INTERNATIONALChapitre 1 : Le rquilibrage de la balance des paiementsSection 1 : L'optique des lasticits
Section 2 : L'optique de l'absorptionS ection 3 : L 'optique montaireChapitre 2 : L'intgration montaireSection 1 : Les thories des zones montaires optimalesSection 2 : Quelques exemples d'intgration montaire
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
11/258
Introduction gnraleLa monnaie et l'changeinternational
L'conomie internationale comporte traditionnellement deux grandes parties :- la thorie du commerce international (R ICA R D O ) ;- l'conomie montaire internationale (HUME).Le prsent ouvrage, qui rsulte en grande partie d'un enseignement que nousdispensons d epuis plusieurs annes en licence la Facult de D roit et desSciences conomiques de Libreville, traite du second aspect : les relationsmontaires et financires internationales.Cette option, qui consiste exposer les principes essentiels de l'conomiemontaire internationale en vue d'en fournir les instruments d'analyse et derflexion, prsente deux principaux avantages :1) elle permet d'aborder des modles relativement complexes qui font inter-venir plusieurs types de biens : les produits, la monnaie, les titres, et pour aumoins deux pays ;2) elle conduit prendre conscience de l'interdpendance qui existe entre lesvariables macro-conomiques, d'une part, entre quilibre interne et quilibreexterne, la situation d'un pays et celle des autres pays, d'autre part.
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
12/258
Introduction gnrale
Concernant ce dernier point, l'option de cet ouvrage ncessite une bonneconnaissance de la macroconomie et des concepts de base tels que l'quilibre,la statique, la dynamique. Elle conduit tudier les problmes de changesinternationaux sous un angle statique et dynamique, ainsi que les politiquesadoptes l'gard de ces problmes et l'organisation montaire internationalequi en dcoule. L'ouvrage traite donc de la nouvelle configuration deschanges internationaux qui prend en compte les disparits internationales,l'interdpendance des nations et la vulnrabilit des conomies ne de l'int-gration financire internationale. Une place de choix y est accorde au modede dtermination du solde extrieur et des taux de change, aux mcanismes detransmission internationale des conjonctures et aux mesures de stabilisation.A utant d'aspects qui obligent les travaux d'conom ie montaire se placerdsormais dans une perspective internationale.Il reste que la monnaie est, par essence, un patrimoine national. Elle exerce ausein d'une nation trois types de fonctions :- instrument de mesure de la valeur ;- intermdiaire dans les changes ;- moyen de conservation de la richesse.D s lors, la proccupation essentielle est de savoir ce que deviennent cesfonctions dans un cadre international. Ce qui pose ncessairement le pro-blme de la convertibilit internationale des monnaies nationales.En effet, les transactions internationales donnent lieu des rglements inter-nationaux qui impliquent ncessairement la convertibilit internationale desmonnaies, car chaque oprateur souhaite tre rgl principalement en sapropre monnaie. D 'o le problme du passage d 'une m onnaie une autre quiconduit rechercher si une monnaie peut tre change contre une autre,autrement dit, si une monnaie est transformable en une autre ou si elle estcondam ne rester elle-mm e, ne pas se transformer.D e plus, la convertibilit est souvent assimile la transfrabilit. E t ce der-nier concept permet de savoir si une monnaie peut se dplacer dans un espaceautre que celui dans lequel elle a t cre ou mise.
- 2 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
13/258
Introduction gnrale
La convertibilit revt plusieurs formes et on distingue gnralement lesdegrs de convertibilit par rapport aux oprations, aux pays et aux agents.Par rapport aux oprations, la convertibilit peut tre gnrale ou limite. Laconvertibilit est dite gnrale si tout agent conomique peut obtenir, tauxfixe, de l'or ou toute autre devise trangre pour rgler ses transactions inter-nationales, quelle que soit l'opration, c'est--dire qu'elle soit faite sur lecompte courant (oprations commerciales courantes) ou sur le compte capital(mouvements des capitaux). En revanche, la convertibilit est dite limitelorsqu'elle n'est possible que pour les seules oprations courantes. Ce qui seproduit lorsque les mouvements spculatifs de capitaux sont dangereux pourun pays, c'est--dire lorsqu'ils risquent d'puiser ses rserves de devises.S 'agissant des pays, la convertibilit est dite gnrale s'il existe une m ultilat-ralit parfaite des paiements internationaux. D ans ce cas, les excdents et lesdficits bilatraux n'ont pas d'importance, car l'ensemble des monnaies sontconvertibles les unes vis--vis des autres. Ce qui permet de prendre globale-ment en compte les transactions d'un pays avec le reste du monde. La conver-tibilit est par contre limite si elle ne concerne que certains pays. On parlealors de convertibilit rgionale. L'exemple qu'on peut donner cet gard estcelui des monnaies europennes vis--vis du dollar.Concernant enfin les agents, la convertibilit sera dite gnrale lorsque toutagent (rsident ou non) peut obtenir de l'or et des devises contre de la mon-naie nationale. Elle est limite si cette possibilit n'est offerte qu'aux seulsagents non rsidents.O n fait galement la distinction entre la convertibilit entirement libre et laconvertibilit plus ou moins rglemente ou totalement interdite.Lorsque la convertibilit est libre, l'conomie obit aux seuls mcanismes demarch. Et lorsque la convertibilit est surveille d'abord, contrle ensuite et la limite interdite, on distingue les divers degrs de libert. D 'une maniregnrale, selon qu'on se trouve dans un systme de convertibilit libre ou deconvertibilit contrle, les effets des relations de change seront trs diffrents.
- 3 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
14/258
Introduction genraleOn peut penser que lorsque rgnent les mcanismes de march, dans un sys-tme de convertibilit libre, les changes sont relativement stables et relative-ment justes. En revanche, lorsque les mcanismes de march sont attnus pardes dcisions autoritaires, on ne sait plus trs bien ce que sont les changes. Ilspeuvent tre stables ou variables. Ils n'ont plus le mme caractre d'quilibreet de stabilit. On parle, dans ce cas, d'un change erratique, autrement ditd'un change qui erre parce qu'il ne trouve pas son modle d'quilibre.En conomie internationale, les problmes montaires refltent essentielle-ment la situation des conjonctures et des structures qui commandent leschanges internationaux. A insi, les relations montaires internationales s'ta-blissent quand apparat une crance ou une dette nette d'une nation sur uneautre. Crances et dettes sont inscrites dans un document comptable, labalance des paiements, qui est le reflet de l'quilibre extrieur tant recherchpar les nations. A ussi cet ouvrage, centr sur l'analyse de la balance des paie-ments, comprendra-t-il quatre parties :- la premire partie traite de la balance des paiements et des oprations dechange ;- la deuxime partie est consacre l'quilibre des oprations courantes ;-la troisime partie traite de l'quilibre des oprations en capital et desmouvements financiers ;- enfin, la quatrime partie est axe sur l'ajustement international.
- 4 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
15/258
Premire partieLa balance des paiementset les oprations de change
Les nations s'changent des biens (matires premires, biens intermdiaires,biens finis), des services (tourisme, transport, assurances...), des facteurs deproduction (connaissance, facult d'organiser et d'entreprendre, travail...)ainsi que des capitaux (mouvements de fonds).Cet change soulve fondamentalement deux problmes :1) un problme d'quilibre entre les nations, analys travers l'tude de labalance des paiements. Ce sera l'objet du chapitre 1 ;2) un problme de change entre les diffrentes monnaies nationales,que nous traiterons travers l'tude des oprations de change, objet duchapitre 2.
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
16/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
17/258
Chapitre ILa balance des paiementsToute tude de relations conomiques internationales est centre sur leproblme de l'quilibre de la balance des paiements. Cet quilibre est lui-mme li l'quilibre interne.En effet, l'activit conomique interne d'une nation s'apprcie en fonction detrois quilibres interdpendants :1) l'quilibre priv entre l'investissement priv (Ip) et l'pargne prive (Sp),soit Ip = Sp. Cet quilibre traduit l'absence de gap (inflationniste ou dfla-tionniste) ;2) l'quilibre du secteur public, entre investissement public (Ig) et pargnepublique (Sg), soit Ig = Sg. C'est l'quilibre budgtaire au sens large ;3) l'quilibre extrieur entre les exportations (X) et les importations (M), soitX = M.Ces trois quilibres sont troitement lis car la somme de ces trois soldes doittre nulle :(S p - Ip) + (S g - Ig) + (M - X) = 0.Ce qui peut galement s'crire :(X - M) = (S p - Ip) - (Ig - Sg).Le solde extrieur est donc gal la diffrence entre le solde du secteur privet le solde budgtaire.L'tude de la balance des paiements nous amne la dfinir, puis l'analysersous les aspects comptable et conomique, avant de procder son apprcia-tion globale.
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
18/258
Economie montaire internationale
S E C T IO N I : D FIN IT IO N D E L A B A L A N CE D E S PA IE M E N T SLa balance des paiements est un compte national qui enregistre les transac-tions et les rglements ( caractre conomique et financier) effectus aucours d'une priode (gnralement l'anne ou le trimestre) entre les rsidentsd'un pays et les rsidents des autres pays.Cette dfinition soulve quelques questions : comment les oprations sont-elles saisies ? qu'est-ce qu'une transaction ? qui est rsident ?
1. L'enregistrement des oprationsL'enregistrement systmatique des oprations est relativement rcent. Il datede la fin de la seconde guerre mondiale, sous l ' instigation du FondsMontaire International. En fait, la balance des paiements regroupe desdonnes ingales qui proviennent des sources diverses, plus ou moins fiables :1) les donnes douanires : ce sont des donnes prcises sur les mouvementsde marchandises ;2) les donnes des banques, qui sont soit des oprations sur titres trangers,des crdits privs des banques prives, soit des variations des rserves four-nies par la banque centrale ;3) les donnes du trsor qui recensent toutes les dpenses officielles faites l'tranger (dpenses des ambassades, dpenses militaires, paiements desintrts sur emprunts) ;4) les donnes qui proviennent des enqutes et des sondages. Elles concernentessentiellement le tourisme, la remise des travailleurs trangers, les fretsmaritimes...
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
19/258
La balance des paiements et les oprations de change
2. Les transactionsUne transaction est un change de valeur, un acte qui est un transfert de titresur un bien conomique ou un service. La transaction donne lieu un paie-ment et une rception de monnaie en change d'un bien, d'un service oud'un actif caractre conomique.Les changes sont saisis, soit immdiatement au moment o ils sont effectus,soit au moment de leurs rglements financiers. Ce qui permet, dans le premiercas, d'tablir une balance des paiements en terme de transaction, et dans lesecond cas, une balance des paiements en terme de rglement.Souvent, les transactions et les rglements ne concident pas. Les rglementspeuvent tre soit anticips (dans ce cas, on parle de lead), soit retards(on parle alors de lag).
3. Le rsidentOn appelle rsident toute personne physique ou morale qui exerce son activitsur le territoire national pendant au moins un an. Sont donc exclus : lestouristes, les diplomates, le personnel militaire, les travailleurs migrants titretemporaire.Il est important de prciser que la balance des paiements ne fournit pas un tatdes stocks de biens et services dont dispose un pays. Elle recense plutt desflux. Il s'agit d'un relev de ce qui s'est pass au cours d'une priode donne.Une distinction doit tre faite entre la balance des paiements comptable(ex post) et la balance des paiements conomique (ex ante).S E C T I O N 2 : T U D E C O M P T A B L E D E L A B A L A N C E D E SPAIEMENTSLa balance des paiements comptable fournit les valeurs des transactions effec-tues au cours des priodes passes. N ous allons parler du passage des cri-tures d'abord, de la structure de la balance des paiements ensuite. Ce qui nous
- 9 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
20/258
conomie montaire internationaleamnera prsenter les apports du cinquime manuel du Fonds MontaireInternational (F.M.I.)-1. L e passage des crituresLe principe fondamental de la construction de la balance des paiementscomptable est l'enregistrement en partie double. Toute opration est la foisun acte d'achat et un acte de vente, c'est--dire qu'elle ouvre un crdit et undbit.Le crdit, prcd du signe +, est plac gauche et compt positivement. Ledbit, prcd du signe -, est plac droite et compt ngativement.L'inscription (+) au crdit traduit une diminution d'actifs rels (exportations),fina ncie rs (sortie de titres de proprit et de crance, donc entre de capitaux)ou montaires (sortie de rserves ou de monnaie nationale). Une inscription(-) au dbit reprsente une augmentation des actifs rels (importations), finan-ciers (entre de titres de proprit et de crance, c'est--dire sortie de capi-taux) ou m ontaires (entre de m onnaie trangre ou nationale).Selon le principe de la comptabilit en partie double, toute opration donnelieu deux inscriptions :- celle qui reprsente sa nature conomique (importations ou exportations) oufinancire (achat ou vente de titres) ;- et celle qui reprsente son mode de rglement, financier (crance) oumontaire. cet gard, la balance des paiements comme document comptable est tou-jours quilibre, car le total des crdits est gal au total des dbits et le soldegnral est nul.Prenons ce niveau quelques exem ples.
- 1 0 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
21/258
La balance des paiements et les oprations de chang eExemple 1 : une conomie de trocPrenons un pays qui vend un bien en change d'un autre pour une valeurconsidre comme quivalente en terme d'un certain numraire 100 (qui peutd'ailleurs tre l'un des deux biens changs). Sa balance des paiements seprsente de la manire suivante :
Crdit (+)Exportation 100 Dbit (-)Importation 100
Exemple 2 : une conomie m ontariseD ans une conomie montarise, l'exportateur d'un bien n'es t pas forcmentimportateur. La balance des paiements se prsente comme suit :Crdit (+)
Exportation 100Dbit (-)
Paiement de l'exportation 100Ainsi, le pays qui vend un bien achte une crance montaire. La vente d'unproduit fait natre un droit un paiement et se traduit par un signe (+), tandisque l'achat de monnaie donne lieu un engagement du pays l'gard de l'ex-trieur et se traduit par le signe (-)Une exportation de marchandise est une diminution de la richesse nationale,puisque les biens sont prlevs sur la production intrieure et vendus l'tranger. Cette transaction constitue en revanch e un gain d e devises.L'intrt de l'inscription au crdit ou au dbit est de dterminer si l'conomienationale a acquis ou perdu des devises. Toute diffrence entre crdit et dbitdoit faire apparatre un solde positif ou ngatif.
- 1 1 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
22/258
Economie montaire internationaleExemple 3 : un pays exporte des biens pour 100 milliards de francs CFAet en importe pour 80 milliards de francs CFA. La balance des paiements seprsente comme suit :
Nature de l'oprationconomiqueMontaire
Total
IntitulExportations (ventes)Importations (achats)Avoirs (caisse)
Crdit (+)10 0
-100
Dbit (-)8020100
Solde+ 20- 2 0
0Exemple 4 : l'exportation de biens pour 100 milliards de francs CFA nedonne pas lieu un paiement immdiat mais la remise d'un titre de crance.Il y a ici introduction d'un autre type de bien. Il s'agit d'un actif financier(actions, obligations...). La balance des paiements est la suivante :
Crdit (+)Exportation de biens 100 Dbit (-)Crdit commercial 100
Le crdit commercial peut tre analys comme un achat de titres par le pays.Ce qui donne lieu ultrieurement un change contre monnaie, d'o labalance des paiements suivante :Crdit (+)
Crdit commercial 100Dbit (-)
Monnaie 100On peut, par analogie avec les marchandises, tre tent d'inscrire les exporta-tions de capitaux en recette (crdit) et les importations de capitaux en dpense(dbit). C'est totalement le contraire.
- 1 2 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
23/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
24/258
conomie montaire internationaleemprunts, crdits commerciaux (actifs financiers), mouvements de devises(actifs montaires). La balance des paiements n'a donc vraiment d'intrt quesi on la dcompose en un certain nombre de balances partielles selon le typed'oprations :- les oprations courantes ;- les oprations en capital ;- la variation de la position montaire extrieure.Cette distinction amne tracer une ligne de dmarcation au sein de labalance des paiements, en laissant certaines rubriques inscrites au crdit et audbit au-dessus de la ligne et les autres au-dessous de la ligne. Onobtient ainsi un excdent lorsque les crdits inscrits au-dessus de la ligne sontsuprieurs aux dbits inscrits au-dessus de la ligne. Paralllement, onenregistre un dficit lorsque les crdits au-dessus de la ligne sont infrieursaux dbits au-dessus de la ligne.Les diffrentes composantes ont t choisies en partie pour permettre laconstruction d'un grand nombre de soldes. Cependant, la balance des paie-ments, quelle que soit sa prsentation, doit tre lue et apprcie la lumired'autres lments de la situation conomique nationale et internationale quiinfluencent les excdents et les dficits constats partir des composantesstandard.Se pose alors le problme du traitement du poste rsiduel, erreurs et omis-sions nettes , que comporte toujours un tat de la balance des paiements. Cersidu, qui provient des composantes figurant tant au-dessus qu'au-dessous dela ligne, se place d'ordinaire dans la catgorie des composantes dont lessources sont les moins sres, gnralement au-dessus de la ligne.En fait, on distingue principalement la balance des oprations courantes et labalance des capitaux.
- 1 4 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
25/258
La balance des paiements et les oprations de change
A -La balance des oprations courantesOn l'appelle galement balance des paiements courants ou balance des tran-sactions courantes. Cette balance se subdivise en quatre balances partielles :- la balance des m archandises, dite aussi balance comm erciale ;- la balance des services ou balance des invisibles ;- la balance des revenus de facteurs ou des rmunrations ;- la balance des dons et des transferts unilatraux.1) La balance commerciale comprend les importations et les exportationsainsi que les oprations de courtage international, c'est--dire les achats etventes de marchandises ne passant pas les frontires (exemple : achats demarchandises par les Gabonais en France pour les revendre au Congo). Ils'agit l de la balance commerciale au sens strict.2) La balance des services ou balance des invisibles recouvre des prestationset des services de natures diverses :- les transports : ferroviaires, routiers, fluviaux, mais surtout maritimes et
ariens ;- les assurances : primes et indemnits ;- les voyages : touristiques, officiels, d'affaires ;- les autres services : banques, postes et tlcommunications, redevancescinmatographiques, brevets, droits d 'auteurs.Il est parfois commode de regrouper ces deux premires balances, et dans cecas, on parle de balance com merciale au sens large.3) La balance des revenus de facteurs de production (souvent assimils auxservices) regroupe :- les revenus des placements, c'est--dire des revenus dcoulant des droits decrances ou de proprit. Il s'agit des intrts, dividendes et autres revenusdu capital des secteurs priv et bancaire.
- 1 5 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
26/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
27/258
La balance des paiements et les oprations de change-les investissements de portefeuille, c'est--dire des achats de titres et
crances (actions et obligations) ;- les prts faits par les mnages et par l'tat et plus de deux ans par lesbanques ;-les crdits commerciaux moyen et long terme, c'est--dire des crdits fournisseurs accords par les entreprises non financires et les crditsacheteurs accords par les banques.La balance des capitaux court terme concerne gnralement le secteur priv(entreprises non financires et mnages) parce que les avoirs et les engage-ments court terme des secteurs bancaire et public sont considrs commemoyens de paiements internationaux et, de ce fait, classs dans la balance descapitaux m ontaires.La balance des capitaux court terme recense donc :- les prts et avances de moins d'un an des entreprises non financires impor-tatrices et exportatrices ;- les autres mouvements de capitaux court terme.S'agissant de la balance des capitaux montaires, on retiendra que la positionmontaire d'un pays l'gard du reste du monde rsulte des mouvements court terme des intermdiaires financiers et montaires. Elle correspond ausolde des avoirs et engagements vu e court terme, en devises et en m onnaienationale du secteur public et du secteur bancaire vis--vis des non rsidents.Cette position montaire extrieure est gale au solde des oprations au-dessusde la ligne , corrige des erreurs et omissions , parce que les transports defonds correspondant aux rglements de ces oprations provoquent une modifica-tion de la position vis--vis de l'tranger de la banque agre qui effectue oureoit le rglement.Exemple : un paiement l'tranger se traduit par une diminution d'avoirs oupar une augmentation de ses engagements. l'inverse, un paiement reu del'tranger augmente les avoirs ou diminue les engagements.
- 1 7 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
28/258
conomie montaire internationaleTableau n 1 : La structure de la balance des paiements
POSTES DE LA BALANCE DES PAIEMENTSI. TRANSACTIONS COURANTES1.1. Marchandises- Exportations et importations1.2. Services- Services lis au commerce extrieur- Services technologiques- Tourisme- O prations gouvernementales- Intrts et revenus du capital- S alaires et revenus du travail- Services divers1.3. Transferts unilatraux
II . CAPITAUX LONG TERME2.1. Investissements directs2.2. Investissements de portefeuille2.3. Crdits commerciaux et prts2.4. Secteur officielIII. CAPITAUX COURT TERME3.1. Secteur priv non bancaire- Crdits commerciaux- Prts3.2. Secteur bancaire3.3. Secteur officiel
3. L es apports du cinquime m anuel du F.M.I.Depuis la publication, en 1977, de la quatrime dition du manuel du F.M.I.,d'importants changements sont intervenus dans la conduite des oprations
- 1 8 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
29/258
La balance des paiements et les oprations de changeinternationales, en raison de la libralisation des marchs financiers, de lacration de nouveaux instruments financiers et de nouvelles approches de larestructuration de la dette extrieure. cela, il faut ajouter une croissanceexceptionnelle du volume des changes internationaux de services.La prparation du cinquime manuel a t motive par les travaux entreprisen vue de la rvision du S ystme de Com ptabilit des N ations unies (S CN ).A -L e s objectifs du cinquime manuel du F.M.I.Le cinquime manuel de la balance des paiements, l'instar des prcdentesditions publies par le F.M.I. (1948, 1950, 1961 et 1977), avait un doubleobjet :- fournir une norme internationale dfinissant le cadre conceptuel pour l'ta-blissement des statistiques de la balance des paiements ;- servir de guide aux pays m embres dans l'laboration des tats de la balancedes paiements qu'ils sont censs communiquer rgulirement au F.M.I.La porte et l'orientation du cinquime manuel diffrent du quatrime divers gards :1) le cadre conceptuel a t largi. Il englobe maintenant la fois les flux debalance des paiements (transactions) et les stocks d'avoirs et d'engagementsfinanciers extrieurs (position extrieure globale) ;2) le compte des transactions courantes a t redfini : il exclut les transfertsde capital (inclus dsormais dans un compte plus large : le compte de capitalet d'oprations financires) ;3) le compte de transactions courantes est subdivis en deux postes distincts :biens et services d'une part, revenus et transferts courants, d'autre part.Le cinquime manuel tablit une distinction nette, dans le compte des transac-tions courantes, entre les transactions internationales au titre des services etles transactions q ui o nt trait aux revenus.
- 1 9 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
30/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
31/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
32/258
conomie montaire internationale
L e compte capital regroupe :- les transferts de capital ;- les acquisitions et cession d'actifs non financiers non produits.Il y a donc ainsi cration d'un nouveau poste acquisitions et cessionsd'actifs non financiers non produits , dont les transactions portent sur desactifs corporels indispensables la production (terre, ressources du sous-sol),des actifs incorporels (brevets, droits d'auteurs, marques com m erciales ...) etdes baux ou autres contrats transfrables.Afin de dissocier les oprations de ce poste avec celui des services, on inscritdans le premier cas, leur vente ou achat et dans le second cas, leur utilisation.Le compte d'oprations financires regroupe les oprations suivantes : inves-tissements directs, investissements de portefeuille, autres investissements etavoirs de rserve.La ventilation des oprationsfinanciresest faite par catgories fonctionnelles(investissements directs, investissements de portefeuille, autres investisse-ments, avoirs de rserves), par types d'instruments (montaires et financiers),par secteurs (autorits montaires, banques...), en avoirs et engagements, eninstruments de long terme et de court terme.Tout ceci est prsent dans le tableau ci-aprs.
- 2 2 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
33/258
La balance des paiements et les oprations de chan geTableau n 2 : Prsentation dtaille de la balance des paiements
1. COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTESA. Biens et servicesa. Biens1. Marchandises gnrales2. Biens imports ou exports pour transformation3. R parations d e biens4. A chats de b iens dans les ports par les transporteurs
5. O r non m ontaire5.1 D tenu titre de rserve de valeur5.2 D tenu d'autres finsb. Services
1. Transports1.1 T ransports maritimes1.1.1 Passagers1.1.2 Fret1.1.3 A utres1.2 Transports ariens1.2.1 Passagers1.2.2 Fret1.2.3 A utres1.3 A utres transports1.3.1 Passagers1.3.2 Fret1.3.3 A utres
2. Voyages2.1 Voyages titre professionnel2.2 Voyages titre personnel
- 2 3 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
34/258
conomie montaire internationale3. Services de communication4. Services de btiment et travaux publics5. Services d'assurance6. Services financiers7. Services d'informatique et d'information8. R edevances et droits de licence9. A utres services aux entreprises9.1 N goce international et autres services lis au comm erce9.2 Location-exploitaiton9.3 D ivers services aux entreprises, spcialiss et techniques
10. Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs10.1 S ervices audiovisuels et con nexes10.2 A utres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs11. S ervices fournis ou reus par les administrations p ubliqu es, n.c.a.B. Revenus1. Rmunration des salaris2. Revenu des investissements2.1 Investissements directs2.1.1 R evenu des titres de participation- D ividendes et bnfices distribus des succursales- Bnfices rinvestis et bnfices non distribus des succursales2.1.2 Revenu des titres de crance (intrts)2.2 Investissements de portefeuille2.2.1 R evenu des titres de participation (dividendes)2.2.2 R evenu des titres de crance (intrts)- O bligations et autres titres d'emprunt- Instruments du march montaire et drivs financ iers2.3 A utres investissements
- 2 4 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
35/258
La balance des paiements et les oprations de change
C. Transferts courants1. A dministrations publiques2. A utres secteurs2.1 Envois de fonds des travailleurs2.2 A utres transferts
2. COMPTE DE CAPITAL ET D'OPRATIONS FINANCIRES
A. Capital1. Transferts de capital1.1 A dministrations publiques1.1.1 Remise de dettes1.1.2 A utres transferts1.2 A utres secteurs1.2.1 Transferts des migrants1.2.2 R emise des dettes1.2.3 A utres transferts2. A cquisitions et cessions d'actifs non financiersnon produits
B. Oprations financires1. Investissements directs1.1 De l'conomie l'tranger1.1.1 Capital social- Crances sur les entreprises apparentes Engagements envers les entreprises apparentes1.1.2 Bnfices rinvestis1.1.3 A utres transactions- Crances sur les entreprises apparentes Engagements envers les entreprises apparentes1.2 D e l'tranger dans l'conom ie1.2.1 Capital social
- 2 5 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
36/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
37/258
La balance des paiements et les oprations de change
2.2 Engagements2.2.1 T itres de participation- Banques- A utres secteurs2.2.2 Titres d'engagement- O bligations et autres titres d'em prunt Autorits montaires A dministrations publiques
Banques Autres secteurs- Instruments du march montaire A utorits m ontaires A dministrations publiques Banques Autres secteurs- Produits financiers drivs Banques Autres secteurs3. A utres investissements3.1 Avoirs3.1.1 Crdits commerciaux- A dministrations publiques
Long terme Court terme- Autres secteurs Long terme Court terme3.1.2 Prts- A utorits montaires
- 2 7 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
38/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
39/258
La balance des paiements et les oprations de change
3.2 Engagements3.2.1 Crdits commerciaux- A dministrations publiques Long terme Court terme- Autres secteurs L ong terme Court terme3.2.2 Prts- A utorits montaires Utilisation des crdits et prts du FMI A utres prts long terme Court terme- A dministrations publiques L ong terme Court terme- Banques Long terme Court terme- Autres secteurs L ong terme Court terme3.2.3 M onnaie fiducia ire et dpts
- A utorits mo ntaires- Banques3.2.4 Autres engagements- A utorits montaires L ong terme Court terme
- 2 9 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
40/258
conomie montaire internationale- A dministrations publiques
Long terme Court terme- Banques Long terme Court terme- A utres secteurs Long terme Court terme4. A voirs de rserve4.1 Or montaire4.2 D roits de tirage spciaux4.3 Position de rserve au FMI4.4 D evises trangres4.4.1 Monnaiefiduciaireet dpts
- A uprs des autorits montaires- A uprs des banques4.4.2 T itres- Titres de participation- O bligations et autre titres d'emprunt- Instruments du march montaire et produ its drivs4.5 A utres crances
S E C T I O N 3 : T U D E C O N O M I Q U E D E L A B A L A N C E D E SP A I E M E N T SDans l'optique conomique, la balance des paiements n'est rien d'autre que sacontrainte budgtaire, autrement dit, la somme de ses demandes excdentaires(diffrence entre l'offre et la demande). Par ailleurs, sa structure un momentdonn rsulte, ou tout au moins devrait rsulter, d'un processus d'optimisa-tion intertemporelle.
- 3 0 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
41/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
42/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
43/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
44/258
Economie montaire internationalegalement valuer le niveau de comptitivit d'un pays, son besoin definancement et sa capacit de financement.Le solde des oprations courantes peut donc tre apprci par rapport l'absorption interne, par rapport au dficit budgtaire et par rapport l'endettement extrieur.Par rapport l'absorption, on retient qu'un dficit du solde courant s'accompa-gne ncessairement de dpenses nationales suprieures la valeur du produitnational (PIB) et qu'un excdent traduit des dpenses infrieures au produit.A insi, un solde courant dficitaire indique que le pays consomm e plus qu 'ilne produit et un solde excdentaire, que le pays exporte plus qu'il n'importeou consomme moins qu'il ne produit.Le solde courant correspond donc l'cart (positif ou ngatif) entre le produitnational (Y) et la dpense nationale ou absorption note A .En effet, si :e t Y = C + G + Id + X - M ,avec C, la consommation nationale ;G, les dpenses publiques ;Id, l'investissement domestique ;X et M , respectivement les exportations et les importations,on peut crire :Y - A = X - M .Le produit national diffre de la dpense nationale du montant du soldecourant et l'quilibre extrieur ne peut tre ralis que s'il y a galit entre leproduit national et l'absorption.
- 3 4 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
45/258
La balance des paiements et les oprations de changeLe solde courant tant une composante de la dpense courante, tout change-ment de la balance des oprations courantes peut tre associ un change-ment dans la production et l'emploi. La relation dfinie ci-dessus montre surque lle (s) variable (s) (revenu national et/ou dpense nationale) il convientd'agir pour modifier le solde courant. Ce qui ncessite la prise en compte deseffets prix et des effets revenus.A insi, Y > A X - M > 0, donc X > M .Y < A < = > X - M < 0 , d o n c X < M .Une action judicieuse repose donc sur la matrise de l'volution des princi-pales catgories de dpenses.Par rapport au dficit budgtaire, on recourt la relation qui existe entrel'pargn e, l'investissement et le revenu national.Puisque l'investissement extrieur net correspond la fraction de l'pargnenationale non investie dans le pays (ou fraction de l'pargne qui ne participepas la formation intrieure de capital), l'galit comptable en conomie fer-me entre l'pargne prive et l'pargne publique d'un pays, d'une part, soninvestissement, d'autre part, n'est assure en conomie ouverte que si le soldecourant est nul.A insi, un dficit extrieur peut signifier que le secteur priv inve stit plus qu 'iln'pargne ou que l'tat dpense plus qu'il ne collecte d'impts ou encore queles besoins d'pargne de l'un des secteurs dpassent les capacits d'pargnede l'autre.Si le pays enregistre un excdent extrieur, on peut penser que le secteur privpargne plus qu'il n'investit ou que les recettes de l'tat dpassent sesdpenses ou encore que les besoins d'pargne d'un secteur sont infrieurs auxcapacits d'pargne de l'autre.Schmatisons cette relation entre la balance des oprations courantes et ledficit budgtaire de la manire suivante.
- 3 5 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
46/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
47/258
La b alance des paiements et les oprations de change
un investissement net ou un dsinvestissement extrieur net selon qu'il estpositif (excdentaire) ou ngatif (dficitaire).A insi, un excdent du solde courant signifie que le pay s acquiert des actifssupplmentaires (montaires ou financiers) ou rduit ses dettes envers l'tran-ger parce qu'il gagne plus de ses exportations qu'il ne dpense pour sesimportations. Il peut galement signifier que le pays finance le dficit courantde ses partenaires commerciaux en leur accordant des prts ou qu'il accrotses avoirs extrieurs.E n cas de dficit cou rant, le pays cd e des actifs (montaires ou financiers) ouaccrot ses dettes. Le pays peut galement puiser dans ses ressources accumu-les antrieurement ou emprunter l 'tranger pour financer le surplusd'importations.A insi, la balance des oprations courantes est gale au changement dans lesavoirs extrieurs nets. La diffrence ngative entre les flux nets de biens etservices et les transferts courants reprsente son endettement extrieur net quiaugmente du montant du dficit courant.Ces trois interprtations servent l'examen des options macro-conomiquessusceptibles d' amliorer le compte extrieur d'une nation.L'excdent du compte courant (X - M > 0) ne peut pas s'accrotre si on neveille pas en mme temps accrotre le produit national (Y) par rapport ladpense nationale, autrement dit le diffrentiel (Y - A ).Le dficit du compte courant, qui signifie que la nation dsinvestit l'tran-ger en important davantage (accentue sa position de dbiteur international),peut tre considr comme normal et souhaitable pour un pays qui doit impor-ter des ressources relles pour son dveloppement. Inversement, un excdentdu compte courant en registr par un pays ne peut tre estim satisfaisant s'ilest infrieur au montant ncessaire pour assurer le maintien du volume d'ex-portations de capitaux jugs adquats.
- 3 7 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
48/258
conom ie montaire internationale
B - L e solde de baseLa balance de base est utilise par le dpartement amricain du commercedepuis 1940. Ce concept est dfendu par LARY dans un article publi en1963. L a balance de b ase spare les flux des produits et des titres long termedes flux de titres court terme et de la monnaie.L'tablissement du solde de base vise exclure du dessus de la ligne toutesles transactions de nature transitoire qui risquent de se renverser brvechance.La distinction cl est celle qui est faite, au niveau des mouvements de capi-taux, entre le court terme et le long terme. T ous les mouvements de capitaux court terme sont placs au-dessous de la ligne , ainsi que les moyens derglements. Il en est de mm e pour le poste erreurs et om issions nettes .L es oprations qui aboutissent ce solde dfinissent la structure d'une cono-mie, permettant ainsi d'valuer son degr de dpendance vis--vis de l'extrieurpar rapport aux biens et services de consomm ation courants, aux quipements etaux capitaux.Selon LARY, la pertinence du concept de transaction de base tient la dis-tinction qu'il permet d'oprer entre :1) les transactions dont les changements apparaissent dans le long terme etcelles qui n'y apparaissent pas ;2) les transactions stables (celles qui correspondent aux forces conomiquesprofondes) et celles qui sont variables et erratiques ;3) les transactions qui rpondent aux grandes forces conomiques et celles quisont sensibles aux variations conjoncturelles dans le court terme, ainsi qu'auxconditions de crdit.D u fait que la balance des paiements recen se, de faon exhaustive, les tran-sactions entre un pays et le reste du monde, elle indique ncessairement lesraisons pour lesquelles l'offre et la demande de devises voluent. Le dficit
- 3 8 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
49/258
La balance des paiements et les oprations de change
ou l'excdent de certains de ses soldes expliquent donc le niveau du taux dechange. Il en est ainsi du solde de la balance de base qui cumule les rsultatsdu solde courant et du solde des mouvements de capitaux long terme.E n effet, lorsque le solde de la balance de base est positif, le taux de change atendance s'accrotre. Inversement, une balance de base ngative entraneune baisse du cours de la devise.Le solde de base mesure les possibilits d'entre ou de sortie de capitaux, autaux de change courant, juges suffisantes ou non. Un excdent de ce soldesignifie que le pays bnficie d'entres de capitaux et donc de sorties dedevises. D ans ce cas, une apprciation de la mon naie nationale s'avre nces-saire pour viter des tensions inflationnistes dans l'conomie. Si le solde estdficitaire, le pays enregistre au contraire une sortie de capitaux ou une entrede devises. La monnaie nationale doit tre dvalue pour arrter le mouve-ment de dflation ou viter la rduction de l'activit conomique.Le solde de base reste galement un instrument intressant, mais non suffisant,de mesure des motifs d'accumulation. cet gard, on peut penser que la struc-ture des biens et services finis, des biens d'quipement, des biens primaires etdes capitaux fournit des indications sur la capacit du pays s'engager dans unprocessus de croissance durable.Il reste que le concept de balance de base est critiquable parce qu'il nie l'exis-tence des motifs d'accumulation, moyen et long terme, de capital courtterme et de la monnaie. Ce n'est pas parce que les actifs ont une chancecourte que leur dtention ne peut pas faire l'objet d'une accumulation longterme.C - L e solde global ou solde de la balance des liquiditsCe concept, dont le partisan le plus acharn est W alter L E D E R E R , consiste inscrire au-dessus de la ligne les postes dont l'quilibre est significatif(les crances sur l'tranger) en mme temps que les postes de la balancede base.
- 3 9 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
50/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
51/258
La b alance d es paiements et les oprations de change
Sont donc inscrits au-dessus de la ligne les mouvements de crances court terme du secteur priv, et au-dessous de la ligne , ceux du secteurpublic.A insi, un dficit de ce so lde indique le dsquilibre des paieme nts que lesrserves doivent couvrir. Les autorits montaires sont tenues, dans ce cas, depuiser dans les rserves antrieurement accumules pour financer le dficit.Elles peuvent galement s'endetter auprs des organismes financiers tatiquesou trangers (banques centrales, organismes financiers de crdits, institutionsmontaires internationales...).Un excdent de ce solde amliore les avoirs extrieurs du pays qui peut, soitaccrotre ses rserves, soit accrotre ses crances auprs des institutions mon-taires et financires trangres sous forme de prts.Si l'objectif recherch est la stabilit du taux de change, un prlvement surles rserves extrieures tend dprcier la monnaie nationale alors qu'unaccroissement de ces rserves tend l'apprcier. cet effet, il n'est pas souhaitable qu'une balance des rglements officielsprsente durablement un solde dficitaire. Cela peut indiquer une situationde crise car le pays liquide ses avoirs internationaux de rserves ou s'endettevis--vis des autorits montaires trangres pour satisfaire une demande plusforte de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies.En dfinitive, le solde des rglements officiels est un instrument de dfensede la monnaie nationale dans la mesure o le niveau des rserves de devisesd'un pays dtermine sa capacit d'intervention sur le march de change poursoutenir sa monnaie ou influencer son cours.Puisque la balance des rglements officiels traduit des phnomnes de courtterme, alors que la balance des liquidits traduit un phnomne plus fonda-mental (la croissance des liquidits nationales), elle est plus instable que laseconde.
- 4 1 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
52/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
53/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
54/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
55/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
56/258
conomie montaire internationale
2) La clientle priveElle n'intervient pas directement sur le march de change, mais plutt parl'intermdiaire des banques en vue de satisfaire leurs besoins en devisesinduits par les oprations commerciales ou financires internationales. Ils'agit des socits commerciales qui oprent dans plusieurs pays et font oureoivent des paiements en devises d 'une part, des institutions financires nonbancaires qui offrent leurs clients des services lis aux transactions endevises et les particuliers, d'autre part.3) Les courtiersIls jouent un rle essentiel en tant qu'informateurs et intermdiaires. Ils infor-ment les oprateurs des cours auxquels se vendent ou s'achtent les diff-rentes monnaies. Comme intermdiaires, ils centralisent les ordres d'achat etde vente de plusieurs banques. L eur rle est de rendre le march plus efficaceet plus fluide.Une maison de courtage est divise en sections, chacune travaillant sur unedevise ou un groupe de devises. Les plus grandes maisons de courtage sontlocalises Londres. Ce sont des maisons internationales ayant de nombreuxbureaux ou filiales sur d'autres places financires.Les maisons de courtage ont beaucoup contribu l'acclration de l'intgra-tion des marchs financiers en raison de liens directs qu'elles ont avec denombreux centres trangers.
2. Les actifs ngocisOn distingue deux types d'lments :- l'lment principal : le transfert tlgraphique de dpt bancaire ;- l'lment accessoire : la lettre de chan ge et le num raire.Le transfert tlgraphique de dpt bancaire est un ordre envoy par tlex dedbiter un com pte dans une devise A et de crditer simultanment un autrecompte libell dans une devise B .
- 4 6 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
57/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
58/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
59/258
La balance des paiements et les oprations de change
L e march au comptant se tient gnralement tous les jours ouvrables. Il fonc-tionne en continu. Cependant, il existe sur certaines places une procdure defixing (sance de cotation au cours de laquelle les cours des principalesdevises sont constates par un reprsentant de la chambre syndicale desagents de change qui les publie au journal officiel).Lorsqu'une banque intervient sur le march de change pour le compte d'uneclientle, elle peut soit procder aux achats et ventes directs de devises, soitpasser par une devise tierce en vue d'obtenir un profit.Exemple : une banque canadienne vend le 4 mars 1998 un million de francsfranais (FRF) provenant des exportations effectues par une entreprise cana-dienne. Quand la banque reoit l'ordre de vendre les FRF, le taux sur le mar-ch est le suivant :1 CA D = 5,4022 FR F Paris ;1 US D = 1,2226 CA D N ew-York ;1 US D = 6,6040 FR F Paris.Premire possibilit : vendre directement :1.000.000/5,4022 = 185.109,77 CA D ;D euxime possibilit : passer par la devise tierce (US D ) : New-York : (1.000.000/6,6040) x 1,2266 = 185.130,21 CAD. Ce qui donneun profit de 20,44.La ralisation de l'arbitrage triangulaire exige une grande clrit car le tauxde change varie trs rapidement et le cambiste risque de se faire coller.
4. O rganisation et fonctionnement du m arch de change term eSur un march terme, les oprateurs contractent des engagements d'achat etde vente de monnaie un cours fix au moment du contrat mais repoussent lalivraison et le paiement une date ultrieure fixe au moment de l'engage-ment (gnralement un mois, trois m ois, six m ois, voire une anne).
- 4 9 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
60/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
61/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
62/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
63/258
La balance des paiements et les oprations de change
1. Sur le march interbancaireLa couverture sur le march interbancaire se traduit par une livraison ouune rception de devises. Elle est immdiate quand la couverture se fait aucomptant et diffre sur le march terme.Sur le march au comptant, l'importateur doit acheter tout de suite la devisedont il aura besoin plus tard. C'est une couverture par une avance en devises. terme, l'oprateur se couvre contre le risque de baisse ou de hausse decours. A insi, l'imp ortateur achte terme des devises correspondant au mon-tant de sa dette. L'exportateur, qui redoute une baisse du cours de la devise,vend terme auprs de son banquier le montant de sa crance.
2. S ur le m arch des contrats termeSur ce march, l'exportateur ou l'importateur prend directement contact avecun courtier pour vendre ou acheter un ou plusieurs contrats de devises.A insi, l'imp ortateu r, qui redoute une hausse du cours de la devise danslaquelle sa dette est libelle, s'en protge en achetant des contrats terme.Quant l'exportateur, il vend des contrats terme parce qu'il redoute unebaisse du cours de la devise.
3. Sur le march des swaps de devisesUn swap de devises est un engagement de gr gr par lequel deuxcontreparties s'changent des flux financiers libells dans deux devisesdiffrentes avec des taux d'intrt fixes. C'est la combinaison simultane d'unevente au comptant de devises et d'achats terme d'un mme montant en devises.Les swaps sont trs intressants et fort utiles pour grer le risque de change delongue priode. Et c'est pourquoi ils sont souvent associs des emprunts ou des placements en devises moyen terme et long terme.Prenons ici l'exemple de deux entreprises amricaine et japonaise qui souhai-tent respectivement s'endetter en yen et en dollar pour une dure donne sans
- 5 3 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
64/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
65/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
66/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
67/258
La balance des paiements et les oprations de changeSi le taux de change est exprim en units de monnaie du premier pays parunit de monnaie du second (cotation l'incertain) et si l'indice de taux dechange rel est suprieur l'un it (T CR > 1), il y a sous-valuation de lamonnaie considre. Ce qui signifie que le prix dans ce pays a diminu parrapport l'autre pays ou que le prix de la devise en sa monnaie a augmentsans aucun mouvement compensatoire dans les niveaux relatifs de prix.Si le taux de change d'quilibre est exprim en units de monnaies trangrespar unit de m onnaie nationale (cotation au certain) et si on a (T CR > 1), il ya survaluation de la m onnaie considre.A insi, dans le cas d'une cotation l'incertain, si T CR > 1, il y a sous-valua-tion de la monnaie nationale et si T CR < 1, il y a survaluation de la monnaienationale.En ce qui concerne les comparaisons multilatrales, pour le calcul du taux dechange effectif rel, il faut que le rapport des taux de change d'quilibre dansles quations (3) ou (4) (e/e0) soit remplac par un indice de taux de changeeffectif (T CE ) et que le niveau des prix trangers P* soit une moyenn e pond-re des indices de prix des partenaires commerciaux.L e concept de taux de change effectif rel (T CE R ) est quivalent dans uncontexte m ultilatral, au concept de taux de change rel dfini plus haut.
B . Interprtation conomique de la thorie de la parit des pouvoirsd'achat (PPA)Trois interprtations thoriques alternatives ont t faites (L. KATSELI,1979). La thorie de la parit des pouvoirs d'achat apparat comme : une relation d'arbitrage spatial ;- une relation causale dans le cadre de l'approche montaire de la balance despaiements ;-une relation de forme rduite dans le cadre de l'approche d'quilibre deportefeuille.La premire interprtation correspond l'application de la loi du prixunique , autrement dit la loi d'galisation des prix entre pays qui repose surles hypothses suivantes :
- 5 7 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
68/258
conom ie m ontaire internationale- information parfaite ;- homognit des produits ;- absence de cots de transport, d'entraves aux changes et de discriminationde prix.La seconde interprtation repose sur une relation causale entre choc mon-taire, niveau de prix et taux de change. A insi, grce la thorie quantitativede la monnaie, le choc montaire (expansion montaire) dtermine le niveaude prix qui, son tour, dtermine le taux de change. Cette interprtationconsidre la parit des pouvoirs d'achat comme une relation indispensable del'approche montaire de la balance des paiements.La troisime interprtation situe la parit des pouvoirs d'achat dans le cadrede l'approche de l'quilibre de portefeuille. Le taux de change est dterminsur le march des actifs. Ce qui revient dire que le taux de change d'qui-libre est influenc par les stocks de monnaie, de richesse, d'actifs nationaux ettrangers. Cette interprtation privilgie une dtermination endogne etsimultane des taux de change et des prix ainsi que le rle fondamental desanticipations sur les valeurs court terme.
C. Controverses et critiquesLa thorie de la parit des pouvoirs d'achat a fait l'objet de grandes contro-verses cause principalement de son caractre logique et simple. Relevonsque G. CASSEL avait dj reconnu que l'application de la parit des pouvoirsd'achat avait certaines limites :1) les entraves aux changes internationaux qui peuvent asymtriquementinfluencer les prix relatifs en perturbant l'arbitrage spatial. En effet, si lesimportations d'un pays sont relativement plus restreintes que ses exportations,le taux de change de ce pays sera suprieur son niveau de parit des pou-voirs d'achat ;2) la spculation sur le march de change, qui peut peser sur le cours d'unedevise et provoquer une dviation temporaire par rapport la parit des pou-voirs d'achat (la spculation contre une monnaie peut faire baisser sa valeurau-dessous de la parit des pouvoirs d'achat) ;
- 5 8 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
69/258
La ba lance des paiements et les oprations de change
3) les anticipations d'inflation, qui peuvent exercer des pressions la baissepar rapport la parit des pouvoirs d'achat (lorsqu'elles prvoient une infla-tion nationale suprieure celle de l'tranger) ;4) les modifications des prix relatifs internes (reflet des changements structu-rels d'une conomie), qui sont l'origin e de dviations du taux de change vis--vis de la parit des pouvoirs d'achat ;5) les m ouvements de capitaux long terme qui peuvent provoquer des cartspar rapport la parit des pouvoirs d'achat (un dficit prolong de la balancedes capitaux peut influencer ngativement le taux de change vis--vis de laparit des pouvoirs d'achat) ;6) les interventions directes du gouvernement sur les marchs de change, quiexercent le mm e effet que la spculation.La thorie de la parit des pouvoirs d'achat a fait l'objet de nombreuses cri-tiques. Cinq points retiennent l'attention :1) la thorie de la parit des pouvoirs d'achat est fonde sur l'volution de labalance des oprations courantes, la seule qui soit affecte par les variationsde prix des biens et services dans diffrents pays. O r, la balance des opra-tions courantes n'est qu'une partie de la balance des paiements et le taux dechange d'quilibre peut voluer sous l'influence d'autres postes de la balancedes paiements ;2) la thorie de la parit des pouvoirs d'achat ignore le fait qu'une devise peutservir de monnaie vhiculaire. D ans ce cas, son volution est dtermine pardes considrations autres que le taux d'inflation du pays (exemple des tats-Unis d'Amrique) ;3) la vrification empirique de la parit des pouvoirs d'achat est tributaire desindices de prix retenus. Or, les indices gnraux sont de nombreux gardscritiquables ;4) cette vrification est sensible la priode de rfrence retenue ;5) enfin, cette vrification est sensible aux pays retenus (la parit des pouvoirsd'achat est souvent vrifie pour les pays industrialiss qui ont le mmeniveau de dveloppement).
- 5 9 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
70/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
71/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
72/258
conomie montaire internationale
3. Les phnomnes de surractionL'analyse moderne de la dtermination du taux de change d'quilibre passepar la thorie du portefeuille qui permet de mettre en vidence des phno-mnes de surraction ou de surajustement (overshooting). Ce phnomne per-met d'expliquer pourquoi les variations de taux de change ont une amplitudesuprieure celle qu'exigeraient les seuls facteurs conomiques dj voqus.D 'o deux explications ce phnomne :1) le jeu des anticipations ;2) la sensibilit des marchs financiers.S'agissant des anticipations, lorsqu'une monnaie se dprcie, les oprateursont tendance l'accompagner, l'inclure dans leurs prvisions, s'en prot-ger. Ce faisant, ils la prcipitent. Les anticipations ne commencent se retour-ner que lorsque la dprciation est excessive (vis--vis de la PPA ). C'est doncau conformisme et la volont de limiter les risques des oprations que l'onpeut attribuer ce surajustement .Quant la sensibilit des marchs financiers, c'est essentiellement le marchdes changes qui est le premier ragir et en subir les contrecoups. C'estdans ce cadre que DORNBUSCH (1976) a propos un modle prenant encompte le principe de la parit des taux d'intrt.A insi, dans la courte priode, la parit des taux d'intr t expliquera it lesvariations du taux de change d'quilibre via les mouvements de capitaux. long terme, d'autres facteurs influent sur le change, la parit des pouvoirsd 'achat notamment (BRANSON).4. La spculationLa prise en compte des phnomnes spculatifs constitue une mthode int-ressante pou r tenter de comprendre les variations rcentes de taux de change.On appelle spculation toute opration terme qui n'est pas couverte par uneopration au comptant. Le spculateur accepte de courir un risque de changecar il pense connatre le futur taux de change d'quilibre d'une devise.
- 6 2 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
73/258
La balance des paiements et les oprations de change
La spculation, qui tait l'exception avant l'apparition d'un systme dechange flexible, est devenue aujourd'hui la rgle. La question intressante ce niveau est de savoir si la spculation est stabilisante (FRIEDMAN) oudstabilisante (B A UM L ). Cette controverse peut tre interprte en termed'information parfaite et imparfaite.Repoussant l'hypothse de NURKSE sur le rle nfaste de la spculation lorsde la dprciation du franc entre 1922 et 1926, FRIEDMAN fera laproposi-tion suivante : Affirmer que la spculation est un facteur dstabilisantrevient pratiquement dire que les spculateurs perdent de l'argent .P o u r F R I E D M A N , les agents ont des anticipations correctes des cours desdevises. Les mouvements de capitaux spculatifs doivent tendre rapprocherle cours de la devise de son cours normal (celui qui galise laparit des pou-voirs d'achat). S'il n'en tait pas ainsi, les spculateurs perdraient de l'argent.En effet, si un moment donn le cours d'une devise est infrieur son coursnormal, l'cart entre les deux cours s'accentue dans le cas o la dprciationest dstabilisante. Or cela n'est possible que si les spculateurs vendent cettedevise lorsque son cours est bas.L 'argument avanc par FR IE D MA N apparat mince parce qu'il ne tient qu'la con viction.Le rle stabilisant de la spculation peut tre reprsent par le graphiquesuivant.
Taux dechangeavant la spculation
\/ " "
volution du taux de change
aprs la spculation
temps
- 6 3 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
74/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
75/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
76/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
77/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
78/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
79/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
80/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
81/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
82/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
83/258
L'quilibre des oprations courantesE n supposant que l'Italie exporte A et importe B , les exportations du produitA sont en m me temps les exportations de l'Italie. L es importations du pro-duit B sont galement les importations de l'Italie. D e mme, les importationsde A sont les importations de la France et les exportations de B , les exporta-tions de la France. L'quilibre ne sera alors ralis que si les diverses valeursdes importations et des exportations sont gales entre elles. Et le prix interna-tional d'qu ilibre pour chaque bien est celui qui galise l'ex cs d'offre d'unpays et l'excs de demande de l'autre.S oient alors l'Italie qui importe B et exporte A , et la France qui exporte B etimporte A . Pour le produit A , le prix d'c han ge international s'obtient enconstruisant la courbe d'offre globale et la courbe de demande globale de A(cf. graphique prcdent).Si l'galisation de l'excs d'offre italienne et de l'excs de demande franaisese ralise pour un prix de 6 lires en Italie et 3 francs en France, le taux dechange qui assure la parit des pouvoirs d'achat est de 1 franc = 2 lires. De lamm e faon, on dtermine le prix international du bien B . L 'galisation del'excs de demande italienne et de l'excs d'offre franaise se ralise pour unprix de 2 francs en France et de 4 lires en Italie. Les changes internationauxseront alors quilibrs car le taux de change dfinit une mme parit de pou-voir d'achat pour les produits A et B (1 franc franais = 2 lires italiennes).tant donn qu' l'ouverture, le prix d'quilibre de chaque produit est celuiqui rend gaux l'excs d'offre d'un pays et l'excs de demande de l'autre, ilfaut que dans chacun des pa ys la valeur des importations soit gale celle desexportations pour que le taux de change qui assure la parit des pouvoirsd'achat (ici 1 franc = 2 lires) soit un taux de change d'quilibre.A insi :- pour la France : A B . pfa = OM. pfb(BF) (JQ)- pour l'Italie : CD . pia = PQ. pib.
- 7 3 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
84/258
conomie montaire internationale
L'quilibre ne sera donc ralis que si les surfaces des quatre rectanglesA B E F , E D GH, IJMO , KL PQ sont gales.SECTION 2 : LA VARIATION DE S PR IX INTERNATIONAUXLes classiques et no-classiques, en tudiant les mcanismes d'ajustement parles variations de prix ou du taux de change, ont voulu mettre en vidence lecaractre automatique des ajustements par les mouvements de prix.Cependant, le recours de plus en plus frquent aux variations de change aprsla seconde guerre mondiale a naturellement conduit de nombreux auteurs examiner les conditions d'efficacit de cette mesure.En fait, lorsque la balance des paiements est en dsquilibre, le processusd'ajustement peut s'effectuer par les variations de prix. A insi, il peut y avoir,soit une variation des prix intrieurs, le taux de change tant supposconstant, soit une variation du taux de change (par une dvaluation ou unervaluation), les prix intrieurs tant maintenus constants.
1. Les variations des prix intrieursLe processus d'ajustement par les variations des prix intrieurs peut tre tu-di dans deux cas : le cas de l'talon-or, d'une part, celui de l'talon dechange-or, d'autre part.A -Le cas de l'talon-orD ans le cas de l 'talon-or, la thorie remonte D avid HUM E . E lle at reprise par RICARDO, Stuart MILL et par TAUSSIG. Les mcanismesde rquilibre de la balance consistent en des changements dans les prixrelatifs des importations et des exportations, provoqus par les mouvementsd'or.
A insi, un pays en excdent (X > M) aura des devises trangres abondantespar rapport la demande. Ce qui entranera une baisse de leur prix. Lorsque lepoint d'entre de l'or sera atteint, c'est--dire lorsqu'il sera plus avantageuxde se faire payer en or qu'en une devise dont le cours s'est dprci, l'or
- 7 4 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
85/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
86/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
87/258
L'quilibre des oprations courantes
rduit-elle ou supprime-t-elle ncessairement l'excden t ? D ans l'affirmative,la variation du taux de change conduit un effet normal et dans le cascontraire, elle entrane un effet pervers.Il faut dire que cette question a longtemps t nglige car on admettait que ladvaluation avait toujours un effet favorable sur la balance des paiements. Etce n'est qu' la suite de nombreuses expriences que l'on s'est efforc dedterminer dans quel cas une dtrioration du taux de change, par exemple,n'am liore pas la balance des paiements courants (effets pervers).C'est Mrs R O B IN S O N (1937) qui a labor une analyse trs intressante ceniveau. Elle prend en compte quatre types d'lasticits :a) du ct des exportations :- l'lasticit de la demande d'exportations par l'tranger (T|x) ;- l'lasticit de l'offre nationale d'exportations (e x) ;b) du ct des importations :- l'lasticit de l'offre d'importations par l'tranger (e m) ;- l'lasticit de la demande nationale d'importations (T|m).E t c'est partir de ces lasticits qu'elle dtermine l'influence de la dvalua-tion sur les valeurs des importations et des exportations. Ces valeurs dpen-dent des variables prix et volume.S'agissant de la valeur des importations, on observe que :1) le prix en monnaie nationale des importations augmente sous l'effet de ladvaluation. Ce prix ne varie pas si les quantits et les prix ne varient pas,donc si r|m = et si e m = 0.Par contre, le prix en m onnaie trangre diminue sous l'effet de la dvaluationsauf dans le cas o e m = et T |m = 0.
- 7 7 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
88/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
89/258
L'quilibre des oprations courantes2) le volume des exportations augmente gnralement la suite d'une dva-luation parce que le prix des exportations en monnaie trangre diminuant,l'tranger achte davantage.Ce volume ne varie pas dans deux cas :- si e x = 0 ;- si rix = 0.
Prix des exportations
Volume des exportations
Valeur des exportations
Prix des importations
Volume des im portations
Valeur des importations
Monnaie locale-si h x =o-> Si | E J = ->si h | =0-> si 1 ex | = 0- si h x | = 0- s i h j =- si 1 em 1 = 0i-si h 1 =o- S i | , | = 0i si h J >isi h m 1< 11 =letsi k U oi-si h 1 = 0- s i 1 em 1 = i si Ivi =0^si lej =0i- * s i | - n m | = o
- 7 9 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
90/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
91/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
92/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
93/258
L'quilibre des oprations courantesPremire hypothse : l'quilibre extrieur se dfinit par le seul quilibre de labalance commerciale (au lato sensu) qui se confond avec l'quilibre de labalance des paiements.Deuxime hypothse : les lasticits des offres sont infinies :Xpm = Mpm ;ex et e m infinies,donc 1 + e m = T)x + exLa formule devient alors :
kXpx(rixtant donn que le succs ou l'chec d'une manipulation du taux de changepeut tout autant provenir des mouvements de marchandises que des mouve-ments de capitaux susceptibles eux aussi de dynamiser ou de freiner les effetsd'une variation du taux de change sur la balance, il est prfrable de raisonneravec les demandes de marchandises. Et c'est l tout l'intrt de la prsenta-tion qu'a propose D A Y (1950).D e plus, la formule de Mrs R O B IN S O N sert tout juste dcouvrir les cons-quences d'une baisse du taux de change (dvaluation). Mais elle ne dit pas decombien il faut dvaluer pour corriger un dficit de la balance. Ce que prvoitdu reste la formule de DAY :
avec :- eh, l'lasticit demande nationale de devises trangres ;- ef, l'lasticit de la demande trangre de devises nationales ;- p, le dficit initial de la balance exprime en pourcentage des recettes endevises trangres ;- n, le pourcentage de dvaluation ncessaire pour raliser l'qu ilibre.
- 8 3 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
94/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
95/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
96/258
conomie montaire internationale
En remplaant Log Df (r) par sa valeur, on obtient :L og D f (r) - L og D a(r) + L og 7 - Log D a (r) + L og D a (F)soit : L og D f (r) - L og D a(r) + L og 7 = (ef + ea)(Log F - Log r).S i p rsen t o n ret ran ch e d e ch aq u e c t d e l 'g al i t , l 'ex p ressio n(Log 7 - Log r), on obtient :L og D f (r) - L og D a (r) + L og r = (ef + ea) (Log 7 - L og r) - (L og 7 - Log r),d'o le thorme de D A Y :L og D f (r) - L og D a (r) + L og r = (ef + ea - 1) (Log 7 - L og r) (4)Si l'on traduit la demande allemande de francs en marks, on dfinit pour toutevaleur donne du taux de change une nouvelle variable :A a (r)= I D a ( r )rCe qui permet d'crire :L og Aa (r) = L og ( 1) D a (r)rc'est--dire : L og A a (r) = L og D a (r) - L og (r) (5)En remplaant Da (r) par sa valeur en (1), c'est--dire : ba + ea Log r, onobtient :L og Aa (r) = ba + ea L og r - L og rL og Aa (r) = ba + (ea - 1) L og rCeci est une dfinition valable quel que soit le taux de change, contrairement la relation (3) qui tait une condition d'quilibre vrifie seulement si r = 7.Avec la nouvelle mesure adopte Aa (r), cette condition s'crit tout simple-ment :
Aa(r) (3)'
- 8 6 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
97/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
98/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
99/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
100/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
101/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
102/258
conom ie montaire internationale
1) la position du pays l'gard des produits qu'il importe ou exporte ; car sile pays est trs concurrentiel, mme une faible baisse de ses prix lui assureraun avantage trs important sur les marchs extrieurs ;2) la structure et le niveau de dveloppement.CHANG a russi classer, dans un tableau, les pays ( lasticits normales etperverses) selon leur niveau de dveloppement. C'est ainsi que :- un pays industriel diversifi et de grande dimension, qui peut substituer uneproduction nationale la plupart de ses importations, a une lasticit
demande d'importation forte. Et mme s'il produit certaines matires pre-mires (ce qui donne une lasticit de la demande trangre de ses exporta-tions assez faible), la somme des lasticits de demande est largement sup-rieure 1, d'o un effet normal ;- les pays agricoles seraient presque tous des pays lasticits normales, lespetits pays agricoles tant en meilleure position ;- un pays industriel peu diversifi qui importe des produits alimentaires et desmatires premires dpourvues de substituts nationaux a non seulement unelasticit de demande d'importation faible mais galement une lasticit dedemande d'exportation faible. C'est une conomie effets pervers ;- un pays moyennement industrialis qui importe peu de produits alimentairesmais surtout des matires premires et des demi-produits se situe, selon letableau de CHA N G, au-dessus ou la limite des lasticits perverses, car ila des lasticits-demande d'importation faibles et des lasticits d'exporta-tion plus varies ;
- un pays minier se situe au bas des lasticits perverses.bl -La variation du change, quelle efficacit aujourd'hui ?
De nombreux travaux sur la dvaluation du franc en 1958 et 1969, de la livresterling en 1967 et du dollar amricain en 1971 ont permis de dgager lesprincipaux effets d'une brusque baisse du taux de change en rgime dechanges fixes.A insi, l'effet d'une dvaluation sur la balance commerciale est double :
- 9 2 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
103/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
104/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
105/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
106/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
107/258
L'quilibre des oprations courantesD eux processus m ultiplicateurs retiennent gnralement l'attention :- le processus multiplicateur par accroissement induit d'exportation ;- le processus multiplicateur par accroissement induit d'investissement.En ce qui concerne le processus multiplicateur par accroissement induit desexportations, tout le problme en pays sous-dvelopp rside dans l'emploides recettes nouvelles. Car l'effet de dveloppement sera d'autant plus impor-tant que le secteur d'exportation se trouve mieux intgr dans l'conomienationale et que le pays exporte des biens transforms par des industrieslocales.S'agissant du processus multiplicateur par accroissement induit des investis-sements, il faut convenir qu'il n'y aura d'investissement que si les firmesbnficiaires rinvestissent leurs profits.L'analyse des glissements structurels (dans le cas d'une dvaluation russie)entrane sur une longue priode des transferts intersectoriels de facteurs et deressources. Les activits favorises par le changement de parit attirent lamain-d'uvre et les capitaux, d'o une augmentation de la production.Il existe gnralement dans les pays sous-dvelopps des obstacles extrieursmajeurs aux effets normaux de la dvaluation. Ce sont notamment :- les tarifs et contingents imposs par les pays acheteurs. En effet, ces tarifsou taxes, en s'ajoutant aux prix de vente des pays producteurs de biens pri-maires, rduisent le march de ces biens ;-l'existence d'oligopoles et de monopoles sur les marchs mondiaux. Cesmonopoles trangers sont mme de capter le bnfice de la dvaluation enrduisant (ou en annulant) la baisse des prix la production par une haussedes cots intermdiaires d e transport et de vente ;- l'aide internationale.
- 9 7 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
108/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
109/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
110/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
111/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
112/258
Economie montaire internationale
C -T erm es de l'change de position et termes de l'change d'volutionAlors que les termes de l'change de position indiquent les conditions abso-lues de l'change, c'est--dire ce qui est export en change de ce qui estimport (ils analysent le gain d'un pays un moment donn) les termes del'change d'volution indiquent les conditions relatives de l'change, c'est--dire si le pays exporte plus ou moins qu'auparavant pour obtenir ce qui estimport. Les termes de l'change d'volution reprsentent alors un rapportd'indices.Il existe un autre concept des termes de l'chan ge : les termes de l'chang e derevenu, exprims par le rapport : indice de la valeur des exportations surindice des prix l'importation. Ils indiquent les changements dans le volumedes importations qui peut tre achet par les exportations. Ce concept a tanalys par DORRANCE (1948-1949).
2. L es facteurs qui agissent su r les termes de l'changeDe nombreux facteurs agissent sur les termes de l'change d'un pays maisnous en retiendrons principalement trois :- l'intensit relative des demandes du pays et de l'tranger ;- le niveau de dveloppement du pays ;- la politique de change du pay s.Pour ce qui est de l'intensit relative de la demande du pays et de l'tranger, ilfaut savoir que lorsqu'un pays accrot sa demande de produits de l'tranger oulorsque l'tranger diminue sa demande de produits de ce pays, il s'ensuit unedtrioration de ses termes de l'change. L'ampleur de cette dtrioration estfonction de l'lasticit de la demande de biens trangers par le pays consi-dr, c'est--dire que la dtrioration est d'autant plus grande que cette lasti-cit est faible.En ce qui concerne le niveau de dveloppement, il faut retenir que les cotsde production en longue priode ont tendance baisser au fur et mesurequ'une conomie se dveloppe, d'o une baisse dans les prix d'exportation et
- 1 0 2 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
113/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
114/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
115/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
116/258
Econom ie montaire internationale
1. Rappel des quations fondamentalesEn conomie ferme, nous avons le revenu qui, l'quilibre, est gal ladpense :R evenu = Produit ou D pense Y = PO r, le revenu (Y) se dcompose en consommation (C) et en pargne (S ), soit :Revenu (Y) = Consommation (C) + Epargne (S)et la dpense, en dpense pour les biens de consommation et dpense pour lesbiens d'investissement, soit :D pense (P) = Consommation (C) + Investissement (I) d'o l'galit :C + S = C + I, soit S = IL'quilibre du revenu global dpend donc de l'galit entre l'pargne et l'in-vestissement. Cette galit est toujours ralise ex post, grce au mcanismedu multiplicateur par une hausse du revenu (qui dgage une pargne suppl-mentaire) ou par une rduction du revenu (qui rduit l'pargne).D eux hypothses sont du reste envisages par les post-keynsiens. E lles sontfonction des pentes respectives des droites (SS) et (II), reprsentant respective-ment les fonctions d'pargne et d'investissement.Les positions relatives des deux courbes, pargne (SS) et investissement (II),sont reprsentes dans les graphiques prcdents :
Hypothse 1 : quilibre stableSi
Hypothse 2 : quilibre instableI
- 1 0 6 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
117/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
118/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
119/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
120/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
121/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
122/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
123/258
L'quilibre des o prations courantesLes conditions nouvelles de l'quilibre macro-conomique et l'existenced'une fonction d'importation vont permettre de prsenter deux phnomnesimportants. D 'une part, une variation des ventes l'tranger donne naissance un effet de multiplication du ct du revenu national. D 'autre part, la propa-gation des flux ns de la variation des investissements est affecte par l'exis-tence des relations avec l'extrieur. Ce qui nous amne parler du multiplica-teur du commerce extrieur et du multiplicateur d'investissement.S E C T I O N 2 : L E M U L T I P L IC A T E U R D U C O M M E R C EEXTRIEURL'approche par le revenu applique le multiplicateur keynsien une conomieouverte. S on objectif est de mettre en vidence :1) les relations entre les flux externes et l'activit conom ique interne ;2) les mcanismes correcteurs des dsquilibres externes par une variation durevenu global et de l'emploi.
1. L a formule gnrale du multiplicateur du comm erce extrieurLe jeu de l'investissement et de l'pargne en conomie ferme va pouvoir tretranspos dans le cadre d'une conomie ouverte aux relations entre les expor-tations et les importations.Pour dcrire les mcanismes du multiplicateur du commerce extrieur (car ily en a plusieurs), on admet les hypothses suivantes :1) il y a sous-emploi, autrement dit possibilit d'un flux additionnel par lamise en route de facteurs, les rendem ents tant supposs constants ;2) tous les prix (salaires et intrts) sont constants ;3) toute exportation est lie une activit de production et entrane par le faitmme une distribution de revenu ;4) les importations sont substituables aux produits et aux services domes-tiques ; ce qui signifie qu'on n'importe que des biens de consommation,l'investissement tant uniquement ralis partir des produits dom estiques.
- 1 1 3 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
124/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
125/258
L'quilibre des oprations courantesII vient :
(Aid + AX)1 = cd + AYD'o:
(Aid + AX)l - c d =AYou encore :
AY(l-cd) = AId + AX.On en tire la valeur de AY :
Paralllement, l'quation (1) Y = Cd + M + S peut s'crire sous forme devariation :AY = ACd + AM + AS, ce qui donne :
AY ACd AM AS _,, = + | , d ou :AY AY AY AY
1 = Cj + m + set1 - cd = s + m.On en dduit la valeur de AY :
- 1 1 5 -
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
126/258
-
7/27/2019 economie_monetaire_internationale_2843710278_content.pdf
127/258