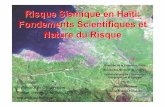Développement local en HAÏTIDéveloppement local en HAÏTI · picales (malaria, chykungunya,...
Transcript of Développement local en HAÏTIDéveloppement local en HAÏTI · picales (malaria, chykungunya,...

Kanpé Kanpé
Magazine de l’AFHAD
N°54
Décembre 2015 Association France Haïti Développement
Développement local en HAÏTIDéveloppement local en HAÏTI

EDITO :EDITO :EDITO :
Changements climatiques et le Développement local en HAÏTI
La COP21 nous interroge sur les impacts
des changements climatiques dans le dé-
veloppement local en Haïti.
Ces changements, causés par les activités
des hommes et un partage inéquitable
des ressources, ont des conséquences im-
portantes pour les populations des pays
du Sud, qui pourtant en sont les moins
responsables.
Les effets se mesurent en 3 points :
· La sécheresse et la rareté de l'eau, pota-
ble et agricole, cette dernière affectant
directement la sécurité alimentaire.
· Les inondations et les ouragans, les pays
tropicaux étant fragilisés par la destruc-
tion des infrastructures, l’atteinte des ré-
coltes et la précarité des habitations
(bidonvilles et zones côtières).
· L’augmentation des cas de maladies tro-
picales (malaria, chykungunya, dengue)
et les infections gastro-intestinales dues à
la contamination de l'eau potable par les
inondations.
Pour notre association de coopération
internationale, la réponse est dans l’inté-
gration de ces risques climatiques à tout
projet de développement. Bien se
connaître, identifier et partager les diffi-
cultés, faire évoluer les projets.
Une telle mobilisation se fera par une
démarche commune avec les partenaires
haïtiens dans des relations de confiance.
Les objectifs sont d’abord, de sensibiliser,
ici et là-bas, les populations et les acteurs
locaux aux enjeux des changements cli-
matiques, puis de former et promouvoir
les bonnes pratiques d’adaptation dans
les secteurs agricoles et énergétiques en
particulier.
Pour l’AFHAD, cette prise de conscience
partagée est un préalable aux réalisations
techniques à venir.
Sommaire :
Le Parrainage scolaire
Le Plan Communal de Développement
La coopération décentralisée avec Desdunes
Les bonnes pratiques de coopération internationale
Le vaudou
Nos prochaine évènements
KanpéKanpéKanpé N
°54 D
écem
bre 20
15
K
anp
é
Photo de couverture : Habitations au village de Modèle, dont l’une des problématiques est l’accès à l’eau, agricole et domestique.
««« DeboutDeboutDebout » en Créole haïtien» en Créole haïtien» en Créole haïtien

Parrainage Scolaire
Page 3
Cette convention tripartie (AFHAD –
Alter Aide – CIG) délègue à l’associa-
tion haïtienne Alter Aide la fonction de
chargé de projet pour ce partenariat.
Elle prend effet à cette rentrée scolaire
2015/2016, pour une durée de 3 ans.
Nous sommes heureux de souligner la
réussite du patient travail, réalisé depuis
2007 avec l’AFHAD Desdunes. Ce qui
permet une plus grande autonomie, un
rôle plus actif et responsable des bénéfi-
ciaires. Cela renforce la pérennité du
partenariat et garantit nos engagements
près des donateurs.
Le parrainage scolaire de l’AFHAD n’est
pas un parrainage d’élèves mais de 6
écoles publiques. Il soutient l’ensemble
des actions pédagogiques : formation
des maîtres, matériels didactiques, four-
nitures, etc.
La dotation de la rentrée 2015 s’élève à
1.000$us par école ; elle est financée
exclusivement par les dons réguliers des
parrains.
La rentrée scolaire à Desdunes s’est dé-
roulée normalement, comme les années
précédentes, avec un décalage d’un
mois, après la date officielle du 7 sep-
tembre 2015. Les effectifs sont stables
avec une moyenne de 40 à 50 élèves
par classe.
Le fait le plus marquant de cette rentrée
est la signature d’une nouvelle conven-
tion de partenariat avec les écoles, ras-
semblées dans le Comité Interscolaire
de Gestion (CIG) qui coordonne le par-
rainage et le fonctionnement des canti-
nes scolaires. Cette convention vient
remplacer celle qui nous liait à l’AF-
HAD Desdunes, arrivée à son terme en
juin 2015.
Le CA de Nantes, s’appuyant sur l’expé-
rience et la proposition des enseignants,
a décidé de travailler directement avec
le CIG. L’objectif est de simplifier le
fonctionnement du parrainage.
Depuis 2012, nous avons engagé un partenariat avec l’association nantaise
KLALI Le Partage, au profit de l’école de Descahos, dont elle assure l’intégrali-
té du parrainage (1.000$us par an).
En outre, elle étudie son engagement sur le projet d’aménagement et d’amé-
lioration du cadre scolaire élaboré par le Comité de Gestion de l’école de Des-
cahos.
Cette école primaire se situe dans un quartier très pauvre accolé au centre ville
de Desdunes. Ses bâtiments sont délabrés, et l’Etat haïtien n’a pas prévu de
programme de rénovation.
Ce projet a pour objectifs de créer des classes séparées et sécurisées dans le
bâtiment actuel et de finaliser la clôture de l’école. Son exécution fera appel à
la main-d’œuvre et aux entreprises locales.
Kanp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Devenez parrain
d’une école pour
10€ par mois
Coût annuel
après déduction
fiscale = 40€
Partenariat avec KLALI - Le Partage
Un projet d’aménagement de classes séparées et plafon-nées pour l’école de Descahos, en collaboration avec
l’association nantaise partenaire KLALI
Préparation des repas à la cantine de Grand Islet
Carole JEAN, directrice de l’école de Modèle

Le Plan Communal de Développement de Desdunes
(PCD) se clôture en décembre 2015. Il est le fruit d’un
long travail participatif visant à planifier le développe-
ment de la commune au niveau local. Ce plan a été
élaboré dans le cadre des règlements ministériels haï-
tiens.
Concrètement, ce plan permet d’intégrer un diagnostic
de la situation de la commune et de ses potentialités,
une analyse des problèmes et des orientations du dé-
veloppement à suivre, conduisant à l’élaboration de
projets et au cadrage de l’investissement.
Le GAFE s’est appuyé sur son expé-
rience acquise dans l’élaboration du
PCD de la commune de Kenscoff,
ainsi que sur son expertise dans les
domaines de la planification, de l’en-
vironnement et de l’éducation.
En particulier, le GAFE apporte une
vision géographique aux PCD, en
basant la description du territoire et
la planification du développement
sur des outils cartographiques et d’a-
nalyse spatiale.
Pour réaliser le PCD, le Groupe
d’Action Francophone pour l’Envi-
ronnement (GAFE) a monté des
structures intégrant les représentants
du gouvernement central, des auto-
rités locales et de la société civile.
Ceci a permis d’organiser les proces-
sus de collectes d’informations et de
planifications par le Comité de Ges-
tion Communale (CGC) et les Comi-
tés Locaux de Coordination.
L’identification des problèmes et des
opportunités de développement ont
été réalisées par secteurs d’activité,
en intégrant les acteurs locaux les
plus pertinents dans des tables secto-
rielles et en suivant une méthodolo-
gie participative.
Deux années d’enquêtes, d’expressions et d’analyses
Plan Communal de Développement de Desdunes
Page 4 K
anp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
L’AFHAD,
cofinanceur avec
l’Union
Européenne, se
félicite d’avoir été
à l’initiative de ce
grand mouvement
de démocratie
participative
Election du Comité Locale de Concertation du village de La Hatte Desdunes
Concertation avec la population du village de Modèle
Crédit photos : GAFE
Formation des membres du Comité Communal de Gestion aux politiques publiques
Type de visuel illustrant le rapport du PCD de Desdunes

La planification en elle-même, réalisée par les
acteurs locaux et basée sur les informations
produites dans le diagnostic, afin d’orienter
les actions de développement de la commu-
ne pour la prochaine décennie.
Le document du PCD de Desdunes comprend
trois parties :
Une présentation de la méthodologie mise
en place par le GAFE avec les acteurs locaux
afin d’obtenir les informations par secteurs et
de planifier les réponses aux problèmes iden-
tifiés.
Un diagnostic de la situation sociale, écono-
mique et environnementale de la commune
permettant d’identifier et de décrire les prin-
cipaux problèmes mais également les oppor-
tunités de la commune.
Un outil de travail et de référence pour 10 ans
Le PCD de Desdunes constitue un outil indispensable au développe-
ment de la commune et, de façon plus concrète, à l’amélioration des
conditions de vie de ses habitants.
Ainsi, la population de Desdunes demeure maîtresse de son dévelop-
pement et fait l’expérience d’une méthodologie de planification
qu’elle pourra appliquer de nouveau à plus long terme.
Un plan de planification pour la commune
Page 5 K
anp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Réhabilitation de 800m d’irrigation pilotée par le Comité de Gestion Communal
C’est la 1ere fois que la diaspora est associée aux projets de développement de Desdunes
Election du Comité Locale de Concertation de La Hatte
Crédit photos : GAFE
Formation du CGC à l’aménagement du territoire
Implication et mobilisation des responsables locaux dans le PCD

Les objectifs d’une Coopération Décentralisée (Coop Déc) entre deux
collectivités territoriales se résument par le partage d’expériences Nord/
Sud et Sud/Nord, la découverte, les échanges sur des valeurs commu-
nes : l’environnement, le vivre ensemble, la fraternité, les échanges
culturels, le jumelage d’associations, les animations sur le territoire, etc.
L’AFHAD a anticipé la réalisation du Plan Communal de Développe-
ment (PCD) de Desdunes, en recherchant une collectivité de l’agglomé-
ration nantaise susceptible d’engager une coopération décentralisée
avec la mairie de Desdunes. Nous en présentons ici l’historique, les ré-
sultats et les perspectives.
Il est apparu un décalage d’échelle
entre les dimensions deux villes et une
non-préparation de la municipalité de
Desdunes à rentrer et conduire une
Coop Déc.
La Ville de Nantes réfléchissait à
concrétiser une Coop Déc avec une
commune en Haïti.
L’AFHAD évaluait alors, avec le servi-
ce de coopération internationale de la
Ville de Nantes, le projet de rénova-
tion du réseau de distribution d’eau
potable de la ville de Desdunes. Une
coopération décentralisée rendait ac-
cessible un financement spécifique
pour l’eau potable et l’assainissement
dit : « loi Oudin ».
Dans cette optique, l’AFHAD a ac-
compagné à Desdunes une délégation
conduite par deux élus de la Ville de
Nantes.
2007 / 2009
Notre démarche pour une Coopération Décentralisée
avec Desdunes
La Ville de Nantes s’est finalement associée avec plusieurs villes de
l’ouest français pour engager une Coop Déc avec l’Association des
Maires du département de la Grande Anse en Haïti (AMAGA).
La Mairie de Desdunes, l’AFHAD et le GAFE ont entrepris l’élabo-
ration d’un projet de PCD.
Parallèlement, l’AFHAD engage des contacts et des actions de plai-
doyer auprès de municipalités de « Nantes Métropole ».
Des rencontres d’informations et de réflexions sont menées avec
les élus des Sorinières.
2010 / 2012
Page 6 K
anp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Une COOP DEC
est un partage
d’expériences et
d’échanges sur
des valeurs
communes.
Réunion publique d’information aux Sorinières
Schéma du réseau d’eau potable commun aux deux communes : L’Estère et Desdunes
Echanges Nord / Sud à Nantes en 2008

Le processus du PCD a débuté à Desdunes. L’AFHAD
et la Mairie des Sorinières ont poursuivi leur ré-
flexion commune. Au retour d’une mission de l’AF-
HAD en Haïti, une réunion publique est organisée
aux Sorinières en mars 2013.
La rencontre avec le service de Coopération Interna-
tionale de la Ville de Nantes a confirmé une vision
commune sur le développement et la gouvernance
locale. La coopération AFHAD / GAFE dans l’accom-
pagnement de la Mairie de Desdunes constitue un
exemple concret d’une action de partenariat Nord /
Sud. Les élus de Nantes Métropole sont sensibilisés à
la réflexion de l’AFHAD en vue d’une Coopération
Décentralisée entre Desdunes et une commune de
l’agglomération.
décision des élus français, pour qui
seuls des élus légitimes haïtiens peu-
vent être des interlocuteurs valables.
L’échéance des élections municipales
de mars 2014 en France a différé la
concrétisation d’un engagement, mê-
me de principe, vers une Coop Déc
ou un jumelage. Une telle décision
appartiendrait à la nouvelle équipe
municipale.
Par ailleurs, le retard apporté aux
élections municipales en Haïti a en-
traîné la nomination, par le prési-
dent Martelly, d’agents remplaçant
les maires élus. Ceci a eu comme
conséquence d’inhiber toute prise de
Report d’engagement :
Pour engager une Coop Déc, une collectivité locale française
attend de ses interlocuteurs haïtiens qu’ils soient aptes à for-
muler des demandes techniques précises. Ces demandes doi-
vent correspondre au « cœur du métier » d’une municipalité :
Etat civil, entretien de voiries, collecte des ordures, fiscalité,
etc.
Le document du PCD sera l’outil argumenté de ces deman-
des. Sa publication sera le moyen de relancer la recherche
d’une Coop Déc auprès d’une commune nantaise.
Perspectives :
Page 7 K
anp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Seuls des élus
haïtiens légitimes
peuvent être des
interlocuteurs
valables d’une
COOP DEC.
Quelles installations sportifs et de loisirs ? Des équipements publiques définis au PCD et porter par la
mairie de Desdunes
Réunion de travail avec les responsables du service de la Coopération Internationale de la Ville de Nantes
2013 / 2015
L’aménagement de la place publique en février 2015 Le lieux des animations du centre ville de Desdunes

L’AFHAD a participé aux Rencontres
Nantaises de la Coopération Internatio-
nale, depuis le 25 juin 2015, organisées
par la Ville de Nantes.
Son objectif est de renforcer la synergie
entre les acteurs : institutions, entreprises,
mouvements de jeunesse ou de diaspora,
associations de coopération internationa-
le ou de promotion des droits humains,
porteurs de projets culturels, écoles et
universités, centres de recherche.
Nous vous présentons la contribution de
l’AFHAD à cette réflexion collective sur
les thèmes retenus :
Tenir compte d’un contexte local.
Mener une coopération durable.
S’appuyer sur le retour d’expériences
d’actions analogues est indispensable.
D’où l’intérêt d’être en réseau thémati-
que, en France et en Haïti. L’expertise
française doit appuyer l’expertise locale
et la renforcer.
Les partenaires s’accordent sur le dossier
de projet et les procédures (dépenses,
calendrier, pilotage, suivi, conséquences
du non respect des engagements, etc) en
définissant les droits et les devoirs de cha-
cun. Ainsi leur coresponsabilité débute
dès le diagnostic initial et le montage de
projet.
(Suite page 9)
Etant donné les grandes différences
(environnements sociaux, culturels, éco-
nomiques et politiques) entre les partenai-
res, il y a risque de réaliser des actions
inopérantes, voire préjudiciables pour les
bénéficiaires.
Notre expérience de 20 ans en Haïti nous
a permis de valider quelques bonnes pra-
tiques de coopération :
Partir d’une demande exprimée des par-
tenaires, en vérifier la source (Groupe
d’intérêts ou implication de la commu-
nauté), l’intérêt et la faisabilité. Ce dia-
gnostic initial doit impliquer les deman-
deurs, les autres membres de la commu-
nauté, les notables et les autorités locales,
en fonction de leur crédibilité et leur re-
présentativité.
Rencontres Nantaises de la Coopération Internationale.
Tenir compte d’un contexte local.
Kanp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Page 8
La finalité de nos
projets est de
renforcer les
compétences et
l’autonomie
d’acteurs locaux.
L’AFHAD n’a
aucune légitimité
à penser, décider
et agir à la place
des autorités
locales et des
partenaires
Haïtiens
Evaluation commune des besoins réels des bénéficiaires
Coresponsabilité par l’implication des bénéficiaires et des acteurs d’un projet
Travailler en partenariat avec les compétences locales

Mener une coopération durable
Un développement
durable tient
compte des enjeux
économiques,
sociaux et
environnementaux.
« Durable » signifie
également que les
actions sont
pérennes.
Kanp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Page 9
Trouver de réels besoins communs qui
permettent d’inscrire une interaction dans
la durée. Le partage d’une vision commu-
ne est un préalable à un partage des inté-
rêts.
Assurer la pérennité sociale en s’appuyant
sur la demande des bénéficiaires et la pri-
se en compte des exclus et opposants
éventuels au projet. Vérifier que les inté-
ressés sont « intéressés » et que les désé-
quilibres initiaux régresseront.
La finalité d’un projet est qu’il soit viable
économiquement, socialement et que les
bénéficiaires se l’approprient. Cela suppo-
se une 1ère
phase préalable de sensibilisa-
tion et de formation.
S’assurer que les techniques mises en œu-
vre correspondent aux capacités locales,
ainsi qu’au matériel disponible et utilisé
dans le pays.
Donner la priorité au transfert de compé-
tences (plutôt que de matériels) est essen-
tiel. Un projet doit renforcer l’économie
et les compétences locales, non pas les
concurrencer.
Elaborer un projet progressif : La 1ère
pha-
se « sociale » de sensibilisation, de mobili-
sation et de formation permet de définir
les critères qui feront l’objet d’une 2ème
,
voire d’une 3ème
phase plus « technique ».
Imaginer comment le projet peut être
reproductible et incitatif pour les
« exclus » afin d’initier une dynamique
locale autour de sa thématique.
En cours d’exécution du projet, toutes les
parties prenantes restent en relation étroi-
te par la mise en place d’un pilotage
conjoint et d’évaluations continues des
actions. Cette implication directe renforce
les capacités des acteurs locaux.
L’évaluation finale et sa capitalisation doi-
vent être conjoin-
tes et faire l’objet
d’une publication
en France et en
Haïti.
Les partenaires définissent et contractuali-
sent en commun les choix, priorités, mé-
thodes et rythme du projet. Un projet est
aussi un moyen d’évolution partagée des
pratiques et des mentalités. Des chargés
de projets locaux, ayant la double culture
Nord/Sud, favorisent ces échanges.
La pérennité d’un projet repose sur l’anti-
cipation de l’appropriation du projet par
les bénéficiaires (échéance, résultats atten-
dus, continuation après l’action en coopé-
ration).
(Suite de la page 8)
Une communication locale claire, compréhensible de toute la population.
Répondre à des besoins réels pour un fonctionnement pérenne.

Kanp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Page 10
Officiellement plus de 50% des Haïtiens sont
catholiques et environ 25% sont protestants,
toutefois tous les Haïtiens sont imprégnés de la
culture et des traditions vaudou (y compris s’ils
se déclarent adeptes d’un rite chrétien). La pra-
tique de cette religion est cependant réservée
aux initiés.
Le vaudou haïtien est la synthèse entre des
croyances de divers peuples d’Afrique de
l’Ouest (majoritairement de la région du golfe
du Bénin) mis en esclavage en Haïti, de certai-
nes pratiques des premiers habitants de l’île et
du catholicisme.
Le mot vaudou vient de « vodu » qui, dans la
langue fon (parlée au Bénin), signifie « divinité »
au sens large, « ce qui est mystérieux pour
tous ».
LE VAUDOU
Nombreux en Haïti sont ceux qui croient que les
« Oungan » (prêtres vaudou) ont le pouvoir de res-
susciter les morts. Le « Oungan » dérobe l’âme du
cadavre qu’il réanime en un automate sans conscien-
ce ni volonté : le Zombi. Cette créature misérable
est sensée devenir l’esclave absolu de son maître. Les
prétendus Zombis sont de fait des gens drogués par
un sorcier, déclarés morts et maintenus sous l’empri-
se de la drogue pendant la durée de leur esclavage
sur une exploitation agricole.
A chaque saint catholique correspond un lwa (loa)
vaudou (Legba est le pendant de Saint Pierre).
Il n’existe qu’un Dieu mais il existe des milliers de
divinités vaudou : les « Lwa » (Loa : esprit, ange ou
« mystère ») dans la religion vaudou. Quelques
exemples : Legba (qui détient les clés de l’Enfer et
du Paradis), Ezili (Dieu de l’amour), Gu (Dieu de la
guerre), Sakpata (Dieu de la maladie), Hebieso
(Dieu de l’orage et de la foudre).
Le vaudou a également servi de
prétexte pour la scission du pays
en deux pôles : d’un côté, les
paysans « non civilisés » constitués
par les noirs qui pratiquent le vau-
dou et de l’autre, les mulâtres qui
composent la bourgeoisie des vil-
les. L’histoire politique d’Haïti est
marquée par cette pratique : Fran-
çois Duvalier a su utiliser tout l’i-
maginaire vaudou pour asseoir son
pouvoir, en se proclamant « Baron
Samedi », esprit de la mort.
Au début, le vaudou a été l’élé-
ment fédérateur des esclaves
contre leurs maîtres. Victime de
persécution de la part des esclava-
gistes, cette religion a longtemps
été réprimée et diabolisée, même
après l’indépendance. En 1826, le
code pénal haïtien prévoit amen-
des et emprisonnements pour les
pratiquants du vaudou. Il ne sera
dépénalisé qu’en 1987.
Le vaudou a eu une grande impor-
tance dans la révolte et l’émanci-
pation des esclaves avec la célèbre
cérémonie vaudou de Bois Caïman
qui amorça l’insurrection des escla-
ves, le 22 août 1791, menée par le
leader marron Boukman.
Surprenant
Un brin d’histoire
Temple Vaudou à la sortie de Desdunes
Cérémonie Vaudou sur l’estran au village de Hatte Desdunes

Kanp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
Page 11
Même si l’image du vaudou colle fortement à
Haïti, sa présence n’est pas forcément très faci-
le à percevoir. Il est également difficile d’accé-
der aux cérémonies. On peut éventuellement
assister à des cérémonies pour non initiés. Il
s’agit alors d’une manifestation de type folklo-
rique.
Les cérémonies ont lieu la nuit, en grand secret,
dans les temples vaudou « Ounfò », où les
« Lwa » disposent de leurs cases propres « kay
mistè » et reçoivent les hommes, leurs servi-
teurs.
Sous la direction d’un « Oungan » ou d’une
« Mambo », les fidèles y viennent pour entrer
en relation avec les « Lwa ». Au centre du péris-
tyle, véritable salle de danse où les « Lwa » se
manifestent, de nombreuses danses circulaires
sont effectuées autour d’un serpent réputé
connaître le passé et l’avenir.
Diverses offrandes ou nourritures sont dispo-
sées autour du socle de « poto mitan » (un trait
d’union emblématique entre l’homme et l’invi-
sible). Sur l’autel sont disposés les objets rituels
des « lwa » : des cruches habillées à leurs cou-
leurs, des bouteilles ou des « potè » (pots de
terre) dans lesquelles sont enfermées des âmes
maintenues proches des « Lwa » afin d’obtenir
leur protection.
Les figures symboliques tracées sur le sol, les
« Veve », attirent les « Lwa » qui prennent alors
possession des fidèles. On dit qu’ils les
« chevauchent ». Durant la transe, le fidèle se
conforme au comportement attribué au
« Lwa » : s’il est chevauché par Gu, il se mon-
trera menaçant.
La ville de Saut d’eau (département du Plateau
Central) est communément appelée Ville Bon-
heur. En juillet, se déroule aux pieds des chutes
d’eau un grand pèlerinage vaudou.
L’excitation, l’agitation
se mêlent à l’inquiétude
liée à la présence des
esprits. Dans les eaux
écumantes au pied de la
cascade, dans les rires,
les cris et les invocations,
on se baigne à demi-nu.
On se croise, on s’entrai-
de sur les rochers glis-
sants, on s’enivre de la
violence des chutes. On
se baigne aussi dans la boue, limon originel et
fécond d’où est sortie la vie. Les corps s’y plon-
gent, pris d’étranges convulsions.
L’eau permet de se fondre, de s’oublier, de
tuer symboliquement les maux du quotidien et
de « laver sa déveine ».
Si vous allez en Haïti
A chaque saint
catholique
correspond une
divinité vaudou
Temple Vaudou entre l’Estère et Aux Sources
A Desdunes, les combats de coqs se déroulent dans l’arène
« gagè » du temple vaudou

Prochains évènements à Nantes
La Compagnie NELLY DAVIAUD est heureuse
de vous présenter pour sa 56ème saison la
comédie de Daniel Wilder, adaptation de
Maurice Risch :
DRÔLES DE PARENTS !
La Compagnie joue au profit de l’AFHAD :
Salle Vasse, 18 rue Colbert, NANTES
- Samedi 23 janvier à 20h30
- Dimanche 28 février à 15h00
Pensez à réserver auprès de Gérard Fribault,
le trésorier de l’AFHAD
Théâtre
Concert de chant choral
Gens qui chantent - Gens qui rient
C’est une chorale nantaise pétillante. Son répertoire est coloré, de Mozart
à Gainsbourg, d’Haendel à Bécaud ou Anne Vanderlove.
« Notre plaisir est de découvrir des styles variés à travers des époques diffé-
rentes, classiques ou modernes, en français ou en langues étrangères. Nous
nous attardons un peu plus dans la variété de la chanson contemporaine. »
Dimanche 20 mars 2016
16h00 - Salle Bretagne
23 rue Villebois Mareuil
Nantes
Kanp
é
N°54 D
écem
bre 20
15
AFHAD
6 place de la Manu
44000 - NANTES
02.40.29.06.13
www.afhad.org
Directeur de publication: Alain GARAUD - CPPAP 77009AS - Publication gratuite - Crédit photos AFHAD
Rédaction: P. LAILLE, G. GUILLET, Thérèse NOMBRET, P. DUPENOR, Lude DAVOUST, JF. TOURNADE
![WOMEN TREASURES OF HAÏTI - AWA-Connect€¦ · WOMEN TREASURES OF HAÏTI ... - Sergeant in Toussaint Louverture’s army ... Microsoft PowerPoint - WOMEN'S_TREASURES_of_HAITI[1]](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5b2997267f8b9a387e8b4660/women-treasures-of-haiti-awa-women-treasures-of-haiti-sergeant-in.jpg)