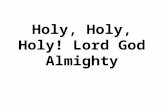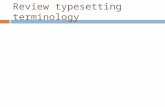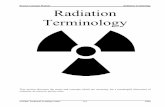Danielou, Review of the Terminology of the Holy Cross in Early Christian Literature as Based Upon...
-
Upload
joshua-harris -
Category
Documents
-
view
3 -
download
1
description
Transcript of Danielou, Review of the Terminology of the Holy Cross in Early Christian Literature as Based Upon...
-
The Terminology of the Holy Cross in Early Christian Literature as Based upon OldTestament Typology by Gerardus Quirinus ReijnersReview by: Jean DanilouGnomon, 39. Bd., H. 3 (Jun., 1967), pp. 256-259Published by: Verlag C.H.BeckStable URL: http://www.jstor.org/stable/27684171 .Accessed: 25/07/2014 01:45
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Verlag C.H.Beck is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Gnomon.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 192.231.59.35 on Fri, 25 Jul 2014 01:45:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
-
256 J. Dani?lou: Reijners, The Terminology of the Holy Cross
Si je ne puis donc ?tre totalement d'accord avec les conclusions de M. Weische, ni m?me avec certains points de sa m?thode, je me plais cepen dant ? signaler le grand int?r?t de son travail. Il est riche de suggestions et
engage ? la r?flexion. Souhaitons qu'il ouvre la voie ? un utile compromis entre ceux qui ont mis en avant dans la vie politique romaine le r?le des rivalit?s personnelles et ceux qui voient la question uniquement sous l'angle id?ologique. Les recherches dont un sch?ma nous est ici propos? peuvent conduire ? une connaissance plus approfondie et plus juste de certains aspects du vocabulaire politique latin.
Lille Joseph Hellegouarc'h
*
Gerardus Quirinus Reijners: The Terminology of the Holy Cross in Early Christian Literature as Based upon Old Testament Typology. Nijme gen: Dekker & van de Vegt N.V. 1965. XXIV, 226 S. (Graecitas Christianorum Prim aeva. 2.) 22,50 hfl.
Le livre de G?rard Reijners porte sur une question fort int?ressante du christianisme primitif. La croix a ?t? l'instrument du supplice du Christ.
Mais tr?s t?t on lui a donn? une signification symbolique. Et ceci en par ticulier en recherchant ses figures dans l'Ancien Testament, soit quant ? sa
mati?re, soit quant ? sa forme. L'apocalyptique chr?tienne a par ailleurs
valoris? sa signification cosmique. Les principaux ?l?ments de cette sym bolique de la croix ont d?j? ?t? rassembl?s. Mais l'int?r?t du livre de Reij ners est d'avoir repris cette enqu?te sur une base philologique, ? partir des termes employ?s pour d?signer la croix. Il concerne ainsi ? la fois la
philologie, la typologie et aussi la liturgie, puisqu'il aborde la question de la signatio dans sa derni?re partie. L'auteur aborde successivement les
principales d?signations et pour chacune d'entre elles proc?de ? un d?
pouillement m?thodique des textes des auteurs grecs du Premier et du Second Si?cle, auquel il a ajout? Tertullien.
Les deux expressions qui entrent d'abord en consid?ration sont celles
qui d?signent proprement la croix dans le Nouveau Testament, crrocopo? et ^uXov. Reijners fait des remarques int?ressantes sur leur pr?histoire. Le
mot ?uXov, qui signifie proprement un pieu, peut d?signer dans la litt?ra ture grecque profane un instrument de supplice. Mais il est inconnu des
LXX. Ceux-ci par contre se servent du mot ?uXov pour traduire l'h?breu
'es, qui d?signe toute esp?ce de bois, mais en particulier l'arbre ou le gibet auquel on suspendait apr?s leur mort le corps des supplici?s (Deut., 21, 22-23). Mais chez Josephe on trouve ?oXov employ? au sens decrTaupo? pour d?signer le supplice de la croix. Cela ?tait d'autant plus facile que ?uXov pouvait en grec profane d?signer des instruments de supplice, comme le pal (p. 10). La langue jud?o-hell?nistique, contemporaine des Evangiles, rendait donc possible la d?signation de l'instrument de la mort du Christ par ?uXov.
This content downloaded from 192.231.59.35 on Fri, 25 Jul 2014 01:45:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
-
J. Dani?lou: Reijners, The Terminology of the Holy Cross 257
L'usage du Nouveau Testament est remarquable. Dans les quatre
?vangiles et dans les ?p?tres pauliniennes, nous trouvons toujours cnrocupo? pour d?signer la croix du Christ. Ceci v?rifie que GTocupo? est le terme nor
mal dans la Koin? pour la croix instrument de supplice. Il faut ajouter que chez Paul le mot se charge de tout le myst?re r?dempteur. Il n'emploie qu'une fois ?uXov, en relation avec Deut., 21, 23. Par contre dans le reste
du Nouveau Testament, nous trouvons ?uXov et non rjTaupo?. On voit bien ce qui va constituer la diff?rence dans l'usage des deux mots. L'expression usuelle est ?videmment rrraupo?. L'usage de ?uXov impliquera une inten tion de r?f?rence ? l'Ancien Testament. Et cela sur un double plan.
D'abord, ? la suite de Paul, par le rapprochement mat?riel entre l'arbre ou le gibet, o? ?taient suspendus les criminels apr?s leur supplice chez les
Juifs, et le pieu, instrument de supplice dans le monde hell?nistique. Et ensuite par l'analogie ?tablie entre la croix, devenue un ?uXov, et les di verses significations de ?uXov dans l'Ancien Testament.
C'est cette typologie de la croix que nous allons surtout rencontrer
maintenant. C'est d?j? le cas dans l'cEp?tre de Barnabe*. L'auteur em ploie huit fois GTaupo?, toujours pour d?signer la croix en tant que r?alit? historique. Et il emploie neuf fois ?uXov, pour la d?signer en r?f?rence ? l'Ancien Testament. Reijners montre bien (p. 24) que dans 10, 6-8, le sens du texte est de montrer que le ?uXov de Ps. 1, 3 (10, 6) d?signe le oraupo? de la Passion (10, 8). On pourrait dire en d'autres termes que ??Xov d?signe la figure et crraupo? la r?alit?. Un point que Reijners n'a pas assez soulign? est que dans certains cas ?uXov a ?t? appliqu? au Christ avant de l'?tre ? la croix. Cela est ?vident dans 12, 1 o? ?uXov, comme je l'ai
montr?,1 est employ? au sens de cbois de vigne5 et d?signe donc le Christ. Il en est aussi de m?me dans 11, 11, o? il me para?t certain qu'il y a allu sion au Christ comme arbre de vie, comme le montre l'allusion ? Gen., 3, 22. Il faut en ce sens corriger l'affirmation de Reijners (p. 41), selon la quelle on trouverait seulement chez Justin une relation entre l'arbre de vie et le Christ.
Mais ce qui est remarquable est que l'auteur de l^Ep?tre5, cherchant ?
constituer un dossier sur ?uXov, interpr?te ces textes non du Christ, mais de la croix. Il y a donc ici une typologie au second degr?. La vigne ou l'arbre de vie ont ?t? des figures du Christ avant de l'?tre de la croix. On
voit bien cette ambivalence quand l'auteur de l'cEp?tre' ?crit, ? propos du bois de la vigne: cCes paroles se rapportent ? la croix et ? celui qui devait y ?tre attach?' (11, 1). En ce qui concerne 12, 7, o? l'expression en? ?uXou est introduite ? propos du serpent d'airain, Reijners ne donne qu'une explication g?n?rale. Je me demande si l'on ne pourrait aller plus loin.
Outre ?m ?oXou, nous voyons ajouter 7rioT?Oaa?. Il y a par ailleurs ?cootcoi Tjom. Il est possible qu'il y ait une influence de Deut., 28, 66 avec l'ar cha?que inclusion d' Im ??Xot>.2 Ce qui le justifierait est que l'expression
1 Etudes d'ex?g?se jud?o-chr?tienne, Paris, 1966, 99-111. 2 Voir Etudes d'ex?g?se jud?o-chr?tienne, 53-76. 17 Gnomon 1967
This content downloaded from 192.231.59.35 on Fri, 25 Jul 2014 01:45:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
-
258 J. Dani?lou: Reijners, The Terminology of the Holy Cross
'Votre vie (?co**)) a ?t? suspendue au bois (ItcI ?uXou) devant vos yeux et vous n'avez pas cru (mcrre?tryjTs)5 pouvait tr?s bien para?tre comme un rappel par Mo?se du serpent d'airain.
Justin pr?sente un usage de crmupo? et de ^uXov, analogue ? celui de Barnabe. Toutefois il y a une tendance ? employer ?oXov au lieu de otocu
po?, m?me sans relation ? l'Ancien Testament. Cette tendance sera plus accus?e dans F'Hom?lie pascale5 de M?liton, qui n'emploie jamais gtocu po?. En ce qui concerne les 'Testimonia5, Reijners a raison de souligner, contre Hugo Rahner, que Justin ne d?pend pas de Barnabe (p. 45). Il utilise des s?ries de 'Testimonia5, qui ?taient d?j? constitu?s de son temps. Reijners rejoint ici les conclusions de Prigent. On voit appara?tre en par ticulier chez lui le groupe J?r., il, 19 et Ps., 95, 10 avec l'addition airo tou |?Xou (Dial., 73, 1-74, 2). Il est vraisemblable, ?tant donn? la lacune qui suit ce dernier paragraphe, que, comme Prigent l'a propos?, Deut., 28, 66 avec l'addition ItcI ?oXqu ait ?t? joint aux deux autres citations auxquelles il est associ? chez Tertullien.1 Justin est ?galement le premier t?moin ?
voir une figure de la croix dans le ^tiXov de Gen., 6, 14 (l'arche de No?) et dans celui de II Reg., 6, 6 (la hache d'Elis?e).
Ir?n?e pr?sente souvent crnxupo?, en relation avec le Nouveau Testa
ment qu'il est le premier ? utiliser largement (p. 90). Avec lui appara?t un th?me destin? ? une grande fortune, celui de l'opposition entre l'arbre du Paradis et l'arbre de la croix (pp. 64-67). Il s'agit ici de l'arbre de la con naissance du bien et du mal et non de l'arbre de vie. Les deux th?mes sont tout ? fait ? distinguer. Je remarque qu'Ir?n?e emploie toujours ici le
mot ?uXov seul. Je pense qu'il ?vite de dire %?Xov yvcocrsooc;, du fait que l'arbre est pr?sent? ici comme source de mort par opposition ? la croix source de vie. C'est quand l'arbre de la connaissance est envisag?,
en lui-m?me - et
non en opposition ? la croix- qu' il est appel? ?uXov yvaazm?. Il est alors le
symbole de la Loi qui est bonne. C'est l'homme qui, en la violant, cause sa
propre mort. C'est le cas chez Th?ophile d'Antioche (Aut., 2, 25), dans F'Ep?tre ? Diogn?te5 (12, 2-3). Th?ophile fait allusion, pour les condam ner, ? 'certains5 qui pensent que 'l'arbre donnait la mort5 (loc. cit.).2 Et il explique que la gnose est bonne. Tertullien pr?sente ? la fois le th?me
typologique et le th?me anthropologique. A propos d*Ir?n?e, Reijners fait quelques allusions aux gnosticistes.
Mais je regrette qu'il ne leur ait pas consacr? une ?tude propre. Les mythes gnostiques sont souvent une
source pr?cieuse pour la connaissance du
christianisme archa?que dont ils transposent les donn?es. Ce qui est
frappant chez eux est que, si %?Xov est un ?on chez les Barbelognostiques (Adv. haer., 1, 27, 1), c'est crraupo? qui est de beaucoup le terme le plus important. Ceci est en contraste frappant avec la tendance de Justin. Mais
nous avons l? une preuve nouvelle du lien de |uXov et de l'Ancien Testa ment. Les gnosticistes, qui sont hostiles ? l'Ancien Testament, s'attachent
1 Justin et l'Ancien Testament, Paris, 1964, 193-194. 2 Voir aussi Novatreis, Treis., 6, qui d?pend de Th?ophile.
This content downloaded from 192.231.59.35 on Fri, 25 Jul 2014 01:45:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
-
J. Dani?lou: Reijners, The Terminology of the Holy Cross 259
? cTTaupo?, qui est sp?cifiquement n?o-testamentaire. Par ailleurs les gnos ticistes sont les premiers ? d?velopper les symbolismes que sugg?rait le
mot GTocopo?. Son sens le plus ancien est celui de pieux formant une palis sade (pp. 1-2). Or les valentiniens d?veloppent le th?me de crTocupo? comme limite (?po?). C'est ?galement chez eux que l'on voit appara?tre la croix en relation avec ?Spa^siv et rjTTjpi?s&v (1, 2, 2; 1, 3, 5). Reijners y fait allu sion (pp. 209-210), mais seulement ? propos de l'cHom?lie pascale> du
Pseudo-Hippolyte. Y a-t-il ici ? nouveau une relation avec un des sens
profanes de crrocupo?, qui d?signe des troncs d'arbre servant de fondation ou de consolidation?
Dans la seconde partie de son livre, Reijners ?tudie d'abord un certain nombre de termes qui ont servi ? d?signer la croix pour des raisons symboliques. On trouve xepoe? (corne) en relation avant tout avec Deut., 33, 17 (les cornes de l'unicorne), qui ?voquait l'image d'une croix. Le symbolisme de pa?Soc se rattache davantage ? la mati?re, qui est le bois. On notera les divers sens de pa?Soc, entra?nant des symbolismes divers: houlette de berger (Ps., 22, 4), sceptre de prince (Ps., 2, 9), b?ton de p?dagogue. Comme pour l'arbre de vie, l'expression d?signe tant?t le Christ, tant?t ia croix. Plus
complexe est le sens de G7](jLe?ov. Reijners consacre une longue ?tude ? l'expression de 'Didach?', 16, 6 ccnr)|X??ov ?x7ceTaaec??\ Il en discute les diverses interpr?tations et estime
qu'il peut y avoir une allusion ? la croix. Il ?carte en tous cas l'hypoth?se d'Audet qui y voit l'ouverture des cieux (pp. 123-124). Mais il reste qu'ici c'est ?xTceTaai? qui fait probl?me: a?j^etov a son sens ordinaire. Plus difficiles sont les cas o?