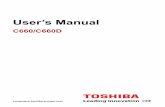Creative commons : Paternité - Pas d’Utilisation...
Transcript of Creative commons : Paternité - Pas d’Utilisation...

http://portaildoc.univ-lyon1.fr
Creative commons : Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY-NC-ND 2.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA READAPTATION
_________
Directeur Professeur Yves MATILLON
_________
DEGENERESCENCES MACULAIRES LIEES A L’AGE ET RETINITES
PIGMENTAIRES,
ENQUETE DE LA QUALITE DE VIE AUPRES DE PATIENTS
DIPLOME UNIVERSITAIRE DE BASSE VISION
par
Amélie BOUGRIER
Née le 15 décembre 1986 à Chambray les Tours (37)
LYON, le 26 Mai 2011
Professeur Philippe DENIS Nnuméro : 72 Responsable de l'Enseignement
Docteur Hélène MASSET
Directrice des Etudes Responsable de l'Enseignement
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

Président Pr. BONMARTIN Alain
Vice-président CA Pr. ANNAT Guy
Vice-président CEVU Pr. SIMON Daniel
Vice-président CS Pr. MORNEX Jean-François
Secrétaire Général M. GAY Gilles
Secteur Santé U.F.R. de Médecine Lyon Est Directeur Pr. ETIENNE Jérôme
U.F.R de Médecine Lyon-Sud Charles Mérieux Directeur Pr. GILLY François Noël
Comité de Coordination des Etudes Médicales (C.C.E.M.) Pr. GILLY François Noël
U.F.R d’Odontologie Directeur Pr. BOURGEOIS Denis
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Directeur Pr. LOCHER François
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation Directeur Pr. MATILLON Yves
Département de Formation et Centre de Recherche en Biologie Humaine Directeur Pr. FARGE Pierre
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

Secteur Sciences et Technologies
U.F.R. Des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (S.T.A.P.S.) Directeur Pr. COLLIGNON Claude
Institut des Sciences Financières et d’Assurance (I.S.F.A.) Directeur Pr. AUGROS Jean-Claude
IUFM Directeur M. BERNARD Régis
UFR de Sciences et Technologies Directeur M. GIERES François Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon (EPUL Directeur M. FOURNIER Pascal
IUT LYON 1 Directeur M. COULET Christian
Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE) Directeur M. PIGNAULT Gérard
Observatoire astronomique de Lyon Directeur M. GUIDERDONI Bruno
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

A l’issue de ce travail, je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont
soutenue dans sa réalisation.
Je remercie,
Monsieur le Professeur Denis, responsable de l’enseignement au sein de la
formation,
Madame le Docteur Masset, directeur des études, votre investissement dans
la formation des étudiants lors de ce diplôme est très précieux.
Mesdames, Griffond, Blanc, Russier, Dubois-Lagedamont, et Ballard,
Messieurs, les Professeurs Vighetto, Romanet et Gain, les Docteurs Cornut, Najjar,
Tonini, Zech et Gaudon et Messieurs Lucas, Collin et Vital-Durand, pour votre
enseignement théorique mais également pour tous vos conseils.
Un très grand merci à Madame Villalon, secrétaire de l’école, vous avez
été d’une patience exemplaire tout au long de la formation.
Je n’oublie pas les Docteurs, orthoptistes, instructeurs en locomotion,
avijiste, psychomotricienne et ergothérapeute rencontrés au cours des divers stages au sein de la
FIDEV, du CTRDV et du centre Rabelais.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

Je remercie sincèrement le Docteur Yannick Nochez (ophtalmologiste au
CHU Bretonneau de Tours 37) pour ton aide et les informations précieuses que tu m’as fournies
au fil de ce travail notamment dans l’élaboration des statistiques.
Merci également au Professeur Pisella (chef du service d’ophtalmologie du
CHU Bretonneau de Tours 37), au Docteur Samuel Mazjoub (ophtalmologiste au CRBV de
Ballan-Miré 37), au docteur Marie-Laure Lelez (ophtalmologiste au CHU Bretonneau de
Tours), à Madame Sophie Lamarre (orthoptiste au CRBV de Ballan-Miré) et toutes les
orthoptistes du service des explorations fonctionnelles pour m’avoir confié vos patients, je vous suis
très reconnaissante de me faire partager votre intérêt pour la basse vision.
Un très grand merci aux patients qui m’ont accordé de leur temps et fait
part de leur vécu face à leur pathologie.
Mes plus vifs remerciements à ma famille et mes amis, pour m’avoir
encouragée tout au long de cette année, pour leur soutient et leur aide.
Je souhaite remercier également, mes camarades de promotion avec qui j’ai
eu la joie de partager cette année.
Enfin merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la
réalisation de ce travail.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

1
SOMMAIRE
INTRODUCTION 3
PARTIE THEORIQUE 4
I. La rétine 4
L’orientation et la géographie 4
Les différentes couches 6
Les photorécepteurs 8
La vascularisation 9
II. Historique 11
III. Epidémiologie 12
IV. Les signes cliniques 13
V. Les facteurs de risque 14
VI. Les examens 15
L’acuité visuelle 15
Le champ visuel 16
Le fond d’œil 19
OCT et Angiographie 23
Electrorétinogramme 27
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

2
PARTIE PRATIQUE 29
I. Patients et Méthode 29
Elaboration du questionnaire 29
Description de la population 33
II. Résultats 35
Etude comparative 35
Comparaison générale 40
DISCUSSION 42
I. La répartition de la population 42
II. La méthode 42
III. Les résultats 43
IV. Les perspectives de ce travail 45
CONCLUSION 46
BIBLIOGRAPHIE 47
I. Ouvrages 47
II. Articles 47
III. Cours 48
IV. Sites internet 48
ANNEXE 49
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

3
INTRODUCTION
La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age dite DMLA et la rétinite pigmentaire
sont deux pathologies atteignant la rétine et provoquant une altération du champ visuel
et/ou de l’acuité visuelle.
La DMLA est la principale cause de cécité après 65 ans dans les pays industrialisés.
De ce fait, elle constitue un véritable problème de santé publique. On compte environ
13% de la population atteinte à l’âge de 80 ans (CHU de Tours en 2009).
Les rétinites pigmentaires regroupent un ensemble de maladies génétiques de l’œil,
impliquant les photorécepteurs et l’épithélium pigmentaire. Elles surviennent à des âges
variables mais débutent généralement tôt (10 à 20 ans) par une héméralopie (baisse de la
vision nocturne), un rétrécissement du champ visuel puis une baisse de l’acuité visuelle.
Ces deux pathologies semblent totalement opposées d’un point de vue clinique et
quant à l’âge d’apparition. Cependant, n’existe-t-il pas une grande similitude sur les
attentes et les gênes des patients ?
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

4
LA RETINE
La rétine est une membrane de quelques dixièmes de millimètres tapissant la
surface interne du globe. C’est un tissu neurosensoriel capable de capter les rayons
lumineux et de transmettre les informations visuelles au système nerveux central.
La rétine est un élément essentiel au globe oculaire, elle se met en place très tôt au
cours de la vie embryonnaire (origine ectodermique).
La première étape de la perception visuelle se situe dans la rétine au niveau des
photorécepteurs (cônes et bâtonnets). La lumière entre dans l’œil et passe successivement
à travers la cornée, l’humeur aqueuse, la pupille, le cristallin et le vitré pour être finalement
focalisée sur la rétine.
I. ORIENTATION ET GEOGRAPHIE DE LA RETINE
La rétine s’étend de la papille (émergence du nerf optique) à l’ora serrata. On
observe deux grandes zones : la rétine centrale de 5 à 6 mm de diamètre comprenant la
fovéa (zone de la vision fine) et la rétine périphérique.
La rétine centrale, située au pôle postérieur du globe entre les branches supérieure
et inférieure de l’artère temporale, comprend la macula, la fovéola et la fovéa.
Figure 1 : Fond d’œil droit
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

5
La macula ou tache jaune, située dans l’axe visuel, est caractérisée par une
concentration maximale de cônes. De forme elliptique, elle mesure environ 2 mm de large
pour 1 mm de haut. Elle entoure tout d’abord la fovéola, dépression centrale de la fovéa.
Ainsi, la macula contient la fovéa, laquelle est entièrement composée de cônes serrés les
uns contre les autres et permettant une vision maximale.
La macula est une zone du tissu rétinien très mince d’environ 130µm d’épaisseur.
Cette minceur est due à l’absence des couches internes : nucléaire interne, plexiforme
interne, cellules ganglionnaires et fibres optiques.
La rétine périphérique est divisée classiquement en quatre zones : la périphérie
proche, la périphérie moyenne, la périphérie éloignée et l’extrême périphérie (ou ora
serrata). La rétine périphérique ne possède pas une vision fine mais permet un
élargissement du champ visuel.
Dans les conditions normales, une image du champ visuel, inversée de gauche à
droite et de haut en bas, se trouve projetée sur la rétine.
Figure 2 : Localisation du champ de vision sur les rétines
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

6
II. LES DIFFERENTES COUCHES DE LA RETINE
Les rayons lumineux traversent les 10 couches de la rétine qui sont :
-La membrane limitante interne,
-Les fibres optiques,
-La couche des cellules ganglionnaires,
-La couche plexiforme interne,
-La couche nucléaire interne,
-La couche plexiforme externe,
-La couche nucléaire externe,
-La membrane limitante externe,
-Les photorécepteurs (cônes et bâtonnets),
-L’épithélium pigmentaire.
Figure 3: Schéma des différentes structures de la rétine
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

7
La limitante interne : c’est l’élément le plus interne de la rétine. Elle répond à la base
du vitré en avant et à la hyaloïde postérieure en arrière.
Les fibres optiques : il s’agit des axones des cellules ganglionnaires, son épaisseur
augmente de la périphérie vers la papille; elle est absente au niveau de la fovéa.
Les cellules ganglionnaires : également absentent au niveau de la fovéa, les cellules
ganglionnaires sont des neurones dont l’axone va former la couche des fibres optiques.
La plexiforme interne : c’est une zone de synapse entre les cellules bipolaires et les
cellules ganglionnaires.
La nucléaire interne : on y trouve quatre types de cellules.
- Les cellules bipolaires assurent la transmission de l’influx nerveux issu des
photorécepteurs vers les cellules ganglionnaires ;
- Les cellules horizontales, cellules d’association jouant un rôle dans la diffusion
et la modulation des influx nerveux ;
- Les cellules amacrines, ce sont des cellules d’association entre les cellules
bipolaires et les cellules ganglionnaires ;
- Les cellules de Muller, (cellules gliales) assurent un rôle important dans la prise
de la fonctionnalité des connexions synaptiques et donc de la vitesse
d’apprentissage.
La plexiforme externe : elle est essentiellement constituée par des synapses entre les
photorécepteurs et les cellules bipolaires ; elle contient également les prolongements
cytoplasmiques des cellules de Muller et des cellules horizontales.
La couche nucléaire externe : elle est constituée par les expansions internes de
cellules photoréceptrices et par quelques corps cellulaires des cellules de Muller.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

8
La membrane limitante externe : c’est une zone d’adhérence entre les articles
internes des photorécepteurs et les cellules de Muller. Elle se présente comme une fine
lame perforée de cellules.
La couche des photorécepteurs : on distingue deux types de photorécepteurs, les
cônes et les bâtonnets.
L’épithélium pigmentaire : c’est la couche la plus externe de la rétine et des grains de
mélanine donnent à cet épithélium son caractère pigmenté. Il présente quatre rôles :
- Un rôle d’écran plus ou moins opaque en fonction du degré de pigmentation,
- Un siège d’échanges hydro-électrolytiques et d’oxygène,
- Un rôle de métabolisme de la vitamine A,
- Un rôle de phagocytose, permettant la régénérescence des photorécepteurs.
III. LES PHOTORECEPTEURS
En traversant les différentes couches de la rétine, la lumière atteint la couche des
photorécepteurs. Ces derniers, alignés parallèlement aux rayons lumineux, sont au contact
de l’épithélium pigmentaire.
Nous possédons deux types de photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets. Les
bâtonnets permettent la vision dans l’obscurité alors que les cônes sont impliqués dans la
vision de jour. Chez l’Homme, on dénombre trois types de cônes (S.M.L.),
essentiellement concentrés dans les deux degrés centraux qui sous-tendent la vision des
couleurs. La vision du détail et la perception de la luminance sont principalement le fait
des cônes de types L et M, respectivement appelés aussi cônes rouges et verts. Le cône M
correspond à une gamme de longueur d’ondes moyennes avec un pic d’absorption à 535
nm. Le cône de type L correspond à une sensibilité aux longueurs d’ondes les plus
longues, avec un pic à 565 nm, on l’appelle de façon impropre le cône rouge. Le troisième
type de cône, le type S, est sensible aux longueurs d’ondes courtes, son pic de sensibilité
se situe à 430 nm. Ce type de cône ne joue un rôle que dans la perception des couleurs.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

9
Figure 4 : Spectre de la lumière blanche
Les photorécepteurs, comme la plupart des cellules des couches plexiformes, ne
génèrent pas de potentiel d’action ; ils libèrent de façon permanente un
neurotransmetteur.
Les mécanismes rétiniens de détection de la lumière sont extrêmement sensibles.
On peut détecter des flashs de lumière constitués seulement de cinq photons, bien qu’un
seul d’entre eux ait la chance de toucher un photorécepteur. Dans chaque œil, on trouve
120 millions de bâtonnets et 6 millions de cônes connectés à 1 million de cellules
ganglionnaires.
IV. VASCULARISATION DE LA RETINE
La rétine reçoit son apport sanguin par un double système :
- La choriocapillaire, elle vascularise les couches externes et notamment les
photorécepteurs. Ce réseau capillaire joue un rôle fondamental dans la vascularisation
fovéolaire.
- Un système d’artères intrarétiniennes, ce sont des branches de l’artère centrale
de la rétine. Ce système prend en charge l’apport artériel aux couches internes de la rétine.
A ce réseau, peuvent s’ajouter des artères surnuméraires comme les artères
ciliorétiniennes.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

10
La vascularisation des couches externes se fait par la choriocapillaire, à travers la
membrane de Bruch. La choriocapillaire forme une couche unique de capillaires, elle
provient des ramifications en arrière des artères ciliaires courtes postérieures et en avant
des artères récurrentes du grand cercle artériel de l’iris.
La vascularisation des couches internes est assurée principalement par les branches
de l’artère centrale de la rétine et accessoirement par des artères ciliorétiniennes
inconstantes. Juste après son émergence de la papille, elle se divise en deux branches :
deux artères temporales et deux artères nasales.
Le drainage veineux de la rétine est assuré principalement par la veine centrale de
la rétine. Les veinules de petit calibre se réunissent de façon centripète, de l’ora vers la
papille pour former des veines de plus en plus importantes qui se drainent en quatre
troncs : les veines temporales supérieure et inferieure et les veines nasales supérieure et
inferieure. La jonction des deux branches supérieures forme la veine supérieure ; celle des
deux branches inférieures, la veine inférieure, qui se réuniront au niveau de la papille pour
former la veine de la rétine.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

11
HISTORIQUE
LA DEGENERESCENCE MACULAIRE LIEE A L’AGE
Les premiers pas dans la découverte de la DMLA furent faits par Donders, en
1855, qui décrivit pour la première fois les drusens issus de l’épithélium pigmentaire
rétinien. En 1893, Oeler publia dans son Atlas d’ophtalmologie des planches évoquant
des dégénérescences maculaires. Dix ans plus tard, il décrivit, chez un homme de 79 ans
des lésions qu’il nomma « dégénération maculae lutea disciformis ». En 1919, Elsching
repris alors le terme qu’il nomma maladie disciforme du centre de la rétine.
Ce n’est cependant qu’en 1966 que la néovascularisation choroïdienne de la
DMLA et ses conséquences furent clairement expliquées dans un article de Donald Gass
(American Journal).
LES RETINITES PIGMENTAIRES
En 1855, Donders proposa le terme de « retinitis pigmentosa » regroupant toutes
les maladies génétiques de la rétine. Par la suite, les recherches sur les Rétinites
Pigmentaires sont intimement liées aux recherches sur le syndrome d’Usher. Ce n’est
qu’en 1989, que le Trinity College a découvert le premier gène responsable de la Rétinite
Pigmentaire - le gène codant la rhodopsine. Cette découverte a représenté une avancée
incroyable pour tous les malades, pour les associations de patients et pour les scientifiques
du monde entier. Depuis cette date, de nombreuses mutations ont été décrites.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

12
EPIDEMIOLOGIE
LA DEGENERESCENCE MACULAIRE LIEE A L’AGE
La DMLA est une maladie fréquente. Dans l’hexagone, il y aurait deux millions de
personnes atteintes de DMLA, et parmi elles 150 000 à 200 000 affectées par une forme
sévère. Dans les pays industrialisés, la DMLA est la première cause de malvoyance. En
raison de l’augmentation de l’espérance de vie, cette situation risque de s’aggraver à
l’avenir.
La prévalence globale de la maladie est de 8% après 50 ans, soit environ 1.5 million
de personnes en France. Cette prévalence augmente avec l’âge de 1% à 55 ans, elle passe
progressivement à 13% à 80 ans.
Les femmes auraient un risque un peu plus élevé de présenter une DMLA que les
hommes, particulièrement dans le groupe des sujets de plus de 75 ans. Cela pourrait
s’expliquer par l’espérance de vie un peu plus longue pour les femmes que pour les
hommes.
LES RETINITES PIGMENTAIRES
La prévalence des rétinites pigmentaires est estimée à 1 cas pour 5 000. Il y aurait
environ 1,5 millions de patients atteints. De ce fait, les rétinites pigmentaires sont la forme
la plus fréquente des dégénérescences rétiniennes chez les sujets jeunes. C’est la première
cause de cécité héréditaire dans les pays développés.
Bien que les rétinites pigmentaires soient génétiques, il n’y a pas de prédominance
en fonction du sexe. Cependant, leur expression se fait par le chromosome X ; elles
seraientt, de ce fait, légèrement plus marquées chez le sujet masculin. Une prédominance
en fonction de l’ethnie n’a pas été mise en évidence.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

13
SIGNES CLINIQUES
LA DEGENERESCENCE MACULAIRE LIEE A L’AGE
Les symptômes de la DMLA varient d’une personne à l’autre, le patient peut ne
pas en être conscient au cours des premières étapes de la maladie. Les premiers
symptômes sont plus facilement décrits lorsque la DMLA touche les deux yeux.
Ces symptômes peuvent inclure :
- Une vision brouillée ou floue qui ne se corrige pas avec le port de lunettes.
- Une déformation des lignes horizontales et verticales, le patient dit voir ondulé
ou déformé. Ce symptôme est généralement associé à la DMLA de type humide et peut
affecter tant la vision de loin que celle de près.
- Les patients décrivent également des contrastes moins vifs, difficulté à voir les
objets qui ont la même couleur que l’arrière plan. Mais également des difficultés à
distinguer les couleurs.
- Tache noire, zone aveugle au centre du champ visuel.
LES RETINITES PIGMENTAIRES
Le symptôme le plus commun est la difficulté de voir lorsque l’intensité lumineuse
diminue : on parle alors d’héméralopie.
Les patients se plaignent également d’un rétrécissement du champ visuel, la vision
sur le coté et en bas est perdue. Les patients nous parlent, lorsque la pathologie est à un
stade avancé, d’une vision à travers un tunnel. La vie quotidienne s’en ressent
progressivement : présence d’une certaine maladresse, difficulté à conduire de nuit,
parfois aussi de jour, faute d’avoir une vision globale de la route, percussions fréquentes
d’objets au cours de la marche…
Parfois, la vision centrale peut également être détériorée notamment en cas de
d’œdème.
Toutes les attaques de rétinites pigmentaires sont progressives et la rapidité de la
détérioration varie d’une personne à l’autre.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

14
LES FACTEURS DE RISQUES
LA DEGENERESCENCE MACULAIRE LIEE A L’AGE
Les causes de la dégénérescence maculaire restent en grande partie encore
inconnues, mais les risques s'accroissent avec l'âge et cette maladie présente parfois une
composante héréditaire.
Le tabac augmente les risques d'apparition de la maladie et semble accélérer sa
progression.
Les rayons ultraviolets semblent également accélérer l'évolution de la maladie,
surtout chez les personnes aux yeux de couleur claire. L’exposition intense à la lumière du
jour, par exemple lors d’une vie professionnelle en extérieur dans une région très
ensoleillée, augmente le risque de développer une DMLA.
Des concentrations élevées de cholestérol dans le sang et l'hypertension artérielle
ont également été associées à la dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire
humide semble plus fréquente chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires.
LES RETINITES PIGMENTAIRES
Le facteur de risque des rétinites pigmentaires est le caractère héréditaire. Le
caractère familial de l’affection chez certains patients présente un triple intérêt : élément
en faveur du diagnostic en cas de doute ou à un stade précoce (notamment chez les
enfants), élément pronostic car les diverses formes qu’elles soient isolées (cas sporadiques)
ou autosomiques dominantes ou récessives ou encore liées à l’X différent sur le stade de
la précocité et sur une évolution plus ou moins rapide, élément important dans
l’investigation en génétique moléculaire (essayer de dresser un arbre généalogique en
notant une éventuelle consanguinité).
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

15
LES EXAMENS
I. L’ACUITE VISUELLE
L’acuité visuelle est le pouvoir d’apprécier les formes, c’est-à-dire d’interpréter les
détails spatiaux mesurés par l’angle sous lequel ils sont vus. Elle fait appel à la vision
centrale mais également au champ visuel.
Les 3 types d’acuité visuelle :
Le minimum visible : il s’exprime par le fait qu’un élément est vu ou non vu. Il
correspond à la plus petite surface perceptible.
Le minimum séparabile : c’est l’angle le plus petit sous lequel peuvent être
aperçus deux points noirs sur un fond blanc pour être vu séparés. Il fait appel au pouvoir
séparateur de l’œil.
L’acuité vernier : plus petit décalage perceptible entre deux lignes. C’est la
capacité de déterminer la position relative d’une ligne par rapport à une autre. Cette acuité
est mesurée par l’angle qui sépare les deux lignes.
L’acuité visuelle est un temps primordial de l’examen, qui se fait avec des échelles
adaptées en fonction de l’âge du sujet mais également en fonction de sa pathologie.
De loin, dans le cas d’une acuité visuelle faible, on préférera utiliser l’échelle
ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) caractérisée par une progression
logarithmique de la taille des lettres de ligne en ligne. Lorsque l’acuité visuelle est encore
bonne, on utilisera plus facilement l’échelle de Monoyer.
De près, l’échelle de Parinaud présentée à 33 cm est la plus fréquemment utilisée.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

16
Acuité visuelle et Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
Chez les patients atteints de DMLA, la baisse de l’acuité visuelle est la première
cause de consultation chez l’ophtalmologiste. En effet, un scotome central entraine
souvent une baisse importante de l’acuité visuelle. Le patient doit alors mettre en place
des stratégies de compensation, notamment en décentrant sa fixation.
Acuité visuelle et Rétinites Pigmentaires
L’affection ne touchant pas la région maculaire centrale, l’acuité visuelle est
souvent excellente durant de nombreuses années. En fin d’évolution, la macula est à son
tour altérée et on observe alors une chute de l’acuité visuelle centrale qui marque alors le
point final de l’évolution.
II. LE CHAMP VISUEL
Le champ visuel correspond à la portion de l’espace qu’un œil fixant droit devant
lui peut embrasser.
On distingue le champ visuel monoculaire, qui correspond à l’espace perçu par un
œil et le champ visuel binoculaire qui correspond à l’espace perçu par les deux yeux
immobiles. Dans le cas de la basse vision, le champ visuel binoculaire est incontournable.
L’étude du champ visuel explore l’ensemble des voies optiques, de la rétine
jusqu’au lobe occipital.
Les appareils d’étude clinique :
- La campimétrie : ce type d’examen n’étudie que le champ central et moyen
(30° à 35° centraux), il y a une diminution de la taille angulaire du test au fur et à mesure
que l’on s’éloigne du point de fixation par augmentation de la distance œil-test.
- La périmétrie : le relevé périmétrique est effectué à l’aide d’une coupole
hémisphérique adaptée à la courbure oculaire. On distingue deux types de périmétrie, la
périmétrie dynamique et la périmétrie cinétique :
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

17
La périmétrie cinétique : c’est l’un des examens le plus utilisé en
clinique. Sur la face interne de la coupole on projette un test dont on peut faire varier la
surface et la luminance. Chaque test est déplacé du « non vu » vers « le vu » sur l’un des 24
méridiens. Dès qu’il est perçu, le point est noté sur un schéma. L’ensemble des points
relevés avec le même test sont réunis en un tracé constituant un isoptère. Les isoptères
sont des lignes correspondant aux points du champ visuel possédant la même sensibilité
visuelle. Chaque tracé de champ visuel comporte plusieurs isoptères.
La périmétrie de Goldmann est une des méthodes de périmétrie cinétique très
fréquemment utilisée. Elle permet l’étude du champ visuel central et périphérique jusqu’à
90° ainsi que la tache aveugle de Mariotte. Celle-ci correspond à la projection, dans le
champ visuel, de la papille optique sous forme d’un scotome absolu négatif situé dans le
champ visuel temporal du point de fixation entre 10° et 20°.
La périmétrie statique : elle permet d’étudier les 25° centraux du champ
visuel et de calculer la capacité visuelle (seuil de perception de certains points du champ
visuel).
Les résultats du champ visuel :
A chaque secteur de la rétine correspond un secteur du champ visuel. Ainsi, la
rétine temporale correspond à la moitié nasale du champ visuel et la rétine nasale à sa
moitié temporale. De même, la rétine supérieure correspond à la moitié inférieure et la
rétine inférieure à la moitié supérieure.
Les limites du champ visuel sont différentes du champ optique théorique calculé
par Y. Legrand qui est plus tendu (les calculs ne prennent pas en considération le
cristallin, l’anatomie de l’orbite et la fonctionnalité de la rétine qui est de 104°).
D’après Hass, les limites moyennes du champ visuel monoculaire sont de :
En temporal : 91°
En nasal : 64°
En supérieur : 63°
En inférieur : 79°
Le champ visuel binoculaire s’étend sur 120°, encadré de part et d’autre d’une
bande de vision monoculaire de 30° (champ de demi-lune).
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

18
L’étude du champ visuel est d’un grand intérêt en clinique. De nombreuses affections
ophtalmologiques (DMLA, rétinites pigmentaires…) et neurologiques (AVC,
méningiome, compression chiasmatique…) sont responsables de son altération. En
fonction du contexte, le champ visuel réorientera vers des examens ophtalmologiques ou
radiologiques.
Son étude est également très importante dans certaines atteintes. En effet, bien que
l’acuité visuelle soit conservée, le champ visuel peut définir une basse vision.
Dans la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
Le champ visuel n’est pas systématiquement réalisé dans une DMLA. Il a une
grande importance dans la prise en charge orthoptique dans le cadre d’une rééducation
basse vision. Il permet de connaitre les zones sans scotome et ainsi mettre en place une
fixation excentrée. On retrouve alors, un scotome central dû à l’atteinte maculaire.
Figure 5 : Champ visuel d’un patient atteint de DMLA
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

19
Dans les Rétinites Pigmentaires
La périmétrie est le meilleur moyen de dépistage et de suivi de l’atteinte du champ
visuel. Au début de l’affection, des scotomes apparaissent à environ 25° du point de
fixation et s’étendent pour devenir progressivement coalescents et former un scotome
annulaire. Le déficit évolue ensuite à la fois en périphérie et vers le centre laissant
finalement un champ tubulaire qui tendra à disparaitre au cours de l’évolution.
Figure 6 : Champ visuel d’un patient atteint de rétinite pigmentaire
III. FOND D’ŒIL
Le fond d’œil est un examen simple permettant l’analyse de la rétine à travers la
cornée, le cristallin et le corps vitré. Il est beaucoup plus facile et précis de le faire à
travers une pupille bien dilatée grâce à un collyre mydriatique.
Le fond d’œil est un examen non douloureux mais il peut cependant être
désagréable et éblouissant.
Les structures observées au fond d’œil sont :
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

20
- La rétine,
- La papille ou émergence du nerf optique,
- Les artères et les veines rétiniennes.
A l’examen du fond d’œil, la rétine apparaît d’une coloration orange foncée
secondaire à la présence de nombreux vaisseaux tapissant la choroïde. La papille, qui
correspond au départ du nerf optique au niveau de la rétine, constitue un petit disque de
couleur jaune, légèrement rosé mais beaucoup plus clair que la rétine. On distingue très
facilement au niveau de cette zone, l’émergence de tous les vaisseaux qui irriguent la
rétine. À quelque distance de la papille, se trouve la macula correspondant à une zone de
la rétine plus sombre et absente de vaisseaux
De nombreuses pathologies, notamment DMLA et rétinites pigmentaires, ont des
conséquences visibles au fond d’œil.
Figure 7 : Photo de fond d’œil normal
Fond d’œil dans la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
Dans le cas d’une DMLA, le fond d’œil permet de faire le diagnostic et de
différencier les différentes formes cliniques de DMLA.
Les premiers signes cliniques de la DMLA sont les Drüsen, on en différencie deux
types :
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

21
- Les Drüsen miliaires : ce sont les plus fréquents, ils sont physiologiques et liés
à l’âge. Au fond d’œil, ils apparaissent sous la forme de petites lésions blanches-jaunes,
arrondies et aux contours nets.
- Les Drüsen séreux : lésions blanchâtres, polycycliques, à contours flous et de
grande taille.
Figure 8 : Drusens maculaires chez un patient présentant une DMLA
La forme atrophique (forme sèche) est caractérisée par la disparition progressive
des cellules de l’épithélium pigmentaire. Cette perte s’accompagne d’une perte des
photorécepteurs sus-jacents et de la choriocapillaire sous-jacente.
Elle se traduit à l’examen du fond d’œil par des plages d’atrophie de l’épithélium
pigmentaire au sein desquelles les vaisseaux choroïdiens deviennent anormalement
visibles.
La forme exsudative (forme humide) est liée à l’apparition de néovaisseaux
choroïdiens qui franchissent l’épithélium pigmentaire et se développent sous la rétine
maculaire. Cette néovascularisation choroïdienne entraîne un décollement exsudatif de la
rétine maculaire.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

22
Figure 9 : Photo de fond d’œil d’un
patient de 74 ans atteint d’une DMLA
atrophique
Figure 10 : Photo de fond d’œil d’un
patient de 68 ans atteint d’une DMLA
exsudative avec présence d’un
néovaisseaux
Figure 11 : DMLA exsudative avec néovaisseaux actif
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

23
Fond d’œil dans les Rétinites Pigmentaires
L’aspect du fond d’œil dans les rétinites pigmentaires dépend du stade de
l’évolution.
Au stade initial, il peut n’y avoir aucune modification visible au fond d’œil. A un
stade plus évolué, on observe une granularité fine de l’épithélium pigmentaire, associé à
une réduction de la vascularisation de la rétine et à une pigmentation tachetée.
Par la suite, un rétrécissement artériolaire, une pâleur cireuse du disque, un œdème
maculaire et des amas pigmentaires s’observent.
Figure 12 : Photo de fond d’œil d’un patient de 48 ans atteint de rétinite
pigmentaire.
Figure 13 : Photo de fond d’œil d’une patiente atteinte de rétinite pigmentaire diagnostiqué à l’âge de 8 ans
IV. L’OCT ET L’ANGIOGRAPHIE
L’OCT (tomographie à cohérence optique) est une méthode de diagnostic récente
(1991), non invasive, sans contact, de haute résolution et donnant une vue
tridimensionnelle des structures rétiniennes. L’OCT projette sur la rétine un point
lumineux mobile dessinant une ligne, générée par une diode infrarouge (840 nm). La
lumière est réfléchie par les différentes structures rétiniennes et amplifiée par un
interféromètre.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

24
Figure 14 : OCT d’une patiente ne présentant aucune pathologie oculaire
La place de l’OCT semble primordiale dans les pathologies maculaires, telles que
les oedèmes maculaires, les membranes épirétiniennes, les décollements de rétine. Il est
également essentiel dans le suivi de diverses pathologies dont les DMLA et les rétinites
pigmentaires.
L’angiographie permet d’observer le fond d’œil après injection intraveineuse d’un
colorant fluorescent, plus souvent la fluoroscéine ; dans certains cas, celle-ci est complétée
par une angiographie au vert d’indocyanine.
- Angiographie fluorescéinique : après injection de fluorescéine, des clichés
photographiques en série à l’aide d’un filtre bleu permettront d’en visualiser le passage
dans les vaisseaux choroïdiens ainsi que dans les vaisseaux rétiniens artériels puis veineux.
- Angiographie en infrarouge au vert d’indocyanine : l’injection de vert
d’indocyanine permet, dans des cas de diagnostic difficile, de mieux visualiser des
vaisseaux choroïdiens pathologiques, notamment les néo-vaisseaux choroïdiens au cours
de la dégénérescence maculaire liée à l’âge.
Résultats de l’OCT et de l’angiographie dans les Dégénérescences
Maculaires liées à l’âge.
L’angiographie est l’examen de référence pour classifier la DMLA et surtout sa
gravité. Elle permet de confirmer l’existence de Drüsen miliaires (hyperfluorescence
précoce qui décroit lentement), de Drüsen séreux (hyperfluorescence progressive et
maximale tardivement sans diffusion), et une atrophie de l’épithélium pigmentaire. Elle
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

25
recherche également des complications néo vasculaires et donne leur localisation par
rapport à la fovéa et leur forme clinique dont dépendra le traitement.
L’angiographie au vert d’indocyanine permet de mieux bilanter et donc traiter une
DMLA compliquée de néo-vaisseaux occultes en explorant plus particulièrement le réseau
choroïdien.
L’OCT permettra, quant à lui, une mesure objective de l’épaisseur rétinienne (mesure
d’œdème maculaire) et de visualiser un éventuel décollement séreux rétinien et précisera
sont étiologie drusnoïde ou néo vasculaire. Il sera très utile dans le suivi de la maladie.
Figure 15 : OCT et fond d’œil montrant des drusens chez un patient atteint de
DMLA
Figure 16 : OCT 3D de DMLA Exsudative et atrophique
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

26
Figure 17 : Angiographie à la fluorescéine d’une patiente présentant une DMLA
atrophique
Résultats de l’OCT et de l’angiographie dans les Rétinites Pigmentaires.
Dans le cas d’une rétinite pigmentaire, l’angiographie n’est réalisée qu’en cas de
doute sur une complication et en particulier, sur un œdème maculaire cystoïde ou pour
établir un diagnostic différentiel. L’angiographie montre un aspect granité du fond d’œil.
Lorsque l’épithélium pigmentaire et la choroicappillaire sont atrophiques, seuls les gros
vaisseaux choroïdiens deviennent visibles au cours de l’angiographie.
L’OCT ne sert pas, en principe, à poser le diagnostic d’une rétinite pigmentaire. Il
s’avère cependant très important pour mesurer l’épaisseur de la rétine et surtout évaluer
l’état de la couche des photorécepteurs. Il permet également d’identifier la présence ou
non d’un œdème maculaire cystoïde.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

27
Figure 18 : OCT et Angiographie en auto-fluorescence d’une Rétinite Pigmentaire
V. L’ELECTRORETINOGRAMME
L’électrorétinogramme est l’enregistrement de l’activité bioélectrique de la rétine
produite par une stimulation lumineuse. Il s’agit d’une réponse complexe résultant de
multiples phénomènes électriques intracrâniens. La morphologie du tracé
électrorétinographique qui dépend de nombreux facteurs est une méthode d’examen
objective qui revêt un intérêt dans le diagnostic et le pronostic de nombreuses affections
rétiniennes.
Il représente la sommation de l’activité globale de la rétine, tout en sélectionnant
une population de cellules particulières en fonction :
- Des caractéristiques de la stimulation (intensité lumineuse, longueur d’onde,
types d’ERG, fréquence du flash),
- De l’ambiance lumineuse (lumière ou obscurité),
- De l’état d’adaptation de la rétine (stable ou non),
- De l’intégrité fonctionnelle de la rétine.
En fonction de l’ambiance lumineuse, de la longueur d’onde du flash, et du type
d’électrorétinogramme (pattern, multifocal, pattern), l’examen explore les cônes et/ou les
bâtonnets.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

28
L’électrorétinogramme dans la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
Les amplitudes des réponses sont significativement altérées pour la fovéa et la péri
fovéa. La périphérie est normale.
La superposition des réponses de l’électrorétinogramme multifocal à l’image du
fond d’œil montre la parfaite correspondance des déficits fonctionnels « électriques ».
L’électrorétinogramme n’est cependant pas couramment utilisé dans le suivi des
dégénérescences maculaires liées à l’âge. Il ne sert uniquement qu’en cas de doute et
permettra de faire la différence avec une dystrophie rétinienne
L’électrorétinogramme dans les Rétinites Pigmentaires
Dans le cas d’une rétinite pigmentaire, cet examen constitue l’exploration
fondamentale pour l’évaluation de l’altération fonctionnelle des photorécepteurs. Karpe,
en 1945, a été le premier à rapporter une altération des tracés dans les rétinites
pigmentaires.
De façon générale, les réponses, obtenues dans des conditions adaptées d’obscurité
reflètent généralement la fonction des bâtonnets et celles obtenues, dans des conditions
de luminosité, la fonction des cônes.
Dans le cas d’une rétinite pigmentaire, une réduction des signaux, générés par les
bâtonnets et les cônes, apparait. L’atteinte des bâtonnets est généralement prédominante
et observée en premier lieu. L’électrorétinogramme montre généralement des anomalies
dès la jeune enfance, sauf dans les formes modérées ou régionales de rétinites
pigmentaires.
Figure 19 : Tracés d’une ERG d’une patiente présentant une rétinite pigmentaire
depuis l’âge de 20 ans
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

29
PATIENTS ET METHODE
Le but de notre enquête est de tenter de mettre en évidence des traits communs
dans les activités quotidiennes entre des patients atteints de rétinite pigmentaire et des
patients atteints de dégénérescence maculaire liées à l’âge.
I. L’ELABORATION DU QUESTIONNAIRE :
Les impératifs à respecter
Il nous paraissait important de respecter un certain nombre d’impératifs afin
d’obtenir des personnes interrogées la meilleure coopération possible.
Nous avons donc opté pour un système de traitement de texte avec support de feuilles au
format A4 afin de gagner en clarté et en lisibilité. Nous avons utilisé la police Arial en
taille 20, correspondant à une valeur de Parinaud 10.
Nous avons également construit une version informatique qui permettait de
compléter le questionnaire d’un simple clic (très utile pour les patients utilisant zoom-
texte).
Les méthodes de rédaction
A travers le questionnaire, l’idée essentielle était d’aborder le plus largement
possible l’étendue des activités quotidiennes.
Toutes les questions ont été conçues de telle sorte que les patients devaient noter
ces activités sur une échelle de 0 à 4.
Le « 0 » correspondait à la réponse : « cette activité m’est impossible depuis l’apparition de
ma pathologie ».
Le « 4 » correspondait à la réponse : « je ne présente aucune difficulté dans cette tâche ».
Les patients pouvaient également répondre « non concerné » lorsqu’ils
n’effectuaient pas cette tache auparavant.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

30
A la demande des patients, le questionnaire était soit envoyé par mail, soit fait par
téléphone ou encore sous forme d’échange direct lors d’une visite au CHU ou au centre
basse vision de Ballan-Miré (37).
Au terme de la collecte, nous avons recueilli les questionnaires remplis. Tous les
questionnaires ont été pris en compte dans cette enquête. Tous les patients l’avait rempli
dans son intégralité.
Les conditions générales de l’enquête :
Méthodes de sélection des patients :
Critères d’inclusion :
Tous les patients inclus dans l’étude devaient être atteints soit d’une
dégénérescence maculaire liée à l’âge soit d’une rétinite pigmentaire.
Pour des raisons de facilités, nous avons interrogé uniquement des patients suivis
au CHU Bretonneau de TOURS (37) et/ou au Centre Régional Basse Vision de Ballan-
Miré (37), nous permettant ainsi d’avoir accès au dossier ophtalmologique de ces mêmes
patients.
Critères d’exclusion :
Nous n’avons pas pris en considération l’âge des patients mais ils devaient malgré
tout être majeurs.
Nous avons également préféré questionner des patients n’ayant jamais eu de
rééducation orthoptique afin d’éviter le plus possible des biais dus à la rééducation.
Enfin, la dégénérescence maculaire ou la rétinite pigmentaire ne devait être associée à
aucune autre pathologie oculaire (ex : glaucome, troubles de la cornée…).
Les contraintes de temps :
Notre but était de réaliser l’enquête rapidement étant donné le temps qui nous était
imparti. Mais, dans cette démarche, nous étions tout de même dépendante des personnes
interrogées. Certains ont répondu très rapidement, d’autres plusieurs semaines après,
voire pas du tout !
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

31
Les différentes questions
Bien que nous avions accès au dossier médical du patient, le questionnaire utilisé à
permis de relever l’identité du patient et de son âge. Nous demandions également au
patient à qu’elle date avait-il remarqué les premiers symptômes et quels étaient-ils.
Ensuite, trente-quatre questions étaient posées successivement. Le patient devait
cocher la réponse qui lui semblait la plus juste.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

32
Tableau 1 : les différentes questions étudiées
4 3 2 1 0 non concerné
1 sortir seul
2 traverser
3 obstacle
4 trottoir
5 escalier
6 feux piétons
7 conduire
8 nom de rue
9 enseigne
10 numéro de bus
11 vitrine / rayons
Score : /44
4 3 2 1 0 non concerné
12 repas
13 entretien de la maison
14 entretien du linge
15 téléphone/clavier
16 achat
Score : /20
4 3 2 1 0 non concerné
17 gros titres d'une info
18 livres
19 journaux
20 courrier
21 chèque
22 formulaire
23 mots croisés / codés…
24 relecture
25 signature
Score : /36
4 3 2 1 0 non concerné
26 télévision
27 cinéma
28 promenade
29 exposition /musées
30 jardinage
31 jeux de société / cartes
32 couture
33 tricot
34 bricolage
Score : / 36
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

33
Ainsi, le questionnaire a été coté sur 136 points au total (34 questions sur 4 points).
Plus le score était faible, plus la qualité de vie semblait être affectée par la pathologie.
Les trente -quatre questions ont également été analysées par groupes :
Questions 1 à 11 : groupe « activités de déplacement » coté sur 44 points.
Questions 12 à 16 : groupe « activités de vie journalière » coté sur 20 points.
Questions 17 à 25 : groupe « activités de lecture et d’écriture » coté sur 36 points
Questions 26 à 34 : groupe « activités de loisirs » coté sur 36 points.
Nous avons utilisé le logiciel Stat View pour l’analyse statistique, une différence
significative était retenue lorsque p<0,05.
II. DESCRIPTION DE LA POPULATION
Nous avons inclus dix patients (6 femmes et 4 hommes) dans l’étude. Le sexe-ratio
est de 1,5 en faveur des femmes. Les patients sont âgés de 32 à 80 ans et la moyenne d’âge
est de 58,5 ans. La population compte cinq patients atteints de DMLA et cinq patients
atteints de rétinite pigmentaire.
Dans le groupe « DMLA », la moyenne d’âge est de 78,2 ans. On compte deux
hommes et trois femmes (soit 40% d’hommes et 60% de femmes).
Dans le groupe « Rétinites Pigmentaire », l’âge moyen est de 46,2 ans. On compte
également deux hommes et trois femmes (soit 40% d’hommes et 60% de femmes).
Les patients présentant une DMLA étaient en moyenne plus âgés que les patients
présentant une rétinite pigmentaire. Cette différence d’âge est statistiquement significative
d’après le test T pour série non appariée (p=0.005).
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

34
Figure 20 : Répartition de la population en fonction du sexe et de la pathologie
30%
30%
20%
20%
Femmes ayant une DMLA
Femmes ayant une rétinite pigmentaire
Hommes ayant une DMLA
Hommes ayant une rétinite pigmentaire
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

35
RESULTATS
I. ETUDE COMPARATIVE ENTRE LES DEUX GROUPES ET LES
DIFFERENTS ITEMS ETUDIES
a) L’acuité visuelle
Tableau 2 : Données descriptives pour l’âge, l’acuité visuelle de loin et de près
mesurée avec correction optique.
Patients
atteints de
DMLA
n= 5
Patients
atteints de RP
n= 5
Echantillon
complet
n= 10
p
Age (années)
moyenne
± écart-type
[minimum-
maximum]
70,8 ± 5,63
[65-80]
46,2 ± 13,37
[32-61]
58.5 ± 15,34
[32-80] 0,005
Acuité visuelle
(logMar)
Œil droit de loin 0,916 ± 0,25
[1,3-0,690]
0,258 ± 0,152
[0,398-0,097]
0,587 ± 0,37
[1,3 – 0,097] 0,0004
Œil gauche de
loin
0, 896 ± 0,249
[1,3-0,690]
0,294 ± 0,108
[0,398 – 0,154]
5,952 ± 0,34
[1,3 – 0,398] 0,0002
Œil droit de près 1,114 ± 0,156
[1,24 - 0,88]
0,336 ± 0,151
[0,48 – 0,18]
7,25 ± 0,41
[1,24 – 0,18] <0,0001
Œil gauche de
près
1,186 ± 0,091
[1,24 – 1,03]
0,596 ± 0,185
[0,78 – 0,36]
8,91 ± 0,32
[1,24 – 0,36] 0,0002
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

36
Qu’il s’agisse de l’œil droit ou de l’œil gauche, il apparait que les patients atteints de
rétinite pigmentaire ont une acuité visuelle de loin et de près plus élevée que celle des
patients présentant une DMLA. Selon le test pour série non appariée, cette différence est
toujours significative (p<0.005).
De manière générale, les patients atteints d’une rétinite pigmentaire inclus dans
l’étude avaient conservé une acuité visuelle jugée satisfaisante.
b) Comparaison des différents items des activités de déplacement
Tableau 3 : Résultats du questionnaire sur les activités de déplacements
Groupe DMLA Groupe Rétinite
Pigmentaire p
sortir seul 3,4 ± 0,5 1,8 ± 0,83 0,007
traverser 2 ± 1,2 2,4 ± 1,14 0,6
obstacle 2 ± 1 1,2 ± 0,84 0,2
trottoir 2 ± 0 1 ± 0,7 0,01
escalier 2 ± 0,71 2,6 ± 0,55 0,17
feux piétons 0 ± 0 3,4 ± 0,55 <0,0001
conduite 0 ± 0 2 ± 1,41 0,03
nom de rue 0 ± 0 2,6 ± 0,55 <0,0001
enseigne 0,6 ± 0,54 3,6 ± 5,5 <0,0001
numéro de bus 0,67 ± 0,55 3 ± 0,82 0,0086
vitrines / rayons 2,2 ± 0,45 1,4 ± 0,55 0,03
Nous n’avons pas mis en évidence de différence significative entre les patients
présentant une DMLA et ceux présentant une Rétinite Pigmentaire aux questions
concernant : la traversée, le franchissement d’un obstacle et la montée ou la descente des
escaliers. Les réponses à ces questions étaient équivalentes dans les deux groupes.
Concernant les autres activités de déplacement mentionnées dans le tableau
précédent, des différences significatives apparaissent entre les deux groupes. En effet, les
patients présentant une DMLA seraient d’avantage gênés sur l’observation des feux
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

37
piétons, des noms de rue, des numéros de bus et des enseignes mais également à la
conduite. Tous les patients atteints de DMLA nous ont avoué que l’arrêt de la conduite
était pour eux le principal handicap.
En revanche, les items : sortir seul, trottoir et vitrines/rayons, bien que gênant
chez les personnes atteintes de DMLA le sont encore plus chez les patients présentant
une rétinite pigmentaire
c) Comparaison des différents items dans les activités de la vie
quotidienne (vie journalière)
Tableau 4 : Résultats du questionnaire sur les activités de la vie quotidienne
Groupe DMLA Groupe Rétinite
Pigmentaire p
repas 2,6 ± 0,89 3,4 ± 0,55 0,13
entretien de la maison 3,4 ± 0,55 3 ± 0,55 0,34
entretien du linge 3,2 ± 0,44 3,2 ± 4,4 1
téléphone/clavier 0,8 ± 0,83 3,4 ± 0,9 0,0015
achat 2 ± 0,7 3,4 ± 0,55 0,008
Dans cette série abordant la vie quotidienne, les patients atteints de rétinite
pigmentaire ne semblent pas, dans l’ensemble, être gênés. En effet la moyenne globale de
ces activités est de 3,28 (sur 4).
Le groupe DMLA présente ici quelques difficultés, notamment pour les repas; la
moyenne est de 2,6. Celle-ci n’est cependant pas statiquement significative (p>0.05). Les
deux questions les moins bien cotées par les patients atteints de DMLA étaient celle
concernant l’utilisation du téléphone ou d’un clavier et celle portant sur les achats.
Ces deux questions obtiennent respectivement une moyenne de 0,8 et 2 sur 4. Ces
deux moyennes sont significativement plus faibles que pour les patients atteints de rétinite
pigmentaire.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

38
Figure 21 : Moyennes des différentes activités de la vie quotidienne en fonction de
la pathologie.
d) Comparaison des différents items dans les activités de lecture et
d’écriture
Tableau 5 : Activités de lecture et d’écriture
Groupe DMLA
Groupe Rétinite
Pigmentaire p
gros titres d'une info 1,6 ± 0,54 3,6 ± 5,5 0,0004
livres 0,2 ± 0,47 2,8 ± 0,45 <0,0001
journaux 0,2 ± 0,45 2,8 ± 0,45 <0,0001
courrier 0,2 ± 0,45 2,8 ± 0,45 <0,0001
chèque 1,2 ± 0,84 3,2 ± 0,45 0,0015
formulaire 0,2 ± 0,44 2,8 ± 0,44 <0,0001
mots croisés / codés… 0,75 ± 0,95 2,8 ± 0,45 0,0036
relecture 0,4 ± 0,89 2,8 ± 0,44 0,0007
signature 3,2 ± 0,45 3,4 ± 0,55 0,54
00,5
11,5
22,5
33,5
4
groupe DMLA
groupe RP
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

39
Nous constatons d’importantes différences entre les patients atteints de DMLA et
les patients atteints de Rétinite Pigmentaire. Tous les résultats de cette série sont
significativement plus faibles pour les patients du groupe DMLA sauf un concernant la
signature. Nous rappelons que l’ensemble de nos patients atteints d’une DMLA
présentent un scotome central recouvrant tout ou partie la région maculaire, rendant alors
la vision du détail (la vision fine) impossible. Ainsi, l’acuité visuelle de loin et de près est
détériorée.
Seule la signature semble ne pas présenter de gêne entre les 2 groupes. En outre,
nous avons demandé à chaque patient de signer le questionnaire. Tous les patients
présentant une DMLA nous ont demandé de leur montrer l’endroit où ils devaient signer.
Malgré tout, cette aide, bien que nécessaire au quotidien, ne semble pas être un
« handicap ».
Figure 22 : Cotation des activités de lecture et d’écriture en fonction de la
pathologie
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Groupe DMLA
Groupe RP
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

40
e) Comparaison des différents items dans les activités de loisirs
Tableau 6 : Activités de loisirs
Groupe DMLA
Groupe Rétinite
Pigmentaire p
télévision 1,6 ± 0,55 3,4 ± 0,55 0,0008
cinéma 2,8 ± 0,45 0,4 ± 0,545 <0,0001
promenade 3,8 ± 0,45 1,6 ± 1,14 0,0039
exposition /musées 3,2 ± 0,45 2 ± 0,70 0,01
jardinage 4,0 ± 0 3,6 ± 0,55 0,14
jeux de société / cartes 1,2 ± 0,84 3,4 ± 0,55 0,0012
couture 2 ± 0 3,4 ± 0,55 0,052
tricot 1 ± 1,41 3 ± 0 0,07
bricolage 3,4 ± 0,55 3 ± 0 0,26
Dans cette catégorie, les résultats sont très variables en fonction des items. Les
personnes atteintes de DMLA sont plus gênées pour regarder la télévision et réaliser des
jeux de sociétés contrairement aux personnes atteintes de rétinite pigmentaire
essentiellement gênées dans les items de cinéma, les promenades et les expositions
culturelles.
II. COMPARAISON GENERALE DES SCORES DANS LES
DIFFERENTES ACTIVITES
Dans cette seconde partie, nous allons étudier de façon générale, si sans distinction
d’item, un des groupes présente plus de difficultés que l’autre.
Nous avons vu, auparavant, que les patients atteints de DMLA présentent un scotome
central recouvrant tout ou partie de la région maculaire, baissant l’acuité visuelle. Dans
notre série, ces patients ont une acuité visuelle, (œil droit et gauche confondue) de l’ordre
de 0,9 LogMar (soit 1,25/10).
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

41
Par ailleurs, les patients présentant une rétinite pigmentaire, montrent un champ
visuel rétréci. Parmi eux, certains ne conservent que les 10° centraux. Cependant, l’acuité
visuelle peut être conservée. Dans cette série, nos patients ont une acuité visuelle
moyenne de 0,276 LogMar (soit 5,3/10). L’acuité visuelle de ces patients est donc plus de
quatre fois supérieure à celle des patients présentant une DMLA.
Tableau 7 : Résultats du questionnaire sans distinction d’item
Groupe DMLA
Groupe Rétinite
Pigmentaire p
Activités de déplacement 14,2 ± 4,55 24,8 ± 3,27 0,0029
Activités de vie quotidienne 12 ± 2,34 16,4 ± 1,52 0,0078
Activités de lecture et d'écriture 7,8 ± 4,4 27 ± 3 <0,0001
Activités de loisirs 24,29 ± 1,13 23,54 ± 1,73 0,433
Pour rappel, les activités de déplacement étaient cotées sur un score total de 44
points, celle de la vie quotidienne sur un score de 20 points, la lecture et l’écriture sur un
score de 36 points et enfin, les activités de loisirs sur un score de 36 points. Selon notre
système de cotation, plus le score est faible, plus la gêne est importante.
Ce dernier tableau fait apparaitre que dans les activités de déplacement, les
moyennes des deux groupes sont assez faibles. Toutefois, les personnes présentant une
DMLA seraient plus gênées que celles présentant une rétinite pigmentaire (p=0,0029). Il
en est de même pour les activités de la vie quotidienne. Bien que l’écart entre les deux
moyennes soit plus faible (4,4 points), celui-ci est statistiquement significatif (p=0,0078).
En revanche, les résultats concernant les activités de lecture et d’écriture montrent
une nette différence entre les deux groupes. En effet, le groupe des rétinites pigmentaires
obtient une moyenne de 27 contre 7,8 (sur 36) pour le groupe des DMLA (p<0.0001).
Concernant, les activités de loisirs, les moyennes sont sensiblement identiques; la
différence entre les deux n’est statistiquement pas significative.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

42
DISCUSSION
I. REPARTITION DE LA POPULATION
Dix patients ont été inclus dans cette étude. Etant donné nos critères d’inclusion
qui excluaient de l’étude les patients ayant eu une rééducation basse vision ou ceux ne
correspondant pas aux caractéristiques de la classification de l’organisation mondiale de la
santé, il était très difficile de trouver des patients présentant une rétinite pigmentaire
pouvant intégrés l’étude. L’échantillon de patients trop réduit ne nous a pas permis de
prendre en considération l’âge.
Tous les patients ont été sélectionnés au hasard, et le niveau socioculturel n’a pas
était pris en compte.
II. LA METHODE
Acuité visuelle
Nous n’avons pas mesuré l’acuité visuelle le jour de la passation du questionnaire.
Nous avons uniquement tenu compte de la dernière mesure effectuée au maximum quatre
semaines auparavant. L’acuité visuelle est systématiquement mesurée à l’aide d’une échelle
logarithmique pour les patients atteints de DMLA, mais elle ne l’est pas dans le cas de
patients atteints d’une rétinite pigmentaire.
Nous avons donc retranscrit chaque acuité décimale en acuité logarithmique afin
d’avoir des résultats similaires et donc plus fiables.
Champ Visuel
Le tracé du champ visuel n’a pas été retenu dans cette étude. Chaque patient a
bénéficié d’un champ visuel Goldmann au CHU Bretonneau de TOURS (37). Celui-ci
nous a uniquement servi à vérifier que tous nos patients, notamment ceux atteints de
rétinite pigmentaire dont l’acuité visuelle était encore bonne, rentraient bien dans la
classification basse vision de L’OMS.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

43
Le questionnaire
Nous nous sommes en partie inspirée du questionnaire de National Eye Institute
(Visual Functioning Questionnaire) permettant d’apprécier la qualité de vision des
patients. Nous avons de la même façon demandé au patient de noter diverses activités du
quotidien. Nous avons sélectionné divers items, que nous avons classés en quatre
catégories, ainsi nous nous sommes intéressée aux activités de déplacement, de lecture et
d’écriture, de vie journalière et de loisirs.
Afin de limiter les biais, nous avons demandé à chaque patient de remplir le questionnaire
sans l’aide d’une tierce-personne. Dans le cas où l’acuité visuelle ne le permettait pas, nous
avons rencontré le patient pour le remplir ensemble.
III. LES RESULTATS
La qualité de vie est un concept abstrait, difficile à définir et extrêmement subjectif.
Que ce soit chez les patients atteints de Dégénérescence Maculaire liée à l’Age ou ceux
atteints de Rétinite Pigmentaire, l’état psychologique, mais également l’état psychosocial
sont très importants. En effet, nous avons pu observer, lors de nos rencontres avec
certains patients, notamment chez ceux présentant une DMLA, que les réponses variaient
si le patient vivait seul ou accompagné.
Les activités de déplacement
Il était très difficile de comparer nos résultats à ceux des diverses études portant
sur la qualité de vie des patients atteints de DMLA ou de Rétinites Pigmentaires.
Cependant, certains résultats sont fortement comparables. En effet, nous avons mis en
évidence que les personnes atteintes de DMLA présentaient d’avantage de difficulté dans
les activités de déplacement que les personnes présentant une Rétinite Pigmentaire. Dans
la Blues Mountains Eye Studies, il était décrit que les patients présentant une acuité
visuelle inférieure à 20/100, encouraient un risque accru de fracture de la hanche.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

44
Les activités de vie journalière
Nos résultats sur cette catégorie d’activité semblent concorder avec ceux trouvés
par Williams dans une étude de 1998.
Williams s’est intéressé aux activités de la vie quotidienne. Cependant, les activités
sur lesquelles portait le questionnaire n’étaient pas spécifiquement liées à la vision. De
manière générale, il apparaissait que les patients les plus âgés présentaient le plus de
difficultés dans les activités quotidiennes telles que les tâches ménagères. Il s’agissait
essentiellement les patients dont l’atteinte était centrale et dont l’acuité visuelle avait
considérablement diminué.
Les activités de lecture
Comme nous l’attendions, nous avons vu dans cette étude que les patients ayant
une atteinte de la vision centrale (patients atteints de DMLA dans ce travail) présentaient
d’importantes difficultés de lecture. Cependant, il est intéressant de noter que les patients
présentant une atteinte de la rétine périphérique (type rétinite pigmentaire) présentaient
également une légère gêne ; ils ont effectivement mis une note moyenne de 3 points sur 4
dans cette catégorie d’activité. Ces résultats s’expliquent par le fait qu’un champ visuel
tubulaire réduit considérablement l’empan visuel, habituellement de 4 lettres à gauche et
14 lettres à droite (dans le cas d’une lecture de gauche à droite). Ainsi, les personnes
atteintes d’un déficit périphérique du champ visuel font plus de fixations et des saccades
plus courtes lors de la lecture. Le mot ou la phrase est donc observé par petites surfaces
qu’il faudra assembler pour comprendre le sens.
Dans une étude de 1999 portant sur 2280 patients, Friedman a montré qu’il existait
une concordance entre la vitesse de lecture et les difficultés à lire un journal. Il a
également mis en évidence l’existence pour certains patients d’un état de transition entre
la chute de l’acuité visuelle et la prise de conscience des difficultés de lecture pourtant
présentes. Cette transition, s’expliquerait par des techniques de compensation. Ainsi, les
patients ne se rendraient pas compte de leur gêne lors de la lecture.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

45
Il apparait également, dans une étude de Hazel (2000), portant sur seize patients,
que la capacité de lecture serait étroitement liée à la qualité de vie générale. On note ici
l’importance pour les patients de la lecture dans la vie quotidienne.
Les activités de loisirs
Dans le tableau 6, reprenant l’ensemble des items liés aux loisirs, nous avons
remarqué que les patients atteints de rétinites pigmentaires semblaient d’avantage gênés
que les patients du groupe DMLA.
De nouveau, nous pouvons remarquer que les patients ayant une atteinte maculaire
présentent des difficultés dans les activités nécessitant la vision fine.
De plus, nous remarquons que les patients atteints de rétinite pigmentaire
présentent une gêne à la vision d’un film sur grand écran (cinéma) ou encore pour la
lecture. Lors d’un champ visuel tubulaire, la vision de l’image se forme par petites
surfaces, il devient donc très difficile de la reconstituer.
Ces patients présentent également des difficultés lors de la promenade, résultat qui
corrobore celui de l’item « sortir seul » de la catégorie activités de déplacement.
IV. PERSPECTIVES DE NOTRE TRAVAIL
Au cours de ce travail, l’intérêt d’étudier la qualité de vie des patients présentant
une basse vision avant une éventuelle rééducation nous semble essentielle. De ce fait, il
serait intéressant, d’étalonner un questionnaire qui servirait de base à tous.
Il parait évident que lors de l’annonce d’une atteinte de la vision (responsable à
80% des notions acquises par l’Homme), qu’elle soit centrale ou périphérique, un travail
de deuil plus ou moins long en fonction des individus et/ou de la pathologie doit se faire.
La qualité de vie dépend-elle alors des différents stades du deuil ?
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

46
CONCLUSION
L'intérêt croissant porté par les praticiens de tous les domaines de la médecine à
l'évaluation de la qualité de vie des patients dont ils ont la charge témoigne d'un
changement profond dans la pratique médicale.
Dans la première moitié du XXème siècle, la pratique médicale a principalement eu pour
finalité de sauver des vies, en luttant par exemple contre des fléaux tels que les pathologies
infectieuses.
Aujourd’hui, les médecins et autres professionnels de la santé se trouvent de plus en plus
confrontés à la prise en charge de pathologies chroniques incurables telles que les
pathologies dégénérative de la rétine, dont la fréquence augmente avec le vieillissement
des populations. L'incurabilité pour certaines de ces pathologies fait que la finalité de la
prise en charge de ces patients n'est pas d'obtenir la guérison, mais de lui assurer une
qualité de vie acceptable.
Malgré toutes les technologies mise en place autour du patient que ce soit en matière de
traitement ou encore d’aide visuelle, il apparait nettement que la qualité de vie des patients
est affectée.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

47
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
ENC, ophtalmologie, Larry BENSOUSSAN, édition Vernazobres-Grego.
Les points clés en ophtalmologie, G.Coscas, S.Soubrane, E. Souied, l’européenne
édition.
La dégénérescence maculaire liée à l’âge, une nouvelle approche du patient, C.Monin,
CHNO des XV-XX Paris, edition des laboratoires Théa.
ARTICLES
Berson EL : Management of retinitis pigmentosa. Retinal Physician, Wolters Kluwer
Pharma Solutions, Inc.: www.retinalphysician.com. Accessed October, 2008.
Shintani K, Shechtman DL, Gurwood AS: Review and update : Current treatment
trends for patients with retinitis pigmentosa. Optometry, 2009 July; 80(7):384-401.
Yang Y, Mohand-Said S, Danan A, Simonutti M, Fontaine V, Clerin E, Picaud S,
Léveillard T, Sahel JA: Functional cone rescue by RdCVF protein in a dominant
model of retinitis pigmentosa. Molecular Therapy. 2009 May; 17(5):787-795.
Prévention de la DMLA par anti-oxydant et zinc, étude AREDS, Age-Related Eye
Disease Study Research Group, Arch Ophthalmol 2001 Oct;119(10):1417-36.
DMLA ; on y voit plus clair, INSERM, E. Souied, P. Benlian, P. Amouyel, J.Feinglod,
J.P. Lagarde, American Journal of ophtalmology, vol. 125, numéro 3, mars 1998.
Un traitement porteur pour la DMLA, revue INSERM, Semkova et al. , numéro 16
année 2003
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

48
COURS
M. Santallier et A.Péchereau, polycopié d’anatomie des écoles d’orthoptie de Tours
Présentation et traitement de la Dégénérescence maculaire liée à l’âge, Docteur
Marie-Laure Lelez année 2010, école d’orthoptie de Tours.
Généralité sur la rétinite pigmentaire, Docteur Emmanuelle Lala, novembre 2009,
école d’orthoptie de Tours.
La prise en charge pluridisciplinaire de la basse vision, Docteur Sadi Mazjoub, Centre
régional basse vision de Ballan-Miré (37), avril 2010.
Aspects thérapeutiques de la DMLA, Docteur J-Christophe ZECH, DU basse vision,
Lyon, février 2011.
Imagerie rétinienne en ophtalmologie, P-Louis Cornut, hôpital Edouard Herriot,
Lyons, DU basse vision, 2010.
Approches scientifiques en Basse Vision, Valérie Griffond, Du basse vision, Lyon,
2010.
SITES INTERNET
http://www.fondave.org/-Institut-de-la-Vision-.html
http://www.snof.org/maladies/dmla.html
http://www.chups.jussieu.fr/polys/ophtalmo/POLY.Chp.5.html
http://www.eyesite.ca/francais/information-publique/les-maladies/retinite-
pigmentaire.htm
http://www.retina.fr/
http://www.metrovision.fr/
http://www.medscape.org/viewarticle/514448_2
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

49
ANNEXE
Concordance échelle de Monoyer, de Parinaud et logMar
Echelle de Monoyer logMar
1/20 +1.3
1/16 +1.2
1/12 +1.1
1/10 +1
1.25/10 +0.9
1.6/10 +0.8
2/10 +0.7
2.5/10 +0.6
3.2/10 +0.5
4/10 +0.4
5/10 +0.3
6.3/10 +0.2
8/10 +0.1
10/10 0
12.5/10 -0.1
Echelle de Parinaud à 33cm logMar
14 +1.03
10 +0.88
8 +0.78
6 +0.66
5 +0.58
4 +0.48
3 +0.36
2 +0.18
1.5 +0.06
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE READAPTATION
49pages – 7 tableaux – 22 figures
Résumé :
La prise en charge des patients atteints de basse vision a considérablement évolué durant
ces dernières années. Les progrès thérapeutiques mais également technologiques
permettent d’améliorer le quotidien des patients même si la maladie reste cependant
difficile.
L’objectif principal de notre étude était d’évaluer la qualité de vie des patients atteints
d’une DMLA ou d’une rétinite pigmentaire à l’aide d’un questionnaire inspiré du
« National Eye Institute, Visual Functioning Questionnaire » et d’en discuter les résultats.
Dix patients âgés de 32 à 80 ans ont été inclus dans ce travail. Tous étaient suivis au CHU
de Tours(37). Parmi eux, cinq étaient suivis pour une DMLA et cinq pour une rétinite
pigmentaire.
Tous les patients inclus correspondaient aux critères de basse vision dans la classification
de l’organisation mondiale de la santé. En effet, les patients présentant une DMLA
avaient tous une acuité visuelle inférieure à 0,5 LogMar (soit 3/10). Les patients atteints
de rétinite pigmentaire présentaient une acuité visuelle supérieure à 0,5 LogMar mais leur
champ visuel était inférieur à 20°.
De manière générale, il apparait que la qualité de vie des patients présentant une DMLA
est plus affectée que celle des patients présentant une rétinite pigmentaire. Cela est
particulièrement vraie pour les activités de déplacement (p=0,0029), les activités de vie
journalière (p=0,078) et les activités de lecture (p<0.0001). Cependant, nous avons
également mis en avant la gêne non négligeable des patients atteints de rétinite
pigmentaire lors des déplacements individuels (items : sortir seul p= 0,007 et promenade
p=0,0037).
Ce travail montre l’intérêt d’étudier la qualité de vie de nos patients au cours de leur
traitement mais également avant toute prise en charge dans la rééducation orthoptique.
En effet, celle-ci variera en fonction du type d’atteinte mais également en fonction des
gênes et des attentes du patient.
Mots clés : basse vision, DMLA, rétinite pigmentaire, qualité de vie.
BOUGRIER (CC BY-NC-ND 2.0)