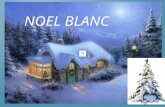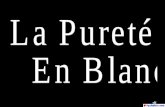Correction Bac Blanc
-
Upload
mme-et-mr-lafon -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Correction Bac Blanc
-
7/29/2019 Correction Bac Blanc
1/5
Comment peut on expliquer la mutation des conflits sociaux ?
Dbut fvrier, lAssemble nationale a adopt le projet de loi ouvrant le mariage et ladoption aux couples de mme sexe. Ildevrait tre prsent en avril au Snat. Ce projet a donn lieu de nombreux dbats : dans lhmicycle dabord o il y a eu plusde 110 heures de dbat dans l'hmicycle, mais aussi dans la rue. Les partisans du mariage pour tous ont mobilis le dimanche 27
janvier 125 000 personnes, alors que les opposants au projet de loi ont, l'issue de rassemblements rgionaux runi 80 000personnes, travers toute la France, samedi 2 fvrier. Ces manifestations tmoignent ainsi du renouveau des conflits sociaux : lesconflits traditionnels ont disparu au profit de conflits bass sur des revendications qualitatives. Des facteurs conjoncturels etstructurels permettent dexpliquer cette transformation des conflits.
I. Une transformation des conflits sociaux
A. Des conflits traditionnels qui sattnuent
1. Les caractristiques
Conflits autour du travail : Opposent salaris et patronat : 1936 et 1947 : grves ouvrires (doc 1)
Mens par les syndicats : 25% de salaris syndiqus aprs-guerre (doc2) Pour des revendications quantitatives : salaires, conditions de travail (doc 1):1831-1834 : les canuts se mettent en grve
contre la suppression demplois due lutilisation de machines dans le textile Moyens : grves, manifestations : grves ouvrires de 36, 47 et 68 (doc1)
2. Des conflits en dclin
Ce type de conflits est de moins en moins frquent : depuis 68, il y en a 2 : 2009 : grves en Guadeloupe, 2010 : contre larforme des retraites (doc 1)
Rle des syndicats diminue : taux de syndicalisation divis par plus de 2 : 8% aujourdhui (doc 2) sa forme canonique, la grve, est en dclin (doc 2)
B. Au profit dautres formes de conflits
1. Des conflits du travail qui se modifient
Laffaiblissement du syndicalisme et le recul en longue dure des journes de grve, ne signifie pas la fin de laconflictualit sociale au travail (doc 2)
Dautres formes de mobilisation apparaissent : refus dheures supplmentaires, ptitions, dbrayages de courtedure (doc 2).
Rsistance nest plus collective mais individuelle : rsistance individuelle qui fournissent un terreau potentiel deressourcement de laction collective. (doc 2)
2. De nouvelles formes de conflits apparaissent : les Nouveaux Mouvements Sociaux
Depuis le dbut des annes 70, de nouveaux conflits apparaissent et ils sont majoritaires (doc 1) De nouveaux acteurs : les femmes, les tudiants, les mal logs, les cologistes (doc 1) De nouvelles revendications qualitatives et non quantitatives : lgalit des droits entre hommes et femmes, entre
homosexuels et htrosexuels, contre le nuclaire, contre le racisme (doc 1) De nouveaux moyens : formes de protestation qui utilisent les medias : installation des tentes autour du canal Saint-
Martin Paris en 2006 (doc1)
Cette transformation des conflits sociaux sexpliquent par des dterminants conjoncturels et structurels
II. Qui sexplique par des causes conjoncturelles
La crise entrane une augmentation du chmage et une prcarisation de lemploi qui entranent une moindre conflictualit du
travail
A. Constat (doc 3)
Taux de chmage multipli par plus de 2 entre 75 et 2008 (de 2.7% 7.5%)
-
7/29/2019 Correction Bac Blanc
2/5
Emploi normal temps plein et en CDI est moins frquent. Dveloppement des emplois atypiques ( CDD, intrim, tempspartiel) : nombre multipli par 5 entre 75 et 2008
B. Les effets sur la mobilisation (doc 2)
La courbe de la dsyndicalisation qui intervient partir de la fin des annes 1970 est associe de manire suffisammenttroite avec celle de la monte du chmage et de la dstabilisation de lemploi pour admettre quil sagit de lun desfacteurs cette chute.
Les syndicats ne se sont pas intrsss aux chmeurs La prcarit de lemploi empche de se mobiliser : moins dengagement social et politique, peur de ne pas tre
rembauch : seuls 2,4 % des salaris en CDD ou en intrim sont syndiqus .
III. Et structurelles
A ces causes court terme sajoutent des transformations longues la fois des emplois et des valeurs qui expliquent latransformation des conflits. En effet, la croissance conomique des 30 Glorieuses a modifi la fois les emplois et les valeurs
A. La transformation des emplois
1. Rle de la croissance
Augmentation du PIB entrane un changement dans la consommation Demande de services qualifis saccrot au dtriment de produits industriels (lois dEngel)
2. Constat
Part des emplois dans les grandes entreprises diminue : de 22% en 75 11.2% en 2008 Nombre demplois douvriers est divis par 1.5, celui des cadres et professions intermdiaires multipli par 1.5 entre 75
et 2008
3. Les effets sur la mobilisation
Or, les bastions des syndicats taient les grandes entreprises et les ouvriers La diminution de ces deux groupes entrane automatiquement une baisse du taux de syndicalisation
B. La transformation des valeurs
1. Leffet de la croissance sur le changement de valeurs
R.Inglehart a mis en vidence le rle de laugmentation des revenus sur les valeurs Dveloppement des valeurs post-matrialistes et individualistes ( doc 4 ) : les pays riches ont des valeurs individualistes
et rationnelles ; les pays pauvres des valeurs matrialistes et traditionnelles
Raisons :o Dveloppement de lducationo Enrichissement rend moins importantes les revendications quantitatives
2. Un changement de valeurs qui se rpercute sur la nature des conflits
Dveloppement de lindividualisme : effet pervers sur la mobilisation : dveloppement du passager clandestin etparadoxe dOlson
Egalit hommes-femmes : Entre des femmes sur le march du travail sexplique par une volont de plus grande galitentre les hommes et les femmes. Taux demploi des femmes augmente : 41.2% en 75 47.1% en 2008. Or taux desyndicalisation faible
Revendications ne sont plus matrielles mais immatrielles
Les formes de conflit ont donc chang : moins bass sur des revendications quantitatives et conomiques et plus sur des motifsimmatriels, de nouveaux acteurs : les femmes, les jeunes, de nouvelles formes daction. La crise qui a gnr une hausse duchmage et une prcarisation de lemploi, a rduit le pouvoir des syndicats. A ces raisons conjoncturelles sajoutent unetransformation des emplois et un changement des valeurs.
-
7/29/2019 Correction Bac Blanc
3/5
Cette transformation des valeurs a aussi des rpercussions sur les attentes de la population vis--vis de lenvironnement : lapopulation stant enrichie, elle prfre avoir un environnement moins dgrad, et demande alors un renforcement des normescologiques, ce qui favorise le dveloppement durable
Epreuve compose
Premire partie :
1.Max Weber une vision de la stratification sociale trs diffrente de celle de Marx car il distingue 3 dimensions de la stratificationsociale :
Ordre conomique : Cette situation de classe correspond la situation occupe par les individus sur le march. Lepouvoir que les individus sont en mesure dexercer dans le monde du travail ou sur le march des capitaux est dpendantdes types de biens et de services quils possdent et quils peuvent apporter sur le march dans le but de gnrer unrevenu. Autrement dit, cest la proprit (ou labsence de proprit) qui dtermine les situations de classe, cest--dire lesopportunits dexercer un pouvoir dans la sphre conomique (qui prend la forme du march dans la socit capitalistedu XIXme sicle)
Ordre social : la situation statutaire est fonde sur le prestige dont bnficie un individu dans lordre social ou dans sacommunaut. La distribution ingale du prestige est par consquent la base dune autre hirarchie que celle qui prvautface au march. Elle donne lieu la constitution de groupes de statuts qui ont un prestige diffrent lintrieur de lasocit. Le prestige selon Weber est un privilge positif ou ngatif de considration sociale qui est fond sur son style devie ou son niveau dinstruction reconnu ou encore li sa naissance (aristocratie) ou lexercice dune profession
particulire. La situation statutaire est donc une ralit intersubjective (soumise la considration et la perception desautres) qui sappuie sur des lments objectifs (niveau dinstruction, famille dorigine,etc.).
Ordre politique : Weber introduit une troisime dimension pour essayer dexpliquer le fait que certaines classes socialesou certains groupes de statut passent laction et se mobilisent autour dintrts communs. Ainsi, le parti est un ensemblede personnes qui sengagent pour une cause et dans une action conjointe pour conqurir le pouvoir. Que cette actioncollective soit lie des groupes sociaux rels ou non, son but est dacqurir le pouvoir d Etat
Il existe certes des rapports possibles entre les trois hirarchies, mais elles ne sont pas toujours lies entre elles de faonncessaire.Au contraire dans lanalyse de Marx la bourgeoisie occupait une position dominante dans la sphre conomique et
dominait donc obligatoirement les sphres sociales et politiques.
2.
Le facteur travail est htrogne, ce qui conduit une segmentation du march du travail et qui incite les entreprises diffrentes traiter diffremment les salaris.
Un dualisme du march du travail :M Piore considre donc quil existe diffrents types de salaris qui sont confins surdes marchs du travail entre lesquels existent des barrires ne permettent pas dtre mobiles. Piore distingue deux typesde march : le march primaire et le march secondaire. Il va constater que sur chacun des marchs sont tablies desentreprises prsentant des caractristiques diffrentes, proposant des emplois dissemblables concernant des populationsdistinctes. Sur le march primaire, les salaris sont jeunes qualifis, alors que sur le march secondaire, les salaris sont
moins qualifis et donc plus interchangeables
Les entreprises adoptent alors une gestion de lemploi adapte chaque catgorie : Au niveau du contrat de travail : lentreprise offre des CDI aux salaris qualifis quelles souhaitent garder et des
CDD aux salaris peu qualifis.
Au niveau des salaires : les entreprises ne vont pas diminuer les salaires des qualifis en cas de crise et de chmage,alors quelles vont tre plus tentes de le faire pour les non qualifis :
Lanalyse des contrats implicites montre que les entreprises nont pas intrt baisser le salaire des dtenteursde CDI. Car les salaris vont tablir des contrats implicites (car non reconnus par la loi) avec leur employeurqui peuvent tre assimils des contrats dassurance. Durant les priodes de croissance, les gains de
productivit augmentent fortement, les salaris vont accepter de bnficier des augmentations de salaire plus
rduites, le salaire devient donc infrieur la productivit. On dit que le salari paye sa prime son employeurqui est son assureur. En contrepartie, durant les priodes de rcession, le salari bnficie dun salaire quidevient suprieur la productivit (le salaire ayant moins baiss que la productivit) , on dit alors que le salarireoit ses indemnits dassurance qui sont la contrepartie de la prime .
La thorie du salaire defficience explique pourquoi les entreprises donnent des salaires levs aux plus qualifis. Lesthoriciens du salaire defficience acceptent gnralement lide que linformation nest pas parfaite. Ds lors , quand une
-
7/29/2019 Correction Bac Blanc
4/5
entreprise embauche un salari , elle nest pas certaine de son niveau de productivit, cest ce qui se passe dans les modlesde slection adverse. Le salaire de rservation annonc par le candidat lors de lembauche joue un rle de signal qui indiqueen partie ses qualits et ses comptences. Plus le salaire offert par lentreprise est lev relativement celui du march, pluslentreprise aura les moyens dattirer et de slectionner une main-duvre de qualit. Dans ce cadre, les candidats lemploi qui se caractriseraient par un salaire de rservation trop bas afin daccrotre leur probabilit dembauche, iraient lencontre de leur objectif. En effet , lentreprise considrerait que , puisquils acceptent un salaire faible , cela signifie queleur niveau de productivit est rduit , donc que lembauche du salari nest pas intressante pour lentreprise : il vaut mieux
payer cher un salari productif que dembaucher un salaire rduit un salari faiblement productif .
Deuxime partie :
Ce document est tir dune revue Flash conomie publie par Natixis le 18 fvrier 2013 et il met en relation deux variables :limportance de la lgislation sur lemploi et lvolution du nombre demploi, cest--dire la cration ou la destructiondemplois .Ce document permet donc de voir sil existe une corrlation entre ces deux variables.
La droite de rgression permet de mettre en vidence une corrlation :o plus la LPE est limite, plus la cration demplois est forte : lAustralie est un des pays de lOCDE o la
protection de lemploi est la moins forte, et entre 98 et 2012, la cration demplois a t importante : lemploi aaugment de 35% entre 1998 et 2012
o en revanche, quand lemploi est protg par de nombreuses lois sociales, la destruction demploi est rapide : lePortugal qui a une LPE trs restrictive a connu une diminution de lemploi de 2% entre 1998 et 2012
Cette droite de rgression nest pourtant pas automatique : de nombreux contre-exemplesinfirment cette relation :
o Un mme niveau de protection peut tre corrl avec des crations demplois trs diffrentes : Irlande et leDanemark ont une LPE presque 2. Or lIrlande a connu une hausse des emplois de 25% entre 1998 et 2012 etle Danemark a vu son nombre demplois rester stable.
o Un rythme de crations demplois identique peut tre corrl avec des niveaux de LPE trs diffrents: leRoyaume-Uni et l4allemagne ont cr 10% demplois en plus entre1998 et 2012, mais la lgislation est presque3 fois plus restrictive en Allemagne quau Royaume-Uni.
Il ny a donc pas de relation automatique entre rigueur de la lgislation sur le travail et cration demplois. Dautres variablesinfluencent la cration demplois.
Epreuve compose
La semaine dernire, la direction des papeteries de Condat a annonc son intention de supprimer 154 postes sur 650 emplois ausein de son usine du Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne. Cela sexplique par labaisse de commandes, lie au march mondial du
papier. Cette baisse sexplique par des raisons structurelles : le dveloppement des services en ligne, mais aussi par des raisonsconjoncturelles : la rduction de la demande est lie la crise de 2007.Cette crise est avant tout une crise financire provenant des prts subprimes. Les banques ont alors subi des pertes. Pour restaurerleur stabilit financire, elles ont alors restreint laccs au crdit en le rendant plus coteux. La hausse des taux dintrt a lorsincit les entreprises moins investir ce qui a dbouch sur une rcession, cest--dire selon lINSEE, deux trimestres conscutifsde croissance ngative du PIB rel. Mais mme si les effets de cette crise sont graves, ils le sont moins quen 1929. En effet, cettercession ne sest pas traduite par une dpression. Mme sil nexiste pas de dfinition claire et scientifique de la dpression, onconsidre que lorsque le PIB diminue de plus de 10% et quelactivit ne se redresse pas "naturellement"au bout d'environ trois
ans, un tat est en dpression. Cette moindre gravit de la crise sexplique notamment par les politiques macro-conomiquesmises en uvre lors de la crise de 2007. La politique conjoncturelle est l'ensemble des mesures de politique conomique qui visent agir court terme sur l'conomie. Les moyens utiliss sont essentiellement : la politique budgtaire qui est l'ensemble desmesures ayant des consquences sur les ressources ou les dpenses inscrites au budget de l'Etat et visant directement agir sur laconjoncture et la politique montaire, cest--dire l'ensemble des mesures qui sont destines agir sur les conditions dufinancement de l'conomie. Elle passe par la "modification" par la Banque centrale des taux d'intrt sur le march interbancaire.Ainsi si la crise de 2007 est moins grave que celle de 2009, cest en raison des politiques de relance dinspiration keynsiennemises en place.
o La crise la plus grave depuis 1929 :
La plus grave depuis la seconde guerre mondiale :
Le PIB a baiss de 1.5% en France au premier trimestre 2009 (doc2) Aux Etats-Unis, le PIB a diminu de 4% en 2009 (doc 3)
Mais moins grave que celle de 1929 : la dure et lintensit sont moins fortes : Dure plus limite :
-
7/29/2019 Correction Bac Blanc
5/5
Aux EU, le taux de croissance du PIB diminue pendant 3 ans de 1929 1932 : la baisse est doncde plus en plus rapide : en 1930, le Pib diminue de 8%, en 32 de 12%
Le taux de croissance diminue pendant 1 an entre 2008 et 2009, puis raugmente et devientpositif en 2010
Intensit rduite : les effets sur le PIB sont moindres que pour la crise de 29 :
La baisse maximale du PIB est de 12% en 1932, De 4% en 2009
La crise financire a ainsi entrain une rcession mais il ny a pas eu de dpression, grce la mise en place de politiques macro-conomiques de relance
o Dont les effets ont t rduits grce une politique de relance adapte :
En 1929, avaient t mises en place des politiques restrictives dinspiration librales : Politique montaire restrictive : hausse des taux dintrt Politique budgtaire de rigueur : lobjectif est de restaurer les comptes publics. Le dficit budgtaire par
rapport au PIB reste limit : 4% au maximum en 1932 Ces politiques dinspiration librale partaient du principe quil fallait rduire au maximum linfluence de
lEtat sur lconomie Seule consquence : transformer la rcession en dpression, un cercle vicieux sest cr
Lors de la crise 2007, les gouvernements ont pris en compte ces lments et ont mis en place des politiques de relance.Pour viter la baisse de la demande, les Etats agissent par deux moyens :
Politique montaire : toutes les banques Centrales diminuent leur taux dintrt directeur (doc 1) : entre 2008 et 2010,
dans la zone euro, la Grande-Bretagne et les Eu, le taux dintrt directeur est divis par 5 effets sur la croissance : facilite linvestissement, donc la hausse de la production et le financement
des innovations ( cf thorie de la croissance endogne)
politique budgtaire : cette baisse des taux dintrt est insuffisante pour relancer la croissance si elle nestpas corrle avec aune augmentation de la demande. Celle-ci est permise grce la politique budgtaire derelance :
moyens : baisse des impts, augmentation des dpenses publiques consquences :
augmentation du dficit budgtaire le dficit budgtaire est de 10% en moyenne depuis2009 aux EU (doc 3)
Mais cela permet la croissance : au deuxime trimestre 2010, le PIB a augment de 0.1%,sans la politique budgtaire adapte, il aurait diminu de 0.5%. Au 4 trimestre 2009, le PIBa augment de 0.6%, sans le stimulus budgtaire il aurait diminu de 0.1%
Leffet multiplicateur mis en vidence par Keynes joue : le dficit public permet uneaugmentation de la demande des mnages et des entreprises par la rduction des impts, decelle des Administrations Publiques par la hausse des dpenses publiques. Leffet sur la
production est plus grand que leffet initial.
La mise en place de politiques macro-conomiques de relance a ainsi permis dviter dentrer dans un cercle vicieux
dpressionniste. Cependant, ces politiques ont aussi aggrav le dficit public et donc alourdi la dette publique. Aujourdhui,beaucoup de pays ne peuvent plus continuer ces politiques de relance car elles ont entran la dfiance des marchs financiers et ladgradation de leur note. Les gouvernements doivent donc essayer de rduire leur dficit public. Chypre a ainsi dans un premiertemps song taxer les dpts bancaires pour lever 5,8 milliards deuros dans le cadre du plan de sauvetage de lle. Mais face autoll dans lle mais aussi ltranger, notamment en Russie, car, une grande partie des fonds dposs dans les banques de llemditerranenne tant russes, le gouvernement a abandonn ce projet.