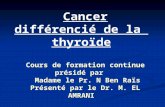COLOPHON - WordPress.com · 2008-04-30 · 9 Le WRITESHOP a été présidé par le Dr. Abou...
Transcript of COLOPHON - WordPress.com · 2008-04-30 · 9 Le WRITESHOP a été présidé par le Dr. Abou...


COLOPHON
Texte initialAbel AFOUDA (Université Abomey Calavi)Tamsir NDIAYE (OMVS)Madiodio NIASSE Lawrence FLINT / Mamouda MOUSSA NA ABOU (ENDA)David PURKEY (SEI-US)
Présidence du WRITESHOPAbou AMANI (UNESCO)
CoordinationJean-Philippe THOMAS (ENDA)
EditionAbou AMANI (UNESCO) Jean-Philippe THOMAS (ENDA) Mamouda MOUSSA NA ABOU (ENDA)
Page de gardeRéalisation : M.M. NA ABOU (ENDA)
Mai 2007


4

5
Table des matièresRemerciements…………………………………………………………………………………………………………9
Résumé exécutifs ……………………………………………………………………………………………………12
Listes des abréviations………………………………………………………………………………………………17
Introduction générale ………………………………………………………………………………………………19
Chapitre I : Impacts du changement et de la variabilité climatiques sur les ressources en eau des bassins versants Ouest Africains : Quelles perspectives ?………………………………23
Résumé …………………………………………………………………………………………………………231.1 Introduction ……………………………………………………………………………………………………231.2 Milieu Physique ………………………………………………………………………………………………24
1.2.1 Caractéristiques du climat …………………………………………………………………………241.2.2 Ressources en eau ……………………………………………………………………………………25
Eaux de surface …………………………………………………………………………………………25Eaux souterraines …………………………………………………………………………………………27
1.2.3 Dépendance des Etats en matière de ressources en eau …………………………………………271.2.4 Les différents usages de l’eau …………………………………………………………………………27
1.3 Variabilité du climat au 20ème siècle …………………………………………………………………………281.3.1 Changements et Variabilité du Climat ………………………………………………………………281.3.2 Variabilité des ressources en eau ……………………………………………………………………28
Au niveau des eaux de surface …………………………………………………………………………28Au niveau spécifique des zones humides ………………………………………………………………29Au niveau des eaux souterraines (nappes souterraines) ………………………………………………29
1.4 Evolution plausible du climat au 21ème siècle ………………………………………………………………29Impacts sur les Ressources en Eau …………………………………………………………………………30
1.5 Contraintes majeures pour la région ……………………………………………………………………30Conclusions - Recommandations……………………………………………………………………………………30
Chapitre II : Actions concrètes envisageables pour l’adaptation à la gestion de l’eau à l’échelle du bassin fluvial en Afrique de l’Ouest, le cas de l’OMVS ……………………………………33
Résumé ………………………………………………………………………………………………………………332.1 Introduction ……………………………………………………………………………………………………342.2 Actions concrètes menées dans le bassin du fleuve Sénégal …………………………………………34
2.2.1 Sur le plan juridique et institutionnel ………………………………………………………………34Plan juridique ………………………………………………………………………………………………34Plan institutionnel …………………………………………………………………………………………35
2.2.2 Sur le plan des réalisations physiques ………………………………………………………………35Infrastructures ………………………………………………………………………………………………35Agriculture……………………………………………………………………………………………………36Agro-industrie ………………………………………………………………………………………………37Elevage ……………………………………………………………………………………………………37Pêche…………………………………………………………………………………………………………37Energie ……………………………………………………………………………………………………37Transport ……………………………………………………………………………………………………37Télécommunication…………………………………………………………………………………………37
2.2.3 Protection et restauration des Ecosystèmes …………………………………………………………372.2.4 Renforcement des capacités …………………………………………………………………………38
Renforcement des capacités Institutionnelles et juridiques …………………………………………38Renforcement des capacités Matérielles ………………………………………………………………38Renforcement des capacités financières ………………………………………………………………38Renforcement des capacités humaines ………………………………………………………………38Renforcement des capacités techniques et technologiques …………………………………………38
2.2.5 Information, sensibilisation et communication ……………………………………………………38

6
2.3 Limites et leçons apprises ……………………………………………………………………………………392.3.1 Limites ……………………………………………………………………………………………………392.3.2 Leçons apprises …………………………………………………………………………………………39
Au niveau de la Gouvernance …………………………………………………………………………39Au niveau des programmes d’intervention………………………………………………………………39
Conclusions - Recommandations……………………………………………………………………………………40
Chapitre III : Climat, vulnérabilité et adaptation de l’aménagement des ressources en eau à l’échelle communautaire, en Afrique de l’Ouest …………………………………………43
3.1 Introduction ……………………………………………………………………………………………………433.2 Impacts des variabilités climatiques sur les ressources en eau
et sur les communautés locales en Afrique de l’ouest……………………………………………………44Pêcheurs…………………………………………………………………………………………………………44Petits exploitants agricoles ……………………………………………………………………………………44Petits éleveurs ………………………………………………………………………………………………44Commerçants ………………………………………………………………………………………………44Transporteurs……………………………………………………………………………………………………44Transformateurs agro alimentaires …………………………………………………………………………44
3.3 Mesures d’adaptation ……………………………………………………………………………………443.3.1 Mesures et actions auto-adaptatives ………………………………………………………………45
Adaptation réactive au déficit pluviométrique …………………………………………………………45Mesures visant l’efficacité et l’efficience dans la gestion de l’eau pour l’agriculture ………………45Adaptation spontanée en cas d’inondations …………………………………………………………45Mesures de collecte et de conservation de l’eau pour usages domestiques ……………………45Autres adaptations spontanées et réactionnelles ……………………………………………………45
3.3.2 Mesures d’Adaptation spécifiques……………………………………………………………………46Accès à l’eau pour la consommation et ou pour l’irrigation …………………………………………45Adaptation à la sécheresse et au dérèglement de la pluviométrie ………………………………45Adaptation par la gestion intégrée des bassins versants …………………………………………46Mesures visant l’amélioration de la qualité de l’eau et des services ………………………………46Autres mesures d’adaptation réactionnelles et anticipatives …………………………………………46
3.4 Options d’adaptation spécifiques prioritaires suivant les modes d’existence …………………………463.5 Analyse du tableau et choix des options prioritaires ……………………………………………………473.6 Options d’intérêt général ……………………………………………………………………………………49
3.6.1 Mention sur le Développement de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau communautaire …………………………………………………………………………49
3.6.2 Mention sur l’approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA) ……………………493.6.3 Mention sur le massif du FOUTAH DJALLON ……………………………………………………503.6.4 Mention sur l’accès à l’énergie…………………………………………………………………………50
3.7 Pré requis pour l’adaptation ………………………………………………………………………………513.7.1 La Communication ……………………………………………………………………………………513.7.2 Perceptions et Participation …………………………………………………………………………51
Conclusions - Recommandations……………………………………………………………………………………52
Chapitre IV : Mesures politiques et institutionnelles concrètes envisageables pour faciliter la gestion adaptative à différentes échelles en Afrique de l’Ouest ……55
4.1 Introduction ……………………………………………………………………………………………………554.2 Performances du dispositif politique et institutionnel actuel dans la gestion
des impacts liés à la variabilité du climat ………………………………………………………………564.3 Perspectives climatiques et niveau de préparation de la région ……………………………………584.4 Réformes institutionnelles envisageables ………………………………………………………………59
4.4.1 Appui aux processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans nationaux ………………59Mesures spécifiques ……………………………………………………………………………………59Modalités de mis en œuvre ………………………………………………………………………………59
4.4.2 Appuyer les Etats pour une mise en œuvre effective de la Convention RAMSAR………………59Mesures spécifiques ……………………………………………………………………………………59Modalités de mis en œuvre ………………………………………………………………………………59

7
4.4.3 Appui à la finalisation et à la mise en œuvre de la Convention Cadre entre les ………………60Mesures spécifiques ……………………………………………………………………………………60Modalités de mis en œuvre ………………………………………………………………………………60
4.4.4 Promouvoir la ratification et de la mise en œuvre Convention des NU sur les eaux partagées ………………………………………………………………………………60
Mesures spécifiques ……………………………………………………………………………………60Modalités de mis en œuvre ………………………………………………………………………………60
4.4.5 Mesures institutionnelles d’accompagnement pour favoriser les investissements …………61Mesures spécifiques ……………………………………………………………………………………61Modalités de mise en œuvre………………………………………………………………………………61
4.4.6 Mesures institutionnelles pour assurer l’amélioration/protection de la qualité de ………………61Mesures spécifiques ……………………………………………………………………………………62Modalités de mise en œuvre………………………………………………………………………………62
4.4.7 Appuyer la mise en œuvre des PANA ………………………………………………………………62Actions spécifiques…………………………………………………………………………………………62Modalités de mise en œuvre………………………………………………………………………………62
4.4.8 Intégrer le changement climatique et prendre en compte les normes …………………………63Actions spécifiques…………………………………………………………………………………………63Modalités de mise en œuvre………………………………………………………………………………63
4.4.9 Réglementation de l’occupation et d’utilisation de l’espace selon les niveaux de …………63Actions spécifiques…………………………………………………………………………………………64Modalités de mise en œuvre………………………………………………………………………………64
Conclusions - Recommandations……………………………………………………………………………………64
ANNEXE : Synthèse des mesures institutionnelles préconisées …………………………………………66
Chapitre V : Actions concrètes potentielles à renforcer les capacités en Afrique de l’Ouest à intégrer l’Adaptation aux changements climatiques dans la gestion des ressources en eau à plusieurs échelles …………………………………………………………………………69
5.1 Introduction ……………………………………………………………………………………………………695.2 Comportement actuel envers la gestion des ressources en eau en Afrique de l’Ouest
et son adaptation potentielle aux changements climatiques …………………………………………70Adapter les besoins aux ressources …………………………………………………………………………70Adapter les ressources en eau aux besoins ………………………………………………………………70
5.3 Identifications des cibles pour le renforcement de capacité …………………………………………71Services de l’Etat ………………………………………………………………………………………………71Entreprises privées (par exemple, société, chambres de commerce, associations) ………………71Les décideurs politiques (par exemple, conseillers, maires, parlementaires, sénateurs,…) …………71Les medias ……………………………………………………………………………………………………71Les ONG et les associations de base ……………………………………………………………………71Les communautés …………………………………………………………………………………………71Les universités, les centres de recherche, et les collèges techniques ………………………………71Les organismes intergouvernementaux de l’Afrique de l’Ouest …………………………………………71
5.4 Définition des catégories d’actions de renforcement des capacités ……………………………………71La sensibilisation, l’information et la communication ……………………………………………………71La formation et le développement des connaissances de base …………………………………………72Stages de 1 à 3 mois …………………………………………………………………………………………72Curricula universitaires…………………………………………………………………………………………72Mémoire, thèses, études expérimentales……………………………………………………………………72Les équipements et outils techniques ……………………………………………………………………72Le cadre juridique et administratif …………………………………………………………………………72La mobilisation des financements …………………………………………………………………………73La coopération et les échanges d’information …………………………………………………………73
5.5 Les adaptations prioritaires ………………………………………………………………………………735.5.1 Au niveau des bassins versants ……………………………………………………………………735.5.2 Les adaptations prioritaires au niveau des communautés …………………………………………735.5.3 Aux niveaux institutionnels et politiques …………………………………………………………74

8
5.6 Méthode d’identification des actions concrètes pour le renforcement des capacités ………………74Conclusions - Recommandations……………………………………………………………………………………76
Chapitre VI : Principales conclusions et recommandations ………………………………………………79Principaux résultants sur la variabilité et changement climatique et ses impacts sur les ressources en eau …………………………………………………………………………………………79Actions concrètes pour une meilleure connaissance et gestion de la variabilité et changements climatiques et leurs impacts sur les ressources en eau ………………………………79Actions concrètes d’adaptation aux changements pour la gestion des ressources en Afrique de l’Ouest à l’échelle de bassin ……………………………………………………………………80Actions concrètes au niveau communautaire d’adaptation aux changements pour la gestion des ressources en Afrique de l’Ouest…………………………………………………………80Mesures et actions auto-adaptatives …………………………………………………………………………81Mesures d’Adaptation spécifiques ………………………………………………………………………………81Actions concrètes aux niveaux politique et institutionnel d’adaptation aux changementspour la gestion des ressources en Afrique de l’Ouest…………………………………………………………81Actions concrètes de renforcement des capacités d’adaptation aux changements pour la gestion des ressources en Afrique de l’Ouest…………………………………………………………82
Références bibliographiques et autres sources de lecture ………………………………………………83
ANNEXE 1 : Agenda WRITESHOP Dakar, 21-24 février 2007 ………………………………………………87
ANNEXE 2 : Liste des Participants au WRITESHOP, 21-24 février 2007, Dakar …………………………89

9
Le WRITESHOP a été présidé par le Dr. Abou AMANI (UNESCO) que nous tenons tout particulièrement àremercier pour ses contributions durant et après l’atelier, en particulier pour la réalisation du document final.Nous associons à ces remerciements NCAP / ETC pour le support technique et financier apporté pour laréalisation de ce « WRITESHOP », aux contributeurs et participants. L’ensemble du processus a été coor-donné par le Dr. Jean-Philippe THOMAS (ENDA).
ContactJean-Philippe Thomas, Moussa Na Abou MamoudaENDA TM :54, Rue Carnot – BP 3370 - Dakar, Sénégal
Ian Tellam, Miranda VerburgETC FoundationKastanjelaan 5 - 3833 AN Leusden - The Netherlands
Remerciements

Objectifs et methode du writeshop
10
Le « WRITESHOP » qui s’est tenu du 21 au 24février 2007 à Dakar, au Sénégal, s’est fixé commeobjectif l’élaboration d’un document de synthèse.Ce document de synthèse n’a pas vocation à ser-vir de référence pour des recherches à venir. Aulieu de cela, sa principale caractéristique sera demettre l’accent sur des mesures concrètes pou-vant être prises dans la région. La description desmesures concrètes présentées dans le documentde synthèse doit être suffisamment détaillée pourservir de base à des textes de projets susceptiblesd’être utilisés pour rechercher le financement dedemandes spécifiques portant sur l’adaptation auxchangements climatiques dans la région del’Afrique de l’Ouest.
Le processus de préparation du document de syn-thèse est un processus important qui s’est diviséen 4 phases, à savoir: a) la préparation d’unensemble de projets de documents de référence,b) un processus d’« atelier d’écriture », lors de laréunion de février 2007, à partir des documents deréférence, c) des révisions ultérieures, après la réu-nion de février 2007, en vue de finaliser le docu-ment, et d) la publication du document de syn-thèse. Cette approche est conforme à l’approcheparticipative d’atelier de rédaction lancée auxPhilippines par l’Institut international pour lareconstruction rurale.
Pour la préparation du présent « WRITESHOP »,cinq (5) documents de référence techniques ontété réalisés :
1. Les changements et la variabilité climatiques etleurs conséquences sur les ressources en eaudes bassins fluviaux d’Afrique de l’Ouest ; quel-les perspectives ? par Abel AFOUDA ;
2. Les actions concrètes potentielles pour l’adap-tation de l’aménagement des ressources en eauau niveau des bassins fluviaux en Afrique del’Ouest : le cas de l’OMVS par Tamsir NDIAYE.
3. Les actions concrètes potentielles pour l’adap-tation de l’aménagement des ressources en eauau niveau communautaire en Afrique de l’Ouestpar Lawrence FLINT & Mamouda MOUSSANA ABOU;
4. Les mesures et les initiatives institutionnellesconcrètes potentielles visant à faciliter l’adapta-tion de l’aménagement des ressources en eau àdifférents niveaux en Afrique de l’Ouest parMadiodio NIASSE ;
5. Les actions concrètes potentielles en termes derenforcement des capacités, en vue d’intégrerl’adaptation de l’aménagement des ressourcesen eau à différents niveaux en Afrique del’Ouest par David PURKEY.
L’objectif de l’atelier était de rassembler un groupetrès ciblé d’experts capables d’aider à définir lesquestions liées à la prise en compte des change-ments climatiques dans l’aménagement des res-sources en eau transfrontalières en Afrique del’Ouest.
L’objectif global de la réunion est de renforcer lescapacités au sein des pays participants, pourqu’un corps croissant de spécialistes puisse for-muler, mettre en œuvre et évaluer les politiquesd’adaptation aux changements climatiques sur le terrain.
La collaboration Sud-Sud constitue un moyendéterminant de renforcer de telles capacités. Afinde faciliter cette collaboration Sud-Sud, les parte-naires élaboreront ensemble un document de syn-thèse qui constituera le produit final de cette phase.
Ce document de synthèse est certes un produitprécieux, mais le processus de production de cedocument s’avère au moins aussi important. Laréunion qui a eu lieu à Dakar, au Sénégal, en février2007, constitue la première étape de ce processus.
Cette réunion a rassemblé les partenaires des dif-férents pays, l’équipe d’aide technique du pro-gramme NCAP/ETC et ENDA à Dakar.
Les ateliers de rédaction accélèrent la productionde documents écrits. Lors du processus d’atelierde rédaction, les documents sont élaborés, révi-sés et finalisés rapidement, en tirant pleinementprofit des connaissances techniques des différentsparticipants à l’atelier.

11
Avant l’atelier de rédaction, des thèmes potentielssont choisis et des experts élaborent un premierprojet de document sur chaque thème, à l’aide deslignes directrices proposées. Ces participantsapportent à l’atelier d’écriture les projets qu’ils ontpréparés et divers autres documents de référence.
Lors de l’atelier à proprement parler, chaque expertprésente son projet. Des copies de chaque projetsont également distribuées à tous les autres parti-cipants, lesquels commentent le projet et suggè-rent des modifications.
Après la présentation, un rédacteur aide l’auteur àréviser et à mettre en forme son projet. Le texte misen forme devient alors une deuxième version duprojet. Pendant ce temps, d’autres participantsprésentent également les documents qu’ils ontpréparés. Chacun, tour à tour, collabore avec lesrédacteurs pour réviser et illustrer les documents.
Chaque expert présente ensuite à nouveau augroupe la deuxième version révisée de son projet.Les auditeurs le commentent une nouvelle fois etsuggèrent des modifications. Après la présenta-tion, les rédacteurs aident à la révision et à l’élabo-ration du projet final.
Le cas échéant, une troisième version du projetpeut être distribuée aux participants en vue derecueillir leurs ultimes commentaires et sugges-tions de modifications. La version finale est ache-vée, imprimée et distribuée peu après l’atelierd’écriture.
Le « WRITESHOP » constitue ainsi un processus extrêmement flexible. Les présentations répétées,l’échange d’opinions et la révision des projets permettent un examen et une révision en profondeur desdocuments, le développement de nouveaux thèmes au cours de l’atelier d’écriture et la combinaison, l’aban-don ou le fractionnement de certains thèmes.
La diversité des compétences, des organisations et des horizons des participants constitue un facteur clefpermettant de garantir l’expression de nombreuses idées dans les documents produits.
Au début de l’atelier de rédaction, les participants ont brassé des idées de nouveaux thèmes (autres queceux qui ont déjà été préparés) qu’il convient d’inclure dans le document final. Ces nouveaux thèmes sontattribués à des participants qui les connaissent et sont chargés de les développer et de les présenter aucours de l’atelier.
L’atelier permet aussi d’inclure les contributions de tous les participants, en mettant à profit l’expérience etles connaissances variées de toutes les personnes présentes. Il permet également aux idées d’être validéespar un éventail d’experts en la matière.
Le fait de concentrer les ressources dans le temps et dans l’espace a permis d’élaborer des documents net-tement plus rapidement qu’à l’habitude. En outre, le fait pour les participants de partager leur expériencepermet d’établir des rapports fructueux qui perdurent longtemps après la fin de l’atelier.

12
Résumé exécutif
Compte tenu de plusieurs facteurs dont entreautres la forte paupérisation des populations, lecaractère partagé des ressources en eau entre lespays, la forte variabilité des ressources en eau, lafaible mobilisation des ressources en eau, l’Afriquede l’Ouest est une région où les défis en matièred’aménagement des ressources en eau sont énor-mes. Les principaux défis de la gestion des res-sources en eau afin de répondre aux objectifs dedéveloppement socio-économique sont entreautres : i) de mieux utiliser l’eau pour soutenir ledéveloppement socio économique de la région ; ii)d’anticiper les crises et préserver l’avenir des res-sources en eau et des écosystèmes associés sur-tout avec le caractère partagé de la plupart desbassins fluviaux de la sous-région ; iii) d’instaurerune gouvernance de l’eau au service des besoinsdes populations et iv) d’assurer la durabilité finan-cière du secteur de l’eau.
Selon le quatrième rapport d’évaluation du GIEC,l’écoulement annuel des rivières et la disponibilitéen eau sont appelés à s’amoindrir de 10 à 30%dans certaines régions sèches des moyennes latitu-des et dans les tropiques secs. Selon le même rap-port, les communautés pauvres seront les plus vul-nérables du fait de leurs capacités d’adaptationlimitées et leur grande dépendance de ressources àforte sensitivité climatique telles que les ressourcesen eau et les systèmes de production agricoles. EnAfrique et à l’horizon 2020, entre 75 et 250 millionsde personnes seront exposées à une pénurie d’eaudu fait du changement climatique. Couplé à unedemande sans cesse croissante, cet état de fait vanégativement affecter les moyens d’existence etexacerber les problèmes liés à l’eau1.
La perspective de changements climatiques enAfrique de l’Ouest est susceptible d’aggraver cesdéfis en termes d’aménagement des ressources eneau et de freiner l’amélioration des moyens d’exis-tence. Il faut donc un document qui expose l’am-pleur potentielle des conséquences et descontraintes et identifie des stratégies concrètespouvant être mises en œuvre dans les bassins flu-viaux de l’Afrique de l’Ouest pour faire face auxchangements climatiques.
Ce document décrit donc les résultats obtenus duWRITESHOP organisé sur les impacts potentielsdes changements climatiques sur les ressources eneau des bassins et populations et des actions
concrètes à mettre en œuvre à l’échelle de bassin,au niveau local des communautés, sur le plan politi-que et institutionnel et renforcement des capacités.
Principaux résultants sur la variabilité et chan-gement climatique et ses impacts sur les res-sources en eau
Plusieurs travaux ont été réalisés sur la variabilitéclimatique et les ressources en eau en Afrique del’Ouest. Ces travaux étaient basés sur des obser-vations hydrologiques de longue durée de cessoixante dernières années et montrent un change-ment important des régimes climatiques et hydro-logiques autour des années 70 caractérisés pardes variations importantes, avec parfois des défi-cits continus sur plus de trente ans après cettepériode. Les principaux changements enregistrésaprès les années 70 sont les suivants :
• Une nette rupture des séries pluviométriques etdes débits moyens, observée autour desannées 1968-1972, avec l'année 1970 commeannée charnière ;
• Une baisse générale de la pluviométriemoyenne d'environ 15% à 30% selon la zone;
• Un début de saison désormais très variable etétalé ;
• Une diminution des ressources en eau de sur-face au niveau des principaux bassins (40 à 60%) avec pour conséquence une baisse drasti-que des volumes d’eau transitant par les grandscours d’eau, des étiages de plus en plus sévè-res avec de fréquents arrêts des écoulements,un déficit de remplissage de la plupart des rete-nues des barrages avec comme impacts socio-économiques, la diminution du niveau d'alimen-tation en eau des villes ;
• Une intrusion de la langue salée à l’intérieur deslagunes côtières (lagune de Cotonou, delta duSénégal, etc.) et menace sur la biodiversitéd’eau douce ;
• Une importante diminution des superficies desprincipales zones humides naturelles tant sur lecontinent que dans les zones côtières avecpour conséquence une réduction de la produc-tion halieutique ;
• Pour la plupart des nappes, une baisse duniveau réduit l'apport des nappes souterrainesau niveau des principaux cours d'eau avecintrusion des eaux salées dans les nappesphréatiques côtières.
1 Working Group II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Climate Change Impacts,Adaptation and Vulnerability

13
Il existe peu de travaux sur l’impact futur des chan-gements climatiques sur les ressources en eau enAfrique de l’Ouest aux horizons 2025 à 2050. Lesquelques travaux réalisés montrent de fortes incer-titudes sur les modèles actuels avec parfois desfortes divergences dans les projections. Des effortsde recherche sont encore à faire dans ce domaine.Toutefois, il est bien admis par la communautéscientifique internationale, que les extrêmes hydro-logiques (sécheresses et inondations) vont se ren-forcer dans le futur. Même si on ne connaît pasencore l’ampleur des futurs changements, il fau-drait s’attendre pour la sous-région à une augmen-tation de la variabilité des ressources en eau liéeaux changements climatiques d’où la nécessitéd’agir maintenant.
Actions concrètes pour une meilleure connais-sance et gestion de la variabilité et change-ments climatiques et leurs impacts sur les res-sources en eau
La multiplicité des futurs climatiques plausiblesmontre que ce qui est important c'est la gestion dela variabilité et des incertitudes. Cela impliquedonc l’amélioration de nos connaissances sur leclimat et ses impacts sur les ressources en eau.Les actions concrètes à mettre en place sont :
• Promouvoir la collecte des données météorolo-giques, hydrologiques et mise en place deréseaux d’information fiables et de plateformesde gestion efficace ;
• Promouvoir la recherche afin de lever certainesincertitudes à l’image du programme AMMA etprojet FRIEND-AOC entre autres ;
• Doter les établissements universitaires et insti-tuts de recherche de moyens techniques etfinanciers et en développant la recherche dansle domaine de la modélisation des processus etde leurs impacts ;
• Renforcer et intensifier les formations sur lesévaluations de la vulnérabilité et des mesuresd’adaptation dans le secteur des ressources en eau.
Actions concrètes d’adaptation aux change-ments pour la gestion des ressources enAfrique de l’Ouest à l’échelle de bassin
Le bassin du fleuve Sénégal avec l’OMVS a servid’étude de cas. De part son mandat, la création del’OMVS est considérée comme une réponse glo-bale pour une gestion durable des ressources eneau du bassin eu égard à la variabilité de ces res-sources. L’analyse critique de sa longue expé-rience de plus de 30 ans pourrait donc servir de
dégager des actions concrètes pour une gestiondurable des ressources à l’échelle de basin. Lesprincipales leçons apprises sont :
• Expression d’une forte volonté politique ;• Etablissement d’un cadre institutionnel et légis-
latif solide et flexible ;• Adoption des mesures et règles de fonctionne-
ment des institutions et de gestion des ressour-ces partagées basées sur l’équité, la solidaritéet la transparence ;
• Mise en place des outils de gestion, de prévisionet de suivi évaluation scientifiquement fiables etaccessibles à toutes les catégories d’acteurs ;
• Mise en place d’un mécanisme financier dura-ble pour soutenir les programmes et projets ;
• Réalisation d’ouvrages intégrateurs à buts mul-tiples ;
• Participation et adhésion des acteurs concer-nés par le biais d’une sensibilisation et d’unecommunication efficace ;
• Adaptation des règles de fonctionnement et degestion à l’environnement régional et international ;
• Amélioration (modernisation et innovation) desoutils de planification, de gestion et de suiviévaluation (programme de gestion des réser-voirs, programme de propagation des crues,SIG, tableau de bord, etc.) ;
• Etudes, recherches/développement pour l’amé-lioration des connaissances des écosystèmesdu bassin ;
• Renforcement des capacités (moyens humainset matériels à tous les niveaux d’intervention).
Pour un bassin transfrontalier donné en Afrique del’Ouest, on peut envisager les actions concrètesd’adaptation génériques suivantes :• Mise en place d’un cadre juridique et institution-
nel adéquat dans chaque bassin transfrontalier : • Statut juridique du fleuve, de ses affluents et
défluents ; • Organisme de bassin ;• Charte des eaux du bassin ;• Code de l’environnement.
• Mise en place d’infrastructures de maîtrise et demise en valeur des ressources en eau (structu-rantes et secondaires) ;
• Etablissement d’un réseau de mesuresmoderne sur les ressources en eau ;
• Etablissement d’un réseau de collecte sur don-nées environnementales et socioéconomiques ;
• Elaboration d’outils de planification, de prévi-sion qui prennent en compte les changementsclimatiques (base de données – SIG – observa-toires - tableau de bord besoins/ressources) ;
• Promotion de recherche/développement sur lesouvrages d’adaptation aux changements clima-tiques ;

14
• Renforcement des capacités des acteursconcernés au niveau national et sous régionalpour une plus grande de prise de conscience surles changements climatiques et leurs effets ;
• Programmes régionaux de lutte contre les végé-taux aquatiques envahissants ; l’ensablement,l’érosion des berges, les maladies hydriques ;
• Mesures pour favoriser l’implication des popu-lations (micro financements, électrificationrurale, pisciculture, aquaculture, AEP, etc.) ;
• Mécanisme de mobilisation des partenairesfinanciers ;
• Réalisation d’infrastructures génératrices derevenus.
Actions concrètes au niveau communautaired’adaptation aux changements pour la gestiondes ressources en Afrique de l’Ouest
En Afrique de l’ouest, les changements et variabili-tés climatiques sur les ressources en eau enregis-trés ces dernières décennies, se sont traduits pardes impacts directs ou indirects sur les principauxmodes et moyens d’existence liés aux ressourcesen eau. Les principaux impacts sont entre autres :
• Une baisse de la production halieutique et dis-parition de certaines espèces halieutiques ;
• Une baisse des rendements agricoles ;• L’indisponibilité et cherté des produits agrico-
les, l’inaccessibilité de certains marchés et pro-duits ;
• Baisse du pouvoir d’achat et accentuation de lapauvreté ;
• L’exode rural.
De tout temps, les communautés locales ontadopté des stratégies et mesures afin de s’adapteraux conséquences des modifications des ressour-ces en eau liées à celles du climat. Les différentescatégories de stratégies et mesure considéréessont :
Mesures et actions auto-adaptatives
Ce sont les options déjà prises par les populationslocales, dès l’instant où la variabilité climatique leurétait devenue une réalité vécue au quotidien. Ils’agit principalement :
• Réaménagement des calendriers agricoles etamélioration des pratiques traditionnelles ;
• Mesures visant l’efficacité et l’efficience dans lagestion de l’eau pour l’agriculture (diguettes fil-trantes, cultures du vétiver, dépressions artifi-cielles, cordons pierreux, meilleure aménage-ment des parcelles, etc.) ;
• Récupération des eaux de pluie par les toits desmaisons.
Mesures d’Adaptation spécifiques
Ces sont les mesures et actions d’adaptation pré-conisées et mise en œuvre par les Etats, les orga-nismes d’assistance et d’aide au développementet ou les ONG. Il s’agit principalement de :
• Aménagement et réhabilitation des retenuesd’eau, kiosques à eau ;
• Boisement / reboisement et protection et réha-bilitation des berges des plans d’eau, récupéra-tion des terres dégradées, fixation des dunes ;
• Création de points d’eau (forages, puits moder-nes, etc.) ;
• Semences adaptées à la sécheresse ;• Prévisions météorologiques et techniques
modernes de pluies provoquées ;• Aménagement et préservation des bas fonds ; • Développement de la gestion intégrée par bas-
sin versant ; • Recharge des nappes (seuil d’épandage) ;• Techniques des zai, démi –lune, cordons pier-
reux, etc.• Pompes à énergie renouvelable (solaires, bio-
carburant, éoliennes, etc.) ;• Développement de la pisciculture et aquacul-
ture ;• Sources alternatives de revenus liées au crédit
carbone (MDP).
Des mesures comme l’accès à l’eau potable et àl’énergie et celles relatives à la réduction de la pau-vreté au niveau communautaire sont des préala-bles et doivent accompagner ces différentes mesu-res d’adaptation. L’implication des communautés àtravers une bonne communication est détermi-nante. La sensibilisation des communautés pour laprotection du massif du FOUTAH DJALLON châ-teau de l’Afrique de l’Ouest est indispensable.
Actions concrètes aux niveaux politique et ins-titutionnel d’adaptation aux changements pourla gestion des ressources en Afrique de l’Ouest
Face à cette situation, le milieu naturel et humain aréagi en tentant de s’adapter au nouvel contexte.Les réponses - pour l’essentiel réactives et sponta-nées - apportées à la variabilité climatique ont étéde divers ordres dont certains institutionnels, etpolitiques. On peut spéculer sur la question desavoir si ces réponses d’adaptation ont permis ounon d’atténuer les impacts des chocs climatiquesau cours des années récentes. Quoi qu’il en soit,au vu des perspectives climatiques annoncées,

15
ces mesures d’adaptation risquent d’être insuffi-santes et méritent par conséquent d’être renfor-cées et diversifiées.
Les principales mesures institutionnelles prioritai-res préconisées pour augmenter la capacitéd’adaptation de l’Afrique de l’Ouest en matière degestion des ressources en eau sont entre autres:
• Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressourcesen Eau ;
• La protection des zones humides ; • La promotion de la Convention Cadre des
Nations Unies sur l’utilisation des eaux trans-frontalières à des fins autres que la navigation ;
• Le renforcement des mesures juridiques et régle-mentaires pour préserver la qualité de l’eau ;
• Mobiliser les moyens financiers et humains pourla mise en œuvre effective des Plans nationauxd’adaptation au changement climatiques ;
• Prise en compte du changement climatiquedans les études de faisabilité des projetshydrauliques et hydro-agricoles ;
• Prendre des mesures juridiques, réglementaireset organisationnelles appropriées pour atténuerles impacts des inondations dont l’ampleur et lafréquence devraient augmenter avec le change-ment climatique.
Pour chacune de ces mesures prioritaires, lesmesures spécifiques à mettre en place ainsi queles modalités de mise en œuvre sont indiquées.
Actions concrètes de renforcement des capaci-tés d’adaptation aux changements pour la ges-tion des ressources en Afrique de l’Ouest
Pour chaque mesure d’adaptation proposées queça soit pour l’amélioration de nos connaissance surle climat et ses impacts sur les ressources, àl’échelle du bassin, à la l’échelle communautaire etsur le plan politique et institutionnel, il faut identifierles cibles à renforcer. De même la nature du renfor-cement de capacité dont chaque cible a besoin est
à identifiant. Les principales cibles ci-après ayantdes actions directes ou indirectes associées à l’eauet au climat sont identifiées et nécessitant de ren-forcement de capacité :
• Services de l’Etat ;• Entreprises privées (par exemple, société,
chambres de commerce, associations professionnelles ;
• Les décideurs politiques (par exemple, conseillers, maires, parlementaires, sénateurs,membres du gouvernement) ;
• Les medias ;• Les ONG et les associations de base ;• Les communautés ;• Les universités, les centres de recherche, et les
collèges techniques ;• Les organismes intergouvernementaux de
l’Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre de renforcement de capacité pourl’adaptation de la gestion des ressources en eauaux changements climatiques en Afrique del’Ouest, plusieurs actions peuvent être envisagéeset ce, en fonction des différentes cibles.Globalement on peut regrouper ces actions de ren-forcement de capacité par catégorie comme suit :
• La sensibilisation, l’information et la communi-cation ;
• La formation et le développement des connais-sances de base ;
• Les équipements et outils techniques ;• Le cadre juridique et administratif ;• La mobilisation des financements ;• La coopération et les échanges d’information.
Ainsi pour une mesure d’adaptation donnée etpour une cible donnée, l’une ou l’autre des actionsde renforcement de capacité sera envisagée. Unemaquette type est préparée afin de faciliter pourtoute mesure d’adaptation donnée, les actions derenforcement de capacité à entreprendre pour toutes les cibles.

16

17
ABN : Autorité du Bassin du NigerABV : Autorité du Bassin de la VoltaACDI : Agence Canadienne pour le DéveloppementInternationalACMAD : African Centre of MeteorologicalApplication for DevelopmentAEP : Adduction d’Eau PotableAEPA : Approvisionnement en Eau Potable etAssainissementAFD : Agence Française de DéveloppementAGRHYMET : Centre Régional en Agro HydroMétéorologieAIEA : Agence de l’Energie AtomiqueAMMA : African Monsoon Multidisciplinary AnalysesASDI : Agence Suédoise de CoopérationInternationale au DéveloppementBAD: Banque Africaine de DéveloppementCBLT : Commission du Bassin du Lac TchadCC : Changement ClimatiqueCCNUCC : Convention Cadre de Nations Unies surles Changements ClimatiquesCEB : Communauté Electrique du BeninCEDEAO : Communauté Economique des Etats del’Afrique de l’OuestCILSS : Comité permanent Inter-Etat de LutteContre la Sécheresse au SahelCLC : Comités locaux de CoordinationCNC : Cellules Nationales de CoordinationCOP : Conférence des PartiesCPE : Commission Permanente des EauxCRP : Comité Régional de PlanificationCSS : Compagnie Sucrière SénégalaiseDGIS : Netherlands Ministry of DevelopmentCooperationDSRP : Document de Stratégie de Réduction de laPauvretéENDA : Environnement et développement du TiersMondeFEM : Fonds pour l’Environnement MondialFRIEND-AOC : Flow Regimes from InternationalExperimental and Network Data – Afrique de l’Ouestet du CentreGDM : Grands Domaines de MauritanieGDS : Grands Domaines du SénégalGEF : Global Environment FacilityGEMS : Global Environment Monitoring SystemGES : Gaz à Effet de SerreGIEC : Groupe Intergouvernemental d’Experts sur leClimatGIRE : Gestion Intégrée des Ressources en EauGTZ : Deutsche Gesellschaft für TechnischeZusammenarbeitGWP/WAWP : Global Water Partnership / WestAfrican Water PartnershipHa : HectareHT : Haute Tension
IIED : Institut International pour l’Environnement et leDéveloppementINSAH : Institut du SahelIPCC : Intergovernmental Panel on Climate ChangeMAB : Man and BiosphereMCGA : Modèles de Circulation Générale del’AtmosphèreMDP : Mécanisme de Développement PropreMRU : Mano River UnionNTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et dela CommunicationNU : Nations UniesOMM : Organisation Mondiale de la MétéorologieOMVG : Office de Mise en Valeur du Bassin duFleuve GambieOMVS : Organisation pour la Mise en Valeur dufleuve SénégalONG : Organisation Non GouvernementaleOSS : Observatoire du Sahara et du SahelOUA : Organisation de l’Unité AfricainePAGIRE : Plan d’Action de Gestion Intégrée desRessources en EauPANA : Programme/Plan d’Action Nationald’AdaptationPCCP : Potential Conflict to Cooperation PotentialPGIRE : Plan de Gestion Intégrée des Ressourcesen EauPGIRN : Plan de Gestion Intégrée des RessourcesNaturellesPHI : Programmes hydrologique internationalPMA : Pays Moins AvancésPNUD : Programme des Nations Unies pour leDéveloppementPRAI/MFD : Programme Régional d’Aménagementintégré du Massif du FOUTAH DJALLONRCA : Centre Régional AGRHYMETSIG : Systèmes d’Information GéographiqueSOGED : Société de Gestion et d'Exploitation deDIAMASOGEM : Société de Gestion et d'Exploitation deMANANTALITRE : Troisième Rapport d’EvaluationUA : Union AfricaineUCRE : Unité de Coordination des Ressources enEauUE : Union EuropéenneUICN : Union Internationale pour la Conservation dela NatureUNESCO : Organisation des Nations Unies pourl’Education, la science et la CultureUSD : United States DollarVBA : Volta Basin. AuthorityVRA : Volta River AuthorityWA_net : West Africa Capacity Building NetworkWWDR : World Water Development Report 2WWF : World Wildlife FundZCIT : Zone de Convergence Inter Tropicale
Liste des abréviations

18

19
Les observations de ces dernières décennies mon-trent une variation importante du cycle hydrologi-que dans la sous région même si nous ne sommespas capables de l’attribuer entièrement aux chan-gements climatiques. On a assisté depuis lesannées 1970 à une baisse des cumuls pluviométri-ques allant de 15 à 30% comparé à la moyenned’avant ces années. Ce changement sur lescumuls pluviométriques combiné aux modifica-tions de l’occupation des sols a conduit à unebaisse allant de 40% à plus 50% des modules desprincipaux grands bassins hydrographiques de lasous-région sur les mêmes périodes. D’autresmodifications telles que la diminution et voire l’as-sèchement de certaines zones humaines, la baissedes niveaux des nappes phréatiques, la diminutionde la production halieutique voire la disparition decertaines espèces de poissons, etc.
Malheureusement avec le changement climatiqueoccasionnant l’augmentation de la températureglobale du globe de l’ordre de 1o à 6o d’ici 2100, ilest reconnu que le cycle hydrologique va renforceravec une plus grande variabilité du climat. Ce ren-forcement du cycle hydrologique va occasionnerdavantage de sécheresses et d’inondations suivantles régions considérées même si celles-ci sont maldéfinies. Malgré le fait que les impacts des change-ments climatiques sur les ressources en eau et leszones humides ne sont pas très bien connus aveccertitudes en Afrique de l’ouest, il est cependantnécessaire de mettre en œuvre des mesures deprévention et d’adaptation. Le premier papier decette série intitulé : Impacts du changement et dela variabilité climatiques sur les ressources en eaudes bassins versants Ouest Africains : Quellesperspectives ? Présente l’état des lieux de nosconnaissances en la matière et dégage des axesprioritaires d’action.
Face au renforcement des conséquences négati-ves actuelles de la variabilité climatique avec lechangement climatique, il est urgent de renforcer lacapacité d’adaptation de la sous-région eu égardsà la gestion des ressources en eau des bassinshydrographiques. En effet un grand nombre desimpacts du changement climatique peut être réduitpar l’adoption de mesures, de stratégies et politi-ques d’adaptation. Les principales raisons généra-lement avancées sur le besoin de mise en œuvrede mesures d’adaptation vis à vis de changementclimatique sont :
• Il n’est pas possible d’éviter complètement lechangement climatique. Une partie de ce quiest survenu est irréversible ;
• L’adaptation par anticipation est plus efficace etmoins coûteuse qu’une adaptation d’urgence,mise en œuvre à la dernière minute ;
• Le changement climatique pourrait être plusrapide et plus accentué que les estimationsactuelles ne le laissent supposer. Les surprisesdésagréables ne sont pas exclues ;
• On peut tirer des avantages immédiats d’unemeilleure adaptation à la variabilité climatique etaux événements atmosphériques extrêmes ;
• On peut tirer des avantages immédiats de l’éli-mination de politiques et de pratiques qui nesont pas compatibles avec l’adaptation.
Introduction générale

20
Les quatre autres papiers de la série se traitent desmesures concrètes d’adaptation à l’échelle d’unbassin hydrographique, à l’échelle des communau-tés locales, en matière de politiques et institutionset sur le plan renforcement des capacités.
Les mesures concrètes d’adaptation à l’échelled’un bassin hydrographique pour la gestion desressources en eau face à la variabilité et change-ment climatique sont présentées et analysées àtravers l’étude de cas de l’OMVS (Organisationpour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal). Face auxmodifications drastiques des débits du fleuveSénégal suite des déficits pluviométriques desannées 70 et 80 et pour une plus grande valorisa-tion des ressources en eau du bassin, les Etats duMali, de la Mauritanie et du Sénégal ont crééel’OMVS le 11 mars 1972. Sa principale missiond’élaborer et de coordonner la mise en œuvre destratégies pertinentes aptes à faciliter une gestiondes ressources en eau au bénéfice d’un dévelop-pement solidaire et durable. Pour atteindre sesobjectifs, l’OMVS a mis en œuvre des actionsconcrètes pour mise en valeur et gestion des res-sources du bassin concernent différents aspects àsavoir. Ces actions sont d’ordre juridique et institu-
tionnel, ont trait à la réalisation physique desouvrages (Barrages de DIAMA et MANANTALI),touchent à la protection et restauration de l’éco-système, au renforcement des capacités et à l’in-formation et sensibilisation.
Tous ces aspects sont décrits dans le deuxièmepapier. De même sont présentées les leçons appri-ses et les actions concrètes tirées de cette expé-rience à mettre en place pour une gestion des ressources à l’échelle d’un bassin transfronta-lier face au changement climatique. S’il y a uneaction concrète indispensable c’est la créationd’une organisation de bassin dotée des textes juri-diques et institutionnels accompagné d’unevolonté politique au plus haut niveau des Etatsmembres et des moyens de ses ambitions. En rap-pel, l’Afrique de l’Ouest compte 30 bassins hydro-graphiques transfrontaliers partagés par au moinsdeux Etats, alors qu’il n’existe actuellement quecinq organisations de bassins (OMVS, OMVG,ABN, CBLT et VBA).
La forte vulnérabilité des pays Africains et plus par-ticulièrement ceux de l’Afrique de l’Ouest estreconnue dans la plupart des publications liées au
Pressions exercées sur les puits - Gabi, Maradi, janvier 2007

21
changement climatique dont les rapports du GIEC.Outre le facteur climatique, l’une des principalesraisons est que plus de 70% de la population de lasous-région est rurale et pratique généralementune culture sous pluie donc liée aux aléas climati-ques. Sur le plan de l’accessibilité à l’eau potable,le taux d’accès est généralement inférieur à 50%dans la plupart des pays de la sous-région. Quantà l’assainissement le taux dépasse très rarementles 10% dans le monde rural. De même au niveaude cette même population la paupérisation est trèsélevée voire totale. Ainsi les communautés localescomposées presque exclusivement des popula-tions rurales sont les plus vulnérables face à lavariabilité et au changement climatique. Pour sur-vivre aux impacts des changements déjà enregis-trés ces populations ont dû mettre au point desstratégies locales d’adaptation. Le troisième papiertraite entre autre de ces actions concrètes d’adap-tation au niveau des communautés locales faceaux impacts du changement climatique vis-à-visde la gestion des ressources en eau. Un inventairedes différentes stratégies à mettre en place auniveau communautaire est présenté. Les actionsconcrètes sont analysées en fonction des modesd’existence des communautés (pêcheurs, petitsexploitants agricoles, éleveurs, commerçants,transporteurs,..).
Afin de face aux conséquences des différentessécheresses des années 70 et 80, les Etats de lasous-région ont mis en place au niveau national etsous-régional des politiques et institutions. Parexemple, la création du CILSS avec ses institutionsspécialisées que sont INSAH et l’AGRHYMETconstitue dans la sous-région une initiative politi-que régionale unique afin de faire face aux impactsde la variabilité climatique sur les activités socio-économiques des populations sahéliennes et plusparticulièrement sur la production agricole et lagestion des ressources naturelles. De même desorganisations de bassins ont vu le jour en Afriquede l’Ouest pour une meilleure gestion des ressour-ces en eau. Il s’agit de l’ABN (Autorité du Bassin duNiger) créé en 1964 ; l’OMVS (l’Organisation pourla Mise en Valeur du fleuve Sénégal) créé en 1972 ;l’OMVG (Organisation pour la mise en Valeur dufleuve Gambie) créé en 1975 ; la CBLT (laCommission du Bassin du Lac Tchad). Il vient des’ajouter en 2006 la création officielle de ABV(l’Autorité du Bassin de la Volta). Dans le cadre dela gestion de l’eau, la sous-région s’est dotée en2003 d’une unité de coordination des ressourcesen eau avec pour principal mandat la promotiond’une gestion intégrée des ressources en eau.
Après avoir analysé les principales actions politi-ques et institutionnelles mises en place dans lasous-région, le papier quatre présente les actionsconcrètes prioritaires d’ordre politique et institu-tionnelle à mettre en place pour une meilleure ges-tion des ressources dans un contexte de variabilitéet changement climatique. Parmi ces actions on aentre autres la promotion de la GIRE, la protectiondes zones humides, la promotion de la ConventionCadre des Nations Unies sur l’utilisation des eauxtransfrontalières à des fins autres que la navigation,le renforcement des cadres législatifs et réglemen-taires concernant la qualité de l’eau, le foncier, lalutte contre les inondations et les mécanismes definancement.
La mise en œuvre efficiente de toutes les actionsconcrètes d’adaptation proposées dans les quatrepremiers documents, nécessite le renforcementdes capacités à tous les niveaux des acteurs. Ledocument cinq est consacré à cette problématiquede renforcement des capacités des acteurs. Enmatière de renforcement de capacité les deuxquestions essentielles sont pour une actiond’adaptation prioritaire donnée : la capacité de quidoit on renforcer ? Sur quels aspects spécifiques ?La réponse à la première question a permis d’iden-tifier de façon générique les groupes d’acteurs àrenforcer (services de l’Etat, entreprises privées,décideurs politiques, les Medias, les ONG et asso-ciations de base, les communautés, les universitéset centres de recherche, organismes intergouver-nementaux). Les aspects spécifiques pour lesquelsle renforcement est nécessaire portent d’unemanière générale sur : (i) la sensibilisation, l’infor-mation et la communication ; (ii) la formation et ledéveloppement des connaissances de base ; (iii)les équipements et outils techniques ; (iv) le cadrejuridique et administratif ; (v) la mobilisation desfinancements et (vi) la coopération et les échangesd’information. L’identification des groupes d’acteurs à renforcer et des types de renforcement apermis pour chaque action d’adaptation prioritairede remplir un tableau où pour chaque groupe d’acteur la nature du renforcement est clairementidentifiée.
Il est indispensable d’accompagner chacune desactions concrètes d’adaptation identifiées dans lesquatre premiers documents d’action de renforce-ment de capacité des différents acteurs. Le tableauconceptuel retenu dans le document cinq permet-tra de dégager pour chacun des groupes d’acteursle type de renforcement dont il aura besoin.


23
RésuméLes changements climatiques et leurs impactsconstituent les sources de menace potentielles surl’avenir des sociétés humaines. La baisse de la plu-viométrie et ses conséquences sur la disponibilitédes ressources en eaux de surface et souterraines,observée depuis plusieurs décennies en Afrique del’Ouest, pénalise fortement tous les secteurs repo-sant sur la disponibilité de ces ressources. En effeton a enregistré une baisse des pluies allant de 15%à plus de 30% en fonction des zones en Afrique del’Ouest entre la période d’avant 1970 et celleaprès. Au niveau des cours d’eau la baisse desdébits a été plus marquée avec des baisses allantde 30% à plus 50% en fonction des bassins. Cephénomène constitue la manifestation régionale duréchauffement global actuel qui intensifie le cyclede l’eau au niveau mondial. Ce travail a pour objet,l’identification et l’étude des impacts de ce chan-gement climatique et de sa variabilité sur les res-sources en eau de l’Afrique de l’Ouest. Il apparaît,sur la base des travaux existants, que les implica-tions des fluctuations des régimes pluviométriqueset de la variabilité climatique se traduisent à diffé-rents niveaux sur les bilans d’eau des bassins ver-sants ouest africains : la durée des saisons depluies, les quantités d’eau précipitées, le nombred’événements pluvieux, les débits des cours d’eau,la recharge des nappes et les zones humides.
Une évaluation du climat futur de la sous-régionsur la base des travaux de l’IPCC/GIEC, montre unmanque de consensus entre les différents modèlesclimatiques et scénarii quant au sens de variationdes précipitations même si plus de la moitié de cesmodèles prévoit une diminution de l’ordre de 10 à20%. Pour ce qui est l’évolution future des débitsdes cours d’eau de la sous-région, l’incertitude estdavantage plus grande. Pour une baisse envisagéedes pluies de 10 à 20%, on pourrait s’attendre àune baisse de 20 à 40% des débits des coursd’eau. Au niveau des zones côtières on s’attend àune élévation du niveau marin de 0,5 à 1m d’ici lafin du 21ème siècle.
Si, compte tenu des transferts interzonaux opéréspar les grands fleuves, la carence totale n’est pasà craindre dans la région à causes des zones gui-néennes relativement encore bien arrosées, leseffets de cette variabilité climatiques peuvent, mal-gré tout, se révéler désastreux en ce sens qu’ilsmodifient les données d’un équilibre déjà mis à malpar la pression anthropique.
Mots clés : Afrique de l’ouest, pluviométrie, varia-bilité climatique, changement climatique, variabilitéet changement climatiques, désertification, vulné-rabilité
1.1 IntroductionLe réchauffement global actuel est un phénomèneplanétaire qui intensifie le cycle de l’eau. Il a pourconséquences, entre autres, une exacerbation desproblèmes de disponibilité et de gestion des res-sources en eau. L’évolution globale du climat quisemble se dessiner est que dans les zones humi-des des régions froides, les précipitations vonts’accroître sensiblement tandis que dans lesrégions arides et semi-arides, les précipitationsauront tendance à diminuer. En outre, les régionsarides et semi-arides auront tendance à s’élargir ensurface. Dans le cas particulier de l’Afrique del’Ouest, ces tendances sont beaucoup plus mar-quées à cause de la présence du plus grand désertdu monde : le Sahara. En effet, depuis près de qua-rante ans, les pays de l’Afrique de l’Ouest, aussibien de la zone sahélienne que soudanienne, sontsoumis à une variabilité climatique dont les consé-quences immédiates se traduisent par l’apparitiondes déficits pluviométriques importants et prolon-gés. Les travaux de Nicholson et al et ceux deHubert et Carbonnel entre autres en particulier ontpermis de situer l’apparition de ce phénomène à lafin des années 60 et au début des années 70.L’intensité de cette variabilité climatique dans leszones soudaniennes (au sud du 14ème parallèle),ainsi que leurs conséquences sur les ressources eneau ont été étudiées par Servat et al, Paturel et al,Le Barbé et Lebel dans les années 90. L’analyse
Chapitre I : Impacts du changement et de la variabilitéclimatiques sur les ressources en eau des bassins
versants Ouest Africains : Quelles perspectives ?
Par : Abel AFOUDA (Université d’Abomey, Bénin) (Writer), Mohamedou OULD BABA SY (OSS, Tunisie),Amadou Thierno GAYE (UCAD, Sénégal), Alexandre CABRAL (PANA, Guinée Bissau), Yahaya NAZOUMOU(UAM, Niger), Jean Abdias COMPAORE (ABN, Niger), Rabé SANOUSSI (MH/E/LCD, Niger)

24
des séries chronologiques pluviométriques montreune nette tendance au glissement des isohyètesvers le sud. Cette évolution traduit une diminutiongénéralisée de la pluviométrie sur l’ensemble del’Afrique de l’Ouest. Les déficits pluviométriquescorrespondants sont de l’ordre de 20% et attei-gnent parfois de valeurs supérieures à 25%. Tousles facteurs reposant sur la disponibilité des res-sources en eau sont aujourd’hui fortement pénali-sés par la diminution des précipitations et sesconséquences sur les ressources en eau (agricul-ture, alimentation en eau des retenues, alimenta-tion en eau potable des populations, productionhydroélectrique, etc.). En outre, les effets de cettevariabilité se révèlent très néfastes sur l’environne-ment en ce sens qu’ils modifient négativement, lesdonnées d’un équilibre déjà mis à mal par ailleurspar la pression anthropique.
L’objectif de ce papier de synthèse est de faire lepoint (i) de la variabilité du climat ouest africain auXXème siècle ; (ii) de l’évolution du climat de cetterégion au cours du XXIème siècle et ses implica-tions sur les ressources en eau à l’échelle des bas-sins versants régionaux, (iii) des opportunités degestion des ressources en eau et les contraintesque cela implique pour la région.
1.2 Milieu Physique L’Afrique de l’Ouest s’étend sur un vaste ensemblegéographique et politique de 7.500.000 km2regroupant une population estimée à environ 260millions d’habitants (soit près de 30% de la popu-lation du continent africain). Les différentes projec-tions indiquent qu’elle passera à près de 300 mil-lions en 2015 (Beekman et al). Le doublementannoncé de la population d’ici 2020 va induire uneaugmentation proportionnelle des besoins enmatière d’alimentation, d’espace d’habitation, etde services sociaux de base. Cette population estinégalement répartie, avec une densité variant de109,3 hab./km2 au Nigeria à 2,2 hab./km2 enMauritanie.Les pays de l’Afrique de l’Ouest sont généralementregroupés en deux (2) grandes entités comprenant :
• Les pays sahéliens regroupés au sein du CILSS(Comité permanent Inter-Etat de Lutte Contre laSécheresse au Sahel) que sont : le BurkinaFaso, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau,le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et leTchad.
• Les pays du Golfe de Guinée qui sont au nombrede huit (8), formant un ensemble regroupant : leBénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, leLibéria, le Nigeria, la Sierra Leone et le Togo.
1.2.1 Caractéristiques du climat
L’Afrique de l’Ouest couvre du point de vue géo-graphique, des zones à climat différent. L’influencede la latitude est prépondérante de sorte que lesprécipitations et la température peuvent être consi-dérées comme les principaux paramètres géogra-phiques qui déterminent fondamentalement cesclimats. Il résulte que dans la réalité, la plupart despays de la sous- région sont à cheval sur plusieurszones éco-géographiques.
En tenant compte de la distribution des pluies etdes conditions d’écoulement, on peut distinguer,cinq (5) zones éco-géographiques, à savoir :
• Une zone saharienne qui enregistre générale-ment moins de 150 mm de pluie par an ;
• Une zone sahélienne encore appelée zone aridequi enregistre en moyenne entre 150 et 400 mmde pluie par an;
• Une zone soudano-sahélienne encore caracté-risée de semi-aride, où la pluviométrie moyenneannuelle se situe entre 400 et 600 mm ;
• Une zone soudanienne sub-humide qui enregis-tre une pluviométrie moyenne annuelle entre600 et 900 mm ;
• Une zone soudano-guinéenne et guinéennehumide où la pluviométrie moyenne annuellevarie entre 900 et 1500 mm voire plus.
La distribution des pluies est en général liée aumouvement Nord-Sud-Nord de la Zone deConvergence intertropicale (ZCIT) qui est la zonede rencontre des masses d’air humide austral (lamousson africaine) et des masses d’air sec septen-trional (l’harmattan). Des études récentes (Taupin etal) ont montré que la remontée vers le nord de laZCIT n’est pas continue et que les pluies au sahelsont principalement d’origine convective. Cespluies convectives sont marquées par de fortesintensités et par une variabilité spatiale très impor-tante. Du Sud vers le Nord, la saison des pluiesdevient de plus en plus courte, et est suivie d’unelongue période sèche où l’évaporation et l’évapo-transpiration atteignent de valeurs maximales. Onnote une irrégularité interannuelle et une grandehétérogénéité spatiale des précipitations.
Plus au Sud, on distingue un climat tropical humideet un climat tropical sec. Le premier est caractérisépar deux (2) saisons de pluies et deux saisonssèches (globalement une grande saison sèche,entre novembre et avril et une petite saison sècheen août et septembre). Ce type de climat seretrouve le long du Golfe de Guinée, allant de laRépublique de Guinée jusqu’au Nigeria. Le climat

25
tropical sec se caractérise par une seule saisonsèche qui s’allonge au fur et à mesure que l’on pro-gresse vers le Nord.
Cette classification climatique laisse apparaître lecontraste très marqué entre régions humides etrégions arides. Mais ce contraste est fortementatténué par la configuration du réseau hydrogra-phique. Les principaux cours d’eau de la région(Niger, Sénégal, Gambie) prennent leurs sourcesdans les régions soudano-guinéennes bien arro-sées avant de traverser les zones sahéliennes oùles déficits pluviométriques sont chroniques. Cescours d’eau permettent ainsi une sorte de transfertinterzonal d’eau douce des régions humides versles régions arides.
1.2.2 Ressources en eau
Eaux de surface
Les écoulements de surface sont conditionnés parles pluies dont l’irrégularité est souvent accentuéepar les conditions locales de ruissellement et d’in-filtration suivant les états de surface des sols. Endehors des cours d’eau qui drainent des zoneshumides, le tarissement complet des écoulementsen saison sèche est la règle générale même sur degrands bassins.La région dans son ensemble, est parcourue parde nombreux cours d’eaux dont les principauxsont :
• Le fleuve Niger qui prend sa source en Guinéedans le massif du FOUTAH DJALLON, traversele Mali, le Niger et le Nigeria avant de se jeterdans l’Atlantique ; c’est le plus grand fleuve par-tagé de l’Afrique de l’Ouest avec une longueurde 4.200 km; son bassin versant évalué à plusde 2.200.000 km2 se répartit entre les territoiresde huit (8) Etats de l’Afrique de l’Ouest et duCentre : Guinée (4,6%), Mali (30,3%), Niger(23,8%), Nigeria (28,3%), Bénin (2,5%), BurkinaFaso (3,9%), Côte d’Ivoire (1,2%) et Cameroun(4,4%) ;
• Le fleuve Volta qui prend sa source au BurkinaFaso et draine ensuite le Togo, le Bénin, leGhana, la Cote d’Ivoire et le Mali avant de sejeter dans l’Océan Atlantique ; long de 1.600 kmjusqu’à son embouchure dans le golfe deGuinée, son bassin versant couvre 394 100 km2répartis entre le Burkina (42%), le Ghana (40%),le Togo (6%), le Mali (5%), le Bénin (4%) et laCote d’Ivoire (3%) ;
• Le fleuve Sénégal qui prend également sasource en Guinée, dans le massif de FOUTAHDJALLON, traverse le Mali, la Mauritanie et leSénégal avant de se jeter dans l’Atlantique ;long de 1.800 km, son bassin versant couvre337.000 km2 répartie entre la Guinée (11%), leMali (53 %), la Mauritanie (26%) et le Sénégal(10%) ;
• Le fleuve Gambie qui prend sa source enGuinée, traverse le Sénégal et la Gambie avantde se jeter dans l’Atlantique après un parcourstotal de 1.120 km; son bassin versant est de78.000 km2 réparti entre le Sénégal (70,22%), laGuinée (16,46%), la Gambie (13,30%) et laGuinée Bissau (0,02%) ;
• Les fleuves moyens : Comoé (Burkina Faso,Côte d’Ivoire et Ghana), Mono (Bénin et Togo),Ouémé (Bénin et Nigeria), Mona (Sierra Léone etLibéria), Kabi et Kolenté (Guinée, Sierra Léone),Koliba (Guinée, Guinée-Bisau), le Komadugu-Yobé (Niger, Nigéria, Tchad), le Logone (Tchad,Cameroun), le Chari (Tchad, Cameroun, CentreAfrique) et la Cayanga/Geba (Guinée, Sénégal,Guinée Bissau) se retrouvent majoritairementdans les pays côtiers.
La plupart de ces fleuves et bassins hydrographi-ques jouent un rôle important dans le développe-ment socio-économique des pays riverains (eaupotable, énergie, irrigation, pêche, navigation, éle-vage, etc.). La figure 1 ci-dessous présente lesprincipaux cours d’eau et leurs bassins.

26
De par leur caractère transfrontalier, les principauxcours d’eau sont gérés conjointement par les Etatsriverains, réunis au sein d’organisations de bassins(tableau 1). Des efforts sont en cours pour renfor-cer la synergie nécessaire autour de ces bassins àtravers la création de nouvelles organisationsautour des autres bassins pour une gestion quan-titative et qualitative durable.
La plupart de ces cours d’eau ont un potentielsocio-économique important notamment dans les
plaines d’inondations sahéliennes et dans les sitespotentiels de production hydroélectrique. En effetgrâce aux transferts interzonaux d’eau douce, lescrues débordent annuellement pour inonder dansle sahel de vastes superficies dont l’étendue peutatteindre 4,6 millions d’hectares dans les annéesde bonne hydraulicité. Les plus importantes sontcelles du delta intérieur du Niger (3.000.000 ha), lamoyenne vallée du Sénégal (500.000 ha), la plainede Hadejia-Nguru au Nord du Nigeria (400.000 ha),la plaine du Chari-Logone entre le Cameroun et leTchad (800.000ha).
Figure 1 : Les principaux cours d’eau et les bassins versants hydrographiques de la région, Source : AGRHYMET
Source : Beekman et al (2005)
Tableau 1 : Ecoulement moyen annuel des principaux cours d’eau
Cours d’eau Bassin de drainage (km2)Ecoulement moyen annuel
(millions de m3)Organisation
Niger 1 215 000 221 500 ABN
Volta 394 100 39 735 VRA
Sénégal 338 000 21 800 OMVS
Gambie 77 850 5 050 OMGV
Mono 22 000 3 675 CEB

27
Une autre caractéristique marquante de la régionest la longueur de sa façade maritime. En prenanten compte le Cap-Vert, celle-ci s'étire sur une lon-gueur de 15.000 km. Sur les 17 pays de la région,seuls quatre (Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad)n'ont pas de façade maritime. La population de larégion concentrée dans la zone côtière (c'est-à-dire à moins de 60km de la côte) était estimée à42,68 millions en 1994, soit le quart de la popula-tion des pays ayant une façade maritime Niasse et.al.. De grands centres urbains comme Lagos,Accra, Dakar, Abidjan, Cotonou, Conakry, Lomé,Nouakchott, Bissau, Port Harcourt, etc. se trouventle long de la côte. Cette zone continue de connaî-tre une rapide croissance démographique facilitéepar l'appauvrissement des campagnes, mais aussipar la concentration des infrastructures économi-ques et des investissements dans les grands cen-tres urbains du littoral.
Eaux souterraines
La disponibilité des eaux souterraines est large-ment conditionnée par le climat et la géologie. Cesressources en eaux souterraines se répartissentdans les grands ensembles sédimentaires ainsique les zones du socle cristallin. La disponibilité deces ressources dépend des capacités d’emmaga-sinement et du degré de recharge des aquifèresque permettent les conditions géologiques. Lamultitude des systèmes aquifères présents dans larégion interdit des généralisations valables quant àla disponibilité des eaux souterraines à l’échelle dela région.La région dispose de plusieurs bassins hydrogéo-logiques locaux et des grands systèmes aquifèrestransfrontaliers dont les plus importants sont lessuivants:
• Bassin du Tchad (Niger, Nigeria, Tchad,Cameroun) ;
• Bassin des Iullemeden (Niger, Nigéria, Mali,Algérie et Bénin) ;
• Bassin de Taoudéni (Mauritanie, Algérie, Mali,Burkina Faso) ;
• Bassin de Mourzouk-Djado (Niger, Algérie,Libye et Tchad) ;
• Bassin Sénégalo-mauritanien (Sénégal,Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau).
Les bassins hydrogéologiques sont constitués pardes nappes phréatiques directement alimentéespar l’infiltration et des nappes profondes dont larecharge est si faible comparée aux réserves (casdes grands bassins aquifères) qu’elles peuvent êtreconsidérées comme des nappes fossiles. Les pro-fondeurs des aquifères sont variables suivant les
formations géologiques. Au niveau local, on noteégalement l’existence de plusieurs aquifères allu-viaux liés aux réseaux hydrographiques auxquelsils sont étroitement associés. Les eaux souterrai-nes constituent la principale source d’approvision-nement pour l’alimentation en eau potable despopulations. Les nappes peu profondes sontaccessibles par les puits et les nappes profondessont accessibles par les forages.
L’interaction des cours d’eau avec les eaux souter-raines se fait essentiellement à sens unique. Lescours d’eau rechargent les nappes phréatiques àtravers les alluvions et en submergeant les plainesd’inondation en période de crue, alors que le drai-nage de ces nappes par les cours d’eau en périoded’étiage est négligeable.
1.2.3 Dépendance des Etats enmatière de ressources en eau
Les ressources en eau des Etats sont variables sui-vant leur situation géographique. Le massif duFOUTAH DJALLON est la source des FleuvesGambie, Sénégal (Baffing, Bakoye et Falémé),Corubal, Kaba et d’autres rivières se jetant dansl’Océan Atlantique en territoire Guinéen et Bissau-Guinéen.
La dorsale guinéenne est la source d’un réseauhydrographique aussi important : le Fleuve Niger etses affluents d’une part et les fleuves Moa(Makona), Mano-River, Loffa, Via et Diani d’autrepart.Les transferts inter-zonaux sont une manifestationde la forte interdépendance des pays en ce quiconcerne l’utilisation et la gestion des ressourcesen eau. En effet, la majorité des pays ont un facteurde dépendance supérieur à 40% (tableau 2).
1.2.4 Les différents usages de l’eau
Le principal secteur utilisateur de l'eau est l'agricul-ture, surtout irriguée (76% des prélèvements d'eaudouce) contre 17% pour la consommation domes-tique et 7% pour l'industrie. En ce qui concerne laconsommation domestique, en 1995, seul 40%des populations rurales et 64% des populationsurbaines de la région avaient accès à l'eau potable.Pour ce qui concerne les usages non consomma-teurs de l'eau, on peut mentionner la productionhydro-électrique et la navigation. Mais l’agricultureessentiellement pluviale domine encore largementles économies de la plupart des pays (tableau 2).Elle fournit 29 % du PIB régional et occupe prèsdes deux tiers de la population active.

28
Le dédoublement de la population annoncé entraî-nera une intensification de la pression sur les res-sources en eau.
1.3 Variabilité du climat au 20ème siècle
1.3.1 Changements et Variabilité du Climat
Depuis la fin du 19ème siècle, la températuremoyenne globale de la planète a augmenté d’envi-ron 0,6°C, les années 1990 étant les plus chaudes(IPCC-2001). Un consensus général au sein del’IPCC se dégage sur le constat que:• Le réchauffement observé au cours de ces cin-
quante dernières années est essentiellement dûaux activités humaines.
• La tendance au réchauffement persisterajusqu’à la fin du siècle même en cas de stabili-sation des émissions des gaz à effet de serre ;
• La fréquence et l’intensité des processushydrologiques extrêmes ainsi que la perturba-tion du cycle hydrologique vont se renforcer.
Les conditions climatiques en Afrique de l’Ouestétaient de tout temps marquées par une grande
variabilité spatiale et temporelle. Elles connaissentdepuis ces dernières décennies, des dérèglementschroniques et de grande ampleur qui se caractéri-sent par :
• Des sécheresses récurrentes sous forme d’unebaisse de pluviosité, d’une plus grande incerti-tude dans la répartition de celles-ci, d’une chutedes débits des cours d’eau de l’ordre de 20 à60%, particulièrement des grands fleuves
• Des déficits pluviométriques de l’ordre de 20%,atteignant parfois des valeurs supérieures à25% pour les zones à climat humide et à plusde 30% dans les zones à climat plus sec,
• Une nette tendance au glissement des isohyè-tes vers le sud (environ 200 km).
1.3.2 Variabilité des ressources en eau
Les travaux réalisés sur la base des observationshydrologiques de longue durée ont montré (réfé-rences):
Au niveau des eaux de surface
• Une nette rupture des séries pluviométriques,observée autour des années 1968-1972, avecl'année 1970 comme année charnière ;
• Une baisse générale de la pluviométriemoyenne d'environ 15% à 30% selon la zone;
Tableau 2 : Disponibilité, dépendance et usage des ressources en eau renouvelable (WWDR 2, 2006).
Pays quantité/an/hab(m3) Dépendance (%) Usage (%)
Bénin 3820 61 2
Burkina 930 0 6
Cap Vert 630 0 9
Côte d'Ivoire 4790 5 1
Gambie 5470 63 0,4
Ghana 2490 43 1
Guinée 26220 0 1
Guinée-Bissau 20160 48 0,4
Liberia 66530 14 0,05
Mali 7460 40 7
Mauritanie 3830 96 15
Niger 2710 90 6
Nigeria 2250 23 3
Sénégal 3810 33 4
Serra Leone 30960 0 0,2
Togo 2930 22 1
Tchad 4860 65 0,5

29
• Une diminution du nombre de jours de pluie etune diminution de la durée de saison de pluie ;
• Un début de saison désormais très variable et étalé.• une rupture des séries de débits moyens
annuels tout comme pour les précipitations(entre 1968 et 1972);
• Une diminution des ressources en eau de sur-face au niveau des principaux bassins (40 à 60%) beaucoup plus marquée que celle des pré-cipitations ;
• Une baisse drastique des volumes d’eau transi-tant par les grands cours d’eau ;
• Des étiages de plus en plus sévères avec defréquents arrêts des écoulements ;
• Une augmentation du coefficient de ruisselle-ment pour les petits bassins.
• Une prolifération des végétaux envahissants(jacinthe, typha, etc.) du fait de la baisse desniveaux d'écoulement, du réchauffement et del'eutrophisation.
• Un déficit de remplissage de la plupart des rete-nues des barrages avec comme impacts socio-économiques, la diminution du niveau d'alimen-tation en eau des villes ;
• Des perturbations dans le fonctionnement debarrages hydro-électriques aussi bien dans lessituations de fortes crues que de déficits d’eau.
Au niveau spécifique des zones humides
• Une importante diminution des superficies desprincipales zones humides naturelles tant sur lecontinent que dans les zones côtières ;
• Une augmentation globale de l’évapotranspiration ;• Une réduction de la production halieutique ;• Une baisse de la biodiversité ; • Une accélération de l’érosion côtière (environ 1
à 30 mètres selon les zones)• Une intrusion de langue salée à l’intérieur des
lagunes côtières (lagune de Cotonou et menacesur la biodiversité d’eau douce).
Au niveau des eaux souterraines (nappes sou-terraines)
• Une diminution très sensible de la recharge desgrands aquifères ;
• Une baisse du niveau des nappes phréatiqueset des coefficients de tarissement, ce qui aréduit l'apport des nappes souterraines auniveau des principaux cours d'eau ;
• Une réduction des réserves d’eaux souterrainesdans les régions humides et sub-humides ;
• Une intrusion des eaux salées dans les nappesphréatiques côtières à cause de la surexploita-tion de ces nappes et/ou une élévation duniveau de la mer.
1.4 Evolution plausible du climat au 21ème siècle
Les changements, notamment d’origine humaine,que subissent les propriétés physiques et chimi-ques de l’atmosphère influencent directement laqualité de la vie, voire l’existence même de certai-nes formes de vie. Les phénomènes météorologi-ques et hydrologiques extrêmes, notamment lessécheresses et les inondations provoquent sou-vent une perturbation des systèmes écologiques etsocio-économiques. Une crise de plus en plusgrave sévit dans le domaine des ressources en eaudu fait de la baisse de la pluviométrie, des débitsdes fleuves et rivières et plus généralement du faitde la diminution continue des volumes d’eau dis-ponibles, d’épisodes de pollution, et de conditionspeu satisfaisantes concernant les eaux usées. Pourêtre viables les systèmes socio-économiques doi-vent être conçus de manière à résister aux phéno-mènes météorologiques et hydrologiques extrê-mes actuels et futurs et être suffisamment robustespour permettre en cas d’échec, leur redressementrapide.
Plusieurs approches sont couramment utilisées parle GIEC dans l’étude de l’évolution du climat et deses impacts dans divers secteurs. Mais les «Modèles de Circulation Générale de l’Atmosphère,(MCGA) », constituent actuellement l’unique outilque possèdent les scientifiques pour obtenir desrésultats fiables de simulation des processus phy-siques qui déterminent le climat et pour proposerdes stratégies d’adaptation et d’intervention quipourraient être adoptées. Malgré les incertitudesliées à l’utilisation de ces modèles un consensusgénéral se dégage autour des aspects suivants(IPCC, 2001) :
• Une augmentation de la température (leréchauffement observé au cours de ces cin-quante dernières années peut être considéré,au moins en partie comme la conséquence desactivités humaines, et que cette tendance auréchauffement va se poursuivre pour atteindrevers la fin du siècle vers 2100, une augmenta-tion de l’ordre de 1,4 à 5,8°C par comparaisonavec l’année 1990) ;
• Une variabilité des précipitations et autresvariables climatiques, mais la plupart des scé-narii prévoient une diminution des précipita-tions qui varie de 0,5 à 40% avec une moyennede 10 à 20% pour les horizons 2025 ;
• Une amplification des extrêmes (inondations etsécheresse), mais avec des incertitudes sur leslieux et les périodes ;

30
• Une augmentation du niveau de la mer (0,5 à 1 m).
Impacts sur les Ressources en Eau
L’évolution plausible du climat mondial donnée parles MCGA laisse présager les impacts suivants surles ressources en eau :
• Un renforcement du cycle hydrologique (avecl’apparition de phénomènes jadis méconnusdans la sous-région) ;
• Une augmentation de la fréquence et de l’am-pleur des inondations ;
• Une recrudescence des sécheresses de plus enplus sévères ;
• Une baisse des nappes phréatiques (surtoutdes aquifères alluviaux) ;
• Une détérioration de la qualité de l’eau.
1.5 Contraintes majeures pourla région En matière de changement et variabilité climati-ques et de leurs impacts sur les ressources en eau,une des principales contraintes communes à l’en-semble des pays d’Afrique de l’Ouest reste l’insuf-fisance des connaissances sur les ressources eneau. Celle-ci découle essentiellement de la mécon-naissance de l’importance des données hydrologi-ques dans la résolution des problèmes de dévelop-pement et donc la non disponibilité de ces don-nées de base, surtout en matière de ressources eneaux souterraines. A cela, il faut ajouter les faiblescapacités scientifiques locales en matière d’étudesur les changements climatiques et leurs impacts.Aussi, les contraintes majeures peuvent être résu-mées comme suit :
• Non disponibilité des données hydrologiques ethydrogéologiques en quantité et en qualité suf-fisantes (la plupart des séries de données n’at-teignent pas trente ans), ce qui rend difficilel’estimation des ressources en eau et de leurévolution face à la variabilité et aux change-ments climatiques) ;
• Insuffisance des moyens matériels de collecteet d’archivage (bases de données non informa-tisées), d’analyse et de communication (SIG,NTIC) pour la plupart des services producteursde données ;
• Insuffisance des connaissances sur les ressour-ces en eau (les études détaillées sur les différentssystèmes de ressource en eau sont rares) ;
• Absence et/ou faiblesse des institutions derecherche et d’observation systématique dans
le domaine des sciences de l’eau (servicesmétéorologiques, hydrologiques,…) ;
• Insuffisance d’expertise nationale en matière dechangements climatiques (manque de modèlesclimatiques régionaux ayant une résolution spa-tiale adéquate pour l’élaboration des scénarii dechangements climatiques à un horizon temporeldonné) ;
• Insuffisance de formations scientifiques sur cer-tains aspects tels que la vulnérabilité, l’adapta-tion et l’atténuation de l’impact du climat;
• Absence de mécanismes efficaces de prévi-sions climatiques et hydrologiques d’aide à laprise de décisions et de systèmes de gestionbasés sur les résultats de la recherche.
Conclusions -RecommandationsLa multiplicité des futurs climatiques plausiblesmontre que ce qui est important c'est la gestion del'incertitude. Ceci nécessite des efforts soutenusen vue de réduire la vulnérabilité actuelle à la varia-bilité et aux changements climatiques tout enmaintenant les options de gestion ouvertes pourfaire face aux scénarii les plus défavorables, maisaussi pour saisir les opportunités qui pourraient seprésenter. Cela implique donc de :
• Promouvoir la collecte des données météorolo-giques, hydrologiques, socioéconomiques,environnementales, etc. ;
• Promouvoir la recherche afin de lever certainesincertitudes à l’image du programme AMMA etprojet FRIEND-AOC entre autres ;
• Doter les établissements universitaires et insti-tuts de recherche de moyens techniques etfinanciers et en développant la recherche dansle domaine de la modélisation des processus etde leurs impacts ;
• Mettre en place un réseau d’information fiable(réseaux optimisés d’observations systémati-ques et de suivi au niveau des services météo-rologiques, hydrologiques,…) et des platefor-mes de gestion efficace des données et d’infor-mations ;
• Mettre en place un observatoire des ressourcesen eau pour l’Afrique de l’ouest ;
• Promouvoir la bonne gouvernance et la gestionintégrée des ressources en eau ;
• Renforcer et intensifier les formations sur lesévaluations de la vulnérabilité et des mesuresd’adaptation dans le secteur des ressources en eau.

31


33
RésuméL’importance primordiale d’une approche bassinversants dans le management des ressources eneau dans un contexte de variabilité et change-ments climatique justifie aussi la nécessité deprospecter des actions d’adaptation envisageablesà l’échelle ainsi considérée. Dans cette perspec-tive, le présent chapitre traite du cas du bassin dufleuve Sénégal (OMVS) tout en soulignant lesdivers efforts et initiatives sectorielles menées parles Etats riverains pour une meilleure gestion desressources en eau prenant en compte la dimensionclimatique. Ces initiatives sont d’ordre juridique(Conventions, Chartes, Codes, etc.), institutionnel(Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,Haut Commissariat, Sociétés de Gestion,Commissions, etc.), réalisations physiques (infra-structures pour l’agriculture, l’élevage, la pêche,l’énergie, le transport, etc.), protection des écosys-tèmes, renforcement des capacités, Information,sensibilisation et communication, etc. Ce chapitrefait ressortir les acquis et leçons tirées de cettegestion intégrée du bassin du fleuve Sénégal, maisaussi les limites et contraintes jusque là observées.Ces acquis vont l’engagement des gouvernements(volonté politique et institutionnalisation) à l’atteinterésultats notables au profit des populations suite àla mise en ?uvre de divers programmes d’interven-tion dans le bassin versant. Quand aux contraintesenregistrées, elles sont d’ordre technique (insuffi-sance du système de suivi évaluation des projets etprogrammes, faiblesse des capacités d’interven-tion au niveau local, décalage entre le respect ducalendrier de la conduite des activités au niveaurégional, etc.), d’ordre structurel (insuffisance decommunication avec les différentes catégoriesd’acteurs concernés, insuffisance dans l’harmoni-sation des priorités entre le niveau national etrégional) mais d’ordre financier (difficulté de mobi-liser des financements conséquents pour soutenirles programmes sociaux prévus).S’agissant des actions concrètes d’adaptation auxvariabilités et changements climatiques envisagea-
bles dans les bassins transfrontaliers ouest afri-cains, elles sont aussi d’ordre juridique (mise enplace d’un cadre juridique et institutionnel adéquat), d’ordre technique (scénarios des changements climatiques, micro irrigation, gestiondes inondations et des sécheresses, réseau demesures moderne sur les ressources en eau, Basede données, réalisation d’infrastructures génératri-ces de revenus, lutte contre les végétaux aquatiques envahissants/ensablement/érosion desberges/maladies hydriques, etc.), d’ordre financier(mécanisme de mobilisation des partenaires finan-ciers), renforcement des capacités, infrastructures,etc.
Mots clés : Changements/variabilités climatiques,bassins versants, OMVS, Adaptation
2.1 IntroductionLa baisse chronique de la pluviométrie en Afriquede l’Ouest s’est traduite par une baisse importantede l’hydraulicité des cours d’eau dans l’ensembledes bassins fluviaux. Dans le cas plus spécifiquedu fleuve Sénégal, le débit moyen annuel à Bakel(station de référence) est passé de 1374 m3/s de lapériode 1903-1950 à 597 m3/s à la période 1951-2002 ; et d’une moyenne de 840 m3/s de la période1950-1972 à seulement 419 m3/s pour la période1973-2002. L’une des conséquences les plusgrave de cette situation, était que durant la saisonsèche, la langue salée (eau de mer) remontaitjusqu’à 200 km environ en amont de Saint-Louis,posant à l’évidence des problèmes de disponibilitéd’eau douce pour les usages domestiques, agrico-les, etc.
Face à ces multiples problèmes liés aux impactsde la variabilité et changement climatique sur lesressources en eau des principaux bassins hydro-graphiques de la sous-région, les Etats riverainsont décidé de conjuguer leurs efforts pour une ges-tion concertée des -eaux transfrontières, notam-
Chapitre II : Actions concrètes envisageables pour l’adaptation à la gestion de l’eau à l’échelle du
bassin fluvial en Afrique de l’Ouest, le cas de l’OMVS
Par : Tamsir NDIAYE (OMVS, Sénégal) (Writer), Boubacar Sidiki DEMBELE (NCAP, Mali), Abdoulaye DOUM-BIA (ABN, Niger), Saadou Ebih Mohamed EL HACEN (CNRE, Mauritanie), Isabelle NIANG (ENDA/UCAD,Sénégal), Aita SECK (DEEC, Sénégal), Madjyara NGUETORA (AGRHYMET/CILSS, Burkina Faso), Viriato luisSOARES CASSAMA (Ministère Ressources Naturelles, Guinée Bissau), Nazaire PODA (Expert SE/EIE,Burkina Faso), Aliou Kankalabé DIALLO (PRAI-MFD, Guinée Conakry)

34
ment par la mise en place d’organismes de bassin.(PRAI/MFD, ABN, OMVS, OMVG, ABV, etc.)
Pour illustrer les efforts d’adaptation au change-ment climatique dans les bassins transfrontaliers lebassin du fleuve Sénégal a été choisi comme étudede cas. Le 11 mars 1972, l’Organisation pour la
2.2 Actions concrètes menéesdans le bassin du fleuveSénégal
Les actions concrètes menées par l’OMVS enmatière de mise en valeur des ressources du bas-sin concernent différents aspects à savoir :
• Juridique et institutionnel• Réalisation physique des ouvrages• Protection et restauration de l’écosystème• Renforcement des capacités • Information et sensibilisation
2.2.1 Sur le plan juridique et institutionnel
Plan juridique
Les principaux textes juridiques (conventionset charte) signés sont
• La Convention relative au statut du fleuveSénégal du 11 mars 1972.
• La Convention portant création de l’OMVS du11 mars 1972.
• La Convention relative au statut juridique desouvrages communs du 21 décembre 1978.
• La Convention relative aux modalités de finan-cement des ouvrages communs du 12 mai1982.
Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a étécréée par les Etats du Mali, de la Mauritanie et duSénégal avec comme principale mission d’élaboreret de coordonner la mise en œuvre de stratégiespertinentes aptes à faciliter une gestion des res-sources en eau au bénéfice d’un développementsolidaire et durable. La Guinée a rejoins l’organisa-tion en 2006.

35
• Convention portant création de la SOGED(1997)
• Convention portant création de la SOGEM(1997)
• La Charte des eaux du fleuve Sénégal du 28mai 2002
• Code International de la Navigation et desTransports sur le fleuve Sénégal (2006)
Plan institutionnel
• La conférence des Chefs d’Etat et deGouvernement
Instance suprême de l’Organisation, elle se réuniten principe une fois par an. Les décisions sont pri-ses à l’unanimité, force obligatoire. La Présidenceest tournante.
• Le Conseil des ministresC’est l’organe de conception et de contrôle del’Organisation. Les décisions sont prises à l’unani-mité, force obligatoire. Il est prévu 2 sessions ordi-naires par an, mais au besoin, il se réunit en ses-sion extraordinaire pour délibérer.
• Le Haut-commissariatOrgane d’exécution de l’OMVS, il est dirigé par unHaut-commissaire, désigné par la Conférence desChefs d’Etat et de Gouvernements. Le SecrétaireGénéral, qui assure en cas de besoin l’intérim duHaut-commissaire, est nommé par le Conseil desministres sur proposition du Haut-commissaire, demême que les Directeurs et Conseillers.
• La Société de Gestion de l’Energie deMANANTALI (SOGEM)
La Société de Gestion de l’Energie de MANANTALI,est une société publique interétatique, dont le capi-tal de 1,2 milliards francs CFA a été souscrit pour1/3 par chacun des trois Etats du Mali, de laMauritanie et du Sénégal. Elle a pour objet « la réa-lisation des ouvrages communs destinés à la pro-duction et au transport de l’énergie électrique deMANANTALI », et « l’exploitation, l’entretien et lerenouvellement des Ouvrages Communs dont lagestion lui est confiée ».
• La Société de Gestion et d’Exploitation dubarrage de DIAMA (SOGED)
La Société de Gestion et d’Exploitation du barragede DIAMA, société anonyme au capital de 600 mil-lions francs CFA, est chargée de la maintenance deDIAMA, des endiguements et du recouvrement duprix de vente de l’eau. Les principes d’organisationet de fonctionnement de la SOGED sont quasiidentiques à ceux évoqués ci-dessus pour laSOGEM.
• La Commission Permanente des Eaux (CPE)Dans l’espace OMVS, la gestion des eaux et del’environnement du fleuve Sénégal passe par laCommission Permanente des Eaux (CPE) instituéeà cet effet pour prendre en charge les questionsrelatives à l’utilisation équitable des ressources eneau entre les différents usages.La CPE émet des avis et des recommandations àl’endroit du Conseil des Ministres.
• Les Cellules Nationales de Coordination(CNC)
Il existe dans chaque pays membre une CelluleNationale OMVS. C’est un organe composé d’unpersonnel technique d’exécution et de suivi desprojets de l’OMVS dans les Etats membres. Il estrattaché au Ministère de tutelle et sert véritable-ment d’interface entre le Haut commissariat et lesServices techniques des Etats.
• Les Comités locaux de Coordination (CLC)Du point de vue fonctionnel, il s’agit d’un relais dela Cellule Nationale OMVS au niveau local.
• Le Comité Régional de Planification (CRP)Le Comité Régional de Planification est composédes représentants des Etats. Il est chargé d'émet-tre, à l'attention du Conseil des Ministres, un avisconsultatif sur le programme d'investissement rela-tif à la mise en valeur optimale des ressources dubassin. Il propose des mesures de mise en cohé-rence, voire d’harmonisation des politiques dedéveloppement sur l’ensemble du bassin.
• Le Comité Consultatif (C.C.)Le Comité Consultatif réunit les représentants despays, des institutions de financement et ceux del’OMVS. Il a un rôle d’assistance auprès du Haut-commissariat pour la mobilisation des ressourcesfinancières, le renforcement des ressources humai-nes, et la promotion des échanges d’informationsentre les différents partenaires de l’OMVS.
2.2.2 Sur le plan des réalisations physiques
Infrastructures
Les infrastructures de première génération (1986à 2006) sont composées essentiellement :• D’un pont barrage anti-sel à DIAMA dans le
delta (23 km de l’embouchure) ;• D’une écluse à DIAMA (navigation) ;• Des endiguements en rive droite et rive gauche
dans le delta ;

36
• D’un barrage régulateur à buts multiples àMANANTALI ;
• D’une Centrale Hydroélectrique ;• D’un réseau interconnecté de 1500 km de
lignes HT,• D’un réseau de câble de garde à fibre optique
(télécommunication) ;• Des routes de liaison.
Les infrastructures de deuxième génération sontentre autres :• Barrage hydroélectrique au fil de l’eau de Félou
(début des travaux en 2007)• Barrage hydroélectrique au fil de l’eau de
Gouina (début des travaux en 2008)• Barrage de régulation de Gourbassi (finance-
ment en cours de mobilisation) ;• Barrages de Koukoutamba, Boureya et Balassa
(acquisition des financements pour l’actualisa-tion des études de faisabilité) ;
• Microcentrales (étude d’identification des sitesvalidée)
• Chenal navigable (travaux en cours)• Ouvrages portuaires (études de faisabilité en
cours).
Activités socioéconomiques
Agriculture
• Agriculture irriguée : Le potentiel irrigable est de 375000 ha dont240000 ha au Sénégal, 126000 ha pour laMauritanie et 9000 ha pour le Mali ;
• Agriculture de décrue :Il y a un potentiel de 50 000 ha et on estime quec’est un nombre compris entre 40 000 et 50 000familles paysannes qui pratiquent les cultures dedécrue.
Superficies aménagées et exploitées sur l’ensemble de la Vallée du Fleuve - Année 2005 (Sources : OMVS)
Type 2005Sénégal
(ha)Mauritanie
(ha)Mali (ha)
Total(Ha)
Irrigation
Superficiesaménagées
Total aménagés 94 320 42180 710 137 210
Aménagés en vivrier 83 320
Aménagés en canne à sucre 11 000
Superficiesexploitables
Total Exploitable 67 909 21 000 200 89 109
Exploitables en vivrier 58 909 21 000
Exploitables en canne à sucre 11 000
Superficiesexploitées
Exploités hivernage 24 275 21 000 0 45 275
Exploités contre saison 11 725 1200 200 13 125
Canne à sucre 7500 - - 7500
Total exploité /an 43 500 22 200 200 65900
Décrue
Potentiel 35 000 15 000 0 50 000
Aménagés
Exploités 9600

37
Agro-industrie
Au niveau industriel la Compagnie SucrièreSénégalaise (CSS) est la plus grande entreprise quiopère dans le bassin. Elle exploite à Richard-Tollplus de 8 000 ha.Il y a ensuite les Grands Domaines du Sénégal(GDS) en rive Gauche et les Grands Domaines deMauritanie (GDM) en rive droite. Ils sont surtoutactifs dans la production sous serre de variétéshorticoles, notamment la tomate fraîche et les hari-cots verts destinés à l’exportation. On note égale-ment quelques petites unités de transformation dela tomate, de décorticage du riz, de traitement del’eau pour l’alimentation de grandes villes commeDakar, Saint-Louis, Nouakchott (projet en cours),etc.
Elevage
Le cheptel est estimé en 2006 dans le bassin dufleuve Sénégal à plus de 2,7 millions de bovins et4,8 millions d’ovins-caprins, soit 25 % du cheptelbovins et 20 % de cheptel ovins-caprins sur l’en-semble des 3 Etats. Cet élevage qui est pour l’es-sentiel extensif a naturellement été positivementinfluencé par la maîtrise de l’eau (barrages) deve-nue disponible en quantité suffisante toute l’annéeet les aménagements hydro-agricoles qui ont gran-dement augmenté le disponible fourrager.
Pêche
Il semblerait que la régularisation du débit dufleuve par la construction des barrages et les endi-guements effectués dans la vallée et le delta ont eudes impacts négatifs sur cette activitéMais, la mise en eau des barrages a aussi eu deseffets positifs capables de compenser ces effetsnégatifs. En effet, le relèvement des niveauxd’étiage et le maintien d’un volume d’eau plusimportant dans le lit mineur du fleuve, dans cer-tains bras secondaires et dans les parties les plusbasses ont permis le développement d’espècesplus variées et la survie de sujets plus gros. Par ail-leurs les lacs, les retenues des barrages de DIAMAet surtout de MANANTALI (11,5milliards de m3 pour500km2) sont bien connus des populations pourêtre effectivement très poissonneuses et polarisentaujourd’hui d’importantes communautés depêcheurs venues de toutes les zones de la sousrégion.
Energie
Depuis le démarrage du premier groupe de la cen-trale hydroélectrique de MANANTALI au mois
d’octobre 2001, l’usine compte plus de 20 820heures de marche et c’est une énergie de plus detrois millions de gigawatts heures qui a été délivréeaux sociétés d’Electricité des trois Etats membresde l’OMVS par l’Opérateur Eskom EnergieMANANTALI à hauteur de 52% de la production auMali, 33% pour le Sénégal et 15% pour laMauritanie grâce à deux lignes à haute tensioninterconnectées d’environ 1500km.La part de l’énergie d’origine hydroélectrique four-nie par la Centrale de MANANTALI représente enmoyenne entre 30% et 50% de la production totalede l’énergie au niveau des trois Etats du Mali, de laMauritanie et du Sénégal.
Transport
Le système de transport de l’OMVS intègre letransport maritime, les ports et les voies navigablesintérieures. Par sa multi modalité, et grâce à desmailles bien emboîtées, il s’insère aux autresmodes de transport terrestres (routier et ferro-viaire).Il comprend la navigabilité mixte mer/fleuve parcabotage et le transport terrestre à travers les rou-tes de liaison DIAMA-Rosso, Saint-Louis - DIAMAet MANANTALI-Mahinanding. Ainsi conçu, il a pourvocation d’être le moteur du vaste programme dedéveloppement durable de notre sous région.
Télécommunication
L’option de poser comme câble de garde deslignes du réseau interconnecté de transport del’énergie de MANANTALI en fibre optique a offert àl’OMVS d’immenses opportunités en matière detélécommunication. En effet elle a permis l’inter-connexion des réseaux de télécommunication des3 Etats du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal etautorise le transit de 30 200 communications téléphoniques simultanées ou de 48 canaux detélévision.Ce réseau de l’OMVS est interconnecté au câblesous-marin transatlantique et constitue aujourd’huiun point nodal entre l’Afrique du Sud, de l’est et duNord.
2.2.3 Protection et restauration desEcosystèmes
De manière spécifique au niveau de l’OMVS, cettepréoccupation est effectivement bien prise encharge depuis quelques années au double niveauinstitutionnel et programmatique.

38
Sur le plan Institutionnel, il y a eu la création del’Observatoire de l’Environnement en mars 2000.Au niveau programmatique l’OMVS a eu à élaborerà mettre en œuvre entre autres :
• Programme d’Atténuation et de Suivi des Impactssur l’Environnement entre 1998 et 2002 ;
• Projets de lutte contre la pauvreté ;• Projets pilotes de santé ;• Programme sanitaire régional ;• Projet de micro financements ;• Projet de libération des emprises du réseau
Haute Tension de MANANTALI ;• AEP et assainissement. • Projet de Gestion Intégrée de l’Eau et de l’envi-ronnement du bassin du fleuve Sénégal(GEF/OMVS) qui a démarré en 2002. Il assure lacontinuité des efforts déployés par l’OMVS dans lecadre du PASIE.
2.2.4 Renforcement des capacités
Renforcement des capacités Institutionnelleset juridiques
Pour assurer une transparence dans l’exploitationdes ressources en eau du bassin, la réglementationa été renforcée par :
• L’adoption de la charte des eaux du fleuveSénégal 2004
• L’adoption du code de la navigation et destransports sur le fleuve Sénégal en 2006 ;
• L’élaboration d’un projet de code del’Environnement du Bassin (en cours de valida-tion)
Renforcement des capacités Matérielles
• Une meilleure consolidation de la base de don-nées a été entreprise par :
• La restauration du réseau de mesures hydro cli-matiques dans le haut bassin ;
• Le renforcement des capacités des servicesnationaux producteurs de données ;
• L’acquisition de matériel informatique ;• L’acquisition de matériel roulant.
Renforcement des capacités financières
La mobilisation d’environ 400 millions USD à tra-vers le Programme PGIRE d’une durée de 10 ansen deux phases de 5 ans chacune.
Renforcement des capacités humaines
Dans le cadre de l’amélioration des performancesde l’organisme, il faut noter :
• Le recrutement de spécialistes dans les domai-nes de l’environnement, l’hydrologie, communi-cation, socio économie, Base de données etSIG, santé, développement rural, ressourcesforestières, passation de marchés et pêche ;
• La mise en place d’un programme de formationcontinue ;
• La mise en place d’un comité scientifiqueconsultatif au niveau de l’observatoire.
Renforcement des capacités techniques ettechnologiques
Pour améliorer la prise d’aide à la décision et faci-liter la circulation de l’information, divers outils ontété développés :
• Une base de données intégrée et un SIG ;• Un tableau de bord besoins/ressources ;• Un Site Web ;• Des logiciels de simulation et de gestion ;• Des outils de planification.
2.2.5 Information, sensibilisation etcommunication
Pour impliquer véritablement toutes les parties pre-nantes dans les actions de développement réali-sées, il faut noter :
• L’adoption d’une stratégie de communication ;• La création d’émissions au niveau des radios
rurales ;• La création d’émissions au niveau de la télévi-
sion et de la radio nationales ;• La publication d’articles dans la presse écrite
(privée et publique) ;• L’installation d’un site web ;• La publication de bulletins de projets et le jour-
nal de l’OMVS ;• La mise en place d’un plan d’alerte sur
les crues.

39
2.3 Limites et leçons apprises
2.3.1 Limites
Parmi ces contraintes et limites, il faut noter entreautres :
• Le décalage entre le respect du calendrier de laconduite des activités au niveau régional pour laréalisation des aménagements structurants(barrages, Centrale Hydroélectrique, endigue-ment, routes de liaison, etc.) Et l’effectivité desmesures prises au niveau national pour accom-pagner l’exploitation des opportunités offertespar ces aménagements structurants.
• La difficulté de mobiliser des financementsconséquents pour soutenir les programmessociaux (lutte contre les maladies hydriques,projets générateurs de revenus, constructiond’écoles, accès à l’eau potable, etc.) Prévuspour atténuer les impacts liés aux aménage-ments réalisés surtout au niveau des popula-tions les plus pauvres qui sont souvent les plusgrandes victimes ;
• La faiblesse des capacités d’intervention auniveau local pour prendre en charge la conduitedes programmes et projets sur le terrain (man-que de moyens humains et matériels des servi-ces techniques, taux élevé d’analphabètes,confusion fréquente des rôles et responsabilitésdes acteurs locaux) ;
• L’insuffisance du système de suivi évaluationdes projets et programmes menés sur le terrain;
• L’insuffisance de communication avec les diffé-rentes catégories d’acteurs concernés;
• L’insuffisance dans l’harmonisation des priori-tés entre le niveau national et régional dansl’élaboration des politiques et programmes dedéveloppement.
2.3.2 Leçons apprises
Après 30 ans d’expérience de l’OMVS ; les leçonssuivantes peuvent être retenues dans la perspec-tive de l’amélioration de la gestion des bassinstransfrontaliers et dans la réplicabilité dans d’au-tres bassins :
Au niveau de la Gouvernance
• Expression d’une forte volonté politique ;• Etablissement d’un cadre institutionnel et légis-
latif solide et flexible
Pour assurer une exploitation optimale des ouvra-ges et pour mieux prendre en compte les interpel-lations mondiales en termes de rationalité et dedurabilité dans la gestion des ressources naturel-les, il faut noter :
• La création de la Société de Gestion del’Energie de MANANTALI ;
• La création de la Société de Gestion etd’Exploitation du barrage de DIAMA ;
• La création de la Commission Permanente desEaux (CPE) ;
• La ratification d’une Charte des eaux du fleuveSénégal ;
• L’adoption d’un Code International de laNavigation et des Transports sur le fleuveSénégal ;
• L’élaboration d’un Code de l’Environnementpour le Bassin.
• Adoption des mesures et règles de fonctionne-ment des institutions et de gestion des ressour-ces partagées basées sur l’équité, la solidaritéet la transparence ;
• Concertation/consultation permanente dans laprise de décision.
• Mise en place des outils de gestion, de prévi-sion et de suivi évaluation scientifiquement fia-bles et accessibles à toutes les catégories d’ac-teurs ;
• Mise en place un mécanisme financier durablepour soutenir les programmes et projets ;
• Prise en compte des réalités socioculturelles dumilieu pour choisir l’approche méthodologiqueà adopter dans la mobilisation des acteurs ;
• Participation et adhésion des acteurs concer-nés par le biais d’une sensibilisation et d’unecommunication efficace.
Au niveau des programmes d’intervention
• Maîtrise et gestion intégrée de l’eau pour s’af-franchir en partie des risques liés aux phénomè-nes relatifs aux déficits ou excédants de pluiesqui surviennent fréquemment dans cette zonede l’Afrique de l’Ouest;
• Construction d’ouvrage de protection contrel’intrusion d’eau saline ;

40
• Adaptation des règles de fonctionnement et de gestion à l’environnement régional et international ;
• Amélioration (modernisation et innovation) desoutils de planification, de gestion et de suiviévaluation (programme de gestion des réser-voirs, programme de propagation des crues,SIG, tableau de bord…) ;
• Etudes, recherches/développement pour l’amé-lioration des connaissances des écosystèmesdu bassin;
• Renforcement des capacités (moyens humainset matériels à tous les niveaux d’intervention) ;
• Réalisation d’ouvrages intégrateurs à buts mul-tiples ;
• Entretien et maintenance des ouvrages.
Conclusions -Recommandations
On note à ce niveau la mise en place d’un cadrejuridique et institutionnel adéquat dans chaquebassin transfrontalier accompagné de :
• Statut juridique du fleuve, de ses affluents etdéfluents ;
• Organisme de bassin;• Charte des eaux du bassin;• Code de l’environnement ;
La mise en place d’infrastructures de maîtrise et demise en valeur des ressources en eau (structuran-tes et secondaires) à travers :
• Prise en compte des scénarios des change-ments climatiques dans la conception et la ges-tion des ouvrages (ouvrage enterré, ombragé,petite taille);
• Promotion de l’irrigation à petite échelle, goutteà goutte, de la mini et micro hydroélectricité ;
• Gestion des inondations par l’écrêtage descrues, notamment au niveau de MANANTALI ;
• Gestion des sécheresses par le soutien au débitd’étiage et par la recharge des nappes grâceaux crues artificielles réalisées à partir deMANANTALI ;
• Etablissement d’un réseau de mesuresmoderne sur les ressources en eau ;
• Etablissement d’un réseau de collecte sur don-nées environnementales et socioéconomiques ;
• Elaboration d’outils de planification, de prévi-sion qui prennent en compte les changementsclimatiques (base de données – SIG – observa-toires - tableau de bord besoins/ressources)
• Promotion de recherche/développement sur lesouvrages d’adaptation aux changements clima-tiques ;
• Renforcement des capacités des acteursconcernés au niveau national et sous régionalpour une plus grande de prise de consciencesur les changements climatiques et ses effets ;
• Renforcement des capacités de gestion et deprotection du massif du FOUTAH DJALLON(château d’eau de l’Afrique de l’ouest) ;
• Programmes régionaux de lutte contre les végé-taux aquatiques envahissants ; l’ensablement,l’érosion des berges, les maladies hydriques,
• Mesures pour favoriser l’implication des popu-lations (micro financements, électrificationrurale, pisciculture, aquaculture, AEP, ….) ;
• Mécanisme de mobilisation des partenairesfinanciers ;
• Réalisation d’infrastructures génératrices derevenus ;
• Réalisation de prestations de services rémunérées

41


43
Résumé
Le présent document est d’une part le résultat deplusieurs enquêtes de terrain en Afrique de l’Ouest,d’autre part le fruit d’une consultation d’expertsouest africains sur les options pertinentes à mettreen œuvre au niveau communautaire en vu d’uneadaptation pérenne dans la gestion des ressourcesen eau face aux changements climatiques. Le pro-cessus d’élaboration de ce document, fondé surl’approche des moyens d’existence, avait dans unpremier temps, permit l’identification des impactsmajeurs des variabilités et changements climati-ques sur les moyens et modes d’existence descommunautés. L’analyse effectuée a montré queces moyens et modes d’existence, basés essen-tiellement sur l’usage des ressources naturelles,sont directement ou indirectement, déjà affectéspar les variabilités climatiques. Partant des optionsd’adaptations spontanément mise en œuvre parles communautés elles mêmes et suivant uneapproche participative, cette analyse a dressé unensemble d’options d’adaptation à mettre enœuvre au niveau communautaire.
Qu’il s’agisse des stratégies employéesaujourd’hui ou dans le passé, on se rend compteque l’intérêt majeur des communautés en Afriquede l’Ouest, porte sur les questions qui concernentdirectement l’existence et les moyens de subsis-tance. Ainsi, le forage des puits aux bons endroits(là où l’eau est proche de la surface) et l’obtentionde pompes à moteur abordables pour faciliter lepuisage de l’eau, constituent des priorités expri-mées au niveau communautaire par les popula-tions locales.
Des options dites fondamentales car nécessaires àl’existence des communautés, même en l’absencede la menace climatique, ont également été identi-fiées. Ces options d’intérêt général vont de l’accèsà l’eau potable à l’accès à l’énergie en passant parl’aménagement et la gestion intégrée des bassinsversants.
Mots clés : Adaptation, Communautés,Ressources en eau, Afrique de l’Ouest, Moyensd’existence.
3.1 Introduction
De tout temps, les communautés locales ont adoptédes stratégies de gestion de l’eau pour faire faceaux changements climatiques. Il convient de réper-torier, de partager et de développer celles qui sontadaptées aux dynamiques contemporaines. Eneffet, les communautés locales d’Afrique de l’Ouestfont face à un ensemble de problèmes liés auxchangements climatiques qui influent directementsur leur existence et leurs moyens de subsistance.
En tant qu’acteurs directement touchés par le pro-blème, les communautés locales n’ont pas l’im-pression d’être bien écoutées et que les acteursextérieurs comprennent ou perçoivent les ques-tions telles que le manque d’eau avec la mêmevision. C’est précisément parce que les pluies, lesfleuves, le soleil, la sécheresse, la flore et la faunesont des composantes vitales et à part entière dela cosmologie rurale qu’il faudrait essayer de mieuxcomprendre la manière dont les communautéslocales perçoivent les changements climatiques etla signification qu’elles associent à leurs compo-santes. Sans cette compréhension, toute tentatived’adaptation risque d’être vouée à l’échec.
Le présent document met en revue les impactsdéjà observés des variabilités climatiques sur lesressources en eau et sur les communautés localesen Afrique de l’ouest. Les options d’adaptationsont ensuite développées en distinguant troistypes d’options : les options auto-adaptatives, lesoptions d’adaptation spécifiques aux communau-tés dans le domaine de l’eau et enfin, des optionsd’intérêt général. Aussi, il apparaît que la réussitede la mise en place d’options d’adaptation néces-site un certain nombre de pré-requis.
Chapitre III : Climat, vulnérabilité et adaptation de l’aménagement des ressources en eau à l’échelle
communautaire, en Afrique de l’Ouest
Par : Lawrence FLINT (ENDA, Sénégal), Mamouda MOUSSA NA ABOU (ENDA, Sénégal) (Writers), BallaAbdou TOURE (ONG POPDEV, Mauritanie), Thomas Anatole Aïnahin BAGAN (Ministère Environnement,Bénin), Mamady Kobélé KEITA (ONG Guinée Ecologie, Guinée Conakry), Madeleine DIOUF SARR(DEEC/NCAP, Sénégal)

44
3.2 Impacts des variabilités climatiques sur les ressources en eauet sur les communautés locales en Afrique de l’ouest
En Afrique de l’ouest, les changements et variabilités climatiques sur les ressources en eau se traduisent pardes impacts directs ou indirects sur les principaux modes et moyens d’existence liés aux ressources en eau.
Ces impacts sont énoncés ci-dessous suivant les modes d’existence ; il s’agit principalement :
Pêcheurs
Baisse des ressources halieutiques, disparition decertaines espèces halieutiques lié à la diminutionde cure dans la plupart des cours d’eau de la sous-région, reconversion des pêcheurs à d’autres acti-vités, l’exode, comblement des points d’eau (ensa-blement, plantes envahissantes, etc.), santé (mala-dies hydriques surtout quand on sait que cespêcheurs vivent aux abords ou même sur l’eau).
Petits exploitants agricoles
Baisse des rendements agricoles, accentuation dela pauvreté (insécurité alimentaire, endettement carla récolte ne couvre pas les besoins annuels desproducteurs), perte des sols (forte érosion hydrique).
Petits éleveurs
Mort du bétail (manque de fourrage et d’eau,baisse du niveau de l’eau des puits), conflits avecles agriculteurs, forte pression sur les points d’eau.
Commerçants
Indisponibilité et cherté des produits agricoles,mévente et endettement à cause du faible pouvoir
d’achat, accessibilité aux marchés et aux produitsprimaires en cas d’inondations.
Transporteurs
Accessibilité difficile aux marchés et aux produitsprimaires en cas d’inondations, inactivité, baissedu pouvoir d’achat, accentuation de la pauvreté,entrave au transport fluvial par les plantes aquati-ques envahissantes.
Transformateurs agro alimentaires
Indisponibilité et cherté des produits agricoles,mévente et endettement à cause du faible pouvoird’achat, accessibilité difficile aux marchés et auxproduits primaires en cas d’inondations.
3.3 Mesures d’adaptation
Les mesures d’adaptation sont classées en troiscatégories.
Peuls Foulani en exode climatique Gabi, Maradi, janvier 2007
Elevage et approvisionnement en eauGabi, Maradi, janvier 2007

45
3.3.1 Mesures et actions auto-adaptatives
Ce sont les options déjà prises par les populationslocales, dès l’instant où la variabilité climatique leurétait devenue une réalité vécue au quotidien. Ils’agit principalement :
Adaptation réactive au déficit pluviométrique
• Réaménagement des calendriers agricoles(pratique de semis tardif, cultures à cyclescourts, plusieurs semis, semis à sec),
• Pluies provoquées (pratiques traditionnelleslocales),
• Prières collectives pour un hivernage fécond• Nécessité de pratiquer simultanément une agri-
culture pluviale et une agriculture irriguée, • Abandon des cultures associées à l’agriculture
pluviale.
Mesures visant l’efficacité et l’efficience dansla gestion de l’eau pour l’agriculture
• Casiérages, diguettes filtrantes, cultures duvétiver,
• Dépressions artificielles creusées dans le sol enguise de retenues d’eau,
• Division des parcelles à l’aide de rangées depierres formant de petits murets destinés à rete-nir le plus longtemps possible sur le sol les eauxde ruissellement résultant des pluies torrentiel-les afin d’obtenir une infiltration et une percola-tion maximales,
• Division des champs en parcelles rectangulairesdélimitées par des remblais de terre et à traverslesquelles on creuse un réseau de canauxéquipé de tuyaux,
• Techniques de repiquage pour une meilleuregestion de l’eau,
• Placer la moto pompe dans un trou afin deréduire la hauteur de prise de l’eau d’un puits.
Adaptation spontanée en cas d’inondations
• Parcage des animaux dans des enclos familiauxpendant la crue ou les inondations,
• Canaux creusés pour évacuer les eaux stag-nantes en cas d’inondation,
• Déplacement des populations en cas d’inondation.
Mesures de collecte et de conservation del’eau pour usages domestiques
• Conservation de l’eau dans de petites bouteillesde plastique à l’intérieur des concessions,
• Récupération des eaux de pluie par les toits desmaisons,
Autres adaptations spontanées et réactionnelles
• Produits alimentaires de substitution, • Réduction du cheptel en période sèche, • Reconversion des pêcheurs, éleveurs, etc. • Rationalisation traditionnelle de la pêcherie, • Déplacement des populations vers des zones
moins sèches,
Femmes à la corvée de l’eau, Gabi, Maradi, janvier 2007

46
3.3.2 Mesures d’Adaptation spécifiques
Ces sont les mesures et actions d’adaptation pré-conisées et mise en œuvre par les Etats, les orga-nismes d’assistance et d’aide au développementet ou les ONG. Ces mesures sont axées autour deséléments suivants :
Accès à l’eau pour la consommation et oupour l’irrigation
• Dragage des puits et cours / plans d’eau• Aménagement et réhabilitation des retenues
d’eau• Amélioration de l’exploitation des eaux de
surface (renforcement des capacités des com-munautés)
• Kiosques à eau• Protection et réhabilitation des berges des
plans d’eau• Création de points d’eau (forages, puits
modernes, etc.)
Adaptation à la sécheresse et au dérèglementde la pluviométrie
• Semences adaptées à la sécheresse• Techniques modernes de pluies provoquées• Prévisions météorologiques
Adaptation par la gestion intégrée des bassins ver-sants
• Aménagement et préservation des bas fonds(éviter l’habitation des lits des cours d’eau etdes zones inondables, systèmes de drainage,etc.)
• Développement de la gestion intégrée par bas-sin versant
• Mise en place de système d’alerte et de gestiondes inondations
• Boisement / reboisement • Recharge des nappes (seuil d’épandage)• Récupération des terres dégradées• Fixation des dunes• Techniques des zai, démi –lune, cordons
pierreux, etc.
Mesures visant l’amélioration de la qualité del’eau et des services
• Mesures d’assainissement autour des pointsd’eau
• Protection des ressources en eau contre la pollution
• Infrastructures d’assainissement dans les établissements communautaires
Autres mesures d’adaptation réactionnelle et anticipatives
• Pompes à énergie renouvelable (solaires, biocarburant, éoliennes, etc.)
• Développement de la pisciculture et aquaculture
• Sources alternatives de revenus liées au créditcarbone (MDP)
3.4 Options d’adaptation spécifiques prioritaires suivantles modes d’existence
Les options d’adaptation spécifiques relèvent decomportements de développement endogènes,dans la plupart des cas elles font l’objet d’appuis etd’apports particuliers dans les plans de dévelop-pement locaux, les interventions des ONG dedéveloppement, ou, plus généralement, des politi-ques de développement rural menées par les pou-voirs publics. En revanche, les options d’adapta-tion complémentaires peuvent faire l’objet de ren-forcements et d’appuis spécifiques, il s’agit ici(tableau ci-dessous) de relier ces options en fonc-tion de leurs impacts sur chacun des modesd’existence.

47
3.5 Analyse du tableau et choixdes options prioritaires
L’analyse du tableau d’évaluation des impacts desoptions d’adaptation sur les modes d’existencerévèle que la petite agriculture et l’élevage sont lesmodes d’existence les plus concernés par lesoptions identifiées du fait de leur forte vulnérabilitéaux variabilités climatiques affectant les ressourcesen eau.
Plus au-delà, deux types d’enseignement peuventêtre tirés :
• Dans une zone géographique spécifique, unrepérage préalable des modes d’existencedominants pour les communautés permet decerner rapidement les options prioritaires àmettre en place. Par exemple, si la pêche etl’agriculture sont dominantes, on peut rapide-ment lire dans ce tableau les options prioritairesqui, à l’évidence, ne seraient pas les mêmesdans une zone où l’élevage et l’artisanat domi-neraient.
• Cela démontre bien la nécessité de l’analysepréalable des modes d’existence des commu-nautés et de leur vulnérabilité avant de déciderd’options à entreprendre.
Tableau d’impacts des options d’adaptation sur les modes et moyens d’existence
Modes d’existence �Options d’adaptation
PêcheTrans-port
Petiteagricul-
tureÉlevage
Artisanat/Industrie
Com-merce
Points d’eau (forages, puits modernes, etc.) x x 710 137 210
Pluies provoquées (ensemencement desnuages)
x x
Semences adaptées à la sécheresse x x
Aménagement et réhabilitation des ouvrageshydrauliques (puits, cours d’eau, retenuesd’eau), recharge des nappes
x x x x
Aménagement et préservation des bas fonds x x x
Aménagement et préservation des bas fonds x x
Promotion des techniques culturales visant àmieux gérer l’eau (repiquage, billonnage, etc.)
x x
Réduction du cheptel en période sèche, x
Pompes à énergie renouvelable (solaires, biocar-burant, éoliennes, etc.)
x x
Protection et réhabilitation des berges des plansd’eau (reboisement, mise en défens, etc.)
x x x
Mise en place de système d’alerte et de gestiondes inondations
x x x x x x
Reboisement des terroirs villageois x x
Activités génératrices de revenus (maraîchage,cultures de contre saison, aquaculture, piscicul-ture, agroforesterie et crédits carbone, etc.)
x x x x x x
Récupération des terres dégradées (demi lune,zaï, traitement des ravines, etc.)
x x
Fixation des dunes (contre l’ensablement descours d’eau)
x x x

48
Trois options ont des effets directs ou indirects surl’ensemble des modes d’existence puisqu’elles nesont pas spécifiques à un mode d’existence parti-culier. Il s’agit de :
• Promotion d’activités génératrices de revenus(maraîchage, cultures de contre saison, aqua-culture, pisciculture, etc.),
• Mise en place de systèmes d’alerte et de ges-tion des inondations,
• Aménagement et réhabilitation des ouvrageshydrauliques.
Parcelles irriguées (planches) entourées de petitsremblais de terre, dans lesquels sont plantés dessemis (village de Goulbi, de Maradi, Niger, janvier
2007).
Rigoles d’irrigation cimentées construites par legouvernement nigérien (village de Saguiya, district
de Niamey, Niger, janvier 2007).
Phase initiale du forage d’un puits financé par legouvernement (village de Maradawa, district de
Maradi, Niger, janvier 2007).
Revêtement d’un puits avant son insertion (villagede Maradawa, district de Maradi, Niger, janvier
2007).
Retenue d’eau sur le Goulbi de Maradi (village deSoumarana, district de Maradi, Niger, janvier 2007)
Puits classique utilisant l’énergie humaine au lieud’un moteur diesel et de carburant (village de Tibiri,
district de Maradi, Niger, janvier 2007)

49
Si ces trois options peuvent toujours être retenuescomme prioritaires dans toutes les communautés,il n’en demeure pas moins que pour chaque zonespécifique, seule une analyse précise des modesd’existence et des options qui leurs sont spécifi-ques, permet de répondre à la vulnérabilité d’unecommunauté identifiée.
3.6 Options d’intérêt général
Des options d’intérêt général ont également étéidentifiées. Ces options sont fondamentales à la viequotidienne des populations même en l’absencede la menace climatique et donc constituent unpréalable à toutes actions d’adaptation dans lagestion des ressources en eau au niveau commu-nautaire, même si elles dépassent parfois ce cadrecommunautaire. Il s’agit de :
• Développement de l’approvisionnement en eaupotable et de l’assainissement ;
• Développement de la gestion intégrée des res-sources en eau par bassin ;
• L’aménagement intégré hydro-agro-sylvo-pas-toral adapté au changement et variabilité clima-tiques à l’échelle communautaire du Massif duFOUTAH DJALLON « château d’eau naturel del’Afrique de l’Ouest » ;
• Le développement de l’accès à l’énergie àl’échelle communautaire.
Ces options d’intérêt général touchent pratique-ment toutes les composantes des modes etmoyens d’existence.
En effet, l’approvisionnement en eau potable etl’assainissement constituent une nécessité abso-lue conditionnant la santé même des populations.Cette option est donc à la base de toute autre acti-vité socio économique.
La gestion intégrée des ressources en eau estbasée sur une approche écosystème et holistique.Elle intègre les cinq formes de capital (naturel, phy-sique, humain, social et financier) en vue d’unemeilleure gestion des ressources. C’est cetteapproche systémique qui sera mise en ?uvre dansle cadre du Programme Régional d’Aménagementintégré du Massif du FOUTAH DJALLON, « châteaud’eau de l’Afrique de l’ouest ».
La question de l’accès à l’énergie, bien que indirec-tement liée à celle de l’accès à l’eau, constitueaussi une problématique transversale au niveaucommunautaire. Les besoins d’énergie apparais-
sent en effet dans la pêche et le transport (pour ali-menter les moteurs des pirogues et autres moyensde déplacement), dans la petite agriculture et l’éle-vage (pour alimenter les pompes), dans le com-merce, l’artisanat et l’industrie (pour la transforma-tion des produits agricoles, de pêche ou d’élevage).
A ce titre ces options d’intérêt général en Afriquede l’Ouest font l’objet des mentions spéciales ci-dessous.
3.6.1 Mention sur le Développementde la gestion intégrée des ressourcesen eau au niveau communautaire
La promotion et le développement des différentssecteurs de l’« économie d’eau » à l’échelle desterroirs villageois (alimentation en eau potable etindustrielle, irrigation et drainage des périmètresagricoles, équipement de mini et micro centraleshydrauliques, équipement et aménagement dessites pour le tourisme et loisirs fluviaux, etc.), parti-cipent fortement à la création des meilleures condi-tions de vie et de développement communautaire.L’ensemble de ces secteurs sont en interactionplus ou moins étroite et dépendant tous de la maî-trise et de la mobilisation des ressources en eauexistantes. Il va s’en dire que la gestion de ces res-sources doit se faire selon une approche à la foisintégrée, participative et décentralisée afin de pré-venir et d’éviter des conflits sur l’exploitation de laressource eau. Les communautés villageoisesconcernées doivent à cet effet bénéficier de l’appuiet de l’assistance des partenaires à tous lesniveaux (organismes et services nationaux spécia-lisés, partenaires au développement, ONG, etc.)
3.6.2 Mention sur l’approvisionne-ment en eau potable et assainisse-ment (AEPA)
Cette fonction de l’AEPA constitue une fonction debase de la gestion des ressources en eau qui estessentielle pour assurer la qualité de la vie danstout établissement humain y compris les commu-nautés villageoises. Elle participe en effet à assurerla bonne santé et la vitalité des populations afin depermettre le plein exercice des activités de pêched’élevage, d’artisanat, d’industrie, etc. et de pré-server l’environnement socio culturel de la cité,tous, secteurs sensibles aux changements et varia-bilités climatiques.

50
3.6.3 Mention sur le massif du FOUTAH DJALLON
L’importance de cet écosystème montagneuxcaractéristique de la sous-région ouest africainen’est plus à démontrer. Le massif du FOUTAHDJALLON constitue effectivement le château d’eaunaturel de la sous région dont il comprend les sour-ces et les bassins supérieurs de six parmi les prin-cipaux fleuves transfrontaliers (Sénégal, Gambie,Kayanga-Geba, kaba-litle scarcis, Kolinté-greatscarcis, koliba Kourbal), ainsi que celle des princi-paux affluents du Niger supérieur. Plusieurs activi-tés d’aménagement et de développement intégréhydo-agro-sylvo-pastoral ont été déployées dansles années 80 à l’échelle des zones particulières dumassif dans le cadre et sous l’initiative du «Programme Régional d’Aménagement Intégré duMassif du FOUTAH DJALLON (PRAI-MFD) » sousl’égide de l’OUA. A ce jour, le programme régionalest en passe de lancer un projet de recherchedéveloppement sur dix ans, avec l’assistance duFonds pour l’Environnement Mondial (FEM) etd’autres partenaires bailleurs de fonds. Ce projetporte sur « la gestion intégrée des RessourcesNaturelles du FOUTAH DJALLON (PGIRN – MFD) »qui va entreprendre en particulier : (i) l’aménage-ment intégré de six bassins versants situés dans lazone amont des fleuves transfrontières qui pren-nent leur source dans le massif et (ii) l’aménage-ment démonstratif pilote des terres et des eaux dequinze nouveaux bassins versants représentatifsdes zones écologiques particulières du massif. Ilest recommandé que l’aménagement de ces bassins ciblés par le PGIRN-MFD à l’échelle com-munautaire du massif prenne dûment en comptel’adaptation aux changements et variabilités clima-tiques afin de mieux atteindre les objectifs de
gestion et de développement durable du massif duFOUTAH DJALLON partagé.
3.6.4 Mention sur l’accès à l’énergie
Une problématique transversale à tous les sec-teurs, est la question de l’énergie dans toutes lesrégions où des études de cas furent réalisées etconstitue un problème sérieux dans toute tentatived’adaptation. Le manque de sources d’énergie esten fait lié au manque de moyens, même si leGouvernement et certaines ONG, avaient assistéles fermiers dans les investissements initiaux(achat de motopompes et construction de puits).Les motopompes sont très coûteuses et nécessi-tent normalement des fonds substantiels pour leurachat par les communautés locales. Elles nécessi-tent surtout du carburant diesel, même si le jatro-pha pouvait être une alternative dans certainesrégions. Le diesel, au même titre que tout autreproduit pétrolier, est une commodité très chère ;ceci fait que ce sont seulement les agriculteursriches qui peuvent investir dans l’irrigation sur devastes terres.
Ainsi, il est recommandé la décentralisation depetits projets énergétiques comme un ajustementaux stratégies d’adaptation dans le secteur del’eau. Ces ajustements peuvent prendre plusieursformes. Les mini-projets hydro électriques en sontune ; les plateformes multi fonctionnelles déjà miseen œuvre au Mali et éventuellement au BurkinaFaso et au Sénégal peuvent rouler au diesel ou àl’huile de jatropha. Des efforts additionnels restentcependant à consentir afin de rendre ces énergiesrenouvelables compétitives par rapport aux éner-gies fossiles.
Exemple caractéristique d’une pompe à moteurusée. Cette pompe est utilisée chaque jour sans
interruption, d’avant l’aube à la nuit tombée,(Goulbi, de Maradi, Niger, janvier 2007).
Exemple de pompe à moteur enfoncée dans le sol dufait de la profondeur extrême de l’eau et de l’insuffi-
sance de la capacité de pompage de l’appareil (villagede Maradawa, district de Maradi, Niger, janvier 2007).

51
3.7 Pré requis pour l’adaptation
La communication et la participation effectives descommunautés sont deux pré-requis essentiels à lamise en œuvre de toute action d’adaptation auniveau communautaire.
3.7.1 La Communication
Comme l’a si bien observé Burton, « Se connectercorrectement et d’une manière durable, avec lescommunautés locales, constitue une tâche et uneactivité hautement intensive… » qui peut significa-tivement s’ajouter aux coûts du projet (Burton2003). Plusieurs barrières doivent être surmontéesdont celles relatives à l’administration locale quipouvait être irritée par les stratégies de communi-cation menées sur les communautés locales pou-vant être perçues comme un défit à leur autoritétraditionnelle. De même, les autorités traditionnel-les, pouvant d’ailleurs être issues d’un héritagelégué et autocratique, peuvent sembler ouvertesdans leur réception des stratégies de communica-tion et d’éventuelles actions d’adaptation, maisnéanmoins rester exclusives et pas toujours repré-sentatives des populations qu’elles clament pour-tant représenter. D’autres barrières sont souventliées à la langue, aux croyances, à la classificationsociale, à la xénophobie et une compréhensioninsuffisante de ce qui se discute (la problématiqueou la thématique leur est vague).
3.7.2 Perceptions et Participation
Si le praticien/chercheur/décideur/responsablepolitique/bailleur extérieur, cherche à mettre enœuvre ou à encourager des stratégies d’adaptationaux changements climatiques, ne parvient pas àcomprendre les processus touchés par les change-ments climatiques tels qu’ils sont perçus par lacommunauté concernée, il y a de grandes chancesà ce que les stratégies et/ou initiatives en questionne reçoivent pas le soutien, la compréhension nil’engagement nécessaires. Il arrive très fréquem-ment que des initiatives de développement soientmises en œuvre, souvent avec la participation descommunautés locales, en grande partie parce quele financement et l’assistance structurelle sont enplace, mais se retrouvent délaissées et abandon-nées au départ du personnel chargé du projet,occasionnant un sentiment de profonde frustrationchez tous les intéressés. Tandis que la politique nationale précise leurcontexte, garantie les facteurs de succès et plusparticulièrement leur durabilité, les actions d’adap-tation dépendent largement de la réceptivité descommunautés locales elles mêmes. Ceci sousentend que très souvent et par le passé, des effortspourtant substantiels mais initiés de l’extérieur, sesont effondrés, une fois que les initiateurs de cesefforts ne sont plus là (Burton, 2003). Trop de rhé-torique entache les expressions comme « partici-pation multi acteurs », « initiatives Bottom Top » et« initiatives par la base » ou consultation à unniveau communautaire et la participation active.Cependant, la réalité est toute autre : très souvent,les communautés sont soit consultées pour leursavis sur des actions possibles puis abandonnéessans explication, ou bien les stratégies sont appor-tées et légitimées depuis un niveau supérieur etdonc non supportées à un niveau local et ne peu-vent l’être, pour diverses raisons.

52
Conclusions -Recommandations
Conclusions
Les voix des communautés locales dénoncentrégulièrement les problèmes avec les officiels, lesobstacles bureaucratiques et le sentiment répanduparmi les étrangers selon lequel les systèmes deconnaissances extérieurs sont plus fiables que lessystèmes locaux. Or, il est également souventaffirmé que le Gouvernement est l’institution qui,dotée des bons outils, est la plus capable de met-tre en œuvre des stratégies d’adaptation parmi lescommunautés locales. Une fois ce principeaccepté, la communauté internationale des ONG,les bailleurs et les scientifiques se doivent deconsacrer une part importante de leurs connais-sances, compétences et technologies en termesde vulnérabilité et d’adaptation, au développementdes capacités au niveau du Gouvernement natio-nal, régional et local. La forme et la structure d’unetelle stratégie peuvent être développées ailleurs,mais ses éléments fondamentaux doivent aborderles points de vue exprimés ci-dessus par les popu-lations locales elles-mêmes.
Aussi, comme soulevé plus haut, la seule barrièremajeure à une adaptation effective au niveau com-munautaire, est une communication effective quibrise les barrières liées à la gouvernance, à l’admi-nistration locale, à la langue, aux croyances et sou-vent aux doutes sur la crédibilité des interlocuteursvenus de l’extérieur. Une stratégie effective decommunication constitue alors en elle même unestratégie d’adaptation valable presque au mêmetitre que l’action d’adaptation elle-même, du fait deses qualités d’ajustement. Toute assistance techni-que et financière n’a donc de valeur que si on y asuffisamment investi de temps et de ressourcesdans la dimension sociale de l’adaptation.
Recommandations
Les stratégies d’adaptation liées à l’eau doiventêtre réalisables, abordables et, qui plus est, plausi-bles, c’est-à-dire convaincantes et en harmonieavec la culture locale. Elles doivent répondre à desbesoins et à des priorités identifiées par les com-munautés locales et adopter des perspectivesexprimées localement, accessibles aux popula-tions locales.
Afin de rendre durable et réplicable l’action d’adap-tation, il y a aussi nécessité de :
• La mise en place d’un réseau d’échange d’ex-périences entre communautés
• Renforcer les capacités des communautés àl’auto gestion des ouvrages
• La documentation des savoirs locaux enmatière de gestion des ressources en eau
La conception de stratégies potentielles d’adapta-tion communautaires se doit aussi de satisfairecertains paramètres spécifiques pouvant êtreregroupés dans les catégories suivantes :
• Crédibilité (nécessité de confiance dans lesinterlocuteurs extérieurs) ;
• Légitimité/acceptabilité (suivant la culture etl’éthique). En ce sens, une recherche adéquateen matière de science socio-économique etphysique s’avère nécessaire ;
• Faisabilité : Les actions d’adaptation identifiéesse doivent donc d’être faisables ;
• Accessibilité (stratégies abordables à moyen etlong terme et ne constituant pas une chargesupplémentaire aux populations locales);
• Communication participative effective – pour laprise de décision et l’adoption de stratégiesconformes aux aspirations et aux priorités locales.

53


55
Résumé
Au cours des dernières années, et en particulierdepuis le début des années 1970, l’Afrique del’Ouest est soumise à des perturbations climati-ques de grande ampleur. Ces perturbations se sontmanifestées par des déficits pluviométriques ethydriques chroniques, et une plus grande fré-quence des extrêmes climatiques (sécheresses etinondations). Face à cette situation, le milieu natu-rel et humain a réagi en tentant de s’adapter aunouvel contexte. Les réponses —pour l’essentielréactives et spontanées— apportées à la variabilitéclimatique ont été de divers ordres dont certainsinstitutionnels, et politiques. On peut spéculer surla question de savoir si ces réponses d’adaptationont permis ou non d’atténuer les impacts deschocs climatiques au cours des années récentes.Quoi qu’il en soit, au vu des perspectives climati-ques annoncées, ces mesures d’adaptation ris-quent d’être insuffisantes et méritent par consé-quent d’être renforcées et diversifiées.
Neuf mesures institutionnelles prioritaires sont pré-conisées pour augmenter la capacité d’adaptationde l’Afrique de l’Ouest en matière de gestion desressources en eau :
• Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressourcesen Eau, notamment par l’élaboration et la miseen œuvre de Plans nationaux GIRE
• La protection des zones humides notamment àtravers une mise en œuvre effective des obliga-tions des Etats de l’Afrique de l’Ouest dans lecadre de la Convention RAMSAR sur les zoneshumides
• La minimisation des risques de conflits inter-étatiques autour de l’eau par la promotion de laConvention Cadre des Nations Unies sur l’utili-sation des eaux transfrontalières à des finsautres que la navigation
• La sécurisation foncière afin de favoriser lesinvestissements dans des mesures d’adaptation
• Le renforcement des mesures juridiques etréglementaires pour préserver la qualité de l’eau
• Assurer que les moyens financiers et humainsnécessaires soient mobilisés à temps pour per-mettre la mise en œuvre effective des Plansnationaux d’adaptation au changement climati-que en cours d’élaboration dans 14 des 17 paysde l’Afrique de l’Ouest
• Considérer le changement climatique commeun des paramètres clé à prendre en comptedans les études de faisabilité des projetshydrauliques et hydro-agricoles ou autresciblant les bassins fluviaux. De même, il estimportant dans la mesure du possible d’incluredes mesures d’atténuation des impacts duchangement climatiques dans les grandes ini-tiatives visant les bassins fluviaux.
• Enfin, prendre les mesures juridiques, régle-mentaires et organisationnelles appropriéespour atténuer les impacts des inondations dontl’ampleur et la fréquence devraient augmenteravec le changement climatique.
4.1 Introduction
L’objet de ce document est de suggérer et discuterdes options concrètes de mesures politiques etinstitutionnelles qui pourraient être envisagéespour faciliter l’adoption de réponses novatrices degestion de l’eau en vue de renforcer la capacitéd’adaptation de l’Afrique de l’Ouest au change-ment climatique. Il vise en d’autres termes à mettreà la disposition des décideurs et parties prenantes,des options de réformes politiques et institution-nelles qui pourraient être envisagées afin d’amélio-rer la capacité d’adaptation de la région ouest-afri-caine aux impacts prévisibles du changement cli-matiques sur les ressources en eau.Le présent papier met l’accent sur les réformesaffectant directement les conditions de mise enœuvre d’actions de gestion de l’eau envisagées àl’échelle communautaire ou à l’échelle de basinsfluviaux tels que le bassin du fleuve Sénégal ou lefleuve Niger en vue d’atténuer le niveau de vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest au changementclimatique.
Chapitre IV : Mesures politiques et institutionnellesconcrètes envisageables pour faciliter la gestion
adaptative à différentes échelles en Afrique de l’OuestPar : Madiodio NIASSE (CSLT, Sénégal) (Writer), Atigou BALDE (Ministère Hydraulique Energie, GuinéeConakry), Toumany DEMBELE (Point Focal MFD, Mali), Madame Jacqueline ZOUNGRANA (MinistèreHydraulique, Burkina Faso)

56
L’Afrique de l’Ouest est présentement confrontée àdes périls climatiques sérieux. Devant cette situa-tion, le milieu naturel, les populations humaines etanimales ont eu à réagir de différentes manièresavec des résultats variables. On insistera ci-des-sous sur les réponses au plan politique et institu-tionnel.
4.2 Performances du dispositifpolitique et institutionnel actueldans la gestion des impactsliés à la variabilité du climat
En réponse aux déficits pluviométriques et aux cri-ses alimentaires qui les ont accompagnés, diffé-rentes réponses ont été apportées aux plans politi-que et institutionnel en Afrique de l’Ouest. On secontente ici d’en citer quelques unes en rapportavec la gestion des ressources en eau :
• A l’échelle des communautés de base, la péjo-ration du climat a entraîné une insécurité ali-mentaire chronique en milieu rural entraînantdes réactions telles que : le glissement progres-sif vers le sud de la population rurale ; les émi-grations saisonnières (dans un premier temps)suivies de l’exode rural et des migrations inter-nationales qui se sont intensifiées au fur et àmesure que la crise climatique s’aggravait. Lespopulations qui sont restées en milieu rural onttenté de diversifier leurs systèmes de produc-tion comme stratégie de minimisation du risque.Les populations riveraines des cours d’eausahéliennes (moyenne vallée du Sénégal, duNiger, vallée du Komadugu Yobe) ont pu pen-dant ces périodes de déficits hydro-climatiqueschroniques atténuer leur vulnérabilité alimen-taire grâce aux cultures de décrue qu’elles pou-vaient combiner avec les cultures pluviales etplus tard avec la culture irriguée (voir Magistro &Lo, 2001 pour la vallée du fleuve Sénégal).
• Partout en Afrique de l’ouest, on a observé l’ac-croissement des investissements dans la maî-trise de l’eau : (a) petite hydraulique villageoise ;(b) forages pastoraux ; (c) politique plus volon-tariste en matière de promotion de la culture irri-guée ; (d) accroissement des investissementsdans les barrages. On notera au passage quel’Afrique de l’Ouest compte aujourd’hui 100 à150 grands barrages (contre 1300 pour l’en-semble de l’Afrique).
• Au niveau national, on s’est de plus en plusintéressé aux aspects juridiques et institution-
nels de la gestion de l’eau. C’est dans ce cadrequ’il faut placer les processus de réforme dusecteur de l’eau dans beaucoup de casappuyés par des institutions internationales. Enrapport à ces professions de réforme du sec-teur, on a souvent créé une place pour le sec-teur privé, dans la distribution de l’eau potableen particulier. Parallèlement ou dans le cadre deces processus plusieurs pays se sont dotés decodes de l’eau (Sénégal en 1981, Guinée en1994, Burkina en 2001, Mali en 2002, etc.).Dans la même dynamique, on notera aussi qu’àla suite du Burkina Faso (2003), plusieurs Etatssont entrain ou envisagent d’élaborer leur PlanNational d’Action de Gestion Intégrée desRessources en Eau, prenant avantage d’unengagement pris lors du sommet deJohannesburg en 2002 de voir tous les Etats sedoter de plans GIRE avant 2005. C’est ainsi quele Sénégal et le Mali qui ont bénéficié de l’appuide la coopération canadienne sont entrain definaliser leur plan GIRE. Le Cap Vert et le Béninavec l’appui de la Coopération néerlandaiseviennent d’entamer leur processus d’élabora-tion de Plan GIRE. La Mauritanie, avec l’appuide la BAD et du PNUD, vient d’entamer un pro-gramme pilote GIRE.
• Toujours au niveau national, les pays del’Afrique de l’Ouest ont presque tous élaborédes stratégies et plans nationaux d’action delutte contre la sécheresse, ceci dans le cadre dela Convention des Nations Unies de Luttecontre la Désertification (1992). Ces plans natio-naux ont été complétés par l’élaboration d’unplan d’action sous-régional de lutte contre ladésertification.
• La création du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans leSahel) est aussi une des réponses au planrégional de l’Afrique à la variabilité climatique,aux sécheresses chroniques en particulier. LeCILSS a été créé en 1973 avec pour mission : larecherche de la sécurité alimentaire et la luttecontre les effets de la sécheresse et de la déser-tification. Le CILSS regroupe aujourd’hui lesneuf Etats que sont le Burkina, le Cap Vert, laGambie, la Guinée-Bissau, le Mali, laMauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.
• La création d’organismes de bassin: chacundes principaux cours d’eau transfrontaliers del’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui doté d’uneautorité de bassin dont la mission consisteentre autres à réaliser les investissementsnécessaires au développement des ressourceset à la coordination des interventions des Etatsriverains.

57
• La création du Centre Africain de MétéorologieAppliquée pour le développement (ACMAD) quidéveloppe des approches pour une plus grandeutilisation des informations et données climati-ques dans les différents secteurs de l’écono-mie. Depuis 1998, l’ACMAD et AGRHYMET ontmis en place le processus de prévision saison-nière en Afrique de l’Ouest qui produit des pré-visions saisonnières des pluies et des débitsdes cours d’eau pour la sous-région dès ledébut de la saison aux mois d’avril et mai. Cesinformations sont très utiles parce qu’elles peu-vent permettre d’anticiper les conséquences àvenir liées à la nature de la saison des pluies.
• L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) aété créé en 1992 pour entre autres aider dans laconnaissance et la gestion des ressources eneau des grands bassins aquifères transfronta-liers du Sahara et du Sahel et à promouvoir lacoopération inter-étatique dans la gestion deces ressources en eau importantes mais parfoisfragiles et non renouvelables. Dans ce cadrel’OSS met en œuvre d’un programme intitulé « Aquifères des Grands Bassins ».
Cette liste de réponses aux plans politique et insti-tutionnel, local, national et sous-régional, n’estbien sûr pas exhaustive. On pourrait bien y ajoutercertaines des politiques dans le domaine de l’agri-culture, de l’élevage, de l’environnement, etc.Cela dit, il n’est pas aisé d’évaluer la performancedes réponses politiques et institutionnelles auxperturbations climatiques auxquelles la régionouest-africaine est confrontée, surtout au cours deces 3-4 dernières décennies. Si on est optimiste onobserverait que les images de famines du Saheldes années 1970 se sont raréfiées, et on mettraitcela sur le compte de l’efficacité des mesuresréactives d’adaptation —mesures spontanées oustratégies pensées. Un point de vue plus lucideconsisterait à nuancer une telle évaluation étantdonné .qu’en dehors du milieu des 1980 (année1984 en particulier), on n’a pas vécu des déficitspluviométriques aussi sévères que ceux desannées 1970. Qui plus est, le spectre des crises ali-mentaires voire des famines récentes continue de
hanter le sommeil des Sahéliens comme en témoi-gne le grave déficit céréalier qu’ont connu certai-nes régions du Niger il y a un an. On peut mêmedéduire de la vulnérabilité persistance du Sahelque les réponses actuelles d’adaptation ont étéd’une efficacité limitée. Cela dit, là où les mesures d’adaptation ont péchéc’est souvent plus de la mise en œuvre timide dessolutions préconisées qu’à cause de leur non-per-tinence —non pertinence qui ne peut être testéequ’avec leur mise en œuvre effective. Par exemple,les superficies irriguées ont été accrues mais conti-nuent à constituer une proportion négligeable desterres cultivées. Si beaucoup de petits et grandsbarrages ont été construits dans la région au coursdes dernières années, l’Afrique de l’Ouest restel’une des régions d’Afrique les moins dotées engrandes infrastructures hydrauliques : sur les 1300grands barrages que compte l’Afrique, seuls 110sont en Afrique de l’Ouest dont l’essentiel (près de70% au Nigeria). Des plans d’action de lutte contre
Tableau: Organismes de bassins autour des grand cours d’eau de l’Afrique de l’Afrique
Options d’adaptation Siège Année de création Pays membres
ABN (Autorité du Bassin duNiger)
Niamey1980 (pour remplacer laCommission du FleuveNiger créée en 1963)
Bénin, Burkina, Cameroun, Côted’Ivoire, Guinée, Mali, Niger,Nigeria, Tchad
CBLT (Commission du Bassin duLac Tchad)
N’Djaména 1964Niger, Nigeria, Tchad,Cameroun, RCA
OMVG (Organisation pour laMise en Valeur du fleuveGambie)
Dakar 1978Gambie, Guinée, Sénégal,Guinée Bissau
OMVS (Organisation pour laMise en Valeur du fleuveSénégal)
Dakar 1972Guinée, Mali, Mauritanie,Sénégal
ABV (Autorité du Bassin de laVolta)
Ouagadougou 2007 (janv.)Burkina, Togo, Ghana, Côted’Ivoire, Mali, Bénin

58
la désertification ont été élaborés un peu partout,mais la mise en œuvre pratique de ces plans a étéloin d’être effective. Des Codes de l’eau sont adop-tées ici et là mais souvent les textes d’applicationqui permettent leur mises œuvre attentes plusieursannées avant d’être prise. Au Sénégal, les premierstextes d’application du Code de l’Eau de 1981attendront 1998 —soit 17 ans— pour être prises. On déduit de cette situation qu’une des stratégiesd’adaptation au climat attendu consiste à mettreen œuvre les politiques et dispositifs institutionnelsexistants, mais aussi à mettre en place un méca-nisme souple qui permettent de faire les ajuste-ments nécessaires sur la base des performancestestées des mesures politiques et institutionnellesd’adaptation.
4.3 Perspectives climatiques etniveau de préparation de la région
L’Afrique de l’Ouest est parmi les trois régions dumonde ayant enregistré les évolutions les plusdéfavorables de la précipitation au cours de lapériode 1900-2000 —les autres régions étant laCorne de l’Afrique et le Sud-ouest de l’AmériqueLatine. Au cours des 50 dernières années, la dispo-nibilité de l’eau par Africain a diminué de 75%,suite à la conjugaison de deux facteurs2 : (a) réduc-tion de la pluviométrie et des débits des coursd’eau ; (b) augmentation de la population. Si cesprocessus démographiques et climatiques conti-nuent et que les pays maintiennent leurs ambitionsde développement, il sera nécessaire d’aller au-delà de la mise en œuvre des politiques existantes,des réponses institutionnelles à la variabilitéactuelle. Les mesures à prendre doivent être à lamesure des défis climatiques futurs, défis qu’ilconvient donc d’abord d’analyser.
Si on en croit le Troisième Rapport d’Evaluation(TRE) du Groupe Intergouvernemental surl’Evolution du Climat (GIEC) de 2001, ces perspec-tives climatiques devraient, de façon générale, seconfirmer voire se renforcer. Mais il s’agit là d’un schéma grossier puisqu’ilexiste des incertitudes concernant les évolutionsspécifiques pour telle ou telle sous-région, tel outel bassin fluvial ou pays. Malgré de telles incertitu-des, le groupe d’experts intergouvernemental surl’évolution du climat (GIEC) estime que, de façongénérale, la poursuite du réchauffement global
aboutira à des températures plus élevées, unehumidité moindre au Sahel, une variabilité accruedes précipitations et des orages de plus forteintensité. Au niveau des bassins versants, sahé-liens en particulier, on observera une diminution ducouvert végétal, de l’infiltration et du ruissellement;l’érosion des sols devrait s’accélérer. Ces différentsprocessus vont profondément affecter le régimehydrologique des cours d’eau et aussi les condi-tions de recharge des nappes phréatiques. (3èmeRapport d’Evaluation du GIEC cité dans Cornet,2002: 113-114).Il est donc important que dans des régions tellesque l’Afrique de l’Ouest des efforts soient entreprispour que le facteur climatique soit tenu en comptedans les programmes de développements et enparticulier dans la gestion des ressources en eaudouces, lesquelles vont être sujet à un enjeu éco-nomique et géopolitique grandissant. Les grandsbassins fluviaux transfrontaliers de la région (Niger,Sénégal, Tchad, Volta, Gambie) vont certes dicterplus qu’auparavant un impératif de coopération etde partage équitable entre Etats riverains, maisvont aussi être sources potentielles de tensions etde conflits inter-étatiques.
4.4 Réformes institutionnellesenvisageablesPour atténuer la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouestaux impacts prévus et prévisibles du climat sur lesressources en eau, les mesures et initiatives insti-tutionnelles suivantes peuvent être envisagées. Lanotion d’institution comprend les formes d’organi-sations, le cadre juridique et réglementaire demême que les mesures politiques. Les institutionsainsi définies déterminent et structurent les façonsde penser, les comportements et pratiques ainsique les règles à travers lesquels les acteurssociaux s’expriment.
4.4.1 Appui aux processus d’élabora-tion et de mise en œuvre des plansnationaux GIRE (PAGIRE)
La GIRE est un processus et une stratégie de ges-tion permettant d’utiliser de façon durable les res-sources en eau aux échelles du bassin, de larégion, du pays et au niveau international tout enpréservant les caractéristiques et l’intégrité desécosystèmes qui abritent ces ressources en eau(les bassins fluviaux en particulier)3. Dans des
2 Source : GIEC. Troisième Rapport d’Evaluation sur l’évolution du climat (TRE)3 Adapté de Kabat et al. 2003.

59
contextes d’augmentation de la demande et deraréfaction de la ressource en eau du fait du chan-gement climatique, et donc d’exacerbation de laconcurrence pour l’accès et le contrôle des res-sources et aussi des risques de conflits de l’eau àtous les niveaux, une approche GIRE permet doncd’atténuer les bouleversements sociaux pouvantnaître de l’iniquité dans l’accès à l’eau et les conséquences environnementales de la péjorationdu climat.
Mesures spécifiques
• Appuyer les pays disposant de PAGIRE(Burkina) dans la mise en œuvre de leurs plans:mobilisation des ressources financières, appuitechnique ciblée, etc.
• Accompagner les pays engagés dans l’élabora-tion de leurs PAGIRE (Sénégal, Mali, Bénin etCap Vert) dans la formulation de ces plans etdans leur mise en œuvre ultérieure
• Sensibiliser les autres pays à s’engager dans laformulation de PAGIRE et le cas échéant, lesappuyer dans la recherche de partenaires tech-niques et financiers.
• Promouvoir la prise en compte et le finance-ment de la GIRE et de mesures d’adaptation auCC dans les Documents de Stratégie deRéduction de la Pauvreté
Modalités de mis en œuvre
L’intérêt de la GIRE comme méthode permettant lagestion durable des ressources en eau a été réaf-firmé lors du Sommet Mondial sur leDéveloppement Durable à Johannesburg en 2002.L’engagement a été pris lors de ce Sommet quetous les pays se dotent d’un Plan ou d’une straté-gie GIRE avant 2005. Cet engagement donne dupoids et de la légitimité à cette action locale. EnAfrique de l’Ouest un certain nombre de pays sesont engagés dans un processus d’élaboration deleurs plans d’action GIRE (PAGIRE): Burkina estdoté d’un Plan national d’Action GIRE depuis 2003 ;le Sénégal, le Mali, le Cap Vert et le Bénin sont encours d’élaboration de leurs plans GIRE. Les parte-naires privilégiés au niveau des Etats sont lesMinistères en charge de l’eau au plan politique etles Directions nationales ou CommissionsNationales de gestion de l’eau au plan opération-nel. Parmi les institutions régionales sur lesquelleson peut s’appuyer au plan technique et dans larecherche de financement, il y a le GWP/WAWP,l’UCRE-CEDEAO, le WA-Net.
4.4.2 Appuyer les Etats pour unemise en œuvre effective de laConvention RAMSAR permettant laconservation et gestion durable deszones humides
Les écosystèmes aquatiques côtiers et continen-taux jouent des rôles importants aux plans dumaintien de la biodiversité, de l’atténuation desimpacts des variations du climat et de la survie despopulations. Parmi leurs fonctions essentielles, onpeut citer le stockage de l'eau, la recharge desnappes souterraines, l'amortissement des crues, lastabilisation des états de surface et la lutte contrel'érosion, la purification de l'eau et la séquestrationdu carbone. Au fur et à mesure que le climatchange, ces différentes fonctions deviennent deplus en plus importantes. Par conséquent la réha-bilitation et la gestion durable des zones humidesconstituent une importante mesure d'adaptation àla variabilité et au changement climatiques.
Mesures spécifiques
• Assister les Etats dans l’inventaire des zoneshumides et le classement en sites RAMSAR deszones humides qui répondent aux critères exigés
• Appuyer les Etats dans la restauration et laconservation de zones humides jouant un rôleparticulier d’atténuation des impacts du chan-gement climatique.
• Promouvoir l’approche éco-hydrologie pour laconservation et gestion des zones humides enAfrique de l’Ouest ;
Modalités de mis en œuvre
En ce qui concerne les zones humides, il est ànoter que tous les 17 Etats de la région ont ratifiéla Convention de RAMSAR de 1971 sur les zoneshumides. Les ONG environnementales internatio-nales telles que l’UICN, WWF et WetlandsInternational peuvent être des partenaires privilé-giés des Ministères en charge de l’environnementet des organismes de bassin pour la mise en œuvredes mesures spécifiques prévues. Afin de pro-mouvoir l’éco-hydrologie pour une gestion durabledes zones humides en Afrique de l’Ouest, appuyerla création d’un site de démonstration d’éco-hydrologie dans le cadre de l’initiative internatio-nale des Programmes hydrologique international(PHI) et l’homme et biosphère (MAB) de l’UNESCOpour la promotion de l’éco-hydrologie.

60
4.4.3 Appui à la finalisation et à lamise en œuvre de la ConventionCadre entre les Etats membres duProgramme d’Aménagement Intégrédu Massif du FOUTAH DJALLON
Le FOUTAH DJALLON qui abrite plus de 8.000têtes de sources est la région où prennent nais-sance 14 sur les 25 bassins fluviaux transfrontaliersde l’Afrique de l’Ouest. Parmi ces bassins trans-frontaliers il y a le Niger, le Sénégal, la Gambie, leKaba, le Kolenté et le Koliba. Le réseau hydrogra-phique originaire du massif du FOUTAH DJALLONirrigue dix pays de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, laGambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, laMauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et laSierra Leone. Le massif du FOUTAH DJALLON estégalement l’une des principales sources de réali-mentation des eaux souterraines de la sous-région.Pour ces raisons, le massif du FOUTAH DJALLONest souvent considéré comme le “château d’eau”de l’Afrique de l’Ouest.L’état de l’environnement du massif du FOUTAH
DJALLON s’est fortement dégradé ces dernièresannées (feux de brousse, déboisement, érosion),souvent du fait de la péjoration du climat et de l’ac-croissement démographique. L’état actuel dedégradation des têtes de source peut affecter àterme les régimes hydrologiques et la qualité deseaux des fleuves qui prennent leur source danscette région (dont le Niger, le Sénégal, la Gambie).La protection et gestion durable du FOUTAH DJAL-LON est donc une mesure importante d’adaptationau changement climatique en Afrique de l’Ouest.
Mesures spécifiques
• Mener des activités de sensibilisation et d’appui(e.g. aide à la tenue de rencontres) pour accélé-rer la finalisation, l’adoption puis la mise enœuvre de la Convention Cadre sur le Massif duFOUTAH DJALLON
• Aider (par des rencontres de concertation) lesorganismes de bassin partageant le Massif duFOUTAH DJALLON a harmoniser leurs appro-ches et/ou développer les synergies concernantleurs interventions dans le massif
Modalités de mis en œuvre
En ce qui concerne le FOUTAH DJALLON, il s’agirad’appuyer à l’aménagement et à la protection desbassins versants ; d’aider à harmoniser les appro-ches des organismes de bassin (OMVS, OMVG,ABN, Mano River Union) concernant le développe-
ment des ressources du FOUTAH DJALLON.Partenaire privilégié : l’Unité de Coordination del’UA, les organismes de bassin concernés (OMVS,ABN, OMVG). La finalisation et surtout la mise enœuvre effective de la Convention Cadre entre lesEtats membres du Programme d’AménagementIntégré du Massif du FOUTAH DJALLON (Guinée,Guinée-Bissau, Gambie, Mali, Sénégal, Mauritanie,Sierra Leone) est un pas important en direction del’attention des objectifs ci-dessous mentionnés.
4.4.4 Promouvoir la ratification et dela mise en œuvre Convention des NUsur les eaux partagées
L’une des conséquences attendues du change-ment climatique est l’exacerbation des conflitsautour de l’eau —ce que d’aucuns appellent le ris-ques de water wars—, surtout autour des bassinsfluviaux internationaux. L’Afrique de l’Ouest estconsidéré comme une des régions à haut risqued’augmentation des disputes voire des conflitsouverts autour de l’eau. La Convention des NU de1997 contient un ensemble de dispositifs qui per-mettent d’éviter les conflits autour des eaux parta-gées et de les gérer lorsqu’ils surviennent. Elle offreune solide base juridique de coopération transfron-talière autour des cours d’eau partagés. Malgré sapertinence pour l’Afrique de l’Ouest, cetteConvention n’est cependant ratifiée par aucun Etatet c’est seulement la Cote d’Ivoire qui l’a signée.L’adoption de cette Convention par les Etats del’Afrique de l’Ouest serait un moyen d’accroître lacapacité de la région à faire face aux risques deconflits de l’eau qui vont être plus importants dufait du changement climatique.
Mesures spécifiques
• Appuyer la sensibilisation des parties prenantessur la Convention des NU sur les eaux parta-gées. Groupes cibles potentiels : hauts cadresdes ministères en charge de l’eau et des orga-nismes de bassins ; parlementaires
• Appuyer les recherches sur l’opérationnalisationpratique de certaines des dispositions de laConvention : exemple mécanisme de la concer-tation préalable ; processus de négociation ;
• Appuyer dans la sous-région la mise en œuvrepar l’UNESCO des acquis de l’initiative PCCP(du conflit potentiel à la coopération potentielle)
Modalités de mis en œuvre
En ce qui concerne la Convention des NU sur les

61
eaux partagées, il est à noter qu’en partenariatavec l’UNESCO et avec l’appui financier partiel deWWF, le GWP/WAWP est entrain de faire l’état deslieux sur les contraintes à la ratification de laConvention en Afrique de l’Ouest. Il s’agit ensuited’appuyer le processus de recherche des moyenspour lever les contraintes, notamment par la sensi-bilisation, en ciblant par exemple les parlementai-res et les responsables des Ministères en chargede l’eau ainsi que ceux des organismes de bassin.Il s’agira ensuite d’encourager et d’aider à l’appro-fondissement de la réflexion sur certaines des dis-positions de la Convention afin de rendre leur miseen œuvre effective plus facile. Eg : processus denégociation et donc de prévention des conflits ;mesures et étapes spécifiques à suivre en ce quiconcerne la concertation préalablement entre Etatsriverains concernés lorsqu’une intervention d’en-vergure est envisagée dans le bassin partagé. Lesoutils développés par l’initiative PCCP du pro-gramme hydrologique international de l’UNESCOpeuvent être mis à profit dans le cadre du plaidoyeret servir pour le renforcement des capacités enmatière de prévention et résolution de conflits liésà l’eau.
4.4.5 Mesures institutionnelles d’ac-compagnement pour favoriser lesinvestissements de valorisation desterres à des fins d’adaptationUne des contraintes majeures à la réalisation d’in-vestissements durables de valorisation des terresreste l’insécurité foncière. Dans la plupart des paysouest-africains la loi foncière ne reconnaît pas l’ap-propriation privative de la terre qui souvent estconsidérée comme propriété de la nation gérée parl’Etat. Dans les années récentes avec la décentra-lisation, les collectivités locales ont été responsabi-lisées dans la gestion des terres par la délégationde pouvoirs plus ou moins étendus. Du fait de lapersistance des coutumes foncières et de l’autoritédes chefs traditionnels, il existe parfois une plura-lité juridique qui ne garantit la sécurité ni auxayants droit traditionnels ni aux affectataires par ledroit moderne4.
Mesures spécifiques
• Encourager la relecture des lois foncières exis-tantes pour permettre une meilleure connais-sance des contraintes éventuelles à la mise en
œuvre des terres et à la réalisation d’interven-tions d’adaptation aux aléas climatiques
• Promouvoir des arrangements sociaux, juridi-ques et institutionnels permettant d’assurer lasécurisation foncière nécessaire aux investisse-ments de gestion durable des terres et des eaux
Modalités de mise en œuvre
Les processus de relecture des codes fonciers etdomaniaux, les réformes agraires et agro-pasto-raux, etc. sont des opportunités de prendre encompte la nécessité de la sécurisation foncière.Des perspectives de solution à la question desécurisation existent dans le cadre des conven-tions foncières locales qui essaient de prendre encompte et mettre en cohérence le droit fonciermoderne et les coutumes et pratiques foncièreslocales. Beaucoup d’ONG et de partenaires (IIED,GTZ, etc.) expérimentent çà et là ces types deconventions, et peuvent être mises à contribution(Hilhorst et al. 1999; Kirsch-Jung, 2003).
4.4.6 Mesures institutionnelles pourassurer l’amélioration/protection de laqualité de l’eau
La dégradation de la qualité de l’eau induite par leclimat s’explique par la prolifération des végétauxenvahissants (salade d'eau, jacinthe d'eau, typha,etc.). Les conditions favorables aux végétauxenvahissants sont créées par la baisse des niveauxd'écoulement, par le réchauffement et par l'eutro-phisation, ce qui réduit la vitesse de propagationdes débits et fait parfois que l'eau est par endroitsdans un état de quasi-stagnation. Les végétauxflottants entravent la pêche, la navigation, le fonc-tionnement des aménagements hydro agricoles ethydro-électriques et constituent un milieu favora-ble à la multiplication des vecteurs, des maladieshydriques comme le paludisme. Ces végétauxenvahissants asphyxient plusieurs plans d'eau dela région, y compris des zones humides dont ladiversité biologique est reconnue d'importancemondiale. La prolifération des jacinthes d'eau a étéobservée dans le sous-bassin de l’Oti dans la Voltaet la typha dans le bassin du Komadugu Yobe(nord Nigeria, et en particulier dans le lac Nguruclassé site RAMSAR). En amont du barrage deDIAMA à l'embouchure du fleuve Sénégal et doncaux abords des sites RAMSAR du Djoudj et duDiawling, l'expansion du typha a été comparée à
4 Dans certains pays tels que le Mali, il semble que la reconnaissance des coutumes et autorités foncières locales permet d’éviter ou d’atténuer les problèmesfonciers tout en assurant une légitimité des droits fonciers

62
une «moquette géante » déroulée sur le fleuve. Enoutre les rejets dans le fleuve, des eaux usées pro-duites par les industries, les sites d’exploitationminière, par les grandes agglomérations ainsi quel'usage de plus en plus croissant des intrants agri-coles contribuent dangereusement à la dégrada-tion de la qualité des eaux et à la prolifération desmaladies liées à l'eau.
Mesures spécifiques
• Aide à la définition et/ou au respect des normesnationales de qualité des eaux
• Aider à la prise en compte et/ou au respect duprincipe pollueur-payeur dans les textes régis-sant la gestion et l’utilisation des ressources eneau,
• Soutien à la construction des stations d’épura-tion des eaux d’égout et des eaux usées
• Renforcement des capacités matérielles,humaines et financières pour la conduite d’ac-tions de suivi et de protection de la qualité del’eau
Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre de cette action nécessite l’impli-cation des laboratoires d’analyse de qualité deseaux qui doivent au besoin bénéficier de l’appuinécessaire (formation, équipement et autresmoyens logistiques) pour réaliser leur tâche. Lesministères en charge de l’eau, de la santé, de l’en-vironnement, de l’industrie et énergie jouent un rôlede premier plan dans la mise en œuvre de cetteaction. Des organismes internationaux spécialiséstels que l’OMS, le GEMS, AIEA peuvent appuyeraux plans technique et financier la mise en œuvrede cette action.
4.4.7 Appuyer la mise en œuvre des PANA
Beaucoup de Plans élaborés dans le passé enAfrique (désertification, environnement) et qui onteu à mobiliser des ressources financières et humai-nes considérables dorment aujourd’hui dans lestiroirs. Il faut éviter que la même chose arrivent auxPANA (Plans d’Action National D’Adaptation auChangement Climatique). Pour appuyer les Paysles Moins Avancés (PMA) dans l’élaboration de cesplans, il a été mis en place un fonds dans le cadrede la Convention Cadre des Nations Unies sur leChangement Climatique. Les PANA sont censés
identifier les besoins les plus urgents des paysconcernés (les PMA) pour s’adapter aux menacesactuelles liées à la variabilité climatique, avec l’ob-jectif que les mêmes mesures aideront ces pays àaccroître leur capacité d’adaptation au change-ment climatique. Pour le financement de la mise enœuvre des PANA, une fois formulés il est prévu unfonds fiduciaire (Trust Fund) à cet effet. Tous lespays de l’Afrique de l’Ouest font partie des PMA àl’exception de la Côte d’Ivoire, du Ghana et duNigeria et sont donc appuyés dans la formulationde leur PANA. Parmi les pays ouest-africainsconcernés, seule la Mauritanie avait soumis sonPANA en juin 20065. Les autres PMA de la régiondevraient le faire avant fin 2007. Il se posera alorsle problème de la mobilisation des ressourceshumaines et financières pour la mise en œuvre deces Plans.
Actions spécifiques
• Aider les Etats dans l’identification de ressour-ces financières internes afin d’accroître leurcapacité d’autofinancement des PANA
• Explorer les possibilités de mobilisation de res-sources financières en faveur des PANA à partirdes échanges de droits d’émission des GES
• Accroître la capacité des Etats ouest-africainsconcernés à accéder aux ressources financiè-res du Trust Fund
Modalités de mise en œuvre
L’existence du Trust Fund est une bonne chose,mais il est aussi important d’appuyer les Etatspotentiellement bénéficiaires dans la formulationde projets éligibles à ce fonds. Mieux encore, il estimportant d’identifier des fonds additionnels pourmettre en œuvre les mesures prioritaires retenuesdans les PANA. Les possibilités offertes dans lecadre du mécanisme d’échanges de droits d’émis-sions de gaz à effets de serre semblent sous utili-sées en Afrique de l’Ouest. Par la sensibilisationdes décideurs et experts du secteur de l’eau et del’environnement au sein des Etats et des organis-mes de bassins, on peut améliorer de façon subs-tantielle l’accès à des opportunités telles que leTrust Fund d’adaptation au changement climatiqueet le Mécanisme de Développement Propre.
5 Il serait utile de voir dans quelle mesure ces PANA prennent en compte les préoccupations et suggestions faites dans le présent papier

63
4.4.8 Intégrer le changement climati-que et prendre en compte les normesinternationales dans la planification etla mise en œuvre des grandes infra-structures hydrauliques
Au moment où un consensus grandissant se formeen ce qui concerne les grandes lignes de l’évolu-tion futur du climat, rien n’indique que le facteur «changement climatique » est pleinement pris enconsidération dans la planification, la conceptionet l’exploitation des programmes et projets hydrau-liques et hydro-agricoles majeurs de l’Afrique del’Ouest. Pourtant, la viabilité économique et finan-cière de même que le bien-fondé social et environ-nemental d’un grand barrage envisagé dans lecontexte actuel de l’Afrique de l’Ouest peuvent êtremis en doute si on n’a pas pris en compte et misen facteur la probabilité de la réduction drastiquedes débits moyens des fleuves ainsi que l’augmen-tation de la fréquence et de l’amplitude des évène-ments extrêmes (sécheresses et inondations). Lechangement climatique doit donc être considérécomme un des paramètres clé à prendre encompte dans les études de faisabilité des projetshydro-agricoles ou autres ciblant les bassins flu-viaux de l’Afrique de l’Ouest. De même, les mesu-res d’adaptation préconisées doivent être rigoureu-sement analysées et évaluées au regard des inter-actions complexes pouvant résulter de leur miseen œuvre : des barrages comme ceux deDIAMA/MANANTALI sur le Fleuve Sénégal, et deMaga, Tiga dans le bassin du Lac Tchad qui ont étéconçus comme réponses à la vulnérabilité auxaléas climatiques et à la désertification ont eu desimpacts non désirés sur l’écosystème, la santé etparfois les conditions de vie de certaines despopulations riveraines. De même pour les petits etmoyens ouvrages, il y a lieu en Afrique de l’ouestde revoir les normes de conception actuellementutilisées qui datent des années 60. En effet lesconditions climatiques et environnementales ontdepuis beaucoup dans la sous-région. Ces chan-gements ont des conséquences sur les différentsouvrages (rupture, ensablement, etc.). Il est indis-pensable et urgent de proposer des nouvelles nor-mes pour la conception des ouvrages hydrauliqueset petite et moyenne tailles.
Actions spécifiques
• Considérer le changement climatique comme undes critères majeurs d’analyse de faisabilité desprojets hydro-électriques et hydro-agricoles ;
• Promouvoir le respect des normes internationa-les dans la planification, construction et exploi-tation des grands barrages ;
• Mobiliser les partenaires au développementpour monter un grand programme hydrologiqueen Afrique de l’Ouest avec pour finalité de dis-poser des nouvelles données pour proposerdes nouvelles normes remplaçant celles desannées 1960 de conception des ouvrageshydrauliques.
Modalités de mise en œuvre
Pour la mise en œuvre des actions spécifiquessuggérées il est important de commencer par faireune revue critique des approches actuelles d’ap-probation des projets hydro-agricoles et hydro-électriques à la lumière des perspectives climati-ques de la région. Les bailleurs de fonds jouant unrôle de premier plan dans les procédures adoptéespar les Etats et les organismes de bassins del’Afrique de l’Ouest, il s’agira de faire la revue desprocédures des principaux bailleurs (BanqueMondiale, BAD, PNUD, UE, ACDI, AFD, ASDI,DGIS, …) et analyser le niveau de respect de cesdirectives dans le cadre de projets récents enAfrique de l’Ouest. Les résultats de cette revuepeuvent servir de base pour engager la réflexion etles activités de sensibilisation. Dans la mesure oùelles sont inspirées entre autres par des préoccu-pations environnementales et d’équité, le niveaude respect des directives de la CommissionMondiale des Barrages sera aussi pris en comptedans la revue des procédures actuelles. L’UNESCOà travers son programme hydrologique internatio-nal pourrait prendre le leadership pour la mobilisa-tion de tous les partenaires pour la préparation etla mise en œuvre d’un tel programme.
4.4.9 Réglementation de l’occupationet d’utilisation de l’espace selon lesniveaux de vulnérabilité aux risquesd’inondation
Du fait de la réduction des débits moyens, la varia-bilité actuelle et le changement climatiqueannoncé, encouragent de nouvelles formes d’oc-cupation et d’exploitation des berges des fleuveset des bas-fonds. Les zones de culture et mêmeles habitations pérennes tendent à occuper lesparties de plus en plus basses des rives et bassinsfluviaux. Ce processus est même accentué dansdes contextes où des barrages sont construits en

64
amont. Ces ouvrages qui sont censés régulariserles débits des fleuves offrent le sentiment de sécu-rité aux occupants des terres basses des bassinsfluviaux. Mais on sait aussi que certaines des mani-festations de la variabilité climatique actuelles sontl’augmentation de l’ampleur et de la fréquence desévènements climatiques extrêmes : sécheresses etcrues dévastatrices. Ces manifestations devronts’intensifier avec le changement climatique. Siaucune mesure préventive n’est prise, les inonda-tions futures vont être plus dévastatrices du pointde vue de leurs impacts sociaux et économiques.
Actions spécifiques
• Identifier et/ou mettre à jour et cartographier leszones les plus exposées aux risques d’inonda-tions dans chacun des principaux bassins flu-viaux de la région ;
• Réglementer les usages et l’occupation dessols selon les niveaux d’exposition aux risquesclimatiques (inondations en particulier) ;
• Mettre en place et/ou mettre à jour le pland’alerte inondation ;
• Appuyer une implication plus active de la sous-région dans la mise en œuvre de l’initiative inter-nationale sur les inondations coordonnée parl’UNESCO et l’OMM.
Modalités de mise en œuvre
La première action spécifique envisagée ici n’estpas à proprement parler une mesure institution-nelle mais se rapporte davantage à la connais-sance de l’évolution du climat et de ses impacts.Le travail d’identification et de cartographie deszones à risques peut être l’initiative des organis-mes de bassin en collaboration avec les institu-tions spécialisées dans le suivi de l’environnement(comme le Centre de Suivi Ecologique au Sénégal).L’expertise de juristes est nécessaire pour aiderdans la formulation du règlement des usages etoccupation des zones à risques. Il est à noter quel’une des activités de la composante 2 du ProjetFEM-Bassin du Fleuve Sénégal actuellement encours d’exécution concerne la conception d’unsystème d’alerte précoce pour les inondationsdans le haut bassin du fleuve Sénégal. On pourraitenvisager de s’appuyer sur les résultats de cetteactivité pour lancer un plan d’alerte pour l’ensem-ble de ce bassin prenant en compte les perspecti-ves climatiques. En prenant en compte cette expé-rience, celle de l’ABN et celle d’AGRHYMET (en cequi concerne la pluviométrie), on devrait pouvoirdisposer de suffisamment d’éléments permettantd’aider à concevoir des plans d’alerte inondationdans les principaux bassins de la région en prenant
en compte les informations les plus récentes sur laprobabilité d’évolution du climat ouest-africain. Les partenaires au développement pourraientappuyer à travers des projets pilotes sur la maîtrisedes inondations en Afrique de l’Ouest (Cas des vil-les comme Niamey, Bamako, Dakar,..) à prendre encompte dans le cadre de l’initiative internationaleUNESCO-OMM sur les inondations.
Conclusions -Recommandations
Les perturbations que connaît le climat ouest-afri-cain au cours des dernières décennies devraients’accentuer au cours des prochaines années dufait du changement climatique. Au vu de ces pers-pectives, les réponses politiques et institutionnel-les jusqu’ici apportées à la variabilité climatique neseront plus suffisantes. Il sera nécessaire de ren-forcer et diversifier ces réponses en vue d’atténuerle niveau de vulnérabilité l’Afrique de l’Afrique del’Ouest aux impacts du changement climatique.Une attention particulière devra être portée sur lapromotion de la bonne gouvernance des ressour-ces en eau par la GIRE et par la mise en place demécanismes de prévention et de résolution desconflits autour des ressources en eau partagées.La protection des zones humides et autres écosys-tèmes sensibles tels que le massif du FOUTAHDJALLON devra faire partie des axes prioritairesd’intervention. Les mesures institutionnelles et juri-diques appropriées devront être envisagées pourprotéger la qualité des eaux, pour réduire les ris-ques liées aux inondations, et pour assurer unemeilleure sécurité foncière afin de favoriser lesinvestissements d’adaptation au changement cli-matique. Il sera aussi nécessaire de penser dès àprésent à la mobilisation des ressources financiè-res requises pour la mise en ouvre effective desPANA en cours de finalisation dans la plupart despays de l’Afrique de l’Ouest. Enfin, il devient impor-tant de prendre en compte le changement climati-que parmi les critères d’analyse de faisabilité desprogrammes et projets de développement, en par-ticulier dans le secteur de l’eau.

65
Actions prévues Activités Echelle Institutions concernées
1. Appui aux processusd’élaboration et de miseen œuvre des plansnationaux GIRE(PAGIRE)
• Appui technique et à la mobilisationpour mise en œuvre PAGIRE déjàélaborés (Burkina).
• Appui dans la formulation et mise enœuvre de PAGIRE en cours d’élabora-tion (Sénégal, Mali, Bénin et Cap Vert)
• Sensibiliser les autres pays à s’en-gager dans la formulation de PAGIREet les assister dans la recherche departenaires techniques et financiers
• Promotion de la prise en compte et dufinancement de la GIRE et de mesuresd’adaptation au CC dans lesDocuments de Stratégie de Réductionde la Pauvreté
National Ministères en charge del’eauGWPUCREEquipes chargés élaboration DSRP
2. Appui aux Etats pourune mise en œuvreeffective de laConvention RAMSARpermettant la conserva-tion et gestion durabledes zones humides
• Assistance dans inventaire des zoneshumides et classement de sites deszones humides en sites RAMSAR
• Appui dans restauration et conserva-tion de zones humides jouant un rôleparticulier d’atténuation des impacts duchangement climatique.
• Promouvoir l’écohydrologie pour lagestion des zones humides
NationalBassinsfluviaux
Ministères en charge del’EnvironnementOrganismes de bassins(OMVS, ABN, OMVG,ABV, CBLT)UICN, WWF, WIUNESCO (PHI, MAB)
3. Appui à la finalisation età la mise en œuvre dela Convention Cadreentre les Etats mem-bres du Programmed’Aménagement Intégrédu Massif du FOUTAHDJALLON
• Sensibilisation et appui pour accéléreradoption et mise en œuvre ConventionCadre sur le Massif du FOUTAH DJAL-LON
• Appui à organismes de bassin pourharmoniser approches sur le Massif duFOUTAH DJALLON
Régional
Régional
Les 6 Etats partiesprenantes de l’Accord ABN, OMVS, OMVG, MRUBureau UA pour le MFD
4. Promotion de la ratifica-tion et mise en œuvreConvention des NU surles eaux partagées
• Sensibilisation sur la Convention desNU sur les eaux partagées.
• Recherches sur l’opérationnalisationpratique de certaines des dispositionsde la Convention (mécanisme de laconcertation préalable ; processus denégociation)
• Appuyer la valorisation des outilsPCCP en Afrique de l’Ouest
Régional Ministères en charge del’eauParlementsOrganismes de bassins(OMVS, ABN, OMVG,ABV, CBLT)GWPUNESCOCEDEAO (UCRE)WWF
ANNEXE : Synthèse des mesures institutionnelles préconisées
Tableau: Organismes de bassins autour des grand cours d’eau de l’Afrique de l’Afrique

66
Actions prévues Activités Echelle Institutions concernées
5. Mesures institution-nelles d’accompagne-ment pour favoriser lesinvestissements de val-orisation des terres àdes fins d’adaptation
• Relecture des lois foncières existantes• Promotion arrangements sociaux,
juridiques et institutionnels permettantd’assurer la sécurisation foncière
NationalRégional
Ministères chargés desréformes foncièresMinistères chargés desressources en eauMinistères de l’agricultureet de l’élevageParlementairesCollectivités localesLandNet (Land NetworkWest Africa)IIED
6. Mesures institution-nelles pour assurerl’amélioration/protectionde la qualité de l’eau
• Définition et/ou respect des normesnationales de qualité des eaux
• Prise en compte et/ou respect duprincipe pollueur-payeur
• Soutien à la construction des stationsd’épuration des eaux d’égout et deseaux usées
• Renforcement des capacités de con-trôle de et protection
NationalBassins flu-viaux
Ministères en charge del’environnementParlementsLaboratoires d’analyse dela qualité de l’eauOrganismes de bassinOMSGEMSAIEA
7. Appui à la mise enœuvre des PANA
• Identification de ressources financièresinternes pour accroître capacité d’auto-financement des PANA par les Etats
• Mobilisation de ressources financièresen faveur des PANA à partir deséchanges de droits d’émission des GES
• Accroître la capacité des Etats ouest-africains concernés à accéder auxressources financières du Trust Fund
National
Bassinsfluviaux
Ministères en charge del’environnementPoints focaux nationauxCCOrganismes de bassinCCNUCC
8. Intégration du change-ment climatique et priseen compte les normesinternationales dans laplanification et la miseen œuvre des grandesinfrastructureshydrauliques
• Prise en compte changement clima-tique comme un des critères majeursd’analyse de faisabilité des projetshydro-électriques et hydro-agricoles
• Respect des normes internationalesdans la planification, construction etexploitation des grands barrages
• Proposition des nouvelles normes pourla conception des ouvrageshydrauliques de petite à moyenne taille
NationalBassins flu-viauxRégional
Ministères en charge del’Environnement et de l’EauParlementsOrganismes de bassins(OMVS, ABN, OMVG,CBLT, ABV)Bailleurs de fonds (BM,BAD, UE, AFD, PNUD,DGIS, ACDI, ASDI, etc..)UNEP/Dams andDevelopment ProjectUNESCO, OMM
9. Réglementation de l’oc-cupation et d’utilisationde l’espace selon lesniveaux de vulnérabilitéaux risques d’inondation
• Identification/mise à jour/ cartographiezones exposées aux risques d’inonda-tions
• Réglementation usages et occupationdes zones à risques
• Mise en place et/ou mise à jour pland’alerte inondation
• Appui pour une implication de la sous-région dans l’initiative internationalesur les inondations
NationalBassins flu-viaux
Ministères en charge del’eauOrganismes de bassin(OMVS, OMVG, ABN,CBLT, ABV)AGRHYMET
UNESCO, OMM

67


69
RésuméLes documents précédents ont traités des effetspotentiels des changements climatiques sur lebilan hydrologique dans la région Ouest Africaine,des adaptations concrètes possibles au niveau desbassins versants régionaux et communautés loca-les, et du point de vue institutionnel.
Ce document, le dernier de la série, traite desactions concrètes dans le domaine du renforce-ment des capacités nécessaire à réaliser ces adap-tations. Ce renforcement des capacités concerneles ressources humaines, plus précisément, lesconnaissances et compétences individuelles etinstitutionnelles.
En prenant les adaptations définies dans les autrespapiers comme un point de départ, ce papieressaye de définir les actions concrètes appropriéesdans le cadre de renforcement des capacités. Ilidentifie les cibles à renforcer et leurs besoins dansdifférentes catégories de renforcement tels que lasensibilisation, la formation, les équipements et lesoutils techniques, le cadre juridique et administra-tif, le financement et l’échange d’informations.Dans l’ensemble, ces actions constituent le soutiennécessaire à réaliser les adaptations aux variabili-tés et changements climatiques potentiels propo-sées dans les autres papiers de la série.
Mots clés : Afrique de l’ouest, changement clima-tique, adaptation, renforcement de la capacité
5.1 Introduction
Le premier papier de la série, intitulé « Impacts duchangement et de la variabilité climatique sur lesressources en eau des bassins versants OuestAfricains : Quelles perspectives ? » décrit les effets
potentiels des futurs régimes climatiques et hydro-logiques dans la région. Bien, que la plupart desscénarios climatiques prévoient dans la sous-région une diminution des précipitations qui variede 0,5 à 40% avec une moyenne de 10 à 20% pourles horizons 2025, il existe des incertitudes impor-tantes sur ces prévisions. Aussi, des décalages destructure de saison pourraient être observés danscertaines parties. Les conséquences de ces chan-gements sur les bilans hydrologiques annuels dansla sous-région pourraient être une baisse desdébits des fleuves allant de 5 à plus de 34% selonles horizons de temps et les pays. Là aussi lesincertitudes sont très grandes. Pour ces mêmeschangements, on devrait assister à une baisse duniveau des nappes phréatiques. Malgré les diffé-rentes incertitudes, il est cependant reconnu queles fréquences et intensités des phénomènesextrêmes (sécheresses et inondations) vont se ren-forcer dans les années à venir. Il faudrait donc s'at-tendre et se préparer à une exacerbation des extrê-mes climatiques dans la sous-région.En réponse à ces changements, les deuxième ettroisième documents de la série ont essayé dedéfinir les adaptations concrètes potentielles quipermettent de protéger les systèmes socio-écono-miques et écologiques vulnérables et sensiblescontre les effets néfastes des changements clima-tiques. Ces adaptations répondent aux conditionsau niveau des bassins versants régionaux (2ièmepapier), qui sont souvent des bassins versantsinternationaux, et aux stratégies d’adaptation auniveau des communautés locales (3ième papier).Prenant les adaptations proposées comme pointde départ, le quatrième document propose lesadaptations politiques et institutionnelles aux diffé-rentes échelles, nécessaires pour créer un environ-nement favorable á leur mise en œuvre.
La motivation de ce dernier document de la sérieest la supposition que ces adaptations, physiquesaussi bien que institutionnelles, ne peuvent pas se
Chapitre V : Actions concrètes potentielles à renforcerles capacités en Afrique de l’Ouest à intégrer
l’Adaptation aux changements climatiques dans la gestion des ressources en eau à plusieurs échelles
Par: David PURKEY (SEI, USA) (Writer), Mouhamed el Moctar OULD MOHAMED (Ministère Hydraulique,Mauritanie), B Eustache BOKONO NGANTA (Université d’Abomey, Bénin), Bassirou DIAGANA (Ministrel’Hydraulique, Mauritanie), Miranda VERBURG (ETC, The Netherlands), Léopold SOME (InstitutEnvironnement Recherches Agricoles, Burkina Faso), Baye FALL (Programme Changements Climatiques,Mauritanie)

70
réaliser elles-mêmes sans un effort de renforcer lacapacité humaine à répondre aux fortes pressionsliées aux changements climatiques dans le cadrede la gestion de l’eau. Le challenge est ici de défi-nir les actions dans le domaine du renforcementdes capacités qui faciliteront leur réalisation. Pourse faire deux questions primaires sont à poser :
• La capacité de qui doit être renforcée ?• Par quelles mesures sera-t-elle renforcée ?
Les réponses á ces questions suggéreront lescibles des actions du renforcement des capacitéset les catégories des actions appropriées.
Une brève discussion est présentée sur la situationactuelle du comportement régional envers la ges-tion de l’eau qui motive une définition des ciblespour le renforcement des capacités face aux chan-gements climatiques. Il est par la suite défini diffé-rentes catégories d’actions nécessaires pour ren-forcer les capacités de ces acteurs pour la mise en?uvre des adaptations proposées. Les adaptationsprioritaires considérées dans les autres papiers dela série sont présentées. Il est par la suite proposéun tableau organisé pour aider à définir les actionsconcrètes de renforcement des capacités qui sou-tiendront les populations ciblées pour une actiond’adaptation donnée. Un exemple est présenté surla manière de renseigner les différentes rubriquesdu tableau pour une adaptation prioritaire (letableau est rempli pour chacune des adaptationsprioritaires proposées aux niveaux des autrespapiers. Les différents tableaux se trouvent enannexe). Enfin des recommandations sont pré-sentées.
5.2 Comportement actuelenvers la gestion des ressour-ces en eau en Afrique del’Ouest et son adaptationpotentielle aux changementsclimatiques
Depuis une quarantaine d’années, l’Afrique del’Ouest est soumise à des périodes successives desécheresse rendant vulnérables les ressources eneau disponibles. Cette situation, qui a affecté sen-siblement les conditions environnementales, aconduit aux concepts de la disponibilité, l’accessi-bilité et le renouvellement dans la gestion régionale
des ressources en eau. Même si ces concepts nefigurent pas intégralement dans toutes actionsrégionales de planification et d’utilisation des res-sources en eau, où certaines décisions se posenttoujours sur les impératifs individuels et immédiats,la prise en compte de ces nouveaux facteurs tendvers une politique de gestion durable qui pourraitbien se conformer á l’adaptation aux changementsclimatiques, et les autres pressions jouant sur lagestion des ressources en eau dans la région, tels que :
• L’augmentation et de l évolution démographique ; • Le développement et la modernisation de
l’agriculture ; • Le développement des industries extractives ;• La mise en valeur des services fournis par les
écosystèmes aquatiques.
La considération de l’ensemble de ces pressionsen vue des nouveaux concepts de la disponibilité,l’accessibilité et du renouvellement, a abouti ádeux axes fondamentaux pour la gestion future del’eau en Afrique Occidentale.
Adapter les besoins aux ressourcesCela suppose une connaissance des ressources eneau tant quantitativement que qualitativement etgéographiquement afin de bien couvrir les besoinsprévus avec les stocks disponibles. Or, au stadeactuel de l’état des connaissances, des lacunessubsistent.
Adapter les ressources en eau aux besoinsCela suppose une maîtrise suffisante des ressour-ces en eau pour satisfaire les besoins prévus quicroissent par ailleurs exponentiellement.
De ces deux axes, il s’impose une conceptionhybride pour adapter la gestion des ressources eneau aux changements climatiques. Il est fonda-mental de tenir beaucoup compte de l’adéquationdes ressources en eau mobilisables vis-à-vis desbesoins d’une part et d’autre part de l’adéquationde la gestion des ressources en eau proposée vis-à-vis des futures pressions, y compris les change-ments climatiques. Cela suggère que le renforce-ment de capacité doit suivre une stratégie d’appro-fondissement de la connaissance de la ressourceet de l’amélioration de sa mise en valeur.

71
5.3 Identifications des ciblespour le renforcement de capacité
Les principaux groupes de cibles á renforcer sontprésentés ci-après. En fonction des niveaux et desobjectifs, les stratégies de renforcement des capa-cités des différentes cibles devront être adaptées.Les groupes de cibles sont :
Services de l’EtatDes services techniques qui ont la charge de laprogrammation et des activités des différentsMinistères et Institutions rattachées intervenantdans le secteur de l’eau et de l’assainissement.
Entreprises privées (par exemple, société,chambres de commerce, associations profes-sionnelles)Des intervenants privés autre que les services éta-tiques qui opèrent dans le secteur de l’eau et del’assainissement.
Les décideurs politiques (par exemple, conseil-lers, maires, parlementaires, sénateurs, mem-bres de gouvernements)Les élus qui répondent au nom de la population àdifférents niveaux politiques ou administratifs.
Les mediasLes cadres de la télévision, de la radio, des jour-naux étatiques et privés qui diffusent des informa-tions sensibles en particulier en rapport avec lesecteur de l’eau et de l’assainissement.
Les ONG et les associations de baseLes acteurs qui interviennent á différentes échellesau niveau de la population aussi bien dans le sec-teur de l’eau et de l’assainissement que dans laprotection des ressources naturelles en général.
Les communautésLes populations qui travaillent sur le terrain etmènent des activités pour leur bien être, leur survieoù a but lucratif, en particulier les activités quidépendent de l’eau et des écosystèmes aquati-ques.
Les universités, les centres de recherche, etles collèges techniquesLes centres d’excellence qui s’occupent desaspects techniques, des recherches pour la bonnecompréhension des aspects ou phénomènes natu-rels, principalement en rapport avec l’eau et lesécosystèmes aquatiques.
Les organismes intergouvernementaux del’Afrique de l’OuestCentres par excellence de renforcement des capa-cités et de coopérations sous-régionales surtoutceux qui interviennent dans le domaine du climat,de l’eau et de la gestion des bassins régionaux.
5.4 Définition des catégoriesd’actions de renforcement descapacités
Dans le cadre de l’adaptation de la gestion des res-sources en eau aux changements climatiques enAfrique de l’Ouest, plusieurs actions peuvent êtreenvisagées et ce, en fonction des différentescibles. Globalement on peut regrouper ces actionspar catégories comme suit :
• La sensibilisation, l’information et la communi-cation ;
• La formation et le développement des connais-sances de base ;
• Les équipements et outils techniques ;• Le cadre juridique et administratif ;• La mobilisation des financements ;• La coopération et les échanges d’information.
La sensibilisation, l’information et la communi-cationLa question des changements climatiques et deses impacts, malgré le quatrième rapport du GIEC,ne semble pas encore avoir convaincu certainsdécideurs. En Afrique de l’Ouest, en dépit de l’im-portance du problème et de ses effets pervers, sur-tout en rapport avec la gestion des ressources eneau, reste peu intégré dans les stratégies et politi-ques de développement. C’est pourquoi il estencore aujourd’hui indispensable d’exploiter lescanaux traditionnels de sensibilisation, d’informa-tion et de communication tels que :
• Petits documentaires• Plaquettes• Affiches• Emissions radiotélévisée• Livre pour enfants• Atelier de sensibilisation
Cependant, ces supports des messages devrontêtre orientes vers une véritable éducation relative ál’eau dans tous ses compartiments.
Mais au-delà de ces canaux classiques pour l’édu-cation sur l’eau, il faudra innover selon les cibles et

72
suivant une stratégie de proximité, intégrer les nou-veaux canaux ouvert spécifiquement à la transmis-sion de données et informations sur les change-ments climatiques. Par exemple, pour les déci-deurs (cadres techniques d’Etat, parlementairesetc.), il conviendrait de privilégier des contactsinformationnels périodiques afin de leur assurerune meilleure compréhension sur la science et lapolitique des changements climatiques avant levote des lois et autres décisions au niveau desdirections techniques des ministères.
La formation et le développement des connais-sances de baseLe constat est que les programmes éducatifs onttrès peu intégré les questions relatives aux chan-gements climatiques, á telle enseigne qu’on peutcraindre que les gestionnaires de demain ne puis-sent être aussi sceptiques que certains d’au-jourd’hui quant á la problématique des change-ments climatiques et a leurs effets pervers. Il y adonc urgence, si l’Afrique de l’ouest veut mieuxs’investir dans le processus du développementdurable, de créer des modules de formation á tousniveaux qui traitent des impacts potentiels deschangements climatiques notamment sur la ges-tion d’eau. Il convient donc et dès aujourd’hui,dans les cursus académiques des universités,Ecoles techniques, et dans le cadre de stages pro-fessionnels, que soient introduits des modulesrelatifs á une meilleure connaissance de cettequestion afin de produire des gestionnaires et desdécideurs plus avertis á la menace potentielle deschangements climatiques. A titre indicatifs, quel-ques propositions sont formulées ci-après.
Stages de 1 à 3 mois• Modélisation de ressources en eau sur les bas-
sins versants• Gestion des bases de données• Harmonisation de la collecte et de l’archivage
des données sur les ressources en eau• Vulnérabilité et adaptation des ressources en
eau face aux changements climatiques• Aspects juridiques de la gestion de ressources
en eau• Changements climatiques et développement
durable• Transfert d’informations techniques aux com-
munautés
Curricula universitaires• Gestion intégrée des ressources en eau• Eau et développement local• Eau et assainissement• Modélisation numérique et SIG pour les
ressources en eau
Mémoire, thèses, études expérimentales• Technologie appropriée dans la gestion et
conservation des eaux• Aménagement des bassins versants• Réhabilitation des bassins versants
Les propositions ci-dessus sont loin d’être exhaus-tives et devront être adaptées selon les spécificitésdes cibles á renforcer et les objectifs spécifiquesde la formation. Elles donnent, néanmoins uncanevas pouvant servir de point de départ.
Les équipements et outils techniques La bonne gestion des ressources en eau suppose,parmi outre, l’existence des données de base, deséquipements d’observation, des outils d’analysedes équipements d’alerte rapide, et des ressourceshumaines qualifiées. Or, d’après plusieurs évalua-tions en Afrique de l’Ouest on peut constater :
• Une obsolescence des équipements et réseauxd’observation ;
• Un relâchement des réseaux dû á des stationsen panne qui ne sont pas remplacées ;
• Une absence et ou faiblesse de bases de données ;
• Un mauvais archivage des données existantes ;• Une faible mise en valeur des données pour les
analyses et la recherche• Un vieillissement du personnel d’observations
climatiques ;
Il est vrai que même si la question de la collecte etde l’archivage des données primaires est du res-sort des Etats, des questions plus urgentes deréduction de la pauvreté et des catastrophes natu-relles (sécheresse, inondation, crises alimentairesetc.) contraignent les gouvernements à ne pasconsidérer comme priorité la question importantedes données hydrologiques et piézométriques,hypothéquant ainsi toutes analyses et projections.C’est pourquoi, il est capital de renforcer les capa-cités en équipements et outils techniques, aussibien des services d’Etat que des universités, éco-les techniques, ONG et entreprises privées. Lesditséquipements concernent essentiellement lamétéorologie, l’hydrologie, l’hydrogéologie et lesmoyens de calcul et d’archivage.
Le cadre juridique et administratif Les négociations dans le cadre des différentesConventions des Nations Unies, notamment cellesur les changements climatiques, se déroulentdans un certain contexte juridique bien défini. Ons’aperçoit qu’á l’occasion des COP par exemple,les négociations internationales sont l’objet de pré-paration attentive de la part des pays du Nord qui

73
déploient un véritable lobbying contrairement á laplupart des pays du sud qui sont souvent malreprésentés et peu aguerris aux techniques denégociation. Il convient alors d’appuyer les repré-sentants des Etats de la sous-région Ouest afri-caine en la matière (points focaux des conventions,cadres des ministères techniques participants, auxdites négociations). Par ailleurs il convient d’intro-duire dans les curricula des Ecoles et InstitutsUniversitaires d’Administration et de Droit,, desnotions sur les techniques de négociation.Plusieurs textes juridiques et administratifs ont étéadoptés dans le domaine des ressources en eaupar les Etats de l’Afrique de l’Ouest. Ces textesdevront être partagés et maitrisés par les acteursen vue d’une intégration et harmonisation. Auniveau national ce même renforcement de capacitépeut soutenir une meilleure intégration des chan-gements climatiques dans les décisions sur la poli-tique de l’eau.
La mobilisation des financements La mise en œuvre des actions d’adaptation auxchangements climatiques nécessite bien évidem-ment des financements. Il est indispensable d’ac-croitre la capacité des différents acteurs à pouvoirmobiliser les ressources nécessaires en exploitantles opportunités locales, nationales et internationa-les. Un appui est indispensable dans ce contextepour améliorer l’efficacité des cadres techniquesdes ministères concernés, des entreprises, desONG. Par ailleurs il convient d’introduire dans lescurricula des universités et autres instituts spécia-lisés en économie et planification, des notions surla mobilisation des ressources financières pour lagestion des ressources en eau.
La coopération et les échanges d’information Aucune entité ne peut aujourd’hui évoluer en vaseclos dans le domaine de l’adaptation aux change-ments climatiques, surtout lorsqu’il est question dela gestion de l’eau. C’est pourquoi il est primordialde promouvoir la coopération à tous les niveaux(local, national, régional et international). Le renfor-cement des capacités s’attèlera à créer, à chaqueniveau le cadre adéquat pour valoriser le partena-riat entre les différents acteurs. De même il estnécessaire d’accroitre les possibilités d’échanged’information à tous les niveaux.
5.5 Les adaptations prioritaires
5.5.1 Au niveau des bassins versants
Plusieurs adaptations au niveau des bassins ver-sant ont été proposées dans le deuxième papier decette série. Parmi ces options, les actions ci-aprèssont jugées prioritaires :
• Renforcement et modernisation des réseaux demesure sur les ressources en eau
• Elaboration des outils de planifications, de ges-tion, de prévision qui prennent en compte leschangements climatiques.
• Planifier et exécuter la recherche/développe-ment sur les ouvrages hydrauliques adaptésaux changements climatiques.
5.5.2 Les adaptations prioritaires auniveau des communautés
Plusieurs options d’adaptations prioritaires auniveau communautaire ont été proposé dans letroisième papier de cette série, parmi lesquelles onpeut citer:
• Promotion d’activités génératrices de revenus(maraîchage, cultures de contre saison, aqua-culture, pisciculture, etc.),
• Mise en place de systèmes d’alerte et de ges-tion des inondations,
• Aménagement et réhabilitation des ouvrageshydrauliques.
5.5.3 Aux niveaux institutionnels etpolitiques
Plusieurs adaptations institutionnelles ont été pro-posées dans le quatrième papier de cette série.Parmi elles, les adaptations ci-après sont jugéesprioritaires :
• Appui aux processus d’élaboration et de miseen œuvre des plans nationaux GIRE (PAGIRE ;)
• Appui à l’adoption et/ou mise en œuvre desconventions sur les ressources en eau et lesécosystèmes ;
• Mesures institutionnelles d’accompagnementpour favoriser les investissements de valorisa-tion des terres à des fins d’adaptation

74
5.6 Méthode d’identificationdes actions concrètes pour lerenforcement des capacités
Rappelant l’impérieuse nécessité de renforcementet de développement des capacités, il s’avèrenécessaire de définir une structure logique quitienne compte des différentes cibles á renforcerainsi que les catégories d’intervention à opérer.Ces cibles ainsi que les éléments des catégoriesdéfinies dans les sections précédentes, varient
certainement en fonction de l’action d’adaptationproposée, son échelle, et son profil. Pour unequelconque action d’adaptation, toutes les ciblespeuvent ne pas être concernées par toutes lescatégories du renforcement de capacité préconisé.
Il faudra donc une structure souple qui permettral’identification des catégories d’action nécessaires,pour chaque cible, pour chaque adaptation priori-taire dans le domaine du renforcement des capaci-tés. Le tableau ci-dessous fournit cette structure àl’échelle du bassin versant.
Action : Renforcement et modernisation des réseaux de mesure sur les ressources en eauEchelle : Bassin versantType : Physique
Moyens, Outils
Cible á renforcer : Services de l’Etat
Sensibilisation, informations et communi-cations
Les posters, séances de débriefing, séminaires et ateliers surl’importance des réseaux de surveillance et les rôles des popu-lations dans la collecte des données
Formations et développement de la con-naissance de base
Cours de recyclage, stages de perfectionnement sur l’étatactuels de la technologie d’échantillonnage et l’archivage dedonnées
Equipements et outils techniques Approvisionnement en Equipements d’échantillonnage, logiciel(SIG, bases des données), équipements de transfert de données
Cadre Juridique et administratif Une résolution des questions liées a l’accès aux points d’échan-tillonnage
La mobilisation des financements Etudes sur la disponibilité des ressources a financier les réseauxde mesure, stage sur la préparation des offres
La coopération et les échanges tech-niques
Rencontres internationales sur l’harmonisation des bases dedonnées
Cible á renforcer : Entreprises privées (si elles ont un rôle dans la fourniture des équipements, leursmise en fonctionnement, et l’archivage des données.
Sensibilisation, informations et communi-cations
Foire commerciale sur les opportunités lucratives dans la fourni-ture des équipements d’échantillonnage, leur mise en fonction-nement et le développement et l’entretien des archives informa-tiques.

75
Cible á renforcer : Les décideurs politique
Sensibilisation, informations et communi-cations
Posters et fichiers qui démontrent l’état dégradé des réseauxactuels et les contraintes que cela impose sur la réalisation de lamise en valeur des ressources en eau
Cadre Juridique et administratif Cours de recyclage, stages de perfectionnement sur l’étatactuels de la technologie d’échantillonnage et l’archivage de don-nées
Cible á renforcer : Les medias
Sensibilisation, information et communica-tion
Posters et fichiers qui démontre l’état dégradé du réseaux actuelet les contraintes que cet état impose sur la réalisation de lamise en valeur des ressources en eau
Cible á renforcer : Les ONG et les associations de base (si elles jouent un rôle dans la collecte dedonnées et l’entretien des points d’échantillonnage)
Formations et développement de la con-naissance de base
Formation sur le protocole de collecte de données et les « chainof custody » pour les données recueillis
Equipements et outils techniques Equipment de sondage
Cible á renforcer : Les communautés
Sensibilisation, information et communica-tions
Placettes, émissions radiotélévisées sur la nécessite de ne pasbouleverser les échantillonnages en milieu rural
Cadres Juridique et administratif Règlement des aspects associés à la mise en place des pointsd’échantillonnage en milieu rural et sur la propriété privée.
Cible á renforcer : Les Universités, Centres de Recherche, et Collèges Techniques
Formations et développement de la con-naissance de base
Curricula sur les traitements et analyses des données clima-tiques et hydrologiques. Recherche sur les équipements d’échan-tillonnage appropriés en milieu Ouest-Africain
Equipements et outils techniques Ordinateurs, laboratoire mécanique
La mobilisation des financements Aide avec la préparation des offres pour la recherche scientifiqueen Afrique
La coopération et les échanges techniques
Participation dans les conférences internationales sur les traite-ments et analyses des données climatiques et hydrologiques
Cible á renforcer : Les organismes intergouvernementaux de l’Afrique de l’Ouest
Formation et développement de la con-naissance de base
Cours de recyclage, stages de perfection sur l’état actuel de latechnologie d’échantillonnage et les archives de données.
Cadre Juridique et administratif Consultations juridiques sur résolution des questions concernantle partage des données entre pays
La mobilisation des financements Etude sur la disponibilité des ressources a financier les réseauxde mesure, stage sur la préparation des offres
La coopération et les échanges techniques
Réunion internationale sur l’harmonisation des bases des données

76
Conclusions -Recommandations
Au terme de cette étude il apparaît important depromouvoir un renforcement des capacités à plu-sieurs niveaux, de l’échelle communautaire àl’échelle des bassins versants en passant par le
niveau national pour garantir l’efficacité des diffé-rentes stratégies d’adaptation pour la gestion desressources en eau face à la variabilité et change-ments climatiques. C’est seulement à ce prix queles ressources en eau pourraient être préservéespour les générations futures en dépit des effetsnéfastes des changements climatiques actuels.

77


79
Principaux résultants sur lavariabilité et changement climatique et ses impacts surles ressources en eau
Plusieurs travaux ont été réalisés sur la variabilitéclimatique et les ressources en eau en Afrique del’Ouest. Ces travaux étaient basés sur des obser-vations hydrologiques de longue durée de cessoixante dernières années et montrent un change-ment important des régimes climatiques et hydro-logiques autour des années 70 caractérisés pardes variations importantes, avec parfois des défi-cits continus sur plus de trente ans après cettepériode. Les principaux changements enregistrésaprès les années 70 sont les suivants :
• Une nette rupture des séries pluviométriques etdes débits moyens, observée autour desannées 1968-1972, avec l'année 1970 commeannée charnière ;
• Une baisse générale de la pluviométriemoyenne d'environ 15% à 30% selon la zone ;
• Un début de saison désormais très variable etétalé ;
• Une diminution des ressources en eau de sur-face au niveau des principaux bassins (40 à 60%) avec pour conséquence une baisse drasti-que des volumes d’eau transitant par les grandscours d’eau, des étiages de plus en plus sévè-res avec de fréquents arrêts des écoulements,un déficit de remplissage de la plupart des rete-nues des barrages avec comme impacts socio-économiques, la diminution du niveau d'alimen-tation en eau des villes
• Une intrusion de la langue salée à l’intérieur deslagunes côtières (lagune de Cotonou, delta duSénégal, etc.) et menace sur la biodiversitéd’eau douce ;
• Une importante diminution des superficies desprincipales zones humides naturelles tant sur lecontinent que dans les zones côtières avecpour conséquence une réduction de la produc-tion halieutique ;
• Pour la plupart des nappes, une baisse duniveau réduit l'apport des nappes souterrainesau niveau des principaux cours d'eau avecintrusion des eaux salées dans les nappesphréatiques côtières.
Il existe peu de travaux sur l’impact futur des chan-gements climatiques sur les ressources en eau enAfrique de l’Ouest aux horizons 2025 à 2050. Lesquelques travaux réalisés montrent de fortes incer-titudes sur les modèles actuels avec parfois desfortes divergences dans les projections. Des effortsde recherche sont encore à faire dans ce domaine.Toutefois, il est bien admis par la communautéscientifique internationale, que les extrêmes hydro-logiques (sécheresses et inondations) vont se ren-forcer dans le futur. Même si on ne connaît pasencore l’ampleur des futurs changements, il fau-drait s’attendre pour la sous-région à une augmen-tation de la variabilité des ressources en eau liéeaux changements climatiques d’où la nécessitéd’agir maintenant.
Actions concrètes pour une meil-leure connaissance et gestion dela variabilité et changements climatiques et leurs impacts surles ressources en eauLa multiplicité des futurs climatiques plausiblesmontre que ce qui est important c'est la gestion dela variabilité et des incertitudes. Cela impliquedonc l’amélioration de nos connaissances sur leclimat et ses impacts sur les ressources en eau.Les actions concrètes à mettre en place sont :
• Promouvoir la collecte des données météorolo-giques, hydrologiques et mise en place deréseaux d’information fiables et de plateformesde gestion efficace;
• Promouvoir la recherche afin de lever certainesincertitudes à l’image du programme AMMA etprojet FRIEND-AOC entre autres ;
• Doter les établissements universitaires et insti-tuts de recherche de moyens techniques etfinanciers et en développant la recherche dansle domaine de la modélisation des processus etde leurs impacts ;
• Renforcer et intensifier les formations sur lesévaluations de la vulnérabilité et des mesuresd’adaptation dans le secteur des ressources en eau.
Chapitre VI : Principales conclusions et recommandations

80
Actions concrètes d’adapta-tion aux changements pour lagestion des ressources enAfrique de l’Ouest à l’échellede bassin
Le bassin du fleuve Sénégal avec l’OMVS a servid’étude de cas. De part son mandat, la création del’OMVS est considérée comme une réponse glo-bale pour une gestion durable des ressources eneau du bassin eu égard à la variabilité de ces res-sources. L’analyse critique de sa longue expé-rience de plus de 30 ans pourrait donc servir dedégager des actions concrètes pour une gestiondurable des ressources à l’échelle de basin. Lesprincipales leçons apprises sont :
• Expression d’une forte volonté politique ;• Etablissement d’un cadre institutionnel et légis-
latif solide et flexible ;• Adoption des mesures et règles de fonctionne-
ment des institutions et de gestion des res-sources partagées basées sur l’équité, la soli-darité et la transparence ;
• Mise en place des outils de gestion, de prévi-sion et de suivi évaluation scientifiquement fia-bles et accessibles à toutes les catégories d’ac-teurs ;
• Mise en place d’un mécanisme financier dura-ble pour soutenir les programmes et projets ;
• Réalisation d’ouvrages intégrateurs à buts mul-tiples ;
• Participation et adhésion des acteurs concer-nés par le biais d’une sensibilisation et d’unecommunication efficace ;
• Adaptation des règles de fonctionnement et degestion à l’environnement régional et internatio-nal ;
• Amélioration (modernisation et innovation) desoutils de planification, de gestion et de suiviévaluation (programme de gestion des réser-voirs, programme de propagation des crues,SIG, tableau de bord, etc.);
• Etudes, recherches/développement pour l’amé-lioration des connaissances des écosystèmesdu bassin ;
• Renforcement des capacités (moyens humainset matériels à tous les niveaux d’intervention).
Pour un bassin transfrontalier donné en Afrique del’Ouest, on peut envisager les actions concrètesd’adaptation génériques suivantes :
• Mise en place d’un cadre juridique et institution-nel adéquat dans chaque bassin transfrontalier :• Statut juridique du fleuve, de ses affluents et
défluents ; • Organisme de bassin;• Charte des eaux du bassin;
• Code de l’environnement.• Mise en place d’infrastructures de maîtrise et de
mise en valeur des ressources en eau (structu-rantes et secondaires) ;
• Etablissement d’un réseau de mesuresmoderne sur les ressources en eau ;
• Etablissement d’un réseau de collecte sur don-nées environnementales et socioéconomiques ;
• Elaboration d’outils de planification, de prévi-sion qui prennent en compte les changementsclimatiques (base de données – SIG – observa-toires - tableau de bord besoins/ressources) ;
• Promotion de recherche/développement sur lesouvrages d’adaptation aux changements clima-tiques ;
• Renforcement des capacités des acteursconcernés au niveau national et sous régionalpour une plus grande de prise de conscience surles changements climatiques et leurs effets ;
• Programmes régionaux de lutte contre lesvégétaux aquatiques envahissants ; l’ensable-ment, l’érosion des berges, les maladies hydri-ques ;
• Mesures pour favoriser l’implication des popu-lations (micro financements, électrificationrurale, pisciculture, aquaculture, AEP, etc.) ;
• Mécanisme de mobilisation des partenairesfinanciers ;
• Réalisation d’infrastructures génératrices derevenus.
Actions concrètes au niveaucommunautaire d’adaptationaux changements pour la gestion des ressources enAfrique de l’Ouest En Afrique de l’ouest, les changements et variabili-tés climatiques sur les ressources en eau enregis-trés ces dernières décennies, se sont traduits pardes impacts directs ou indirects sur les principauxmodes et moyens d’existence liés aux ressourcesen eau. Les principaux impacts sont entre autres :
• Une baisse de la production halieutique et dis-parition de certaines espèces halieutiques ;

81
• Une baisse des rendements agricoles ;• L’indisponibilité et cherté des produits agrico-
les, l’inaccessibilité de certains marchés et pro-duits ;
• Baisse du pouvoir d’achat et accentuation de lapauvreté ;
• L’exode rural.
De tout temps, les communautés locales ontadopté des stratégies et mesures afin de s’adapteraux conséquences des modifications des ressour-ces en eau liées à celles du climat. Les différentescatégories de stratégies et mesure considéréessont :
Mesures et actions auto-adaptativesCe sont les options déjà prises par les populationslocales, dès l’instant où la variabilité climatique leurétait devenue une réalité vécue au quotidien. Ils’agit principalement :
• Réaménagement des calendriers agricoles etamélioration des pratiques traditionnelles ;
• Mesures visant l’efficacité et l’efficience dans lagestion de l’eau pour l’agriculture (diguettes fil-trantes, cultures du vétiver, dépressions artifi-cielles, cordons pierreux, meilleure aménage-ment des parcelles, etc.) ;
• Récupération des eaux de pluie par les toits desmaisons.
Mesures d’Adaptation spécifiques
Ces sont les mesures et actions d’adaptation pré-conisées et mise en œuvre par les Etats, les orga-nismes d’assistance et d’aide au développementet ou les ONG. Il s’agit principalement de :
• Aménagement et réhabilitation des retenuesd’eau, kiosques à eau ;
• Boisement / reboisement et protection et réha-bilitation des berges des plans d’eau, récupéra-tion des terres dégradées, fixation des dunes ;
• Création de points d’eau (forages, puits moder-nes, etc.) ;
• Semences adaptées à la sécheresse ;• Prévisions météorologiques et techniques
modernes de pluies provoquées ;
• Aménagement et préservation des bas fonds ; • Développement de la gestion intégrée par
bassin versant ; • Recharge des nappes (seuil d’épandage) ;• Techniques des zai, démi –lune, cordons
pierreux, etc.• Pompes à énergie renouvelable (solaires,
biocarburant, éoliennes, etc.) ;• Développement de la pisciculture et aquacul-
ture ;• Sources alternatives de revenus liées au crédit
carbone (MDP).
Des mesures comme l’accès à l’eau potable et àl’énergie et celles relatives à la réduction de la pau-vreté au niveau communautaire sont des préala-bles et doivent accompagner ces différentes mesu-res d’adaptation. L’implication des communautés àtravers une bonne communication est détermi-nante. La sensibilisation des communautés pour laprotection du massif du FOUTAH DJALLON châ-teau de l’Afrique de l’Ouest est indispensable.
Actions concrètes aux niveauxpolitique et institutionneld’adaptation aux changementspour la gestion des ressourcesen Afrique de l’Ouest
Face à cette situation, le milieu naturel et humain aréagi en tentant de s’adapter au nouvel contexte.Les réponses - pour l’essentiel réactives et sponta-nées - apportées à la variabilité climatique ont étéde divers ordres dont certains institutionnels, etpolitiques. On peut spéculer sur la question desavoir si ces réponses d’adaptation ont permis ounon d’atténuer les impacts des chocs climatiquesau cours des années récentes. Quoi qu’il en soit,au vu des perspectives climatiques annoncées,ces mesures d’adaptation risquent d’être insuffi-santes et méritent par conséquent d’être renfor-cées et diversifiées.
Les principales mesures institutionnelles prioritai-res préconisées pour augmenter la capacitéd’adaptation de l’Afrique de l’Ouest en matière degestion des ressources en eau sont entre autres:
Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources enEau ;

82
La protection des zones humides ;• la promotion de la Convention Cadre des
Nations Unies sur l’utilisation des eaux trans-frontalières à des fins autres que la navigation ;
• Le renforcement des mesures juridiques etréglementaires pour préserver la qualité de l’eau ;
• Mobiliser les moyens financiers et humains pourla mise en œuvre effective des Plans nationauxd’adaptation au changement climatiques ;
• Prise en compte du changement climatiquedans les études de faisabilité des projetshydrauliques et hydro-agricoles ;
• Prendre des mesures juridiques, réglementaireset organisationnelles appropriées pour atténuerles impacts des inondations dont l’ampleur et lafréquence devraient augmenter avec le change-ment climatique.
Pour chacune de ces mesures prioritaires, lesmesures spécifiques à mettre en place ainsi queles modalités de mise en œuvre sont indiquées.
Actions concrètes de renforce-ment des capacités d’adapta-tion aux changements pour lagestion des ressources enAfrique de l’OuestPour chaque mesure d’adaptation proposées queça soit pour l’amélioration de nos connaissance surle climat et ses impacts sur les ressources, àl’échelle du bassin, à la l’échelle communautaire etsur le plan politique et institutionnel, il faut identifierles cibles à renforcer. De même la nature du renfor-cement de capacité dont chaque cible a besoin està identifiant. Les principales cibles ci-après ayantdes actions directes ou indirectes associées à l’eauet au climat sont identifiées et nécessitant de ren-forcement de capacité :
• Services de l’Etat ;• Entreprises privées (par exemple, société,
chambres de commerce, associations profes-sionnelles ;
• Les décideurs politiques (par exemple, conseil-lers, maires, parlementaires, sénateurs, mem-bres du gouvernement) ;
• Les medias ;• Les ONG et les associations de base ;• Les communautés ;• Les universités, les centres de recherche, et les
collèges techniques ;
• Les organismes intergouvernementaux del’Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre de renforcement de capacité pourl’adaptation de la gestion des ressources en eauaux changements climatiques en Afrique del’Ouest, plusieurs actions peuvent être envisagéeset ce, en fonction des différentes cibles.Globalement on peut regrouper ces actions de ren-forcement de capacité par catégorie comme suit :
• La sensibilisation, l’information et la communi-cation ;
• La formation et le développement des connais-sances de base ;
• Les équipements et outils techniques ;• Le cadre juridique et administratif ;• La mobilisation des financements ;• La coopération et les échanges d’information.
Ainsi pour une mesure d’adaptation donnée etpour une cible donnée, l’une ou l’autre des actionsde renforcement de capacité sera envisagée. Unemaquette type est préparée afin de faciliter pourtoute mesure d’adaptation donnée, les actions derenforcement de capacité à entreprendre pour tou-tes les cibles.

83
1- AGRER, SERADE, SETICO. (2003), Etude pour la Restauration du Réseau Hydraulique du Bassin duFleuve Sénégal. Rapport. Phase I. Vol 1 & 2. OMVS/SOGED. Mars 2003.
2- Allan, A, (1999) ‘Water in international systems: A risk society analysis of regional problem sheds and glo-bal hydrologies’ SOAS Water Issues Group Occasional Paper No; 22, University of London.
3- Banque Mondiale (2003), AET préliminaire réalisée en phase de PDF-B, (Annexe 11 au Project AppraisalReport). Report No. 26632. Octobre
4- Beekman H.E., Abu-Zeid K., Afouda A., Hughes S., Kane A., Kulidwa K. A.,Odada E. O., Opere A.,Oyebande L. and Saayman, I. C. (2005) : Facing the Facts: Assessing the Vulnerability of Africa’s WaterResources to Environmental Change. Early Warning and Assessment Report Series, UNDP/DEWA/RS,United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
5- Broersma Klaus; Downing Tom; Thomas, Jean-Philippe (2004), National Adaptation Programmes ofAction: Selection of examples and exercises drawn from NAPA workshops. Geneva, UNFCCC, UNEP,UNDP, UNITAR, - 60 p.
6- Brondeau, F. (2004), ‘L’accès à l’eau, facteur de différenciation des paysages et des sociétés rurales:exemple des périmètres irrigués de l’Office du Niger et de leurs marges sèches’ Sécheresse, 1 E, 2
7- Catling, D. (1992), Rice in Deep Water, Macmillan, Londres.8- CNC-OMVS-Mali. (2005)- Rapport de mission relatif à la collecte de données pour la protection des ber-
ges dans le Haut Bassin – 31 mars au 5 avril. CRM/CN-OMVS-AB. No.5.Bamako9- Coly. A (2005),Gestion des données et des connaissances : Etude comparative des systèmes utilisés par
les Etats membres de l’OMVS et l’Organisation elle-même Décembre. 10- Cornet, A. (2002), La désertification à la croisée de l’environnement et du développement: un problème
qui nous concerne. In Barbault, Robert; Antoine Cornet; Jean Jouzel; Gerard Megie; Ignacy Sachs;Jacques Weber. Johannesburg. Sommet Mondial du Développement Durable. 2002. Quels enjeux?Quelle contribution des scientifiques?. Ministère (France) des Affaires Etrangères. ADPF, pp93-134
11- Denton, F (2005), Communities on the Margins of Development: Real Life Stories of Gender, Energy andPoverty, ENDA Publications, Dakar.
12- Downing, T; et al (1997), ‘Adapting to climate change in Africa’, Earth and Environmental Science, 2, 1,pp. 19-44
13- FAO (2004), Analyse Diagnostique Transfrontalière du Massif du FOUTAH DJALLON. ProgrammeIntégrée d’Aménagement du Massif du FOUTAH DJALLON. UNEP-GEF-FAO. Novembre.
14- Gannett Fleming Corddry & Carpenter Inc. & ORGATEC (1980), Evaluation des effets sur l’environne-ment d’aménagements dans le bassin du fleuve Sénégal. Organisation pour la Mise en Valeur du fleuveSénégal (OMVS), Dakar
15- Gibb, A. and Partners ; Electricité de France : Euroconsult (1987), Etude de la gestion des ouvragescommuns de l’OMVS. Rapports phase 1, Volume 1B, Optimisation de la crue artificielle
16- Halwart, M. e A.A. van Dam (eds.) (2006), Integrated Irrigation and Aquaculture in West Africa:Concepts, Practices and Potential, FAO, Rome.
17- Hilhorst,T; A Coulibaly (1999), Une convention locale pour la gestion participative de la brousse auMali.IIED.
18- Hubert P., Carbonnel J.P., (1987) : Approche statistique de l’aridification de l’Afrique de l’Ouest. Journalof Hydrology, 95 : 165-183.
19- IPCC, (2001), Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Intergovernmental Panel onClimate Change, Working Group II Contribution to the Third Assessment Report of the IPCC. Geneva,Switzerland.
20- IRD. (2001),Programme d’Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR). Phase 3. Annexe 1 :Cultures de décrue. IRD – OMVS. Juin
21- IRIN : UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) (2006) ‘Niger: Govt expulsion order will fuelinstability, Arabs warn’ report posted on the Internet 26-10-2006 online athttp://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=56078&SelectRegion=West_Africa&SelectCountry=NIGER
Références bibliographiques et autres sources de lecture

84
22- Kabat, P. ; R.E. Schulze ; M.E. Hellmuth &J. A. Veraart (eds) (2003), Coping with Impacts of ClimateVariability and Climate Change in Water Management. A Scoping Paper. Dialogue on Water and Climate(DWC). Wageningen.
23- Kirsch-Jung, K.P. and M. Gensler (2003), Les conventions locales: Un instrument de la gestion décen-tralisée de ressources naturelles. GTZ, Eschborn,
24- Le Barbe L. & Lebel T. (1997): Rainfall Climatology of the Happex-Sahel region during the years 1950 -1990, Journal of Hydrololy, 188-189, (1997) 43-73
25- Magistro, John & Medou Lo, (2001), Historical and Human Dimensions of Climate Variability and WaterResource Constraint in the Senegal River Valley. In Climate Research, 19:133-147.
26- Mai Moussa, K.A. (28-30 septembre 2005), ‘Adaptation to climate change and priorities of local com-munities in Niger’, présentation à la réunion du GEF Community Based Adaptations to Climate ChangeProgram, Bangkok
27- McCarthy, J.J; et al (2001), Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, CambridgeUniversity Press, Cambridge [en particulier chapitres 4 et 5].
28- MDR/Direction Nationale de l’Aménagement et de l’équipement Rural (Décembre 1998), Projet dedéveloppement rural intégré à l’aval du barrage de MANANTALI – Document de projet
29- Nakicenovic N., Alcamo J., Davis G., de Vries B., Fenhann J., Gaffin S., GregoryS., Grübler A., JungT. Y., Kram T., La Rovere E. L., Michaellis L., Moris L., Morita T.,Pepper W., Pitcher H., Price L., RaihiK., Roehri A., Rogner H.H., Sankoski A., Schelsinger M., Shukla P., Smith S., Swart, R., Van RoijenS., Victor N. & Dadi Z. (2000), Emission Scenarios. A special Report of Working Group III of IPCC.Cambridge, RU & New York. NY, USA, 599 pages.
30- NEPAD (2001), ‘The NEPAD framework document’ consultable en ligne surhttp://www.nepad.org/2005/files/documents/inbrief.pdf
31- Niasse M., Afouda A. & Amani A. (2004): Réduire la vulnérabilité de l'Afrique de l’Ouest aux impactsdu climat sur les ressources en eau, les zones humides et la désertification : Eléments de stratégie régio-nale de préparation et d'adaptation. GWP, CILSS & UICN (édit.)
32- Nicholson S. E., Kim J. & Hoopingamer J., (1988): Atlas of African rainfall and its interannual variabi-lity. Department of Meteorology; Lorida State University, Tallahasseed, Florida, USA
33- Olivry J.C., Bricquet J.P. & Mahé G. (1998), Variabilité de la puissance des crues des grand scoursd’eau d’Afrique intertropicale et incidence de la baisse des écoulments de base au cours de deux der-nières décénnies. Water Resources Variability in Africa during the XXth Century. (Proceeding of theAbidjan’98 Conference, Abidjan, Côte d’Ivoire, November 1998). IASH Publ.n°252, 1998, pp189-197.
34- OMVS (2003), Etude de base pour la phase initiale de la mise en place de l’Observatoire del’Environnement – Rapport technique – Version finale V 2.1
35- OMVS (2004), Programme d’atténuation et de suivi des impacts sur l’environnement (PASIE) – Rapportd’achèvement – IDA. Mai
36- OMVS / Observatoire de l’Environnement (2006), Notes techniques de l’Observatoire del’Environnement relatives au suivi-évaluation de l’Etat de l’Environnement du Bassin du fleuve Sénégal.Janvier.
37- OMVS/SOGED (2003), Etude pour la restauration du réseau hydraulique du bassin du fleuve Sénégal –Rapport de phase I – version provisoire – AGRER –SERADE – SETICO. Mars
38- Paturel J.E., Servat E., Kouamé B., Lubès H., Ouédraogo M., Masson JM. (1997). Climatic variabilityin humid Africa along the Gulf of Guinea, Part two: An integrated regional approach. Journal ofHydrology, 191 (1997) 16-36.
39- Prein, M. et M.M. Dey (2006), ‘Community-based fish culture in seasonal floodplains in Halwart, M. etA.A. van Dam (eds.) Integrated Irrigation and Aquaculture in West Africa: Concepts, Practices andPotential, FAO, Rome.
40- REDDA (2005), Rapport sur l’Etat de l’environnement en Afrique de l’ouest41- Servat E., Paturel J.E, Lubès H., Kouamé B. , Ouédraogo M., Masson J.M., (1997). Climatic variabi-
lity in humid Africa along the Gulf of Guinea, Part one: Detailed analysis of the phenomenon in Côted’Ivoire. Journal of Hydrology, 191 (1997) 1-15
42- Smit, B. et al (2000), ‘An anatomy of adaptation to climate change and variability’, Climatic Change, 45,1, 223-251.
43- SOGED (2003), Etude pour la Restauration du Réseau Hydraulique du Bassin du Fleuve Sénégal –Rapport de Phase I – Version provisoire – OMVS. Mars

85
44- STUDI International, SACI & GEDUR (2006), Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP). Plande Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans leBassin du Fleuve Sénégal. OMVS – Banque Mondiale. Janvier.
45- Taupin J.D., Amani A. &Lebel T. (1998): Variabilité spatiale des pluies au Sahel, une question d’échel-les ; Approche expérimentale - Water Resources Variability in Africa during the XXth Century. (Proceedingof the Abidjan’98 Conference, Abidjan, Côte d’Ivoire, November 1998). IASH Publ.n°252, 1998, pp143-151
46- Van der Zaag, P; (2005), ‘Water’s vulnerable value in Africa’ Paper presented to workshop entitled ‘Valueof Water – Different Approached in Transboundary Water Management’ Koblenz, 10-11 mars 2005, enligne sur http://www.bicc.de/events/vow_workshop/pdf/zaag_abstr.pdf dernière visite le 09-01-2007
47- Venema, H.D. et al, ‘A water resources planning response to climate change in the Senegal River basin’,Journal of Environmental Management, 49, 125-155.

86

87
Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24
Matin
09:00Discours de bienv-enue par ENDA,NCAP Pays-Bas,Sénégal- Jean-PhilippeThomas, ENDA- Miranda VerburgETC,- Fatima DiaTOURE, DEECPrésidence duWRITESHOPAbou Amani09:30Présentation duprogramme et duprocessus de l’ate-lier d’écriture Jean-PhilippeThomas09:45Présentation de lapremière versiondes projets de doc-uments en plénièreAbel AfoudaTamsir NdiayeMoussa Na AbouMadiodio NiasseDavid Purkey
9:00Sessions théma-tiques de l’atelierd’écriture
5 sous-groupes
Abel AfoudaTamsir NdiayeLawrence FlintMadiodio NiasseDavid Purkey
09:00Présentation de ladeuxième versiondes projets PlénièreAbou Amani
Abel AfoudaTamsir NdiayeLawrence FlintMadiodio NiasseDavid Purkey
09:00Finalisation
5 sous groupes
13:00 DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER
Après-midi14:30
17:30
Suite Présentationde la première ver-sion des projets dedocuments
Nouveaux thèmeset résumé de lajournée
Sessions théma-tiques de l’atelierd’écriture
5 sous-groupes
Conclusionsd’étape
Sessions théma-tiques de l’atelierd’écriture
5 sous-groupes
Conclusionsd’étape
Plénière Abou Amani
Finalisation- Quelles mesuresconcrètes ?- Quel plan d’actions ?- Les étapes à venir ?
CLOTÛRE
Soirée
Arrivée des partici-pants/réunion des organ-isateurs pour clarifi-er les rôles et lesresponsabilités
Départ des partici-pants,réunion des organ-isateurs pour l’éval-uation et la prépa-ration des étapessuivantes
* Des pauses sont prévues en milieu de matinée et d’après midi.
ANNEXE 1 : Agenda WRITESHOP Dakar, 21-24 février 2007

88

89
Prénoms et Nom Organisation Pays Adresse
1 Atigou BALDE
Ministère HydrauliqueEnergie / Direction
Nationale de la Gestiondes Ressources en Eau
Guinée
Kipe sis Ecole FrançaiseCommune de Ratoma
BP. 642 Conakry République de GuinéeTél. + 224 60 25 05 [email protected]
2Mouhamed elMoctar OULDMOHAMED
Ministère del’Hydraulique
Mauritanie
Ministère de l’Hydraulique BP 4913Nouakchott, Mauritanie
[email protected]. : +222 525 71 40
3Balla Abdou
TOURE
Populations etDéveloppement - ONG
POPDEVMauritanie
Avenue Gamal Abd. Nasser 712,BP 4263 Nouakchott
Mauritanie tel. : +222 524 00 [email protected]
4Mohamedou OULD
BABA SYObservatoire du Sahara
et du Sahel OSSTunisie
Bd du Leader Yasser Arafat ; BP 3Code postal 1080 Tunis - Tunisie
tel. : +216 71 20 66 33Fax. 216 71 20 66 36
5Thomas AnatoleAïnahin BAGAN
Ministère de l’environnement et de laProtection de la Nature
Bénin
Ministère de l’Environnement et de laProtection de la Nature
01 BP 3621 Cotonou, République du BéninTél. : +229 95 71 45 [email protected]
6Amadou Thierno
GAYE
Laboratoire de Physiquede l’Atmosphère, Ecole
SupérieurePolytechnique, UCAD
Sénégal
LPAOSF/ESPBP 5085 Dakar- Fann Sénégal
Tel. : +221 825 93 [email protected]
7Mamady Kobélé
KEITAGuinée Ecologie ONG Guinée
210, DI 501 DIXINNBP 3266 Conakry, Guinée
Tél. : +224 60 20 70 [email protected] - [email protected]
8Toumany
DEMBELE
STP – CIGQEPoint Focal Massif
Foutah DjallonMali
Quartier du fleuve2357 Bamako, Mali
Tél. : +223 223 10 74 / 603 68 [email protected]
9B. Eustache
BOKONON-GANTA
Université d’Abomey-Calavi
Consultant en EtudesEnvironnementales
Bénin
BP 261 Abomey - Calavi Benin Tél. : Dom : 21 36 07 75
Cel : 95 05 08 94 / 97 05 68 [email protected]
ANNEXE 2 : Liste des Participants au WRITESHOP,
21-24 février 2007, Dakar

90
10Boubacar Sidiki
DEMBELE
Secrétariat Techniquedu Cadre Institutionnel
de la Gestion desQuestions
Environnementales(STP/CIGQE) NCAP
Mali
BP 2357 Bamako, MaliTél.: (+223) 223 10 74 / 673 15 58
Fax. +223 223 58 [email protected]
11AbdoulayeDOUMBIA
Autorité Bassin du NigerABN
Niger
Observatoire du Bassin du Niger / ABN BP 729 Niger
Tél. : 227 20 31 52 [email protected], [email protected]
12 Bassirou DIAGANA
Inspecteur chargé desaspects techniques au
Ministre del’Hydraulique
MauritanieBP 1111 Nouakchott
Mauritanie Tél. : +222 [email protected]
13Saadou EbihMohamed EL
HACEN
Centre National desRessources en Eau
CNREMauritanie
BP 889 Nouakchott Cel : +222 630 70 17
Tél. : +222 52 95 [email protected]
14 Abel AFOUDAProfesseur Université
d’Abomey CalaviBénin [email protected]
15 Tamsir NDIAYE OMVS Sénégal
5, place de l’indépendance,BP 3152 –Dakar Tél. : 842 02 16
[email protected]@yahoo.fr
16 Madiodio NIASSE CSLT SénégalTél.: 867 39 49 / 450 04 [email protected]
17 Lawrence FLINT ENDA Séné[email protected]@orange.sn
18 David PURKEY SEI USA
SEI– US 133 DST. suite F Davis, CA95616
Bureau 916 325 [email protected]
19 Miranda VERBURG ETCThe
Netherlands
Kastanjelaan 5, 3830 A B LeusdenPays – Bas
Tél. + 31 (0) 33 432 6000Fax : +31(0) 33 494 07 91
20 Isabelle NIANG ENDA / UCAD Séné[email protected]@yahoo.fr
21Jean-Philippe
THOMASENDA Sénégal
[email protected]@gmail.com

91
22 Aita SECK DEEC Séné[email protected]
23Mamouda MOUS-
SA NA ABOUENDA Sénégal
Observatoire du Bassin du Niger / ABN BP 729 Niger
Tél. : 227 20 31 52 [email protected], [email protected]
24 Alexandre CABRAL
Ministère desRessources Naturelles /Direction Générale deL’Environnement Projet
PANA/NAPA
GuinéeBissau
Bissau/Guinée-Bissau 438 Tél. : +245 661 44 99 / 25 45 83 /
720 42 [email protected]/
25Yahaya
NAZOUMOUUniversité Abdou
Moumouni NiameyNiger
Dépt. de Géologie/ Université A.Moumouni /
BP 10662 Niamey NigerTél. :+227 96 87 36 72
[email protected] /[email protected]
26 Abou AMANIProgramme Specialist
Water ScienceUNESCO Accra Office
GhanaUNESCO / Accra - Ghana
27Madame Jacqueline
ZOUNGRANA
DGRE, Ministère del’Agriculture, de
l’Hydraulique et desRessourcesHalieutiques
BurkinaFaso
03 BP 7025 Ouagadougou 03Tél. : +226 50 37 48 76 / 70 22 43 28
Fax : +226 50 37 48 [email protected]
28Madeleine DIOUF
SARRDEEC NCAP Sénégal
[email protected], rue Carnot Dakar
29Madjyara NGUETO-
RAAgrhymet CILSS
BurkinaFaso
CILSS03 BP 7049 Ouagadougou 03
Tél. : +226 50 37 41 25 / Poste 210Fax : +235 524 127
Email : [email protected]
30Jean Abdias COM-
PAOREAutorité du Bassin du
Niger (ABN)Niger
Observatoire du Bassin du Niger / ABNBP 729 Niger
Tél : +227 20 31 52 39 / 93 93 79 78 Fax : +227 20 72 42 08
[email protected] , [email protected]
31Viriato luis
SOARES CAS-SAMA
Ministère desRessources Naturelles
GuinéeBissau
Bissau-Bairro Militar 399 Guinée Bissau Tél. : +245 67 59 288 - Fax : + 245 201753
Email : [email protected]@hotmail.com

92
32 Nazaire PODA
Expert SE / EIE pro-gramme de lutte contrel’ensablement dans lebassin du fleuve Niger
BurkinaFaso
01 BP 301 Dom Tél. : +226 40 46 03 50/fax :+226 40 46 00 77
Email : [email protected]
33 Rabé SANOUSSIDirection des
Ressources en EauMH/E/LCD
Niger
MH/E/LCD 257 Niger, NiameyTél. : +227 96 59 22 04 / fax :+ 227 20 72
34 Léopold SOMEInstitut de
l’Environnement et deRecherches Agricoles
BurkinaFaso
INERA 04 BP 8645Tél. : +226 50 34 02 70Fax : +226 50 34 02 71
Email : [email protected]
35Aliou Kankalabé
DIALLO
Union AfricaineBureau de CoordinationInternational du PRAI-
MFD
Guinée
Programme Régional d’AménagementIntégré Massif Foutah Djallon
BP 1386 Guinée tél. : + 224 30 43 53 65 cell : + 224 64 40 21 09
Fax : + 224 43 41 70Email : [email protected]
36 Baye FALLProgramme
ChangementsClimatiques
Mauritanie
Secrétariat d’Etat auprès du PremierMinistre Chargé de l’Environnement
Mauritanie, BP 170 NouakchottTél. : +222 631 42 [email protected]
37 Fatima Dia TOURE DEEC / MFPN SénégalDEEC 106 Rue Carnot Dakar
Tél. : + 221 821 07 25

93