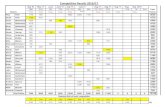CLGB_REIMS#17
-
Upload
granbag-open-art-revue -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of CLGB_REIMS#17

Open Art Revue Mars Avril 2012 /// Reims /// Gratuit
Man Ray, Portrait de Berenice Abbott, 1925. Épreuve gélatino-argentique, 22 x 14,5 cm Collection Hank O’Neal, New York • © Man Ray Trust / ADAGP, Paris, 2011

Modèle : Maï line • Coiffure : Jean Noël • Maquillage : Sophie • Photo : Crapaud Mlle • Robe : Maje

C’est toujours un peu pareil lorsque l’on visite une exposition. On a d’abord une impression générale et puis, très vite, le besoin invariable d’entrer en contact avec l’autre pour mieux se faire
une idée, en tendant l’oreille par exemple vers ces voisins venus à deux qui ne sont généralement pas avares en commentaires. « Ce ne sont que de vul-gaires photos numériques » (un jeune couple branché), « - Je m’attendais à autre chose – Mais où sont les œuvres ? » (deux amatrices d’art, la cinquantaine), « c’est de la provocation gratuite » (un mari), « allons plutôt voir Berenice Abbott au premier ! » (sa femme). Voilà ce que l’on pouvait entendre fin février, au Musée du Jeu de Paume à Paris, lors de la toute première exposition française de l’artiste Ai Weiwei. Les moues étaient bou-deuses et les avis désappointés. Mais à quoi s’attendaient au juste les spectateurs venus en nombre voir les travaux de l’artiste chinois le plus engagé de sa génération ? À une œuvre spectaculaire, comme à la Tate Modern, à Londres, il y a deux ans, lorsque Ai Weiwei avait tapissé le sol de 100 millions de graines de tournesol en céramiques peintes à la main, toutes fabriquées par des artisans de Jingdezhen ? À des œuvres plus drôles, plus tape-à-l’œil, plus colorées sans doute ? Les photo-graphies et vidéos documentaires de Ai Weiwei semblent bien loin, dans leurs formes, des œuvres dites « engagées » de ses compatriotes artistes, encensés par la presse aux quatre coins du monde. Il n’est point question ici d’une critique de notre société de consommation à coup de ready-made glossy à la Jeff Koons, ni d’un objet sacrilège comme a pu l’être le manne-quin d’Hitler en prière de Maurizio Cattelan. Et pourtant, en traversant
les salles consacrées à Ai Weiwei au Jeu de Paume, il est impossible de ne pas faire le rapprochement entre son « doigt d’honneur », fait aux autorités chinoises et internationales par le biais d’une série de photographies (Étude de perspective, 1995-2003), et la sculpture monumentale en doigt d’hon-neur de Cattelan (L.O.V.E., 2011), soit six tonnes de marbre et onze mètres de haut, placée devant la Bourse de Milan. Si le choix esthétique
de leur engagement diffère - ici c’est la photo-graphie qui joue ce rôle -, l’engagement lui, est bien là. Ai Weiwei comme Cattelan, « ont en commun le désir d’être compris de n’im-porte quel spectateur, pour le scandaliser ou lui donner à réfléchir » comme le rappelle très justement Philippe Dagen dans un article du Monde, et de souligner : « Le risque est réduit, en Occident, pour Cattelan. En Chine, pour Ai Weiwei, il n’en est pas de même. ».Dans les deux cas, l’artiste se joue des symboles, et on y voit rien de plus normal. Mais lorsque Ai Weiwei questionne la destruction du patri-moine culturel chinois, avec notamment un
tryptique de grands tirages n/b, où on le voit laisser tomber une urne de la dynastie des Han (1995), ou que l’on lit les extraits de son blog fermé par la censure, on comprend qu’il soit retenu à Pekin pour faire le moins de vagues possible. Dans « Entrelacs », il n’est peut-être pas question de sculp-tures ou d’installations purement décoratives, à la grande déception de certains, mais d’images comme autant de documents subversifs qui disent les choses, et qui font, faut-il le rappeler, trembler la Chine.
ARTISTE ENGAGÉTexte / Jessica Piersanti • Photo / © Jessica Piersanti
CONSTANCE LARRIEU + La note du mot +
LANA DEL RAY + X-Rey +
MIRCEA CANTOR + L’art de l’esquive +
JACQUES ANTOINE + Le grand jeu +
BOTOX(S) + Association d’idées +
BERENICE ABBOTT + Changing photography +
THE ENGLAND’S DREAMING TAPES + L’autre versant de la crête +
KULTURINDUSTRIE + Culture de la domination +
JULIEN NÉDÉLEC + Empirisme +
MORGANE TSCHIEMBER + De la peinture à l’architecture, une odyssée des espaces +
CLAIRE PEILLOD + L’Art d’école +
AI WEIWEI + Perspectives photographiques + 051013162022243032343940


Texte / Isabelle Giovacchini • Photos / © Ai Weiwei, courtesy Jeu de Paume
AI WEIWEI - 05
EXPOSITION
+ PERSPECTIVES PHOTOGRAPHIQUES +
AI WEIWEI
Lors du vernissage d’Entrelacs au Jeu de Paume, les visiteurs étaient schématiquement divisés en deux catégories. La première, avant même d’avoir découvert les salles du centre d’art, était déjà exaltée par
l’exposition d’Ai Weiwei, comme acquise à la cause de cet artiste et martyr maintenu en détention, censuré et harcelé par les autorités chinoises. L’autre partie, moins nombreuse, avouait timidement ne le connaître qu’au
travers de ce scandale et, au mieux, de son oeuvre monumentale constituée de fausses graines de tournesol installée en 2010 à la Tate Gallery de Londres. Cette portion du public a dû être déroutée par la proposition du Jeu de Paume, tant celle-ci, presque intégralement photographique, ne présente pas vraiment le travail de cet artiste,
constitué certes d’images, mais aussi de sculptures, d’installations et de performances. En ceci, Entrelacs est plus une invitation à parcourir en coulisses la mémoire et les engagements politiques de cet «artiste de la communication»* qu’une réelle présentation de ses oeuvres photographiques. Urs Stahel, directeur du Winterthur Photomuseum et
commissaire de l’exposition, nous éclaire sur ce choix.
• Pourquoi avoir choisi de titrer l’exposition Entrelacs ? Parce que s’il fallait résumer le travail d’Ai Weiwei, c’est-à-dire par exemple ses sculptures, ses ins-tallations, son activité de blogueur et de membre actif des réseaux sociaux, son projet Portraits de conte de fée (ndlr : longue et spectaculaire performance réalisée lors de la Documenta 12 où l’artiste a fait venir à Kassel mille et un chinois comme s’ils participaient à une installa-tion vivante), les termes d’échanges et d’entrelacements seraient les plus pertinents. Lorsque nous avons pré-paré l’exposition, nous ne voulions pas parler de mise en réseau car l’expression est trop liée à cette idée très contemporaine de communication virtuelle, alors que son travail connecte aussi l’Histoire de la Chine avec le monde d’aujourd’hui. Le mot «entrelacs» permet de réunir très justement les différentes notions qui tra-versent l’oeuvre d’Ai Weiwei.
• Pouvez-vous m’expliquer cette volonté de pré-senter presque uniquement des documents pho-tographiques alors qu’Ai Weiwei est un artiste pluridisciplinaire ? C’est vrai que l’exposition est essentiellement photographique. Par exemple, nous
montrons dix mille des quelques deux cent mille photos apparaissant sur son blog. On peut donc voir dans l’exposition les différentes façons qu’a Ai Weiwei d’utiliser le médium photographique. Il faut bien com-
prendre qu’Ai n’est pas un photographe, mais un artiste conceptuel utilisant la photographie. Quand on entre dans la première salle de l’exposition, on découvre son travail documentant les incroyables changements qui
sont survenus en Chine ces dernières années, notam-ment à Pékin. La situation de la Chine ressemble beau-coup à celle de Paris au milieu du XIXe siècle, lorsque Haussmann et le gouvernement en place à l’époque ont totalement reconstruit toute la ville. La différence, c’est qu’en Chine la façon de procéder est très différente. Là-bas, les habitants ont été expropriés en échange d’un peu d’argent, puis tout a été rasé sur des kilomètres pour être reconstruit dans un style très contemporain que l’on peut difficilement qualifier d’architectural. Ai Weiwei a enregistré ces changements, mais a aussi documenté ceux liés au tremblement de terre ayant eu lieu dans la province de Sichuan en 2008 ou à la construction de son atelier commandé et financé par les autorités de Shanghai en 2008 et détruit par ces mêmes autorités deux ans après. S’il documente tout ceci, c’est parce qu’il pense que ce sont des événements très importants. Il le fait de façon presque filmique. Là où certains ne prendraient qu’une seule photo, lui en fait cinquante ! S’il était maintenant ici avec nous, il nous aurait photographiés tout au long de l’entretien et nous aurions presque pu faire de ses photos un flip-book ! Il aime beaucoup l’aspect théâtral de la photo-
« Peut-être que ma vie est ma
meilleure oeuvre d’art. »
Laisser tomber une urne de la dynastie des Han, 1995 Triptyque • Courtesy Jeu de Paume
* C’est ainsi que le décrit Lucas Lai, son assistant.

06 - AI WEIWEI
EXPOSITION
Juin 1994, 1994 • Courtesy Jeu de Paume

AI WEIWEI - 07
EXPOSITION
Juin 1994, 1994 • Courtesy Jeu de Paume

08 - AI WEIWEI
EXPOSITION
graphie, les possibilités de mise en scène qu’elle offre. Sur certaines de ses images, on peut voir des personnes avec des coupes de cheveux totalement spectaculaires. Il va par exemple faire appel à quatre modèles, leur raser respectivement un F, un U, un C et un K sur le crâne et les faire poser ensemble. Ce qu’il souhaite faire, c’est documenter l’actualité pour le futur. Ses photos sont comme une base de données pour construire une mémoire et une réflexion, un peu à la façon des philo-sophes du siècle des Lumières en France.
D’autre part, ces photographies permettent de montrer qu’Ai Weiwei est un artiste de la provocation. Sur l’un des triptyques présentés dans l’exposition, on peut le voir laisser tomber une urne de la dynastie des Han, vieille de cinq cents ans, de façon à la briser. Autre exemple : il a photographié en 1994 sa petite amie en train de soulever sa jupe et montrer sa culotte sur la place Tian’anmen de Pékin le jour de l’anniversaire du massacre de 1989 au cours duquel près de trois mille personnes ont été tuées par la police nationale, ce qui revient à peu de choses près à faire publiquement un doigt d’honneur aux forces de l’ordre chinoises. Au même endroit, il a photographié un soldat au garde-à-vous et a découpé le tirage obtenu en sept parties alignées à l’horizontale. Faire passer ce soldat de la ver-ticalité à l’horizontalité revient pour Ai Weiwei à faire s’écrouler le pouvoir et l’autorité, à les abolir. C’est un geste de protestation. On retrouve cette même idée dans la série intitulée Études de perspectives, (1995-2003) où il a photographié des paysages et monuments histo-riques en leur faisant un doigt d’honneur. La première image de cette série a d’ailleurs été faite sur cette même place Tian’anmen. Sur les autres images, on peut voir des édifices tels que la Tour Eiffel, de simples paysages
et même son propre atelier. Ainsi mis en scène, ce geste devient une réflexion sur les individus au sein d’une société donnée, comme pour essayer de comprendre d’où ils viennent et où ils vont. Le doigt d’honneur ressemble beaucoup au geste que les peintres utilisent pour reporter sur la toile les mesures des différents élé-ments d’un paysage en pointant leur pouce face à eux et fermant un oeil pour évaluer les distances. Cette pos-ture, très ancrée dans l’histoire de la représentation pic-turale, est appelée «étude de perspective», tout comme la série d’Ai Weiwei. C’est une relecture très personnelle des différents codes de la représentation, du pouvoir et de l’académisme.
Dans la dernière partie de l’exposition, c’est Ai Weiwei en tant qu’artiste de la communication qui est mis en valeur. Il fait constamment appel à travers son travail artistique à différents outils de communication. Il blo-guait et voyageait (ndlr : Ai Weiwei est actuellement interdit de sortie du territoire chinois et son blog a été censuré), et continue maintenant à parler aux gens en twittant, à les photographier, à se laisser photographier par eux. Ceci représente une partie très importante de son travail. Les photographies qu’il prend traduisent son amour pour l’architecture, le design, l’art, ses propres oeuvres… D’autre part, Ai est un artiste qui écrit constamment. Certains de ses écrits ont été pu-bliés par le MIT Press, tout d’abord aux Etats-Unis l’an dernier, puis en Allemagne depuis peu. On y retrouve certains des textes du blog que les autorités chinoises ont fermé. Cette partie de l’exposition liée à la com-munication prend aussi en compte ses textes, mais ses différentes actions et performances, comme celle dont je parlais tout-à-l’heure avec les mille et un chinois voyageant jusqu’à la Documenta. Je le répète, le point
de vue d’Ai Weiwei est proche de celui des Lumières : tout ce qu’il veut, c’est ouvrir l’esprit de ses contempo-rains, leur faire prendre conscience de cette idée que le gouvernement n’a pas le droit de leur dicter ce qu’ils doivent faire et qu’ils peuvent bien au contraire se sou-lever contre lui.
L’exposition est donc pensée en trois parties, réparties de façon quasi chronologique dans trois salles d’expo-sition. Ses photographies les plus anciennes, présentées dans une pièce un peu à part des autres, sont très diffé-rentes du reste de l’accrochage. Elles fonctionnent sur le mode du journal intime, sont en noir et blanc et datent de l’époque de son séjour à New York. Là-bas, il disait ne rien faire. Finalement, il a tout de même fait plus de dix mille photographies, qu’il n’a d’ailleurs pas développées sur place. Il est rentré en Chine, a mis de côté toutes ces pellicules photographiques et les a oubliées. Il a commencé à les développer il y a seule-ment cinq ans, soit vingt ans après. Sur ces images, on peut apprendre beaucoup de choses sur Ai Weiwei. Il ressemblait beaucoup alors à une sorte de chinois bau-delairien flânant à New York qui s’est soudainement intéressé aux différents mouvements de protestation qu’il observait dans les rues de New York et la façon dont la police réprimandait les manifestants. On peut voir toute sa formation à travers ces photographies new yorkaises. Au début de son séjour, il était comme para-lysé par ce qui l’entourait, ne parvenait à rien faire, puis peu à peu, il est devenu cet artiste conceptuel mais très engagé socialement que l’on connait aujourd’hui.
• Ai Weiwei est très actif sur les réseaux sociaux. Considère t-il ces médias comme autant de moyens d’expression, comme des extensions de
son travail ou plutôt comme des oeuvres à part entière, gratuites et diffusables ? Il se réfère réguliè-rement à Marcel Duchamp. Il le cite souvent lorsqu’il dit que l’art fait partie intégrante de la vie. Parfois, face à ses images, les gens se disent « mes enfants auraient pu faire cette photo, donc en quoi est-ce de l’art ? ». Je crois que pour Ai Weiwei, absolument tout peut faire partie de son art. Il le dit lui-même : « Peut-être que ma vie est ma meilleure oeuvre d’art ». En Allemagne, on utilise un mot intraduisible, mais qui définit bien la posi-tion d’Ai, et qui correspondrait en français au terme «généraliste». Il est tout à la fois : sculpteur, architecte, écrivain, photographe, fait des installations… C’est ce tout qui forme son art. Il va bien au-delà de l’idée que l’art doit être simplement un bel objet ou une chose bien faite. Il a une vision beaucoup plus conceptuelle de l’art. Donc, quand il blogue ou qu’il twitte, il ne parle de son propre travail artistique que lorsqu’on le lui demande, et préfère plutôt utiliser ce média pour se mêler à la société, interagir avec elle. Les allers-re-tours entre son positionnement artistique et sa place en tant qu’individu au sein de la société sont perma-nents. C’est cette attitude, cette énergie et cette force qui lui confèrent une personnalité si impressionnante, du moins de mon point de vue. Actuellement, il est attaqué de toutes parts ; les autorités chinoises tentent de ruiner sa réputation en disant que c’est un parvenu alors qu’il investit tout son argent dans de nouveaux projets en se moquant du luxe. C’est un artiste très simple qui communique, pour qui le partage est im-portant. Son activité sur internet l’atteste.
• De la même façon, ses photographies prises au téléphone portable sont-elles un moyen d’oeuvrer avec un médium simple et accessible à
Gu Changwei, Nouvel An chinois sur Mott Street, 1989. Série Photographies new-yorkaises, 1983-1993. Tirage C-print Ai Weiwei. Williamsburg, Brooklyn, 1983. Série Photographies new-yorkaises, 1983-1993 Tirage C-print.

AI WEIWEI - 09
EXPOSITION
tous ? Entre 2005 et 2009, il a tenu différents blogs. Il utilisait alors un appareil photo numérique. C’est seu-lement lorsqu’il a commencé à twitter qu’il s’est mis à utiliser son téléphone portable. L’une des dernières fois que j’ai vu Ai Weiwei, c’était au mois d’octobre 2011, pendant le vernissage d’une exposition à la galerie Urs Meile (ndlr : galerie qui représente Ai Weiwei en Suisse et à Pékin). A l’issue du vernissage nous sommes tous allés dîner, et le lendemain j’ai pu voir toutes les pho-tos de la soirée sur son compte Twitter. Avec Twitter, en un clic, n’importe quelle photo peut se retrouver en ligne. Cette façon de photographier reste dans la lignée de son journal intime new yorkais en noir et blanc. C’est sa manière à lui de témoigner de sa vie et son travail, et ça l’amuse beaucoup. Avec ces images, il ne prétend pas faire de l’art sérieux. Ses photographies prises au téléphone portable font partie de la stratégie qu’il a mise en place pour prendre part à la société, en être acteur, la documenter. Les autorités chinoises l’ont interdit de twitter mais il continue à le faire malgré tout et avec beaucoup d’humour, en postant énormément d’images, en jouant de l’immédiateté de ce réseau social et de la simplicité de ces prises de vues au téléphone.
• La question du paysage urbain est très présente au sein de son oeuvre. Est-ce que photographier ses mutations est pour lui une manière de docu-menter les bouleversements qui traversent les sociétés ? Oui, bien sûr. Souvent, ce n’est pas lui qui réalise ces photographies urbaines, comme par exemple pour la série Paysages provisoires ( 2002-2008). Là, il a fait appel à un photographe professionnel qui l’ac-compagnait à Pékin et qui travaillait avec une chambre 8x10 inches. Ai Weiwei lui disait où poser son trépied, comment cadrer, que faire. Cette série compte énormé-
ment d’images, beaucoup plus que ce qui est présenté ici au Jeu de Paume. Elle parle de la ville, en profondeur, et prend presque part à l’architecture qu’elle docu-mente, à son évolution.
En occident, on ne peut pas imaginer les drames qui se sont tenus à Pékin ces dix dernières années. Ce qui se passe au niveau de l’aménagement de l’espace urbain est d’une violence extrême, par exemple. Seules les mai-sons traditionnelles sont épargnées. Elles ne peuvent pas être rasées, contrairement aux autres bâtiments et édifices de la ville. Ceux qui sont détruits sont rempla-cés par des architectures de très mauvaise qualité, tant matérielle qu’esthétique, et effacent en même temps que leur destruction des pans entiers de communautés et d’histoire. Ai Weiwei est bien conscient de tout ça et l’enregistre.
• Lorsqu’Ai Weiwei réalise ses Portraits contes de fées (2007) ou son installation faites graines de tournesol en porcelaine (2010), il met à contri-bution des personnes totalement étrangères au domaine de l’art et n’ayant pas forcément le droit à la parole. Cela lui permet-il de créer le temps d’une oeuvre une société utopique ou plutôt de dénoncer des paradoxes et des inégalités ? On peut en effet dire que ce qu’il a créé avec les Portraits contes de fée une petite bulle, utopique et temporaire. La Chine compte 1,3 milliard d’habitants. Au vu de ce nombre, Ai Weiwei sait pertinemment qu’en tant qu’artiste il ne peut pas changer cette société en pro-fondeur. Par contre il peut laisser la parole aux gens, provoquer un «effet boule de neige». C’est ainsi qu’il travaille. Cette action faite pour la Documenta peut paraître symbolique pour tous les autres, mais pour les
mille et une personnes y ayant participé, c’était bien réel. Ces personnes n’avaient pour la majorité jamais quitté leur village et jamais eu de passeport ou de visa, très difficiles à obtenir en Chine. Il a donc fallu les aider à effectuer ces différentes tâches administratives, mais aussi leur trouver une valise, un logement sur place, embaucher des cuisiniers pour la durée du voyage, etc. C’était une installation énorme, très lourde d’un point de vue logistique, qui a duré deux semaines, si mes sou-venirs sont bons. Elle était donc à la fois réaliste, uto-pique et symbolique. Comme souvent chez Ai Weiwei, il s’agissait de souligner l’idée qu’un changement est possible, tant à l’échelle individuelle que d’une société, et ce malgré la censure.
• Justement, comment peut-il encore oeuvrer alors que sa parole même est censurée ? Lorsqu’il était détenu et qu’il a été relâché en juin, les autorités lui ont dit assez ironiquement « vas-y, continue, fais de l’art ». En un sens, Ai Weiwei est exactement ce que le gouvernement veut qu’il soit, c’est-à-dire un chinois internationalement reconnu, un peu comme peuvent l’être les sportifs de haut niveau qui remportent des médailles olympiques pour la Chine. Ils l’encouragent donc à travailler. Ce qu’ils ne veulent pas, c’est qu’il parle de la société, alors que son oeuvre ne parle que de ça ! Lui demander d’arrêter ça, c’est amputer son travail. Au tout début de sa détention, il n’allait vrai-ment pas bien. Maintenant, il se sent beaucoup plus fort, plus combatif. Il recommence à travailler, pas vraiment comme il le souhaite, mais il est en tout cas un petit peu plus libre. Il continue de twitter, et, pour cette exposition au Jeu de Paume, beaucoup de journa-listes parisiens ont voulu l’interviewer, mais il n’en a pas le droit. En le faisant malgré tout, il court d’énormes
risques, notamment celui d’être maintenu en détention une seconde fois. Certains disent que le gouvernement chinois s’est rendu compte qu’il ne changera jamais et qu’il le laisse donc faire ; d’autres pensent que les autorités le punissent constamment et qu’au fond ça n’a rien à voir avec lui. Enfin si, bien évidemment, c’est lié à lui, mais ce qui ressort de tout ça, c’est qu’il est puni pour servir d’exemple. La stratégie consiste à le punir, puis le laisser sortir, puis le punir à nouveau, etc. En somme, les autorités ont transformé Ai Weiwei bien malgré lui en instrument leur permettant de faire pres-sion et d’être craintes des autres artistes.
• Quels sont malgré tout ses projets pour les mois à venir ? Il fait beaucoup de photos et travaille sur ses projets de sculptures. Même s’il est obligé de rester à Pékin, il parvient à superviser des expositions qui au-ront lieu à l’étranger, un peu comme ce qu’il a fait avec moi pour cette exposition à Paris, ou comme il l’a fait à Stockholm où son travail est aussi présenté en ce mo-ment. Il prend part à beaucoup de projets sans pouvoir s’y investir totalement ou autant qu’il le souhaiterait.
Ai Weiwei «Entrelacs»+ 21 février - 28 avril 2012 +
Jeu de Paume1 place de la Concorde
75008 Paris
Miroir, 1987. Série Photographies new-yorkaises, 1983-1993 Tirage C-print.

10 - CLAIRE PEILLOD
ARTTexte / Alexis Jama Bieri • Photos / DR
+ L’ART D’ÉCOLE +
CLAIRE PEILLOD
Fondée en 1748 par Louis-Jean Levesque de Pouilly, l’école des beaux-arts de Reims dispense, en ses temps anciens, un enseignement basé sur l’immersion du jeune artiste au cœur des œuvres de grands maîtres de l’art, tels Cranach, Dürer, Lebrun, Poussin ou Rubens. Devenue École Supérieure d’Art et de Design en
1992, l’école accorde une grande importance à la relation de l’art avec son environnement social et économique, même si la relation aux œuvres anciennes se fait plus distante, celles-ci appartenant depuis la révolution française aux collections du musée des beaux-arts de Reims. A la direction de l’établissement depuis six ans, Claire Peillod ancre ce lieu d’enseignement, vieux de plus de deux siècles, dans la contemporanéité des années 2000 naissantes
afin de former les créateurs indépendants et novateurs de demain.
• Pouvez-vous vous présenter ? Je suis directrice de l’ESAD de Reims depuis six ans. Auparavant, j’ai occu-pé à peu près toutes les positions qu’un(e) passionné(e) d’art contemporain peut avoir, sans être artiste elle même : critique (notamment dans Art Press), auteure de préfaces de catalogues, directrice artistique d’un événement urbain (la Fête des Lumières), créatrice d’un lieu de diffusion (la BF15), enseignante en Ecole Supé-rieure d’Art (à Valence, puis Saint-Etienne) et en Ecole d’Architecture (à Lyon), assistante à maîtrise d’ouvrage pour la commande publique auprès des collectivi-tés etc... Tout un tas de « petits boulots » qui m’ont beaucoup plu et beaucoup appris. Et qui me servent au quotidien dans la polyvalence de mes fonctions de direction.
• Comment est née votre vocation pour l’art ? Je ne viens pas d’une famille de musiciens, ce que je regrette, mais mes parents aimaient les belles choses, et les enfants fréquentaient une salle de peinture le mercredi après midi où l’on peignait avec les doigts… J’adorais. C’était nouveau dans les années 60 ! Ensuite, j’avais plutôt une vocation pour l’écriture, ayant fait khâgne et des études de lettres. C’est en écrivant sur l’art que progressivement j’ai abandonné la littérature et je me suis plus impliquée dans l’art contemporain, reprenant des études d’histoire de l’art à trente ans. En fait, je crois plus aux rencontres qu’à la vocation : j’ai rencontré des artistes, des galeristes, des conservateurs qui m’ont ouvert leur univers, m’ont transmis leur en-thousiasme, leur exigence et m’ont fait percevoir cette articulation du sensible et du conceptuel dans l’art.
• Comment et quand êtes-vous arrivée à la direc-tion de l’ESAD ? Je suis arrivée à Reims en 2005, à un moment de rupture totale dans ma vie personnelle et professionnelle. Ayant vécu jusque là à Lyon, je me suis trouvée dans la nécessité de partir, de changer de ville, et de vie. J’avais toujours rêvé diriger une Ecole d’Art, et ce fut Reims un peu par hasard. J’avais pos-tulé pour trois écoles à peu près au même moment. Je
ne l’ai jamais regretté, et m’en réjouis même tous les jours, même si les débuts furent difficiles. Le temps a passé, et j’ai la chance aujourd’hui d’avoir pu renouve-ler l’équipe pédagogique pour moitié, et mettre dans une dynamique de projets les nombreuses activités de l’établissement offertes aux étudiants. Tout cela est possible grâce au soutien de l’équipe municipale, qui aime cette école et qui la soutien dans un contexte difficile pour les finances publiques. Rappelons que la Ville finance l’ESAD à 85 % ! J’ai la chance également d’avoir une équipe pédagogique exceptionnelle : jeune, motivée, réactive et très compétente, c’est un bonheur renouvelé que de monter des projets avec eux ! Ils sont toujours solidaires et volontaires pour des aventures dans lesquelles embarquer les élèves. J’ai également pu développer l’équipe technique, elle aussi soudée et motivée, et un petit groupe de cadres très engagés pour leur Ecole et les étudiants. J’ai vraiment beaucoup de chance d’être à cet endroit là, en ce moment.
• Quels enseignements offre l’ESAD ? L’ESAD pro-
pose deux filières : art et design, avec deux spécialisa-tions majeures en design : le design d’objet et le design graphique-multimédia. Ces formations sont entérinées par deux diplômes : le DNAP (équivalent à la Licence, au bout de trois ans d’études) et le DNSEP (cinq ans) qui confère le grade de Master. Ces diplômes sont vali-dés par le Ministère de la Culture et de la Communica-tion, et par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. J’insiste sur le fait que nous sommes un établissement public, ce qui représente de nombreuses contraintes pour la pédagogie, mais ces contraintes sont une garantie pour la qualité de la formation. Nous formons des artistes et des designers généralistes, nous initions des démarches d’auteurs, dans la grande et noble tradition de l’Ecole des Beaux Arts.
Il faut savoir cependant que les années Master (la 4e et la 5e) ont désormais des couleurs variées selon les Ecoles, en lien avec le développement récent de la re-cherche, qui a été nécessaire pour valider le grade de Master. Ainsi, le design objet et espace est-il marqué
par des approches spécialisées en végétal et en culinaire, l’art par la question contemporaine des « artists run spaces » et le design graphique-multimédia par divers développements en design d’interaction, qui pense les nouvelles interfaces homme/machine. Chacune de ces orientations, ou spécialité, est portée par un ou des créateurs dont c’est le domaine, car l’artiste est au cœur du dispositif pédagogique. Deux exemples : Guillaume Leblon et Rozenn Canévet ont développé ce projet sur les « artists run spaces », parce que cela correspond à l’inscription de l’un comme de l’autre dans certains de ces réseaux. Cette prise en mains des conditions de production-diffusion-analyse-commercialisation de l’art par les artistes est portée par un engagement cri-tique, aux vertus pédagogiques certaines, et s’apparente au mode de travail insulaire développé dans l’option art : le groupe d’artistes/critique d’art, avec leurs étudiants, installés dans la friche de Franchet d’Esperey. Ce thème représente également des enjeux pour l’art contempo-rain dans lequel notre atelier fait figure de laboratoire.
Patrick Nadeau et Sara Lubtchansky qui portent la thé-matique du design végétal, sont engagés l’un comme praticien, l’autre comme organisatrice dans la transfor-mation de l’habitat et de l’architecture par le végétal. Nous travaillons actuellement à la végétalisation du bâ-timent de l’ESAD rue Libergier : pour cacher la misère de ce bâtiment de 50 ans d’âge, jamais rénové, mais surtout pour poser un manifeste. Il s’agit d’un proto-type de biotope vertical, alimenté par les eaux de pluies, quasiment sans entretien, conservatoire des plantes lo-cales, abri pour les oiseaux indigènes, et terrain d’acti-vité mellifère pour nos ruches, qui fournissent déjà près de 200 kg de miel par an. Rien à voir avec la première génération des murs végétaux, composés de plantes tropicales, entretenus à grand renfort de lumière artifi-cielle, d’eau publique et de phytosanitaire !
On voit avec ces deux exemples, que l’Ecole se posi-tionne comme terrain d’investigation POUR la société, dans les domaines de ses enseignements. L’Ecole d’art
« L’art se doit d’entretenir
l’humanité qui est en chacun, et qui me semble
menacée. »

CLAIRE PEILLOD - 11
ART
« Falaise » de Férréol Babin
« Culture d’eau » d’Olivier Cortes

forme les forces d’innovation d’une société, dans un mouvement permanent d’analyse critique et de projec-tion utopique. Son rôle est donc beaucoup plus large, plus essentiel à notre monde, que simplement délivrer des formations et des diplômes à des jeunes qui en ont besoin. J’ai coutume de dire que c’est le dernier endroit où les utopies sont possibles, et j’ai bien l’intention de défendre ce rôle, quelles que soient les difficultés du contexte. Nos partenaires universitaires, en Sciences Humaines et Sociales ou de l’ingénierie, ne s’y sont pas trompés. Nous avons reçu un accueil enthousiaste de certaines Ecoles ou universités, pour associer des cher-cheurs sur nos sujets. Par exemple sur la problématique du design d’interaction, piloté par trois designers gra-phique Olaf Avenati, Christian Porri, Mattieu Ersham, nous avons un partenariat très actif et enthousiaste avec l’Institut Telecom (ingénieurs, management) et le réseau des Fab Lab. Les deux équipes, coordonnées par la res-ponsable de la recherche à l’ESAD, Patricia Ribault, ont monté un Séminaire de deux ans sur l’Imaginaire des technologies tout à fait pertinent, et intègrent les cours de design de nos enseignants dans les formations d’in-génieur et manager. Nos étudiants sont associés dans les workshops et les ingénieurs travaillent sur les projets les plus prospectifs de nos élèves. Certains élèves ingé-nieurs ont fait des étincelles dans la dernière Semaine Folle à laquelle nous les avions invités. Ce fut pour eux une expérience décisive qui a bouleversé leur percep-tion de l’art et la place de la culture dans leur vie. De notre côté, ces spécialisations et partenariats ont permis de construire des réseaux et des contenus qui donnent du poids et mènent les projets des élèves à de nouveaux aboutissements. On se sent moins isolés dans nos pro-blématiques, et sur notre territoire, depuis la structura-tion de ces collaborations. C’est très motivant !
• Ainsi, l’ESAD propose un enseignement de de-sign culinaire. En quoi consiste cette discipline ?Le design culinaire est l’application des problématiques et méthodologies du design à l’alimentation. Le fait culinaire est le matériau du designer. C’est une pra-tique artistique -via la performance, et de design, -par ses relations avec les industries agro-alimentaires, que Marc Brétillot, a initié à l’ESAD il y a quinze ans, et qu’il pilote toujours, en parallèle à sa carrière interna-tionale de designer culinaire.
Il s’agit globalement de penser nos pratiques alimen-taires en lien avec nos modes de vies. L’enjeu est de taille, quand on s’interroge sur comment nourrir la planète à 7 milliards d’habitants ! Mais aussi comment penser de nouvelles formes de partage et de convivialité à l’heure de l’hyper -ou de l’omni- industrialisation. Travailler avec le culinaire induit une démarche senso-rielle et intime qui peut-être décisive dans la formation d’un artiste, quelque soit le champ d’exercice auquel il se destine au final. La nourriture met en jeu nos histoires familiales, nos appétits culturels, notre capa-cité au dépassement des habitudes, de façon intime et sociale. C’est un terrain d’approche très riche pour la création.
Notre antériorité internationale sur le sujet nous a per-mis de développer un post-diplôme en design culinaire, des formations continues, dans un atelier complet : cuisine pédagogique, designers, cuisinier, partenaires universitaires ou de la gastronomie. Nous avons un partenariat très actif et structurant avec l’Université de Tours (histoires et cultures de l’alimentation) et l’Ecole de Cuisine Grégoire Ferrandi. Et nous sommes sollicités
pour présenter ce travail dans le monde entier.
• L’ESAD développe t’elle ses actions de média-tion et de formation à l’attention de publics ex-térieurs à l’école ? Peut-on aujourd’hui intégrer votre école avec un parcours atypique ? Y-a-t-il une limite d’âge et des pré-requis obligatoires ? Il y a des cours pour adultes (peinture et dessin de modèle vivant) qui s’élargiront à la rentrée vers d’autres champs que ces disciplines académiques (culinaire, graphisme, retouche photo, par exemple). On peut intégrer l’école sans bac, sur dérogation, et les parcours atypiques ont toute leur place. Nous avons cette année intégré par exemple un jeune architecte algérien, avec un projet d’orientation précis. L’atypique est une nourriture indispensable pour une école supérieure d’art ! La seule limite est celle de l’âge, dans le cadre d’une for-mation initiale, avec le statut étudiant. La dynamique de groupe est essentielle, nous évitons les trop grand décalages.
• Quels sont les débouchés professionnels ? Pour reprendre les statistiques du Ministère : 85% des diplô-més ont un emploi dans leur domaine de formation dans l’année qui suit le diplôme. Les journées de « pro-fessionalisation » faites de rencontres étudiants /pro-fessionnels, de présentation des métiers et des statuts, que nous avons mis en place récemment sont là pour faire encore progresser l’insertion. Il vaut mieux faire aujourd’hui des études d’art que des études d’informa-tique ou de commerce… avec la dimension de déve-loppement personnel et d’adaptabilité que cela permet. Dans quel monde travailleront les jeunes que nous for-mons dans 30 ans ? La seule certitude, que l’on peut avoir, est que ce monde sera très différent du nôtre.
• Comment l’enseignement de l’ESAD fait-il le lien entre les bases classiques, l’expression contemporaine et les supports novateurs, notam-ment liés à l’évolution des techniques et techno-logies ? Dans la noble tradition de l’Ecole des Beaux Arts évoquée plus haut, le socle des études est la pra-tique plastique, l’enseignement artistique traditionnel élargi : dessin, peinture, photographie, volume, vidéo, photographie, son… Le dessin de modèle vivant, ou la photographie argentique, par exemple, sont toujours des enseignements fondamentaux. La pratique est dé-veloppée autour du projet de l’étudiant, la technique étant expérimentée au début dans le cadre d’exercices, puis choisie par chaque élève en fonction de son projet. Elle reste au service du projet artistique. Pour les acquis techniques plus spécifiques, ils sont pensés selon une progression et selon la spécialisation des élèves : tous
font du graphisme, mais le multimédia, motion design, web design est réservé aux designers graphiques, en rai-son du niveau de technicité. Tous les élèves font du des-sin technique en 1e année, puis de l’informatique 2D, mais les designers objet seuls s’exercent à la conception 3D pour piloter les outils de prototypage rapide spé-cifiques de l’Ecole (fraiseuses numériques, imprimante 3D, découpe laser). Ils ont ainsi dès la 3e année des compétences sur les outils les plus récents, ce qui leur donne un réel avantage pour leur insertion profession-nelle. Ils maitrisent des outils que les designers qui les embauchent ne maîtrisent pas !
• Quelles opérations développe l’ESAD pour la diffusion et la réflexion collective autour de l’Art ? Nous avons plusieurs programmes de confé-rences, dont l’un avec le FRAC Champagne Ardenne depuis cinq ans, sur les « pratiques contemporaines ». Nous organisons chaque année les Rencontres Interna-tionales de l’art et du Design, dont la troisième édition aura lieu en octobre sur les problématiques du végétal. Ces Rencontres se positionnent progressivement dans le paysage national, et nous permettent de donner des fondements théoriques à nos pratiques : ce fut le cas avec Les 400 goûts en 2010 qui ont traité du design culinaire, ou de l’Autoproduction, en art et en design, thématique des Rencontres 2011. Nous avons une jour-née Art et Philosophie en partenariat avec l’URCA, qui réunit artistes et philosophes dans l’évocation d’un grand texte philosophique et de son influence sur la création. Ce sera le 27 mars prochain une journée sur Pourparler de Deleuze. Toutes ces manifestations sont publiques et gratuites.
• Pouvez-vous nous parler de la Semaine folle, que l’ESAD organise chaque année ? Quel est son concept, son impact attendu et son rôle ? C’est une semaine intense de workshops (quatre jours) avec des intervenants venant de toutes disciplines et de tous pays, qui se partagent l’ensemble des étudiants, tous niveaux confondus. Les ateliers sont menés par des artistes ou designers, dans une perspective très interna-tionale, mais aussi par des créateurs issus de la musique, du spectacle vivant. À l’issue des quatre jours de tra-vail, les élèves font une présentation publique des réa-lisations. L’effet sur l’Ecole est d’intégrer les nouveaux étudiants, tout en lançant une dynamique collective et de création. La pédagogie est affaire de temporailité : il y a des temps longs, pour travailler en profondeur, favoriser l’assimilation, et des temps courts, comme la semaine folle, pour dynamiser, apprendre à vivre une épreuve de création avec bonheur. C’est l’occasion de sortir dans la Ville, installer des propositions éphé-
mères. Ce sont également des pratiques disciplinaires autres que celles enseignées à l’ESAD. Nous avons ainsi chaque année un chorégraphe différent proposé par le Manège de Reims, qui mène un atelier corporel… Nous recevrons l’année prochaine également le scénographe de l’équipe artistique de la Comédie. Césaré ou l’Opéra nous ont souvent proposé des artistes. C’est une chance pour l’ESAD que d’avoir ainsi à proximité et avec une grande complicité tout ce que la pensée et la création contemporaine peut aborder.
• Quelles collaborations mettez vous par ailleurs en œuvre avec les artistes et structures de création et de diffusion du territoire rémois et d’ailleurs ?Les institutions culturelles rémoises, nombreuses en spectacle vivant sont dirigées par des artistes de très haut niveau, qui mettent généreusement leur profes-sionalisme et leur carnet d’adresses à notre disposition. Nous avons de nombreuses collaborations : soit que les artistes invités dans ces structures viennent dans l’Ecole, soit que nos étudiants présentent leurs travaux en lien avec leurs domaines, chez eux, soit pour des workshops ou des conférences. Nous préparons éga-lement des événements culturels en commun : nous avons été associés à Reims Scène d’Europe, au Whaou Festival, nous serons impliqués dans l’inauguration des halles du Boulingrin etc... C’est d’une grande richesse pour l’Ecole, et je crois que cette amicale complicité, cette confiance réciproque entre institutions est assez exceptionnelle en France. En tous cas, je ne l’ai jamais rencontrée avec une telle qualité ailleurs. • Quels sont les artistes aujourd’hui renommés dans leur domaine d’activité, au delà de la Région Champagne Ardenne, issus de l’ESAD ? Parmi les plus jeunes, de très bons artistes : Laurent Montaron (Pensionnaire de l’Académie de France à Rome, la Villa Médicis 2012-2013) ou Julien Discrit, sparnassien re-présenté par la galerie Martine Aboucaya, à Paris, ont fait tout ou partie de leurs études à Reims ! Pour les designers, laissons encore un peu de temps aux géné-rations sorties depuis 10 ans pour devenir vraiment célèbres !
• Enfin, que diriez-vous pour inciter les étudiants à venir à l’ESAD ? Qu’est-ce qui fait de l’ESAD une école unique ? Dans le désordre et sans exhaus-tivité : l’état d’esprit, la dynamique de projet, les com-pétences et les qualités humaines des équipes, la taille de la structure, la politique d’exposition et d’édition, les partenariats d’entreprises, la démarche d’auteur, la convivialité, la vie culturelle rémoise, l’ouverture inter-nationale, les thèmes de recherche, la projection dans le futur… la créativité institutionnelle !
12 - CLAIRE PEILLOD
ART

MORGANE TSCHIEMBER - 13
Texte / Laetitia Chazottes • Photos / © Morgane Tschiember, « Space Oddity »ART
+ DE LA PEINTURE À L’ARCHITECTURE, UNE ODYSSÉE DES ESPACES +
MORGANE TSCHIEMBER
L’œuvre de la plasticienne Morgane Tschiember est hétérogène. L’artiste tend à multiplier les techniques et les protocoles au service d’ expérimentations plastiques singulières. Née en 1971 à Brest, primée
par la Fondation Ricard en 2001, Morgane Tschiember interroge l’espace explorant constamment la relation physique à l’objet. Le travail de la matière apparaît alors comme une priorité, une nécessité dans un
questionnement perpétuel des rapports entre peinture, photographie, sculpture et architecture. L’exposition “Space Oddity”, présentée au Centre d’Art Passage à Troyes jusqu’au 16 mars 2012, est pensée comme un contexte de révélation, il s’agit de réactiver des œuvres conçues entre janvier 2010 et janvier 2012. Cette proposition est la
première séquence d’une série de quatre évènements en 2012, avec, successivement, le CRAC (Sète), la Fondation d’entreprise Ricard (Paris) et la galerie Loevenbruck (Paris).
• Votre œuvre peut être qualifiée de «protéi-forme». Tour à tour peintre, photographe, sculp-teur, vidéaste, vous multipliez les techniques, les protocoles et les formats. Comment vous posi-tionnez-vous en tant qu’artiste ? Même si j’utilise des matériaux et des techniques différentes, mon travail reste très classique. Il n’est question que de rapports : rapport de la peinture au volume, du volume à l’archi-tecture, de l’architecture à l’espace, de l’espace au vide, du vide au plein, du plein à la surface, de la surface à la matière, de la matière à la couleur, de la couleur à la lumière, etc. C’est presque infini et en même temps ce n’est qu’une seule et même question: une question de rapports. Par ailleurs, qui dit rapport dit contact et donc « toucher ».
• L’exploration de la matière apparaît comme
un élément central de votre démarche artistique. D’où vient cette volonté d’expérimenter les qua-lités des matériaux ? Si je travaille avec le verre, le béton, le métal, ou encore avec des bonbons gélatineux - pour citer une matière différente - c’est que j’éprouve une difficulté excitante dans la découverte et l’utilisa-tion de nouveaux matériaux: une forme d’inconnu. La matière me dépasse, je sens la nécessité d’être “mal armée” devant elle. Je travaille les matériaux pour leurs qualités premières et j’en reste à des techniques très simples. Il n’est pas question de devenir un orfèvre dans l’art du metal. Pour le verre, par exemple, je n’utilise que du blanc et du transparent. Il n’y a pas d’effet de matière ni de formes complexes. La pièce est soufflée contre un modèle en béton s’inscrivant contre et avec lui. Elle est contrainte par le matériau. Mais comme le dit Robert Morris « Simplicité de forme ne signifie
pas nécessairement simplicité de l’expérience ». Utili-ser des matériaux différents ne change en rien le ques-tionnement. Les matériaux me donnent juste le moyen de réduire mon message à son essence et ainsi trouver d’autres terrains d’expérimentations.
• La diversité des matériaux que vous utilisez vous conduit régulièrement à travailler et colla-borer avec des sociétés de chaudronnerie, ferron-nerie, carrossier, etc. Pourquoi cet attrait pour le monde industriel et ses procédés ? Dès que l’on ne travaille pas seulement à l’échelle de la main mais que l’on aborde celle du corps ou de l’architecture, les be-soins diffèrent. Hélas, n’étant pas “Superwoman”, je ne peux soulever une tôle de trois cent kilos à bout de bras ! Il m’est donc impossible de travailler seule dans mon atelier ! On pourrait dire que c’est la principale raison.
Vient ensuite le plaisir d’aller dans ces entreprises. Cela me permet de découvrir de nouvelles machines, de nouveaux matériaux et ainsi d’élargir mon champ d’expérimentation. Les usines sont mon “méta-atelier”! J’aime ces lieux ! Je me sens chez moi lorsque je suis entourée de toutes ces machines qui contraignent les matériaux, testent leur résistance… Et puis l’art c’est avant tout un échange, un dialogue avec un critique, un galeriste, mais aussi un menuisier, un chaudronnier, etc.
• Dans votre œuvre la surface colorée est une récurrence. Quel rôle accordez-vous à la pein-ture ? La peinture est au centre d’un paradigme, elle tend d’un côté vers la matière et de l’autre vers la lu-mière. C’est ce vers quoi j’essaie d’orienter la peinture. Dans la peinture il y a quelque chose d’ancré depuis

« La matière me dépasse, je sens la nécessité d’être “mal armée”
devant elle. »longtemps en moi et qui ne me quitte pas. Elle s’est ins-tallée et fait pleinement partie de mon existence. Je ne la perçois plus comme un médium séparé du volume. Depuis toujours je peins sur des volumes - jamais sur de la toile. Du volume je suis passée à l’espace et à la lumière - ce qui est le cas pour Space Oddity au Centre d’Art Passage à Troyes.
• Votre travail est une réflexion sur la relation physique à l’œuvre et donc à l’espace, comment développez-vous le rapport entre volume et es-pace ? Et quelle est la place du corps dans cette réflexion ? Comment faire abstraction du corps dans lequel nous vivons ? Et surtout, n’est-il pas là notre premier outil ? C’est une question de phénoménolo-gie au premier degré. Même l’art conceptuel passe par le corps. Le corps est le lieu de toutes les perceptions. Exposer c’est organiser la rencontre d’un corps et d’un objet. Nous faisons partie de l’espace, nous le sentons et l’expérimentons et en même temps il reste insaisis-sable et fragile. Comme le dit Robert Smithson: « Le temps possède de nombreuses représentations anthro-pomorphiques mais l’espace n’en possède aucune. Il n’y a pas d’Epace-Père ou d’Espace-Mère. L’espace n’est rien et pourtant nous avons tous une sorte de foi vague en lui ».
• Toutes vos expositions peuvent être appréhen-dées comme des sortes de promenades, des déam-bulations, des « errances sensibles ». Dans votre actuelle exposition Space Oddity, vous remettez
en jeu et réinterprétez des oeuvres conçues entre janvier 2010 et janvier 2012, comment avez-vous pensé leur mise en espace ? J’ai travaillé en colla-boration avec le curateur de l’exposition Baron Osuna pour tenter d’organiser et de choisir au mieux les pièces à présenter. J’ai d’abord relevé ce que le lieu impose de part son architecture. L’espace du Centre d’Art est comme coupé en deux, il fallait donc réunir ces salles divisées : d’un côté des pièces avec des boiseries impo-santes d’une maison ancienne, de l’autre un white cube. La quantité de lumière qui entre dans ce bâtiment est relativement conséquente ce qui a conduit certains ar-tistes à en limiter la présence. Pour ma part, j’ai simple-ment décidé de recouvrir toutes les fenêtres d’un filtre jaune. L’ensemble de l’exposition est ainsi plongé dans un bain chromatique, une lumière jaune acide post-apocalyptique. Je voulais que l’on ait la sensation d’une lumière lointaine, venue d’ailleurs… L’exposition aurait pu se réduire à cela. Etant en hiver, j’ai pensé que si le temps était morne et nuageux, les spectateurs n’auraient pas l’oeuvre formellement disponible à tout moment. Concernant le choix des oeuvres j’ai choisi, aux côtés de Baron Osuna, un certain nombre de pièces susceptibles de pouvoir pleinement exister dans ce lieu. D’un côté se trouvent les Unspecific Spaces, qui sont des surfaces laquées renfermant un chaos pythagoricien. La présence de leurs reflets sur la vitre de la salle annexe qui par ailleurs est vide, les fait exister de manière fan-tomatique. Sont-ils ici ou ailleurs ? Ce questionnement est renforcé par le rapport des oeuvres à l’air. Sa pré-sence est partout : autour de chaque oeuvre mais aussi
enfermé dans cette salle nommée Space Oddity où seul un bouquet de fleur respire. De plus il y a mon souffle contenu dans l’oeuvre Bubble qui trône dans la verrière. De l’autre côté - du miroir - l’espace est traduit en un rythme, bitumeux dialogue avec un ou des motifs qui se répètent sur des grands verres et se décalent grâce à la lumière…
• Space Oddity peut se caractériser comme : « La même chose autrement ». Comment définiriez-vous cet autrement ? Autrement peut être vu comme le synonyme d’une autre ville, un autre contexte, un autre espace, une autre lumière… À chaque fois que les pièces sont mises dans un nouveau rapport, les oeuvres s’informent entre elles.
• Quels en sont les enjeux ? Il s’agit plus d’un jeu que d’enjeux.
• L’exposition au Centre d’Art Passages est la pre-mière séquence d’une série de quatre expositions personnelles en 2012, au CRAC de Sète, à la fon-dation Ricard et à la galerie Loevenbruck. Peut-on en savoir plus sur ces évènements à venir ? SWING ‘ND ROLLS & BUBBLES va démarrer le 6 avril au CRAC de Sète. J’ai conçu l’exposition en fonc-tion des trois salles qui m’ont été proposées et j’ai tenté d’instaurer une dialectique entre ces espaces en présen-tant trois séries assez distinctes. Trois salles impliquent donc trois mouvements: un swing pour la première, un roll pour la seconde et un souffle bubble pour la
troisième. Ce sont trois rapports de forces aussi, les pre-mières prenant appui sur les murs et le sol, les secondes se confrontant par rotation, les troisièmes soufflant contre la matière. C’est grâce à Noëlle Tissier, directrice du Centre d’Art, et à Oussmane Sylla, directeur d’une filiale d’Arcelor Mittal, que j’ai pu travailler à l’échelle du lieu et ainsi créer une installation de neuf mètres de haut par vingt mètres de long. Swing... est en lien avec des oeuvres réalisées précédemment comme Parallel ou encore Iron Maiden ; elle est cependant conçue spécia-lement pour le volume du Centre d’Art. Il s’agit d’une succession de seuils de métal aussi bien dans l’axe de la nef que dans les espaces intercalaires entre les douze travées qui délimitent deux déambulatoires latéraux. Il s’agit d’un travail sur l’apesanteur de la pesanteur. Le spectateur pourra se promener au-dessus ou en dessous de l’oeuvre. La seconde salle sera plus picturale mais je n’en dis pas plus… Quant au troisième espace ce sera la suite des Bubbles qui prendra, j’espère ici, une autre dimension. J’ai pu continuer cette série grâce à la carte blanche offerte par le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers. Pour la Fondation d’En-treprise Ricard, dont le vernissage aura lieu le 4 juin, il y aura une série d’oeuvres réunies afin de permettre aux spectateurs d’appréhender mon travail dans son ensemble avec comme curator Claire Moulène. Enfin, concernant l’exposition qui se déroulera à la Galerie Loevenbruck ce sera la cerise sur le gâteau et c’est donc une surprise !
14 - MORGANE TSCHIEMBER
ART


Pile rectangle bleue
16 - JULIEN NÉDÉLEC
ARTTexte / Isabelle Giovacchini • Photos / © Julien Nédélec, courtesy Galerie ACDC
+ EMPIRISME +
JULIEN NÉDÉLEC
Si ce n’était déjà fait, le public parisien a pu découvrir l’oeuvre de Julien Nédélec lors de la dernière édition de la FIAC. Présenté sur le stand de la galerie ACDC (Bordeaux), son solo show Comme une soucoupe qui ricocherait sur l’eau permettait de prendre la pleine mesure du potentiel de cet artiste nantais n’ayant pas
encore tout-à-fait trente ans mais déjà très présent sur la scène contemporaine française. Décomplexé et prolifique, il serpente habilement, avec tout le sérieux qu’impliquent l’humour et la légèreté, entre sciences et langage, art
conceptuel et histoire des techniques, faisant de l’empirisme et de la curiosité ses devises. Interview.
• Ton travail semble toujours osciller entre la volonté de tout classifier (Les dessins de tête, qui reprennent des têtes de vis) et, par glissements sémantiques, celle de bouleverser les différents systèmes de classification. Comment procèdes-tu ? Par empirisme. Je suis à la fois confronté au fait de ne pas parvenir à définir les choses, donc je choisis de jouer avec leurs frontières, ce qui me permet de ne pas avoir à classifier, à comprendre où les choses com-mencent et se terminent. Une sculpture peut aussi être une image, les choses sont multiples. J’aime cette idée de procéder au recensement des choses même si c’est toujours un peu vain, de tendre vers l’infini ou de me lancer dans des entreprises vouées à l’échec dès le dé-but. Pour Les dessins de tête par exemple, qui sont des gouaches de têtes de vis, j’ai trouvé vingt-six têtes diffé-rentes tout en sachant que ce compte n’est pas exhaustif ; j’imagine qu’il doit y avoir quelqu’un au Pérou qui a inventé une tête de vis inconnue de moi pour fabriquer sa mobylette. Ces décomptes, ces classifications me permettent de créer des systèmes clos, des boucles qui me donnent la possibilité de passer d’une oeuvre à une autre. Je dis souvent que je pratique un art de curieux, c’est-à-dire que j’ai envie d’apprendre, et grâce à mon travail, je peux découvrir de façon empirique beaucoup de choses.
• Peux-tu m’expliquer ton intérêt marqué pour un certain univers cartésien, fait de figures géo-métriques, de phénomènes optiques, de cartogra-phies que tu détournes justement de façon assez empirique ? Je ne sais pas. Je pense que ça vient d’un plaisir esthétique à la fois plastique et littéraire. Ce qui m’a le plus tenu à la littérature à une époque où je lisais peu, c’est l’Oulipo, qui est une pratique très ma-thématique de la littérature, faite de contraintes avec lesquelles il faut jouer. En découvrant l’art contempo-rain, j’ai tout de suite été touché par des formes plutôt modernistes où la géométrie est un motif récurrent. Ce qui m’intéresse en tant qu’artiste, c’est de m’approprier et réinterpréter de façon ludique des formes préexis-tantes de façon totalement non-euclidienne. Ainsi, je peux aussi bien jouer avec le son, l’édition, etc, qui sont autant de prétextes de création. Je suis souvent attiré par les mathématiques du fait de leur abstraction, cer-tainement parce que je suis plutôt un abstrait qu’un figuratif. Le langage scientifique m’a toujours semblé extrêmement poétique. Ne pas comprendre les choses et penser qu’elles sont de la poésie est assez rassurant, en somme.
• Beaucoup de tes pièces fonctionnent sur un mode opératoire systématique poussé parfois à l’extrême. Quelle place laisses-tu au hasard ? Pous-
ser jusqu’au bout des systèmes qui n’ont pas d’autre lé-gitimité ou valeur que celles que je leur confère donne souvent des résultats inattendus. Par exemple, pour une œuvre comme Cartons à dessins, j’ai réalisé douze car-tons d’invitation différents dans le cadre d’une exposi-tion à Astérides à Marseille. Je me suis donc préparé en mettant en place un système rigoureux, une partition, associant les différents cartons en grand nombre, pour créer une grande fresque inconnue. Avec de tels proces-sus, je deviens moi aussi spectateur de mon propre tra-vail. C’est assez proche des systèmes aléatoires et com-binatoires que John Cage ou François Morellet ont utilisé dans nombre de leurs œuvres et qui sont de l’ordre du hasard programmé.
• Lorsque je vois des oeuvres telles que Courbe inversée du travail (sorte de graphique fait de crayons taillés, que tu expliques en disant «Plus je travaille, moins il y a de crayons et inversement»), je me demande de quelle façon tu parviens à trou-ver le bon dosage d’humour pour ne pas tomber
dans le potache ou le caricatural. Je crois que je ne sais pas trop quand m’arrêter pour ne pas tomber dans le potache. Je crois surtout que mon travail me ressemble, et que je suis à la fois ironique, pince-sans-rire et j’essaie d’être drôle, donc mes pièces vont dans ce sens là. Étrangement, l’humour permet aussi une cer-taine forme de pudeur. En faisant une oeuvre qui peut paraître drôle, je me protège d’un aspect qui pourrait sembler plus poétique. Ensuite, quand je présente mon travail, je dis souvent de mes pièces qu’elles sont des blagues alors qu’évidemment je trouve qu’elles vont au-delà de ça. Ce qui permet un équilibre entre l’humour et tout ce qui est aussi présent dans mon travail, c’est qu’en partant d’une recherche très sérieuse, j’arrive à en tirer une blague ou créer un décalage. Par exemple, pour ma Courbe inversée de travail, qui révèle mon amour pour les formes des courbes statistiques, je suis parti d’un histogramme et donc d’une imagerie relati-vement austère. Cette esthétique très froide me permet aussi de créer un contrepoids à l’humour présent dans mes pièces. Sans être surproduite, ma production essaie
d’effacer le plus possible la trace de la main. Souvent, le décalage se trouve aussi dans les titres de mes pièces. Ils peuvent prêter à sourire mais sont pourtant des clés pour comprendre mon travail et le mener hors du seul terrain de l’humour. Courbe inversée de travail est simplement un boîtier en bois dans lequel des crayons sont taillés plus ou moins haut, ce qui crée une courbe faisant penser à un histogramme. Pour apprécier cette pièce il faut essayer de comprendre le jeu de langage qui a lieu entre sa forme et son titre.
• Souvent, ton humour passe par le langage, les glissements sémantiques. Dans Les gravures de modes par exemple, pièce qui reprend en gravure les modes ON et OFF de l’électronique, tout se joue et se dénoue par le langage de façon très ouli-pienne. Est-ce que le langage représente pour toi un matériau plastique à part entière ? J’aime utili-ser les mots pour ce qu’ils sont, et les langages les plus variés. Par exemple, l’une de mes pièces intitulée De beaux sons comme de belles images reprend le langage morse comme s’il s’agissait d’une image. Le langage devient forcément forme puisqu’il est une articulation de la pensée, de la même façon qu’un sculpteur pur et dur va amener ses idées par la matière. Ça n’est pas si éloigné de moi qui décide d’utiliser le langage comme une forme. D’illustres ancêtres comme Alphonse Allais ou Marcel Duchamp créaient déjà à partir du langage ; chez eux, le jeu de mot était le point de départ de l’oeuvre. Les gravures de modes est typiquement une pièce qui se révèle une fois que l’on a son titre sous les yeux. Elle est née de mon envie de faire de la gravure sur verre. J’aime beaucoup découvrir de nouvelles tech-niques. Mon travail ne se constitue pas uniquement de connaissances intellectuelles puisqu’il est fait de toute une gamme de connaissances artisanales. Lorsque je me suis acheté un graveur, j’ai eu l’idée de partir de l’idée de la gravure même, de graver des gravures. J’ai donc fait des recherches dans le champ lexical de la gravure et ai arrêté mon choix sur l’expression «gravure de mode» que j’ai ensuite détournée à la façon d’une boutade plastique.
• Tu travailles le papier depuis très longtemps. C’est un matériel assez traditionnel en art, sauf que celui que tu utilises est très bureautique puisqu’il s’agit de papier A4 conditionné en ramettes, donc en volume. Peux-tu m’expliquer la relation particulière que tu entretiens avec ce médium ? Lors de mes trois premières années de beaux-arts, 90% de ma pratique était faite d’éditions que je faisais à partir de mon imprimante. Je voyais que ces objets édités pouvaient potentiellement se dé-velopper au-delà de la forme papier. Lorsque je regar-
« Pousser jusqu’au bout des systèmes
qui n’ont pas d’autre légitimité ou valeur
que celles que je leur confère donne
souvent des résultats inattendus. »
* Ekphrasis : Description ou d’une représentation verbale d’un objet artistique visuel.

JULIEN NÉDÉLEC - 17
ART
Pile rectangle bleue

18 - JULIEN NÉDÉLEC
ART
dais mes livres, j’y voyais de la sculpture, du dessin, de la performance… Les livres étaient pour moi des sortes de «médiums pluri-médiums». Tout en étant des oeuvres abouties, ils pouvaient potentiellement devenir autre chose. Je faisais tout ça avec très peu de moyens : du papier, mon ordinateur, mon imprimante. Ça me permettait d’arriver à des formes achevées tout en ayant une économie réduite, en travaillant de façon autonome, dans mon appartement, sans être nécessai-rement à l’école. J’ai aussi un amour pour le livre en tant qu’objet. À la fin de ma troisième année, après mon DNAP, je me suis promis de ne plus faire de livre jusqu’à la fin de ma scolarité. Bon, évidemment, je n’ai pas tenu ! J’ai tout de même commencé à créer d’autres formes où j’utilisais toujours le papier. En par-tant du livre, en deux dimensions, je voulais passer à trois dimensions. Ça a finalement débouché sur une série d’oeuvres dont le titre est En 5 dimensions, comme s’il s’agissait de l’addition de deux et trois dimensions. Chacune de ces pièces est à la fois une sculpture et un poster imprimé recto-verso. Ça m’a permis de passer en douceur d’un médium à l’autre, de l’édition à la sculp-ture. J’ai depuis conservé cet amour pour le papier qui est un matériau aux possibilités quasi infinies. On peut aussi bien faire un mur en papier compressé que caler une table avec une feuille pliée ! Le papier, c’est quelque chose de très quotidien, c’est la fourniture minimum de l’univers bureautique, mais c’est aussi l’art pour tous. J’aime beaucoup les beaux papiers mais le papier en ramettes correspond mieux à mon économie, à mes oeuvres qui font référence à la vie de tous les jours au travers du standard A4. Faire une pile de papier A4, la peindre à la bombe, c’est déjà faire une peinture et une sculpture tout en conservant les propriétés de ces feuilles simplement empilées les unes sur les autres qui, une fois le temps de l’exposition passé, redeviennent des papiers brouillons dont je me sers dans mon ate-lier. Tout ça apporte une réelle légèreté à ma pratique artistique tout en questionnant l’idée de l’art pour tous. Cet art sur papier n’est pas forcément intelligible par tout le monde mais il est au moins accessible. Ca ne m’empêche pas de faire par ailleurs des oeuvres beau-coup plus produites dont le coût de mise en oeuvre est bien plus élevé. Il est très important pour moi de conserver cette double pratique. Si un jour je n’ai plus d’exposition, si mon économie devient plus précaire, je pourrais toujours produire ces pièces faites de papier.
• Est-ce que des oeuvres telles que La part du vide (sorte de puzzle parallélépipède formé à l’aide d’une chaise minimaliste et du vide qui l’entoure) ou Les fonds de l’eau (sculpture repre-nant en creux la forme de piscines) sont une fa-çon de t’intéresser à la tradition du moulage, du négatif, en somme de l’idée d’empreinte en art ? De toute façon, mon travail est une ré-assimimation de l’histoire de l’art contemporain. Aujourd’hui, on voit
tellement d’images défiler sous nos yeux que lorsqu’on a une idée de pièce on ne sait plus si cette idée surgit de nulle part ou parce qu’on a vu plus ou moins incon-sciemment quelque chose existant et y ressemblant déjà. Personnellement, j’ai décidé de faire des formes qui peuvent déjà exister et je l’assume totalement. Les formes négatives que j’utilise, comme pour Les fonds de l’eau qui sont des fonds de piscines municipales inver-sés, peuvent faire penser à Rachel Witheread ou encore Bruce Nauman, mais aussi à des formes architecturales. J’aime aussi l’idée que ces pièces sont comme un gla-çon fait avec l’eau de la piscine et démoulé. En fin de comptes, je me moque de savoir que quelqu’un d’autre ait pu avoir cette idée avant moi ou que certaines formes se rapprochent de celles de mes pièces. La part du vide est une oeuvre comparable à la pratique du mi-nimalisme tautologique que l’on pouvait voir dans les années soixante. En tant que spectateur, cette pratique tautologique me plaît vraiment et en tant qu’artiste, je me l’approprie ; je la sors de l’histoire de l’art pour le ramener à mon quotidien. Certes, ça crée des formes qui peuvent paraître austères et distantes mais qui font pourtant partie des éléments qui nous entourent. La part du vide est un parallélépipède de bois compact, très minimaliste, constitué de deux éléments qui s’imbriquent l’un dans l’autre et qui sont une table et une chaise, c’est-à-dire ce qui constitue le minimum de l’ameublement intérieur. La chaise est très présente dans l’art contemporain, est constitue, couplée à la table, l’endroit où se pense et se fait la création. Tout comme le reste de ma production, c’est finalement une pièce assez autobiographique, qui parle du travail en atelier, d’une certaine pratique de la sculpture, du plan et de la réflexion.
• Pour ton travail intitulé Les copistes, tu de-mandes à d’autres artistes de recopier un mono-chrome gris coloré, marquant ainsi les différents écarts de perception puisqu’il s’avère que des onze monochromes, aucun n’a la même tona-lité. Lorsque tu ne sollicites pas d’autres regards comme ici, comment fais-tu pour mettre en avant cette problématique liée à la perception ? Cette question de la perception fait partie de mes principales problématiques. Avec Les copistes, les gens visitent le lieu de l’exposition en ayant l’impression de regarder des énièmes monochromes accrochés à la façon de Sherrie Levine alors que ce qui m’intéresse personnel-lement est plutôt la question de la malfaçon liée à la reproductibilité d’une forme, ou encore constater que les choses nous échappent. Vouloir reproduire manuel-lement une forme tout en lui étant le plus fidèle pos-sible est en quelque sorte un échec programmé. Finale-ment, c’est plus l’idée de la traduction qui m’intéresse que celle de la perception : traduire une image en deux dimensions pour en faire une version en trois dimen-sions, traduire un texte en braille et l’agrandir de façon
à le rendre illisible, traduire un son en l’imprimant, etc. La traduction induit forcément l’idée de perception. Il y a quelques années j’ai édité un livre intitulé Alice au pays de Google. Ce livre était composé de la maquette originale d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll dont j’avais ôté le texte pour ne conserver que l’empla-cement des images. Celles-ci étaient elles-mêmes rem-placées par d’autres images sélectionnées selon Google lorsque je rentrais dans ce moteur de recherche la description textuelle des images de départ, à la façon des ekphrasis*. Evidemment, ça conduisait à une infi-nité de traductions par image, ça posait la question de la place de l’auteur et ça m’a permis de me demander comment me positionner en tant qu’artiste face à cette idée d’interprétation. Lorsque l’on fait une oeuvre, on l’orchestre tout en sachant que sa signification nous échappe. Par exemple, est-ce que la personne qui reçoit cette oeuvre et l’interprète devient une sorte de co-au-teur ? Je ne crois pas, mais cette question m’intéresse tout de même.
• Puisque nous parlons des Copistes, oeuvre collaborative, t’arrive-t-il souvent de faire appel à d’autres personnes pour des projets collectifs ? Lorsque j’étais étudiant, j’avais créé un collectif à géométrie variable dont j’étais le seul point fixe et qui s’appelait la République Bananière. C’était un groupe assez joyeux, à l’esprit proche de celui de Fluxus. On se réunissait et au bout d’un moment on se mettait à réfléchir sur une question, généralement assez idiote, et à créer à bâtons rompus à partir de cette question. On ne s’interdisait rien, que ce soit bien ou mauvais, et c’était extrêmement libérateur. C’était aussi un moyen de nous défaire pendant un moment de nos pratiques individuelles au profit d’un travail collectif basé sur des échanges. Par contre, j’ai eu peu de collaborations directes au sein de mon travail, peut-être aussi parce que je n’ai pour le moment pas rencontré les artistes qui me semblent aller dans mon sens à tous points de vues. Je n’ai pas envie de faire de concessions ou de produire une œuvre moins bien au travers d’une ren-contre qui modère les deux pratiques. C’est pourtant quelque chose que je voudrais tenter à moment donné. J’ai par contre collaboré avec des personnes plutôt liées à l’écriture ou à l’histoire de l’art, mais il s’agit plutôt d’un travail en amont que de la réalisation, d’une entre-prise d’écriture théorique commençant en même temps que l’oeuvre.
• La République Bananière ne produisait pas d’oeuvres, c’est bien ça ? C’était plutôt un temps de création réduit. On se réunissait autour d’une question de ce type : « Les règles de l’art sont-elles droites ? ». On montrait ensuite sur un site internet notre temps de création qui était ainsi rendu réellement visible. Le tout finissait sous la forme d’un journal imprimé au format A3, le Journal Officiel de la République Bananière, qui
était à la fois prétexte et finalité. Toutes les petites idées de création que l’on poussait plus ou moins loin étaient recensées, créant ainsi la micro-fiction d’une micro-nation. La République Bananière, qui demandait beau-coup d’énergie et de temps, a finalement disparu.
• Tu collabores souvent avec l’éditeur Zédélé qui te permet d’éditer certains de tes multiples. Selon toi, qu’apportent les idées de multiple, de repro-ductibilité à une oeuvre ? Plusieurs choses m’inté-ressent dans la reproductibilité. Déjà, ça me permet de diffuser plus largement mon travail. Si j’ai une pratique artistique, c’est pour que mon travail existe, et donc le multiple accélère cette diffusion. Même à l’époque où j’étais étudiant, mon travail se diffusait sans moi car j’avais produit des éditions. Ainsi, je rencontrais régu-lièrement des personnes ayant croisé mon travail, mes posters, mes livres, du fait de cette diffusion. J’aime aussi beaucoup les idées de gratuité, d’art pour tous. Si les artistes minimalistes et conceptuels m’ont beaucoup influencé, c’est à Fluxus que je dois cette idée de gratui-té, de générosité. Personnellement, j’ai découvert l’art contemporain en fin de première année aux Beaux-Arts d’Angoulème. J’y ai d’abord étudié dans l’idée de faire de la bande-dessinée ou de l’illustration. L’art contem-porain ne m’intéressait pas du tout, je l’ai découvert sur le tard et j’ai envie de partager cette découverte.
• Quels sont tes projets ? Actuellement, je pré-pare une exposition personnelle intitulée Déplacer les bornes et présentée à la Zoo galerie à Nantes aux mois de mars et avril. Ensuite je vais participer à différentes expositions collectives dont Ravine, sur une invitation de Guillaume Constantin, aux Instants Chavirés en avril à Montreuil. Mon travail sera ensuite visible lors de mon exposition personnelle au Musée des beaux-arts de Mulhouse à partir de juin. Voilà, en gros, pour le printemps !
• Déplcer les bornes, exposition personnelle
à la Zoo Galerie, Nantes, du 22 mars au 28 avril 2012.
• Independant, New-York (USA), stand de la revue 02,du 8 au 11 mars 2012.
• Mémoires d’éléphants, exposition collective, L’atelier, Nantes,du 13 mars au 8 avril 2012.
• Ravine, exposition collective, Instants chavirés, Montreuil,du 6 avril au 6 mai 2012.
• Exposition personnelle, Musée des Beaux-Arts de Mulhousedans le cadre de Mulhouse 012.
• Exposition personnelle, FRAC Pays de la Loire, Carquefou,du 27 septembre au 4 novembre.
La part du vide Stereos copies

Photos : carlos.fr designer
34 rue de Mars • 51100 Reims • 03 26 86 25 84

20 - KULTURINDUSTRIE
BOOKSTexte / Raphael Mandin • Photo / DR
+ CULTURE DE LA DOMINATION +
Kulturindustrie : raison et mystification des masses
Le risque est grand, pour une pensée qui se veut prophétique, de se voir démentie par le temps. Le mérite n’en est alors que plus grand, pour T.W. Adorno et M. Horkheimer, tant on peut constater combien les
analyses et les intuitions de la Dialectique de la Raison, ouvrage écrit pendant la guerre et publié en 1947, se sont révélées riches d’avenir et pertinentes afin d’éclairer notre époque. Les éditions Alia proposent, de manière
indépendante, la réédition d’un chapitre fameux de cet ouvrage, Kulturindustrie : raison et mystification des masses. C’est donc l’occasion de revenir sur le chemin parcouru et d’évaluer la portée de cette pensée, sombre et
pessimiste, sur l’avenir de la culture et sur le destin de l’art en particulier.
Afin d’apprécier le ton si particulier qui anime l’ouvrage, tout en urgence, fébrile et sincère, parfois emphatique, il importe d’être sensible au contexte de rédaction. Car la philosophie ne pouvait sortir indemne des camps d’extermination et il fallait dès lors que notre culture, à prétention humaniste et rationnelle, soit capable d’une radicale remise en question. L’enjeu, pour les deux fondateurs de ce qu’on nommera l’École de Francfort, consistait alors à produire une pensée critique de la rationalité par elle-même, à la mesure de la gravité de l’époque, une pensée capable d’une « vraie tristesse ». En effet, là nous serions enclin à interpréter les fas-cismes du XXe siècle comme une rechute accidentelle dans la barbarie de notre civilisation de l’humanisme, Adorno et Horkheimer y décelaient au contraire l’abou-tissement d’un lent processus de domination de la na-ture qui trouverait sa source dans la rationalité grecque et les Lumières. Car, si « la rationalité technique est la rationalité de la domination même », alors le nazisme ne fut pas un accident et nous sommes loin d’en avoir terminé avec le processus qui y a conduit.
En effet, on a tendance à oublier, en se focalisant sur la barbarie, combien les outils technologiques de do-mination qui rendirent cette idéologie effective sont encore les nôtres : les médias, la radio et le cinéma, la vitesse des flux, la propagande et la publicité, l’extrême rationalisation de la vie, le contrôle sécuritaire et admi-nistré des individus, le nivellement et l’absorption de la sphère privée. Car le triomphe de la Raison en occi-dent est celui d’une dialectique totalitaire qui absorbe toute extériorité, une entreprise lente, mais irrésistible, de désacralisation et de désenchantement du monde au profit des valeurs technologiques et capitalistes de rationalisation, d’efficacité et de rentabilité. Malins que nous sommes, techniciens, scientifiques et positivistes, dominateurs de la nature, fiers descendants d’Ulysse, nous sommes les non-dupes ; mais cette lucidité est notre aveuglement, car la technologie, omniprésente, est devenue notre mythe irrésistible, notre plus grande mystification, d’autant plus efficace qu’elle nous fait croire que nous sommes à l’abri de toute superstition. Ce ne sont pas les relents de mysticisme et de féti-chisme de la marchandise, selon la belle expression de Marx, ayant accompagné la mort récente de Steve Jobs qui vont contredire le propos de nos auteurs. Ainsi, « Industrie culturelle », ces termes nous semblent tel-
lement familiers désormais que nous avons oublié de nous étonner de ce qu’une telle alliance peut avoir de monstrueuse : « Ce qui est significatif, ce n’est pas l’in-culture crasse, la bêtise et la grossièreté. […] Mais ce qui est nouveau, c’est que les éléments inconciliables de la culture, l’art et le divertis-sement, sont subordonnés à une seule fin et réduits ainsi à une formule unique […] la totalité de l’industrie culturelle ». La démocratisa-tion de la culture n’est donc pas ce progrès que l’on aimerait y voir. À la suite des analyses de W. Benjamin sur l’art au temps de la reproductibilité technique, les auteurs montrent combien l’industrialisation de l’art transforme ce dernier en outil de domination afin d’ali-menter un système économique plus vaste à travers la recherche effrénée du best-seller, de la rentabilité, de l’efficacité, du nivellement par les « tubes », la star, les fans. Ce vocabulaire que convoquent les auteurs nous parait désormais tellement évident et quotidien qu’on a du mal à replacer cette pensée dans toute sa nouveauté : « Le culte des produits à bon marché implique que les individus moyens soient élevés au rang de héros. Les stars les mieux payées ressemblent à des images publi-citaires pour des articles de marques non spécifiées. ». L’uniformisation de la culture et des œuvres d’art obéit à la logique capitaliste et démocratique de l’offre et de la demande, de la production et de la consommation en laquelle l’individu n’est plus qu’un rouage alimen-tant le système. « Dès le début d’un film, on sait com-ment il se terminera » ; « Les mêmes bébés grimacent éternellement sur les pages des magazines, la machine à jazz pilonne éternellement ses rythmes. ». Ainsi, les ar-tistes et les œuvres d’art ne sont désormais plus que de simples épiphénomènes, dont le prétendu « style », en vérité publicitaire, vient renforcer le système dans son efficacité : « Dans l’industrie culturelle, le concept de style authentique apparaît comme un équivalent esthé-tique de la domination ». Aussitôt le style apparaît qu’il s’impose et domine, aussitôt est-il copié, dupliqué, reproduit et vendu en masse de manière industrielle, à satiété, pour nourrir l’exigence de culture des individus
qui alimente elle-même à son tour l’insatiable machinerie industrielle. On produit des films exactement comme on produit des voitures et des bombes. Car qu’importe ce qu’il y a sur l’écran, ce qui compte, c’est bien le temps de cerveau disponible, pour reprendre la lucide expres-sion de P Le lay. Ainsi, « la publicité devient l’art par ex-cellence avec lequel Goebbels déjà l’avait identifiée, l’art
pour l’art, la publicité pour elle-même, pure représen-tation du pouvoir social. ».
Le contenu de l’œuvre d’art n’est désormais qu’un pré-texte pour une entreprise publicitaire et propagandiste de domination totale de toutes les sphères de la vie humaine. « Et voici le résultat du triomphe de la pu-blicité dans l’industrie culturelle : les consommateurs sont contraints à devenir eux-mêmes ce que sont les produits culturels ». L’industrie culturelle devient alors à la fois le moteur et le symptôme d’une transformation radicale de l’homme : « La manière dont une jeune fille accepte un rendez-vous inévitable et s’en acquitte, le ton d’une voix au téléphone et dans la situation la plus intime, le choix des mots dans la conversation, voire toute la vie intérieure […] témoigne d’une tentative faite par l’homme pour se transformer lui-même en ap-pareil conforme jusque dans ses émotions les plus pro-fondes au modèle présenté par l’industrie culturelle. ».
L’effacement de la sphère privée et la lente transforma-tion de l’individu s’accomplit à travers une dialectique immanente de la « valeur travail » : nos désirs, notre pulsation vitale même, obéit désormais à l’offre et à la demande et nous sommes intimement persuadés qu’il faut toujours être « actif », être performant et donner le meilleur de nous-même dans tous les domaines de la vie. Il faut être intéressant, heureux et cultivé, autre-ment dit, être rentable, puisque dans nos sociétés de consommation et de spectacle « l’amusement est le pro-longement du travail ». Nous en venons ainsi à récla-mer et à contempler notre propre asservissement dans le moindre de nos désirs, dans la jouissance du divertis-
sement : « Dans les dessins animés, Donald Duck reçoit sa ration de coups comme les malheureux dans la réa-lité, afin que les spectateurs s’habituent à ceux qu’ils re-çoivent par eux-mêmes. » Mais il ne faudrait pas croire, naïveté de l’orthodoxie marxiste, que cette domination soit exercée, de l’extérieur, par une classe dominante qu’il suffirait de renverser. Au contraire, la domination est immanente à la rationalité elle-même et à l’emprise de la technique sur le monde : « même lorsqu’il arrive que le public se révolte contre l’industrie culturelle, il n’est capable que d’une très faible rébellion, puisqu’il est le jouet passif de cette industrie. ».
La pertinence de ces analyses et l’ampleur que prend désormais l’industrie culturelle au sein du capitalisme ne s’est jamais démentie. C’est là, peut-être, dans la ca-ractérisation d’une dialectique entre le spectacle, l’éco-nomie pulsionnelle et le Capital, dans l’immanence des jeux de pouvoir, que se tient la grande originalité de l’ouvrage, promise à une impressionnante postérité théorique, plus ou moins avouée, chez des auteurs aussi divers que P. Bourdieu, G. Debord, M. Foucault, J.F Lyo-tard, H. Habermas, R. Barthes, J. Baudrillard ou encore P. Sloterdijk parmi tant d’autres. Mais l’entreprise cri-tique s’avère au final amère et pessimiste. Certes, notre liberté est désormais totale, mais par là même totale-ment enfermée dans des réseaux de domination dans lesquels on passe son temps à vouloir reconnaître les siens et à espérer de la reconnaissance des autres et dont le but est d’alimenter la grande matrice techno-ration-nelle désormais productrice d’humanité.
Et s’il fallait encore convaincre le lecteur de la perspi-cacité de nos auteurs, il suffirait de cette citation en laquelle on aurait guère de difficulté à reconnaître une belle définition anticipée d’un très célèbre réseau social: « l’habitant des grandes métropoles [est] incapable de concevoir l’amitié autrement que comme « contact social » avec des gens avec lesquels il n’a aucun contact réel. ».
KulturindustrieTheodor Wiesengrund Adorno , Max Horkheimer
janvier 2012 - prix: 6,10 €
format : 10 x 17 mm
112 pages

Disponible chez • 2 impasse JB de la Salle, Reims • Ouvert les vendredis et samedis de 14H à 19H.

22 - THE ENGLAND’S DREAMING TAPES
BOOKSTexte / Raphael Mandin • Photos / DR
+ L’AUTRE VERSANT DE LA CRÊTE +
The England’s Dreaming Tapes
Jon Savage publiait, en 1991, England’s Dreaming, une monumentale anthologie du Punk anglais principalement axée sur les Sex Pistols (2002 pour la traduction française, Allia). L’ouvrage a fait date
dans l’historiographie rock et s’est imposé depuis comme étant la biographie la plus complète et la meilleure synthèse de cette période. Savage avait alors réalisé un travail de terrain colossal, procédant à plus d’une centaine
d’interviews de tous les acteurs de l’époque, des plus connus (Malcom McLaren, Johnny Rotten, Joe Strummer etc.) aux plus discrets (les vendeurs de la boutique Sex, les fans, les photographes et journalistes de l’époque) en passant par des protagonistes jusqu’alors restés dans l’ombre (Warwick Nightingale, co-fondateur du groupe et guitariste, viré en 1975 ou encore Anne Beverley, la mère de Sid Vicious). C’est ce matériau de recherche, qu’il n’avait pu
intégralement restituer, que J. Savage nous présente désormais dans The England’s Dreaming Tapes que viennent de traduire et d’éditer en français les éditions Allia.
Lorsque J. Savage réalisa ces entretiens, entre 1988 et 1989, le mouvement punk avait, depuis longtemps déjà, baissé le rideau. Entre temps, les années 80, celles de Thatcher et Reagan, avec leur cortège d’optimisme New Age, leur son FM et leur visuel MTV, avaient englouti les dernières flammes qui animaient l’énergie punk du désespoir. La révolte était finie et il devenait possible de faire les comptes. Le but avoué de Savage, à travers chacun de ces entretiens et de ces illustrations, est d’offrir un témoignage brut sur le quotidien et les enjeux sociaux-politiques de cette fin des années 70. Ainsi se justifie le choix de classer les interviews selon un découpage thématique en privilégiant les lieux, comme autant de centres névralgiques et de points de bifurcation. De Londres à New York, en passant par les salles de concerts mythiques, jusqu’à la mort de Sid Vicious, on découvre ainsi d’étonnantes ramifications. Tout part de la boutique Sex, de Malcom Mc Laren et Vivien Westwood, simple sex shop londonien au départ, devenu une boutique de mode où gravitent tous les zonards de l’époque. Le lieu va devenir rapidement le centre névralgique et bouillonnant du mouvement
punk. Le groupe des Sex Pistols, initialement pensé comme produit marketing et publicitaire pour la bou-tique et ses fringues, fera alors boule de neige, un « dé-rapage contrôlé » selon la belle expression de Savage, dans une Angleterre ravagée par la crise et les tensions sociales. Ces contradictions initiales donneront au mouvement punk un destin chaotique et sinueux, où le cynisme de dandy d’un Mac Laren se conjugue malgré lui aux plus sincères revendications politiques issues de la rue, dont Joe Strummer espérait traduire la révolte. De même, avec le recul, l’étonnante déflagration punk en Angleterre contraste énormément avec sa réception aux USA, où l’élan ne prendra jamais vraiment. Dans une Amérique abîmée par le Vietnam et lasse des luttes intestines des 70s, elle ne gardera du punk que son aspect le plus nihiliste, par exemple avec les destroys et particulièrement junkies New York Dolls.
« En histoire, je ne m’intéresse qu’aux anecdotes » au-rait dit Prosper Mérimée. et c’est le grand intérêt de ce livre, en laissant la parole s’exprimer de manière singu-lière et en laissant chacun refaire son parcours person-
nel, que de rentrer dans l’histoire à voix basse, par la petite porte, à même le vécu dans tout ce qu’il a de plus concret, d’intime et anecdotique, mais par là même d’humain, avec tous les relents de médiocrité, mais aussi les instants de grâce que cela suppose. Et derrière la « mythologie » punk, une fois que les masques sont tombés et que la tragédie du « no futur » s’est achevée, on découvre qu’il y avait des hommes et des femmes en quête d’un futur, animés par le désir de s’en sortir et de résister, en proie à l’angoisse, aux problèmes d’argent et de jalousie. Ainsi les entretiens se croisent, parfois se contredisent, adoptant chacun une certaine perspective évidemment partiale. Les souvenirs sont parfois altérés ou réinterprétés par l’occupation du moment. La nos-talgie s’accompagne de rancœurs et de ressentiment liés aux magouilles innombrables et aux procès qui s’ensui-virent. Ainsi, il faut entendre Mc Laren cracher dans la soupe : « Rotten n’a jamais eu une once de talent musi-cal. […] Il détestait le rock-n roll. Il détestait vraiment ça. ». Mais on y apprend, aussi bien, que Rotten allait se confesser tous les dimanches à l’église avec sa mère, même après la sortie de l’album, ou encore que les Sex
Pistols, contrairement à la légende, étaient pointilleux et attentifs à l’acoustique de la salle. De même, dans une interview touchante, on écoute la mère de Sid Vicious raconter comment elle lui a fourni, au dernier acte, sa dose mortelle d’héroïne, pure à 93%. Ainsi, en punk comme ailleurs, si Dieu sauve la reine, le diable est dans les détails. Et de diable, il fut beaucoup question dans l’histoire du punk. Au final, à lire ces entretiens, on ne sait jamais vraiment avec les Sex Pistols quelle est la part de provocation (savamment calculée par Mc Laren) et la part de spontanéité. Mais si l’ouvrage se termine avec la mort de Sid Vicious, dont l’absence hante indiscu-tablement chacun des protagonistes, c’est justement parce qu’il fut de tous le seul à aller jusqu’au bout, celui pour qui le dérapage ne put être contrôlé.
The England’s Dreaming TapesJon Savage
octobre 2011 - prix: 30 €
format : 170 x 220 mm
736 pages

THE ENGLAND’S DREAMING TAPES - 23
BOOKS

24 - BERENICE ABBOTT
EXPOSITION
Berenice Abbott, Portrait de James Joyce avec un bandeau, 1926. Épreuve gélatino-argentique Ronald Kurtz / Commerce Graphics • © Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.
Texte / Isabelle Giovacchini • Images / © Berenice Abbott, courtesy Jeu de Paume
+ CHANGING PHOTOGRAPHY +
BERENICE ABBOTT
L’exposition Berenice Abbott (1898 - 1991) présentée au Jeu de Paume du 21 février au 29 avril 2012 est la première rétrospective en France de cette photographe américaine ayant traversé le XXe siècle. Si Abbott
occupe une place essentielle dans l’histoire de la photographie, certains aspects de son travail ont pourtant été trop souvent ignorés. En cela, l’exposition permet de réhabiliter la somme d’un travail riche et complexe. Au fil des salles, on croise ainsi une Abbott tour à tour portraitiste, photographe scientifique ou d’architecture. Si elle excelle dans ces différents domaines, ses vues urbaines sont particulièrement époustouflantes. Interrogeant tout au long de sa carrière la question du documentaire, elle parvient, notamment à travers sa série Changing New York (1935-1939), à transformer les édifices de métal et de béton de la mégalopole américaine en de lumineuses apparitions
presque expérimentales. Jouant avec les perspectives et les éclairages, ses vues de nuit méritent à elles seules le déplacement jusqu’au Jeu de Paume. Entretien avec Gaëlle Morel, commissaire de l’exposition.
• De quelle façon êtes-vous parvenue à rendre compte de façon rétrospective du travail de Be-renice Abbott pour cette exposition au Jeu De Paume ? Cette exposition est construite en plusieurs parties. Cinq salles permettent de rendre compte des différentes étapes de la carrière de Berenice Abbott qui est une photographe qui a traversé tout le XXe siècle. La première salle est organisée autour du portrait, puisqu’elle a eu un studio de portrait ; elle a en effet été formée dans le studio de Man Ray pour ensuite ouvrir son propre studio. La seconde salle de l’exposition montre les images prises lors de son retour aux Etats-Unis, à New York, alors qu’elle découvre cette ville en train de se transformer. On peut y voir les pages de ses albums qui lui permettent de solliciter les institu-tions new yorkaises pour obtenir des subventions. Une salle est ensuite consacrée à son grand projet photo-graphique intitulé Changing New York. La quatrième salle montre ses projets réalisés dans le Sud et la côte Est des Etats-Unis. L’exposition se termine sur une salle où sont accrochées ses photographies scientifiques réa-lisées au Massachusetts Institute of Technology à la fin des années 50. Elle y enregistre des phénomènes physiques normalement invisibles à l’oeil nu qu’elle parvient à capter grâce à la technique photographique. Il m’a fallu articuler l’exposition en plusieurs chapitres pour rendre compte de la très longue carrière de cette photographe.
• L’exposition s’organise donc autour de cinq thé-matiques. D’un point de vue formel, comment se recoupent les différentes manières de photogra-phier d’Abbott ? Y a t’il un dénominateur com-mun ? Durant toute sa carrière, Berenice Abbott ambi-tionne toujours de tenter de définir ce que serait une photographie documentaire. Elle se demande toujours quelles informations une photographie peut apporter, même si elle ne néglige jamais l’aspect esthétique de ses prises de vues. Bien sûr, la question du document est modifiée en fonction des thèmes et des sujets re-présentés. Lorsqu’il s’agit de phénomènes abstraits et
physiques comme dans ses photographies scientifiques, le document prend une toute autre valeur que quand il s’agit de représenter un immeuble New Yorkais. Ce qui intéresse Berenice Abbott, c’est vraiment le rapport qu’entretiennent réalisme et photographie, ce qui n’est pas incompatible avec son grand intérêt pour la mise en forme. Elle était très opposée au mouvement picto-rialiste, ce mouvement photographique qui a vu le jour à la fin du XIXe siècle et qui manipule beaucoup les images par l’intermédiaire d’effets de flous, de tirages vaporeux et charbonneux, ressemblant plus à de la gra-vure ou à de l’estampe qu’à de la photographie. Abbott adopte la démarche inverse en explorant les limites de la photographie, de ce qu’un tel médium peut avoir à offrir, que ce soit par les détails, le rendu minutieux des matières et des contrastes, les lumières, ou en jouant sur les perspectives. Ce sont les phénomènes optiques qui l’intéressent.
• Comment est-elle parvenue à tirer la photogra-phie documentaire, appliquée ou de commande vers des formes plus esthétiques qui font que l’on considère maintenant cette photographe comme étant une artiste à part entière ? Le style documen-taire est pensé dans les années 30 par les photographes qui l’utilisent comme un style tout à fait compatible avec une visée artistique. Par exemple, Walker Evans est lui aussi toujours considéré comme un artiste alors qu’il utilisait un style documentaire. Le fait de fournir des informations en images tout en voulant créer une oeuvre n’est pas antinomique. La photographie permet ce jumelage.
• En quoi le regard de Berenice Abbott était-il no-vateur par rapport à ses contemporains ? En quoi se démarquait-elle des autres ? À mes yeux, elle est une photographe qui a la faculté d’adapter sa photo-graphie en fonction du sujet qu’elle veut représenter. C’est une grande technicienne ; elle sait très bien uti-liser l’appareil photographie, elle invente même des boitiers et améliore des procédés, elle a une capacité à
« Ce qui intéresse Berenice Abbott,
c’est vraiment le rapport
qu’entretiennent réalisme et
photographie, ce qui n’est pas
incompatible avec son grand intérêt pour la mise en
forme. »

BERENICE ABBOTT - 25
EXPOSITION
Berenice Abbott, Portrait de James Joyce avec un bandeau, 1926. Épreuve gélatino-argentique Ronald Kurtz / Commerce Graphics • © Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.

26 - BERENICE ABBOTT
EXPOSITION
Berenice Abbott, Photomontage, New York, 1932. Épreuve gélatino-argentique, 11 x 20 cm Ronald Kurtz / Commerce Graphics • © Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.

BERENICE ABBOTT - 27
EXPOSITION
Berenice Abbott, Photomontage, New York, 1932. Épreuve gélatino-argentique, 11 x 20 cm Ronald Kurtz / Commerce Graphics • © Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.

faire jouer la lumière, les points de vues en fonction des thèmes abordés. Elle n’applique ainsi pas une recette au préalable. Elle adapte son appareil photographique au sujet qu’elle veut révéler.
• Les portraits d’Abbott participent à sa noto-riété, notamment ceux d’artistes tels que Du-champ, Man Ray, Cocteau, Joyce, et bien sûr Atget qui ont aussi beaucoup défendu son tra-vail. De quelle façon a t-elle rencontré ces per-sonnalités ? Elle fait leur connaissance après avoir quitté l’université, lorsqu’elle arrive à New York. Elle y fréquente les milieux underground et artistiques. Elle veut déjà devenir artiste, elle est d’ailleurs plutôt inté-ressée par la sculpture à ce moment là. C’est dans ce milieu qu’elle rencontre tout d’abord Marcel Duchamp et Man Ray. Quand elle quitte New York pour Paris, elle retrouve ces exilés américains. Ils sortent ensemble, partagent des ateliers, se rencontrent dans des cafés ou au cours de soirées, trouvent du travail… Quand elle retrouve Man Ray au milieu des années vingt à Paris, il lui offre du travail comme assistante. C’est de cette façon qu’elle se forme à la photographie. Elle fait donc partie intégrante de ce cercle d’artistes avant-gardistes parisiens, ou avant cela, new yorkais.
• Avant d’être photographe, Abbott souhaitait de-venir sculpteur. De quelle façon cette formation a t’elle influencé son approche de la photographie ? Personnellement, je n’ai jamais vu ses sculptures. Donc je n’en ai aucune idée. En tout cas, elle sait jouer de la
lumière et du graphisme sur les personnes, les archi-tectures et elle a un sens de la composition très déve-loppé. J’ai par contre vu des dessins et des esquisses à la plume, brossés assez rapidement mais il s’agissait là plutôt de travaux préparatoires. Ce qui est intéressant, c’est qu’au départ elle n’a pas du tout l’ambition de devenir photographe, mais elle cherche un emploi et pense simplement que travailler dans l’atelier de Man Ray va lui permettre de subvenir à ses besoins. Finale-ment elle y prend goût et s’enthousiasme pour ce nou-veau médium dans lequel elle va exceller.
• Malgré son approche presque documentaire, est-ce que Berenice Abbott était une photographe expérimentale, à la façon des surréalistes ou de la Nouvelle Objectivité ? Non. Elle expérimente un peu, par le biais de distorsions, de surimpressions, mais il s’agit plus de tests que d’un réel parti pris. Elle est vraiment plus intéressée par cette question du docu-ment dont nous avons parlé. Elle cherche avant tout à comprendre comment un style peut permettre d’avoir une photographie à la fois porteuse d’informations et esthétiques. Elle n’a jamais réellement été surréaliste et n’a pas non plus fait partie de la Nouvelle Objecti-vité. Malgré tout, son travail adopte des points de vues proches de ce mouvement puisqu’elle réalise souvent des vues en plongée ou en contre-plongée, qu’elle fait des bascules, utilise des angles inusités, renouvelle les perspectives. Elle est donc traversée par ce courant qu’elle connaît très bien et qu’elle adapte en fonction de son style et du sujet photographié. Lorsqu’il s’agit
par exemple de célébrer une forme de modernité archi-tecturale, elle sait qu’une contre-plongée sera très effi-cace, très esthétique et elle n’hésite pas à l’utiliser. Par contre, à ma connaissance, elle n’a jamais effectué de solarisation.
• Pouvez-vous me parler de ses photographies scientifiques, qui paraissent de prime abord être en marge de sa production ? Elle est embauchée par le MIT au moment où la concurrence scientifique et économique commence à s’accélérer entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique à la fin des années cin-quante, en pleine période de Guerre Froide. Au sein du MIT est créé un comité scientifique chargé de donner envie à la jeunesse américaine de se former à la science, de façon à ce que les Etats-Unis aient des ingénieurs de qualité. Au sein de ce comité est engagée Abbott. Elle doit y produire des photographies qui vont notamment être diffusées dans les manuels scolaires. Ces photogra-phies doivent être suffisamment attirantes pour susciter des vocations scientifiques chez les jeunes américains et leur donner l’envie de remplir leurs devoirs de citoyens une fois adultes. Ces photographies sont pour le coup un peu plus expérimentales, puisqu’il s’agit pour Abbott de travailler autour de phénomènes invisibles tels que le mouvement de la lumière, le déplacement des ondes… Ici, il s’agit vraiment de manipuler des appareils et de tenter de capter des choses impalpables, invisibles à l’oeil nu. Ces photographies sont amenées dès le départ à beaucoup circuler, par l’intermédiaire d’ouvrages, de manuels scolaires, mais aussi d’une exposition qui
va voyager dans tout le pays, toujours pour essayer de montrer les qualités positives de la science, de la phy-sique, et de mettre l’accent sur la nécessité pour le pays de s’engager dans ces voies pour concurrencer l’Union Soviétique.
• De son travail Changing New York, Berenice Abbott disait qu’ «Il était nécessaire de position-ner l’appareil photographique avec soin. Ces photographies ne sont pas le fruit du hasard». Comment composait-elle ses images ? Elle travaille à la chambre, avec un matériel assez lourd. Elle accorde beaucoup d’importance à la lumière, aux conditions météorologiques, à l’emplacement de sa chambre. Chaque image prend beaucoup de temps. C’est un travail très laborieux, très lent, qui permet d’aboutir à des négatifs de grand format donnant des images d’une précision extrême lorsqu’ils sont ensuite reproduits par contact. Cela induit la mise en place d’un protocole assez rigoureux, où exigence et savoir-faire technique sont très importants. Nous parlions tout à l’heure d’expérimentations et pour moi, c’est là qu’elle expé-rimente vraiment. Ses photographies de nuit sont par exemple très esthétiques mais aussi très difficiles à réa-liser. C’est là qu’elle explore la photographie, ses pos-sibilités, repousse ses limites techniques et artistiques.
28 - BERENICE ABBOTT
EXPOSITION
Berenice Abbott, Gunsmith et quartier général de la police, 6 Centre Market Place et 240 Centre Street, New York, 4 février 1937. Épreuve gélatino-argentique, 19 x 24,5 cm Museum of the City of New York. Gift of the Metropolitan Museum of Art © Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.
Berenice Abbott, Mineur, Greenview, Virginie Occidentale, 1935. Épreuve gélatino-argentique, 25 x 19 cm Ronald Kurtz / Commerce Graphics • © Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.

BERENICE ABBOTT - 29
EXPOSITION
Berenice Abbott, Mineur, Greenview, Virginie Occidentale, 1935. Épreuve gélatino-argentique, 25 x 19 cm Ronald Kurtz / Commerce Graphics • © Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.

30 - BOTOX(S)
ASSOCIATIONTexte / Julia Ségovie • Photos / © Botox(s)
+ ASSOCIATION D’IDÉES +
BOTOX(S)
Avec un nom évoquant ces liftings ratés que l’on peut admirer en toutes saisons sur la Promenade des Anglais jusqu’à la Croisette, Botox(s) n’est pourtant pas un institut chirurgical non remboursé par la Sécurité Sociale. Bien au contraire, Botox(s) est l’une des associations d’art contemporain les plus actives des
Alpes Maritimes, puisqu’elle regroupe pas moins de vingt centres d’arts, galeries et musées à Nice et ses alentours. Contribuant au dynamisme de la scène locale par le biais d’expositions et d’événements tels que Les visiteurs du soir, Botox(s) fédère artistes et institutions sous un même étendard. Les différents membres de l’association ont pourtant l’ambition de ne pas être obtusément régionalistes. Ainsi, en favorisant les échanges avec les structures culturelles avoisinantes, Botox(s) permet à la création azuréenne de rayonner en dehors de son seul territoire et
donne la possibilité au public niçois d’enrichir ses connaissances en matière de création contemporaine. Entretien avec Cédric Teisseire, artiste, Président de Botox(s), fondateur et directeur de La Station.
• Comment est né Botox(s) ? Fin 2007, Sandrine Mons (Galerie Sandrine Mons), Hélène Fincker (Maison Abandonnée) et Bérengère Humblet (alors assistante de direction de l’Espace A VENDRE et actuelle coordina-trice du réseau), face au constat de la conjoncture et de la mauvaise diffusion et visibilité du paysage artistique niçois, se réunissent pour rédiger un courrier aux lieux d’art contemporain de Nice (associations, galeries, friches, centres d’art, musées…). L’objectif de ce cour-rier est de provoquer une rencontre, de réunir les atouts de chacun et d’ainsi travailler d’avantage ensemble, no-tamment par le biais de communications communes, du rassemblement et de l’organisation des différents vernissages de la région, du partage des voyages de presse, etc...
• Pourquoi avoir choisi ce nom ? Lors d’une réu-nion où nous cherchions un nom, nous sommes entre autres tombés sur Botox(s), qui faisait un pied de nez aux femmes botoxées de la Côte d’Azur. Ce second degré nous a permis de prendre à contrepied tous les clichés que la Côte d’Azur génère. C’était pour nous une façon d’exorciser ces poncifs. Finalement, le public se l’est facilement approprié et la blague s’est imposée d’elle-même.
• Botox(s) regroupe une vingtaine de lieux. Est-ce difficile de fédérer autant de structures ? L’orga-nisation s’est faite petit à petit, en commençant par regrouper une petite dizaine de structures, tels que le Centre d’Art de la Villa Arson, les Musées Nationaux, La Station, L’Espace A VENDRE, De L’ART - qui à l’origine était le Dojo -, la Maison Abandonnée (Villa Cameline), la galerie Sandrine Mons, l’atelier Soardi, la galerie Nor-bert Pastor, et la Sous-Station Lebon (Projet Diligence). Travailler solidairement est extrêmement important pour nous, même si nous faisons en sorte, et ça n’est pas toujours simple, que les caractéristiques de chaque lieu soient respectées. Botox(s) est une structure où les idées, les avis, les positions sont rarement modérés, ce qui rend les modes opératoires plus difficiles à fluidifier depuis que le cercle s’est agrandit. Mais tout le monde garde à l’esprit la nécessité d’une telle entreprise, ce qui nous permet finalement de proposer au public une offre cohérente et solide. Comme le milieu culturel niçois est très volatile, plusieurs lieux ont malheureusement fermé leur porte depuis l’existence de Botox(s). Cette association permet de faire face à cette réalité, de gar-
der un noyau dur et vivace. Cette mise en relation des différentes structures est d’ailleurs grandement facilitée par la présence d’une coordinatrice au sein du réseau.
• De façon concrète, comment agit Botox(s) pour défendre et diffuser la création contemporaine ?
Botox(s) synchronise les vernissages de chaque struc-ture qui la compose et propose par ailleurs un Parcours d’Art Contemporain mensuel : les Visiteurs du Samedi. Cet événement récurrent permet à tous les publics de découvrir les expositions d’une sélection de lieux d’art contemporain à Nice mais aussi à Saint Paul de Vence,
Mouans-Sartoux, Mougins, Biot ou encore Monaco. Ces parcours permettent également une vraie ren-contre avec les acteurs directs tels que les directeurs de Centre d’art ou de Musées, les médiateurs, les artistes, les galeristes, les commissaires d’expositions, etc.Suivant le même principe, le nocturne d’art contem-porain Les Visiteurs du Soir est organisé annuellement depuis 5 ans, de 15h à 1h du matin dans une trentaine de sites à Nice. Les Visiteurs du Soir est un événement gratuit qui propose tout d’abord de prolonger l’ouver-ture des différents lieux participant jusqu’à 22h. Chacun propose, en fonction de ses orientations et de sa programmation, des expositions, des performances, des rencontres, des happenings, ou encore des projets ambulants et innovants. L’événement se termine avec une clôture festive sur une plage ou dans un lieu public en fonction des années. La prochaine session des Visi-teurs du Soir se déroulera le samedi 26 mai 2012. Par ailleurs, des projets ponctuels sont imaginés chaque année, pour ouvrir et aller à la rencontre des publics. Par exemple, les Traversées du Territoire est une pro-grammation où des «artistes marcheurs» proposent au public de (re)découvrir un endroit de la ville de Nice de façon originale et atypique ; Voix Publiques pro-pose quant à lui des interventions «d’artistes crieurs», à l’image des « Speaker’s Corner » de Hyde Park à Londres ; le projet d’édition intitulé En attendant la fin du monde, est une revue, faite en collaboration avec la Strada, qui est distribuée pendant la FIAC à Paris et Ar-tissima à Turin. Enfin, notre site internet (www.botoxs.fr) recense l’actualité des vingt lieux membres de l’asso-ciation. Afin de répondre à la réactivité de chacun, il est très régulièrement mis à jour, permet à qui le souhaite de recevoir par mail des newsletters. Des dossiers de presse trimestriels sont aussi mis à disposition en ligne.
Avez-vous le sentiment que la scène artistique sur la Côte d’Azur et à Nice ait évolué grâce à l’arri-vée de Botox(s) ? Botox(s) a très certainement généré plus de visibilité et a indéniablement produit un bras-sage de publics très différents, faits de jeunes, de retrai-tés, de collectionneurs, de simples amateurs d’art ou de curieux. Comme je l’ai dit auparavant, cette association a aussi permis une meilleure coordination des différents acteurs culturels locaux ainsi qu’un développement des possibilités d’actions artistiques. Cette mise en com-mun des compétences et des réseaux a permis de créer quelques emplois, de rendre possible le soutien de pro-
« Ce qui est remarquable,
c’est la diversité des lieux qui composent Botox(s) :
musées, centre d’art, galeries et
initiatives privées, associations... »

BOTOX(S) - 31
ASSOCIATION
ductions artistiques et a fait émerger des propositions collectives qui n’auraient pas vu le jour si chacun était resté replié sur soi. Botox(s) a permis de montrer avec cohérence au public local, mais aussi en dehors des fron-tières de notre région, une grande diversité de projets artistiques. En se regroupant, nous avons réussi à nous « dé-fragiliser », à mettre en avant les singularités de chaque élément qui compose Botox(s) et à affirmer notre crédibilité sur la scène artistique nationale.
• Souhaitez-vous étendre votre réseau au-delà de cette scène locale, en invitant des artistes ou des structures étrangères à interagir ? Oui, cela com-mence déjà à se faire sur différents projets. Nous avons eu quelques échanges avec Marseille Expo (une structure proche du mode de fonctionnement de Botox(s).)De plus, nous nous ouvrons à l’échelle nationale et inter-nationale grâce aux projets et à la programmation de nos structures, qui font souvent appel à des artistes de tous horizons, mais aussi grâce au contenu forcément cosmo-polite de nos projets communs.
• Comment choisissez-vous les lieux que vous déci-dez d’intégrer à Botox(s) ? Avez-vous une ligne di-rectrice ? La plupart des lieux qui désirent entrer dans l’association viennent à nous spontanément. Quelques conditions sont requises pour devenir membre actif ; elles sont rédigées dans le règlement intérieur de nos statuts (il faut par exemple être parrainé par l’un des membres de l’association, avoir une programmation d’art contemporain régulière, participer à la vie de l’association, payer une cotisation annuelle…).En échange, les membres reçoivent les publics des Visi-teurs du Samedi et du Soir, ont une page où leurs acti-vités sont régulièrement mises à jour sur le site internet www.botoxs.fr, figurent dans le dossier de presse et la newsletter trimestrielle, etc.
• En plus d’assurer la direction de Botox(s), vous êtes vous-même artiste et co-fondateur de La Sta-tion. Comment parvenez-vous à allier ces trois ac-tivités ? Cela demande évidemment beaucoup de temps et d’énergie. Mis à part ma pratique artistique, tout cela se fait en collégialité et collectivement ; cette mise en commun des compétences et des désirs rend la chose intéressante et enrichissante. La difficulté est de trouver le bon équilibre entre ces fonctions acrobatiques mais finalement complémentaires. Cela nécessite une faculté d’adaptation certaine. J’avoue que j’apprécie de plus en plus les moments trop rares où je me retrouve seul dans mon atelier.
• Pouvez-vous me parler plus précisément des Visiteurs du Samedi et des Visiteurs du Soir ? Les Visiteurs du samedi est une visite accompagnée proposant un focus sur quelques expositions à une quinzaine de personnes. Cela permet de fidéliser un public, de faire fonctionner un principe de bouche-à-oreille grâce à ce moment particulier. Cette médiation permet de sen-sibiliser les publics aux contenus des expositions que nous proposons. La fréquence des Visiteurs du Samedi est mensuelle, ce qui permet un « turn-over » des lieux de Botox(s) sur l’année. Les Visiteurs du soir est un pro-jet annuel où nous élargissons le propos, pas seulement aux lieux déjà identifiés, mais aussi des projets singuliers qui peuvent prendre place dans des appartements, des ateliers, garages ou en extérieur. Toutes les visites se dé-roulent entre 15h et 22h puis se terminent en musique jusqu’à 1h du matin. C’est une grande fête autour de l’art contemporain avec de vraies propositions artis-tiques. Depuis 4 ans, le nombre de personnes partici-pant, tout comme l’intérêt du public, ne cesse de croître.
• Quel a été le fait le plus marquant (exposition, événement…) de l’histoire Botox(s) ? Sa création. Et
l’idée que cela fait cinq ans que ça dure : un miracle ! Ce qui est remarquable, c’est la diversité des lieux qui composent Botox(s) : musées, centre d’art, galeries et ini-tiatives privées, associations... Toutes ces entités intera-gissent sans hiérarchie et forment un corpus qui travaille dans un même sens, vers un même but… un autre pro-dige ! C’est d’ailleurs assez unique en France.
Projets 2012 :- Les Visiteurs du soir – Parcours nocturne d’art contemporain / 26 Mai 2012.- Les Visiteurs du samedi – Parcours mensuel guidé, en minibus / Toute l’année.- Édition d’une revue artistique – Distribution prévue sur Turin (Artissima, Italie) et sur Paris (FIAC, France) / Octobre et novembre 2012.- Édition d’une plaquette de presentation des diffé-rents lieux Botox(s) – Historique de chacun des lieux et leur programmation / Courant 2012.- Édition d’une plaquette de présentation des Visites Privileges / Début 2012.- Voix Publiques (CAC Arts Visuels 2012) – Une di-zaine d’artistes seront invités à créer des situations de parole publique dans les espaces extérieurs (jardin, par-king, terrasse, trottoir, place...) d’un certain nombre de structures d’art contemporain de la Côte d’Azur. À la manière des Speaker’s Corner de Hyde Park à Londres / Eté 2012.- Création d’un poste ADAC pour pérenniser le poste indispensable de notre coordinatrice qui est la clé de voûte de cette aventure. Notre fragilité budgétaire ne nous permet pas encore d’être sûr de pouvoir la rémuné-rer à la hauteur du travail qu’elle fournit.
LISTE DES MEMBRES DE BOTOX[S]
• Centre national d’art contemporain[Villa Arson] > Nice• Les musées nationaux des Alpes-Maritimes[Musée F.Léger] > Biot[Musée M.Chagall] > Nice[Musée P.Picasso] > Vallauris• La Station> Nice• De L’ART Editions> Nice• Maison Abandonnée[Villa Cameline] > Nice• Espace À VENDRE> Nice• Galerie Sandrine Mons> Nice• La Maison [Galerie Singulière]> Nice• Galerie de la Marine> Nice• Galerie Depardieu> Nice• Galerie Catherine Issert> St Paul• Musée de la Photographie André Villers> Mougins• Galerie Sintitulo> Mougins• Espace de l’Art Concret> Mouans-Sartoux• Hôtel Windsor> Nice• Espace À Débattre/BEN> Nice• Nouveau Musée National de Monaco[NMNM] > Monaco• Atelier Keskon Fabrique ?> Nice

32 - JACQUES ANTOINE
MÉDIATexte / Julia Ségovie • Photos / DR
+ LE GRAND JEU +
JACQUES ANTOINE
En plus de quarante ans, le producteur Jacques Antoine a accompli la prouesse de créer pas moins de cent cinquante jeux télévisés et radiophoniques, pour Europe 1, Télé Monte Carlo, dont il fut le directeur des
programmes durant les années soixante et soixante-dix, mais aussi pour les principales chaînes de télévisions françaises. Le Schmilblick, c’est lui. Tournez Manège, c’est encore lui. Fort Boyard, c’est toujours lui. Et la liste est longue. Celui que ses prestigieux confrères (Pierre Bellemare, Philippe Gildas, Pierre Tchernia…) appellent encore «Monsieur Antoine» a accepté le temps d’un entretien de revenir sur les débuts et les moments forts de sa carrière.
• Comment passe t-on de la radio à la télévision ? On ne passe pas de la radio à la télévision ! Moi, ça m’est arrivé, ainsi qu’à mes anciens collaborateurs, comme Pierre Bellemare par exemple. Personnellement, quand la radio s’est arrêtée pour moi, je faisais une radio qui n’existe plus. Cette radio là a été remplacée par la télévi-sion. Tout comme ce média, la radio était alors faite de grands programmes qui passaient le soir, généralement très spectaculaires. Les jeux qui nous diffusions étaient enregistrés en public. L’un des jeux que j’ai créé se pro-duisait même dans un chapiteau de cirque ! Le jeu qui a le plus marché s’appelait Cent francs par seconde. Il était très spectaculaire. D’ailleurs, quand les gens écou-taient ce programme, ils s’asseyaient en rond devant le poste de radio et ils le regardaient ! C’était comme s’ils voyaient ce que leur racontaient les animateurs. Dans ce jeu, on gagnait donc cent francs par seconde jusqu’à ce qu’on soit éliminé. Les candidats devaient par exemple monter dans une nacelle de montgolfière tenue par des fils. L’animateur leur posait des questions très simples et très rapides et dès que les participants se trompaient, ils avaient un gage. Ils devaient couper l’un des six fils de la nacelle. Seul l’un des fils la tenait réel-lement. Si les candidats le coupaient, la nacelle tombait et ils avaient perdu. Quand l’animateur racontait tout ça, les gens qui écoutaient voyaient littéralement ce qui se passait ! Ils voyaient la nacelle, ils imaginaient le bal-lon de la montgolfière alors que celui-ci n’existait pas !C’était de la radio visuelle ! La plupart des émissions que je produisais alors fonctionnaient sur ce modèle. Donc le passage de la radio à la télévision s’est fait tout seul. Quand la concurrence de la télévision est devenue très forte, ce genre de programmes radiophoniques, très onéreux, n’était plus rentable : l’audience a chuté, les budgets aussi, et les radios n’ont plus eu les moyens de les diffuser. Tout ceci a donc disparu de la radio. Ne sont restés que les programmes à base de musique ou liés aux services publics. Le visage et le public de la radio ont ainsi complètement changé. Notre public a suivi notre migration vers la télévision. À cette époque la télévision fonctionnait sans producteur ; j’étais donc un producteur qui n’avait plus rien à produire. Je me suis presque retrouvé au chômage. On m’a alors pro-posé la direction des programmes de Télé Monte-Carlo. C’est ainsi que j’ai embrayé sur la télévision.
• À cette époque, les programmes radiophoniques étaient extrêmement spectaculaires et quasiment visuels. Tout était donc à inventer pour créer une illusion. Quand vous êtes passé à la télévision, média purement visuel, comment avez-vous fait pour adapter votre façon de créer des images ? Cent francs par seconde, qui était une émission de radio ayant eu un succès énorme, n’a jamais pu fonctionner à la télévision. Nous avons plus ou moins tenté de l’adap-ter au support cathodique, ça n’a jamais pris. Étran-
gement, aux États-Unis, cette émission est passée avec succès à la télé. Maintenant encore, je me demande pourquoi en France ça n’a pas marché. Enfin si, j’ai une idée : les américains ont lancé Cent francs par seconde alors que la télévision en était à ses débuts, donc le côté un peu infantile de cette émission qui avait des décors un peu «cheap» passait encore. Tout ça allait bien avec l’enfance de la télévision. En France, quand on a voulu passer ce jeu à la télévision, celle-ci avait déjà trop évo-lué. C’en devenait comique, ridicule même. C’était trop tard.
• Quand vous êtes passé du poste de producteur de radio à celui de directeur des programmes de TMC, qu’a t-il fallu réinventer ? Je n’ai pas com-mencé par créer un jeu, mais une émission qui s’appe-lait Chapeau et qui a connu un succès énorme. C’était à l’origine un concept de jeu radiophonique totalement insignifiant : un crochet. Avant-guerre, les radio-cro-chets fonctionnaient selon le schéma suivant : des amateurs venaient chanter et un jury d’auditeurs et de téléspectateurs les jugeait. Lorsque l’un des participant perdait, un grand crochet venait le tirer pour le sortir de scène. Chapeau reprenait ce concept et fonctionnait avec des moyens infimes. Le crochet était remplacé par un immense chapeau melon tenu par une hôtesse pos-tée derrière le candidat. Celui-ci ne la voyait pas arri-ver et ça amusait les téléspectateurs. Lorsqu’il perdait, l’hôtesse le coiffait de ce chapeau. Comme celui-ci était très grand, il recouvrait le visage de l’apprenti chanteur qui ne pouvait du coup plus chanter ! Cette émission a été un triomphe. Voilà ma première idée «géniale» pour TMC (rires).
• Justement, en parlant d’idées géniales, quelle est l’émission que vous avez préférée produire ? C’est une émission qui date de l’époque où je travaillais à la radio. Elle s’appelait Vous êtes formidables. C’était une émission humanitaire qui a duré six ans et qui a soulevé la France. Le principe était le suivant : on prenait un cas désespéré, par exemple un village qui n’avait plus d’eau. On se rendait sur place pour faire un petit reportage où l’on dramatisait la situation puis on demandait aux auditeurs de résoudre le problème dans le temps de l’émission. C’était très cruel, parce que, même si la plupart du temps le problème était résolu, parfois ça ne fonctionnait pas et l’émission se terminait par un bide. C’est ce ressort cruel qui créait le suspens, qui donnait de l’audimat à l’émission, qui tenait en haleine les auditeurs mais qui nous a valu beaucoup de critiques. Malgré cette apparente cruauté, malgré ces quelques échecs, l’émission a résolu beaucoup de problèmes.
• Faut-il nécessairement du suspens pour qu’une émission fonctionne ? Toutes les émissions n’ont pas besoin de suspens. Mais dès qu’il y a une fiction, il faut qu’il y ait du suspens ou de l’humour. Il y en avait dans Chapeau, dans Vous êtes formidables, et il y en a dans tous les jeux. Dans les émissions que j’ai produites, le suspens était en effet un ingrédient indispensable.
• Et en dehors de la radio, quelle a été votre meil-leure émission ? Un jeu intitulé Pourquoi ? Ce qui m’énerve avec les jeux, c’est que ce sont toujours des questionnaires faisant appel à la mémoire, c’est-à-dire où tout se borne à connaître ou pas la bonne réponse.
Tout est une question de chance, pas plus. Maintenant il n’y a plus que ça, à la télévision. Tous les jeux se res-semblent, seules les règles du jeu changent ! J’ai tou-jours essayé de proposer autre chose. Avec Pourquoi ?, le jeu commençait avec une question très simple posée au candidat. Prenons un exemple. On lui demandait «Est-ce que vous avez chaud en ce moment ?». Il répondait «Oui». On lui demandait alors pourquoi. Il répondait «À cause de la chaleur des projecteurs du studio». On lui redemandait «Pourquoi les projecteurs chauffent-ils ?». Il répondait «Parce qu’il s’agit d’un éclairage incan-descent qui dégage de la chaleur». On lui demandait encore «Pourquoi» et le débat partait sur un terrain scientifique, de plus en plus précis, jusqu’à ce que le candidat soit à court de réponses et qu’il perde. L’inté-rêt de ce jeu, c’est qu’en fonction des réponses qu’il donnait, le candidat pouvait orienter les questions qui allaient suivre. C’était un jeu où l’on ne pouvait pas tri-cher. Le jury était composé d’une dizaine de personnes : il y avait un grand scientifique, un grand linguiste, etc. À chaque fois, ce jury expliquait précisément pourquoi la réponse était acceptée ou refusée. C’était réellement passionnant car il permettait au public de s’instruire et donnait envie à des gens très érudits de participer, comme par exemple le ministre Edgar Faure et certains scientifiques très prestigieux.
• Si vous étiez producteur maintenant, à l’heure où l’on a plus ou moins épuisé tous les concepts d’émissions et de jeux possibles, que proposeriez-vous ? Je ne sais pas. J’ai du mal à imaginer l’étape qui suivra la télé-réalité, par exemple. Je me suis posé la question mais je ne sais pas ce que j’aurais fait. J’ai parfois l’impression d’avoir vécu l’Âge d’Or de la radio et de la télévision, où tout était à inventer et donc où tout était possible. Mes collaborateurs de l’époque me disaient que, peu importent le domaine et la période, j’aurais eu des idées. Je n’en suis pas si sûr. La télé-réali-té devait inévitablement exister, j’y ai moi-même pensé. À l’époque, ça m’avait été refusé car on m’avait dit que l’on n’avait pas le droit de mettre des hommes dans une éprouvette ! Et c’est vrai que c’est le principe de la télé-réalité. Mais la façon dont on le fait actuellement n’apporte rien. Moi, je voulais vraiment mettre les can-didats dans une éprouvette, pour observer des phéno-mènes qui ne s’étaient jamais produits, pour apprendre quelque chose, sociologiquement, presque antropolo-giquement. En tout cas, que faire après la télé-réalité ? Peut-être un programme sondant le conscient et l’in-conscient. Le problème, c’est que le niveau socio-cultu-rel du public regardant la télévision a considérablement chuté, c’est donc difficile de créer maintenant de façon qualitative. On ne peut créer qu’en montant le niveau, pas en l’abaissant.
« On ne peut créer qu’en montant le
niveau, pas en l’abaissant. »

JACQUES ANTOINE - 33
MÉDIA

34 - MIRCEA CANTOR
ARTTexte / Isabelle Giovacchini • Photos / © Mircea Cantor, courtesy Yvon Lambert Paris / Dvir Gallery • Portrait de Mircea Cantor / © Gabriela Vanga
+ L’ART DE L’ESQUIVE +
MIRCEA CANTOR
En rejoignant Mircea Cantor chez un torréfacteur et en l’y voyant nous commander deux thés, j’aurais déjà dû me douter qu’il y allait y avoir quelque chose de décalé dans cette entrevue. C’est en effet placé
sous le signe du serpent, dans un art certain de l’esquive et de la fuite, qu’il va tenter de contourner méthodiquement chacune de mes interrogations, refusant par principe, parfois blasé, parfois amusé, le cadre même
de l’interview. Il ne s’agit pas pour lui d’une forme de parade intellectuelle, mais véritablement d’un refus de la simplification et du bavardage. Au fil de notre entretien et des ses acrobaties pour ne pas y répondre, je comprends
que rien ne le rebuterait plus que de me voir détourner ses propos pour les loger dans cette introduction en une série de mots-clés un peu vains, tels que «Lauréat du prix Marcel Duchamp», «Artiste poétique et politique» qui à peine écrits sont déjà galvaudés et réduisent une œuvre en trois lignes. Certes, voir Cantor réclamer le silence, ou mieux, m’inviter à un dialogue ouvert plutôt qu’au déploiement d’un discours d’avance millimétré est chose fascinante, mais est aussi une entreprise périlleuse à tenir. Je me risque donc à poser puis improviser bon gré mal gré mes
questions à cet artiste dont l’oeuvre consiste justement à résister. Tout se joue alors en filigrane, dans les pauses entre deux paroles, dans ses remarques et reformulations, dans ses éclats de rires inattendus et ses soupirs dépités, mais au
final, hors des sentiers battus. En ce sens, cet échange en forme de fugue est étrangement réussi.
« Être artiste, c’est une grande responsabilité, c’est une façon
presque pesante de définir la position que l’on occupe
dans le monde. »
• Tu dis « Vivre et travailler sur terre ». Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Est-ce une façon idéale, presque utopique, de te définir ? Je dis que je travaille sur terre parce que je pense qu’aujourd’hui avec toutes les possibilités de communication que l’on a, il faut plus être attentif aux rencontres que l’on fait qu’à son passeport. On parle d’avenir, de voyages sur Mars, et paradoxalement, on est toujours en train de montrer du doigt de quelle nationalité nous sommes. Je ne veux pas dire que je renie ma nationalité, que je n’aime pas la Roumanie ou la France, mais c’est une façon de m’efforcer d’aller plus en profondeur dans ma rencontre avec l’autre, de ne pas m’étiqueter avec des phrases telles que « Il vit et travaille à Paris ». • D’origine Roumaine, tu es venu en France pour intégrer le post-diplôme de l’ERBAN de Nantes. Pourquoi as-tu décidé de rester ensuite en France, qui a pourtant la réputation de ne pas être une terre fertile en matière d’art contemporain ? Je ne sais pas. Peut-être simplement parce que je parle fran-çais et que j’adore Paris, où le niveau de culture est très spécial, n’a rien à voir avec les autres capitales euro-péennes. Pour moi c’est un grand atout. Ensuite être en France me laisse la possibilité de beaucoup voyager, d’aller de New-York à Berlin assez facilement.
• On dit souvent que ton travail est à la fois politique et poétique. Or, le sens de ces mots est tellement vaste que ces derniers ne définissent plus grand chose. Peux-tu donc me donner une interprétation plus personnelle de ton travail ? Lorsque nous avons monté le communiqué de presse du Crédac, Claire Le Restif, la directrice, a rédigé une sorte de statement : «Le travail de Mircea Cantor se base sur trois piliers : éthique, esthétique et mysticisme.» Elle m’a demandé si j’acceptais que l’on utilise ces trois termes. Je lui ai répondu qu’il était vrai que j’avais une façon très spirituelle d’aborder l’art et le monde, mais que les trois termes qu’elle souhaitait faire impri-mer allaient devenir des sortes de tiroirs, de cases où
les gens, les critiques surtout, allaient me catégoriser par la suite, surtout dans le contexte français qui est très «décortiquant», «déconstructif». De toute façon, peu importe les mots, ce qui est sûr c’est que ceux-ci empêchent d’aller chercher le sens en profondeur. Quand on utilise ces termes, on a l’impression, presque la certitude d’avoir tout compris, d’avoir saisi tout ce
qui se passait au sein d’une oeuvre. Bien évidemment, c’est faux ! Au contraire, ça dénote une certaine dose de superficialité, de paresse intellectuelle. Ca signifie se contenter de chercher à survoler le travail plutôt que rencontrer l’artiste.
• Mais s’il fallait vraiment résumer les choses, car
on ne peut jamais se passer des mots bien long-temps, tu le ferais comment ? Je suis artiste ! Se défi-nir comme artiste, c’est déjà un poids tellement lourd qu’il ne faut pas ajouter des adjectifs à ce mot. Artiste poétique, artiste politique, peu importe ! Essayons déjà de savoir ce que c’est, l’art, de comprendre le sens ul-time de ce terme. Etre artiste, c’est une grande respon-sabilité, c’est une façon presque pesante de définir la position que l’on occupe dans le monde. Les médias, la presse particulièrement, sont souvent superficiels. Les médias semblent penser que les gens sont bêtes. C’est même là leur principal à priori. Il faudrait donc tout simplifier pour que l’on saisisse tout immédiatement, pour adhérer avec cette ère de vitesse dans laquelle nous vivons. Prenons par exemple Picasso, superstar des mé-dias s’il en est. Examinons ce qu’il a fait, du début à la fin de sa carrière. On ne va pas dire qu’il était un artiste politique simplement parce qu’il a peint Guernica, ou artiste de salon ou du dimanche parce qu’il faisait des natures mortes et des portraits. Son oeuvre va bien sûr au-delà de tout ça. Il faudrait que la presse, écrite ou pas, soit plus courageuse, qu’elle tente de moins sim-plifier les oeuvres, car si la simplification part du pic de la pyramide que représentent les médias, tout le reste, tout ce qui est en-dessous, s’effondre, se délite irrémé-diablement.
• Empreinte, trace et disparition font partie de tes thématiques récurrentes, comme par exemple au sein des pièces Unpredictible future, où ce titre est tracé au doigt sur une vitre embuée, ou Seven Future Gifts qui sont de gigantesques cadeaux vides, seulement matérialisés par des noeuds en béton. Comment parviens-tu à fixer de façon plastique ces manifestations, par définition fra-giles et fugaces ? Comme ça ! (rires) Je ne sais pas si je les fixe. Je pense qu’elles vont se fixer au moment de la rencontre avec le public. C’est cette façon-là de fixer qui est réellement intéressante. Il ne s’agit pas de pérenniser de facto.

MIRCEA CANTOR - 35
ART
• Il est souvent question du ciel dans tes oeuvres : il se reflète dans les pancartes en mi-roirs des manifestants de la vidéo The landscape is changing ; il prend la forme d’un arc-en-ciel naïf dans Rainbow, il s’écrit à la bougie sur les plafonds de Ciel variable. Quelle signification donnes-tu à ces différents ciels ? Je ne sais pas !
• Il y a tout de même quelque chose d’assez atmosphérique dans tout ceci, non ? Atmosphé-rique… « L’artiste atmosphérique », voilà une nouvelle catégorie ! Pour te répondre, je pense que j’aspire à l’impalpable. Mais au fond, je ne sais pas. Il me semble que ce ciel est simplement une sorte de contrepoids.
• Tu déclines certains éléments, tels que les avions hameçonnés des Fishing flies en les présentant dif-féremment au fil des pièces et des expositions. Se-lon toi, les formes sont intéressantes lorsqu’elles deviennent instables, mouvantes ? (long silence) C’est important, mais en même temps ça n’obéit qu’à une certaine forme de nécessité. L’instabilité n’est pas une chose que je recherche, c’est au contraire très intui-tif. C’est là tout l’intérêt d’être artiste, de chercher à ressentir à un certain moment qu’une certaine forme a besoin d’une certaine taille pour exister, par rapport à l’espace, par rapport au message, par rapport aux choses qui l’environnent.
• C’est donc une façon de s’adapter aux lieux que tu investis ? C’est plutôt une façon d’adapter l’esprit !
• Tu utilises aussi bien des matériaux dits «pauvres» (empreintes digitales composant tes dessins de fils barbelés, cannettes de soda dans Fishing flies, etc.) que d’autres dits «nobles», tel que l’or que l’on retrouve par touches dans plusieurs de tes pièces. Comment choisis-tu ces matériaux ? Ont t-il un dénominateur commun malgré leur apparente hétérogénéité ? Je pense que chaque matériau a un certain message, et que c’est sa nature qui définit ce message. Ensuite, tout dépend de ce que je fais avec tout ça, comment j’assemble ces matériaux et donc ces messages. Si par exemple j’avais réalisé ma porte en or (NDLR : Arc de triomphe, 2008, pièce inspirée des grandes portes de propriétés en bois sculptées, que l’artiste a dorées à la feuille et dont les motifs traditionnels ont été remplacés par des dessins
reprenant le motif elliptique du code génétique) unique-ment avec du bois, ça n’aurait pas eu le même impact, ç’au-rait été juste une pièce ethnographique : du bois vieillissant avec le temps. L’or apporte ici un troisième élément : il y a la porte en tant que telle, les dessins et l’or. Ce troisième élé-ment est aussi présent au sein d’une pièce comme Fishing Flies que je présente au Crédac, même si là ce troisième élément n’est pas de l’or : il s’agit d’un avion, constitué de barils d’essence et attaché à un immense hameçon. J’aurais pu me conten-ter de n’assembler que des barils, basta cosi. Mais en ajoutant un hameçon, j’ai vraiment l’impression de modifier totalement la signification et donc la portée de ma pièce. L’avion ne discourt plus seulement avec les barils d’essence mais devient un leurre. Utiliser des matériaux, ça n’est rien d’autre que les mettre en sym-biose et en jouer. Ca devient un processus pour créer des messages.
• Chaque matériau est donc comme l’un des élé-ments d’une grammaire ? Exactement. C’est comme une poésie (zut, j’ai dit «poésie» !). Ou plutôt, pour jouer à « l’artiste gastronomique », c’est comme un plat. Quand on cuisine un plat, on sait combien de temps on doit le laisser cuire, quelle quantité de tel ingrédient on doit mettre, à quel moment on doit l’ajouter, etc. Mais ça ne s’arrête pas là, il faut ensuite savoir comment le servir, avec quelles assiettes, dans quel plat. C’est tout un art, pour utiliser une expression toute faite. Un art de la composition. Je trouve qu’aujourd’hui, cet art de la composition, surtout dans les écoles de beaux-arts, est un peu oublié.
• Justement, tu composes souvent à partir d’idées d’enfermement, de restriction, que ce soit à l’aide de fils barbelés ou de cages gigognes enfermant deux paons dans l’installation The need of uncer-tainty. Que cherches-tu à pointer du doigt au travers de ces différentes formes d’interdiction ?
Je préfère à l’expression «restriction» celle de «signal d’alarme», par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à nos propres vies. L’idée d’aller vers l’autre en ayant des préjugés est déjà une forme d’enfer-mement, une barrière. L’entretien que nous avons maintenant tous les deux est assez représentatif : tu es venue avec des questions déjà toutes prêtes, écrites, «pré-posées». C’est une fa-
çon de venir en étant fermée à la discussion, à la décou-verte. J’aurais préféré que tu viennes en te disant que tu étais curieuse de savoir qui j’étais et que l’on parle très ouvertement, que l’on discute sans savoir quelle forme tout cela va avoir, où tout cela va mener. C’est très symptômatique d’une forme d’auto-restriction qui fait hélas partie de nos vies. C’est pour ça que je tire ces signaux d’alarme. Ce que je veux savoir, c’est com-ment aller au-delà de ces restrictions, de ces paradoxes, pour produire ou aller vers des choses et des formes intéressantes.
• Dans la vidéo I decided not to save the world (2011), ton fils dit qu’il a décidé de ne pas sauver le monde. Est-ce ta façon de nous dire qu’un art politique n’a pas nécessairement besoin d’être contestataire ? «Art politique» (rire presque consterné) ! Comment reformulerais-tu ta question de façon à ôter cette expression ?
• Comment est venue cette phrase, et pourquoi est-elle restée dans ton oeuvre ? Pourquoi l’avoir gardée ? Parce tous les jours on trouve cette volonté, qui a d’ailleurs mené à des désastres, de vouloir sauver le monde. Mais au nom de quoi ?! Tous les jours des gens essaient de faire ça, de sauver le monde, politi-quement, économiquement, socialement, écologique-ment, etc. En fait, je me rends compte que vouloir faire ça nous prive de notre propre liberté, nous engage dans un courant qui ne fait pas partie de notre nature, de notre volonté intrinsèques. Tout ceci est une ques-tion de volonté et cette vidéo le dit bien : non, je n’ai pas décidé de sauver le monde. Ces «je» et «décidé»
veulent bien dire que j’ai choisi pour moi et seule-ment moi. Comme disait Thoreau, «Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins.*» Que ce soit un enfant qui dise cette phrase dans la vidéo est encore mieux, car, c’est bien connu, «la vérité sort de la bouche des enfants». Avec l’âge, les gens ont tendance à se cristalliser. Or, avoir un enfant ne laisse absolu-ment pas le temps de se cristalliser. En ce sens, mon fils est une sorte de muse. Il m’inspire énormément. Cette phrase que mon fils dit dans la vidéo I decided not to save the world est venue de discussions que j’ai eues avec Gabriela (NDLR : Gabriela Vanga, la compagne de Mircea Cantor qui est elle aussi artiste). On s’imaginait un dirigeant politique énonçant cette phrase lors d’un discours aux Nations Unies. Ca serait grave, lourd de sens et de conséquences, et en même temps, finalement ça ne serait qu’une personne qui se déresponsabilise.
• Vertical attempt est une vidéo d’une seconde qui met en scène une fois de plus ton fils es-sayant de couper aux ciseaux le filet d’eau sortant d’un robinet de cuisine. En la visionnant, je me demandais quelle place tu accordes à l’improvi-sation et à la mise en scène. Aucune. Ca n’a pas d’importance. (Il prend mon téléphone). Je n’ai pas besoin de savoir de quoi est fait ce téléphone. Je sais simplement qu’avec je peux communiquer, faire des photos ou vidéos et c’est largement suffisant.
• En octobre 2011, tu remportes le Prix Marcel Duchamp. Tu exposeras donc en octobre 2012 au Centre Pompidou. Songes-tu déjà à ce que tu vas y présenter ? Aucune idée. Pour le moment, je pense plus à toutes les expositions que je suis en train de pré-parer : le 3 mars, j’en inaugure une au Museum of the Moving Images de New York, une autre qui commence-ra le 16 mars à Rome, au Museo d’Arte Contemporanea di Roma (MACRO) ; enfin, à partir du 12 mai je par-ticipe à une exposition collective au S.M.A.K. à Gand. Après avoir plannifié tout ça, je penserai à l’exposition du Prix Marcel Duchamp !
Mircea Cantor :
• Restless : films and other works by Mircea Cantor, Museum of
the Moving Images, New York, du 3 mars au 6 mai 2012.
• Sic transit gloria mundi, MACRO, Rome, du 16 mars au 6 mai
2012.
• TRACK, S.M.A.K., Gand, du 12 mai au 16 septmebre 2012.
Fishing Fly, 2011 • Acier recyclé, acier inox, altuglass, pvc • 202 x 405 x 340 cm • Courtesy Yvon Lambert Paris • Vue d’exposition More Cheeks Than Slaps • Centre d’Art Contemporain d’Ivry- Le Crédac
* Henry David Thoreau, La désobéissance civile, 1894

36 - MIRCEA CANTOR
ART
Tracking Happiness, 2009. Super 16mm transféré sur HDCAM, sonore, 11’ • Courtesy Yvon Lambert Paris / Dvir Gallery

MIRCEA CANTOR - 37
ART
Tracking Happiness, 2009. Super 16mm transféré sur HDCAM, sonore, 11’ • Courtesy Yvon Lambert Paris / Dvir Gallery


Texte / Nicolas Giraud • Photo / DR
LANA DEL REY - 39
MUSIQUE
+ X-REY +
LANA DEL REY
Je ne sais pas trop quoi faire de ces photos qui sont dans mon téléphone portable depuis la semaine dernière. D’un côté, je me dis que je pourrais en tirer de l’argent, mais d’un autre
côté, déontologiquement, je ne sais pas si ça se fait.
Bon, j’étais déjà passablement ivre quand je suis rentré dans le bar de l’hôtel mardi soir. Ces temps-ci je ne sors plus trop dans mes rades habituels, saturés qu’ils sont d’étudiantes Erasmus en chaleur et de parisiennes névrosées. Elles sont de toute manière de plus en plus jeunes, ou alors c’est moi, peut-être, qui suis de plus en plus vieux. Les bars des grands hôtels c’est autre chose. C’est cher, c’est décoré par un stagiaire de Phi-lippe Starck sous acide, mais le personnel est serviable et compassé, c’est très vieille France et ce qui me plaît le plus : c’est calme. Sauf ce soir apparemment. Alors que je tends mon manteau au type du vestiaire j’entends cette fille qui crie je ne sais quoi, fort, en anglais et avec une voix un peu fausse. J’hésite et puis je rentre tout de même, juste au moment où elle sort. Nous nous percutons moelleusement, elle me regarde, elle veut crier, elle hésite, finalement elle pleure. Une femme, la cinquantaine martiale nous rejoint, elle me dit désolée, lui prend l’épaule et lui dit un truc gentil en anglais. On voit qu’elle prend sur elle pour parler gentiment, si elle pouvait elle tabasserait la fille avec son sac Chanel, mais en même temps on ne déconne pas avec un sac Chanel. La fille ne marche pas dans son baratin, elle se dégage, lui re-hurle dessus et re-pleure. Je pose la main sur son épaule et lui dit, dans un anglais presque parfait mais avec ce french accent que j’ai travaillé de longues heures, qu’on devrait aller s’asseoir et boire (encore) un verre. La fille pleure toujours mais moins, son chaperon montre les dents et tourne les talons. On traverse le bar, tout le monde nous regarde. La nounou de la fille discute avec un journaliste musical de Libé, il fait un peu la gueule. En fait, à part moi, tout le monde à l’air de faire la gueule, c’est marrant.
La fille s’appelle Nana, mais elle ne voit pas vraiment le rapport avec Emile Zola. Je lui raconte un peu l’affaire Dreyfus, J’accuse, tout ça, mais tout ce qu’elle retient c’est que c’est un journaliste et qu’elle déteste tous ces connards d’enculés de journalistes. Elle essaie de m’expliquer qu’ils lui posent des questions sur ses lèvres, je sens qu’elle va repleurer encore. Du coup, je recommande deux daiquiris et je lui dit des trucs sur ses lèvres. Elle sourit un peu. Voyant que je com-mence à lui prendre la main, la nounou s’approche de notre table, la fille se tourne vers moi et me dit : Could
you be kind and walk me to my room ? Elle me dit ça avec une petite voix d’américaine bien élevée. Tout le monde nous regarde, je me demande si on voit mon érection. Nous nous levons dignement et marchons jusqu’à l’ascenseur. La dame avec le sac Chanel semble regretter d’avoir laissé son lance-flamme dans le garage de sa maison de campagne. Dans un coin, un journa-liste musical du Figaro, ivre mort, me fait un clin d’œil salace. Les portes de l’ascenseur se referment sur nous. Je me penche vers la fille, glisse quelques mots puis ma langue dans son oreille. Elle rigole et se tourne vers moi, dans son regard, je vois tout les bienfaits d’une
éducation parfaite ou le puritanisme est en constant conflit avec l’appel à la liberté des corps. J’hésite à lui demander si ses lèvres sont vraies mais je me dis que c’est le mauvais moment, du coup je l’embrasse. Je ne sais pas pour ses lèvres, mais sa langue semble tout à fait vraie. Elle agrippe ma veste et me tire jusqu’à sa chambre, là elle allume l’une des lampes de chevet, se penche sur la stéréo et met une chanson grecque assez cool, si on aime les trucs vaguement pop. Je lui dit que j’adore, elle minaude comme si c’était elle qui l’avait écrite, elle danse doucement sur la musique. Je m’aper-çois que je n’ai pas encore parlé de ses vêtements, mais
en même temps pour quoi faire puisqu’ils tombent un par un sur l’épaisse moquette de l’hôtel. Un instant je pense à DSK et je fais quelques photos avec mon télé-phone pour pouvoir prouver que la fille était consen-tante. Elle ne me voit pas, complètement absorbée par la chanson qu’elle fredonne un peu, les yeux fermées. Elle s’assied sur le lit et me regarde, me dit un truc à propose de mon blue jean et de ma chemise blanche. À la voir passer sa langue sur ses lèvres, je me dit qu’elle en a marre de chanter. Tandis que nous jouons à voir dif-férentes parties de nos corps avec les mains, quelqu’un frappe à la porte. Nous nous immobilisons un instant. Lentement je déplace son corps pour le rapprocher du mien. Lorsqu’on frappe à nouveau, nous sommes dans une posture qui nous permet difficilement d’aller ou-vrir. Je crois que l’on frappe une troisième fois, mais elle crie et cela couvre les autres bruits. Tout cela dure un moment. Alors que je reprends mon souffle je la vois qui tend la main vers la stéréo, et plutôt que de réécou-ter sa chanson grecque une cinquième fois, je m’assied sur elle. Elle se retourne et minaude You want more you naughty French man. J’ai détourné son attention de la stéréo.
Je déchire la taie d’oreiller et lui attache les mains… puis les jambes. Je passe ma langue sur son corps et puis je me lève pour boire un verre d’eau. La salle de bain est immense, il y a une très grande glace, j’ai sur la langue le goût de sa sueur. Quand je reviens vers le lit, elle gigote un peu, tendant ses fesses vers moi. Je me dis tiens, c’est marrant dans gigoter, il y a gigot. Puis comme mon regard remonte le long de ses cuisses, j’ar-rête de me faire des réflexions philologiques pour laisser passer ma main sur ses jambes. Son corps se cabre, elle esquisse un mot qu’elle ne termine pas, sa respiration se fait plus profonde. Je me penche pour m’embrasser, elle me murmure Swing in my backyard… Suivant le rythme et ce qu’elle accepte petit à petit de faire, sa voix se fait plus grave. Je la détache finalement, elle se réfu-gie au bord du lit et me regarde avec une chaste perver-sité. Elle tremble un peu, je repense à DSK : You’re ok baby, you’re shaking… Elle se mord les lèvres : It’s you, elle me dit, it’s you, it’s all for you.
« Je ne sais pas pour ses lèvres, mais sa langue
semble tout à fait vraie. »

+ LA NOTE DU MOT +
CONSTANCE LARRIEU
Quand jeu d’instrument de musique, jeu d’acteur et mise en scène se lient, se complètent et se répondent sensuellement, le spectacle vivant atteint une plénitude que l’on savoure tel un nectar exquis enivrant de notes, de mots et de gestes. Constance Larrieu, jeune comédienne et metteur
en scène, artiste associée à la Comédie de Reims de 24 ans, est issue d’une famille de musiciens de la région d’Annecy. Plongée très tôt dans le monde musical, elle étudie le violon à Genève, sans vouloir toutefois en
faire son métier. Elle se tourne parallèlement vers le théâtre qui la passionne et intègre l’école régionale d’acteurs de Cannes (ERAC). Artiste prometteuse, elle présente à la Comédie de Reims, du 27 au 30 mars,
sa première mise en scène avec «Canons» de Patrick Bouvet.
« J’envisage le texte comme une
partition. Je le perçois comme un ensemble de modulations de rythmes et de respirations »
• Comment es-tu arrivée dans le Collectif artis-tique de la Comédie de Reims ? C’est lors de mes études de théâtre à Cannes que j’ai rencontré Ludovic Lagarde qui était intervenant dans cette école avec Laurent Poitrenaux. Nous y avons travaillé ensemble pendant trois ans et après ma sortie de l’école en 2008, lorsque Ludovic Lagarde a été nommé à la direction de la Comédie de Reims, il m’a embauchée comme comé-dienne permanente.
• Quelles collaborations artistiques as-tu déjà réalisées ? J’en ai réalisé plusieurs, à Cannes, à Mar-seille, où j’ai monté Manque de Sarah Kane, en y ajou-tant de la musique contemporaine à partir de composi-tions de Meredith Monk, une chanteuse et performeuse dont le travail s’articule autour du rire et des pleurs chantés, afin d’utiliser les sons comme vecteurs pre-miers de l’émotion.
• Comment ressens-tu le jeu et l’espace et qu’est-ce qui différencie une partition de musique inter-prétée d’un texte joué ? Pour moi, les démarches sont intimement liées, car j’envisage le texte comme une partition. Je le perçois comme un ensemble de modu-lations, de rythmes, de respirations et je réinterprète ce ressenti. Par ailleurs, j’utilise mon corps comme je pourrais utiliser un instrument de musique, afin de restituer ce jeu et transmettre au public cette matière physique et sensible.
• Quel rapport avec le public souhaites-tu jus-tement développer ? Mon objectif lorsque je joue, est de tenter d’avoir un rapport au jeu assez sincère et direct afin de toucher au maximum le public. Ce qui est intéressant c’est d’émouvoir les gens, leur proposer un spectacle qui leur parle intellectuellement, éveille l’imagination et suscite des sensations multiples, pour qu’ils sortent du spectacle avec quelque chose en plus, en étant différents de l’état dans lequel ils se trouvaient en y entrant.
• Au-delà, as-tu envie de travailler en liaison avec d’autres esthétiques et autres formes d’art ? Je suis très intéressée par l’art contemporain, notamment tout ce qui relève des arts plastiques, des installations et de
la performance. Par ailleurs, je suis très attentive à la musique contemporaine, mais aussi évidemment à la musique classique et baroque. Dans Canons, la pièce de Patrick Bouvet dont je co-dirige la mise en scène avec Richard Dubelski (metteur en scène, compositeur, co-médien et percussionniste) avec qui je travaille depuis longtemps, on se confronte à un regard critique sur les clichés de la performance depuis les années 70.
• Canons est-elle ta première expérience en tant que metteur en scène ? J’ai déjà proposé plusieurs projets à la Comédie la saison dernière, dont un dîner concert de musique baroque qui a eu lieu le 17 février 2011 en lien avec la représentation de La Place Royale de Corneille. J’avais imaginé cet événement de rencontre conviviale avec le public autour de la pièce avec tout
un ensemble de musiciens, parce que je pratique aussi le violon baroque. Pour la saison 2012, j’ai eu l’idée d’un projet intitulé Ripostes, comportant à la fois des textes de Molière peu connus et de la musique baroque. Ce spectacle a suscité un vrai engouement auprès du public, c’est pourquoi nous espérons le rejouer la saison prochaine. Mais Canons est ma première « vraie » mise en scène de forme purement théâtrale plus aboutie.
• Peux-tu parler de Patrick Bouvet, l’auteur du texte ? C’est un auteur dont les textes percutants sont très intéressants pour le théâtre car ils sont à la fois politiques, drôles et entremêlent plusieurs domaines artistiques.En effet, Patrick Bouvet est d’abord un musicien et il faisait du rock dans les années 80. Puis il a commencé
à pratiquer le sampling et à prendre alors des motifs musicaux pour en réaliser des boucles et en constituer des morceaux. Par la suite, il s’est lancé dans l’écriture, en utilisant l’esprit de cette technique musicale. Ses textes comportent des motifs d’un ou deux mots qui reviennent en boucle. Leur sens varie par conséquent au fur et à mesure du texte et lui confèrent un relief tout particulier. Patrick Bouvet intervient fréquemment dans le do-maine de l’art contemporain et de la performance, no-tamment dans des galeries d’art. Il est donc très connu dans ce milieu, mais il est en revanche peu monté au théâtre, car ses écrits ne sont pas des pièces à l’origine. Canons n’a donc à ma connaissance jamais été mis en scène, c’est une première ici !
• Et de quoi parle Canons ? La pièce met en jeu les représentations contemporaines de la femme par le prisme de trois archétypes féminins aux prises avec leur être, leur corps et leur rapport à l’existence. Ces femmes subissent les clichés du monde contemporain et de la société de représentation dans laquelle nous vivons. La première est une lectrice de magazines, la deuxième est une actrice et la troisième une performeuse féministe. Se pose alors la question de leur soumission ou rébel-lion face aux diktats de leur univers.
• On pourrait dire que la musicalité du texte donne un relief tout particulier à la pièce ? La dimension musicale du texte est politique, car l’auteur travaille sur les slogans, et sur l’impact de leur musi-calité sur la mémoire de chacun. La parole extérieure devient alors parole intime, éliminant toute pensée propre.
• Il y a un aspect visuel et graphique très fort dans les slogans… Oui. Nous travaillons particulièrement les poses des corps comme une sorte de chorégraphie, mais il y a aussi dans le spectacle des vidéos constituées d’images fortes destinées à la fois à choquer et à repro-duire des clichés de la mode, de la femme enfermée dans un seul rôle : la séduisante, la femme forte et guerrière, l’intello, la victime, etc. Dans le spectacle la parole se fait slogan : slogan de coaching sportif, slogan de publicité. Je transforme ma voix en la désincarnant,
40 - CONSTANCE LARRIEU
COMÉDIE DE REIMS - publi rédactionnel

presque à la manière d’un ventriloque afin de présen-ter mon corps comme une machine. La représentation comporte par ailleurs un temps sans paroles, où l’on joue de la musique avec des machines de salle de sport.
• Peux-tu nous en dire plus sur cette réalisation ? La pièce, qui sera jouée dans la petite salle de la comé-die, dure environ 1h15. Le décor qui a été conçu pour le plateau est plutôt épuré. Tout repose donc ici sur les objets présents et sur le texte qui est très musical. Il est principalement constitué des objets que les trois femmes ont chacune dans leur espace, et d’un écran qui est placé au centre, derrière la performeuse.
• Comment s’est donc concrètement déroulée l’expérience de cette première mise en scène ? Au sein de l’équipe, il y a une véritable synergie car on se connaît tous. Je travaille avec Ludovic Lagarde depuis plusieurs années maintenant. C’est pourquoi je lui ai proposé ce projet basé sur un texte de Patrick Bouvet publié en 2007. C’est un auteur qu’il connaissait pour l’avoir déjà lu. De mon côté, j’ai personnellement ren-contré l’auteur il y a deux ans lors d’une performance basée sur l’un de ses textes intitulé Direct et qui par-lait du 11 septembre 2001, programmée par le Frac
Champagne-Ardenne, à la Comédie.Pour cette création, nous avons constitué une équipe avec Richard Dubelski, Stéfany Ganachaud qui est danseuse et comédienne, Fanny Fezans comédienne qui faisait partie de ma promotion à Cannes, et Jona-than Michel, qui est vidéaste. Se sont ensuite joints à l’équipe de création Françoise Michel, qui avait déjà travaillé avec Stéfany Ganachaud et de nombreux cho-régraphes, dont Odile Duboc et Guillaume Olmeta au son.
• Après cette expérience enrichissante et réus-sie, tu retravailleras avec l’équipe de Canons ? Oui ! C’est une équipe avec laquelle nous avons d’autres projets en cours, toujours dans un dialogue libre et ouvert au sein duquel les idées circulent !
• Cette pièce est une création, avez-vous le projet de la jouer ailleurs ? Il y a quelques pistes de lieux qui pourraient être intéressés pour diffuser Canons. Avec Richard Dubelski, qui a vécu comme moi dans le sud, nous aimerions beaucoup que cette pièce y soit jouée, que ce soit à Marseille, Cannes ou Nice, car ce serait aussi l’occasion de renouer avec les lieux que nous connaissons dans la région.
Une sélection de spectacles à découvrir en mars-avril à la Comédie de Reims :
DU 3 AU 6 AVRILTARTUFFE • Molière / Éric LacascadeSous la comédie et le rire jaillit l’expression de passions humaines puissantes. La famille devient le champ de bataille de la jalousie, du désir et du pouvoir.
DU 11 AU 13 AVRILLE SOCLE DES VERTIGES • Dieudonné NiangounaLa folle vie de deux frères, dans les quartiers perdus de Brazzaville. Une œuvre littéraire hors du commun, servie par une troupe de grands acteurs congolais.
DU 17 AU 20 AVRILMADEMOISELLE JULIE • August Strindberg / Frédéric FisbachJuliette Binoche est cette Mademoiselle Julie, grisée par l’ivresse du bal de la Saint-Jean. Chronique d’un rapport de force sensuel entre un serviteur et la jeune maîtresse de la maison.
Comment réserver à la Comédie de Reims ?
• par téléphone au 03.26.48.49.00• auprès de la billetterie : 3, chaussée Bocquaine à Reims. La billetterie est ouverte du mardi au vendredide 12h à 19h et le samedi de 14h à 18h (sauf pendant les vacances scolaires)• sur notre billetterie en ligne : www.lacomediedereims.fr
CONSTANCE LARRIEU - 41
COMÉDIE DE REIMS


Séjour des rois et des reines de France pendant les cérémonies du sacre, le palais du Tau – ancien palais de l’archevêque de Reims – est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il présente aujourd’hui la mémoire de la cathédrale et la splendeur des sacres. Sculptures, tapisseries, costumes, ornements et pièces d’orfèvrerie constituent un trésor exceptionnel, du Moyen-âge au XIXe siècle. Idée insolite : prolongez la visite du palais du Tau et de la cathédrale par l’ascension des tours de Notre-Dame. Cette approche exceptionnelle d’un chef d’œuvre de l’architecture gothique permet de découvrir sa statuaire haute et sa charpente du XXe s. En cheminant tout au long de la toiture, profitez d’un panorama unique sur la ville des sacres.
LE PALAIS DU TAUUN INCONTOURNABLE DE LA CITÉ RÉMOISE
www.monuments-nationaux.fr
Actualité :
• Exposition photographique d’Anne Deniau
« Vingt-quatre heures dans la
vie d’un homme »
du 7 février au 3 juin
• Monuments pour tous
les 23, 24 et 25 mars
Tarifs :
Plein tarif palais du Tau : 7,50 €
Plein tarif tours de la cathédrale : 7,50 €
Billet jumelé plein tarif : 11 €
Gratuité exceptionnelle les 23, 24 et 25 mars
Informations et réservations :Centre des monuments nationauxPalais du Tau2 place du Cardinal Luçon • 51100 Reimstél. (33)03 26 47 81 79

+ SECONDE BIENNALE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES +
LA VILLA DOUCE
+ Jeudi 22 mars +19h00 • Présentation du guide pourl’égalité femmes-hommesPrésentation du guide « des bonnes pratiques » destiné à l’ensemble du personnel de l’URCA et aux étudiant(e)s ayant pour but de fournir des informations précises sur les moyens à mettre en œuvre, au niveau individuel et au niveau collectif, pour atteindre une égalité entre les femmes et les hommes. Ce guide se compose de plusieurs fiches présentant la manière dont le sujet peut être abordé dans différents domaines essentiels tels que le recrutement, la féminisation du langage, l’analyse des statistiques en tenant compte du genre, les violences faites aux femmes. Chaque fiche se compose d’une information théorique rapide et de solutions concrètes.
20h00 • Concert Elisabeth like a dreamDans un esprit plus festif et pour faire suite à cette présentation du guide, le SUAC vous invite à plonger dans l’univers, d’une envoutante énergie, du Groupe de rock féminin « Elisabeth like a dream ». Fraîchement formé
depuis un an, le groupe Elisabeth Like A Dream est né de la rencontre de trois rémoises (Sarah Walbaum au clavier, Coralie Datt au chant et Myriam Bâ à la basse) et surtout d’Aleksandra Plavsic résidant aussi depuis plus de dix ans à Reims, guitariste et leader du groupe, issue de la scène musicale alternative de Belgrade. Ensemble, elles incarnent Elisabeth Like A Dream, nouveau groupe émergent de la scène rémoise. Leur musique se teinte d’un mélange doux-amer, aux accents électro-rock, aux textes parfois acides, emprunts de mélancolie et d’ironie, qui n’est pas sans nous rappeler Siouxie and the Banshees, Goldfrapp et aussi the Kills. Pourtant, Elisabeth Like A Dream a un univers bien trempé qui n’appartient qu’à elles : à la fois féminin mais pas seulement, leur musique sonne comme un coup de fouet électrique, séduisant, parfois même insolent. Sur scène, les quatre filles dévoilent chacune une personnalité propre, singulière, voire charismatique.
+ Mardi 3 avril +19h00 • Café-débat sur Les femmes
dans le Mouvement Art-décoAnimé par Marie-Hélène Montout-Richard, Attachée de conservation au musée des Beaux-Arts. Des années folles aux années d’ordre, les femmes artistes sont présentes dans tous les domaines (peinture, art graphique, photographie, sculpture, textile).À Reims, leurs œuvres sont parfois dans la ville, chez les particuliers, au musée ou à la bibliothèque. Connus, méconnus ou reconnus aujourd’hui, leurs noms et leurs créations évoquent l’histoire de la région et plus largement l’époque de l’entre-deux-guerres, caractérisée par la richesse et la variété des mouvements artistiques. Les artistes liées à l’Art déco sont représentatives de cet esprit de modernité et de tradition mélangées. A Reims ou à Paris, qu’il s’agisse de Madeleine Carpentier, de Sonia Delaunay, de Tamara de Lempicka ou de Suzanne Tourte, ces femmes ne sont plus uniquement des artistes de l’intérieur, elles sont actrices de leur temps et produisent des œuvres sensibles, pleines d’énergie et parfois singulières par leur travail qui évoque la féminité.
Le service universitaire d’action culturelle de l’université de Reims Champagne-Ardenne a pour objectif de favoriser le rayonnement du territoire rémois et de son université en proposant une offre culturelle à la
Communauté universitaire et au grand public, en suscitant la rencontre entre des créateurs, des artistes, des étudiants, des enseignants-chercheurs, et des personnels administratifs et techniques de l’Université, en valorisant l’expertise de l’ Université, l’excellence de ses pôles de formation et de ses laboratoires de recherche, en développant
la culture scientifique par des évènements en lien avec les partenaires impliqués dans ce domaine et enfin en accompagnant l’intégration des étudiants dans la Cité. Le 30 mars 2011 la Ville de Reims a signé la Charte
européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale qui prévoit la participation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de décision ; l’élimination des stéréotypes sexués susceptibles
d’influer sur les comportements et l’action publique ; l’intégration du « genre » dans l’ensemble des politiques et dispositifs publics et l’égalité de traitement des femmes et des hommes. Déjà engagé lors de la première biennale égalité femmes-hommes en 2010, le SUAC s’implique à nouveau dans la seconde édition, en mars et avril 2012
avec trois événements à la Villa Douce.
Villa Douce • 9 boulevard de la Paix • Reims
44 - LA VILLA DOUCE
ÉVÉNEMENT - publi rédactionnelTexte / Anne Babb / SUAC • Images / DR


ÉPILOGUE !HYPOCRISIE ET RENIEMENT
« Couvrez ce sein que je ne saurais voir : Par de pareils objets les âmes sont blessées, Et cela fait venir de coupables pensées. » (Molière – 1669 - Tartuffe acte III scène 2)
Bienvenue au XXIème siècle où les lumières, pour cause d’économies d’énergie (cérébrale) sont souvent éteintes, trop souvent… Bienvenue en 2012, où le mensonge et le reniement sont les perspectives que l’on offre à l’épanouissement et au bonheur des citoyens à qui l’on peut
assurer qu’on ne fera plus les choses que l’on a faites ou que l’on fera les choses que l’on n’a pas faites, mais que l’on a promises. Bienvenue en 2012 où l’hypocrisie et l’obscurantisme religieux sont présentés comme vertus par certains fidèles les plus illuminés qui essaient de régir la vie en société, niant tout esprit moderne, par de grotesques tentatives d’interdictions d’expositions d’art ou de performances théâtrales « blasphématoires » (un terme d’un autre temps, celui de l’inquisition), qu’ils ne comprennent pas, ou par des actions destinées à interdire les love stores, au motif qu’ils pourraient porter atteinte à l’innocence des enfants qui passeraient devant leurs vitrines raffinées et dédiées au marivaudage, une innocence confiée entre de bonnes mains, celles de leurs prêtres. En inversant ce tableau en apparence sombre, 2012 pourrait voir éclore un Printemps dans lequel chacun reprendrait possession de son destin, en toute liberté, loin des Tartuffes vêtus de noir d’une époque révolue, leur bible érigée en mains. Une liberté de penser la société, une liberté de vivre son époque, une liberté de jouir d’instants intenses, en réécrivant l’esprit des lumières et du libertinage, d’une élégante attitude, humaniste, inventive et flamboyante jusqu’à la « Décadanse ». Dieux pardonnez nos offenses, la décadanse a bercé nos corps blasés et nos âmes égarées… (Alexis Jama-Bieri)
Journal à par parution bimestrielle. Prochain numéro : mai 2012.
CLGB Newspaper est édité par l'association CLGB (2 impasse JB de la Salle 51100 Reims). CLGB est une marque déposée. Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation.CLGB décline toute responsabilité pour les documents remis. Les textes, illustrations et photographies publiés engagent le seule responsabilité de leurs auteurs et leur présence dans le magazine implique leur libre publication.
+ Éditeur +Boris Terlet ([email protected])
+ Directeur artistique +Romuald Gabrel ([email protected])
+ Rédacteur en chef +Isabelle Giovacchini ([email protected])
+ Rédaction locale +Alexis Jama-Bieri ([email protected])
+ Régie publicitaire +Boris Terlet ([email protected])
À Reims, CLGB Open Art Revue est disponible gratuitement dans plus de 250 points partenaires.À Monaco, CLGB Open Art Revue est disponible gratuitement dans plus de 180 points partenaires,avec le soutien de la Fondation Prince Pierre et de la Fondation Albert II.
Pour devenir diffuseur, n’hésitez pas à nous contacter :
• CLGB Reims2 impasse JB de la Salle • 51100 [email protected] • +33 (0) 6 6480 2248
• CLGB Monaco29 rue de Millo • 98000 Monaco, [email protected] • +33 (0) 6 2804 1815
www.facebook.com/chezlegrandbagwww.clgb.net
La CartonnerieLa CartonnerieCONCERTS
W W W . C A R T O N N E R I E . F R
LA CARTONNERIE I MUSIQUES & CULTURES ACTUELLES84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 REIMS u 03 26 36 72 40 Locations : la Cartonnerie*, fnac, sur fnac.com, au 0 892 68 36 22 (0,34€/mn), Carrefour, Leclerc, Cora, Auchan, Virgin Mégastore, Cultura, www.digitick.com *sans frais de location
GENERAL ELEKTRIKSSMOKEY JOE & THE KID
V E N
06AVRIL
YOUSSOUPHARAASHAN AHMAD I CAOS LOCOS
S A M
28AVRIL
BARCELLABEN RICOUR
V E N
11MAI
SETH GUEKOYORONER I DJ KEMAR
S A M
12MAI
NATTY JEANPREMIÈRE PARTIE
V E N
13AVRIL
NNEKAKERJOSTYLE & THE MOTHAFONK
J E U
19AVRIL
PONY PONY RUN RUNTHE POPOPOPOPS
M E R
04AVRIL
DOMINIQUE AMELLANOISESCAPE
S A M
07AVRIL
SONIC PROTESTAVEC TAPETRONIC I TERRIE EX & PAAL NILSSEN-LOVEJUSTICE YELDHAM I SUPER REVERB
J E U
12AVRIL
PARTY ANIMALSAVEC DUSTY KID (LIVE) I JOKE DJ I KRONIC DJ I KLEM DJ
S A M
21AVRIL
A PLACE TO BURY STRANGERSTHE OSCILLATION
S A M
14AVRIL
CYCLE MUMA I PROJECTION
HERETIK SYSTEM “WE HAD A DREAM” PROJECTION SUIVIE D’UN MIX DU SYNAPSYS KREW I °GRATUIT POUR TOUS, RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DU KIOSQUE
M E R
25AVRIL
JOEY STARR & PREMIÈRE PARTIE
D I M
25MARS
BRIGITTEBETTY BOOM
M E R
28MARS
TINARIWENCHICKEN DIAMOND
J E U
29MARS
CABARET STONER AVEC MARS RED SKY I JACK & THE BEARDED FISHERMENROCKIN’BITCH
S A M
31MARS
JONATHAN RICHMAN FEAT. TOMMY LARKINSAFTER WORK DÈS 18H AVEC CONCERT, SÉLECTEURS & TAPAS
M A R
27MARS
S A M
24MARS
ELEKTRICITY SPRING SESSION WWW.ELEKTRICITYFESTIVAL.FR
M A R
20MARS
AU#
pour
les
abon
nés,
une
pla
ce a
chet
ée =
une
pla
ce o
ff ert
e
gra
tuit
pour
les
abon
nés
(dan
s la
lim
ite d
e 10
0 p
lace
s)
°g
ratu
it po
ur to
us
Imprimé par

MINI Store Reims Philippe Emond SASZAC Croix Blandin • Cité de l’automobile
03.26.08.63.68philippe-emond.com