article_roman_0048-8593_1974_num_4_8_5020 (1)
description
Transcript of article_roman_0048-8593_1974_num_4_8_5020 (1)

Edgar Knecht
Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée(1600-1844)In: Romantisme, 1974, n°8. Écriture et désir. pp. 103-116.
Citer ce document / Cite this document :
Knecht Edgar. Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée (1600-1844). In: Romantisme, 1974, n°8. Écritureet désir. pp. 103-116.
doi : 10.3406/roman.1974.5020
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1974_num_4_8_5020

EDGAR KNECHT
Le mythe du Juif errant
Esquisse de bibliographie raisonnée (1600-1844)
La présentation de cette bibliographie poursuit un double but : montrer l'évolution et la structure d'un mythe, d'un mythe qu'il faut se garder toutefois de mettre trop rapidement en parallèle avec ceux de Faust ou de Prométhee qui ont justement retenu l'attention des compa- ratistes \
Tout d'abord, vu le corpus extrêmement varié, le mythe du Juif errant ne fait-il pas éclater la notion traditionnelle de littérature, à moins de comprendre le mot dans un sens assez large pour que puissent y entrer livres dits populaires, chansons, chroniques, encyclopédies, opéras, recueils de légendes, articles, etc. ? En même temps, le concept d'oeuvre est mis en question : le mythe du Juif errant ne s'est incarné dans aucun chef-d'œuvre; vague et omniprésent, il est presque insaisissable, plus comparable à une présence diffuse d'images rimbaldiennes qu'à une figure littéraire, de sorte que son étude relève plutôt de la sociologie religieuse que de l'histoire littéraire. Aussi ne peut-on étudier son évolution en suivant une géographie des lettres : les passages d'un pays à l'autre (ainsi que les passages incessants d'un niveau d'expression à l'autre), nous semblent être un des aspects les plus
portants du mythe. C'est pourquoi nous avons renoncé à vouloir séparer les différents domaines nationaux3.
Notre bibliographie reflète l'état touffu de ce corpus. L'ordre choronologique montre l'évolution du mythe ; des chiffres, accompagnant les titres mentionnés de l'époque romantique, indiquent les catégories auxquelles ces ouvrages appartiennent : nous avons ainsi essayé de dégager les structures du mythe.
La périodisation a posé quelques problèmes, surtout pour le хк* siècle, en raison d'abord des variétés nationales, puis du mélange des thèmes et des pn> cédés traditionnels avec des conceptions nouvelles. Si nous avons néanmoins tenté d'en établir une, c'est pour indiquer certains centres d'intérêt.
Les textes sont généralement cités dans leur édition originale, à l'exception de ceux de quelques auteurs principaux dont nous avons signalé une édition d'oeuvres complètes. Quand la date de composition diffère de celle de la publication, nous avons respecté la première, à condition toutefois qu'elle soit certaine.
Seule la partie consacrée au romantisme tend, à une exhaustivité approximative. Les autres époques sont traitées
1. Cette bibliographie est issue d'une étude dont nous préparons actuellement la publication. A l'instar de celle, très complète, qu'on trouve dans le livre de J.J. Gielen, De wan- delende Jood, Amsterdam, 1931, elle ne fait aucune distinction entre Uvres populaires, littérature savante et études ou articles.
2. La France, l'Allemagne et l'Angleterre sont presque seules représentées : les documents épars que nous possédons en provenance d'autres pays ne permettent pas de présumer une tradition originale.

104 Edgar Knecht
très sommairement: nous y avons mis l'accent surtout sur l'évolution française.
I. — Naissance d'un mythe
Trois survivants légendaires de la Passion ont servi de modèles pour le personnage d'Ahasvérus : Male, gardien qui aurait frappé le Christ lors de l'interrogatoire devant le grand prêtre, condamné à vivre éternellement dans un cachot souterrain ; Cartaphile, portier de Ponce Pilate qui, en 1228, est censé vivre pieusement en Arménie, et Bou- dedeo ou Boutedieu, dont la légende est probablement née dans le milieu des Français établis en Syrie et qui s'est répandue en Italie. Mais trop de documents nous font défaut pour pouvoir retracer exactement et avec certitude la préhistoire de la légende du Juif errant.
De plus, si l'on tente de retrouver les ancêtres d'Ahasvérus, il convient de ne pas oublier les Juifs convertis expulsés d'Espagne vers la fin du xv* siècle, ou même les Juifs pratiquant la pénitence du Galut, subissant une errance volontaire et menant une vie humble.
Le xvr3 siècle apparaît comme décisif pour la formation définitive du mythe : la ferveur religieuse et l'instabilité politique et sociale accentuent, d'une part, l'antisémitisme hérité du Moyen Age et, d'autre part, favorisent toutes sortes de croyances magico-religieuses. Des imposteurs prétendant avoir assisté à la Passion et procédant à des guérisons miraculeuses ont largement contribué à propager le mythe.
Pour cette période, nous renvoyons aux ouvrages et articles suivants : — Killen (Alice M.), « L'Evolution de
la légende du Juif errant >, Revue de littérature comparée, t. V, 1925.
— Bataillon (Marcel), < Pérégrinations espagnoles du Juif errant >, Bulletin hispanique, Bordeaux, avril-juin 1941.
— Gielen (J.J.), De wandelende Jood in volkskunde en letterkunde, Amsterdam, de Spiegel, Mechelen, Her Kompas, 1931.
— Anderson (George Kumber), The Legend of the Wandering Jew, Pro-
vidence, Brown University Press, 1965, «A Brown University Bicentennial Publication ».
II. — Un mythe populaire (xvir3 siècle)
La première manifestation du mythe apparaît tout au début du xvn8 siècle : eue est liée à la publication, en 1602, d'un opuscule allemand dont l'étonnant succès s'explique mal sans l'existence d'un large arrière-fonds de légendes.
En France, les traductions et les commentaires proviennent surtout des cercles protestants. Moins portés vers l'antisémitisme que les écrivains allemands, les Français s'intéressent, malgré l'appellation «Juif errant*, au problème de sa longévité.
Le sujet passionne surtout les théologiens qui s'affrontent dans des discussions savantes. Les érudits enregistrent cependant cette légende avec beaucoup de prudence et raillent la crédulité populaire.
Cette époque de l'histoire du mythe est caractérisée par une certaine hésitation. Plusieurs éléments — qui resteront partie intégrante du mythe — sont créés, d'autres seront bientôt abandonnés. Quelques types de Juifs errants sont déjà ébauchés : le magicien, le témoin de l'histoire, le bouffon, le représentant du peuple juif. Au lieu d'un approfondissement, û y a un éparpillement, mais l'essentiel est l'étonnante propagation de cette Histoire, la croyance particulièrement enracinée et tenace en l'existence du Juif errant, encore attestée par le dédain et l'ironie des cercles lettrés.
1602 — Kurtze Beschreibung und Erzehs-
lung von einem Juden mit Namen Ahasvérus. Welcher bey der Creutzigung Christi selbst Persônlich gewesen auch dos Crucifige uber Christum hat helfen schreyen und umb Barrabam bitten hob auch nach der Creutzigung Christi nimmer gen Jerusalem kônnen komrnen auch sein Weib und Kinder nimmer gesehen: und seit hero im Leben ge~ blieben. Gedruckt zu Leyden, bey Christoff Creutzer. Anno 1602.

Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée 105
Nom d'éditeur et de lieu d'édition fictifs ; ouvrage probablement publié à Dantzig. La source livresque la plus importante : la Chronique majeure de Matthâus Paris (Londres, 1571). Récit d'un évêque allemand qui relate son entrevue avec Ahasvérus, advenue en 1542 à Hambourg. Première mention du nom d'Ahasvérus. Tendance antisémite prononcée. Succès considérable : cette Beschreibung fut réimprimée neuf fois la même année, et au moins trente- huit fois tout au long du xvn* siècle. Des traductions parurent dans tous les pays d'Europe. Nous nous bornerons à montrer le sort qui fut fait à ce livre en France.
1605 — Cayet (Pierre- Victor-Palma), Chro
nologie septénaire de VHistoire de la paix entre les roys de France et ďEspa- gne. Contenant les choses les plus mémorables advenues en France, Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre, Ecosse, Flandres, Hongrie, Pologne, Suède, Transsilvanie, et autres endroits de TEu- rope : avec le succès de plusieurs navigations jaictes aux Indes Orientales, Occidentales et Septentrionales, depuis le commencement de Van 1598, jusques à la fin de Van 1604. Divisée en sept livres. A Paris, par lean Richer, rue S. lean de Latran, à l'arbre verdoyant : Et en sa boutique au Palais, sur le Perron Royal, vis à vis de la gallerie des prisonniers, M.D.C.V., Avec privilège du Roy.
P. 442-446, on trouve une traduction de la Kurtze Beschreibung, suivie d'un commentaire de Cayet qui envisage les possibilités d'une pareille longévité et relève les noms des personnages légendaires de diverses religions, et les moyens, naturels et magiques, de prolonger la vie. Anderson, p. 54, mentionne une édition antérieure de cet extrait qui aurait paru en 1603 à Bordeaux.
1608 — Discours véritable dun juif errant,
lequel maintient avec paroles probables avoir esté présent à voir crucifier Jésus-
Christ. Avec plusieurs beaux discours de diverses personnes sur ce mesme subject. A Bordeaux, jouxte la coppie3 imprimée à Rouen, par Thomas Daré.
Ouvrage mentionné par Gielen, op. cit., p. 181, et par L. Desgraves, Livres imprimés à Bordeaux au XVIP siècle, Genève, Droz, 1971, p. 30. S'agit-il d'une édition originale, ou d'une réimpression d'après une édition rouennaise ? Nous l'ignorons. Nous n'avons eu en main que l'édition de 1609, parue également à Bordeaux, et portant la mention « Jouxte la coppie imprimée en Allemagne ». Elle rapporte plusieurs apparitions du Juif, la relation allemande dans la traduction de Cayet, ses commentaires, avec de légères variations, la sentence de Ponce-Pilate contre Jésus et une « Complainte en forme et manière de Chanson, d'un Juif encore vivant, errant par le monde, qui dit avoir assisté et estre l'un de ceux qui mirent à mort et crucifièrent nostre Seigner Iesus- Christ, sur le chant Dames d'honneur*.
Une autre édition, non datée, et qui ne contient ni jugement ni complainte, a paru avec la mention « Iouxte la coppie imprimée à Rouen », à Lyon, chez Thomas Daré.
1610 — Boutrays (Raoul), Rodolphi Boto-
reii in magno Franc. Consilio advocati de rebus in Gallia, et репе toto orbe gestis, commentariorum lib. XVI. Ad sereniss. Augustam Parish's, Typographia Pétri Chevaleri, in monte divi Hilari.
Note que l'histoire du Juif errant s'est répandue dans toute l'Europe. Première réaction d'incrédulité : Boutrays ne veut pas courir le risque de se voir reprocher son intérêt pour de tels contes ridicules.
1615 — La rencontre faicte ces jours passez
du Juif-Errant, par Monsieur le Prince, ensemble les discours tenus entreux. Paris, Anth. Du Breuil.
Relate trois apparitions du Juif errant (à Fontainebleau, en 1614, à Châlons- sur-Marae et en Ile de France, en 1615).
3. Nous respectons la graphie des titres, sans relever d'éventuelles étrangetés par le traditionnel sic.

106 Edgar Knecht
Première prise de position du Juif en matière politique : il admoneste le prince de Condé qui porte les armes contre le roi.
1619 — D'Esternod (Claude), L'Espadon
satyrique. Lyon, Jean L'Autret. (Réédité en tout cas en 1621, 1626, 1680.)
Satire anticléricale : le Juif errant surgit dans un couvent de nonnes, essaie de les étonner et de les séduire par le récit de ses aventures. C'est un Juif bon vivant dont le trait le plus frappant est son incroyable faculté à changer d'aspect : « En toutes saulces je suis bon. »
(s. d.) — Histoire admirable du Juif errant.
Où est prouvé par le tesmoignage des Anciens Philosophes: comme Vhomme peut prolonger sa vie, outre le commun cours de sa nature. Avec la description de la sentence ou arrest des Sanguinaires Iuifs, contre Iesus Christ le Sauveur du monde; Et comme ledit Iuif depuis la mort et passion de Iesus Christ est encores vivant errant par le monde. Anvers, Par Thomas Arnaud d'Armorin, Imprimeur, Libraire et Marchand, avec Permission. (Vers 1620 ?)
A ne pas confondre avec l'Histoire admirable ultérieure. Le commentaire de l'histoire du Juif donne lieu à un petit traité de gérontologie.
1638 — Ballet du Mariage de Pierre de
Provence et de la Belle Maguelonne. Dansé par Son Altesse Royale dans la ville de Tours le 21, en son Hostel et le 23, en la salle du Palais. Paris, chez Cordin Besogne, au Palais en la Gallerie des Prisonniers.
Le Juif y tient le rôle d'un bouffon qui débite des vers inintelligibles composés de mots fabriqués dans différentes langues.
1667 — Scarron (Paul), Le Virgile travesty
en vers burlesques. Tome premier. Paris, chez Guillaume de Lyne. (Livre I.)
Compare les voyages d'Enée à ceux du Juif errant: l'élément d'errance se trouve ainsi nettement dissocié de celui de l'origine juive d'Ahasvérus.
1668 — Droscher (Martin), Dissertatio theo-
logica de duobus testibus vivis passionis Dominicae, quam auxiliante Jésus Naza- reno crucifixa, sub umbone domini Sebastiani Niemanni SS. Th. D. in inclyta propter Salam academica publico erudi- torum examini subjicit Martinus Droscher ad idem XVIII Octobris. Iena.
L'une des thèses allemandes assez nombreuses, dont l'originalité vient du fait que Droscher utilise la double tradition de Cartaphile et d'Ahasvérus pour démontrer l'existence de deux témoins de la Passion ayant été frappés de la même malédiction.
III. — Le bon Juif errant ET LE VOYAGEUR PHILOSOPHE
(xvhï8 siècle)
Dans la seconde moitié du xvn* siècle, on nota, en France, l'absence de tout texte populaire relatif à Ahasvérus. Est- ce le signe de la méfiance des autorités religieuses envers une Histoire portant le sceau du protestantisme? Toujours est-il qu'au début du xvnr9 siècle surgit l'Histoire admirable qui fixe définitivement la légende populaire et qui restera le seul livre populaire sur Ahasvérus publié encore tout au long du xix® siècle. Les Complaintes, cependant, prennent une place importante dans l'évolution du mythe. La pitié qu'inspire le bon Juif errant favorise l'identification sociale et humaine avec le sort d'Ahasvérus : de ces Complaintes à la Chanson de Bérenger et au roman de Sue, il n'y aura qu'un pas très court à franchir.
En Allemagne, les discussions théologiques continuent. Mais le fossé entre manifestation populaire et manifestation littéraire du mythe se creuse : les auteurs, tout en reprenant ce qu'ils appellent une fable ridicule, n'hésitent pas à exprimer leurs réserves, voire leur dédain. Toutefois, les livres de voyages réels ou imaginaires ne peuvent se passer de ce voyageur par excellence qu'est le Juif

Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée 107
errant. Le Juif se fait historien ou prophète. De nouveau, il témoigne d'une inquiétude spirituelle et du besoin des hommes de repousser encore plus loin les limites de leurs connaissances.
1684 — Marana (Giovanni-Paolo), L'Esplo-
ratora turco, et le di lui relazioni segrete alla Porta Ottomana scoperte in Parigi nel regno di Luiggi U Grande, tradotte [...] da Gian Paolo Marana. In Parigi, appresso C. Barbin.
La même année parut, chez le même éditeur, la traduction française.
Plusieurs lettres mentionnent le Juif errant, curieusement appelé Michob Ader. Grâce à ce témoin oculaire des époques passées, Marana peut établir des comparaisons utiles entre le passé et le présent. Au Juif souffrant succède le Juif voyageur qui prédit l'avènement de l'unité religieuse de l'humanité.
1710 — Tyssot de Patot (Simon), Voyages
et aventures de Jacques Massé. Bordeaux.
Massé rencontre le Juif à Dieppe : il est fasciné par les connaissances exceptionnelles du voyageur exemplaire. Cette entrevue décide Massé de partir à son tour.
[1710?] — Histoire admirable du Juif errant,
lequel, depuis Van 33 jusqu'à Theure présente, ne fait que marcher; contenant sa tribu, sa punition, les aventures admirables qu'il a eues en tous les endroits du monde et l'histoire de son temps. Bruges, André Wids, s. d.
On ignore s'il s'agit vraiment de la première édition. Le nom de Wids est probablement faux : les imprimeurs français se servaient d'une approbation étrangère et d'un lieu d'impression fictif pour faire passer leur Histoire.
h'Histoire est, en quelque sorte, une anthologie de légendes : celle du Juif errant prend place dans un ensemble de
traditions apocryphes. Elle s'oppose radicalement à celle de Judas : celui-ci est le traître infâme, tandis qu'Ahasvérus ne pèche que par sa mécréance, et son sort devient touchant. On passe, comme l'a souligné M. Poliakov, de l'antisémitisme théologique à l'antisémitisme racial 4.
Nous connaissons les rééditions suivantes : Rouen, chez J.-F. Behourt, s.d. ; Rouen, chez la Vve Behourt, s.d. ; Rouen, chez P. Seyer, 1751 ; Rouen, chez La- crêne-Labbey, s.d. ; Troyes, chez Gar- nier, s.d. ; Troyes, chez A.-P.-T. André, s.d. ; Troyes, chez Baudot, s.d. ; Avignon, E. Chaillot, s.d. ; Neufchâteau, chez Godfroy, 1810 ; Porrentray, chez Deckherr, 1813 ; Epinal, chez Pellerin, s.d. ; Paris, chez Bernardin-Béchet, s.d. ; Montbéliard, chez Deckherr, s.d. ; Mont- béliard, chez de Barrots, 1856. Mais en réalité, presque chaque éditeur de livres de colportage avait inscrit à son programme cette Histoire.
1722 — Calmet (Dom Augustin), Diction
naire historique, archéologique, philologique, géographique et littéral de la Bible. Paris, Emery, Saugrain et Martin. (Article « Juif errant »).
Qualifie le Juif d'imposteur.
1722
— Grandes prophéties du Sieur de Montague, autrement nommé le Juif Errant, qui est un homme qui a fait quarante-quatre fois le tour du monde, dans lesquelles on y verra quelles sont les parties du Monde, la grandeur des Etoiles, le nombre et la grandeur de toutes les Pianettes, le nombre de lieues que fait le Soleil et la Lune par chaque heure, la manière dont se forment les Eclipses du Soleil et de la Lune, ce qui engendre FArc-en-Ciel, les Nuées, la Pluye, la Grêle, les Brouillards, la Gelée blanche, la profondeur de la Mer et celle de la Terre, et le prix des Grains, Boissons et autres Marchandises. A Selon, Chez Louis Luciot, s.d. Avec Permission.
4. L. Poliakov, Histoire de l'antisémitisme. Tome III : De Voltaire à Wagner, Paris, Cal- mann-Lévy, 1968, p. 366.

108
(s. d.) Histoire admirable. Troyes, Gamier. Contient une complainte offrant le
texte de celle qui relate l'entrevue du Juif et des bourgeois de Bruxelles, avec une variante importante : le Juif passe à Paris. Nous avons trouvé une première fois la complainte de Bruxelles dans une Histoire datant de 1810. On lui attribue généralement la date de 1774; le texte lui-même nous fait penser plutôt qu'elle fut créée autour de 1750.
[1763] Histoire admirable. Rouen, chez J.-F.
Behourt, s.d. Autre complainte, importante puis
qu'elle met en rapport le métier d'Ahasvérus et sa malédiction. Le Juif invite les cordonniers à ne pas se moquer des passants : « Vous en serez plus estimés / l'on ne pourra vous en blâmer. »
1774 — Goethe (Johann Wolfgang von),
Der ewige Jude (Fragments). Dans : Gœthes Werke, Weimar, t. XXXVIII, p. 53-64 et p. 450-456.
Poème inachevé conçu dans un esprit voltairien : Ahasvérus aurait dû procéder à une critique ironique de l'Eglise au cours de son histoire.
1777 — Mémoires du Juif errant. Dans :
Bibliothèque universelle des romans. Juillet 1777, second volume. Cinquième classe, Romans de Spiritualité, de Morale et de Politique. Paris.
Divisés en siècles, ces Mémoires présentent une vision de l'histoire qui reflète les lieux communs du xvnr3 siècle. Le Juif est un observateur moralisant, quoique impassible, des grands événements historiques.
IV. — Hantises romantiques
1. Magie, révolte et soumission (1785- 1830).
Edgar Knecht
Pendant que des chroniques 4ffi et des satiresy^- continuent à être publiés, les romantiques allemands et anglais découvrent un mythe populaire qui semble correspondre à leurs préoccupations littéraires et à leurs obsessions personnelles. Schubart et Shelley Çacent le portrait d'un Juif prométhéen ̂ , Schiller et Lewis celui du magicien ($. Les romantiques allemands sont particulièrement sensibles au caractère expiatoire de l'errance ahasvérienne (mfc ^ ̂on* entendre, en même temps, des plaintes mélancoliques Щ qui expriment leur mal du siècle. L'importance accordée aux traditions populaires incite quelques auteurs à publier des récits légendaires ф). Le goût des tableaux historiques et pittoresques^^ inspire de nouvelles Chroniques Ж
Cette époque de révolte, littéraire et politique, de renouvellement religieux n'est pas sans rappeler le début du xvir* siècle qui avait vu naître le mythe du Juif errant: comment les contemporains du comte de Saint-Germain ou de Cagliostro n'auraient-ils pas cru au Juif errant? Tendances conservatrices et révolutionnaires s'affrontent; elles exploitent les deux éléments constitutifs du mythe, l'éternité et l'errance, l'inertie et le mouvement.
1784 — Schubart (Christian Friedrich Dan
iel), « Der ewige Jude, eine lyrische Rhapsodie ». Dans : SâmUiche Gedichte, ton ihm sélbst herausgegeben. Erster Band, Stuttgart, 1785. (3)
Fragment d'une grande épopée dans laquelle Schubart pensait présenter un Ahasvérus contemplant du haut d'une montagne l'immense océan du temps et décrivant toute l'évolution du monde végétal, animal et humain. Ecrit à la citadelle de Hohenasperg, le poème est l'expression violente du désespoir ahas- vérien, contrebalancé par la foi piétiste du poète. Le fragment impressionne surtout par l'accumulation parfois presque frénétique d'images violentes. Une suite de courts tableaux peint les efforts désespérés et vains d'Ahasvérus de se donner la mort : cette partie, traduisant une révolte titanique, se retrouvera, parfois presque textuellement, dans un grand nombre d'ouvrages romantiques. La vi-

Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée 109
sion nihiliste de l'histoire que Schubart présente, a également exercé une grande influence sur les romantiques : elle est écoulement stérile du temps. L'éternité — et non plus l'errance — est le signe caractéristique de la condamnation du Juif
1785 — Reichard (Heinrich August Otto-
kar), Der ewige Jude : Geschicht oder Volksroman, wie man will. Riga. (1)
Traduction allemande des Mémoires. Détail nouveau : le Juif fait partie de la franc-maçonnerie.
1786 — Schiller (Friedrich), Der Geister-
seher. Eine Geschichte aus den Memoi- ren des Graf en von O*. Leipzig, 1789.
(4) Fragment d'un roman qui parut d'
abord dans la revue Thalia. Etude de l'influence de l'occultisme sur le caractère d'un prince protestant. Les machinations mystérieuses dont le prince fait l'objet sont ourdies par un Arménien dans lequel on reconnaît le personnage du Juif errant.
1790 — Le Juif errant. (Périodique.) Paris,
Impr. de Cordier et Meymac (t. I et t. II), de C.J. Gelé (t. III).
Profession de foi révolutionnaire du Juif errant.
1791 — Heller (Wilhelm Friedrich), Briefe
des ewigen Juden tiber die merkwur- digsten Begebenheiten seiner Zeit. Utopia, 1791 (t. I et II), Germanien, 1801 (t. Ш). (1)
Version la plus volumineuse des mémoires du Juif.
1795 — Lewis (Matthew Gregory), Am-
brosio, or the Monk, a Romance. London [John Pearson]. (4)
Le Juif apparaît dans l'épisode de la nonne de Lindenberg. Exemple le plus connu du Juif magicien.
1796 — Wordsworth (William), The Bor
derers. Dans : Poetical Works, p.p. Th. Hutchinson, London, 1904. (5)
Exemple d'un personnage inspiré par le mythe du Juif errant : Marmaduke, chef des « Borderers », décide d'expier un crime par l'errance.
1797 — Franklin (William), The Wandering
Jew : Or Love's Masquerade. (2) Comédie satirique jouée au Drury
Lane Theatre.
1799 — Le Juif errant. Journal politique et
littéraire. Paris. Publié par une certaine « citoyenne
C. Hémery », ce journal fait, par le seul titre, allusion au rôle du témoin omniscient qu'est Ahasvérus.
1802 — Schlegel (August Wilhelm), « Die
Warnung ». Dans : Musen almanach fur dos Jahr 1802. Tubingen, p. 52-59. (5)
Dans une taverne, le Juif admoneste quelques blasphémateurs.
1804 — Nachtwachen des Bonaventura.
Penig. (IV Nachtwache). (6)
1805 — Potocki (Jean), Manuscrit trouvé
à Saragosse. Texte établi, présenté et préfacé par Roger Caillois, Paris, Gallimard [1967]. (4)
Le Juif apparaît au début de la Neuvième Journée comme messager mystérieux qui apporte une lettre importante à Alphonse van Worden. Attitude ambiguë, respectueuse et irrespectueuse à la fois, de Potocki à l'égard du personnage légendaire.
1806 — Brentano (Clemens) et Arnim
(Achim von), « Das Leiden des Herrn ».

110 Edgar Knecht
Dans : Des Knaben Wunderhorn, t. I, Heidelberg, p. 143. (7)
Un Volkslied.
1807 — Schreyber (Alois), «Der ewige
Jude i». Dans : MorgenblaU, 1807, n° 170. (5)
— Gorres (Johann Joseph von), Die teutschen Volksbucher. Heidelberg.
Jugement négatif porté sur la Courte description.
1810 env. — Shelley (Percy Bysshe), «The
Wandering Jew, or the Victim of the Eternel Avenger ». Dans : Edinburgh Literary Journal, 27 juin et 4 juillet 1829.
(3) Poème inspiré par Schubart dont
Shelley avait trouvé en 1809 une traduction anglaise. Ecrit en collaboration avec Medwin.
1811 — Achim (Arnim von), Halle und
Jérusalem. Studentenspiel und Pilger- abenteuer. Heidelberg. (5)
Grand drame inspiré par Gryphius. Ahasvérus guide un jeune couple, Car- dénio et Célinde, vers Jérusalem, lieu du salut. En même temps, il veut amener ses frères de race au baptême : le judaïsme, père du christianisme, devrait se fondre dans une nouvelle religion universelle.
Premier exemple d'une nouvelle conception humanitaire du mythe du Juif errant.
— Shelley (Percy Bysshe), Si. Irvyne ; or the Rosicrucian: A Romance. By a Gentleman of the University of Oxford. London, Stockdale. (4)
1812 — Shelley (Percy Bysshe), The Wand
ering Jew's Soliloquy. P.p. B. Dobbel, Shelley Society, II, 12, London, 1887.
(3)
Le Juif lance son défi à Dieu : Shelley reprendra le même thème dans Queen
Mob.
— Byron (George Gordon, Lord), Childe Harold. Repris dans : The Poetical Works. London, H. Frowde, 1904.
La mélancolie de Harold évoque celle du Juif errant.
— Caignez (Louis-Charles), Le Juif errant. Mélodrame en trois actes et à grand spectacle. Musique de M. Alexandre. Ballet de M. Hullin. Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de la Gaieté, le 7 janvier 1812. Paris, Barba.
Premier mélodrame sur le Juif qui s'apelle, cette fois-ci, Iglouf (nom dérivé de l'allemand « ich lauf >) et qui tient le rôle de deus ex machina, déjouant les intrigues, rétablissant l'ordre moral, punissant les méchants et récompensant les bons.
1813
— Shelley (Percy Bysshe), Queen Mab. Dans : Complete Poetical Works. Oxford, 1907. (3)
Le Juif est le témoin éternel de l'abaissement de l'homme, de son hypocrisie, de son goût de la vengeance et de sa barbarie, mais il est aussi le symbole de l'esprit humain qui ne cesse de travailler au progrès.
1814
— Horn (Franz), « Der ewige Jude »). Dans: Frauentaschenbuch fur 1816, et Novellen, Berlin, t. I, 1819. (8)
Un des meilleurs exemples de ces récits historiques où le Juif amène les membres d'une famille à se soumettre à la volonté divine. Réflexion parfois assez banale sur la valeur de la vie et celle de la mort.
1816
— Shelley (Percy Bysshe), Alastor ; or the Spirit of Solitude: and other poems. London, Baldwin. (3) (6)
Plainte mélancolique et accusation violente du Juif qui ne peut mourir.
— Relation curieuse et intéressante du nouveau voyage du Juif errant : son passage à l'île Sainte-Hélène. Paris, Impr. de Setter. (2)
Pamphlet anti-napoléonien.

Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée 111
1819 — Hartig (Nepomuk Johann), «Der
ewige Jude ». Dans : Gesammelte Blatter. Sulzbach, 1822, p. 169-190. (2)
Ahasvérus est le défenseur des libertés de l'homme.
1820 — Pasero di Corneliano (Carlo), His
toire du Juif errant, écrit par lui-même, contenant une esquisse rapide et véri- dique de ses admirables voyages depuis environ dix-huit siècles. Paris, Renard, Delaunay, Pelicier, Ponthieu. (1)
Une traduction allemande de cet ouvrage parut à Gotha, en 1821.
— Witte (Karl), «Der laufende Jud auf der Grimsel ». Dans : Alpenrosen. (7)
— Laun (Friedrich) (pseud. de Schulze, Friedrich August), « Der ewige Jude ». Dans : Drei Erzahlungen. Leipzig, p. 1-88.
Le vrai Juif démasque un imposteur et sauve une jeune fille.
— Gait (John), The Wandering Jew : Or the Travels and Observations of Hereach the Prolonged. London. (9)
Image romantique du Juif chroniqueur: le côté pittoresque, dramatique et tragique de sa destinée est accentué.
— Platen (August von), «Auf Gol- gatha». Dans: Werke. Redlichs Aus- gabe, t. I, p. 516. (5)
— Maturin (Charles H.), Melmoth the Wanderer. London.
Autre personnage ahasvérien. — Salgues (Jean-B.), Des erreurs et
des préjugés répandus dans les diverses classes de société, t. I. Paris, Buisson.
(2) Ouvrage contenant un article satirique
sur le sort enviable du Juif errant, capitaliste étonnant (il possède toujours cinq sous) et voyageur privilégié.
— Byron (George Gordon, Lord), Cain. London, Murray. (3)
Rapprochement courant, à l'époque romantique, des deux figures mythiques.
1822 — Shelley (Percy Bysshe), Hellas. A
Lyrical drama. London. Dans l'œuvre de Shelley, Ahasvérus
a cédé la place à Prométhee. Dans Hellas, Ahasvérus est présenté comme le prophète d'un âge de raison où les superstitions, les passions et le fanatisme n'ont plus de prise sur l'homme.
— Hertel (Johann Jakob), Der Ausflug des ewigen Juden in malerische Aufldge in die schb'nsten Gegenden des deutschen Vaterlandes. Augsburg. (2)
Ahasvérus, conservateur, est opposé au libéralisme et déclare qu'il aurait préféré vivre en Allemagne.
1823 — Muller (Wilhelm), « Der ewige
Jude ». Dans : Taschenbuch zum geselli- gen Vergnù'gen auf das Jahr 1823. Leipzig. (6)
Toute la nature trouve son calme ,seul le Juif est condamné à ne jamais trouver le repos.
— Quinet (Edgar), Les Tablettes du Juif errant. Paris, A. Beraud. (2)
Conte voltairien qui exprime la crise de scepticisme que le jeune Quinet traverse à cette époque. Dernier exemple d'une Chronique à la manière du
siècle. — Soubira (J.A.), Le Juif errant.
Cahors, Combieu. (2) Ce court poème ironise sur Ahasvérus
le prophète qui soutient rois et empereurs dans leur lutte contre le christianisme.
— Soubira (J.A.), Le Juif errant. A ses banquiers. Montcuq. (2)
Satire dirigée contre les Anglais.
1824 — Goschel (CF.), Ueber Goethe's
Faust und dessen Fortsetzung, nebst einem Anhange von dem ewigen Juden. Leipzig.
Goschel donne une sorte de catalogue des significations multiples que peut englober le mythe du Juif errant : il en énumère quelques vingt-deux. La plus

112 Edgar Knecht
importante s'inspire de la philosophie hégélienne : le Juif symbolise les forces négatives et antithétiques nécessaires à un mouvement dialectique de l'histoire.
1825 — Klingemann (August), Ahasver:
Trauerspiel in ftinf Aden. (8) Drame romantique inspiré par la
nouvelle de Horn.
1826 — Schiessler (Sebastian Willibald),
« Auch etwas vom ewigen Juden >. Dans : Monatrosen : Oder Scherz und Ernst in Erzà'hlungen, Novellen, Màr- chen, Sagen, Schwânken, und Anekdo- ten. Prag. (5)
Une fois de plus, le Juif sauve un jeune homme d'un péché.
— Schon (Johann), « Ahasvérus, der ewige Jude ». Dans : Archiv fur Ges- chichte, Literatur und Kunst, LV. (6)
Le Juif déplore la décadence du monde moderne. Influence probable de Schubart.
— Maltitz (Freiherr von), Gelasius, der graue Wanderer im 19. Jahrhundert. Leipzig. (5)
Le personnage principal a les traits d'Ahasvérus : longévité et errance.
— Hauff (Wilhelm), Mittheilungen aus den Memoiren des Satan. Hg. von e*7. Stuttgart. (2)
Un Juif pleurnichard, enfantin, démodé : satire de l'image romantique et de la mélancolie ahasvérienne, en particulier de la nouvelle de Horn.
— Collin de Plancy (Jacques-Auguste- Simon), Dictionnaire infernal, ou répertoire universel des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de tenfer, aux démons, aux sorciers, aux sciences occultes, aux grimoires, à la Cabale, aux esprits élémentaires, au grand œuvre, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux impostures, aux arts des bohémiens, aux superstitions diverses, aux contes populaires, aux pronostics, et généralement à toutes les fausses croyances, merveilleuses, surprenantes, mystérieures ou
surnaturelles. Deuxième édition, entièrement refondue. Paris, P. Mongié aîné.
Nous n'avons pu consulter la première édition (1811) dans laquelle figurait probablement déjà la notice sur le Juif errant, interprété comme symbole du peuple juif. Dictionnaire réédité en 1844.
1827 — Croly (George), Salathiel : A Story
of the Past, the Present and the Future. London. (8)
Peinture, à la Walter Scott, de la Passion du Christ et de la destruction de Jérusalem : le Juif rassemble ses coreligionnaires pour porter des attaques incessantes contre les Romains. Son invulnérabilité donne lieu à toutes sortes d'aventures extraordinaires.
— Auerbacher (Ludwig), Ein Volks- buchlein. Enthaltend die Geschichte des ewigen Juden, die Abenteuer der sieben Schwaben nebst vielen anderen erbau- lichen und ergôtzlichen Historien. Miin- chen. (8)
Nouvelle esquisse historique : le Juif à Rome, et sa conversion.
1828 — Chamisso (Adalbert von), « Der
neue Ahasver г. Dans : Gedichte. Berlin. (6)
Autre forme du mal ahasvérien : l'amour méprisé.
1829 — Kaiser (A.), Salathiel oder die
Memoiren des ewigen Juden. Leipzig. (8)
Traduction allemande de Croly.
2. Le Peuple et les Juifs (1830-1844).
Les thèmes précédents se maintiennent et ne cessent d'être variés. De nouveaux thèmes s'y ajoutent :
Ahasvérus est, d'une part, identifié à deux groupes marginaux : le peuple souffrant et les Juifs (10) et (11). Notamment la deuxième interprétation donne lieu à des attitudes très diverses, les uns soutenant un antisémitisme parfois violent,

Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée 113
les autres se montrant pleins de pitié pour les exilés éternels. D'autre part, Ahasvérus devient le symbole de toute l'humanité et de sa marche victorieuse vers la liberté et la fraternité : il incarne le mouvement du progrès (12).
L'individualisme de la première époque romantique fait place à la considération des rapports humains et sociaux.
1830 — Brentano (Clemens), « Blatter aus
dem Tagebuch der Ahnfrau ». Dans : Gesammelte Schriften. Frankfurt, 1852, t IV, p. 69-71. (6)
— Norton (Caroline), The Undying One. London. (8)
Poème épique qui peint le sort malheureux du Juif apportant la mort aux femmes qu'il a aimées.
— P. В., Histoire du Juif errant. Paris et Montereau, G. Moronval. (9)
Date incertaine, indiquée par Anderson. Nous avons relevé deux éditions, l'une datant de 1845, l'autre de 1865
1831 — Blaul (Friedrich), Der etvige Jude
und sein Liebling in Munchen. Miin- chen (paru anonymement). (2)
— Jemand (Wilhelm) (pseud. de W. Langwiesche), Der etvige Jude. Didac- tische Tragodie. Iserlohn. (5)
Inspiré par la philosophie hégélienne. — Pfizer (Gustav), « Der ewige Jude ».
Dans: Gedichte. Stuttgart, p. 284-289. (H)
Vers mélancoliques sur la destinée du peuple juif.
— Nerval (Gérard de), « La Mort du Juif errant». Dans: Album littéraire. Recueil de morceaux choisis de littérature allemande. Paris, Louis Janet. (3)
Première traduction française du poème de Schubart. Grâce à Nerval commence en France l'histoire du mythe romantique.
— Bérenger (Pierre-Jean), « Le Juif errant ». Dans : Chansons nouvelles et dernières. Paris, Perrotin, 1833. (6)
1832
— Zedlitz (J.C. Freiherr von), «Die Wanderungen des Ahasver ». Dans : Gedichte. Stuttgart, 2e éd., 1839. (8)
— Hugo (Victor), « A l'homme qui a livré une femme». Dans: Les Chants du crépuscule. (Œuvres poétiques, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade ».)
Poème dirigé contre Simon Deutz qui avait livré la duchesse de Berry au gouvernement de Louis-Philippe. Hugo lui lance la malédiction d'A. : « Marche, autre juif errant ! »
— Barthélémy (Auguste-Marseille). Némésis. Satire hebdomadaire. Paris, Impr. de David, 1831-32.
De la foule misérable qui hante les alentours du Palais-Royal un nouveau Juif errant émerge : Chodruc-Duclos, que la longue barbe et les va-et-vient incessants dans les Galeries du Palais rendent presque semblable à son légendaire prédécesseur.
1833 — Lenau (Nicolaus), « Ahasver, der
ewige Jude ». Dans : HeidebUder. (6) — Quinet (Edgar), Ahasvérus. Un
mystère. Dans : Œuvres complètes. Paris, Pagnerre, t. XI, 1858. (12
Sans doute, cette épopée humanitaire est l'ouvrage romantique le plus important qui ait été consacré au mythe du Juif errant. Quinet procède à cet effort syncrétique dans le but de réintégrer au Bien le Mal que d'autres poètes romantiques ont fourni pour d'autres mythes. Il rejette l'idée de la chute et du péché originel sur laquelle était fondée la tradition populaire, et lui substitue celle d'un progrès continu. A. résume en lui la destinée de toute l'humanité : l'histoire est ressentie comme un continuum, animé par un mouvement sans fin.
1834 — Merville (Pierre-Français) et Mail-
lan (Julien de), Le Juif errant, drame fantastique en cinq actes, et un épilogue avec chœurs nouveaux. Musique de M. Paris, décors de MM. Desfontaines,

114 Edgar Knecht
Devoir et Pourchet, mise en scène de M. Grandville. Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de Y Ambigu-Comique, le 31 juillet 1834. Paris, Marchant. « Le Magasin théâtral », t. III, n° 66. (8)
Les scènes de la malédiction et du Jugement dernier englobent trois tableaux historiques dans lesquels les auteurs déploient une fresque grandiose. Le drame connut un grand succès.
— Lenau (Nicolaus), « Der ewige Jude ». Dans : Gedichte. Leipzig, 1910.
(6) — Steinmann (F.), « Der ewige Jude ».
Dans F. Bassmann, Die Romanzen und Balladen der neueren deutschen Dichter. Leipzig, 1834. (3)
Poème inspiré par Schubart. — Joly (Victor Vincent, dit), Le Juif
errant. Mystification fantastique en trois tableaux, représentée pour la première fois sur le Théâtre des Folies Dramatiques, le 25 octobre 1834. Paris, Marchant, « Magasin théâtral », t. IV, n° 85.
(2) Parodie du drame de Merville. — Histoire extraordinaire et remar
quable du Juif-Errant nommé Ahasvérus, écrite par lui-même avant sa mort. Paris, Impr. de J.-L. Bellemain.
Traduction du poème de Schubart, présentée sous la forme d'un livre de colportage. La même Histoire fut imprimée par E.-E. Herhan, s.d.
— Le Juif errant. Revue mensuelle du progrès. Paris. (12)
La popularité du sujet est l'une des raisons majeures pour le choix du titre. Les récits du Juif errant revêtent, aux yeux des éditeurs, un sens éducatif : elles peuvent, en démontrant les lentes améliorations de la civilisation dans le passé, hâter son progrès dans l'avenir. Ce progrès ne peut s'appuyer que sur la prise de conscience, par le peuple, de sa propre valeur.
1835 — Smets (Wilhelm), «Ahasvérus».
Dans : Kleinere epische Dichtungen. Kôln, p. 144 et suiv. (5)
— Theremin (Franz), « Der ewige
Jude ». Dans : Abendstunden, Berlin. (12)
— De Jailly (Hector), « Ahasvérus ». Dans : Ikon. Basilike (Journal conservateur) et imprimé séparément à Leipzig- Frankfurt. (2)
Fraternité, égalité et liberté, au nom desquelles l'humanité a tant souffert, ne sont que des chimères.
— Vogl (Joh. N.), « Der ewige Jude. Eine Légende ». Dans : Dullers Phônix, n° 232. Frankfurt. (5)
— Ségalas (A.)», « Aux poètes ». Dans Revue poétique du XIXe siècle, ou Choix de poésies contemporaines inédites ou traduites des langues européennes et orientales. Paris, Vve Dondey-Dupré, t. I, p. 43-45. (6)
Ahasvérus est le symbole du poète.
1836 — Seidl (Gabriel), « Die beiden Ahas-
vere ». Dans Bifolien, 1836, et Gesam- melte Schriften, Vienne, 1877, p. 88-91.
Les deux Juifs symbolisent l'idéalisme et le pessimisme.
— Schenk (Eduard von), « Hi-Tang und Li-Song », (deux fragments d'une épopée sur le Juif errant). Dans Deut- scher Musenalmanach fur dos Jahr 1836, p. 389-411. (5)
Reprend un épisode de « Halle und Jerusalem ».
— « Le Juif errant » (traduction du poème de Schubart). Dans Revue germanique, troisième série, t. V, p. 211- 215. (3)
— Robin (Eugène), Livia (poème dramatique). Paris, H. Souverain. (3)
Faust opposé à Don Juan (le type du spiritualisme confronté avec celui du sensualisme). Les personnages sont tous représentatifs d'une idée métaphysique : Ahasvérus incarne l'intelligence humaine, sans bornes ni chaînes. Drame imprégné d'idées saint-simoniennes.
— Delasalle (Paul), Pierre Gringoire ; vers publiés par Paul Delasalle. Paris, Charpentier. (6)
Deux poèmes mentionnent le Juif errant : « La Femme maudite » (p. 81- 83) varie le thème de la malédiction (un homme maudit une femme sans cœur) ;

Le mythe du Juif errant. Esquisse de bibliographie raisonnée 115
«Le Néophyte > (p. 219-222) exprime la mélancolie d'une jeunesse pour qui le passé n'a plus de valeur et qui s'avance vers un avenir incertain.
— Le Poittevin (Alfred), « Ahasvérus ». Dans Le Colibri, 18 septembre 1836, p. 31-33. (6)
Plainte traditionnelle du Juif. Influence de Schubart.
1837 — Joel-Jacobi (Franz Karl), « Harfe
und Lyra », « Klagen eines Juden ». Dans Religiose Rhapsodien. Blatter fiir die hôchsten Interressen. Berlin. (11)
La douleur du Juif errant est celle de son peuple.
— Corday (Aglaé de), « Ahasvérus ». Dans Bulletin de l'Académie ébro'icienne, suivant les règlements de l'ancienne Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de VEure. Louviers, Ch. Achaintre. (6)
Ahasvérus implore Mob (la Mort dans le Mystère de Quinet) de le laisser mourir.
1838 — Wihl (Ludwig), « Ahasver ». Dans
Athenâum fur Wissenschaft, Kunst und Leben. Niirnberg. (11)
— Rosenfeld (Isaac), « Der ewige Jude». Dans AUgemeine Zeitung des Judentums, n° 87, 21 juillet 1838. (6)
Ahasvérus, symbole de la souffrance humaine.
— Beck (Karl), Fantasien am Grabe Poniatowskys : Gepanzerte Lieder. Leipzig. (12)
Ahasvérus, symbole de la liberté dont les progrès ne s'arrêtent pas.
— Alexander (Graf von Wtirttemberg), « Ahasver und Bonaparte ». Dans Lieder des Sturms, Stuttgart, p. 216-219. (2)
Poème dirigé contre Napoléon et l'émancipation des Juifs : Ahasvérus assiste l'empereur dans ses efforts pour soumettre les peuples chrétiens.
— Mosen (Ulrich), Ahasver. Episches Gedicht. Dresden-Leipzig. (6)
Illustration la plus importante du mal du siècle ahasvérien.
— Franke (F.F.), Die Ahasveriade. Dresden. (11)
S'élève contre les Juifs et contre l'Islam.
1839
— Wolfram (L.H.), Faust: Ein dra- matisches Gedicht in 3 Abteilungen. Leipzig. (11)
Ahasvérus est le Juif éternel et pragmatique qui s'adapte à toutes les situations.
— Braun von Braunthal (Bitter), «Ahasver». Dans Gedichte. Niirnberg, p. 20-21. (11)
— Rose (Friedrich), « Ahasver ». Dans Gerichte. Hamburg, p. 18-19. (2)
Un Juif blasphémateur qui se moque de l'efficacité de la prière.
— Wittich (L.C.), « Ahasuerus ». Dans A. Nodnagel, Sieben Bûcher deut- scher Sagen und Legenden. Darmstadt, 1839, p. 102-104. (6)
L'humanité souffre de la vie, mais ne veut pas mourir.
— « La dernière heure du Juif errant». Dans Revue poétique du XIXe siècle. Paris, Vve Dondey-Duprey, mars 1839, p. 191-194. (3)
Autre traduction de Schubart. — Père Douhaire, « Cours sur l'his
toire de la poésie chrétienne ». Dans Université catholique, Recueil religieux, philosophique, scientifique et littéraire. Paris, n° 44, août 1839, p. 92-103.
Distnigue Ahasvérus, Juif « aveugle mais honnête », de Judas, « traître et cupide ».
1840
— Delasalle (Paul), « La Bibliothèque Bleue ». Dans Revue du Calvados, t. I, p. 11-24 et p. 170-185.
Essaie d'expliquer la sympathie durable du peuple pour la légende du Juif errant par l'identification sociale.
— Histoire complète et authentique ď Isaac Ahasvérus surnommé le Juif- Errant, racontée par lui-même, à Leip- sick, en 1839. Paris, Les Marchands de nouveautés. (9)

lie Edgar Knecht
1841 — Kohler (Ludwig), Der neue Ahas-
ver. Jena. (12) Ahasvérus est le symbole de la révo
lution allemande. — Stehling (Nikolaus), Dos jungste
Gericht. Dusseldorf. (5) Tandis que l'humanité recule avec
effroi devant la Mort, Ahasvérus l'accueille avec joie.
— Dutertre de Veteuil, Le Réveil de V Ambigu, Prologue d'Ouverture, en un acte, mêlé de couplets. Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre de ï 'Ambigu-Comique, le 4 mai 1841. Paris, L.-A. Gallet. (2)
Dans cette sorte de petite rétrospective de l'Ambigu, le Juif errant se plaît à prendre de multiples déguisements.
— Martin (Nicolas), « Le Juif errant ». Dans Ariel. Sonnets et chansons suivis d'une traduction de Pierre Schlemihl, l'homme qui a vendu son ombre. Paris, Desessart, p. 82-83. (5)
1842
— Gras (L.-A.), « Ahasvérus. Le Juif- Errant. » Dans Les Insomnies. Paris, Fur- ne, Montélimar, Charbert, p. 89-91. (3)
Traduction et imitation de Schubart. — Levitschnigg (Heinrich Ritter von),
«Ahasver». Dans Gedichte. Vienne, p. 88-91. (11)
Ahasvérus est un banquier juif. — Gutzkow (Karl), « Plan eines Ahas-
vers ». Dans Vermischte Schriften. Leipzig, t. II, p. 158-160. (11)
Pour Gutzkow, Ahasvérus est le symbole des « vilains Juifs ».
1843 — Heinen (E.M.L.), cDer ewige
Jude ». Dans Rheinische Glockentône. (6)
Le Juif symbolise tout ce qui est cause de notre frustration et de notre manque de repos.
— Trautmann (Franz), « Ahasvérus ». Dans Proteus : Zwei Dichtungen. Miin- chen, p. 66-68. (5)
Poème sur la fin du monde où enfin le Juif trouve son repos.
— Tillier (Claude), Mon Oncle Benjamin. Paris. W. Coquebert. (2)
Benjamin se fait passer pour le Juif errant : Tillier se moque de la crédulité populaire.
1844 — Neumann (Hermann), Das letzte
Menschenpaar. Togau. (3) (11) Influence de Quinet. Ahasvérus, Juif
convaincu, ne se soumet à l'amour divin que le jour du Jugement dernier.
— Andersen (Hans Christian), Ahasvérus, s.l. (3)
Ahasvérus est l'ange du doute qui peu à peu se convertit.
— Gôrres (Guido), « Der ewige Jude ». Dans Gedichte. Miinchen, p. 120. (5)
— Simrock (Karl), « Der ewige Jude ». Dans Gedichte. Leipzig. (6)
Les hommes sont des frères dans la souffrance.
— Oelcker (Theodor), Prinzessin Marie von Oldendorf : Oder der ewige Jude. Leipzig. (5)
Ahasvérus nous rappelle le péché originel.
— Ahasver, der ewige Jude der Urzeit. Leipzig.Meissen. (10)
Ahasvérus est le conseilla: du prolétariat.
(A suivre)

![1 $SU VW (G +LWDFKL +HDOWKFDUH %XVLQHVV 8QLW 1 X ñ 1 … · 2020. 5. 26. · 1 1 1 1 1 x 1 1 , x _ y ] 1 1 1 1 1 1 ¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5fbfc0fcc822f24c4706936b/1-su-vw-g-lwdfkl-hdowkfduh-xvlqhvv-8qlw-1-x-1-2020-5-26-1-1-1-1-1-x.jpg)


![1 1 1 1 1 1 1 ¢ 1 , ¢ 1 1 1 , 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 ] ð 1 1 w ï 1 x v w ^ 1 1 x w [ ^ \ w _ [ 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ð 1 ] û w ü](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5f40ff1754b8c6159c151d05/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-w-1-x-v.jpg)










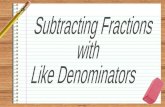
![089 ' # '6& *#0 & 7 · 2018. 4. 1. · 1 1 ¢ 1 1 1 ï1 1 1 1 ¢ ¢ð1 1 ¢ 1 1 1 1 1 1 1ýzð1]þð1 1 1 1 1w ï 1 1 1w ð1 1w1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¢1 1 1 1û](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/60a360fa754ba45f27452969/089-6-0-7-2018-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg)


