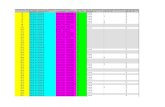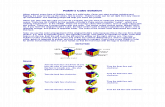article_bch_0007-4217_1939_num_63_1_2674
-
Upload
petros-josephides -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of article_bch_0007-4217_1939_num_63_1_2674
Jacques Roger
Le Monument au lion d'AmphipolisIn: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 63, 1939. pp. 4-42.
Citer ce document / Cite this document :
Roger Jacques. Le Monument au lion d'Amphipolis. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 63, 1939. pp. 4-42.
doi : 10.3406/bch.1939.2674
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_1939_num_63_1_2674
LE MONUMENT AU LION D'AMPHIPOLIS
(PI. I-X)
Le monument que nous nous proposons de publier ici a déjà une assez longue histoire, qu'il doit aux conditions de sa découverte et aux initiatives diverses qui se sont succédé autour de lui (1). Il est situé à proximité du site antique d'Amphipolis, sur la rive droite du Strymon, vers l'endroit où le fleuve achève la boucle qu'il décrit autour de la ville, dans un lieudit au nom inévitable de Marmara. On connaissait déjà là, depuis le premier passage de P. Perdrizet, l'existence d'une nécropole, où il avait remarqué parmi de maigres vestiges, un morceau de colonne dorique (2) en marbre blanc. Mais ce fut d'abord, pendant la guerre balkanique de 1912-13, le hasard d'une tranchée creusée à cet endroit par des soldats, qui mettait au jour une file régulière de blocs de calcaire ; et MM. Oikonomos et Orlan- dos (3) commençaient à découvrir, au cours de recherches sommaires, interrompues avant leur achèvement par une brusque reprise des hostilités, un ensemble de fondations. Puis ce fut surtout le passage de l'armée anglaise (4), qui signalait à nouveau ces ruines, en relevant, en 1916,
(1) BCH, LV, 1931, 184-190; LIX, 1935, 285 et 286, fig. 40 (Chron.) ; LX, 1936, 476 sqq. (Chron.); LXI, 1937, 463. AJA, XL, 1936, 152 (fig. 13) ; XLI, 1937, 333; XLII, 1938, 151 et 150 (fig. 1), 152 (fig. 2). CRAI, 1935, 188; 1937, 182; 1938, 176 et 189-190. BA, 1935, II, 29, n. 2, et p. 97 ; 1938, I, 126. REG, XLIX, 1936, 209 ; LI, 1938, 118 et 124. Cf. pour mémoire Πολέμων, II, 1938, 89 sqq.
(2) BCH, 1894, 432 sqq. Il est impossible de vérifier si ce fragment de colonne doit être rapporté au monument qui nous occupe ; mais l'attribution est vraisemblable.
(3) BCH, 1931, 184, n. 2. Cf. Néa Himéra, 11-24 mai 1913. (4) BCH, 1920, 406 (Chron.); cf. BCH, 1931, 186, n. 1. Une tradition, conservée par des officiers
britanniques qui avaient cantonné vers cet endroit, rapporte qu'un fragment de ce lion qu'on essayait de transporter vers les navires anglais mouillés à Orfano, dut, sous le feu de l'ennemi, être abandonné en chemin ; cependant la tête elle-même, dès alors connue, et qui eût dû tenter le plus, est restée. En tout cas, si l'itinéraire de l'expédition, encore marqué par les restes d'une voie de Decauville, est facilement reconnaissable, l'enquête tentée pour retrouver ce fragment est demeurée sans résultat.
LE MONUMENT AU LION D AMPHIPOLIS Ο
de puissants fragments de marbre sculptés appartenant à un lion colossal. Les éléments principaux étaient alors tous à peu près dégagés, mais la première description, gênée encore par les difficultés du lieu et son état d'abandon, n'en fut publiée qu'en 1931, par MM. Collart et Devambez (1), qui les virent au cours d'un voyage accompli dans la région.
Qu'il nous soit permis de renvoyer, pour tous détails concernant le projet de reconstitution qui prit corps peu à peu par la suite, et le rôle des ingénieurs de la Cle Monks-Ulen et particulièrement celui de M. Mac- Veagh, ministre des États-Unis en Grèce, au texte d'une conférence faite par celui-ci à l'École Française, à Athènes, et publiée par le Messager d1 Athènes (2). Il nous suffira de rappeler ici comment la fouille fut régulièrement achevée en 1934 par MM. Michel Feyel, membre, et Henri Ducoux, architecte de l'École ; la recherche fut complétée en quatre jours par le dégagement et le nettoyage des blocs en place de la base, l'étude et le classement des fragments (3). En juin 1936, suivant un accord intervenu entre les deux Écoles américaine et française, nous fîmes, M. 0. Broneer et nous, à Amphipolis un séjour de trois semaines pour préparer la reconstruction pratique du monument et nous acquitter des dernières vérifications (4) : c'est à ce moment que nous pûmes ensemble reconnaître le véritable caractère de l'édifice. Le lion se dresse, à nouveau, depuis la fin de l'automne 1937, à son ancienne place, mais sur un socle modeste, qui ne reproduit aucunement l'ambitieux monument qu'il couronnait jadis : il fallut, par nécessité, se contenter d'une réalisation plus humble. M. Broneer a pris particulièrement toute la peine de diriger et d'administrer
(1) BCH, 1931, 184-190. (2) Les 27 et 28 février ,et le 2 mars 1937 (trad, française). M. Broneer se propose de revenir à
son tour bientôt sur toutes ces circonstances et d'exposer toutes les conditions de la reconstitution. (3) Tandis que M. Feyel étudiait les ruines, prenait les photographies nécessaires (nous lui en
devons plusieurs de celles que nous reproduisons ici), et donnait les premières conclusions fermes sur la sculpture (cf. BCH, LIX, 1935, Chron., 285-6 ; RA, 1935, II, 29, n. 2 et 97), M. Ducoux, mesurant et dessinant tous les blocs conservés, établissait, par un difficile et ingénieux travail, un premier schéma de la figure sculptée (cf. BCH, 1935, Chron,, 286) : M. Panayotakis, en maniant, combinant et raccordant les moulages mêmes de tous les blocs, a opéré par la suite en dernier lieu les corrections nécessaires. Nous remercions ici très vivement M. Feyel de nous avoir généreusement cédé, avec les résultats acquis de son travail, tous ses droits en vue de la publication.
(4) Nous n'avons ajouté de nouveau au lot qu'un petit fragment du lion, appartenant au poitrail, et un certain nombre d'éclats des chapiteaux et des colonnes. Diverses tranchées, menées sur les abords immédiats, ont montré le sol vide {BCH, 1936, 476 sqq. Chron. ; AJA, 1937, 333). Notre séjour n'aurait pas été possible sans l'hospitalité et les facilités de toutes sortes que nous ont offertes les ingénieurs de la Compagnie américaine Monks-Ulen, qui ont pris si vivement à cœur dès le début la restauration du lion ; c'est à eux d'abord qu'on adressera les remerciements les plus sincères et les plus vifs pour tous les travaux qui ont pu être réalisés sur place.
b J. ROGER
la restauration, confiée au sculpteur A. Ν. Panayotakis ; l'exposé que nous présentons ici, signé d'un seul nom, exprimera aussi sur bien des points le résultat d'une recherche poursuivie en commun (1).
Les ruines, maintenant modestes, se tiennent sur la rive droite du Strymon, à 4 ou 5 kilomètres de la mer. C'est l'endroit où le fleuve, sortant du passage resserré qu'il se taille dans une ligne de moyennes hauteurs, va s'élargir à nouveau dans une plaine sablonneuse et plate. Du monument, on aperçoit, sinon le rivage, du moins tout le vaste et majestueux méandre que le Strymon décrit avant d'arriver à la mer. Le petit amas de blocs travaillés ou sculptés, fragments du lion mêlés à des blocs de calcaire ou de marbre, provenant de la base, gisait là presque sur la rive du fleuve, sur le côté d'une petite vallée remontante, sillonnée par un court ravin. Le monument s'adossait, construit sur la pente même, à une petite colline, haute d'une quinzaine de mètres, qui forme le dernier prolongement des hauteurs qui portent Kerdylion, vis-à-vis d'Amphipolis. La ville était en face, vers le Nord-Est, derrière le mamelon pelé qui se montre seul aujourd'hui (cf. pi. I et- II).
P. Perdrizet, qui visita le site à la fin de l'année 1894, y avait reconnu une nécropole (2), qui occupait dans l'antiquité le creux de cette petite vallée, dernier compartiment de terrain isolé que le Strymon détermine sur son cours. De là provenaient d'après lui toute une série de fragments inscrits, d'époque grecque déjà, retrouvés à Kerdylion (3). Il put voir aussi sur place des constructions de tuf jaune, et un fragment de colonne dorique. Les courtes recherches de 1936 ont dégagé à quelques mètres derrière le monument, sur la pente même de la colline, les restes épars d'une tombe de petite fille, faite de plaques de terre cuite, accompagnés d'une stèle à fronton, simple et assez commune, portant le nom de Νίκαια Εύξιθέου (4). Sans doute la nécropole n'eut-elle cependant ici qu'une importance restreinte, et demeure-t-elle comparable à ces groupements de sépultures et de tombeaux que l'on trouve toujours à partir d'une
(1) Les principaux éléments de cette étude ont déjà fait l'objet d'un mémoire soumis à l'Académie des I. et B.-L. en 1937 (CRAI, 1938, 189-190).
(2) BCH, 1894, 431-4. (3) Stèles funéraires ,dont « l'écriture élégante » indique le me ou le ne siècles, et bas-reliefs
funéraires. A citer aussi quelques fragments d'épitaphes plus récentes, et des débris qui vont jusqu'à l'époque romaine : sarcophages, inscription latine publiée par Cousinéry, que cite Perdrizet (mais Cousinéry, Voyage, 1, 134, n'indique pas que l'inscription provienne précisément de cet endroit). Cf. Collart-Devambez, BCH, 1931, 186.
(4) A dater, semble-t-il, d'après les caractères, du milieu du mesiècle (M. Feyel). La tombe fut donc creusée après la construction de notre monument. Cf. flg. 1.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS
certaine époque aux portes d'une grande ville, et bordant la voie d'accès (1). Il faut évidemment croire, en effet, qu'elle dépendait d'Amphipolis,
et non du bourg antique de Kerdylion, comme on a pu le penser parfois (2) : celui-ci, s'il faut maintenir l'identification, qui semble assurée (3), avec le village moderne de Κάτω-Κερδύλιον (ancien nom : Κάτω-Κρούσοβα) , se serait trouvé à quelque trois ou quatre kilomètres de distance, par un
chemin escarpé, extrêmement malaisé et pénible. La petite vallée aux tombeaux regarde au contraire vers Amphipolis ; elle forme la suite naturelle de la nécropole découverte très exactement en face, sur l'autre rive, dans les travaux de construction de la nouvelle route. Elle devait même être très directement reliée, par un pont, avec la ville (4).
Les travaux de la compagnie américaine, en creusant profondément le cours du fleuve, ont extrait des eaux, précisément en face du lion, une énorme quantité de blocs de marbre accumulés à cet endroit (5). Ils sont de nature assez différente ; la plupart présentent un travail encore hellénistique (me ou iie siècle ?) : parements de 1 m. 20 χ 0 m. 82,
sur 0 m. 35 d'épaisseur, plaques de couverture en forme de larges tuiles, assez singulières et de dimensions analogues, blocs de seuil monumental ou
(1) Le texte de Perdrizet fait entendre qu'il vit là plusieurs tombeaux, dont « la plupart» appartenaient à l'époque grecque. Le terrain, cultivé, ne laisse plus rien paraître maintenant à côté du monument au lion. Les sondages rapides menés sur le devant, au Nord, n'ont rien retrouvé, qu'un amoncellement de cailloux traînés par le torrent. Certaines des « fosses rectangulaires » dont parlait Perdrizet ont été cependant revues par M. Panayotakis, à quelques mètres sur le côté Ouest des fondations, dans un moment où le terrain était complètement débarrassé des cultures, après un léger grattage. Les substructions de notre monument sont faites de ces mêmes « larges blocs de tuf jaune » que Perdrizet signalait. Les fragments de colonnes doriques retrouvés depuis sont à vrai dire de dimensions légèrement moindres que celles qu'il indique pour le sien (ouverture des cannelures : de 7 cm. 5 à 8 cm. 1, au lieu de 10 centimètres). Mais cette différence peut s'expliquer par des raisons fort simples (indication approximative, mauvaise conservation du fragment et difficulté de la mesure, etc.). On ne voit rien, autrement, à quoi l'attribuer.
(2) Ainsi Perdrizet, /. c, suivi peut-être trop rapidement par Collart-Devambez, Λ c. (3) Ainsi Cousinéry, Voyage en Macédoine, I, 134 (et pi. VIII) ; Leake, Northern Greece, III,
191-2 ; Perdrizet, l. c, 431 sqq. Pélékidis, ΠΑΕ, 1920, p. 93 ; Collart-Devambez, /. c, 190. (4) On connaît depuis longtemps la nécropole principale, au-dessus de Νεοχωρι (ancien nom :
Iénikieuï), et à l'Est, vers le col qui sépare la colline d'Amphipolis des hauteurs du Pangée (Cf. Perdrizet, BCH, 1897, 514-515). Mais elle n'était pas l'unique emplacement des tombeaux.
(5) A. D. Kéramopoullos, 'Αρχ. Έφ. 1932, Άρχ. χρον. Ι sqq. ; P. Roussel, HA, 1934, 1, 40.
Fig. 1. — Petite stèle inscrite.
ο J. ROGER
linteaux de porte décorés de bandeaux, qui doivent provenir de la démolition, tardive, d'un édifice considérable subsistant à proximité ; à cela s'ajoutent des éléments divers, larges blocs de tuf, ou stèles et bas-reliefs funéraires dont certains descendent jusqu'à très basse époque, ou plaques de sarcophages, qui peuvent venir de Marmara comme de l'autre rive. C'est là que fut trouvé le fragment de règlement militaire publié par M. P. Roussel, avec son complément publié par M. Feyel (1). On voit encore au même endroit, sur la berge du fleuve, une dédicace de la ville en l'honneur de Caracalla, qui fut extraite dans les mêmes conditions (2). Les machines ont arraché les blocs un à un; mais sur un grand nombre, des traces attestent qu'ils se trouvaient remployés dans des constructions massives, solidement liées par des crampons de fer scellés au plomb, ou, d'autres fois, par du mortier (3). Celles-ci formaient d'une rive à l'autre une sorte de barrage, construit — ou refait — à l'époque byzantine. Une inscription retrouvée dans le fleuve à 200 mètres plus bas commémore un pont construit sous Tibère par une légion romaine (4) : on serait tenté de la mettre en rapport avec ces vestiges énigmatiques. L'endroit, plus resserré, après un coude du fleuve et juste avant l'élargissement marécageux de la vallée, est le plus favorable à un ouvrage de ce genre. On croit pouvoir reconnaître là le tracé le plus normal d'une route qui devait franchir le col naturel dessiné par le terrain entre la ville et les premières pentes abruptes du Pangée, en passant sous les murs de la ville (5). Tous ces signes, assez convaincants pour une époque postérieure, romaine, nous permettent sans doute de remonter à un moyen de passage quelconque plus ancien, déjà grec. La ville d'Amphipolis* peut avoir ainsi disposé, pour franchir le Strymon, de deux ponts : celui du Nord, qui semble bien attesté, pour assurer les communications avec la Sintique et la vallée supérieure du Strymon (6), et le
(1) P. Roussel, ib., 40-47. M. Feyel, RA, 1935, II, 29 sqq. (2) Kéramopoullos, /. c, n. 17; texte amélioré par A. Stein dans Papastavrou, Amphipolis,p.9Q. (3) C'est certainement sur ces constructions que Leake (Northern Greece, III, 184-5) a encore
vu un moulin, dont il n'existe plus de traces depuis longtemps. Elles étaient aussi utilisées par les pêcheurs pour retenir le poisson (anguilles célèbres) du lac Kerkinitis, au temps de Pierre Belon du Mans (Observations, 1, 55).
(4) Kéramopoullos, /. c, 3 ; et ΠΑΕ, IX, 1934, 12-14. Cf. A. Stein, /. c, 94. (5) Cf. Pélékidis, "Ερευνοα εν ' Αμφιπόλει,ΠΑΕ, 1920, p. 82 et plan p. 81; et notre carte,
pi. I (cf. pi. II). • (6) Cf. Leake, Northern Greece, III, 196; Hirschfeld, dans PW, Real-Enc, I, 2, 1950 ; Pélékidis,
l. c, 83, malgré Kromayer, Aniike Schlachtj elder, IV, 201 (cf. 583), et sa carte reproduite dans Glotz-Cohen, Hist, gr., 653, extrêmement hypothétique. C'est l'emplacement qui explique le mieux la manœuvre de Brasidas à l'arrivée de Cléon en 422, sinon ses mouvements pour prendre la ville en 424. C'est là que se trouvait aussi (Cousinéry, 1, 134, et croquis pi. VIII) le pont turc en bois de Iénikieuï (cf. le récit de Leake). On a retrouvé dans le fleuve à cet endroit un certain nombre de blocs taillés en voussoirs qui devaient appartenir à un pont romain.
LE MONUMENT AU LION d'amPHIPOLIS 9
passage du Sud, qui donnait accès aux villes intérieures de Chalcidique, et, par là, à toute la Macédoine occidentale (1) : nous en retiendrons simplement la double conclusion que la petite nécropole de Marmara se trouvait liée avec Amphipolis, et placée sur une voie de passage importante.
Le Lion
Structure et combinaison des fragments. — Nous n'avons pas tous les fragments qui composaient jadis l'animal gigantesque dont les restes ont
été retrouvés épars ; mais avec les éléments qui sont demeurés il est possible de se représenter à très peu de chose près la figure dans son ensemble : nous avons les parties essentielles, et au moins les indications nécessaires pour toutes les hauteurs de la construction. Celle-ci se laisse apprécier tout d'abord comme une belle œuvre d'architecture.
Les grands fragments conservés sont au nombre
de 14 ; mais certains se recollent entre eux. On peut les classer comme suit :
Fig. 2. — Bloc n° 3 (renversé).
N° 1. Tête: mufle et crinière ; toute la longueur ; le bloc est coupé dans le sens horizontal au-dessus des yeux et au-dessous de la mâchoire supérieure, dans le sens vertical au milieu de la joue droite. Manquent la calotte du crâne, la joue droite, la mâchoire inférieure. — Hauteur : 0m,77 ; la profondeur atteint plus de deux mètres. PI. IV, a et b ; et fig. 4, 10 et 13.
N° 2. Crinière : côté droit du cou ; le bloc est brisé aux extrémités antérieures (il porte encore les traces de la collerette de poils qui entourait le dessous du mufle) et postérieure (il s'arrête bien avant la ligne médiane du dos). L'autre côté du cou manque. — Hauteur : 0m,63. Fig. 4.
(1) Cf. Grote, III, 666 et note ; Arnolds, Thucydide, II, 174, et carte ; Busolt, III, 2, p. 1152, cités par Pélékidis, l. c, 82 sqq. Cf. Collart, Philippes, 508, n. 6. Pour la route en général, voir Tafel, de Via Egnatia (1837-1842) ; Collart, BCH, 1935, 395 sqq. et Philippes, 487 sqq.
10 J. ROGER
N° 3. Epaule: côté gauche ; intact sur sa face intérieure, taillée pour l'assemblage ; mais ne conserve que sur une infime étendue la surface extérieure, qui indique le modelé à la chute du cou. Manque l'autre côté, certainement symétrique. — Hauteur : 0m,88 (cf. n° 9). Fig. 4.
N° 4. Poitrail: au-dessous du précédent ; bloc transversal, donne à gauche et à 'droite le flanc à l'attache des pattes antérieures. Il s'y adapte un fragment isolé. Manque toute la partie postérieure. — Hauteur : 0m,57. Un ressaut, sur la face
supérieure, marque exactement la place où le bloc 3, au- dessus, s'arrêtait. Fig. 2 et 5.
N° o. Patte avant droite: partie supérieure. Le reste de la patte manque. Hauteur conservée : lm,3G. PI. V, b ; et fig. G et 8.
N° G. Patte avant gauche: le bloc, d'un seul morceau, s'est brisé en deux. Partie supérieure (n° G) : lm,25di ; partie inférieure (G bis)': lm,22±. PI. V, c.
N° 7. Patte arrière droite: gros bloc, comprenant la partie droite du train arrière et la jambe repliée, moins le pied (bloc isolé rapporté, qui est perdu) et la dernière art
iculation (brisée) ; ne va pas tout à fait jusqu'à la ligne médiane du dos ou à la queue. — Hauteur : lm,84. Fig. 3, 5 et 7.
N° 8. Patte 'arrière gauche: bloc symétrique, à gauche ; entier, même hauteur. PL V, a et fig. 5.
N° 9. Dos: petit fragment, portant la raie de division des poils ; s'encastre dans le n° 3. Donne, par le record du 3 avec le 4, déjà placé, le passage exact de la ligne du dos.
N° 10. Deux fragments réunis, très abîmés de tous côtés, mais sur lesquels on peut reconnaître un peu de la surface du corps (à peu près indéterminée).
N° 11. Fragment de crinière: place également indéterminée (poitrail?). Plus grande dimension : 0m,30.
Aucun autre fragment de quelque importance n'a pu être retrouvé, si l'on met à part un petit éclat de la mâchoire inférieure, qui assure la restau-
Fig. 3. — · Patte arrière droite.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 13
ration. Ce qui manque a dû être cassé sur place pour faire de la chaux ou pour toute autre raison, comme en font foi les multiples débris de marbre portant encore des traces de travail (surtout de la crinière) qui ont été relevés sur le terrain ou emportés au loin (cf. p. 4, n. 4). Ce sont les blocs les plus irréguliers ou les plus massifs qui sont en général demeurés ; du moins ne manque-t-il rien de vraiment essentiel. La statue était composée de blocs rangés par assises : nous avons la hauteur de chacune et de quoi compléter, quelquefois avec certitude, le plus souvent avec une probabilité suffisante, les parties manquantes. La reconstitution a été possible, non seulement sous la forme abstraite d'un dessin mais par une réalisation réelle sur le terrain, dans tous les détails de la figure sculptée. Les lacunes devront simplement inspirer quelque retenue dans l'appréciation du style.
A la base étaient établis les morceaux les plus massifs : deux blocs immenses, hauts de 1 m. 84 et larges de 2 m., dans lesquels le sculpteur a taillé les membres postérieurs (nos 7 et 8). Ils reposaient par leui propre poids, sur une face assez large soigneusement polie et mise d'aplomb. Ils ne semblent avoir été assujettis au sodé par aucun scellement (1) ; la précaution eût été mutile : leur équilibre, déjà solide, était raffermi par les blocs qui s'encastraient entre eux et par tout le poids de la charge supérieure. Entre ces deux blocs s'inséraient d'autres fragments — maintenant perdus — pour assurer vers l'avant leur écartement et figurer le dessous du corps (fig. 5 et 7) ; un autre s'intercalait, en coin, \ers l'arrière pour former l'arête du dos (cf. pi. VI, lre assise). Dans le bas, les pattes se prolongeaient par un bloc de marbre rapporté et joint pour donner la dernière articulation et le pied. — Sur cette base portait toute la partie basse du corps (cf. pi. VI).
Les membres antérieurs, d'autre part, étaient taillés chacun dans un bloc unique, de 2 m. 41 ± de haut : sur eux reposaient au contraire essentiellement les parties hautes (nos 5, 6 et 6 bis).
Nous avons le bloc (n° 4) qui s'attachait aux pattes avant à leur naissance
et qui s'adapte à leur face postérieure (fig. 2 et 6, et pi. VI, 2e assise) : il a 57 cm. de haut. Il avait pour rôle principal de maintenir fermement par le haut l'écartement des pattes arrière, et d'y lier les pattes avant. — A ce niveau nous comptons les lacunes du bloc postérieur (dos) et du bloc
(1) II semble cependant que le scellement qui joignait, par en-dessous, le bloc rapporté de la patte arrière prenait aussi appui dans le socle.
14 J. ROGER
intercalaire entre les pattes avant : elles ne sont pas réellement gênantes pour la reconstitution de l'animal.
Là-dessus s'élevaient les parties hautes de la bête : cette fois les blocs qui les composaient, portant également sur le système avant et sur le système arrière, couvraient d'une seule pièce au moins la plus grande dimension de l'assise, et de manière à s'entrecroiser. Venait d'abord le
n° 3, qui occupait la moitié de la tranche ainsi constituée (pi. VI, 3e assise) ; puis des fragments de la crinière (n° 2 : cf. pi. VI, 4e assise) : l'assise était composée de deux blocs, auxquels s'ajoutait un petit fragment rapporté ; enfin la tête, avec son applique de côté ; et — pour couronner le tout — le crâne, aujourd'hui perdu, mais qui devait, à en croire le jeu des proportions, mesurer environ 68 ou 70 cm. de haut.
On recompose ainsi (pi. VI) la figure d'un lion assis, type bien connu déjà en Grèce, en particulier par des exemples célèbres comme Thespies ou Chéronée. C'est l'attitude qui s'impose au sculpteur dès qu'il s'agit d'une œuvre colossale, si on ne veut pas se contenter de la forme étendue et moins imposante du lion couché. L'animal est ainsi construit en équilibre, bien d'aplomb, sur une base assez large qui lui permet de s'élever sans
risques, suivant le principe de la pyramide, et de telle façon, grâce à l'arrière- train replié et massif, que les parties inférieures supportent solidement tout le corps : le lion passant ou rampant, reposant sur quatre trop minces supports, n'est possible qu'à très petite échelle ; il exige en tout cas l'emploi d'un bloc monolithe. Seule l'attitude assise libère de cette obligation.
Au total, l'animal mesurait 1 m. 84 + 0 m. 57 + 0 m. 88 + 0 m. 63 + 0 m. 77 + 0 m. 68 ±, c'est-à-dire de 5 m. 37 à 5 m. 40 environ. A la base, il s'inscrivait dans un rectangle de 3 m. 30 sur 2 m. 10 environ.
Cette construction considérable fut réalisée naturellement sur un plan et des dessins mûris et établis d'avance .jusque dans le détail. Les blocs semblent avoir été seulement un peu retaillés, puis polis et ravalés, après
Fig. 6. — Patte avant droite, face postérieure.
LE MONUMENT AU LION D AMPHIPOLIS 15
leur mise en place : ils devaient être dégrossis et complètement formés en place déjà, avant d'être scellés. C'est ainsi que l'artiste pouvait à chaque assise ajuster à mesure ses joints en ayant déjà exactement la forme générale de l'ensemble. Il n'avait plus, ses pièces montées, qu'à rejoindre les surfaces, corriger les détails, polir, donner le fini. Il est étonnant de constater combien le travail de révision a eu peu à reprendre : presque nulle part, par un crampon rejeté à une place insolite ou irrégulière, par un manque de symétrie dans les anathyroses ou les surfaces jointives, etc. on ne peut soupçonner qu'il ait été retaillé après coup plus qu'il n'était prévu lors du montage.
Chacun des fragments porte la trace d'un travail très minutieux : avant même d'en venir à la sculpture, le soin de la préparation est sensible dans l'assemblage des blocs. Les coupures entre assises sont strictement horizontales et de niveau, sauf, peut-être, pour le bloc de la tête, mainte - nant d'ailleurs assez abîmé. Les contacts d'un bloc à l'autre sont exactement taillés et polis ; la parfaite adaptation de deux surfaces est facilitée et assurée par des anathyroses largement dessinées : on a ménagé vers le contour extérieur, là où il faut que le joint ne montre aucune fissure, une large bande portante qui se prête à un ajustement rigoureux (cf. fig. 6). Certains blocs qui pourraient être instables sont encastrés dans des évide- ments où ils prennent solidement appui : ainsi pour les blocs qui s'intercalent sur le devant entre les pattes arrière l'encastrement compense l'inconvénient du porte-à-faux (et le poids supérieur contribue à tout maintenir en place) : cf. fig. 7. De même pour le bloc n° 9 (qui n'est peut-être qu'une réparation) : cf. pi. VI et fig. 5.
Les pièces sont assurées dans leur position, sans jeu possible, par des goujons, de forme carrée (cf. fig. 9 : face supérieure du morceau de crinière du cou ; les scellements tenaient là l'applique rapportée de la joue droite), ou rectangulaire (fig. 7, patte arrière droite).
Fig. 7. — Patte arrière droite, préparation intérieure.
16 J. ROGER
Ils ne sont pas multiples, mais assez puissants: un seul goujon, de forme rectangulaire allongée, retient le bloc en biseau qui intervient à l'arrière
entre les pattes pour former le dos (fig. 5 et 7, pattes arrière gauche et droite) : l'assise supérieure contribuait aussi, il est vrai à le fixer. De même à la partie supérieure du bloc n° 3, des pattes arrière, du bloc n° 9, ou du n° 4 ou des pattes avant (fig. 8) (1). Un tenon très petit resserre vers l'avant l'écartement des pattes arrière, en agissant sur le bloc transversal encastré (fig. 7). Des évidements très allongés (fig. 8) paraissent être des trous de louve.
Fig. 8. — Patte avant droite, Dans le sens horizontal, des face supérieure. » , , , crampons — fer et plomb — tien
nent les blocs en une adhérence étroite. Ainsi sont fixés les blocs qui pourraient glisser ou se déboîter : comme le bloc n° 9 — ou ceux dont la liaison importe pour l'équilibre et la solidité générale : pattes avant liées au corps (mais c'est là un robuste scellement en Τ qui a été choisi: fig. 8), ou bloc n° 3 lié avec son symétrique, ou enfin crampon destiné à retenir le fragment encastré dans la cavité intérieure des cuisses (fig. 7, et face supérieure du bloc n° 8). Tous ces scellements, Fig. 9 _ Bloc n0 2, face supérieure, sauf celui des pattes avant, sont de la forme la plus simple, en Π. Quelques-uns ont une forme de queue-d'aronde assez récente, comme nous en montreront' aussi les
(1) Nous n'avons conservé, par un singulier hasard, de correspondance d'une assise à l'autre entre les mortaises qu'entre la tête et le côté du cou (n° 2) ; et encore le bloc de la tête est-il là extrêmement abîmé.
LE MONUMENT AU LION d'amPHIPOLIS 17
blocs de la base, mais avec une sorte (Γεμβολον. Les crampons disposés sur les faces supérieures étaient naturellement scellés à mesure et recouverts par les assises successives ; tout en haut, le crâne était fixé — ■ à cause de son peu d'épaisseur sans doute — par de minces tenons de fer : et il a fallu, là, pratiquer un étroit canal pour couler le plomb de l'extérieur.
Les joints mêmes, pour assurer la solidité de la construction, sont attentivement surveillés : ils sont répartis de façon irrégulière, au hasard de la dimension des blocs (1), mais aussi de telle sorte que jamais, en se répétant à trop peu d'intervalle sur la même ligne ou dans le même sens, ils ne puissent créer une zone de moindre résistance. Les lignes d'assemblage se contrarient l'une l'autre : aux deux pattes arrière, coupées dans le sens longitudinal, succède une assise dont le rôle est d'assurer les blocs dans le sens transversal (n° 4). Inversement, au-dessus il reste à assurer l'adhérence des pattes et du corps: c'est à quoi pourvoient deux blocs avec coupure longitudinale (n° 3 et symétrique). Enfin, après les deux blocs du cou et avant la calotte crânienne, la tête coiffe le tout d'un seul morceau.
Enfin, partout, dans la mesure qu'autorisaient les nécessités de la construction, les parties intérieures inutiles, qui ne contribuent ni à la solidité ni à l'équilibre, sont évidées et creusées pour alléger le poids de l'ensemble. C'est une précaution qui a été constatée déjà à Chéronée (2), où le sol risquait de mal soutenir une base un peu étroite. Ainsi les pattes arrière, le bloc n° 4, le cou, qui devait former une sorte de grande couronne
Fig. 10. — Bloc de la tête, face inférieure.
(1) Ainsi la coupure de la joue droite : nous ne pouvons croire, avec Collart-Devambez (/. c, 188), qu'elle soit intentionnelle à cette place. Cf. fig·. 10.
(2) Pour le lion de Chéronée, v. Collignon, Statues funéraires, 233 et fig. 152-3; cf. Welcker, Monum. ed Annali, 1856, I sqq. pi. I ; Taylor, Transactions of Noyai Soc. of Liter. Londres 1864; Koumanoudis, 'Αθήναιον, IV, 1875, 304 sqq.; Koerte, AM. Ill, 1878, 385, n° 151 ; Stamatakis, ΠΑΕ, 1879, 22 et 1880, 16; Phytalis, 'Αθήναιον, IX, 1880, 347-352; Cavvadias, ΠΑΕ, 1903, 27-32 (Cf. Pausanias, IX, 40, 10 ; Strabon, IX, 414).
18 J. ROGER
creuse, et la tête, où la cavité pratiquée atteint plus de 35 cm. (fig. 10). Tous ces détails sont autant de marques du soin avec lequel a été composée en elle-même la masse à sculpter.
La sculpture. — La matière est un marbre de Thasos, mais à assez gros grain, blanc et brillant, qui même poli et lissé demeure assez rugueux. C'est le marbre qui se prête le mieux, pour ses qualités de résistance à la lumière, à ce genre de monument. Avec le temps il gagne une sorte de patine grise assez égale, qui ne diminue nullement le relief : c'est le caractère qu'ont les fragments dans leur état actuel.
La sculpture montre partout un soin très attentif. Si la représentation de la bête est bien encore à peu près aussi conventionnelle que dans les autres exemples de la même série, le corps se compose de grandes masses solidement liées et proportionnées, d'un équilibre assez robustement posé, mais en quelque sorte plus naturel, et les détails sont quelquefois plus heureux qu'ailleurs. L'artiste a poursuivi avec la même conscience dans toutes les parties la recherche de l'effet général à produire.
Ce qui frappe le plus, c'est d'abord la crinière. Elle couvre la tête et le haut du corps, et tombe sur les épaules en un bloc assez épais et massif. Autour de la tête les poils se dressent légèrement, pour former cette espèce de collerette hérissée caractéristique de l'animal. Le dessin en est marqué sans insistance, dans le style ordinaire du ive siècle, bien éloigné de ces dards jaillissants qui paraissent entourer la tête de certains lions de l'archaïsme ou des monnaies (1). Elle était au repos, légèrement retombante, et un peu figée.
(1) Cf. les lions des vases ioniens et corinthiens (une hydrie de Cœré à Berlin : Anlike Denk màler, II, pi. 28) ; les monnaies d'Ionie, ou d'Akanthos (G. Richter, Animals in Gr. Sculpture pi. V, 14-17 ; cf. Regling, Gr. Mùnzen d. Samml. Warren, pi. XIII, n. 537-546) ou de Rhégion
Fig. 11. — Le lion du Pirée, à Venise.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 19
Le traitement de la crinière, dans sa masse, est ici encore d'une application plus complaisante qu'exacte, mais assez vigoureuse. Les poils sont figurés par mèches longues et puissantes, qui tombent d'un mouvement légèrement irrégulier, heurté, mais sans révolte, de la tête et du cou, se groupent, se prolongent les unes les autres, et reviennent vers l'avant du corps pour se terminer sur la poitrine. L'ensemble, avec ses inévitables gênes, a un relief assez suggestif. C'est dans le principe la même représentation classique, et devenue très vite conventionnelle, que dans les œuvres attiques du ive siècle (1), ou surtout à Chéronée : on a rompu depuis longtemps aussi bien avec les petits losanges géométriques des types milésiens (2) qu'avec les petits sillons inégaux et serrés du lion de New- York (3) ou de ceux de Xanthos (4) ; le procédé paraît déjà — dans la mesure où les pauvres restes maintenant visibles du monument prêtent à comparaison — à Thespies (5) ; il existe, dans un style plus sobre et plus direct, à Gnide (6) ; il se maintiendra avec quelques variantes pendant toute la période
(Richter, VI, 18-19), de Vélia {ib., VII, 22) ; ainsi encore un bronze de Boston (ib., IV, 12 ; Burlington Catalogue, 1904, pi. LVIII, n° 65) ; le lion de la frise des Siphniens (Delphes, IV, I, pi. XIII- XIV) ou même de Loutraki, à Copenhague (Richter, 1, 4 ; Schroder, d. Bmnn-Bruckmann, texte aux pi. 641 sqq., p. 7 et 8, iig. 8-11).
(1) Lion du Pirée, à Venise (Zanetti, délie antiche statue Gr. e. Rom. II, 48 ; Welcker, Aile Denkmàler, V, 75 ; de Laborde, le Parthenon, pi. IX, 15 ; Bosanquet, Days in Attica, pi. XIII) ; lions du Céramique à Athènes (Collignon, l. c, 228, fig. 148 et 227, iig. 147) ; lion Van Branteghem (ib., 230, fig. 150) ; lion de Vigonovo, à Berlin ( Brunn-Bruckmann, 644 ; cf. Jahrbuch d. Kb'n. Preuss. Kunslsamml. XII, 54 et XIII, p. xxm ; Collignon, /. c, 230; C. Blûmel, Tierpl. aus fùnf Jahrl., n° 83) ; lion Halgan du Louvre (cf. E. Michon, Mém. Soc. Anl., LVIII, 1897, 26-54, et Collignon, /. c, 229, fig. 149). A citer enfin le lion de l'Hymette, à Liopési (cf. Perdrizet, HA, 1897, 1, 136). Certaines de ces sculptures ont cependant une sorte d'élégance, quelquefois un peu fleurie (lion de Venise), qui leur est propre.
(2) Lion de Milet (nécropole) au Louvre : Rayet et Thomas, Milet et le Golfe Latmique, pi. XXI I ; Collignon, 89, iig. 47 ; Schroder, p. 7-8, fig. 8-11. Lion de Milet (Voie sacrée) à Londres : Br. Mus. Sculpt., I, 22 n° 17; Perrot et Chipiez, VIII, 286, fig. 118 ; Schroder, 10 (fig. 12) ; pour l'inscription de dédicace, cf. Solmsen3, Dial., 102 (n° 57). Lion de Didymes (à imbrications) : Pontrémoli- Haussoulier, Didymes, 194 sqq. et pi. XIX ; Schroder, 10, fig. 13 (à Constantinople). Rapprocher le lion de Loutraki à Copenhague (Ny-Carlsberg Glypt., n° 5) : cf. p. 18, n. 1 ; un lion de Berlin (Wiegand, Berl. Museen, XLVIII, 3 (1927), 61 sqq.; Richter, /. c, IV, 10; Blûmel, l. c, n» 55); un lion d'Olympie (Olympia, III, pi. V, 1-2 ; texte p. 26, fig. 23 : imbrications).
(3) Bulletin of Metrop. Museum, 1910, 210 ; Brunn-Bruckmann, 643 ; Blûmel, l. c. n° 82. (4) Br. Mus. Sculpt. II, 929-930 ; Mon. Ined., X, pi. XII, iig. 18 ; Br. Bruck. 231 ; Collignon,
246, flg. 160 (Monument des Néréides). Rapprocher le relief d'Akanthos, au Louvre: Br. Bruck. 231 b ; Calai, somm. des marbres anl. du L. ( 1912), p. 50, n» 857 ; Uxkull, Arch. Plaslik der Gr. ( 1922), fig. 19.
(5) Cf. Stamatakis, ΠΑΕ, 1882, p. 67-74 et pi. A; IG. VII (1888), 344-7; Kéramopoullos, ΠΑΕ, 1911, 153-163 (photographies malheureusement insuffisantes, fig. 2-4).
(6) Newton, Discoveries at Halicarnassus..., II, 480 sqq. ; et pi. LXI-LXVII. Cf. P. Gardner, Sculptured Tombs of Hellas, 225 (fig. 77) ; Catal. du Br. Mus., II, 1350, pi. XXVI (Smith, 1900) ; Richter, Animals, pi. VIII, 27. — II y aurait peut-être quelque raison de suspecter la date proposée par Newton (cf. plus bas, p. 40, n. 2).
20 J. ROGER
hellénistique et romaine (1). C'est une convention qui s'impose peut-être à une certaine échelle à la sculpture sur marbre. C'est au lion de Chéronée que le nôtre, par ce point, ressemble le plus : ils sont tous deux assez éloignés déjà des crinières attiques. Ici les mèches paraissent un peu plus naturelles et moins ordonnées qu'à Chéronée ; mais, détachées et saillantes, refouillées plus profondément, elles cherchent, avec plus de calme, un effet plus marqué. ·
Ailleurs, des poils stylisés ou quelquefois sommairement indiqués soulignent utilement le mouvement de la jambe arrière pliée (2), ou, sur le poitrail, les plis de la peau à la naissance des pattes avant ; les longues mèches qui ornent celles-ci par derrière servent autant à rompre la monotonie d'une ligne trop longue de la jambe qu'à donner plus d'épaisseur au support (3).
Sur tout le reste du corps, le pelage n'était pas dessiné. On ne trouve ici ni le travail léger et régulier, à la pointe, qui couvre le lion Van Brante- ghem ou le lion de Vigonovo, ni ces indications rapides de poils, de place en place, que porte le lion Barberini ; la peau reste lisse et unie, dans une opposition d'autant plus sensible avec la crinière.
Le modelé manifeste la même recherche tournée vers l'expression et vers l'effet, de masse et de puissance. Mais l'artiste est là, semble-t-il, sur un terrain plus sûr. Les parties du corps même où l'on reconnaît le dessin de la surface ont une étendue minime : elles nous permettent à peine de deviner des lignes assez peu accentuées, simplifiées et générales ; le fragment conservé n° 4 (attache des pattes avant et de la partie antérieure du torse) suggère seulement que les côtes devaient être indiquées très faiblement, à la différence des formes excessives de Chéronée (cf. fig. 12). Mais le dessin des membres, s'il est pesant, demeure vigoureux, sans être
(1) C'est une manière de faire qui paraît déjà dans le lion dePérachora (Br. Bruckmann, 641 ,' cf. Perdrizet, RA, 1897, 134 et pi. IV ; Handb. of the Mus. of Fine Arls, 1911, 65 ; Caskey, Calai, of Gr. and Rom. Se, 1925, 15, n° 10 ; Collignon, p. 90), à travers toutes les gaucheries de style dont il n'arrive pas à se dégager (cf. Ch. Picard, Sculpture archaïque, 472-3 et 479). C'est aussi, mais dans un style décoratif et abstrait, celle des lions du Mausolée (Br. Bruckmann, 73.; Collignon, 261, fig. 170 ; Richter, pi. VIII, 28). A citer encore le lion de Berlin, pour le ive siècle. — Cela se retrouvera encore sur les sarcophages de Sidon, dans la grande frise à Pergame, et dans le lion Barberini, romain {Br. Bruck. 645).
(2) Le détail est fréquent, mais traité différemment : lion de Pérachora, étrangement géométrique, lion du Pirée à Venise, lion de Chéronée. De même aussi le molosse couché du Céramique à Athènes (Richter, LIV, fig. 170).
(3) Aucune trace, dans les fragments, ne se rapporte à la queue ; la position n'était donc pas celle de Chéronée, par exemple où elle s'enroule autour de la cuisse (cf. aussi Cnide, ou le lion du Pirée). Peut-être traînait-elle autour de la base (cf. Pérachora, ou le lion de Loutraki à Copenhague).
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 21
contourné et boursouflé comme à Chéronée. Les pattes arrière paraissent bien en place ; les grands muscles sont indiqués largement, dans des formes arrondies et liées, mais fermes ; ils gonflent la peau entre deux dépressions, ou ressortent sur la ligne extérieure de la jambe pliée ; plus massifs, ils sont aussi posés de façon plus simple et plus naturelle. La bête reproduit sans doute les traits qui existent ailleurs, mais avec
quelque chose de plus « vraisemblable », de plus aisément taillé qu'à Chéronée.
Les membres antérieurs, dans des contours assez uniformément et assez rudement marqués, conservent au contraire ^es ^a^^esses habituelles ; les pattes ne s'attachent pas sans quelque gaucherie ; la courbe de l'ossature est lourdement accusée, et soulignée par le renflement d'une veine ; le muscle s'élargit et se gonfle en arrière de façon fort peu réelle, comme le genou trop arrondi (mais cette partie est restaurée). Il est vrai que la nécessité de conserver leur résistance à ces blocs qui soutiennent tout le haut du corps interdit toutes les recherches qui les creuseraient ou les aminciraient. Mais le tout montre un très net parti pris de robustesse et de vigueur.
Les veines qui paraissent sur tous les membres sont gonflées et saillantes ; elles
servent souvent à relever le dessin des muscles (pattes antérieures, cuisses ou surtout visage), ou simplement à varier des surfaces qui seraient, autrement, un peu trop nues. C'est sur la face intérieure des cuisses que leur traitement est le plus significatif : elles constituent là un filet plus serré qui se dessine sous la peau, la soulève sur les muscles et la fait vivre de façon particulière.
Lemême procédé, suggérant par une plus grande finesse du travail une peau plus mince et plus fragile, fait du visage et du mufle la partie de la bête où l'exécution est la meilleure. C'est l'image habituelle du lion grondant : lèvres retroussées, montrant les dents, toute la face plissée et froncée, yeux arrondis, gros et profondément enfoncés sous les sourcils (1). La
(1) Cf. Schroder, /. c, 16, lre colonne
Fig. 12. — Le lion restauré vu de dos.
22 J. ROGER
description anatomique est accusée avec insistance, muscles tirés, veines gonflées, front bosselé par les contractions. Le plus remarquable est la manière dont le travail du marbre, exact et lisse, sur la face et les joues, suggère avec subtilité le frémissement nerveux, et redoutable, des muscles sous la peau rase(l): la notation est ancienne, mais assez rarement rencontrée.
Il faut avouer que la restauration n'a pas absolument justifié tout l'espoir qu'inspiraient les fragments isolés, et que l'ensemble, s'il reste- imposant, est plus comparable aux réalisations monumentales du môme ordre que le soin de certains détails ne le laissaient d'abord penser. Telle qu'elle est, cependant, l'œuvre entière fait assez d'impression. Le lion était assis, dressé sur ses pattes de devant : c'est l'attitude la moins naturelle pour l'animal, mais c'est celle qui, usitée à partir du vie siècle (2), a reçu une particulière consécration au cours du ive dans la sculpture funéraire et officielle. Elle a ici aussi ses extraordinaires et inévitables conventions : la sculpture se range au premier regard dans la série de ces lions à tête relativement petite (bien qu'ici la disproportion, due à la perspective, soit beaucoup moins sensible qu'ailleurs), à poitrail trop large, à pattes grossies et violemment montées pour gagner en hauteur, qui sont connus pour cette dernière époque. Encore ici ces défauts, bien moins frappants
(1) Schroder, 15. col. 2 ; Richter, Animais, p. 8. Cf. le lion de Milet (Nécropole) ; le lion de Berlin couché (cf. p. 19, n. 2) ; une tête de lion d'Éphèse, au British Museum (Hogarth, Exe. ai Ephesus, 309, fig. 88 ; Br. Mus. Calai. I, 39, n° 53 ; Br. Bruckmann, 642).
(2) Comme une suite, peut-être, des anciens sphinx, ou des lions affront es ou isolés (exemples funéraires: Collignon, l. c, 90; cf. Noack, AM, XXXII, 1907, 542,n° 3, pi. XXIV, fig. 2), bien que le type le plus fréquent soit celui du lion combattant (chasse) ou terrassant un animal. Le type du lion rampant semble être postérieur. Cependant le lion assis figure déjà sur la frise d'Assos (Monumenti delVInsl. III, 34; Br. Bruckmann, 412), ou dans des allées de sanctuaires archaïques (Délos). On connaît le lion de Pérachora. Le type s'est maintenu pendant toute l'époque classique, au Ve siècle (Thespies : polyandrion des Thespiens morts à Tanagra ou à Délion ?), et ensuite surtout : lions de Thespies (de Ridder, BCH, 1922, 253 sqq. ; cf. P. Jamot, BCH, 1891, 660), de Chéronée, du Pirée, Van Branteghem, de Copenhague (Ny-Carlsberg, 339, cité par Schroder, 15, η. 50), etc.
Fig. 13. — Tête du lion, vue de face.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 23
qu'à Ghéronée où l'animal s'élève presque verticalement, en « pain de sucre », s'atténuent-ils si l'on observe la statue comme l'a voulu l'artiste : le lion était fait pour être vu de loin, comme l'indiquent l'exagération des traits, la recherche du relief et la simplification des masses, et, semble-t-il, d'en-bas. Les formes paraissent lourdes et trapues, mais elles ne sont ni monotones ni rigides. La position, l'expression, quelques différences d'un côté à l'autre, conservent à la bête quelque chose de suffisamment vivant et animé. Il n'a pas le mouvement cambré et fier, la déformation héroïque, du lion de Ghéronée, mais il est en général d'un style beaucoup plus simple et plus heureux. Si l'on met à part la brillante supériorité de la matière, il a aussi, à côté des faiblesses imposées par les nécessités matérielles et traditionnelles, des morceaux pleins d'éclat, comme les pattes arrière ou la tête, ou qui montrent un peu de « bravoura », comme la crinière.
Le symbole moral est beaucoup moins raffiné que celui qu'on a pu trouver exprimé à Chéronée (1), plus habituel et plus simple : l'artiste semble même n'avoir pas poursuivi d'intention particulière ; il a surtout visé à produire une impression de force imposante et terrible. La gueule à-demi ouverte, sans être agressive, le lion est ici le gardien fermement campé, résolu, mais au repos encore, d'un dépôt qui n'est pas sérieusement menacé. L'œuvre atteint ainsi à une sorte de majesté un peu vide, mais malgré tout noble et vigoureuse.
Il resterait à dater ce travail, et c'est la question difficile, à cause du caractère nécessairement composite et mêlé d'une œuvre de ce genre, et aussi du manque d'appuis solides. La posture, les grands traits des membres et de la tête, le soin de l'exécution, seraient encore assez classiques. Mais la taille colossale, la recherche de l'effet, attentive et judicieuse, mais violente, à laquelle contribue même la simplification des partis, sont d'une époque assez avancée, et ne paraissent pas pouvoir être antérieures au milieu du ive siècle au plus tôt. C'est qu'il faut sans doute distinguer le type traditionnel, et la manière, qui peut seule donner des indications réelles. Le modèle, un peu hiératique et usé, est repris sans grandes modifications, mais avec un parti pris de vigueur et d'insistance plus évolué. Notre lion est, certes, avant les sculptures trop « réalistes » et mouvementées de l'époque hellénistique et gréco-romaine (2) ; mais, très loin déjà du grand
(1) Newton, Halicarnassus, II, 497 (cf. Collignon, l. c. 233-4). (2) Pergame (cf. Pergamon, III, 2, pi. I, II, VII, XIX), et peut-être aussi le sarcophage
d'Alexandre, de Sidon (Hamdy bey et Th. Reinach, Nécropole de S., pi. XXVII, 1, XXXI-XXXIV). Cf. des animaux blessés, se tordant : panthère de New- York (Richter, Animais, X, 34), chiens (Musée Barraco : Richter, LIV, 171 ; ou Florence, Ufïîzi : LV, 174), etc.
24 J. ROGER
lion de Thespies (années 424 et suivantes ?), sans doute vient-il nettement après le lion de Gnide et ceux du Mausolée (années 350 et suivantes), de même qu'il paraît postérieur aux sculptures élégantes et faciles du Céramique et de l'Attique. La comparaison s'impose surtout avec Chéronée (après 338) ; mais elle ne donnera encore qu'un indice de valeur relative. Rien dans les traits d'exécution du lion d'Amphipolis n'oblige à remonter à une date antérieure ; des détails comme le pli des narines, le sillon des yeux ou le modelé du front, l'embarras un peu mou de la crinière autour du visage, le soin excessif apporté aux longues mèches du cou, certaines négligences des pattes antérieures, tendraient même à produire l'impression contraire. Si l'on ajoute des indications prises aux modes d'assemblage des blocs, comme aussi, nous le verrons, aux particularités du monument qui portait le lion, on y trouvera peut-être encore la suggestion d'une date plus basse.
Le Monument
L'attention, appelée naturellement par la sculpture, s'était détournée d'abord des ruines au milieu desquelles les fragments du lion ont été retrouvés, et le véritable caractère du monument était resté inconnu. Seule une partie, d'abord, en paraissait encore au moment où MM. Collart et Devambez passaient sur le site, et ils ne cherchèrent là qu'un vague reste de socle et de soutènement (1). Même ensuite, quand les ruines furent complètement déblayées et nettoyées, et malgré l'avertissement, d'intuition si sûre, de M. R. Vallois (2), le peu d'importance des constructions conservées empêcha de penser à un édifice ample et compliqué. Depuis, quelques notes rapides (3) ont sinon fixé la restauration, ce qui est impossible, du moins indiqué ce qu'il fallait raisonnablement imaginer.
Les fondations visibles aujourd'hui (pi. VIII) couvrent un carré exactement régulier, de 9 m. 95 ou 96 de côté ; la hauteur conservée est inégale, comme il est naturel sur une pente. Dans le haut, ne reste In place qu'une assise : une ligne de blocs continue, qui forme le bord extérieur, avec quelques blocs qui remplissent encore l'angle Sud-Est. Les deux côtés Est et Ouest sont un peu dégarnis et irréguliers. Au Nord existent encore, à un niveau inférieur, deux lignes jointes de beaux blocs qui ont fait croire d'abord à
(1) BCH, 1931, 189-190. Le relevé présente quelques inexactitudes. (2) REG, 1932 (Chron. arch.), p. 45 (et n. 3). (3) BCH, 1936, 476 sqq. (Chronique. Pour la date proposée pour le lion, lire « seconde moitié »
du ive siècle, et non « première ») ; AJA, 1936, 152 (E.-P. Blegen).
LE MONUMENT AU LION D AMPHIPOLIS
une sorte de dallage (pi. IX, A), mais dont la face supérieure, marquée de trous de pince, et le bord intérieur, irrégulièrement taillé, montrent qu'ils étaient recouverts et que l'assise se prolongeait vers l'intérieur ; ils sont d'ailleurs de même nature et de même travail que tous les autres. A cela il faut ajouter quelques blocs épars, dont nous parlerons à mesure.
Les fondations ne reposent pas sur le roc : mais le roc, dans ce terrain d'origine alluviale, est trop bas pour être atteint en cet endroit. Le sol est constitué par une sorte de sable qui, en se tassant, devient très compact,
très ferme et résistant. Aux quatre angles, la première pierre est un bloc débordant à l'extérieur, selon l'habitude. L'ensemble paraît avoir été capable de supporter un poids considérable.
L'appareil est d'un poros jaunâtre, à grain assez grossier, légèrement coquillier, les blocs sont soigneusement taillés, en assises égales continues, à joints régulièrement espacés et alternés d'une
Fig. 14. — Détail de la base. asgise à |'autre. Aux assises
inférieures (Nord), qui ne devraient pas être visibles, les arêtes des faces extérieures sont rabattues en biseau (fîg. 14), ce qui a pour effet de souligner très profondément les joints, sans qu'il s'agisse à proprement parler de bossages. Une fois les pierres, à surface rugueuse et irrégulière, mises en place, l'angle du monument a été taillé, de manière à dégager dans la masse une arête verticale droite et continue (1).
Le soin de la construction est partout sensible : d'abord dans la préparation matérielle des blocs et la régularité de la taille ; surtout dans la combinaison des joints : les dimensions des pierres et leur position sont à chaque fois choisies de manière que les joints s'entremêlent et se contra-
(1) C'est un ornement qui paraît, semble-t-il, dès la fin du ve siècle et qui se généralise ensuite (particulièrement dans les murs de villes du ive siècle et postérieurs) La matière permet ici une grande régularité. Les proportions assez allongées sembleraient placer notre monument parmi des exemples récents ; de même aussi la taille en biseau, aux joints, paraît être un indice de date au moins relativement assez avancée. Cf. pi. IX, A et B.
20 J. ROGER
rient d'une assise à l'autre ; mais cette précaution, habituelle, témoigne ici d'une recherche frappante ; l'ensemble de la maçonnerie constitue ainsi une sorte de tissu très serré et robuste. Pour que les blocs joignent exactement, un cadre d'anathyrose est préparé sur les côtés, dégagé le plus souvent très profondément (fîg. 15). Des trous de pince, dans la partie Nord, montrent encore avec quelle attention les blocs étaient mis en place les uns sur les autres, même dans des parties non visibles.
Ainsi se reconstitue la partie inférieure du monument : à mesure que les assises s'élèvent, elles gagnent progressivement en profondeur vers le
haut de la pente. Si l'on met à part les blocs de fondation qui renforcent les angles, et qui ne se continuent pas, la première assise, en partant du bas, s'étend, pour la longueur déjà indiquée de 9 m. 96, sur 3 m. 50 de profondeur (cf. pi. VIII, 2° et 3°; la position des blocs a été vérifiée en c : ib. 1°). La seconde assise (même plan) couvre à son tour quatre mètres ; la troisième qui a maintenant disparu sur tout le devant du monument, et n'a été conser
vée que sur les côtés, devait (au moins vers l'Est) couvrir 7 m. 50 ; la quatrième venait peut-être jusqu'à 8 mètres (anathyroses du côté Ouest ; elle allait sans doute jusqu'au bout vers l'Est) ; la cinquième assise, enfin, la dernière en poros, occupait toute la surface du carré définitivement formé. Le monument à partir de ce moment n'avait plus qu'à s'élever. Les ruines nous conservent encore à l'angle S.-E. deux blocs, de marbre cette fois, qui correspondent à une sorte d'euthyntéria, qu'il faut imaginer faisant le tour du monument. Sur le côté Sud, adossé à la colline et moins visible, le marbre était remplacé par du poros, mais taillé dans les mêmes dimensions. — Avec cette assise paraissent des scellements : crampons enPl, à tête élargie en forme de queue-d'aronde, qui atteignent 30 cm. environ (fig. 16).
La première hypothèse, sur laquelle avaient été faits les premiers projets de reconstitution, avait été inspirée par la disposition présente des ruines. Dans la partie basse, les plaques de la seconde assise font un
Fig. 15. — Anathyroses (angle sud-ouest).
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 27
rectangle très allongé, qui pouvait suggérer l'idée d'un dallage, isolé du reste et complet par lui-même. Aussi avait-on imaginé, là, un socle, portant le lion (1). Les autres blocs en place avaient été attribués à une sorte de mur de soutènement et de protection, retenant les terres de la colline, et qui aurait été renforcé à ses angles intérieurs par un massif plus important de maçonnerie. Outre le caractère inusité de pareille disposition, ce projet est condamné, maintenant que tous les restes existants sont au jour, par le plus rapide examen du détail. Le bord, vers l'intérieur, du socle supposé est brut et irrégulier, sans aucune idée d'un travail d'égalisation des blocs; ceux qui sont conservés en place sur le pourtour portent des anathyroses qui obligent à les continuer en assises complètes. Les indices concordent sur tous les points.
Sur le côté Est, le pseudo-mur de retour doit se poursuivre à la fois vers le Nord (le long du côté) et vers l'Ouest (vers l'intérieur). La dernière pierre en place est à 48 cm. de celle qui commence, au niveau au-dessous, l'assise inférieure : c'est-à-dire exactement à la moitié d'une longueur de bloc ; la pierre à restituer couvrait ce dernier bloc par sa seconde moitié, et se coupait juste au milieu de celui-ci : ainsi était observée la succession parfaitement régulière des assises ; dans l'autre sens, la différence de dimension d'une assise à l'autre est imposée, nous l'avons vu, par la préoccupation de faire alterner les joints (remarquer également le dessin de l'assise n° 2). — A l'angle Sud, les pierres conservées ne semblent nullement s'interrompre sur une face égale, en pilier ou en bastion ; les écarts des joints sont les écarts habituels dans les assises ; et elles s'engageaient
Fig·. 16. — Blocs de marbre à l'angle Sud-Est.
(1) Peut-être à l'imitation du socle de Cliéronée ? Mais la lumière n'est nulle part absolument faite sur les caractères du monument antique ; et de toute façon le rapprochement ne joue pas (cf. p. 39).
28 J. ROGER
li
if—65
face Su.jitiitw.ifc.
face intci icicle
κ ID.S
τ
Τ
■Vf
Profil (réduction aux 2/3)
Fig. 17. — Le chapiteau dorique engagé.
Ptof.X.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 29
dans d'autres blocs qui les continuaient. Ici les anathyroses sont moins visibles ; mais les blocs sont plus abîmés qu'ailleurs. Un détail à ajouter, c'est que certains blocs très abîmés sur leur bord supérieur semblent avoir été écrasés par une pression considérable, ce qui ne s'expliquerait guère dans l'hypothèse d'un simple mur de protection.
Sur le côté Ouest, les blocs s'interrompent plus tôt, mais la distance à ceux qui sont en place de l'assise inférieure — 1 m. 45 — est encore celle d'une longueur de bloc, plus une demi-longueur, et l'on doit prolonger la construction de la même façon ; l'anathyrose sur le côté intérieur du bloc est ici encore plus reconnaissable qu'à l'Est (fig. 15). Les anathyroses, fortement marquées, gagnent vers l'extrémité Sud à mesure que les assises s'élèvent, et finalement remplissent tout le côté : c'est un dessin qui correspond à l'élévation du côté Est (pi. VIII, 1°). La pierre inférieure d'angle, qui de ce côté (le plus élevé) est au niveau de la 4e assise, déborde à l'intérieur, de manière à soutenir solidement, à sa place dans la maçonnerie, un bloc qui devait s'encastrer à cet endroit au-dessus : et si la quatrième assise, laissant une dernière place au sol de la pente, était encore incomplète, la cinquième du moins, sous l'euthyntéria, était remplie.
Le fond, enfin, réduit à présent à une seule ligne de blocs (niveau : cinquième assise), présente sur toute sa longueur, vers l'intérieur, des anathyroses fortement marquées qui engagent nécessairement à la même conclusion.
Toute la maçonnerie dans son ensemble formait un massif plein ; les assises ne sont plus complètes dans les parties hautes, mais cela s'explique tout simplement par l'existence de la pente. A mesure qu'elles s'élèvent, elles gagnent en profondeur, jusqu'à couvrir enfin toute la surface du monument. C'est sur ce socle carré que s'établit une euthyntéria de marbre, qui règne sur tous les côtés. Il ne faut pas s'étonner que tant de pierres aient disparu : dans l'amas de matériaux retirés du Strymon se confondaient des blocs de poros de dimensions identiques à ceux du monument, qui donnent aussitôt l'explication. Mais ici s'arrêtent les indications à tirer directement de ce qui reste en place dans les ruines ; nous ne pouvons compléter une restitution de l'édifice, et encore à grands traits, que par des rapprochements et des hypothèses.
D'autres éléments importants ont été cependant retrouvés sur les lieux. C'est d'abord un chapiteau dorique, engagé à-demi, dont les angles sont un peu brisés, mais qui reste, autrement, entier (pi. X, 1, et fig. 17)· II est taillé dans une sorte de marbre gris-bleu, à gros grains compacts,
30 J. ROGER
très dur, mais susceptible d'acquérir un poli assez fin. D'autres fragments qui proviennent de demi-chapiteaux semblables sont à joindre à celui-là (pi. X, 2).
L'appartenance à notre monument, d'abord écartée à cause de la différence de la matière, est cependant assurée. Il n'existe rien à proximité à quoi on puisse attribuer ces restes assez nombreux ; le travail et le style s'accordent, comme nous verrons plus loin, avec la date de la maçonnerie comme de la sculpture. Surtout, des débris de colonnes doriques, de travail et de dimensions identiques, qui ont été relevés sur le terrain en assez grand nombre, et qui conviennent si exactement aux chapiteaux que, malgré leur état de mutilation, leur rapport n'est pas douteux, sont en marbre blanc. Deux d'entre eux, même, appartiennent à une colonne coupée suivant son diamètre, ce qui démontre qu'il s'agissait bien d'une demi- colonne plaquée contre un mur (pi. X, 3 et 4). Le fût était donc en marbre blanc, comme l'euthyntéria et sans doute tout le corps de l'édifice ; le chapiteau seul était teinté. Nous ne savons rien de l'entablement, dont aucun élément n'a été découvert. Ce procédé de décoration par la couleur de la matière, peu surprenant déjà ici, a encore d'illustres précédents. Il faut donc restituer au-dessus du socle une série de colonnes engagées : nous en verrons ensuite la disposition.
Il reste cependant une difficulté, essentielle : comment le lion, qui occupe en plan un rectangle de 3 m. 30 sur 2 m. 10 + , pouvait-il reposer sur un carré de 10 m. sur 10 m. ? Il est nécessaire d'imaginer des intermédiaires, pour diminuer progressivement la surface portante, et arriver finalement à une forme rectangulaire, d'un socle. C'est l'idée d'une pyramide qui se présente dès l'abord. Or nous avons, parmi les restes épars du monument, plusieurs blocs de marbre, creusés dans le bas sur leur long côté d'un double refend décoratif, qui ne peuvent être que des degrés. Ils sont de deux sortes ; les uns (représentés par un bloc d'angle : pi. VIII, 4° b, d'un travail très fin, et un bloc de poros) ont 28 cm. 4 ± de haut ; les autres ont entre 35 et 37 cm. de haut : ainsi pi. VIII, 4° a (1), auquel il faut joindre un autre bloc de dimensions identiques (hauteur : 34 cm. 5 ; longueur : 0 m. 87) abîmé à deux angles, et un autre brisé en son milieu (hauteur : 37 cm.). Toutes ces pierres sont soigneusement taillées, portent des anathyroses
(1) Les refends sont creusés là sur les deux côtés ; mais une face est restée rugueuse et grossière, et les refends' sur le même côté n'ont même pas été poussés jusqu'à l'extrémité de la pierre : le travail a été commencé d'un côté, puis abandonné, et repris de l'autre : une seule face était visible.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 31
nettement dessinées sur le côté, et étaient assemblées avec des scellements (fig. 18). Il y avait donc dans l'édifice deux systèmes de degrés ; l'un, le moins élevé sans doute, doit se placer entre la colonnade et le soubassement, en crépis régulière ; l'autre pourrait fournir une pyramide, décroissant régulièrement vers le haut. Les éléments que nous conservent les ruines, si réduits qu'ils soient, donnent encore du poids à ce qui serait déjà sans eux une hypothèse nécessaire. Deux blocs qui portent sur la face d'attente des lignes de pose à une distance inégale sur leurs long et petit côtés confirmeraient à la rigueur l'idée, s'il en était besoin.
Ainsi se présentent pour nous, en définitive, les principaux éléments
\f v=
Fig ig. _ Scellements des degrés (A et B) et de la base (B et C).
de notre construction : un socle carré, massif ; une colonnade engagée ; une pyramide : le tout supportant le lion, colossal επίθεμα. Or ce schéma de monument rentre dans une série sinon déjà parfaitement connue, du moins jalonnée par plusieurs grands exemples : les hérôa. A vrai dire est-on plus habitué à les voir en Asie Mineure ; mais il ne faut pas s'étonner de rencontrer ce type dans une région qui a eu avec l'Asie Mineure des rapports
si étroits.
Le culte des morts paraît en effet s'être entouré en Asie Mineure, surtout à partir d'une certaine époque, d'un faste qu'il n'a peut-être pas eu de longtemps sur le continent, et cette tradition s'est manifestée dans un grand nombre de formes architecturales, plus ou moins somptueuses, qui semblent n'avoir pénétré qu'ensuite en Grèce propre, même si, assez tôt déjà, leur décoration s'inspire de thèmes helléniques (1). Peut-être, de cette série encore incomplètement connue, ne sera-t-il pas inutile de rappeler les différents types (2).
C'est d'abord l'hérôon à τέμενος, composé en général d'un simple tombeau ou de plusieurs, auxquels s'ajoutent diverses dépendances, au milieu d'un
(1) Cf. Ch. Picard, RHR, 1931, 5-28 ; et Sculpt, arch., 422. (2) Cf. Poulsen, Rhomaios et Dyggve, das Heroon von Kalydon, p. 118 406 sqq. ; Matz, die
Anlike, IV, 1928, 266-292.
32 J. ROGER
enclos fermé (1). Nous en connaissons d'assez nombreux exemples, par les textes ou par leurs ruines, à des dates différentes, en Asie Mineure, dans les Iles, sur le continent aussi, et en divers points de tout le bassin méditerranéen. Le plus célèbre est celui de Giôlbachi-Trysa (2) ; mais il y en a beaucoup d'autres (3). Dans tous ces exemples, autour du tombeau d'un homme ou d'une famille se sont groupées plusieurs constructions pour servir à un culte ou même à des jeux divers en l'honneur des morts. Ce n'est point le type auquel appartenait le monument d'Amphipolis ; les recherches faites aux environs ont montré d'ailleurs qu'il était isolé : mais sa forme même n'est pas celle d'un tombeau à τέμενος.
Il s'apparente au contraire étroitement à une seconde classe de monuments où l'aspect de culte et de cérémonies, qui subsiste, s'efface cependant un peu dans l'éclat de la construction dont on veut faire honneur au mort une fois pour toutes. Ceux-ci sont désormais, plus qu'un sanctuaire, un splendide lieu de repos pour la dépouille. Mais il faut encore ici distinguer deux formes essentielles : l'une, qui peut être le développement des anciennes tours lyciennes (4), à niche funéraire ou à sarcophage (5), s'exprime dans, toute son ampleur dans le monument des Néréides ou le Mausolée d'Halicar-
(1) Cf. Pfuhl, Jahrb. 1905, 123-155. (2) Benndorf-Niemann, das Heroon von G. T. ; pour la décoration, Praschniker, Oest. Jhefte,
1933, 1-40. (3) La publication de Poulsen, Rhomaios et Dyggve, Kalydon, p. 119/407, cite à côté de G. Τ
le Pélopion d'Olympie, le τέμενος de Néoptolème à Delphes, et le tombeau d'honneur du Bouleu- térion de Milet (Knackfuss, Milet, II, 49 sqq.). Une autre liste (Kalydon, 121) comprend, parmi les héroâ à fêtes musicales, cultes annexes (Muses) ou concours divers, à côté de Calydon même, le célèbre hérôon d'Epictéta à Théra (Dragendorff, Thera, II, 239 sqq.), le Τιμολεοντεΐον de Syracuse (Plutarque, Timoléon, 39, 5), le τέμενος d'Antigone Gonatas à Cnide (Benndorf, /. c, 43 ; cf. Usener, lihein. Mus., N. F. XXIX, 29), l'hérôon à la palestre de Milet, près des Thermes de Faustine (Wiegand, 7ter v. Bericht, 22 sqq.), l'hérôon d'Académos à Athènes (Judeich, Topographie von Alhen1, 412 sqq.). Nous nous bornerons à rappeler simplement aussi, sans considérer aucunement la forme ou le style du monument principal, l'frérôon d'Apollonios à Apollonie de Pisidie (Benndorf, 43), ou de Diomédon à Cos (ne siècle av. J.-C), d'autres à Milet : sur la pente Est de la colline du Théâtre (Wiegand, Arch. Anz., 1906, 36-38 et fig. 16), ou l'hérôon détruit dans la cour d'une maison romaine, à l'Ouest du temple d'Athéna (Milel, I, 8, p. 86 sqq. et pi. XI, 1 et XXIX, 1) ; ou encore un hérôon à Cyrène (cf. Matz, Antike, IV, 1928, 274 et 276, iig. 6), un tombeau en Syrie (Benndorf, 44 ; cf. Renan, Phénicie, 62 et pi. VIII et X), ou d'autres que nous mentionnent des inscriptions (Benndorf, 43 sqq.). Ce sont les monuments qui permettraient de suivre le mieux les progrès de l'héroïsation des morts et les variations du culte rendu.
(4) A Bélenkli (Heberdey-Kalinka, Bericht iiber zwei Reisen..., Denkschrift der kôn. Akad. der. Wiss., phil. hist. Klasse, XLV, 1, Vienne, 1896, p. 31 ; et Mendel, Cat. Sculpt. Const., I, 270 sqq.) ; à Xanthos : tombe aux lions (Pryce, Br. Mus. Sculpt., 1928, I, 1, 117 et fig. 176) et tombe aux Ilarpyes (Pryce, 122 sqq. ; Benndorf-Niemann, Reisen in Kleinasien, I, pi. XXVI ; cf. Mendel, l.l.) ; ou à Giôlbachi (Benndorf, das Heroon von G. T., 23). Comparer un monument (Pélékiti) conservé près de Phocée (couronné d'une pyramide : Perrot et Chipiez, V, 68 et fig. 39-41 ; Weber, Trois tombeaux archaïques de Phocée, 129-136. Reproduit dans Sartiaux, Civil, anc. de VA. M., pi. XX, 3).
(5) Cf. par exemple les planches de Benndorf-Niemann, Reisen, I, passim ; et un sarcophage de Limyra (entre autres) reproduit dans Matz, die Antike, IV, 1928, p. 273, fig. 4.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 33
nasse ; elle comprend un socle élevé (souvent creusé en crypte funéraire), portant une sorte de chambre d'apparat (décorée le plus souvent sur ses faces extérieures d'une colonnade, et presque toujours condamnée) (1). Les exemples en sont nombreux (2), que l'édifice se termine en toit à deux versants (3), ou en pyramide, pour porter un επίθημα (4), qu'il soit carré, rectangulaire ou même rond. — L'autre est une forme surtout romaine : elle est constituée essentiellement par une chapelle, en temple in antis, surélevée sur un podium débordant, renfermant ou non une crypte (5) ; c'est le type du temple capitolin. Cette forme rétablit, en la renouvelant, l'idée de la fréquentation due aux morts. Les exemples en sont nombreux, à grouper autour du soi-disant temple du Deus Rediculus, bien que celui-ci soit loin d'être le plus ancien. Ils semblent commencer vers le second siècle (6),
(1) Matz, Λ c, 272 sqq. ; cf. Oelmann, Arch. Anz. XLV, 1930, 240-243. (2) Cf. Newton, Discoveries al Halicarnassus, Cnidus and Branchidae, pi. XXXI. V. Dinsmoor,
dans AJA, 1908, 163 sqq. (3) Ainsi les Néréides à Xanthos (Durm, Handbuch der Architektur, I, 540 et fig. 491 ; cf.
Ch. Picard, RHR, 1931, 5-28, avec bibliographie) ; le « Charmyleion » de Cos (Schatzmann, Jahrb. 1934, 110-127 ; cf. R. Vallois, REG, 1936, 160 sqq.) ; un hérôon des environs de Milet (Wiegand, Arch. Anz. 1902, 149-150) ; ou des tombeaux hellénistiques de Paros (Rubensohn, Jahrb. 1935, 66-67, fig. 11 et 12).
(4) Ainsi au Mausolée (Percy Gardner, Sculptured Tombs of Hellas, 231, fig. 39 ; Matz, 275, fig. 5 ; Krischen, Bonner Jahrbucher, CXXVIII, 1923, 1 sqq.) ; au monument découvert par Newton à quelques kilomètres de Cnide (Newton et Pullan, II, 480-511, et pi. LXI-LXVII ; P. Gardner, 225, fig. 77 ; reproduit dans Matz) ; ou au mausolée des récentes fouilles autrichiennes à Bélévi, près d'Éphèse (J. Keil, Oest. Jhefte, XXVIII, 1933, Beiblatt, 28-41 ; XXIX, 1935, Beib., 105-145 ; XXX, 1937, 175-193) ; et ainsi de suite. A rapprocher le « Tombeau de Théron » à Agrigente (reproduit dans Matz, 277, fig. 7) ; une tombe à Mylasa (à pyramide de degrés : Ch. Fellows, Ausflug nach Kleinasien (trad. Zenker), § 257 sqq., p. 128 et pi. III ; Benndorf- Niemann, Reisen, I, pi. XLVIII et XLIX ; Durm, 187, iig. 161) ; un mausolée romain à Cyrène (El Bent : cf. Oliverio, lscrizioni di Tolemaïde, 242-3, pi. XC, 67-68, dans les Docum. antichi dell' Afr. liai., vol. II, fasc. 2, Bergame, 1936) ; un édifice assez proche a été signalé en Acarnanie, à Alyzia, près de Mytika (C. Rhomaios : BCH, 1920, Chron., 393, cf. 'Αρχ. Έφ., 1930, 142 sqq.). Peut-être faut-il citer aussi ici les tombeaux-hérôa de Sicyone (Pausanias, II, 7, 2 ; cf. Imhoof- Blumer et P. Gardner, J1IS, VI, 1885, p. 77). C'est une forme comparable qui paraît, avec des variantes, dans des monuments de destination particulière, comme le monument chorégique de Lysicrate à Athènes.
(5) Cf. Kaludon, 1 19-20 (mais l'exemple cité de Saradschik est d'une série légèrement différente). (6) La série est nombreuse et diverse. Entre autres : une « tombe d'honneur » à Priène (Wiegand,
Prient, 277 sqq., près du gymnase supérieur) ; le pseudo « temple romain » de Magnésie du Méandre (Magn. am M., p. 30-31, fig. 19) ; un hérôon à Milet, entre le marché de l'Ouest et le port du Théâtre (Wiegand, 8ter v. Berichl, Abh. der Preuss. Akad., 1924, I, p. 7 et fig. 2-3) ; et plusieurs dans la nécropole (Wiegand, Arch. Anz. 1906, 38) ; à Myra (Texier, Asie Mineure, III, pi. 213- 214) ; à Patara (ib., III, pi. 189) ; toute la série de Théra : Evangélismos (Thera, II, 240 sqq.), Echendra (251 sqq.), Sellada (254 sqq.), temple de la Théa Basileia (?), etc. C'est à ce type qu'il faut rattacher l'« hérôon de Pylaea » à Delphes. Il existe encore en Thrace, à Balcik (èkorpil, Oest. Jhefte, XV, 1912, beib., 101 sqq.) et à Ladschané (Seure, BA, 1916, I, 364 sqq. : époque antonine). Les exemples les plus célèbres sont le «temple de Deus Rediculus» à Rome (Durm, II, 770, fig. 853 ; Matz, 285, fig. 16) ou le pseudo « temple d'Esculape » à Spalato (Durm, II, 604, fig. 685). Le tombeau de Bibulus, à Rome, encore de l'époque républicaine, est plus proche du mausolée.
34 J. ROGER
et se poursuivre assez longtemps dans l'ère chrétienne. Entre ces deux formes essentielles se multiplient les créations dérivées, comme on trouve à Saradschik (Petersen-Luschan, Reisen, II, 143, et 151 sqq. ; fig. 67 et 69-72), où le socle est surmonté d'une chapelle in anlis, ou à Termessos par exemple : socle assez élevé, supportant une sorte de chapelle entre colonnes, ouverte, pour l'exposition du sarcophage, sur un ou plusieurs côtés, ou sur tous (cf. Lanckoronski, Villes de Pamphylie el de Pisidie, II, 66 sqq. ; Heberdey-Wilberg, Oest. Jhefle, 1900, 177 sqq.). Quelquefois encore le monument est réduit à une simple chambre, sans socle ni podium, la crypte étant tout entière dans le sol. Il faudrait citer, pour compléter la liste, les innombrables dérivés qui furent construits un peu partout dans le bassin méditerranéen (1), comme aussi sans doute ceux que l'on trouve dans les régions éloignées et plus septentrionales, de Gaule et de Germanie (2).
On voit dès l'abord, dans tout cet ensemble, à quel groupe appartient notre monument : c'est du type Mausolée qu'il emprunte tous ses traits essentiels. Il en a le socle élevé, la colonnade entourant une chambre (?) et la pyramide. De l'hérôon des environs de Milet (cf. p. 3, n. 33), il a le socle, la colonnade, la même forme carrée, dans des proportions de même ordre. Mais c'est au monument décrit par Newton (près de Cnide : cf. p. 33, n. 4) qu'il s'apparente le plus étroitement. Les éléments sont les mêmes : socle carré (un peu plus large à Cnide : un peu plus de 13 m. au lieu de 10), colonnade dorique engagée faisant le tour du monument, pyramide de degrés, et portant même un épithéma semblable, un lion plus grand que nature (représenté couché). On ne peut manquer d'être frappé par un
(1) Ainsi en Syrie : Monument de Hermel (Perdrizet, Syria, XIX, 1938, I, 47 sqq.; cf. ib., II, 192; Ch. Picard, dans REG, LU, 1939, chron.,165 sqq.) :« Tombeau d'Hamrat », à Souéïda (reproduit dans Matz, 270, pi. XXVII, d'après de Vogué) et un tombeau près de Bràd (type différent, mais à pyramide ; Matz, 280, fig. 10 et 281) ; on connaît les « Lanternes » de Syrie; en Palestine : «Tombeau d'Absalom », à Jérusalem (Fyfe, Hellenistic Architecture, 57 et pi. VI, a; reproduit aussi dans Matz, 279, fîg. 9, et 280) et « Tombeau de Zacharie » (Matz, 280 : pyramide) ; en Cyrénaïque (Mausolées de la nécropole de Ghirza : cf. Ll C1 Guido Bauer, dans Africa Jtaliana, VI (1-2), 1935, p. 61-78 : Le due necropoli di Ghirza; du me au ve siècle ap. J.-C.) ; en Tunisie, le mausolée de Dougga, du ne siècle av. J.-C. (Saladin, Nouv. Arch, des Missions, IVe série, II, 1892, 455-485; Poinssot, Bull, du Comité des Trav. hist., Arch., 1909, ccxiv ; et 1910, 19 juillet, ccxxxi : lion assis comme épithéma ; cf. A. Merlin, CRAI, 1912, 347 sqq.) ; en Provence : à S* Rémy, le « Tombeau des Jules » (Newton, Halic, pi. XXXI). Il faudrait ajouter aussi des monuments massifs, à colonnade, d'Algérie, à Médracen, à Alger (« Tombeau de la chrétienne »), à Akbou (pyramide), etc.
(2) Cf. Kâhler, Bonner Jahrbûcher, GXXXIX, 1934, 145-172 et pi. IX. Ainsi dans la région de la Moselle : Mausolée romain d'Igel (Dragendorff et Krilger, dus Grabmal von lgel, Trêves, 1924) ; tombeaux de Neuwagen (Von Massow, die Grabmàler von N., Berlin, 1932) ; tombeaux de Trion, près de Lyon (cf. HA, 1936, I, 151 et n. 1), etc.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 35
parallélisme si exact. Les différences ne sont que dans les détails d'organisation et de proportions ; le schéma général est identique.
En même temps qu'il peut éclairer la destination de pareil monument, ce rapprochement, à s'en tenir à la forme architecturale, nous donnerait la clé de la restauration à imaginer (fig. 19).
Le socle dont nous avons établi la disposition servait à la fois à fonder solidement le monument, et à créer une surface horizontale en rattrapant les différences de niveau dues à la pente. S'enfonçant dans le sol à l'arrière, il s'élevait, en façade, par 4 ou 5 assises (suivant le niveau antique) de 50 cm. chacune d'épaisseur, à une hauteur d'environ deux mètres.
L'euthyntéria qui le couronnait, et dont quelques blocs, nous l'avons vu, sont encore en place, mesurait 30 cm. de haut. A l'angle, le marbre, qui porte la trace de la ligne de pose du bloc supérieur, indique un retrait de 16 cm. 5 i. On pourra, là, restituer des degrés, comme ceux qui toujours font le soubassement de ces monuments, à Halicarnasse, à Milet, à Cnide. C'est ici que l'on placera le système de degrés le moins élevé (28 cm. 5 ±) de ceux que nous avons conservés : le plus haut paraît plus propre à composer la pyramide du sommet, à la fois par ses proportions et par le genre de son travail, moins fin et plus large.
Mais là s'arrête toute espèce de certitude. Tous les blocs des parties hautes ont été emportés, et nous ne pouvons tirer nos indications que de menus fragments. Le schéma général n'est certes pas douteux, mais l'application dans le détail précis et mesuré nous échappe absolument. Il ne peut s'agir de fixer le modèle du monument tel qu'il fut effectivement réalisé, mais d'indiquer comment, en principe, ,les éléments conservés pouvaient se combiner entre eux. Faut-il suivre jusqu'au bout les analogies ? Mais comment les adapter dans le cas présent ? Nous ne nous attacherons donc ici qu'à quelques remarques particulières.
A Milet, ou à Cnide (ou à Halicarnasse, à Xanthos, ou ailleurs), c'est, une façade lisse, d'appareil très régulier, fait de larges plaques de parement, qui vient s'intercaler entre les degrés du soubassement et la colonnade pour hausser celle-ci, la suspendre, et la réduire au rôle d'élément décoratif ; les proportions sont ainsi plus légères. Il ne nous reste ici aucun indice qui se rapporte à telle partie de l'édifice. De plus, dans tous ces autres monuments, le problème est tout autre, car ils n'ont pas ces fondations si élevées
36 J. ROGER
que nous trouvons ici, et les degrés partent du sol. L'espace que donne le socle lisse est ici occupé par ce haut soubassement : et la colonnade devait reposer directement sur les degrés.
De la colonnade même, nous n'avons que le chapiteau (fig·. 17 et pi. X) et quelques fragments très petits de cannelures. Pour certains, l'ouverture des cannelures entre deux arêtes est de 7 cm. 5 (c'est la mesure que donne le chapiteau lui-même) ; un autre a 7 cm. 9 +. (pl.X,6) ; un autre (coupé selon son diamètre : pi. X, 4) mesure 8 cm. 1 +. autant que l'état des cannelures permet d'exactitude. C'est assez du moins pour indiquer que la colonne s'élargissait, normalement, vers le bas, mais aussi qu'elle était cannelée sur toute sa longueur (contrairement à l'exemple de Cnide). La profondeur, au creux des cannelures (au dessin elliptique allongé) est d'environ 1 centimètre, quelquefois légèrement davantage, semble-t-il. La difficulté est d'en retrouver les proportions ; nous ne pouvons y parvenir que d'après des exemples que le style du chapiteau nous donne comme contemporains.
Le chapiteau présente sans doute encore un profil classique ; les cannelures viennent s'amortir doucement sur la ligne de l'échiné ; le travail est extrêmement fin et soigné ; mais déjà l'échiné est toute droite, sans courbe sensible ; elle tombe suivant un angle inférieur à 45° avec la verticale ; elle est plus verticale qu'à Tégée (1), qu'à Stratos (2), ou qu'à Samo- thrace (3), et se rapprocherait un peu du chapiteau de Némée (4), à part la différence des annelets et du gorgerin. L'épaule est ici réduite à ce que dessine un simple trait mené tout autour de l'échiné pour en cerner le contour au contact de l'abaque. Le chapiteau est ainsi assez sec et abstrait ; assez haut, aussi, pour sa largeur (23 centimètres, pour 58 centimètres de large, c'est-à-dire exactement la moitié du diamètre supérieur de la colonne). La hauteur de l'échiné, jusqu'à la fin des annelets, est presque égale à celle de l'abaque. Le profil des annelets, surtout, quadrangulaire (les annelets en saillie, aussi bien que les filets creux, composés de lignes droites, à angle droit entre elles, et perpendiculaires à la ligne de l'échiné), assez rare, ne se trouve guère avant le début de la période hellénistique. Un exemple analogue existe à Pergame, dans un portique du marché (5). C'est de ce côté, semble-t-il, qu'il faut beaucoup plutôt chercher les
(1) Pronaos (Dugas-Berchmans, pi. XXXVII, B). (2) Courby-Picard, p. 28 et pi. VII ; restitution pi. VIII). (3) Nouveau temple des Gabires, proslasis (Conze-Hauser, pi. XXII, XXXIII, XLII). (4) Expédition de Morée, planches, III, 74. (5) Pergame, III, 1, pi. XXX, 1, et XXXI ; texte p. 104-5.
LE MONUMENT AU LION D AMPHIPOLIS 37
analogies ; mais à Pergame en général paraissent les signes d'une évolution plus avancée : cannelures se cassant net sur les annelets, ou, d'autre part, s'interrompant à mi-hauteur de la colonne, ou n'existant même que sur un très court espace, au chapiteau et à la base. S'il fallait constituer une
Fig. 19. — Schéma de reconstitution.
série suivie, notre chapiteau s'intercalerait sans doute entre les dernières grandes constructions doriques du ive siècle et celles de Pergame, en précédant d'assez peu celles-ci.
On a retrouvé dans les ruines un bloc de marbre extrêmement mutilé, mais qui avait été très régulièrement et très soigneusement taillé et poli. Des éclats ont sauté à tous les angles ; on avait commencé à l'attaquer par le milieu pour le briser. Ses faces sont encore, reconnaissables sur de très petites étendues, mais les dimensions sont conservées. Des anathyroses, sur les côtés et sur la face arrière, sont encore visibles. Le bloc a 0 m. 995 de
38 J. ROGER
long, 0 m. 41 de large (profondeur) et 0 m. 446 de haut. Sa longueur est une mesure habituelle dans le monument ; mais si l'appartenance est bien assurée, ses autres dimensions empêchent qu'on range le bloc parmi les degrés. Sans doute appartenait-il à la maçonnerie même du monument ? Il n'a guère de place ailleurs, ni dans le socle, ni parmi les degrés, ni dans l'entablement. Peut-être était-ce un des blocs qui formaient mur entre les colonnes. Mais alors on serait conduit à penser que le mur était composé d'assises de deux hauteurs, 0 m. 23 (comme l'assise correspondant au chapiteau) et 0 m. 45, l'une approximativement double de l'autre, alternant. Nous n'avons malheureusement pas le moyen de restituer, même à peu près, la hauteur de la colonne, ni, par conséquent, celle du mur.
Nous n'avons aucun reste de l'entablement. Quant à la pyramide de degrés qui devait couronner l'édifice (cf. Halicarnasse, Cnide, Bélévi, le tombeau de Pélékiti, la tombe de Mylasa, le «tombeau d'Hamrat » à Souéïda, celui de Brâd et bien d'autres exemples), son rôle principal était, autant que de surélever l'épithéma, de réduire en rectangle le carré de base (comme à Cnide) ; l'étagement se faisait suivant deux pentes inégales, selon les côtés : le degré supérieur était à chaque fois en retrait sur le degré inférieur, mais le retrait était moindre sur les côtés Nord et Sud (façade et derrière) que sur les côtés Est et Ouest (flancs droit et gauche du lion). On arrivait ainsi à la forme d'un rectangle allongé. Ce rectangle final devait porter une sorte de socle ou de piédestal, sur lequel reposait enfin le lion. La hauteur de l'ensemble atteignait ainsi de 17 à 18 mètres, et peut-être davantage. Du sommet, le lion contemplait la ville (1).
S'il faut essayer de situer aussi le monument dans le temps, les rapprochements que nous avons été amené à faire ont déjà suggéré par eux-mêmes une date approximative. Les données de la construction de base confirment celles que nous avions cru pouvoir reconnaître dans la sculpture. Le caractère de l'appareil, autant que le type du monument lui-même, ne peuvent pas accepter une date trop ancienne ; notre chapiteau trouverait peut-être sa place dans la fin du ive siècle, et même dans le passage du ive au ine.
(1) Le monument est orienté presque exactement vers le Nord, comme à Chéronée ou à Thespies ; mais cette position est ici déterminée, en dehors de toute analogie, par la présence de la ville, en face.
Nous ne nous dissimulons pas ce que cette reconstruction peut avoir d'incertain ; nous sommes obligés de nous fonder trop souvent sur des hypothèses ou des rapprochements forcément mal assurés ; nous ne saurons jamais rien de l'organisation intérieure ; mais cette recherche, groupant dans une figure d'ensemble les éléments qui nous sont donnés et qui sont, eux, à peu près à l'abri du doute, aura du moins pour résultat de rattacher plus clairement l'édifice à des séries déjà connues.
LE MONUMENT AU LION d'aMPHIPOLIS 39
Les crampons en Π encore visibles dans la partie de l'euthyntéria conservée (fîg. 16) sont postérieurs au Philippéion de Megalopolis et au temple de Stratos (1) ; le mélange des scellements, le type des queues-d'aronde qui y sont représentées (cf. Courby, Délos, XII, les temples d'Apollon, 21, fig. 26 et 27 ; cf. p. 102 et n. 2) indiqueraient même une époque plus avancée. Mais nous ne parviendrions à plus de précision que si nous pouvions déterminer les grands événements ou le personnage exceptionnel à propos de qui a pu s'établir à Amphipolis un tel type de monument : c'est à quoi sans doute il faudra pour le moment renoncer.
La destination du monument est éclairée par la série dans laquelle il rentre. Tous ces édifices plus ou moins somptueux sont des tombeaux, tombeaux de princes, de dynastes ou de particuliers distingués entre tous. A Amphipolis aussi le monument est un tombeau ; l'explication est tout à fait en accord avec le site où il s'élevait.
Une première conclusion s'impose ainsi : de même qu'il ne s'agit pas là d'un trophée de victoire (2), il ne s'agit pas non plus d'un « polyandrion ». Le monument n'était pas dressé pour commémorer le souvenir d'une grande bataille, et conserver les restes de braves glorieux. L'exploration du terrain a montré que l'édifice se dressait, isolé, sur le côté de la nécropole : or les « polyandria » que nous connaissons (Chéronée et Thespies, à côté de Marathon) sont toujours composés d'un enclos de tombes, dominé par un σήμα principal qui le marque à l'extérieur. A l'époque indiquée par la construction, nous n'apercevons guère, d'ailleurs, d'occasion suffisante dans les événements ; les longues tentatives des Athéniens pour reprendre la ville avaient depuis longtemps définitivement échoué ; à partir du moment où Philippe met la main sur la ville, il ne la perd plus, et l'histoire d'Amphipolis paraît dès lors assez limitée aux affaires intérieures, à l'abri de grands troubles. Sans doute eut-elle toujours, ville grecque, quelques démêlés avec les populations qui l'environnaient ; mais ils ne paraissent pas avoir laissé de souvenir de quelque retentissement. L'indice le plus fort que l'on pourrait faire valoir, c'est Γέπίθημα, lion colossal, trop semblable à Chéronée et à Thespies ; mais l'argument n'est pas non plus décisif.
(1) Au temple de Némée aussi (R. Vallois-Clemmensen, BCH, 1925, 17). (2) II est même inutile, pour en exclure l'idée, de rappeler que les Macédoniens n'élevaient
jamais de trophée (Pausanias, IX, 40, 7. Cf. A.-J. Reinach, REG, 1913, 347 sqq.) : le monument pourrait n'être pas d'origine macédonienne.
40 J. ROGER
Le lion n'est pas uniquement voué aux tombes collectives, et c'est une explication dont il faut se garder d'abuser. E. Michon (1) a montré à juste titre, à propos du lion Halgan du Louvre, combien le motif du lion funéraire était répandu, sans qu'on soit obligé à chaque fois d'invoquer une grande bataille et la commune sépulture des héros tombés (2). Le grand nombre des victimes enterrées sous sa protection ne se mesure pas nécessairement non plus aux proportions colossales de la statue qui les recouvre (3).
La présence d'un épithéma de telle nature semble assurément cependant attester une intention particulière dans le choix et dans l'importance du symbole. La valeur symbolique du motif du lion, assez bien connue, est multiple (4) : d'abord gardien et défenseur, il figure comme un signe favorable et joue presque un rôle d'a7coxp(^aÎov ; il est souvent associé dans les monuments à l'idée royale, du souverain et du prince ; il est, dans des temps très anciens, en Phénicie, le symbole de la mort, et c'est avec cette valeur qu'il est repris dans l'art grec à partir du vie siècle. Mais surtout, il évoque finalement les idées de courage et de vaillance militaire, et c'est à ce titre qu'il orne des monuments comme Thespies ou Chéronée, ou encore que des souverains guerriers, comme Alexandre, à l'imitation d'Héraklès, s'en associent l'image. Si le motif conserve dans notre monument un reste de valeur symbolique, c'est bien certainement celle-là qu'il faut lui attribuer, particulièrement à cette date. Peut-être reviendra-t-on par là à l'idée d'un monument élevé publiquement par la cité, plutôt qu'à celle d'un tombeau privé. Mais, puisqu'il n'a pas abrité les victimes héroïques d'une grande bataille, ne peut-on imaginer qu'il a simplement reçu la dépouille d'un célèbre chef de guerre, grand citoyen et grand général, particulièrement cher aux Amphipolitains ?
Un second point, c'est qu'il faut, croyons-nous, écarter tout rapport du
(1) Mém. Soc. Antiq. de France, LVIII, 1897, 26-54. (2) Les mêmes réserves sont à faire pour le monument de Cnide. Il y aurait de sérieuses raisons
de suspecter (malgré Schroder, l. c, et les ouvrages qui se bornent à rassembler des documents) la date et l'interprétation proposées par Newton : polyandrion élevé par les Athéniens, à la suite de la victoire navale de Conon, en 394, au large de Cnide. Le monument ne doit pas avoir été un polyandrion. Pausanias nous rapporte (I, 29) que les corps des Athéniens tombés au loin dans les batailles, de terre ou de mer, étaient ramenés à Athènes et recevaient là leur sépulture solennelle. Newton cite lui-même, à côté de son monument, dans des sites identiques, d'autres tombeaux analogues, qui retirent à celui-ci tout caractère exceptionnel, et donc historique. Le site choisi n'évoque pas nécessairement l'idée d'une bataille navale à commémorer (cf. le tombeau de Milet, où le site est très comparable). Enfin la' sculpture du lion serait peut-être aussi à dater de moins haut, malgré sa plénitude d'exécution, de même que certains éléments de l'architecture paraissent plus avancés que ne le comporte la date de 394.
(3) Cf. Arvanitopoulos, Πολέμων, II, 1938, 90. (4) Cf. en général Collignon, Slat. Fun., 88 sqq.
LE MONUMENT AU LION d'âMPHIPOLIS 41
monument au lion avec les événements de 422 et le combat où périrent Brasidas et Cléon (1). Ce serait peut-être la première hypothèse qui se présenterait à la pensée, tant cette bataille domine aujourd'hui dans notre esprit toute l'histoire d'Amphipolis. Mais des raisons très pressantes invitent à y renoncer. Les Amphipolitains rendirent ailleurs — dans la ville (Thucydide, V, 11) — les honneurs qu'ils devaient à Brasidas. Les Athéniens de leur côté ramenèrent leurs morts à Athènes (Thuc, V, 11, 2), et leur élevèrent à l'endroit habituel, près de l'Académie, le tombeau traditionnel (Pausanias, I, XXIX, 2) ; il y aurait peu de vraisemblance, d'ailleurs, que les Amphipolitains victorieux eussent laissé leurs ennemis défaits construire en paix, à leurs portes, un monument commémoratif qui les défiait. Dira-t-on que l'édifice fut élevé, après un long intervalle, pour honorer les morts lacédémoniens de 422 ? Mais aussi bien les incessantes opérations militaires qui se poursuivirent longtemps dans la région avant qu'Athènes se fût résignée, que le style et le caractère même de l'édifice, empêchent de croire que la construction ait pu avoir lieu au plus tôt avant le milieu du ive siècle : l'espace est considérable. Une telle manifestation symbolique ne pourrait guère s'expliquer que par un renouveau, dû à Philippe, des passions anciennes. De toutes façons on devrait s'attendre à trouver de l'événement, dans les textes athéniens qui évoquent Amphi- polis avec tant d'émotion, des traces, qui n'existent pas. Et enfin un tel monument perdrait bien de sa signification là où il est dressé : ce n'est pas à cet endroit du tout qu'eut lieu la bataille, mais sur les collines de la rive opposée (Thucydide, V, 7 sqq.), où d'ailleurs fut élevé un trophée !
Il est naturel de rechercher dans des ruines marquantes le souvenir de grands événements ; mais il serait bien vain de prétendre retrouver toujours des monuments historiques. Pour un fait que nous donnent les textes, combien d'autres ont été complètement ignorés et passés sous silence, auxquels aucune allusion ne nous fait remonter ! Toutes les vraisemblances que l'on peut réunir ne valent pas une ligne de texte. Pour le monument qui nous occupe, la reconstitution architecturale a déjà des lacunes et des incertitudes redoutables, qu'on ne réparera pas par de fausses facilités d'attribution. La première précaution est de se tenir étroitement aux données fermes conservées. La date de la construction nous paraît résister
(1) Cf. A. Philadelpheus, Messager (VAlhènes, déc. 1937. A plus forte raison ne peut-il être question de Périclès et d'Hagnon ! La théorie qui voudrait rattacher le monument à la guerre de l'or et à la politique de Périclès est faite de suppositions gratuites, qui ne tiennent aucun compte des données fournies par les ruines elles-mêmes (cf. Πολέμων, II, 1938, 89-98).
42 J. ROGER
à un rapprochement avec le souvenir de 422. Les analogies de type portent à la conclusion que le monument était un tombeau, et le tombeau d'un homme, même s'il s'agit d'un personnage particulièrement distingué.
A vrai dire celui-ci est d'un type unique jusqu'à présent en Macédoine, et, par la date, encore plus surprenant. Nous ne connaissons guère pour la région que deux genres de tombeaux : les tombes, simples et isolées, perdues dans la masse d'un tumulus (type thraco-macédonien), ou les caveaux funéraires à κλίνη, avec vestibule, le plus souvent aussi sous tumulus, qui semblent bien être le type le plus habituel à partir du moment où les progrès du pays permettent des constructions plus fastueuses. P. Perdrizet a vu, tout près même d'Amphipolis, un tombeau de ce genre (1). Mais il n'y a pas à s'étonner de retrouver ici une trace, entre autres, de l'influence de l'Asie Mineure ; les deux pays n'ont pas manqué de contact, surtout après le milieu du ive siècle ; l'influence particulière d'un monument aussi célèbre que le Mausolée a pu se répandre assez au loin dès l'origine (2).
C'est là, à peu de chose près, tout ce que nous pouvons dire dans l'état actuel des choses, et il faut s'en tenir à quelque généralité. Ce tombeau aux formes mêlées et étrangères, auxquelles se combine un επίθημα si magnifique, demande encore un nom certain (3).
Jacques Roger.
(1) BCH, 1898, 335 sqq. (2) Malgré Dinsmoor, AJA, 1908, 164. Pour Amphipolis ville ionienne, cf. Perdrizet, BCH,
1922, p. 42 sqq. et particulièrement p. 48. (3) Des personnages illustres ne nous sont guère connus à Amphipolis pour cette époque
qu'en relation avec l'expédition d'Alexandre (c'est un indice qui s'ajouterait au type du monument, comme à la présomption de somptueuses funérailles faites à un général par la cité, pour incliner à une date assez avancée). Les précisions que l'on pourra donner, sans y croire, ne seront proposées qu'à titre d'exemple, que pour montrer ce que pourrait être le tombeau, et non pour révéler ce qu'il est. C'est sous ces réserves seulement que nous avions déjà aventuré le nom de Néarque (cf. CHAI, 1938, 189-190), qui rappellerait le rôle d'Amphipolis au départ de la flotte et l'importance de sa participation dans les grandioses campagnes d'Orient, et rendrait compte, par sa date et quelques circonstances personnelles, d'influences lyciennes. Cf. Lehmann-IIaupt, dans Papastavrou, Amphipolis, Prosopographie und Geschichte, p. 97-137. Mais il ne peut s'agir naturellement que de rapprochements hypothétiques, que de suggestions voisines, non d'explications fermes et assurées, qui n'ont pas de lieu ici.