Analyser Le Massacre
-
Upload
espolion-filosofico -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
description
Transcript of Analyser Le Massacre
-
Questions de Recherche / Research in Question
N 7 Septembre 2002
Analyser le massacre
Rflexions comparatives
Jacques Smelin
Centre d'tudes et de recherches internationales
Sciences Po
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
2
Analyser le massacre Rflexions comparatives
Jacques Semelin CNRS / CERI
L'poque de la destruction de Rosalie tait arrive
Justine, Marquis de Sade
Rsum Ce texte vise penser un objet particulirement difficile saisir et qui est pourtant au cur de nombreuses guerres prsentes et passes : le massacre. Celui-ci y est dfini comme une forme d'action le plus souvent collective visant dtruire des non-combattants, en gnral des civils. Le massacre est apprhend comme une pratique de violence extrme, la fois rationnelle et irrationnelle, procdant d'une construction imaginaire d'un autre dtruire, peru par le bourreau comme un ennemi total. L'ambition de ce texte est de montrer la pertinence d'une rflexion comparative sur le massacre. Son parti pris est d'aller au-del de l'tude de cas ou plutt de mettre en perspective le meilleur de ces tudes (sur l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, etc.), pour mieux comprendre les processus du passage l'acte de massacrer. A cette fin, deux lignes de force inspirent l'analyse :
- La profondeur historique : difficile en effet de tenter de comprendre les massacres des annes 1990 sans prendre en compte leur histoire au XXme sicle, y compris ceux que l'on nomme "gnocides".
- L'ouverture transdisciplinaire : le phnomne massacre est en lui-mme si complexe qu'il appelle tout autant le regard du sociologue, de l'anthropologue ou du psychologue ; ce dont ces pages voudraient aussi attester.
Abstract
This text aims to examine a particularly difficult phenomenon to study slaughter , although it is at the center of many wars today and yesterday. Slaughter is defined as a generally collective form of action that aims to destroy non-combatants, usually civilians. Slaughter is viewed as an extremely violent, both rational and irrational practice growing out of an imaginary construct pertaining to someone to be destroyed, whom the torturer perceives as a complete enemy. The aspiration of this text is to show the relevance of exploring slaughter from a comparative standpoint. It will go beyond the mere case study, or rather it will put the best of these studies (on ex-Yugoslavia, Rwanda, etc.) into perspective. To better understand the process by which the slaughter is put into action, two main directions guide the analysis:
- historic depth: it is in fact difficult to attempt to understand the slaughters that took place in 1990 without taking into account occurrences in the 20th century, including those termed "genocides."
- transdisciplinary overture: slaughter as a phenomenon is so complex in itself that it requires the eye of the sociologist, anthropologist and psychologist, as can be seen in the following pages.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
3
Lorsqu'un massacre est commis et rvl par la presse, des journalistes sont enclins
insister sur son apparente irrationalit : pourquoi s'en prendre aux enfants, aux femmes,
aux personnes ges ? Des dtails sur les atrocits sont aussi donns dans ces reportages.
Les caractristiques rvoltantes des massacres ne doivent pourtant pas empcher de
s'interroger sur la logique des acteurs, non seulement du point de vue de leurs moyens
d'actions mais aussi de leurs objectifs et de leurs reprsentations de l'ennemi. Par-del
l'horreur, force est de reconnatre que ceux-ci poursuivent des buts bien prcis :
appropriation de richesses, contrles de territoires, conqute du pouvoir, dstabilisation d'un
systme politique, etc.
Penser le massacre, c'est alors chercher saisir la fois sa rationalit et son
irrationalit : ce qui peut relever du froid calcul et de la folie des hommes, ce que je nomme
sa rationalit dlirante. Ce qualificatif de dlirant renvoie deux ralits de nature
psychopathologiques. La premire est celle d'une attitude de type psychotique l'gard
d'un autre dtruire qui en fait n'est pas un autre parce qu'il est peru par celui qui va
l'anantir comme un non semblable lui-mme. C'est dans le dni de l'humanit de cet
autre barbare que rside la part psychotique du rapport du bourreau sa future victime.
Mais dlirant peut encore signifier une reprsentation paranoaque de cet autre vu
comme menaant, voire incarnant le mal. Or la particularit d'une structure paranoaque est
sa dangerosit, la conviction d'avoir faire un autre malfaisant tant si forte quil y a
effectivement risque de passage l'acte. Ainsi, dans le massacre, la polarisation binaire
Bien/Mal et Amis/Ennemis est son comble comme dans la guerre. C'est pourquoi
le massacre fait toujours bon mnage avec la guerre ou, s'il n'y a pas de guerre
proprement parler, il est vcu comme un acte de guerre. C'est par l que les massacres ne
sont pas insenss , du point de vue de ceux qui les perptuent, parce qu'ils ressortissent
une ou des dynamiques de guerre. En somme, la population ennemie est perue
comme une cible lgitime de violence - y compris militaire -, une ide qui s'est gnralise
durant les deux guerres mondiales mais qui, selon l'historien John Horne remonte la
priode de la Rvolution franaise (Horne, 2002). On peut ainsi tenter de penser les
massacres du point de vue de leurs usages politiques et stratgiques, dans le contexte
contemporain (Semelin, 2001).
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
4
La diversit des situations historiques conduit distinguer au moins trois types
d'objectifs associs aux processus de destruction partielle, voire totale d'une collectivit :
- la soumission : le but est de dtruire partiellement un groupe de manire soumettre ceux
qui survivront. L'effet de terreur est ainsi de nature cristalliser la sujtion de la collectivit
vise par les massacres, que ce soit pour l'exploiter conomiquement, pour la dominer
politiquement, ou pour les deux la fois. Ceci inclut notamment les procds de
bombardement des populations civiles ;
- l'radication : le but est d'liminer d'un territoire particulier un autre prsent comme
tranger ou dangereux. Le massacre limit des membres de ce groupe, dont les critres de
dfinition relvent de l'agresseur, est galement de nature propager un climat de terreur
destin provoquer la fuite du territoire de tous les membres du groupe vis (cas du
nettoyage ethnique ). Dans certaines situations encore plus extrmes, la volont de
destruction s'applique tous les membres du groupe, l'agresseur ne laissant pas ses
victimes la possibilit de s'enfuir (cas du gnocide) ;
- la dstabilisation : les auteurs du massacre n'ont pas ici les moyens de parvenir la
soumission ou l'radication du groupe vis. En revanche, ils peuvent le frapper
ponctuellement de manire esprer provoquer en son sein un effet politique dstabilisant
qu'ils esprent favorable leur cause. C'est le principe mme de l'action dite terroriste ,
entendue alors comme pratique de groupes ou rseaux non tatiques.
J'ai tent ailleurs d'expliciter les ressorts de ces diffrentes dynamiques de
destruction des civils en cherchant notamment lucider les logiques d'action qui conduisent
du massacre un processus gnocidaire (Semelin, 2002). Mais cette r-injection de
sens dans l'acte de massacrer n'est certainement pas suffisante pour en expliquer
l'avnement. En effet, le problme central, pos aux sciences sociales, est de tenter de
comprendre les circonstances politiques, conomiques et culturelles susceptibles de
conduire au dveloppement de ces formes particulires d'actions collectives que sont les
massacres. Ceci revient alors centrer la rflexion sur la question du passage l'acte, non
pas apprhend au sens psychologique d'une pulsion , mais bien plutt comme le
moment critique de bascule dans des pratiques d'extrme violence.
Comment avancer dans cette direction? Il convient en premier lieu de faire l'analyse
des rapports complexes et souvent ambigus entre les auteurs des massacres - en anglais,
perpetrators - et leurs victimes pour voir notamment en quoi ce basculement dans l'extrme
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
5
violence est l'expression d'une crise politique, sociale, communautaire bien antrieure au
passage l'acte lui-mme. A cet gard, les travaux sur le discours identitaire, ou plutt sur la
construction des identits, notamment dvelopps en France par Denis-Constant Martin,
offrent des perspectives fcondes. Celui-ci a dj remarqu que ce passage de la
coexistence au massacre est fluide et qu'il s'agit par consquent d'tudier aussi bien ce
continuum que le seuil du conflit . En ce sens, il suggre d'explorer trois aspects de ce
passage : les rapports entre peur et anxit, les luttes pour le pouvoir dont ce conflit est le
thtre, la faon dont les discours identitaires sont idologiss (Martin, 1999 : 194).
Mais l'analyse du massacre ne saurait se limiter l'tude de l'volution du binme
perpetrators-victimes . En effet, il faut aussi prendre en compte un troisime terme - le
tiers - que les auteurs anglo-saxons tels que le psychosociologue Irving Staub nomment by-
standers (Staub, 1989). Ce tiers peut tre proche (le voisin) ou bien plus lointain (un tat
particulier ou ce que l'on dsigne aujourd'hui sous le terme peu satisfaisant de
communaut internationale ). Or, ce tiers peut non seulement jouer un rle aprs le
massacre ( titre de tmoin) mais aussi bien avant le massacre. Tout porte croire en effet
que le processus qui conduit celui-ci s'explique galement par la passivit, voire la
complicit de tiers proches ou lointains, vis--vis de ce qui s'apprte tre commis ou est en
train d'tre commis. Il y a alors lieu d'interprter le passage au massacre en fonction de la
dynamique d'une situation sociale et internationale, au sein de laquelle ceux qui tiennent la
fonction de tiers occupent une place dterminante, car leur action ou non-action est de
nature jouer un rle essentiel sur la dtermination des bourreaux se saisir ou non de
leurs victimes .
Ce triangle des perscuteurs, des victimes et des tiers constitue le cadre
d'analyse lmentaire du massacre. Pour comprendre en profondeur ce qui se joue dans ces
rapports triangulaires, on pourra aussi bien convoquer la discipline des relations
internationales que la sociologie politique ou historique, l'anthropologie ou la psychiatrie
sociale. La complexit des phnomnes de massacres appelle une multiplicit de regards
disciplinaires. Ce texte voudrait tre une contribution modeste dans cette perspective,
prenant notamment appui sur les travaux du groupe de recherche Faire la paix. Du crime
de masse au peacebuilding que Batrice Pouligny et moi-mme avons lanc au CERI,
dans le but de dvelopper prcisment des approches transdisciplinaires1.
L'autre orientation de ce texte, qui est galement celle de notre groupe de recherche,
est de tenter de dvelopper des analyses comparatives entre divers cas de massacres ayant 1 Pour une prsentation de ce groupe, se reporter au site du CERI : http://www.ceri-sciences-po.org
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
6
vis la soumission et/ou l'radication d'un groupe. En effet, on dispose aujourd'hui
d'tudes de cas remarquables principalement en histoire, commencer par celles sur la
destruction des juifs europens (Hilberg, 1994), mais les approches comparatives restent
encore rares et balbutiantes. Nous parions ici sur le caractre heuristique de l'analyse
comparative pour faire avancer la connaissance des dynamiques du massacre, le champ
des genocide studies en plein essor, principalement aux Etats-Unis, tant cet gard
assez prometteur2. Aussi ce texte s'efforce-t-il de poser des jalons galement dans cette
perspective comparatiste, prolongeant mes travaux antrieurs sur les cas trs diffrents du
nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie au cours des annes quatre-vingt dix (Semelin, 2000)
et du gnocide des juifs dans l'Europe nazie (Semelin, 1986, 1998).
Ce n'est pas le lieu ici de revenir sur la lgitimit, les conditions et les limites de
l'exercice de la comparaison, une question qui a dj suscit une vaste littrature (Aron,
1971 ; Passeron, 1992 ; Chazel, 1998 ; Badie, 1992 ; Leca, 1992). Bornons-nous seulement
dire que, dans notre esprit, comparer n'est nullement niveler les diffrences mais bien
plutt les mettre en relief. On dit en gnral que comparer consiste tablir la fois les
lments de similitudes et de distinctions entre des vnements comparables. Certes, il
s'agit l d'une premire tape - importante - mais assez rudimentaire. Pour tre vraiment
intressant, l'exercice de la comparaison doit tre pouss plus loin, cest--dire vers la
construction de problmatiques qui soient de nature rendre compte de la spcificit
historique de chaque vnement. Par problmatiques, j'entends des questions communes
susceptibles d'une certaine thorisation, dont les rponses peuvent se dcliner diffremment
selon les situations historiques examines. C'est d'ailleurs l une approche qui a t
dfendue en histoire par Paul Veyne : conceptualiser pour individualiser (Veyne, 1976).
C'est une perspective assez proche qui est adopte ici partir des six problmatiques
suivantes :
- Crise de l'Etat, massacres et systme international ;
- Idologies, mythes et reprsentations de l'ennemi ;
- Discours publics, dcisions et organisation du massacre ;
- Opinion publique, lien social et co-construction de l'vnement ;
- Tueurs de civils : bourreaux volontaires ou monstres ordinaires?
- Sens et non-sens des atrocits.
2 Il suffit pour s'en convaincre de regarder les premiers numros de la nouvelle revue Journal of Genocide Research fonde New York en 1999 et le programme de la dernire confrence de la nouvelle association universitaire : the International Genocide Scholars Association (Minneapolis, juin 2001).
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
7
CRISE DE LETAT, MASSACRE ET SYSTEME INTERNATIONAL
Dans la mesure o l'essentiel des cas connus de destruction des populations civiles
ont t le fait de pouvoirs tatiques (Rummel, 1994), une des toutes premires interrogations
est de savoir si le massacre est commis par des tats forts ou des tats faibles ? La thse
de l'tat fort semble s'imposer d'emble, tant il faut de puissance pour commettre un
massacre et plus encore un gnocide. Puissance de destruction mais encore puissance
d'organisation, de communication, de commandement, etc. Le gnocide suppose lui-mme
le pouvoir d'un tat disposant bien sr de la force arme mais aussi d'un systme
bureaucratique consquent, d'un appareil de propagande, etc., comme l'ont soulign bien
des auteurs (Kuper, 1981 ; Fein, 1990). Certains en ont d'ailleurs conclu que le gnocide est
un phnomne moderne, dans la mesure o il suppose un dveloppement technologique
important (Bauman, 1989).
Cependant, cette thse de l'tat fort est branle par ceux qui attirent l'attention sur
le contexte gnral dans lequel sont placs ces pouvoirs. Ils remarquent que ceux-ci, bien
que puissants, se retrouvent dans une position de vulnrabilit qui est prcisment de nature
expliquer leur engagement massacrer. La prise en compte du contexte de la guerre est
ici essentielle, notamment pour expliquer le processus de bascule vers le gnocide. Ainsi
des historiens comme Philippe Burrin ou Christian Gerlach ont avanc que la dcision de la
solution finale , prise par les nazis trs probablement partir du mois de dcembre 1941,
ne peut tre isole du fait que ceux-ci ralisent alors qu'ils ne pourront pas gagner la guerre
qu'ils ont dclenche contre l'Union sovitique (Burrin, 1989 ; Gerlach, 1999). C'est donc
avec la conscience d'un chec venir, renforce par l'entre en guerre des Etats-Unis aprs
le bombardement de Pearl Harbor (6 dcembre 1941), que Hitler aurait pris la dcision de
gagner au moins sur son autre objectif fondamental : l'extermination des juifs ; d'o
l'importance, comme le propose Florent Brayard, de rvaluer l'analyse des propos de Hitler
qui se targuait d'tre le prophte de l'anantissement de la race juive dans le cas o
celle-ci en viendrait dclencher une nouvelle guerre mondiale (Brayard, 2002)3. Au
Rwanda, le contexte est videmment tout autre mais la question du rapport entre la guerre et
3 Il s'agit notamment de ses propos du 30 janvier 1939 : si la finance juive internationale, en Europe et hors d'Europe, prcipite nouveau les peuples dans une guerre mondiale, le rsultat en sera non plus la bolchvisation de la terre et avec elle la victoire de la juiverie mais l'anantissement total de la race juive en Europe , cit dans Philippe Burrin, Hitler et les Juifs. Gense dun gnocide, Paris, Le Seuil, 1980, p. 63. Je reviendrai sur cette importance du discours public annonant le massacre de masse dans la troisime section de ce texte.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
8
le gnocide est galement centrale. La scurit du gouvernement hutu au pouvoir Kigali
tait menace de l'extrieur, celui-ci tant attaqu depuis 1990 par le Front Patriotique du
Rwanda. Nombre d'auteurs mettent ainsi en rapport cette menace tutsi de l'extrieur avec la
construction idologique par les extrmistes hutu, d'une menace tutsi de l'intrieur, relayant
la premire, pour miner les fondements mmes du pouvoir d'tat. Par consquent, ne pas
perdre la guerre consistait au moins dtruire totalement cette menace interne, donc
exterminer les Tutsi. Un raisonnement assez semblable peut encore s'appliquer au gnocide
des Armniens, dont les massacres sont engags la suite d'une svre dfaite des Turcs
contre les Russes, dans un contexte de guerre o cette minorit armnienne de l'Empire
ottoman est perue par le gouvernement des Jeunes-Turcs comme complice et allie de
la Russie.
Cette approche renforce la thse de ceux qui pensent que les massacres sont plutt
le fait d'tats faibles ou qui se peroivent comme vulnrables ou encore qui croient qu'ils ne
peuvent gagner la guerre sans aller jusqu'au massacre des populations civiles. Plusieurs cas
de figures sont ici distinguer. En premier lieu, celui d'un pouvoir politique dont la lgitimit
n'est pas assure ou/et fortement conteste. Ainsi, pour l'historien Jean-Clment Martin, on
ne peut comprendre les massacres de la Rvolution franaise ( commencer par ceux de la
Vende) sans avoir en tte qu'ils sont paradoxalement l'expression de la faiblesse du
pouvoir d'tat (Martin, 1987). Selon Jean-Louis Margolin, l'ultraviolence des Khmers rouges
s'explique aussi par le fait qu'ils sont et se savent ultraminoritaires. Le recours au massacre
revient donc subsumer une position de faiblesse pour assurer son ascendant sur les
populations et renforcer son pouvoir. Si l'tat fait la guerre autant que la guerre fait l'tat,
pour rependre la formule de Charles Tilly, 2000), on en dira autant du massacre. Un autre
cas de figure est celui d'un tat dj en place mais dont la lgitimit est vivement conteste
ou se trouve fortement mise en cause, les individus s'tant rappropri ou se rappropriant
le droit la violence, n'acceptant pas ou plus de faire allgeance ce pouvoir. La situation
de l'Algrie, aprs le refus par le pouvoir de reconnatre le rsultat des lections de 1991,
offre une illustration d'une telle volution, selon Luis Martinez, entranant le pays dans la
guerre civile (Martinez, 1997).
Un troisime cas de figure est celui de l'effondrement d'un systme de domination ou
de fdration, antrieurement accepte ou subie par ceux qui le composaient. Par exemple,
comme le suggrent les travaux de K. Holsti (1996) ou de Zartman (1995), le contexte de
dcomposition d'un empire rend plus probable l'apparition de ce type de violence, en
permettant des restructurations identitaires fortes sur des bases nationalistes ou
communautaires. L'effondrement de l'Empire ottoman au dbut du XXe sicle et les
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
9
contrecoups de celui de l'Empire sovitique dans les Balkans aprs 1989 en fournissent des
illustrations.
Quoi qu'il en soit de ces approches, on voit combien il est difficile d'analyser les
pratiques de massacres en faisant abstraction du contexte international dans lequel elles
voient le jour. La difficult est de penser l'vnement dans son cadre local mais en
l'apprhendant simultanment dans sa dimension internationale. Ici aussi, les approches
peuvent tre diffrentes, adoptant soit un point de vue plutt structurel, soit plutt
fonctionnel. Dans ces travaux sur le gnocide, l'historien Marc Levene se situe plutt dans la
premire approche. Il entend montrer que le gnocide n'est pas penser comme une
aberration de la trajectoire d'un Etat-nation mais plutt comme un driv du systme
international et de l'conomie mondiale. Il s'appuie notamment sur la pense d'Antony
Giddens qui analyse cet tat dans un rapport systmique avec les autres tats-nations
(Giddens, 1985). Le gnocide se produirait lorsque certains tats en qute d'une
modernisation rapide prennent pour cibles des populations qu'ils peroivent comme une
menace ou un obstacle leur volont de puissance (Levene, 2000).
Le politiste Manu Midlarsky propose une approche plus fonctionnelle dans son
analyse comparative des trois gnocides armnien, juif et rwandais. Selon lui, il ne peut y
avoir de massacre de masse sans que les tats gnocidaires bnficient de la bienveillance
ou tout le moins de la passivit d'autres tats (en ce cas, l'Allemagne impriale pour la
Turquie, le Vatican pour le IIIe Reich, la France pour le Rwanda). C'est prcisment cette
non-intervention d'un tiers (ici sur le plan international) qui laisse le champ libre aux
entrepreneurs gnocidaires. Il convient donc de garder l'esprit que toute initiative
nationale de l'tat massacrant est resituer dans le contexte international de
l'poque. Ainsi l'volution de la politique de purification ethnique en ex-Yougoslavie peut-elle
s'interprter par les cycles successifs d'initiatives des cts serbe, croate, bosniaque, d'une
part, et des ractions ou non-ractions de la communaut internationale, d'autre part, envers
ces actions (Hassner, 1993, 1997). De ce point de vue, le massacre de Srebrenica (13-15
juillet 1995), perptr par les troupes bosno-serbes du gnral Mladic, restera comme
l'exemple le plus tragique de la passivit de la communaut internationale (Semelin,
2000).
Cette convergence entre facteurs internes et facteurs internationaux ne peut pourtant
elle seule rendre compte du passage l'acte : tout au plus cre-t-elle une structure
d'occasions favorables pour reprendre l'expression forge par Sidney Tarrow dans le cadre
de la sociologie des mouvements sociaux.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
10
IDEOLOGIES, MYTHES ET REPRESENTATIONS DE LENNEMI
Dans un contexte propice mais non dterminant, faut-il alors penser que l'idologie
des bourreaux est la cause premire et dclenchante de la violence extrme et des
massacres ? Nul doute que dans des situations de crise et de guerre, le discours idologique
propag par le pouvoir en place (ou par des groupes en qute de ce pouvoir) propose une
lecture de cette situation, dsigne des menaces et appelle une mobilisation
collective pour les dtruire. Dans son tude comparative sur les cas du Cambodge, de la
Bosnie et du Rwanda, Ren Lemarchand remarque, bien entendu, le poids du facteur
idologique, que celui-ci se nomme marxisme-lninisme, nationalisme ou vision pervertie de
la dmocratie (Lemarchand, 2001). Mais il souligne aussi que ces idologies ont rarement un
impact profond sur les masses, surtout lorsqu'elles ont des racines trangres ; moins que
leur langage soit radicalement transform et adapt la culture locale. C'est alors la r-
interprtation, voire la fabrication de mythes propres l'histoire de ces pays, qui vont
permettre la greffe idologique dans la culture locale. D'o l'importance de l'tude des
contes, des rumeurs, des mmoires propres cette culture, comme le propose Batrice
Pouligny, pour comprendre les pratiques de massacres qui y ont t commises4.
C'est en effet cette plonge dans l'imaginaire qui donnera une rsonance historique
et motionnelle au discours idologique.
Or, ce qui se construit ainsi, c'est un processus identitaire en tant que tel, comme en
rend compte la sociologie politique. le rcit identitaire, souligne Denis-Constant Martin,
permet dans les situations 'modernes' de troubles et de changements rapides, matriels
aussi bien que moraux, de verbaliser l'anxit et, du mme mouvement, de l'attnuer en
redonnant, grce des rfrents familiers -historiques, territoriaux, culturels ou religieux- du
sens ce qui semble n'en plus avoir (1994 : 31-32). C'est probablement cette
proclamation identitaire qui, lorsqu'elle se radicalise de plus en plus, est consubstantielle
la logique mme du massacre. Elle aboutit une polarisation antagoniste entre le nous
contre un eux , l'affirmation du nous impliquant la destruction du eux . En somme,
c'est au nom d'une vision d'un soi collectif construire ou dfendre que le massacre est
perptr, sur fond de ressentiment, de peur ou de vengeance. C'est bien aussi, comme l'ont
remarqu Frank Chalk et Kurt Jonasshon, dans le regard des bourreaux que l'autre
dtruire prend forme de menace et figure d'ennemis (Chalk, Jonassohn, 1990). 4 Voir son intervention dans le cadre de la premire runion du groupe CERI Faire la paix (8 fvrier 2001).
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
11
Cette construction identitaire produit alors deux manires de parler du nous et de
l' ennemi . Le discours sur soi est souvent celui de la puret, thme qui peut tre aussi
bien dclin par une idologie raciste, nationaliste ou une doctrine politique (de type
marxiste-lniniste) ; ou religieuse (de type islamiste). Ce discours de la puret s'labore bien
videmment travers une rhtorique sur l'impuret et la souillure (Douglas, 2001). On
parlera encore du soi collectif comme d'un mme , d'un mme ternel qu'il s'agit de
retrouver (ce qui rejoint le mythe). Intressante cet gard est la notion de puret
organique avance par Michael Mann (1998) et reprise par Scott Strauss comme une
caractristique fondamentale de la pense des gnocidaires (Strauss, 2001).
Cette affirmation du mme peut tre une raction la modernit et au
changement, tant alors propos comme cadre de repli et de scurit collective : On est
entre nous contre un autre , un non-mme . Si le processus identitaire conduit au
passage l'acte, ce moment du passage l'acte est en lui-mme vecteur de renforcement
de cette construction identitaire. La destruction du eux sera bien la preuve
constitutive du nous . Ainsi, tuer, c'est non seulement purifier, c'est aussi se purifier. D'o
un vocabulaire de la purification ou du nettoyage qui emprunte la religion (la purification
rituelle), la guerre (nettoyer le secteur), la mdecine (liminer les microbes).
Le discours sur l'autre dtruire se nourrit d'abord d'une rhtorique de la menace
qu'il reprsente. Que cette menace soit fictive (dans le cas des juifs contre les nazis) ou bien
relle (attaque des Tutsi du FPR), l'autre dtruire doit faire peur puisque c'est ce sentiment
de peur qui doit lgitimer sa destruction. C'est pourquoi le thme du complot est souvent
prsent, complot foment par ce eux dangereux, dont le nous dveloppe une
reprsentation paranoaque (Poliakov, 1980). Ce thme du complot peut d'ailleurs prendre
appui sur la ralit d'une situation stratgique militaire difficile : quand un pouvoir en guerre
cherche mobiliser sa population contre deux ennemis qui, dans son esprit, n'en font qu'un :
celui qui, l'extrieur, menace les frontires et celui qui, l'intrieur, mine les fondements du
rgime. Certains auteurs ont affirm que ce mcanisme de la double menace interne/externe
est propre aux systmes totalitaires (Todorov, 1990 : 141). Il semble plutt que le
totalitarisme 5 se nourrit de la forme extrme de cette double menace qui caractrise plus
gnralement le processus identitaire dans un contexte de guerre.
5 Encore faudrait-il s'entendre sur le sens de ce mot. Voir en ce sens l'approche critique de Enzo Traverso (Le Totalitarime, Paris, Points Essais, 2001) qui peut tre complte par Pierre Hassner ( Le totalitarisme vu de l'ouest , in Guy Hermet (dir.), Totalitarismes, Paris, Economica, 1984).
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
12
Ds lors, plus la menace militaire se fera relle et plus probable sera le passage
l'acte contre l'ennemi intrieur, prsent comme complice du premier. Tout se passe comme
s'il s'agissait d'un dilemme de scurit (Posen, 1993) puisque, dans de telles circonstances,
l'argument de la destruction des civils devient de la lgitime dfense : Comme ils veulent
nous tuer, nous devons les tuer avant, au plus vite . Celui qui s'apprte devenir bourreau
se prsente comme la victime. Son entreprise de destruction s'apparente une opration de
prvention et de survie de son groupe. Encore une fois comme dans la guerre : C'est eux
ou nous qui y passons.
cette rhtorique de la menace et du complot, s'ajoute celle de la dshumanisation
de cet ennemi ou plutt de son animalisation. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en
Europe, les victimes sont dcrites comme de vulgaires microbes , des insectes
nuisibles , des rats ou des bufs . Mais dans quelle mesure cette reprsentation
zoologique de l'ennemi (que l'on retrouve aussi sur les champs de bataille militaire) est-elle
une prparation l'acte de massacrer son semblable ? Ou bien est-ce une rationalisation
labore in situ ou a posteriori par le bourreau qui se convainc lui-mme que ses victimes
sont bien des animaux ? Des tudes empiriques sur le vocabulaire des bourreaux avant et
pendant le massacre font dfaut.
Les reprsentations de l' ennemi ne sont cependant pas les mmes selon que les
massacres visent leur soumission ou leur radication. Dans la dynamique de la
soumission, la figure de l'ennemi est prcisment celle de celui qui ne veut pas se soumettre
ou qui mne un double jeu. C'est la figure du suspect, d'un ennemi double face : il se dit
rvolutionnaire mais, en ralit, c'est un bourgeois . Il se dit pour le pouvoir mais en
fait, il appartient la gurilla. Bref, il possde une face secrte et dangereuse que masque
son apparence immdiate. La dynamique de l'radication produit une figure de l'ennemi bien
diffrente : celle de l'autre en trop, fondamentalement tranger nous . Il n'a pas le
mme sang , les mmes murs que nous , etc. De plus, ce trop de l'autre est
aussi quantitatif : il est peru comme tant en trop grand nombre, il a tendance se
multiplier, pulluler
En somme, tout ceci revient dire que le massacre, avant d'tre cet acte physique
atroce, procde d'abord d'un processus mental, d'une manire imaginaire de voir un
Autre dtruire. Mais comment valuer la puissance praxologique de cet imaginaire de
destruction ? En conomie ou en sociologie, on admet que la reprsentation imaginaire est
de nature crer du rel. C'est notamment ce que l'on nomme les prophties auto-
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
13
ralisatrices , la suite du sociologue Robert Merton. Une telle ligne d'interprtation est
aisment applicable aux conflits ethniques et situations gnocidaires. Ainsi, Jean-Franois
Bayart crit-il : Au Rwanda et au Burundi, la qualification ethnique des clivages politiques
et sociaux opre () comme une prophtie autoralisante, chacun des camps en prsence
supputant que son adversaire a planifi son extermination et agissant en consquence.
Situation extrme que celle-ci. Elle rappelle pourtant que le fantasme du complot est une
figure forte et universelle des imaginaires politiques (Bayart, 1996 : 179). Faut-il donc
considrer que cet imaginaire politique de destruction d'un autre , qui se cristallise dans
un discours public, est suffisant pour prcipiter le passage l'acte ?
DISCOURS PUBLIC, DECISION ET ORGANISATION DU MASSACRE
Ceci revient poser le problme de l'intention de dtruire dans le processus mme
du passage l'acte. Pour qualifier le crime, le juge cherche toujours prouver l'intention du
criminel. A-t-il bien eu l'ide de son meurtre ? Est-il prmdit ? Aussi cette notion d'intention
est-elle au cur de la Convention sur la prvention et la rpression du crime de
gnocide adopte par l'ONU en 19486. Mais son usage est problmatique en sciences
sociales. On peut certes parler de l'intention d'une personne pour dcrire sa disposition
d'esprit vis--vis d'une action particulire, un instant. Mais appliquer la mme approche
pour qualifier le fonctionnement d'une structure de pouvoir est inappropri7 : Ceci revient
psychologiser son fonctionnement, l o il vaudrait toujours mieux analyser une politique
et dcrire les moyens organisationnels mis en uvre pour l'atteindre.
Plus encore, cette notion d' intention sous-entend une vision simpliste du passage
l'acte. Elle semble en effet prsupposer une squence pense/action qui va du projet de
dtruire une collectivit sa mise en application concrte ; comme s'il s'agissait d'en 6 Article 2 : Le gnocide s'entend dans l'un quelconque des actes ci-aprs commis dans l'intention de dtruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel : a. meurtre de membres du groupe ; b. atteintes graves l'intgrit physique ou mentale de membres du groupe ; c. soumission intentionnelle du groupe des conditions d'existence devant entraner sa destruction physique totale ou partielle ; d. les mesures visant entraver les naissances au sein du groupe ; e. transferts forcs d'enfants du groupe un autre groupe. 7 Bien que le langage courant nous y invite souvent quand on dit par exemple, La France a l'intention de
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
14
formuler l'ide, d'chafauder un plan dans ce but et de le mettre en pratique. Mais une telle
approche oblitre d'emble l'nigme fondamentale que pose le massacre de masse : celui
de sa ralisation concrte, ce que Claude Lanzman a bien formul propos de la Shoah :
Entre le vouloir tuer et l'acte mme, il y a un abme (Lanzman, 1986 : 20). Aborder la
mise en uvre des processus de destruction des civils par l' intention , c'est donc risquer
de passer ct de toute la complexit du dveloppement de tels phnomnes. Et pourtant,
objectera-t-on, il y a bien des gens qui dcident le massacre, qui donnent des ordres en ce
sens et d'autres qui les excutent. Alors comment travailler sur cette problmatique ? mon
sens, cette notion d'intention pose en ralit trois types de questions relatives aux discours
publics sur l'ennemi, la dcision du massacre et son organisation concrte.
L'analyse du discours public nous renvoie au point prcdent sur les constructions
des figures de l'ennemi. Quand le leader des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, dclare,
en octobre 1991, la tribune du Parlement bosniaque, que si les musulmans optent pour
lindpendance, ils prennent le risque de disparatre, il voque alors clairement un projet de
purification ethnique, sinon de gnocide. Il faut toujours situer lacteur politique dans une
volution complexe, en interaction avec lvolution mme de la situation sur laquelle il tente
dagir 8. On pourrait en dire autant du fameux discours d'Adolf Hitler au Reichstag, le 30
janvier 1939 (prcdemment cit), au cours duquel il prophtise lanantissement de la
race juive en Europe . En dduire que la solution finale est dj dcide, sinon
programme, serait pourtant une grossire erreur d'interprtation historique. C'est bien plutt
en fonction de l'volution d'une situation particulirement complexe, dans le contexte d'une
guerre totale, que les objectifs idologiques gnraux et les dcisions tactiques se
renforcrent mutuellement favorisant des initiatives toujours plus radicales (Friedlander,
1997). Au moment prcis o elles sont formules, de telles dclarations ne peuvent donc
tre prise la lettre : l'intention qu'elles formulent publiquement n'a pas alors de
traduction tangible dans les faits.
Mais la violence extrme qu'elles expriment contre un ennemi publiquement dsign
n'en fait certainement pas des dclarations anodines. De tels discours publics, prononcs
par des leaders politiques (dans le cas allemand, c'est le chef de l'tat lui-mme) sont une
manire de lgitimer l'avance le dchanement d'une violence physique, de plus en plus
radicale contre cet ennemi . Autrement dit, l'apparition de ce discours ouvertement violent
donne le ton , prcisment parce qu'il est public, sans complexes , il cre de facto un
8 Intervention de Xavier Bougarel dans le groupe de recherche du CERI, Faire la paix (sance du 20 juin 2001).
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
15
climat d'impunit et, par l mme, d'incitation au meurtre. Intressante cet gard est
l'approche de Philippe Braud, qui tente d'articuler les fonctions respectives de la violence
symbolique et de la violence physique (Braud, 1999). Le discours public de haine ne
vient d'ailleurs pas seulement de chefs politiques mais encore de divers intellectuels ou
crivains, de journalistes, d'hommes d'glise, dont les crits, les dclarations expliquent,
justifient, lgitiment les raisons de cette violence. Dans les cas de l'ex-Yougoslavie et du
Rwanda, Laurent Gayer et Alexandre Jaunait ont fait en ce sens une tude comparative de
ces entrepreneurs identitaires (2001). Leurs dclarations publiques fournissent, par avance,
ceux qui seront impliqus dans les massacres, les cadres d'interprtation et de lgitimation
de leurs actes. Le rle des mdias est ici particulirement important, comme l'ont montr des
tudes sur le Rwanda (Chrtien,1995) ou sur la Yougoslavie (Popov, 1998). On ne peut
pourtant survaloriser ce rle de la propagande de la haine : car rien ne prouve que, par elle-
mme, celle-ci soit de nature dclencher le passage l'acte. En revanche, il est certain
que la propagande contribue crer une sorte de matrice smantique, qui donne sens la
monte en puissance de la dynamique de violence, laquelle va oprer alors comme un
tremplin vers le massacre.
Mais ceci ne nous apprend encore rien du moment de sa dcision. Quand est-il
dcid et par qui ? Il ne s'agit plus ici de supputer sur le processus de bascule vers le
massacre, partir des discours ou crits des acteurs, mais bien de reprer l'instant de la
dcision, comme moment critique du passage l'acte. tudier ainsi le processus de
dcision, c'est une autre manire d'explorer la question de l'intention, sur des bases
historiques, comme le remarque Maxime Steinberg (1999 : 170).
Il est vrai que cette approche s'est avre fconde pour l'tude de la Shoah (Gerlach,
1999), encore que des points importants restent dans l'ombre. Mais en bien des cas, les
documents crits qui permettraient de dater et d'authentifier sans ambigut la dcision du
passage l'acte sont rares, voire inexistants. Et pour cause : ceux qui en prennent la
responsabilit ne tiennent gure en laisser les traces. En rsultent maints dbats sur la
vritable intention des dcideurs, sur la date prsume de la dcision et, bien
videmment, sur la ngation a posteriori de la ralit des faits. Le cas des massacres des
Armniens de 1915-1916 est exemplaire cet gard, l'historien de l'empire ottoman, Gilles
Veinstein ayant contest leur nature gnocidaire , du fait, selon lui, de l'absence de
preuves crites permettant de qualifier l'intention du gouvernement Jeunes-Turcs envers la
minorit armnienne (Veinstein, 1995 : 41). Cette position a suscit de vives polmiques,
dont une rponse de Yves Ternon (Ternon, 1999).
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
16
Tant et si bien que ce qui atteste encore le mieux la volont de ceux qui dcident le
massacre, c'est son organisation pratique, c'est--dire la mise en uvre des moyens pour
parvenir l'limination physique de telle ou telle catgorie de populations. On voit ici
l'importance d'une mthodologie d'enqute historique qui a dj t rde dans diverses
tudes de cas : dcrire le comment pour comprendre le pourquoi ; une dmarche qui est
prconise par Claudine Vidal pour les recherches sur le gnocide au Rwanda, seul moyen
de se dgager de prsupposs idologiques (Vidal, 1998). Dans cette perspective, je
propose un questionnaire d'enqute sur les massacres pouvant aider le chercheur
entreprendre des tudes de cas et des analyses comparatives (voir en annexe).
L'tude de l'organisation des massacres doit alors porter en priorit sur les moyens
tatiques utiliss cette fin. On dit juste titre que les principaux massacres de masse ont
t jusqu' prsent le fait des tats. Mais il convient d'explorer plus finement cette
affirmation. Ne s'agit-il pas plutt d'un dtournement des moyens et des agents de l'appareil
d'tat, tombs sous le contrle d'un groupe politique dtermin raliser son projet
destructeur ? Vahakn Dadrian a propos une telle grille d'analyse vis--vis des gnocides
des Armniens et des juifs, qui pourrait galement s'appliquer celui des Rwandais tutsi
(Dadrian, 1999). tudier l'organisation du massacre, c'est non seulement s'intresser aux
personnels qui y sont impliqus (militaires, policiers, miliciens, civils), mais encore sa
technologie (nature des moyens de destruction utiliss), ses stratgie et tactique (leurre ou
non des victimes), sa gographie (exploitation des zones recules, dsertiques, etc.)
Dire "organisation du massacre" ne signifie pas que tout soit prvu par ceux qui le
dcident. Certains auteurs ont souvent tendance faire accroire que tout tait calcul et
prmdit par les criminels. C'est l encore une vision inspire par l'approche juridique :
prouver que le massacre rsulte bien d'un plan concert et coordonn. Si la dynamique du
processus de destruction est bien enclenche par une impulsion centrale (provenant de ceux
qui le dcident et l'organisent), elle obit aussi une certaine improvisation de l'action. On
sait par exemple que le premier programme nazi d'extermination en Allemagne mme visant
les malades mentaux a t accompagn d'incroyables erreurs et maladresses. Comme pour
d'autres formes d'actions humaines collectives, les processus organiss de destruction des
civils peuvent connatre des alas divers, des inflexions, des rpits et de soudaines
acclrations.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
17
OPINION PUBLIQUE, LIEN SOCIAL ET CO-CONSTRUCTION DU MASSACRE
Mais cette apprhension du processus de destruction comme obissant une chane
volontariste allant de la dcision l'organisation, puis l'excution, n'aboutit-elle pas en
dformer la comprhension ? En effet, tout se passe comme si on avait en tte un schma
hirarchique du haut en bas pour rendre compte de sa dynamique. Or, cette approche
mcanique , fonctionnelle ne nous aide en rien comprendre l'nigme de la participation
sociale au massacre. Ne voir celui-ci que comme une entreprise commande ne permet pas
d'explorer la question d'une certaine complicit sociale, sinon dadhsion collective, son
gard. Aussi convient-il de dvelopper une tout autre approche : tudier le massacre par le
bas de la socit. Indpendamment de la puissance d'un tat, qui dispose des moyens de
tuer grande chelle, ne serait-ce pas l une voie des plus fcondes pour rendre compte du
caractre massif de certains massacres ?
Cette question peut tre dj traite par l'tude de l'opinion publique. Il faut en effet
faire la part des choses entre le dploiement d'un appareil de propagande visant diaboliser
tel ou tel ennemi et l'adhsion effective du public cette rhtorique idologique. Ltude de
l'opinion permet prcisment de se faire une ide sur l'tat d'esprit d'une population,
commencer par son degr de rceptivit cette propagande. Or, ds les annes cinquante,
des travaux sur l'Allemagne nazie ont affirm qu'il ne pouvait y avoir gnocide sans une
sorte de consentement tacite la perscution des juifs (Poliakov, 1951). Les nazis
interprtaient d'ailleurs la non-raction de l'opinion allemande comme la possibilit de
franchir un seuil supplmentaire dans leur perscution. Cette hypothse a t confirme par
des travaux ultrieurs, mme si des enqutes historiques plus prcises ont permis de la
nuancer (Kershaw, 1995). Autrement dit, la fonction du tiers, si importante entre le
perscuteur et ses victimes, n'est plus ici la communaut internationale (voir plus haut),
mais ce qu'on nommera opinion publique . Ce serait donc quand ce tiers non seulement
reste passif, mais adhre implicitement, voire ouvertement, au processus de violence que le
passage l'acte vers le massacre devient d'autant plus probable. Cette carence peut
seulement tre compense par l'intervention extrieure d'une opinion publique
internationale qui, principalement par les pressions de diverses ONG, tentera de
dnoncer, de porter assistance, de soutenir les victimes. Ce tiers participant de la formation
du processus de destruction peut trs concrtement tre le voisin ; ce qui conduit alors
rflchir sur la notion de lien social . Cette approche renverse alors compltement la
perspective prcdente : au lieu de considrer que le massacre entrane la destruction du
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
18
lien social entre les victimes et leur environnement proche, elle fait l'hypothse inverse :
savoir que le passage l'acte est plutt la consquence de la dislocation pralable de ce lien
social l'gard de ceux qui vont en devenir les victimes.
Il ne s'agit donc plus de prendre en compte seulement la crise de l'tat
(problmatique n 1), mais bien plus profondment la crise de la socit elle-mme,
travers l'tude de ces liens sociaux et communautaires. Ainsi pourrait-on expliquer que le
massacre, loin d'tre toujours command par le haut , peut tout autant provenir de
l'initiative d'acteurs locaux. Les cas de massacres de juifs perptrs par les Polonais eux-
mmes, tel que celui du village de Jedwabne, tudi par Jan Gross (Gross, 2001) ou ceux
de Hutu contre leurs voisins Tutsi (ou des membres de leur propre famille) sont analyser
dans cette perspective9. Pour la Bosnie, Xavier Bougarel a montr comment, dans le
contexte de l'effondrement de l'tat fdral yougoslave, la socit bosniaque tait confronte
un problme de redfinition de la citoyennet ; ce qui a notamment eu pour effet de
remettre en question les rgles de bon voisinage entre communauts, codifies dans le
Comsiliuk hrit de l'Empire ottoman. Les conditions taient alors runies, selon lui, pour que
l'on bascule dans le crime intime : le viol des femmes et des maisons et le massacre de
leurs habitants (Bougarel, 1996).
Mais il reste vrai que c'est le contexte de la guerre qui a cristallis , dans la
pratique du massacre, cette violence potentielle entre voisins, souvent nourrie de
ressentiments anciens entre les communauts et les individus. cet gard, la pntration en
Bosnie des milices du type de celle d'Arkan, appuyes par des lments de l'arme
yougoslave, a presque toujours t le facteur dclenchant et acclrateur de la violence.
On est donc conduit penser le massacre tout la fois par le haut et par le
bas en situant cette analyse dans un contexte historique toujours particulier. Car s'il y a
impulsion par le haut du processus de destruction (dcision et organisation de
massacres), il s'agit aussi de savoir comment cette impulsion centrale est applique et
relaye par les acteurs locaux. On s'intressera alors une histoire spcifique des
massacres selon les rgions, comme l'a fait par exemple l'quipe d'Alison Des Forges au
Rwanda pour celles de Gikongoro et Butare, en tenant compte de l'histoire de ces rgions,
des structures du pouvoir local, du degr de cohsion entre groupes et communauts, de la
9 On sait que le livre de Jan Gross a suscit des vives polmiques en Pologne. Il est toutefois noter qu'un historien amricain, Timothy Snider, propose d'analyser ce massacre dans une autre perspective : celle peu connue du nettoyage ethnique entre Polonais et Ukrainiens au milieu des annes quarante. Voir son "working paper" sur le site : http://web.mit.edu/cis/www/migration/RRWP-9_Snyder.html.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
19
gographie et de la dmographie locales, etc. La manire dont l'anthropologue nerlandais
Marc Bax raconte l'histoire de la purification ethnique en Bosnie-Herzgovine, pratique par
les Croates, semble assez exemplaire de cette prise en compte de facteurs la fois centraux
et locaux : tout autant l'histoire locale de cette rgion que les interactions des acteurs dans le
conflit. Une telle tude est mettre en parallle avec celle effectue au Rwanda par Timothy
Longman sur les deux villages voisins de Kirinda et Biguhu, au moment du gnocide.
Longman disqualifie la thse de la "haine ancestrale" pour expliquer le passage l'acte
gnocidaire, de mme que celle d'une raction spontane de la population cherchant
venger la mort du prsident Habiyarimana. Il insiste plutt sur le rle des cadres
intermdiaires de ces villages qui voulaient tout prix conserver leurs privilges et sur celui
des jeunes chmeurs enrls dans les milices (Longman, 1995) ; une analyse qui est
rapprocher de celle de Roland Marchal sur les milices Mayi-Mayi au Kivu, constitues de
"bande de jeunes ruraux marginaliss par les transformations foncires" recourant des
formes de violence radicale pour des fins atomises et changeantes (Marchal 2000, 71).
En dfinitive, les pratiques de massacre sont des vnements complexes construits
tout autant par des acteurs centraux et locaux, les uns et les autres adaptant leurs conduites
destructrices en fonction de l'adhsion ou de l'intervention de tiers proches ou lointains. En
somme, le massacre est le produit d'une co-construction entre une volont et un contexte,
l'volution du second pouvant modifier la premire. Selon les ractions des victimes
(passivit, rsistance) et du contexte environnant, ceux qui ont enclench le processus de
destruction peuvent ajuster ou inflchir leur projet initial. Ils risquent tout autant d'enclencher
un processus de fuite en avant qui, au gr des acteurs locaux, absorbe des cibles non
prvues l'origine. Dans la France de Vichy, on pense par exemple Pierre Laval qui, de sa
propre initiative, propose de rajouter les enfants des parents juifs promis la dportation,
la suite de la rafle du Vel d'Hiv de 1942, ce que les nazis n'avaient pas demand. La fuite
en avant peut provoquer, dans d'autres circonstances, un phnomne de contagion des
massacres, l'instar de la guerre en Bosnie, o les pratiques de purification ethnique
finissent par gagner toutes les communauts serbe, croate et musulmane. Tout cela valide
l'approche du massacre comme un processus dynamique, certes organis, mais soumis
aussi certaines inflexions relativement alatoires.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
20
TUEURS DE CIVILS : MONSTRES ORDINAIRES OU BOURREAUX VOLONTAIRES ?
Ce qui vient d'tre dit ne permet pas encore d'apprhender le problme du passage
l'acte, l'chelle de l'individu, du tueur. Certes, l'approche dfendue ici, via l'tude du
processus de destruction, implique de toujours prendre en compte plusieurs types d'acteurs
dans la responsabilit du massacre : le dcideur qui ne tue pas, le propagandiste qui ne tue
pas davantage, l'organisateur qui tue rarement, et enfin les excutants qui, eux, sont les
vritables actants . Or c'est prcisment parce que ces excutants sont les oprateurs du
passage l'acte qu'il convient d'en faire une tude spcifique. Leurs conduites et motivations
concentrent en effet bien des problmes dj abords. Etude spcifique qui doit cependant
distinguer les positions diffrentes de ces tueurs dans le processus de destruction. En ce
sens, au moins quatre ensembles de tueurs de civils doivent tre distingus selon que
ceux-ci sont des soldats, des policiers, des miliciens ou des civils eux-mmes. Les travaux
de qualit sur chacun de ces ensembles de tueurs sont rares et ingalement proportionns
(on dispose plus de recherches sur des militaires et policiers que sur des miliciens ou civils).
En outre, ils portent surtout sur la destruction des juifs.
l'gard de ces tueurs, une premire question vient souvent l'esprit : ces individus,
qui en viennent tuer des hommes sans dfense, des femmes, des enfants, sont-ils des
tres normaux ou des monstres ?
La thse du sociologue Daniel Goldhagen, qui a soutenu l'existence d'un
antismitisme liminationniste puissant dans l'Allemagne des annes 30, accorde par
exemple un poids dterminant l'idologie : selon lui, ceux qui assassinent les juifs sont des
bourreaux volontaires parce qu'ils sont vraiment convaincus de la ncessit de ce qu'ils
font (Goldhagen, 1997). Mais cette explication monocausale a suscit de vives critiques
parmi les historiens, dont Jean Solchany a fait une bonne synthse (Solchany, 1997).
Nombre d'tudes montrent en effet que si la conviction de participer une uvre de
purification en dtruisant le juif est effectivement ancre dans l'esprit de certains
bourreaux, ceux-ci constituent une minorit. Pour rendre compte de l'implication du plus
grand nombre, il faut faire appel des facteurs autres qu'idologiques, comme l'a fait Omer
Bartov, afin de comprendre la participation de l'arme allemande au gnocide (Bartov, 1999).
Si celui-ci accorde videmment de l'importance l'antismitisme (dont on a sous-estim la
prsence parmi les militaires allemands), il insiste aussi sur les facteurs de situation : le
contexte de guerre totale, les directives du haut commandement, la division des tches qui
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
21
conduit laisser aux auxiliaires baltes les besognes les plus abominables, la peur de
l'ennemi sovitique, le sentiment de dracinement, etc.
Dans son chapitre final du livre Des hommes ordinaires, Christopher Browning
propose un tableau complexe des variables pr-formattant la conduite des policiers-
tueurs, dont on retiendra quatre facteurs. Le premier est celui de la soumission l'autorit,
au sens du psychologue Stanley Milgram (1974), laquelle de facto a constitu ce
groupe de policiers pour tuer des juifs, en commande les dplacements, en dtermine les
objectifs prcis, etc. Ce facteur de l'obissance est nanmoins relativiser dans la mesure
o il constitue un argument commun mis en avant par les bourreaux, ds lors qu'ils se
retrouvent comme inculps devant les tribunaux de justice. Argument d'autant plus
discutable que les quelques rares hommes qui n'ont pas voulu participer aux tueries n'ont
pas t sanctionns par leur hirarchie. Mais ce que Stanley Milgram met en vidence dans
ses expriences de psychologie sociale, ce sont prcisment les ressorts de l'obissance
une autorit non coercitive, perue comme lgitime. La conduite du tueur ne peut pourtant
pas se comprendre uniquement par cette seule insertion verticale dans un
fonctionnement hirarchique consenti. Ce que les travaux de Milgram ne montrent pas et ne
peuvent pas montrer, c'est le fonctionnement horizontal de ces tueurs : beaucoup ont en
effet cd la pression du groupe au moment mme de l'action. Ce conformisme de groupe
contribue limiter les conduites dviantes faisant valoir le modle de la fraternit virile
dont la force se mesure justement la capacit de tuer des civils. Ne pas lcher les
autres qui acceptent de faire le sale boulot semble ici plus dterminant en fin de
compte qu'obir aux ordres. Cette participation consentie aux tueries suppose alors une
dsidentification totale avec les victimes, compltement exclues de la communaut humaine;
mcanisme de dsempathie galement observable dans la guerre (Dower, 1986). C'est
ce dni de l'humanit de l'autre dtruire qui est, dans le cas de ces policiers allemands,
prpare par des annes de propagande antismite et nationaliste. Tous ces lments
n'empchent pourtant pas le choc psychologique traumatisant de la premire tuerie sur
les tueurs eux-mmes. C'est de ce choc initial que nat la brutalisation des hommes, non
l'inverse. Et s'ils parviennent ainsi s'endurcir , la tuerie devient une habitude : Comme
la vraie guerre, l'horreur de la premire rencontre finit par se muer en routine et la mise
mort d'tres humains est devenue de plus en plus facile (Browning, 1994 : 212).
Ce cadre d'analyse ne peut cependant tre appliqu toutes les situations de
massacres. Il peut certes aider comprendre la conduite d'autres policiers ou militaires dont
la mission est de procder des excutions de masse. Mais il est de peu d'utilit par
exemple pour analyser le fonctionnement de groupes de miliciens ou le comportement de
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
22
civils participant plus ou moins spontanment des tueries. En outre les policiers tudis par
Browning sont d'ge mr (beaucoup ont dans la quarantaine) et ne sont donc pas
reprsentatifs de bien des situations plus contemporaines. En effet, que ce soit au
Cambodge, au Rwanda ou en Bosnie, les tueurs sont en gnral bien plus jeunes, sans
responsabilits familiales, quand ils ne sont pas adolescents. En fait, les procdures de
recrutement des tueurs de masse et leurs motivations peuvent tre trs diffrentes d'une
situation une autre. Les pouvoirs peuvent tout autant s'appuyer sur des forces militaires ou
policires (qu'ils dtournent de leurs missions fondamentales) que sur des groupes et milices
ad hoc, constitus aux seules fins du massacre et du pillage. Dans ce but, certains pouvoirs
n'hsitent pas librer des prisonniers de droit commun, comme ce fut le cas dans le
gnocide armnien et la purification ethnique en Bosnie, en leur fixant pour mission de tuer
et/ou chasser les civils, tout en ayant la possibilit de piller leurs biens en guise de
rcompense. Comme le note John Mueller, The relationship of such behavior to
nationalism and to ethnic hatred, ancient or otherwise, is less than clear. Its relation to
common criminality, however, is quite evident (Mueller, 1999 : 17). De tels mobiles
conomiques semblent parfois dterminants dans la conduite de certains tueurs, au point
que l'on a parl au Rwanda d'un genocide business. Mais dans d'autres exemples,
l'appropriation des richesses est quasi absente, comme au Cambodge, les Khmers rouges
excrant les biens de consommation de la socit capitaliste et rejetant simultanment le
principe de la proprit prive.
Cette multiplicit des variables influenant le passage l'acte individuel, ici mais non
l, est droutante pour le chercheur qui voudrait tablir des lois gnrales. Il est fort
difficile de hirarchiser ces facteurs du passage l'acte, comme le montrent des tudes
anthropologiques sur les trajectoires des bourreaux10. En outre, ce qui est vrai pour un
individu un moment prcis ne le sera pas pour un autre. En fait, les auteurs d'un massacre
peuvent tre anims par des mobiles qui ne sont pas en rapport avec la lgitimation politique
de celui-ci et rechercher des bnfices qui leur soient propres. Ce qui reste certain, et plutt
consternant d'un point de vue moral, c'est la facilit dconcertante avec laquelle l'individu
peut rapidement basculer dans le meurtre de son semblable, ds lors que les circonstances
sociales favorisent un tel passage l'acte. Pour expliquer ce phnomne, certains auteurs
comme John Steiner ont utilis la mtaphore du dormeur potentiellement assassin, qui
sommeille en chaque individu, et qui peut tre activ dans un contexte propice, puis revenir
nouveau un tat de latence (Steiner,1980). Le sociologue Zygmunt Bauman considre
cependant que cette conception psychologique du dormeur est une bquille mtaphysique
10 Voir ce propos le comptre-rendu de la runion du groupe CERI "Faire la paix" qui a port sur "les trajectoires individuelles des bourreaux" (15 novembre 2001).
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
23
inutile qui ne peut remplacer le constat que la cruaut est fondamentalement d'origine
sociale (Bauman, 1989).
En ce sens, une piste de recherche fconde consiste explorer la manire dont un
individu devient tueur de masse en fonction des normes sociales et culturelles du pays ou du
groupe communautaire dans lequel il a grandi. Autrement dit, au sein d'une socit o la loi
n'est plus du tout l'interdit du meurtre mais l'incitation au meurtre, comment un individu
particulier peut-il grimper dans la hirarchie sociale en fonction de ces nouvelles normes
et comment intgre-t-il les conduites encourages par le pouvoir son propre hritage
culturel ? Deux types de travaux me semblent ici particulirement pertinents. L'entretien
biographique tel que celui ralis par Guita Sereny avec Frantz Stangl, l'ancien commandant
des centres d'extermination de Sobibor et Treblinka. En effet, ce travail d'une qualit
remarquable, entrepris aprs que le procs de Stangl ait t achev11, permet de
comprendre l'engrenage infernal dans lequel s'est engag ce policier autrichien, m par un
fort dsir de reconnaissance sociale (Srny, 1974). Par ailleurs, des tudes
anthropologiques telles que celles menes par Alexander Hinton sur les Khmers rouges
aident aussi comprendre comment des modles culturels pr-existants peuvent servir
de tremplin la violence de masse (Hinton, 1998). Une telle approche prolonge celle de
Ren Lemarchand (problmatique n 2), mais au niveau de l'individu. Ainsi, Alexander
Hinton s'intresse-t-il l'histoire d'un paysan khmer, Lohr, ancien soldat du tristement
clbre centre de dtention de Tuol Sleng, lequel admet avoir tu de sa main environ 400
prisonniers12. Hinton tente d'expliquer sa conduite en montrant, travers la trajectoire de
Lohr, comment les codes de l'honneur et de l'obissance, propres la culture khmre, ont
t utiliss par l'idologie d'inspiration maoste pour l'entraner tuer sans scrupules ses
ennemis .
Or, ce qui est frappant dans ces deux itinraires, appartenant des univers culturels
compltement diffrents, c'est non seulement la culture de l'obissance (importante dans ces
deux socits) mais ce que disent ces deux hommes de leurs propres processus de
basculement dans la violence. Ils semblent oublier leurs responsabilits dans l'excution
d'une mort de masse pour ne retenir qu'un vnement personnel traumatisant, qui se situe
en amont ou au dbut de ce processus. Chez Frantz Stangl, c'est le moment o, en 1938,
les nazis lui ont demand de renoncer officiellement sa religion catholique. Il a d signer
11 Dtail trs important car alors l'interview n'a plus conformer ses propos en fonction d'une ligne de dfense qui pourrait diminuer sa peine. 12 Certains tmoignages prtendent qu'il en a tu en fait prs de 2 000.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
24
une dclaration en ce sens et, ses yeux, ce fut un pas considrable vers sa corruption
ultrieure : comme s'il avait alors vendu son me . C'est sur ce seul point qu'il se
reconnat responsable : C'est alors que tout a commenc pour moi (Sereny : 42). Quant
Lohr, il avoue d'abord Hinton qu'il n'a tu qu'un ou deux hommes. Ce qu'il lui raconte tout
de suite c'est son premier meurtre, comme si cet vnement avait conditionn tous les
autres, tout ce qui allait suivre et ce qu'il n'osait dire. La scne ressemble une sorte de rite
d'initiation : ce fut le jour o son chef, en prsence d'autres camarades, lui demanda s'il
avait dj tu quelqu'un. Comme il lui rpondait que non, il lui intima l'ordre d'excuter un
prisonnier. Lohr estime alors ne pas avoir t en position de refuser et, tuant son premier
homme, il se savait regard par tous.
Dans les deux cas, l'engrenage dans lequel les deux hommes s'enfoncent provoque
une sorte de dissociation de leurs personnalits fonde sur un dsengagement affectif total
envers leurs victimes. Significative cet gard est la question immdiate pose Lhor par
son chef, aprs qu'il ait tu son premier homme : As-tu le cur sec ? ; ce que Lohr
retraduit en ces termes : Je devais couper le robinet des sentiments (Hinton : 94). Chez
Stangl, le processus de distanciation semble particulirement puissant : dirigeant un centre
de mise mort, il semble ne jamais avoir voulu voir la mort, en construisant en son for
intrieur une sorte de barrire psychique qui le maintenait distance de l'horreur du camp,
dont il tait pourtant le majordome. Devenir ainsi tueur de masse, que l'on soit chef ou
excutant, n'est-ce pas subir aussi un processus de dgradation psychique assimilable
une forme de dshumanisation ? C'est l une manire de rejoindre la question de la zone
grise souleve par Primo Levi, dans laquelle se retrouvent bourreaux et victimes, crass
par un mme systme qui anantit leur humanit (Levi, 1989 : 53). Certes, de tels
rapprochements sont faire avec prudence dans la mesure o il n'y a pas galit de destins
entre les uns et les autres : les victimes sont promises la mort, non les bourreaux, du
moins peu souvent.
La notion de zone grise prsente cependant le grand intrt de casser les
reprsentations manichennes du bourreau et de sa victime pour nous entraner penser la
complexit de ce binme dans un processus commun de destruction.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
25
SENS ET NON-SENS DES ATROCITES
Peut-on enfin comprendre les atrocits associes au massacre ? Si le but est de
dtruire des civils en masse, on ne voit pas pourquoi en plus les faire souffrir, les humilier,
les mutiler avant que de les tuer. D'o cette question encore pose par Primo Levi :
Pourquoi cette violence inutile ? (Levi, 1989). Il est vrai que celle-ci caractrise surtout
les massacres de proximit, puisque le principe de ceux qui sont provoqus distance
(comme le bombardement arien) est d'abord de causer des destructions quantitatives (faire
le plus de dgts et de victimes possibles)13.
Pourquoi la proximit produit-elle donc de la cruaut avant, pendant et mme parfois
aprs le massacre ?
Doit-on privilgier un schma d'analyse par le haut , en faisant valoir par exemple
l'intention stratgique, ou bien un schma par le bas , partir de l'tude des relations
bourreaux-victimes ? Je dfendrai encore ici une approche dialectique. Par le haut : car c'est
bien le pouvoir qui cre les conditions de dveloppement des atrocits. Avant le massacre
(et mme pendant), son premier outil est la propagande. Ici encore, on retrouve
l'instrumentalisation de l'imaginaire (vocation d'atrocits commises par l'ennemi) et
l'incitation plus ou moins ouverte et dguise (ceci dpend des circonstances et de qui parle)
en faire autant pour se venger : Ils nous ont fait a ; donc on peut leur faire a . De la
sorte, cet imaginaire de cruaut peut lgitimer en retour d'en faire autant : mais cette fois-
ci pour de vrai : du coup, il y a bien passage l'acte, pour ainsi dire du fantasme
l'action.
Le pouvoir joue encore un rle incitatif en couvrant les excutants, c'est--dire en
les assurant qu'ils peuvent agir au-dessus des lois sans risque de reprsailles. Ce
sentiment d'impunit est dj cr par la situation du huis clos, dans laquelle se droule en
gnral le massacre : pas de tmoin. Mais le message peut tre ouvertement adress
ceux qui sont ou vont devenir les bourreaux : Vous pouvez faire ce que vous voulez. Car
la perptration d'atrocits au cours du processus de destruction des civils peut elle-mme
avoir une vise tactique ou stratgique. Ainsi, au cours de la guerre en Bosnie, les cas de
13 Encore que la technologie des bombes dites anti-personnelles vise prcisment mutiler sans tuer, ce qui est une manire de provoquer distance une forme premire d'atrocit.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
26
viols de masse ont t interprts comme des pratiques intentionnelles servant l'objectif du
nettoyage ethnique. L'anthropologue Vronique Nahoum-Grappe a parl en ce sens d'un
usage politique de la cruaut (Nahoum-Grappe, 1996). En fait, tout dpend des objectifs
recherchs par le pouvoir. Le recours aux atrocits peut indistinctement s'intgrer dans une
dynamique de soumission ou d'radication des civils. Le procd est toujours le mme : faire
un exemple pour effrayer c'est--dire frapper l'imaginaire , de telle sorte que celui qui
possde cette puissance d'effroi obtienne ce qu'il veut de l'autre/ennemi : soit sa fuite, soit
sa soumission.
Cette approche instrumentale des atrocits est cependant loin d'en apprhender
toute la complexit. Il convient aussi de les tudier par le bas , ne serait-ce qu' partir de
l'analyse des rumeurs qui circulent dans une socit en crise. En effet, ce qui vient d'tre dit
du rle de la propagande aurait pu d'abord tre formul au sujet des rumeurs colportes sur
l' ennemi . De ce point de vue, le rle de la rumeur dans les priodes de guerre et/ou de
massacres des civils est-il vraiment si diffrent ? Marc Bloch s'est intress ce phnomne
apparu dans la Premire Guerre mondiale, notamment la rumeur qui disait que les
Boches coupaient les mains aux enfants . Les soldats allemands avaient certes commis
des atrocits contre les civils mais pas celle-ci. C'tait l'une des plus horribles, sinon la plus
horrible, qui tait retenue par la population. Mais elle tait fausse (Bloch, 1999). La fonction
de ces rumeurs est de donner une interprtation du conflit en diabolisant l'ennemi. Par l
mme, les activits de propagande peuvent puiser dans le fonds des rumeurs pour lgitimer
l'avance la destruction de l'ennemi, en lui faisant subir son tour les horreurs qu'il a
commises sur des innocents.
Mais les conditions mmes du massacre de proximit, impliquant de facto le
rapprochement physique des bourreaux de leurs victimes, n'est-elle pas ncessairement
propice au dveloppement d'atrocits ? C'est l une hypothse galement releve par Jean-
Pierre Derriennic au cours de son analyse des guerres civils (Derriennic, 2001 : 83-84).
Mme si l'ennemi est dpeint par la propagande sous des traits hideux et dangereux, il garde
une face terriblement humaine. Ne serait-ce pas alors la raison pour laquelle il faut vite
dfigurer cet autre semblable pour parer tout risque d'identification ? Pouvoir le tuer
implique donc de le dshumaniser, non plus seulement par l'imaginaire de la
propagande, mais maintenant, en actes : en mutilant son corps, en le dmembrant, en le
brlant, etc. En somme, ce serait la proximit qui cre la cruaut, ce qui peut susciter
comme une fuite en avant vers la sauvagerie, pour juguler toute virtualit d'empathie entre le
bourreau et sa victime. En ce sens, la pratique cruelle est vritablement une opration
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
27
mentale sur le corps de l'autre visant briser son humanit. Selon la psychologue Franoise
Sironi, c'est l'essence mme de la torture (Sironi, 1999).
Si donc les pratiques de cruaut s'enracinent dans le psychisme des bourreaux, alors
celles-ci se caractrisent par des traits culturels spcifiques. Sans doute le sociologue
Wolfgang Sofsky a-t-il raison d'observer comme un universel du massacre (Sofsky,
1998). Mais la manire de massacrer et de faire souffrir avant le massacre n'est-elle pas
avant tout un acte culturel comme le suggre l'anthropologue Arjun Appadura ? Selon lui, la
violence contre les corps n'est jamais vraiment alatoire, prenant un sens prcis dans les
contextes culturels o elle se dveloppe : It is clear that the violence inflicted on the human
body in ethnic contexts is never entirely random or lacking in cultural form [] It becomes
clear that even the worst acts of degradation involving faeces, urine, body parts ;
beheading, impaling, gutting, sawing ; raping, burning, hanging, and suffocating have
macabre forms of cultural design, and violent predictability (Appadura, 1998 : 909). Les
pratiques cruelles seraient donc pour le bourreau une faon d'affirmer sa propre identit sur
le corps de ses victimes, ce qui peut aussi impliquer de les contraindre transgresser leurs
propres tabous culturels. C'est une autre manire de dtruire les victimes avant de les tuer.
Ainsi comprise, la perptration d'atrocits serait donc le moyen pour le bourreau de
crer une distance psychique radicale avec les victimes, de prouver de facto ce qu'il
croit dj ou ce qu'il se doit de croire : que ce ne sont pas des tres humains. Notons que,
s'il n'y parvient pas, il s'expose alors tre psychiquement atteint par l'humanit de ses
victimes. Il risque alors de craquer , pouvant basculer dans une forme de dpression ou
de folie. C'est notamment pour de telles raisons que les nazis ont mis fin aux procdures de
tueries de masse ( la mitrailleuse) pratiques par les Einsatzgruppen, pour les remplacer
par des procds plus industrialiss de mise mort (les chambres gaz). Mais mme en ce
cas, le dispositif devait prvenir l'ide que l'on tuait des tres humains. la question pose
par Guita Sereny l'ex-commandant de Sobibor et Treblinka : Puisque vous les auriez
tous tus, quel sens avaient ces humiliations ? , Frantz Stangl rpond : Pour conditionner
ceux qui devaient matriellement excuter les oprations, pour leur rendre possible de faire
ce qu'ils faisaient (1974 : 107.). Autrement dit, les atrocits ont ici un usage clairement
fonctionnel : celui de mettre en condition les futurs bourreaux.
Par-del la rpulsion qu'elles suscitent, s'interroger sur les atrocits ne doit-il pas
enfin nous conduire envisager une approche plus gnrale et quelque peu drangeante :
celle du plaisir que celles-ci peuvent procurer au bourreau ? On le sait, on l'admet : Si les
pratiques de violence sont si rpandues au point quelles semblent inhrentes la condition
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
28
de l'homme, c'est aussi parce qu'elles lui donnent du plaisir, un plaisir certes malsain,
ambigu , comme l'a not la psychologue Denise Van Caneghem (1978). Humilier l'autre et
plus encore le faire souffrir peut apporter une forme de jouissance : soit disposer
sexuellement de son corps, soit martyriser ce corps de diverses manires avant que de
l'anantir. Serait-ce du sadisme ? Au sens psychiatrique du terme, les bourreaux n'ont pas
une personnalit sadique (sauf une infime minorit), nous dit par exemple Bruno Bettelheim
(Bettelheim, 1972). Mais la situation dans laquelle le bourreau se trouve plac, celle de
pouvoir transgresser tous les tabous, lui procure l'ivresse de la toute-puissance sur sa
victime. Cette abolition de la loi, qui fait du rapport bourreau-victime une relation antisociale
par dfinition, permet le dveloppement chez les individus de conduites sadiques et
perverses, particulirement jouissives. Dans son beau texte sur la torture, l'ancien rsistant
et dport Jean Amrie n'hsite pas crire en ce sens que la comprhension profonde de
ce qu'il a lui-mme vcu (ayant t tortur par les nazis) ne lui est pas fournie par la
psychologie : Mais selon les catgories eh bien oui : de la philosophie du marquis de
Sade (Amrie, 1995 : 71). Et de citer l'uvre du philosophe Georges Bataille (qui a
travaill les crits de Sade), pour qui le sadisme ne doit pas tre compris comme une
psychologie sexuelle mais plutt comme une psychologie existentielle ayant pour principe la
ngation radicale de l'autre.
Cette rfrence peut surprendre. Mais nos recherches en histoire, sociologie ou
science politique ne reviennent-elles pas parfois mettre au jour des questions que la
littrature, et plus gnralement l'art, ont dj explores ? Ne serait-ce pas ici le cas de
l'uvre maudite de Sade ? Dans Justine, il dcrit bien cette ivresse de la violence que
procure le plaisir de la souffrance inflige aux victimes : d'o le besoin de recommencer
jouir de leurs humiliations et de leurs cris avant de les tuer. Et puis recommencer encore sur
d'autres corps, sur d'autres proies. Ces phnomnes de violences nous semblent si
complexes que leur apprhension justifie cet clairage de la littrature et singulirement de
la littrature compare (Coquio, 1997), tout comme les travaux qui s'en inspirent, en premier
lieu l'uvre de Ren Girard (Girard, 1972, 1982).
L'acte violent, et plus encore l'acte cruel, peut susciter tout la fois l'horreur et la
fascination, ce dont la cration artistique sait jouer tout particulirement ; non seulement
travers le rcit littraire, mais aussi la mise en scne cinmatographique ou le gnie d'une
peinture. Cette esthtique de la violence est de nature provoquer des sentiments
quivoques puisque, si l'uvre est russie, celle-ci suscitera la fois l'motion de la beaut
et la sensation de l'effroi.
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
29
* * *
Ds lors, comment le chercheur peut-il se dprendre lui-mme de ces rapports
ambigus? Pas facile pour lui de ne pas tomber sous l'accusation de voyeuriste (Audoin-
Rouzeau, 2002). Il se donne certes le droit de regarder la violence pour en faire l'analyse
au plus prs. C'est d'ailleurs par l que se constitue une anthropologie du geste violent dans
la guerre (Bourke,1999, Audoin-Rouzeau et Becker, 2000). Mais la difficult pour lui est bien
de trouver la bonne distance de manire ne pas se laisser absorber par son objet.
Va-t-il par exemple adhrer au rcit d'atrocits que lui proposera tel ou tel tmoin ou
acteur de l'vnement? Qu'il dpouille des archives ou mne des enqutes de terrain, le
chercheur est en effet rarement l au moment mme de l'acte violent dont il prtend pourtant
faire l'analyse. Son travail de chercheur se situe presque toujours a posteriori, comme l'a
soulign l'anthropologue Clifford Geertz (1995). Ainsi, comment doit-il dcrypter le rcit
d'horreurs sachant par ailleurs que le temps de guerre est prcisment propice au
dveloppement et la propagation de rumeurs? Pour Batrice Pouligny, le chercheur ne
peut prtendre retracer objectivement ce qui s'est pass . Il doit plutt prendre au
srieux la manire dont les personnes et groupes concerns l'ont compris et expliqu
subjectivement et empiriquement (Pouligny, 2002). Cette approche est d'autant plus
importante que le massacre, de par sa nature traumatique, engendre des mmoires
contradictoires et conflictuelles. Mais le chercheur doit-il pour autant rester distance de
tous les rcits qui lui sont proposs, y compris de ceux qui nient la ralit des massacres,
leur importance ou leur caractre organis ?
La comprhension des massacres implique ncessairement de les resituer dans leur
contexte historique et culturel. Ce travail de contextualisation est dcisif pour se dtacher
d'une analyse du massacre qui en isolerait la forme et la nature. C'est bien cette mise en
contexte et donc, l'tude du jeu des acteurs , de la structure de leurs conflits, qui donne
sens au massacre et qui permettra d'en construire un rcit analytique par-del la varit de
ses mmoires. Prenant l'exemple des massacres perptrs contre les Armniens au sein de
l'empire ottoman, l'historien Marc Levene en distingue ainsi trois significations diffrentes :
les massacres partiels de 1895-1896 commis sous le sultan Abdul-Hamid, le gnocide
proprement dit des annes 1915-1916 et les massacres post-gnocidaires dans l'Est de
l'Anatolie la fin de 1917. Dans ces trois pisodes, remarque-t-il, les formes de violence
-
Questions de recherches / Research in question n 7 Septembre 2002 http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm
30
peuvent souvent tre comparables. C'est le contexte historique qui seul permet d'en
diffrencier la signification et la porte politique (Levene, 2002).
La contextualisation culturelle est tout aussi dterminante pour comprendre les
reprsentations mentales des auteurs d'un massacre et les formes que celui-ci peut prendre.
L'analyse des mythes, codes et lgendes propres une culture aide en effet interprter les
modes de la violence, la nature des atrocits, etc. Sur ce plan, le regard de l'anthropologue
est fondamental. Au dbut des genocide studies, les recherches ont surtout port sur des
macro-facteurs , historiques, politiques, conomiques, structurels, ce dont le livre d'Alex
Alvarez propose une synthse intressante (2002). Mais encore faut-il chercher
comprendre comment ces macro-facteurs s'enracinent dans la ralit locale d'une culture
pour conduire effectivement un massacre et plus encore un gnocide. A cet gard, les
travaux les plus novateurs proviennent aujourd'hui des anthropologues, comme en
tmoignent les rcents ouvrages publis sous la direction d'Alexander Hinton (2002 a et b).
Les rgimes gnocidaires, nous dit ce dernier, s'appuient sur des codes et savoirs culturels
prexistants pour lgitimer leurs propres normes idologiques en leur donnant des
rsonances familires et contraignantes . C'est pourquoi les auteurs des massacres ne
doivent pas tre perus comme de simples automates obissant aux ordres de leurs chefs.
Les rgimes gnocidaires mlangent le vieux avec le neuf de manire ce que leur
idologie fasse sens pour les gens et soit efficace (Hinton, 2002 a : 11). C'est peu prs
dans les mmes termes que Franois Bizot interprte, dans Le portail, la violence de masse
des Khmers rouges, partir des structures traditionnelles de la socit cambodgienne (Bizot,
2000).
Mais par-del cette indispensable contextualisation, on ne comprendra rien au
massacre si on ne le voit pas comme le produit monstrueux d'une dynamique d'extrme
violence, dont la matrice principale reste la guerre. C'est en effet la guerre qui rend optimales
les conditions





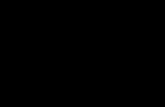












![TLE ANALYSER · TLE ANALYSER User Manual v2.8 TLE analysis ... TLE ANALYSER Version 2.8 - 2013 TLE ANALYSER - User Manual [4] 2. TLE Analyser Setup and Options TLE Updater allow to](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5aa68a5c7f8b9a517d8ea13c/tle-analyser-analyser-user-manual-v28-tle-analysis-tle-analyser-version-28.jpg)

