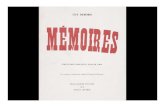ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES …faseg.net/includes/memoires/2010/MA_G_2010_0049.pdf · La NATRAC...
Transcript of ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES …faseg.net/includes/memoires/2010/MA_G_2010_0049.pdf · La NATRAC...

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
1
INTRODUCTION
Le développement économique et social des pays les moins avancés, membres de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), constitue un défi majeur tant pour les Pays
Moins Avancés (PMA) eux même que pour la communauté internationale. Ce qui caractérise
surtout les pays les moins avancés, c’est d’une part, leur vulnérabilité face aux conditions
économiques actuelles, et d’autre part, leurs contraintes : un capital humain sous exploité ,
une capacité productive réduite , une autonomie limitée des institutions face aux pouvoirs
exécutifs , l’insuffisance d’infrastructures (scolaire, sanitaire et routière) , la petitesse des
marchés ,un accès limité aux technologies de l’information et de la communication et les
handicapes géographiques tels que les sols peu productifs, les bouleversements climatiques.
Dans un tel environnement, les entreprises sont confrontées à de nombreuses
difficultés liées à leur performance et à leur survie, auxquelles s’ajoutent les effets néfastes de
la mondialisation des marchés. Dès lors elles sont confrontées à de nombreux défis tels que :
la concurrence intensive, les turbulences de l’environnement économique mondial, auxquelles
leur performance est très sensible. En effet, la création de grands espaces économiques est
d’actualité dans le monde. Avec l’élargissement de l’Union Européenne, la dynamisation de
l’Union Economique Et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), l’adoption du New Partenariat
For Africa Development (NEPAD), on assiste progressivement à la disparition des barrières
douanières marquée par l’adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) et à la naissance d’une
véritable zone de libre échange entre les pays membres de l’UEMOA. Ce nouveau cadre
contraint les entreprises de la sous région Ouest Africaine quelque soit leur dimension à voir
s’ouvrir leur marché à des concurrents potentiels mais aussi et surtout à s’armer pour saisir
les opportunités qui s’offrent à elles et réduire les menaces auxquelles elles seront confrontées
pour leur survie. Elles doivent alors redéfinir leurs objectifs en termes de productivité et de
qualité de service et adapter leur orientation stratégique aux nouvelles réalités économiques.
Depuis plusieurs décennies, dans le but d’améliorer la performance des organisations,
de nombreuses études ont été consacrées à la recherche des moyens et techniques de gestions
optimales. Et bien d’auteurs (Mayer et Goldstein, 1961; Bédard, 1977; Clute, 1979;
McKinlay, 1979; Robidoux, 1980; Daigne, 1984; D'Amboise et Gasse, 1987) affirment que la
cause principale des faillites d'entreprise est liée à la mauvaise gestion.
Par ailleurs, il est généralement admis que le niveau de vie et le taux de révolution
économique sont déterminés par le degré de productivité de la communauté nationale. Au sein
de ce vaste système, l'activité du bâtiment et travaux publiques détient une position-clé parce

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
2
que d'une part, le travail, les matériaux, les équipements et l'organisation de chaque pays
constituent un élément capital de l'input global de la communauté et, d'autre part, les
bâtiments et travaux publics (BTP) sont indispensables à toutes les autres activités
productives nationales et à tous les membres de la communauté (Fjosne, 1962: 17)
En effet, aucune croissance de production industrielle ne peut être envisagée sans le
développement parallèle des BTP. Face à une telle importance, il n’est donc pas surprenant
que le secteur BTP suscite l’intérêt tant des industriels que des chercheurs en économie et en
gestion et des autorités dans leur vision de développement.
C’est pour appréhender la problématique de ce secteur et apporter quelques pistes de
solutions que nous avons choisi de réfléchir sur le thème : « Analyse de la performance des
entreprises du secteur des BTP : cas de la NATRAC SA ».
Pour mieux appréhender le concept de la performance dans le B.T.P., le plan de notre
recherche est organisé en trois chapitres. Un premier s’est consacré au cadre contextuel de
l’étude, ensuite vient le chapitre réservé au cadre théorique et approche méthodologique ; puis
s’ensuit l’analyse empirique.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
3
Ce chapitre est essentiellement consacré à la présentation de notre cadre de
recherche (la société NATRAC), à l’importance du secteur des BTP et à ses particularités.
SECTION 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE NATRAC
Dans cette section, nous avons procédé à une présentation succincte de la NATRAC
SA.
Paragraphe1 : Historique et mission
Dans ce paragraphe nous avons retracé l’historique de la société et la mission qu’elle
c’est assignée.
A. Historique
Créée le 08 Avril 1987 en république du Bénin au capital de 10.000.000 par Monsieur
SOKOU M. Nestor son actuel Président Directeur Général, la NATRAC, Société à responsabilité
limitée (SARL), est enregistrée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) sous le N°
14371-B. Elle a pour activités principales l’organisation et la réalisation de tous travaux publics
et de construction. Mais également des activités secondaires que sont le Commerce général, la
gestion des postes de péage, vente de pavées et la location des engins lourds.
Grâce au dynamisme, au savoir-faire et à l’esprit d’entreprise de son PDG et son DG,
Mme SOKOU Philomène, soutenu par son personnel, la NATRAC a procédé Le 23/02/1994,
compte tenu de l’accroissement de ses activités à une augmentation de son capital qu’elle a porté
à 100.000.000, soit un accroissement de 1000%, au changement de son statut et est devenue une
société anonyme, mais continue d’exercer les mêmes activités sous le nouveau N° M2/94-14371.
Ensuite, le capital a été porté à 500.000.000, soit une augmentation de 500%.
B. Mission de la NATRAC, ses activités et ses ressources
Cette rubrique est consacrée à sa mission, à ses activités et ses ressources.
1. Fiche signalétique
Raison sociale : Nouvelle Agence pour Travaux de Construction
CHAPITRE 1 : CADRE CONTEXTUEL DE L’ETUDE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
4
Sigle usuel : NATRAC SA
Siège social : Carré 758 Gbégamey
Adresse : 03 BP 1753 Cotonou
Téléphone : 0022921350216
Fax : 0022921350029
E-mail : [email protected]
Statut : Société anonyme
Régime fiscal : Droit privé
Capital social : 500.000.000
N° d’Identification Fiscale Unique : 3200700088112
N° INSAE : 2955000040441
Date de démarrage effectif des activités : le 08 Avril 1987
Activité principale : organisation et réalisation de tous travaux publics
et de construction (les infrastructures routières ;
les dalots et les voies pavées)
Activités secondaires : Gestion des postes de péage, vente de pavées,
la location des engins lourds et le commerce
général
Nationalité : béninoise
2. Mission
La NATRAC est une société anonyme qui a pour objectif principal de contribuer à
l’amélioration de l’état de praticabilité du réseau routier béninois.
3. Importance économique, ses clients, ses concurrents
Nous allons aborder à présent l’importance économique de la société, ses clients et ses
concurrents.
3.1. Importance économique
En tant qu’unité de production, les activités de la société NATRAC lui permettent de
contribuer dans une certaine mesure à l’accroissement du PIB avec en moyenne, une valeur
ajoutée annuelle de 206.565.935 soit un pourcentage de 0,09% du PIB sur la période
quinquennale de 2004-2008 pour un chiffre d’affaires moyen de 692.955.606 par an. Elle

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
5
contribue également à l’accroissement des recettes fiscales en reversant à l’administration
fiscale un impôt BIC moyen de 11.27 4.043,5. Au plan social, elle crée en moyenne 140
emplois sur la même période.
3.2. Ses clients
Le principal client de la société NATRAC est l’Etat pour qui elle réalise des routes en
terre, des dalots, des voies pavées. Elle lui assure également la gestion de certaines
infrastructures routières telles que le poste de péage de Grand-Popo, de Sirarou et de
Kpédekpo. Mais elle fait des prestations de service telles que la fabrication des pavées, la
location des engins lourds aux particuliers et à ses concurrents.
3.3. Ses concurrents
Exerçant son activité dans un environnement concurrentiel, elle partage le marché
avec d’autres entreprises telles que :
• AGETIP Bénin - Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public
• AGETUR - Agence d'Exécution des Travaux Urbains
• Sogea Satom
• Edil Group
• Franzetti Benin (Groupe Sade)
• Colas Bénin
Paragraphe 2 : Structure organisationnelle et opérationnelle
La structure organisationnelle et opérationnelle de la NATRAC est de type pyramidal
allant du PDG jusqu’au ouvriers comme le montre l’organigramme en annexe 4
SECTION 2 : IMPORTANCE ET PARTICULARITES DES BTP
L’une des activités importantes de l’économie d’un pays reste incontestablement la
construction. De prime abord, soulignons que le secteur des BTP se subdivise en trois sous-
secteurs: le gros - œuvre, le second - œuvre et les travaux publics. Représentant environ 40%
de l'activité de construction du bâtiment, le gros-œuvre désigne l'activité qui consiste à bâtir la
structure même du bâtiment. Le second œuvre regroupe les activités liées à la mise en place
des équipements et aux finitions. Les travaux publics, quant à eux, correspondent au travail de
génie civil.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
6
Dans ses spécificités, la production est tout à fait particulière pour quatre types
essentiels de raison :
- La production est immobilière et fabrique des biens durables. Il est donc exclus de déplacer
les biens, qui doivent être réalisés sur place, dans des conditions difficiles et, en tout cas,
éloignées de celles d’une usine. Il est aussi impossible de stocker les produits finis. Quant à
la commande, elle doit toujours précéder la réalisation du travail. Il faut aussi rechercher la
meilleure mobilité des moyens de production. Ces différents facteurs provoquent d’importants
décalages entre l’offre et la demande qui sont à l’origine de crises qui secouent le secteur.
- Les travaux sont diversifiés à la fois dans leur nature et dans les moyens qui doivent être mis
en œuvre pour les réaliser. Ceci empêche toute standardisation et nuit à la stabilité et au plein
emploi du matériel de l’entreprise.
- Les travaux sont soumis à des aléas dûs à la grande mobilité de la main-d’œuvre, ce qui pose
des problèmes de qualification.
- Le niveau de la production est très dépendant de la politique des pouvoirs publics. Non
seulement ceux-ci constituent la principale clientèle du secteur, mais encore l’Etat décide de
la politique du crédit auquel le secteur est très assujetti.
Faisons remarquer aussi que l'analyse complète de l'activité du secteur des BTP
entraînerait un énorme travail en raison de la multiplicité des processus de production
impliqués qui demanderaient à être étudiés séparément. Il est très difficile de trouver un
critère de base valable permettant de comparer des processus de production aussi différents
que la construction de ports et de barrages hydroélectriques, ou celle de routes et de
logements.
Dans cette section, nous nous sommes limités à une analyse succincte de l'importance
des BTP dans l'économie nationale, ses intervenants et leurs caractéristiques et en dernier
point du processus de travail dans ce secteur
Paragraphe1 : Importance du secteur BTP dans l’économie nationale
Le secteur BTP tant par le volume de sa production et le nombre d'emplois qu'il offre
que par les masses de capitaux qu'il mobilise occupe dans l'économie nationale une place qui
reste fondamentale. En France, par exemple, le bâtiment à lui seul a connu en 1987 une
production équivalant une fois et demie à celle de l'automobile et du matériel de transport
réunis. Il a en outre employé 6 % du total de la population active et 25 % de la population
active de l'industrie (Cavallini et Raffestin, 1988: 13). Au Burundi, par exemple, la production

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
7
du secteur de construction en 1992 a représenté environ 5% du PIB; le nombre d'emplois
créés dans le secteur s'élevant à environ 11 000. Pour la période du 5ème plan quinquennal de
développement économique et social (année de début: 1990), les investissements dans le
secteur de construction ont été estimés à environ 84 milliards de francs burundais,
représentant 53% du total des investissements. Au Bénin1, la production du secteur de
construction sur la période quinquennale de 2004-2008 représente en moyenne environ
4,46% du PIB; et pour l’année 2008 plus particulièrement, sa contribution au PIB est de
6,32%, le total des investissements dans ce secteur pour le compte de l’année 2008 est de
10,35 % par rapport aux investissements totaux au plan national. Le nombre d'emplois créés
dans le secteur est non négligeable et le niveau des investissements ne cesse de croître
d’année en année.
Par ailleurs, le développement de ce secteur a un grand effet d'entraînement favorable
sur l'ensemble des autres secteurs de l'économie nationale. Il est, en effet, un client important
des industries du bois et de ses dérivés, de la mécanique, de la fonderie, des industries du
travail des métaux, des industries de la parachimie, du caoutchouc, des produits pétroliers, des
matières plastiques et du matériel électrique. Selon Alain Boublil (cité dans Du Tertre, 1989:
131) le coefficient multiplicateur de ce facteur d’entraînement est proche de deux. Ce qui
signifie qu'un million de francs dépensé dans le secteur BTP engendre un million de
demandes supplémentaires dans l'appareil de production, sous l'hypothèse restrictive que les
capacités de production nécessaires à ce supplément d'activité sont disponibles et qu'il n'est
pas nécessaire d'investir (le coefficient multiplicateur serait alors plus fort) pour le satisfaire.
Voilà l'une des explications rationnelles du dicton populaire qui affirme: "lorsque La
construction va, tout va".
Notons enfin que le bâtiment joue un rôle important dans l'incitation à l’épargne pour
le logement. Toutefois, il est dépendant du pouvoir public, celui-ci constitue un client
potentiel car dit-on « la route du développement passe par le développement de la route », et
intervient beaucoup dans la réglementation (lois et règlements divers). L’évolution du chiffre
d'affaires de ce secteur se trouve donc directement liée à la politique de l'État, notamment en
matière d'enveloppe budgétaire.
1 Confère l’annexe 8

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
8
Paragraphe 2 : Particularités Du Secteur BTP
La particularité du secteur se situe au niveau de ses intervenants et de son processus de
travail.
A. Les intervenants dans l’exécution d’un projet de construction
Nous abordons ici les différents acteurs et marchés du secteur des BTP.
1. Les différents acteurs de l’acte de construction
Pour mieux comprendre la complexité du secteur des BTP, il est important d'en
connaître les principaux intervenants:
Le maître de l'ouvrage: ce terme est utilisé pour désigner le producteur primaire c’est-à-dire
le client des entreprises BTP qui peut être une personne physique ou morale (organisme
public, association, société civile, société commerciale, etc.), qui se procure le terrain, définit
le programme, fait concevoir et réaliser le projet et finance les études et les travaux. Il conclut
le plus souvent deux contrats pour la réalisation de la construction. L’un avec le maître
d’œuvre et l’autre avec l’entrepreneur.
Le maître d'œuvre: C'est un architecte, un bureau d'études agréé en architecture, ou encore
une équipe associant plusieurs acteurs que s’adjoint le maître de l’ouvrage pour réaliser
certaines missions avant et pendant l’opération de construction. Sans être exhaustif, il est
celui qui conçoit et assure le contrôle des travaux. Il établit les études techniques d'un projet,
les études architecturales et financières, le devis confidentiel, le programme de réalisation, le
cahier spécial des charges, assiste le maître de l’ouvrage à la réception, etc.
Le contrôleur SPS : il doit coordonner les mesures de sécurité et de protection de la santé. Il
a un contrat distinct avec le maître de l’ouvrage. Il joue un rôle à deux niveaux :
* Au stade de la conception :
- élaborer le plan général de coordination (s’il est requis)
- ouvrir le registre journal de la coordination,
- définir les sujétions de protection.
* Au Stade de l’exécution :
- Organiser les activités simultanées ou successives,
- Veiller à l’application des mesures définies,
-Tenir à jour le plan général de coordination,
-Compléter le dossier d’intervention ultérieur,

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
9
- Communiquer les consignes de sécurité,
-Préciser le Collège Inter - entreprise de Sécurité, Santé et Condition de Travail (C.I.S.S.C.T)
Le contrôleur technique : Il a pour rôle de contribuer à la prévention des aléas climatiques. Il
est lié au maître de l’ouvrage par un contrat spécifique.
L’entreprise: elle peut être une personne physique ou morale. Elle exécute les travaux dans le
cadre d'un contrat passé avec le maître de l'ouvrage. Il fournit les matériaux, la main-d’œuvre,
le matériel, la compétence technique et toutes les autres ressources nécessaires au bon
déroulement des travaux. Il peut y avoir plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres
ou associées suivant des formes diverses (entreprises groupées, entreprises générales ou
entreprises sous-traitantes). Responsable de ses ouvrages, l’entreprise agit sous la direction
générale de l’architecte (également chargé de vérifier la conformité de la réalisation aux
documents du marché), mais également du coordonnateur et du contrôleur technique.
L’entreprise, exécutant les travaux, est, de ce fait, liée au maître de l’ouvrage par un marché des
travaux. Elle n’est pas liée contractuellement au maître d’œuvre, mais elle s’engage envers le
maître de l’ouvrage, par l’intermédiaire du marché des travaux, à obéir aux directives du maître
d’œuvre selon le marché qu’ils concluent. L'entreprise peut aussi désigner un artisan.
Le fabricant: c'est l'industriel qui fabrique les produits nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage.
Le négociant: c'est celui qui achète les produits, les stocke et les revend. Il peut faire transiter
les marchandises par son dépôt, ce qui est le plus fréquent; mais il peut aussi faire de la vente
directe.
Le distributeur: cherche à promouvoir un produit dont il assure la distribution. Il remplit le
plus souvent le rôle de conseiller technique. Il est un lien privilégié entre les fabricants des
produits qu'il distribue et ceux qui décident de leur mise en œuvre.
L’utilisateur: c'est celui ou ceux qui occuperont ou utiliseront l'ouvrage construit. C'est la
personne la plus importante pour tous ces partenaires car, sans lui, on ne parlerait pas de la
construction comme de l'industrie.
L’État: intervient directement par l'intermédiaire de la demande; joue un rôle direct ou
indirect pour favoriser la solvabilité des ménages (salaires indirects, caisse - maladie,
subventions...); met au point des politiques législatives et réglementaires pour permettre au
secteur de se développer et encourage les investissements dans le secteur.
La réalisation d'un ouvrage de construction est l'affaire de tous ces partenaires. C'est
comme une chaîne qui résiste si tous ses maillons sont solides, mais qui se brise si un seul

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
10
maillon est faible. Beaucoup d'erreurs peuvent être évitées si tous les partenaires s'entendent,
dès le début, sur le projet et sur le partage des responsabilités et le respect des attentes
réciproques. Pour éviter tout litige, il est important que :
- Les liens contractuels soient bien établis.
- Les rôles particuliers et domaines spécifiques soient précisés.
- Il doit bien être précisé qu’il n’y a pas de hiérarchie ni de subordination entre ces divers
intervenants. Le seul donneur d’ordre est le Maître de l’ouvrage.
- En conséquence, toute modification relative aux différents contrats doit faire l’objet
d’avenant signé par le maître de l’ouvrage.
- Au cas où des modifications interviennent, que ce soit sur des points précis au marché ou
non tous les intervenants devront en être avertis.
2. Les marchés
Nous allons à présent aborder la distinction entre marchés publics et privés, les
différents modes de passation des marchés publics.
2.1. Distinction entre marchés publics et marchés privés :
� Son considérés actuellement comme marchés publics, les marchés de travaux passés
avec les maîtres d’ouvrage suivants :
� maîtres d’ouvrages publics :
• Etat (en pratique les différents ministères), départements, communes, établissements
publics nationaux, départementaux, à caractère administratif (exemple, les
universités), communaux (hôpitaux, régies communales, etc.), districts urbains,
syndicats de commune, offices publics d’H .L.M.
� maîtres d’ouvrage privés :
• sociétés d’économie mixte, concessionnaires d’autoroute.
� Sont considérés comme privés les marchés de travaux conclus avec les maîtres
d’ouvrage privés suivants :
� Sociétés industrielles, commerciales ou civiles :
• associations ;
• particuliers.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
11
� Les marchés de travaux conclus avec certains maîtres d’ouvrage ont un caractère
encore incertain. On peut les considérer comme privés mais la jurisprudence évolue
dans ce domaine. Il existe, en effet, des limitations à la liste ci-dessous :
• établissements publics à caractère industriel et commercial ;
• sociétés d’économie mixte ;
• organismes publics ou privés ayant la qualité de concessionnaires (sauf les sociétés
concessionnaires d’autoroutes).
2.2. Mode de passation des marchés publics
Dans le secteur de BTP, on distingue trois modes de passation des marchés à savoir :
l’adjudication, l’appel d’offres et le gré à gré.
.
2.2.1. L’adjudication
Le code des marchés publics et textes d’application, à son article 39, définit
l’adjudication comme étant « le mode de passation des marchés par lequel le soumissionnaire
qui présente l’offre dont le montant est le plus bas est retenu séance publique après mise en
concurrence des candidats ».
L’adjudication peut être ouverte ou restreinte (article 40 du code) :
- Elle est dite ouverte lorsque tout candidat qui n’est pas exclu comme indiqué à l’article 122
du code peut présenter une offre.
- elle est dite restreinte lorsque l’objet de marché concerné ne s’adresse qu’à un nombre limité
de candidats que le maître de l’ouvrage décide de consulter après présélection.
2.2.2. L’appel d’offres
L’appel d’offres est le mode par lequel le maître de l’ouvrage attribue le marché au
soumissionnaire le mieux disant, c'est-à-dire l’offre qui aurait le plus grand de point (note
technique et note financière). Dans le code des marchés publics et textes d’application en son
2 Sont frappés d’interdiction de participer à un appel à la concurrence au Bénin :
- toutes les personnes physiques ou morales en état de liquidation de faillite personnelle déclarée, à l’exception des personnes physiques ou morales en règlement judiciaire qui ont justifié qu’elles ont été habilitées par le tribunal à poursuivrent leurs activités ;
- les personnes physiques ou morales qui n’ont pas obtenu le quitus fiscal ou qui n’ont pas honoré leur engagement à l’égard de la sécurité sociale ;
- les personnes physiques ou morales précédemment titulaires d’un marché public ayant fait l’objet de résiliation pour faute ou carence des intéressées.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
12
article 31, « l’appel d’offres est le mode de passation des marché par lequel le
soumissionnaire dont l’offre répond le mieux aux intérêts du maître de l’ouvrage est retenu
après mise à concurrence des candidats. »
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint (article 32 du même code)
- Il est ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas exclu comme indiqué à l’article 12
peut présenter une offre.
- Il est restreint lorsque l’objet du marché concerné ne s’adresse qu’aux candidats que le
maître de l’ouvrage a retenus après présélection.
L’article 41 du même code nous informe que les avis d’appel d’offres ou d’adjudication
doivent être porté à la connaissance du public par une insertion dans un quotidien
d’information ou par autres moyens de publicité appropriés.
2.2.3. Les marchés négociés ou gré à gré
La personne responsable du marché engage, dans ce cas, sans formalités les
discussions qui lui paressent utiles. Elle attribut ensuite, librement le marché au candidat
qu’elle a retenu. Selon l’article 43 du code des marchés publics, un marché est dit gré à gré ou
négocié lorsque « le maître de l’ouvrage engage librement des consultations et négociations
directes avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services. »
En outre, étant donné que les chantiers de construction présentent beaucoup de
particularités auxquelles il faut s'adapter, il est important que les divers intervenants et surtout
l'entrepreneur puissent maîtriser les caractéristiques du procès du travail dans le BTP pour
l’atteinte de leurs objectifs.
B. Le procès de travail dans le secteur BTP
Dans l'hypothèse d'analyse de la gestion du procès de travail en terme d’« économie
du temps », considérée à la fois comme principe d'organisation du travail et principe de
croissance économique (Kündig, 1984: 57), il est possible d'établir une distinction entre les
industries dont l'économie du temps dépend du rythme de travail direct (comme les industries
de forme incluant les industries de série et celles des BTP) et celles où il n'est pas possible de
faire le lien entre le temps de travail et la quantité de marchandises produites (industries de
procès).

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
13
En raison du fait que, parmi les industries de forme, il y en a qui produisent des
marchandises en grande série (là où la standardisation a pu s'imposer) et celles qui produisent
à l'unité, Du Tertre (1988: 13) propose d'établir une double dimension de l'intensité du travail,
en distinguant l'intensité directe du travail de l'intensité connexe du travail. La première
traduit une action sur les "temps élémentaires opératoires" qui incluent les temps directement
productifs et les temps morts programmables lors de la conception de la production. La
seconde rend compte d'une volonté d'agir sur les "temps connexes", ceux liés à la régulation
de la production.
Pour les industries qui produisent à l'unité comme le BTP, le déroulement du procès de
production fait apparaître en particulier un grand nombre de dysfonctionnements qui exigent
la mise en œuvre de nombreuses tâches dites aléatoires. La réduction des temps connexes,
facile dans les industries de série (automobile par exemple) devient ainsi un problème dans le
BTP.
Le procès de travail mis en œuvre dans le BTP est un procès de travail de type
"chantier" dont les caractéristiques sont les suivantes d’après Du Tertre, 1988: 14-19:
1) Le procès de travail dans le BTP apparaît soumis aux contraintes d'une double variabilité et
de spatialisation, ce qui implique de faibles possibilités de mise en œuvre de tâches
parcellaires et répétitives sous contrainte de temps. D'un côté, à une "variabilité externe" liée à
l'hétérogénéité du produit et du marché, s'ajoute une "variabilité interne" liée aux
particularités de la mise en œuvre du travail vivant du chantier.
Campinos Dubernet (1984: 214) soulève pour sa part le problème de "lissage" pour
obtenir un étalement du travail et éviter le déplacement du personnel d'un chantier à l'autre.
Il faut tout d'abord remarquer que la production du secteur des BTP est moins celle
d'un produit que celle d'un projet. Or, tout projet par définition se transforme. Il l'est d'autant
plus que la politique en matière de logements varie, comme en témoignent les successions de
projets et d'abandons de certains programmes de construction. Cette impossibilité de mettre
en place des projets définitifs et à long terme, sur une grande échelle, est déjà en soi un frein
important à tout essai de standardisation des produits.
À cette difficulté d'élaborer des projets définitifs, vient se greffer la variabilité ou la
diversité même des types de produits. Celle-ci ne permet pas aux entreprises de se spécialiser
dans un ou deux "sous - marchés": logements individuels ou collectifs, bâtiments scolaires,
hospitaliers, administratifs, bâtiments destinés à la production et au stockage, ponts et
autoroutes, voies urbaines, adduction d'eau, ports et voies navigables, ouvrages ferroviaires,

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
14
aérogares...; qui exigent à chaque fois l'utilisation des techniques de production différentes.
Concernant les conditions d'usage du travail vivant, il semble que, dans le BTP, l'organisation
du travail ne soit dictée par aucun déterminisme technologique. Dans l'objectif de pouvoir
satisfaire une part significative des besoins du marché, les entreprises sont ainsi amenées à
maintenir chez elles des savoir - faire et compétences différents et à diversifier leurs pratiques.
La multiplicité des clients (publics, privés, collectivités locales...) et celle des agents qui
interviennent dans le secteur (architectes promoteurs, entrepreneurs...) viennent renforcer le
caractère hétérogène de la production et la variabilité du produit.
D'un autre côté, il faut souligner que la production dans le BTP est très liée à la
dimension régionale de l'activité du secteur. En effet, la plus grande part des produits ne se
transporte pas; ils sont fabriqués sur place, sur chantier. Les entreprises sont donc incitées à
utiliser des matériaux régionaux, à tenir compte de l'évolution et des changements de mode de
vie d'une région à une autre.
2) Ces contraintes externes et internes ont un impact sur le type d'équipements utilisés dans le
secteur. On peut, en effet, constater que le BTP emploie très peu de machines - outils et
d'appareils utilisés généralement dans les industries de série ou à processus continu. Par
contre, il utilise massivement des outils et du matériel peu spécialisé qui laissent d'importantes
marges dans l'organisation du travail et qui sont très souvent dissociés des temps élémentaires
précis quant à leur mise en œuvre.
3) II faut remarquer également que, dans le BTP, il n'est généralement pas possible de séparer
les temps connexes liés à la régulation des temps élémentaires opératoires. Les deux types de
temps sont intrinsèquement liés; les tâches élémentaires et celles liées aux régulations étant
assumées ici par un corps unique d'ouvriers. Comme dans toutes les industries de forme,
l'intensité directe du travail est certes un déterminant important, mais elle apparaît ici
dépendante de l'intensité connexe du travail. La tendance à la fusion des temps élémentaires et
des temps connexes, et le nombre important de dysfonctionnements conduisent, en effet, à
souligner le poids de l'intensité connexe du travail.
4) Compte tenu des nombreux obstacles liés aux événements aléatoires ainsi que des
contraintes de successivité et de simultanéité qui surviennent en grand nombre au cours de
séquences de production, les directions de chantiers ont beaucoup de mal à programmer de
façon précise l'ordonnancement des tâches et mettre au point des techniques d'équilibrage. Un
nouveau chantier nécessite de repenser le déroulement des tâches et des postes. En d'autres
termes, les contraintes de successivité et de simultanéité, d'un côté, et celles de variabilité, de

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
15
l'autre, s'opposent aux formes de rationalisation taylorienne classique. En fait, les
dysfonctionnements qui surviennent lors du procès de production imposent des régulations
particulières de celle-ci et impliquent donc la non régularité des charges de travail.
C'est à partir de ces quatre caractéristiques que Du Tertre (1988) considère que, dans
le BTP, les réserves de productivité sont principalement localisées dans la gestion de la main-
d’œuvre et dans l'organisation du travail de chantier. Le BTP est caractérisé par d'autres
particularités. Il apparaît, en effet, comme un secteur où la mobilité est plus importante, la
durée de travail très variable (en fonction des saisons, des intempéries, du rythme de
production et de la successivité des différents modes opératoires) et les accidents de travail
plus nombreux. Les conditions de travail sont loin d'être enviables. La chaleur, la pluie, la
neige, les intempéries... créent des conditions de travail particulièrement difficiles. De plus, le
maniement des différents matériaux est parfois considéré comme peu "noble". La fatigue
aidant, le chantier est un lieu propice aux accidents de travail qui peuvent être
particulièrement dangereux. Le BTP apparaît aussi très typique des secteurs à mode de
gestion par le marché du travail, caractérisés principalement par le recours important qu'il fait
à une main-d’œuvre inoccupée et qu'il rejette ensuite assez massivement sur le marché du
travail. Soulignons enfin que, dans bon nombre de pays, le BTP apparaît comme un secteur où
les salaires sont peu élevés.
Jusqu'ici, nous avons tenté de donner un aperçu général sur les caractéristiques de
l'industrie de construction où œuvrent les entreprises constituant les unités de la présente
étude. Dans le chapitre qui suit, nous allons, à partir de cette description globale, situer la
problématique de notre sujet qui, rappelons-la, sera axée spécifiquement sur l'industrie
béninoise de construction.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
16
Dans ce chapitre, nous exposons le problème, nos objectifs, nos hypothèses de
recherche, la méthodologie suivie et la revue de littérature.
SECTION 1 : DE LA PROBLEMATIQUE AUX HYPOTHESES DE RECHERCHE
Nous présentons ici la problématique, les objectifs et les hypothèses de recherche.
Paragraphe1 : La problématique et l’intérêt de l’étude
Ce paragraphe retrace la problématique et l’intérêt de la recherche.
A. Problématique
Les petites et moyennes entreprises, tant dans les pays développés, en voie de
développement que sous développés ; sont considérées comme le moteur du développement
économique et de création d'emplois. Ce développement suppose dans une large mesure
l'enrichissement national qui découle de l'enrichissement des entreprises et des individus.
Dans ce rôle moteur, l'activité de construction détient une position - clé parce que d'une part,
le travail, les matériaux, les équipements et l'organisation de chaque pays constituent un
élément capital de l'input global de la communauté et, d'autre part, les BTP sont
indispensables à toutes les autres activités productives nationales et à tous les membres de la
communauté (Fjosne 1962: 17). Toutefois, pour exercer véritablement ce rôle, les entreprises
du secteur de BTP se doivent d'être performantes. Ce n’est que de cette manière qu'elles
seront utiles et pour l'État à travers les recettes fiscales, et pour elles-mêmes et aux
actionnaires par les bénéfices qu'elles génèrent et enfin, pour ses employés au moyen des
salaires et de la stabilité de l'emploi. La performance financière devient de ce fait un des
objectifs primordiaux à atteindre. Il est de constater que, l’importance du secteur de BTP au
Bénin en termes de contribution au PIB n’est pas négligeable. En effet, sur la période
quinquennale de 2004-2008, ce secteur a contribué en moyenne environ à 4,46% du PIB; et
pour l’année 2008 plus particulièrement, sa contribution au PIB est de 6,32%, le total des
investissements dans ce secteur pour le compte de l’année 2008 est de 10,35 % par rapport au
total des investissements au plan national. Par ailleurs, sur la même période, sa valeur ajoutée
CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET APPROCHE MÉTHODOLO GIQUE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
17
a connu un accroissement continu3. Dans la nouvelle politique économique du Bénin, un des
axes majeurs de développement est la relance des investissements.
Dans Ce cadre, le Bénin a conclu avec le Millenium Challenge Acompt (MCC) début
2006, un contrat d'une durée de cinq ans et d'une valeur de 307 millions de dollars soit
153.500.000.000 de franc CFA, afin de financer des projets d'infrastructures4. D’après la note
de conjoncture du deuxième trimestre 2008, le secteur BTP a dors et déjà dans ce cadre
enregistré un accroissement du regain d’activité de 7,7% par rapport au premier trimestre de
la même année. Et au cours du troisième trimestre un regain d’activité de 10,7% par rapport
au deuxième trimestre. Malgré que le secteur BTP ait connu un regain d’activité. La Nouvelle
Agence des Travaux de Construction (NATRAC SA) de part la lecture de ses états
financiers, présente sur la période de 2004 - 2008, une tendance baissière du chiffre d’affaires
et la moyenne du bénéfice net avant impôt est négative de 73.428.608,4. Compte tenu de ces
résultats, malgré l’état favorable de la conjoncture du secteur, il urge de porter une attention
particulière sur la situation de la NATRAC afin de pouvoir trouver des approches de solution.
Pour ce faire, il est capital de trouver réponse à une question qui a guidé notre recherche:
Dans le secteur BTP, en particulier à la NATRAC, quels sont les facteurs internes et externes
susceptibles d'influer, de façon significative, sur la performance ?
B. Intérêt de l’étude
L’intérêt de notre étude se situe à trois niveaux :
- premièrement, il est lié à notre condition d’apprenant. Cette étude nous permet de faire
l’expérience de la vie professionnelle et de mettre en pratique les théories et concepts
capitalisés durant notre cursus scolaire et universitaire ;
- deuxièmement à l’entreprise dans laquelle nous avons mené nos recherches. Nous espérons
que notre séjour dans son cadre lui sera très bénéfique, en ce sens que les analyses,
diagnostics et orientations stratégiques qui découlent de la présente étude serviront de piste
de réflexion pour l’orientation des mesures d’amélioration de sa performance ;
3 Confère l’annexe 8 4 Rapport de la Conférence Régionale sur l’Investissement Bâtiment et Travaux Publiques Afrique de l’Ouest et Centrale

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
18
- enfin, pour l’économie nationale une prise de conscience de l’importance du secteur de BTP
augmentera plus l’intérêt de l’Etat qui prendrait d’avantage de dispositions nécessaires pour
améliorer sa performance.
Paragraphe 2 : Les objectifs et les hypothèses de recherche
Il s’agit ici de préciser les objectifs et hypothèses de recherche.
A. Les objectifs
Ils sont composés de l’objectif général dont la réalisation passe par celle des objectifs
spécifiques.
1. L’objectif général
L’objectif général de notre recherche est d’étudier les facteurs qualitatifs et quantitatifs
qui influent négativement sur les performances de la NATRAC.
2. Les objectifs spécifiques
La réalisation de cet objectif général passe par celle des objectifs spécifiques suivants :
1- Etudier la politique de motivation du personnel en place à la NATRAC.
2- Evaluer l’équilibre financier et le cycle d’exploitation de l’entreprise.
3- Etudier la rentabilité économique et financière et la productivité de la NATRAC.
B. Les hypothèses de recherche
Les hypothèses retenues pour la concrétisation de cette étude sont :
H1 : L’absence de motivation du personnel pourrait constituer un frein à la performance de la
NATRAC.
H2 : La non-conformité des délais client et fournisseur et le non respect de l’équilibre financier
constitueraient un frein à la performance de la NATRAC.
H3 : La richesse créée par la NATRAC ne serait pas suffisante pour couvrir ses charges
d’exploitation

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
19
SECTION 2 : REVUE DE LITTERATURE ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCH E
Cette section est d’une part consacrée à la recension des écrits portants sur les notions
liées à notre thème et pose d’autre part la méthodologie utilisée.
Paragraphe1 : La Revue de la Littérature
Il s’agit ici de baliser la compréhension en nous appuyant sur les analyses
conceptuelles, les déterminants et les mesures de la performance.
A. Etude Conceptuelle
Il s’agit de clarifier les concepts d’entreprise et de performance.
1. Concept d’entreprise
Il est question de donner la définition de l’entreprise, de parler brièvement de la
pratique de la gestion dans une entreprise, de la culture d’entreprise et des difficultés qu’on
rencontre dans la gestion d’une entreprise.
1.1. Définition
L’entreprise peut être définie comme une organisation qui combine les ressources
humaines, naturelles, financières et technologiques en vue de produire des biens et / ou des
services destinés à une clientèle dans le but de dégager un bénéfice ou d’atteindre un certains
niveau d’utilité sociale.
Selon le lexique d’économie (Dalloz 2008) « une entreprise est une unité économique
autonome combinant divers facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des
services et distribuant des revenus en contrepartie de l’utilisation des facteurs ».
Quant à Ackoff F. E. Emery 1972 (cité dans contrôle de gestion de Michel Gervais)
« l’Entreprise peut être définie comme un système finalisé et adaptatif en se fondant sur les
développements de la théorie générale des systèmes ». La notion de finalité traduit le fait que
l’entreprise n’est pas entièrement déterminée par son environnement mais qu’elle a la capacité
de choisir des objectifs et des moyens ainsi que des logiques de raisonnement qui influencent
ses comportement futurs. Ces comportements sont à la fois le résultat de l’état de
l’environnement et des choix du système qu’est l’entreprise. En quelque sorte,
l’environnement et le système coproduisent les comportements.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
20
La notion d’adaptation signifie que l’entreprise a la faculté de transformer ses
structures, de modifier ses buts et ses moyens pour les harmoniser avec ceux de
l’environnement.
Ces différentes définitions nous permettent de retenir trois caractéristiques générales
de l’entreprise à savoir :
- Une coalition avec un but commun, produire et vendre des biens et services ;
- Un centre de décision distinct des individus qui la composent ;
- Une somme de moyens d’actions humains, individuels, intellectuels et financiers.
Chacune de ces caractéristiques principales donne à l’entreprise sa spécificité et son identité.
1.2. La pratique de la gestion dans une entreprise
Dans l’entreprise, selon Henri FAYOL, la pratique de la gestion fait recourt généralement
à quatre fonctions essentielles à savoir : la planification, l’organisation, la direction et le
contrôle.
• La planification
Elle consiste à la détermination des objectifs de l’entreprise et à l’élaboration des
programmes, des politiques, des plans, des échéances, des budgets, des procédures, des
méthodes, en vue de l'atteinte des objectifs fixés.
• L’organisation
Elle a pour but de former les équipes et de coordonner les tâches et les activités, de
créer les liens organisationnels nécessaires, d’orienter tous les efforts dans la même direction
et d’atteindre ainsi les objectifs fixés. Les activités liées à cette fonction sont donc l’analyse
des besoins, la définition et l’attribution des tâches, le choix des rôles et des personnes,
l’entraînement, la formation et l’évaluation des ressources humaines.
• La direction
Elle est une activité de leadership qui revient à faire en sorte que les employés
accomplissent au mieux la tâche qui leur est assignée. Ce faisant, le dirigeant doit les guider,
les superviser, les motiver, les encourager, les entraîner, les développer. Il doit également
rechercher et maintenir le personnel nécessaire à l'évolution de l'organisation.
• Le contrôle
Enfin, le contrôle est un processus qui permet, d'une part, d'évaluer la performance de
l'organisation et de comparer les résultats et les prévisions. D'autre part, le contrôle donne lieu
à la recherche des divers moyens de corriger les écarts négatifs comme positifs constatés.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
21
Pour J. Gray et K.S. Johnson 1976, « le contrôle est l’ensemble des mesures prises par la
direction pour assurer le respect des objectifs d’un plan ». De même selon M. Gervais dans le
contrôle de gestion (2005) « le contrôle consiste à rapprocher les résultats réels des résultats
escomptés ».
Il est à remarquer que la planification et le contrôle sont deux activités
complémentaires, qui ne peuvent exister l'une sans l'autre
1.3. La culture d’entreprise
L’entreprise dispose-t-elle de sa propre culture ?
Comme tout Homme possède une personnalité c’est-à-dire un ensemble de
caractéristiques cognitives, affectives et comportementales relativement constants et stables,
l’entreprise possède également une personnalité désignée sous l’appellation ‘’culture
d’entreprise’’. Généralement définie comme étant l’ensemble des croyances et des attentes
partagées par les membres d’une entreprise, la culture d’entreprise désigne les normes
comportementales, les valeurs partagées, la philosophie de la firme, ‘’les règles du jeu’’ qui
permettent d’agir ensemble et qui conditionnent aussi les rapports avec les personnes
extérieures. Stephen Robbins et David DeCenzo la définissent comme étant « un système
commun de signification élaboré au sein d’une organisation et qui détermine, dans une large
mesure, comment les employés agissent et réagissent en situation ». Dans leurs recherches,
ces auteurs ont découvert dix critères pouvant permettre aux dirigeants d’évaluer la culture de
leur organisation. Il s’agit de : sentiment d’identification, propriété au groupe, intérêt pour les
personnes, esprit d’intégration, contrôle, tolérance au risque, critères de récompense,
tolérances des conflits, orientation moyens/fin et de système ouvert.
1.4. Les dysfonctionnements et difficultés dans une entreprise
Chercher la cause d’une maladie est tout aussi important que de chercher le remède
nécessaire pour guérir cette maladie. De toute évidence, on ne saurait améliorer la
performance d’une entreprise sans au préalable identifier les faiblesses et les menaces qui
pèsent sur cette entreprise.
Notre terrain d'étude (la NATRAC SA) étant situé au Bénin, pays "sous-développé"
dont l'industrialisation est encore embryonnaire, l'on peut se demander ce qu'il y en est de la
performance des entreprises.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
22
Les entreprises béninoises souffrent de plusieurs disfonctionnements aussi bien au
plan interne qu’au plan environnemental :
� Au plan interne nous pouvons citer :
• Problèmes de formation des propriétaires dirigeants:
Le niveau de connaissance de la plupart des chefs de PME est insuffisant tant
en ce qui concerne les techniques de production utilisées que celles de la gestion. Les
programmes locaux de perfectionnement des cadres dirigeants ne sont pas non plus
dépourvus de faiblesses: moyens pratiques limités, matériels et attitudes pédagogiques
peu adaptés, etc. D'aucuns estiment que cette insuffisance de formation des
entrepreneurs est à l'origine de beaucoup de difficultés auxquelles ils se heurtent, et
semble constituer la principale cause d'échecs des entreprises. En plus de la formation
limitée des dirigeants, ceux-ci étant de surcroît caractérisés par un faible esprit
d'innovation, on constate également un manque flagrant de conseillers techniques
expérimentés et bien formés.
• Problèmes de planification:
La planification en Afrique se limite à un exercice théorique. Lorsqu’elle a
lieu, elle ne tient pas véritablement compte des situations conjoncturelles. Une
structuration des buts et objectifs ; des attentes signifiées et des choix d'options ne font
pas partie du langage des gestionnaires. Il existe parfois de fortes barrières culturelles
aux actes de planification. Les entreprises règlent souvent des problèmes
circonstanciels et leur solution ne suit pas un plan précis.
• Problèmes économiques et financiers:
Parmi ceux-ci, on distingue:
� Insuffisance de ressources: l'insuffisance des fonds propres est caractéristique des
organisations béninoises. Cette situation peut bloquer leur capacité d'endettement à
long et moyen termes, menaçant ainsi de freiner ou d'empêcher leur
développement. En effet, les entreprises deviennent de plus en plus sensibles aux
événements conjoncturels, très fréquents en Afrique. Or, suite aux manquements
parfois importants en matière de remboursement de prêts par certains entrepreneurs,
les banques se méfient de ceux-ci et exigent davantage des garanties plus sévères
qui dépassent généralement leurs possibilités; ce qui les empêche d'avoir un accès
satisfaisant au crédit.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
23
� Absence de prévisions: l'absence d'études de marché avant le lancement d'une
activité est souvent évoqué comme cause majeure des échecs ou des difficultés.
Certains entrepreneurs n'envisagent pas à l'avance les meilleures parades aux
éventuelles insuffisances de trésorerie, insuffisances qui peuvent hypothéquer la
survie de l'entreprise. L'entreprise agit souvent par imprévision et selon les
impulsions de ses dirigeants.
� Ignorance des règles comptables de base: trop souvent, les entrepreneurs
n'établissent pas de registres classiques recensant leurs recettes et leurs dépenses ou
ne le font que par souci de répondre aux obligations légales, sans que ce soit un
véritable outil de gestion. La comptabilité analytique d'exploitation, si impérieuse
pour des entreprises exploitant plusieurs produits ou intervenant sur de nombreux
marchés comme c'est le cas des entreprises du secteur de construction, est quasi
inexistant dans bon nombre d'entreprises.
� Mauvaise utilisation de fonds: certains chefs d'entreprise ont tendance à
confondre en permanence leurs biens personnels et le patrimoine social de
l'entreprise, ou encore le bénéfice et le chiffre d'affaires. La lourdeur des frais
généraux, conséquence souvent des dépenses somptueuses, inutiles à l'exploitation,
est un autre volet de la mauvaise gestion financière. Tout cela renforcera la
méfiance qu'ont les banques vis-à-vis des entrepreneurs nationaux qui constamment
déclarent des bénéfices minimums quand ce ne sont pas des pertes systématiques.
• Problèmes techniques:
La qualification insuffisante du personnel technique ; la nature surannée des
installations et l'impossibilité de se procurer des moyens de production ; des pièces
détachées et matières premières entravent souvent, en Afrique, les efforts fournis pour
se doter d'une capacité technologique ou la développer. Les institutions capables de
fournir des services de vulgarisation sont peu nombreuses. Les dirigeants ou leurs
employés ne disposent pas assez de gammes variées de connaissances et d'aptitudes
industrielles. Ils ne procèdent pas valablement aux opérations d'entretien et de
réparation de toutes sortes d'équipements. Ils sont alors inaptes à détecter et à corriger
les pannes ou les défauts de fonctionnement les plus importants sur les équipements,
d'où des mauvaises utilisations du matériel aux conséquences graves: cassures, usure
prématurée, retards... L'entreprise risque de se retrouver avec un parc de matériel
inutilisable avec des conséquences évidentes sur sa rentabilité ou sa productivité.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
24
• Problèmes sociaux et organisationnels:
Les carences d'organisation sont nombreuses et il faudrait plusieurs pages pour
les énumérer. On peut citer notamment les problèmes suivants:
� certaines entreprises n'ont pas d'organigramme ou ne le possèdent que pour la
forme;
� bon nombre d'entreprises effectuent un classement vertical des dossiers et des
pièces commerciales; il est même souvent difficile de retrouver des pièces datant
des années récentes;
� l'absentéisme ; les retards dans l'exécution des tâches importantes sont autant
d'écarts que, s'ils sont trop négatifs, entraînent des diminutions de rentabilité;
� l'organisation personnelle des dirigeants laisse à désirer. En effet, la diversité des
activités de l'entrepreneur l'empêche de suivre suffisamment son entreprise. Les
décisions sont concentrées au sommet de l'organisation. S'il est vrai que le
commandement rend la direction plus pratique, il pose de problèmes dans la gestion
de l'entreprise. L'employé ne voit pas sa responsabilité et considère parfois
l'entreprise comme concurrente ou subordonnée à ses intérêts. Pour manifester un
mécontentement suite à une décision inconvenable, l'employé utilise des moyens
subtils sur lesquels l'autorité n'a pas de prise;
� l'initiative fait défaut, la motivation est souvent absente et la solidarité
organisationnelle déficiente; etc.
� Au plan environnemental nous pouvons citer :
• les taux d'intérêts sont excessifs, les délais de remboursement trop brefs, les garanties
et nantissements importants;
• les pénuries régulières de matières premières qui privent les organisations de
ressources dont elles ont besoin pour leur développement;
• les équipements et les pièces de rechange sont insuffisants ou parfois indisponibles;
• l'infrastructure est déficiente dans plusieurs pays africains surtout au Bénin. Or, un
développement durable et efficace des entreprises ne va pas sans une infrastructure
solide.
2. Concept de performance
Le concept de performance est couramment utilisé tant dans la littérature que dans les
milieux organisationnels. Elle désigne le plus souvent un certain niveau d’excellence, de

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
25
capacité d’exploitation et d’action. En effet, pour être compétitive, toute entreprise doit être
performante. Dans le langage courant, la performance renvoie à quatre significations
majeures :
- le résultat d’une action : La performance correspond dans ce cas à un résultat mesuré
par des indicateurs et se situe par rapport à un référant qui peut être endogène ou
exogène ;
- le succès : ici la performance fait recours à un résultat positif et par là même à la
représentation de la réussite propre à chaque individu ou établissement ;
- l’action : la performance désigne simultanément les résultats et les moyens mis en
œuvre pour les atteindre, c’est - à - dire un processus ;
- la capacité : la performance renvoie alors au potentiel.
Selon le lexique d’économie (Dalloz 2008) la performance représente un degré
d’accomplissement des objectifs, des buts, des plans ou programmes que s’est donné une
organisation. Les indicateurs de performance sont généralement des quantifications se traduisant
par des rapports entre les résultats obtenus et les moyens mis en œuvres pour les atteindre.
Selon Albanes (1978), la performance est la raison d’être des postes de gestion, elle
implique l’efficacité et l’efficience. Dans ses recherches, Miles définit la performance comme
étant la capacité de l’organisation à réaliser une satisfaction minimale des attentes de sa clientèle
stratégique.
Quant à Chandler (1992), la performance est une association entre l’efficacité
fonctionnelle et l’efficacité stratégique. L’efficacité fonctionnelle consiste à améliorer les
produits, les achats, les processus de production, la fonction marketing et la relation humaine au
sein de l’entreprise. L’efficacité stratégique consiste à devancer les concurrents en se
positionnant sur un marché en croissance ou en se retirant d’un marché en phase de déclin.
B. Déterminants et mesures de performance
Dans cette rubrique, nous exposons les déterminants et les mesures de la performance.
1. Déterminants de la performance
On ne peut vraiment parvenir à une bonne analyse de la performance sans au préalable
identifier les facteurs qui influence significativement cette dernière. Au terme de son mémoire

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
26
en 1995, SCARIE NIVYINTIZO a mis en évidence un certain nombre de facteurs qui influent
significativement sur la performance des entreprises de construction. Il s'agit de:
� la gestion financière ;
� la gestion des matériaux ;
� la gestion du matériel ;
� la motivation ;
� et le profil du dirigeant.
Il précise cependant que parmi ces facteurs, seule la gestion financière explique le plus
et dans une forte mesure la variation de la performance.
Ainsi, pour mieux appréhender l’analyse de la performance, il paraît indispensable de
procéder à une analyse financière de l’entreprise dans le but de porter un jugement pertinent
sur sa structure financière.
La notion d’analyse qui s’oppose à la synthèse, évoque l’idée de ‘’décomposition’’, de
‘’démontage’’ ou de ‘’mise à plat’’. L’analyse est donc la décomposition d’un tout en ses
parties constitutives.
L’idée de base de l’analyse financière est que l’on va procéder à l’examen des résultats
et de la situation financière de l’entreprise en décomposant le compte de résultat et les
composants du bilan en leurs principaux éléments. L’analyse financière peut être définie
comme un ensemble de réflexion et travaux qui permettent, à partir de l’étude des documents
comptables et financiers, de caractériser la situation financière d’une entreprise, d’interpréter
ses résultats et de prévoir son évolution à plus ou moins long terme, afin de prendre les
décisions qui découlent de ce travail de réflexion.
2. Mesures de performance
La mesure de la performance est une notion capitale dans les domaines aussi bien
organisationnels qu’économiques. Son rôle peut être comparé à celui d’une boussole dans le
domaine de la navigation. Pour R. KAPLAN et D. NORTHON (tableau de bord
prospectif…..p13) essayer de diriger une équipe sans un système de guidage bon et simple,
revient à essayer de conduire une voiture sans tableau de bord. Selon Françoise G. ; Gérard
R. ; Marie-Hélène D. et Pierre Laurent B. (2003) « les managers ont besoin de données qui
ont un sens pour les parties prenantes à la décision et qui font l’objet d’un consensus quant à
leur signification et leur valeur. » Il parait donc évident que les dirigeants de la NATRAC ont

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
27
besoin d’instruments qui leur donnent des indications sur l’environnement et la performance
de leur entreprise. Ces données et instruments d’une grande variété, ont fait l’objet de
plusieurs études. Les différents concepts de performance énumérés plus haut permettent de
retenir quelques mesures de performances à savoir : l’efficacité, l’efficience et la pertinence.
• L’efficacité : elle désigne la réalisation d’un objectif. Elle permet d’apprécier la qualité du
résultat obtenu par rapport aux objectifs fixés. H. BOUKIN (1986) précise que
« l’efficacité consiste à atteindre un objectif attendu. Elle représente la capacité d’une
organisation à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. »
• L’efficience : elle désigne le résultat obtenu par rapport aux moyens mis en œuvre. Selon le
lexique d’économie Dalloz (2008) « l’efficience est quasi synonyme à la fois de rendement
et de productivité. » Un procédé est plus efficient qu’un autre s’il exige moins de moyens
que ce dernier. L’efficience est ainsi le rapport inverse de la productivité moyenne
apparente. Si cette dernière en tant que rapport entre la valeur ajoutée et le volume du
facteur utilisé indique la production par unité de facteur, l’efficience indique le volume de
facteur nécessaire pour obtenir une unité de produit. L’efficience correspond donc au rapport
(volume des facteurs / volume de la production)
• La pertinence : elle est le caractère de ce qui est conforme à une norme fixée. Dans le cadre
d’une entreprise, la norme peut être assimilée aux objectifs de cette dernière. La pertinence
est l’appréciation de la qualité du bien et/ou du service produit, l’appréciation du bien fondé
des orientations et des objectifs au regard des moyens disponibles, de l’environnement et de
la concurrence, des performances de réalisation antérieur.
En fonction du domaine d'étude et de l'objectif de recherche, plusieurs chercheurs ont
proposé diverses mesures de performance. Ainsi pour Bartoli et Hermel, (1989: 108), elle peut se
mesurer par :
- la manière dont elle réalise certains résultats économiques et sociaux (productivité, rentabilité,
croissance du bénéfice net, retour sur investissement, satisfaction des employés...);
- sa contribution sociale et "sociétale" (niveau des rémunérations, qualité des emplois offerts et
des compétences requises, impact sur l'environnement...).
Dans une étude sur les petites entreprises, Friedland et Pickle (1964) suggèrent, comme
mesure de la performance d'une organisation, l'accroissement de la profitabilité (profit/ventes) et
des ventes, lequel apparaît significativement associé à une efficacité élevée mesurée par la
satisfaction des besoins de la communauté, des clients et des employés. Cette conception est
reprise par Edminster, Gru et Alves (cités dans Robinson, 1980: 46) qui signalent que « la mesure

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
28
de la profitabilité, de la productivité et de la variation des ventes, sont des critères principaux
pour comparer la performance des entreprises. »
Robinson (1980) pour sa part suggère deux critères de mesure d'efficacité pour les PME, à
savoir: l'accroissement des ventes et des bénéfices. Dans le même ordre d'idées, Begley et Boyd
(1986: 8-15) proposent quatre critères pour examiner la performance d'une compagnie: le taux de
croissance du chiffre d'affaires sur cinq ans, le taux annuel de rentabilité commerciale, le taux de
rentabilité commerciale sur cinq ans et le taux annuel de rentabilité de l'investissement (R.O.I).
Cependant, l'entreprise se doit d'être performante non seulement pour le gestionnaire et ses
partenaires, mais aussi aux yeux de l'État. Celui-ci en effet, s'intéresse, à connaître l'importance de
la participation des facteurs de production d'une entreprise, notamment le travail et le capital dans
la création de la richesse nationale (PIB ou PNB). La mesure de la performance d'une entreprise à
partir des bénéfices que tire l'État de l'activité de celle-ci devient complexe dès que l'on considère
les divers avantages qualitatifs et quantitatifs directs ou indirects. C'est pourquoi, pour caractériser
l'apport de l'entreprise dans la création de la richesse nationale, certains auteurs suggèrent la
notion de "valeur ajoutée" qui, elle, mesure le poids économique de l'entreprise dans l'économie
nationale (Colasse, 1973: 10). Godard et al. (1982) vont plus loin en affirmant que « la valeur
ajoutée rend compte à la fois de la productivité d'une entreprise, de l'utilité de ses produits et de
la marge de manœuvre qu'elle soutire de leurs marchés. »
Pour ne citer que les mesures mentionnées ci-dessus, il apparaît que les critères suggérés dans
la littérature sont nombreux et varient selon le domaine d'intérêt et le bon jugement du chercheur.
En d'autres termes, il ne semble pas y avoir présentement des critères unanimement admis pour
mesurer la performance d'une organisation. Pour cette raison, il est primordial pour tout chercheur
de s'assurer préalablement de la validité et de la fiabilité des mesures qu'il utilise, et nombreux
sont les auteurs qui suggèrent d'utiliser plusieurs critères au lieu d'un seul. Gibson et al. (1973)
proposent notamment d'introduire la notion de temps affirmant que les critères utilisés peuvent
être différents selon qu'il s'agit de courtes, moyennes ou longues périodes. Eccles (1991: 131-137)
parle même de la nécessité d'une nouvelle définition de mesures de performance qui ne s'appuie
pas uniquement sur les données financières.
3. La performance et le contrôle
Généralement conçue comme étant la réalisation efficace et efficiente des objectifs
élaborés lors de la planification, la performance n’aurait de sens sans le contrôle. En effet, la
planification et le contrôle sont deux activités complémentaires et indissociables dans la

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
29
pratique de la gestion au sein de l’entreprise. Ainsi pour l’atteinte efficace et efficiente des
objectifs d’une entreprise, les dirigeants doivent mettre sur place un système de contrôle. Ce
dernier permettra aux dirigeants de procéder à une comparaison entre les résultats escomptés
et ceux réalisés. Dans le cadre de notre étude nous abordons trois aspects du contrôle Il s’agit
du contrôle stratégique, du contrôle de gestion et du contrôle budgétaire.
Le contrôle stratégique :
Il est basé sur une analyse du degré de réalisation des projets sur le long terme et
l’adaptation sur cette même période des méthodes et hypothèses de prévisions, des modes
d’organisation de la situation de la firme
Le contrôle de gestion :
Pour R. N. Anthony dans la fonction contrôle (1993), « le contrôle de gestion est un
processus par lequel les dirigeants influencent les membres de l’organisation pour mettre en
œuvre les stratégies de manière efficace et efficiente ». Cette définition :
- présente le contrôle comme une fonction d’accompagnement du déploiement de la stratégie.
Il permet de concrétiser les objectifs stratégiques au niveau de la gestion quotidienne et de
formaliser les aptitudes ou le savoir-faire du quotidien au niveau stratégique ;
- offre une vision marginale en soulignant l’implication des dirigeants dans le contrôle de
gestion et dans la définition du modèle de performance ;
- affirme l’importance de la gestion du couple coût-valeur en reformulant le concept
d’efficience.
De même, A. Burlaud et C. Simon, dans le contrôle de gestion (1997), abordent le
terme en soulignant le rôle du contrôle de gestion dans la coordination des comportements :
« Le contrôle de gestion est un système de régulation des comportements de l’homme dans
l’exercice de sa profession et, plus particulièrement, lorsque celle-ci s’exerce dans le cadre
d’une organisation ». Cette dernière (l’organisation) étant constituée d’êtres humains
poursuivant leurs objectifs propres qui sont généralement différents de ceux de l’organisation,
le contrôle de gestion met en place des dispositions qui conduisent à une convergence des
intérêts individuels vers l’objectif de l’organisation. Sa mise en œuvre est soumise à deux
conditions :
- le caractère ambigu des objectifs : si les objectifs ne sont pas correctement identifiable par
les membres d’une organisation, il est impossible de mettre en œuvre des dispositifs pour les
atteindre ; dans ce cas l’organisation n’est pas efficace et n’est donc pas performante ;

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
30
- la possibilité de mesurer des résultats : il est parfois impossible de quantifier les résultats
obtenus, soit parce qu’ils sont trop qualitatifs ou soit parce qu’il n’existe pas de
représentation de l’activité. Il est alors impossible d’évaluer l’efficience de l’organisation.
Le contrôle budgétaire :
Le contrôle budgétaire est une technique qui consiste à rapprocher périodiquement les
prévisions budgétaires et les réalisations. Cette technique permet de dégager les écarts
éventuels entre les montants réalisés et ceux budgétés (montants préétablis). Elle permet
aussi d’identifier les causes de ces écarts et de mettre en œuvre des actions correctives.
4. Quelques relations
Il s’agit de faire ressortir la relation entre la performance et le profil du dirigeant d’une
part et les activités administratives d’autre part.
4.1. Relation entre profil du dirigeant et performance
Nombreuses recherches sur les organisations ont fait état du rôle indéniable du
dirigeant sur le succès et l'échec de l'entreprise qu'il "pilote". Le dirigeant d'entreprise est
incontestablement la personne-clé pour une meilleure productivité et une compétitivité
efficace sur le marché mondial. Sweeney (1982: 91) est plus explicite à ce sujet lorsqu’il
affirme: « Les petites entreprises valent ce que valent les gens qui les dirigent. S'ils sont bons,
ils peuvent faire des choses exceptionnelles ». La même idée est reprise par UlfAf Trolle (cité
dans Daigne, 1984: 53) qui affirme ce qui suit: « il est rare que l'entreprise soit en situation
très grave et le dirigeant principal très bon et s'il est mauvais, il devrait inévitablement
partir... ».
A l'origine, la réussite d'une entreprise est conditionnée, dans une large mesure, par la
capacité de son dirigeant à exceller dans plusieurs des fonctions-clé de l'entreprise. Plus il est
compétent dans ses divers rôles, plus ses chances de succès sont élevées. Nombreuses sont les
études où le profil du dirigeant est reconnu comme pouvant influer sur la performance d'une
organisation. A cet effet, nous étudierons principalement quatre variables à savoir : le niveau
et le type de formation, l’expérience, l’âge et les excédents familiaux.
Le niveau et le type de formation : Pour cette variable, Mayer et Goldstein (1961: 101) ont
constaté, dans une étude sur les entreprises ayant pu passer le cap des deux premières années
d'existence, que leur succès était relié au niveau d'instruction élevé de leur propriétaire-

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
31
dirigeant. Par ailleurs, Gasse (1982: 65) soutient que le type et le niveau de scolarité du
dirigeant peuvent influencer d'autres variables telles que l'ouverture d'esprit, l'idéologie
d'affaires, le traitement de l'information et les performances générales de l'entreprise. Il en
ressort que le niveau d'instruction constitue une variable susceptible d'influencer
significativement l'utilisation des pratiques et techniques de management. Mais l'influence de
la formation académique sur l'utilisation des pratiques de management dans le monde des
affaires ne s'est pas avérée statistiquement significative. Robidoux et Gamier (1973), quant à
eux, dégagent une relation positive entre le taux de croissance et le niveau de scolarité du
propriétaire - dirigeant. Cependant, pour un même niveau d'instruction, aucun effet du type de
formation sur la performance de l'entreprise n'a été décelé dans leur étude. Par contre, il se
dégage des recherches réalisées par Idrissa (1989), en contexte africain, que plus le dirigeant
d’entreprise est formé en gestion, plus la productivité du capital de son entreprise est
meilleure. II est intéressant de souligner aussi les recherches faites par Douglas (1976: 461-
464) et desquelles il ressort qu'une corrélation significative n'a pu être établie entre le niveau
et le type d'instruction des propriétaires - dirigeants et le succès de leur entreprise en termes
de croissance. Ces résultats ne viennent pas nécessairement contredire les autres études, mais
indiquent plutôt la variabilité des résultats selon les contextes de recherches.
L’expérience : Pour ce qui est de l'expérience, Sweeney (1982: 95) affirme que la
compétence du créateur est généralement étroite et purement technique. Il manque
d'expérience et de savoir faire en matière de gestion, et c'est souvent pour cela qu'il échoue et
continue d'enregistrer des insuccès jusqu'à ce qu'il ait acquis une expérience suffisante. De
son côté, Idrissa (1989: 279) conclut après une étude sur les PME au Niger que plus le
dirigeant est expérimenté en gestion, plus l'entreprise qu'il dirige est rentable. Par ailleurs,
certaines recherches (Mayer et Goldstein, 1961; Sweeney, 1982) ont montré que les créateurs
qui disposent au départ d'une expérience de propriétaire - dirigeant essuient moins d'échecs.
L’âge : S'agissant de l'âge, il semble que l'entrepreneur parvient à son niveau de succès le
plus élevé lorsqu'il est rendu à sa pleine maturité (Cloutier, 1973: 95). Certaines études
(Mayer et Goldstein, 1961) ont montré par ailleurs qu'en deçà de l'âge de 40 ans, la
probabilité d'un échec est plus élevée. Selon Lalonde (1985: 76), le niveau et le type
d'instruction de même que l'expérience acquise en management seraient de nature à expliquer
les écarts de performance qu'on retrouve entre les entrepreneurs issus de groupes d'âges
différents.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
32
Les antécédents familiaux : Enfin, antécédents familiaux du propriétaire - dirigeant, il est
connu dans la littérature que ceux-ci jouent un rôle important dans l'entrepreneurship. Ils
expliquent en partie les facilités ou les difficultés que l'entrepreneur est prédisposé à
rencontrer. Cependant, l'influence de cette variable sur la performance d'une entreprise
existante n'est pas évidente. En effet, Lalonde (1985) n'a pas décelé dans son étude une
relation significative entre les antécédents familiaux des propriétaires - dirigeants et
l'utilisation qu'ils faisaient des pratiques et techniques de management dans les entreprises
qu'ils dirigeaient.
4.2. Relations entre activités administratives et performance
La cause principale des faillites d'entreprises généralement pointée du doigt est la
mauvaise gestion. Par ailleurs, le déclin d'une entreprise est très rarement brutal, il est
annoncé par des signes avant-coureurs qu'il faut savoir identifier et évaluer (Collard et al.
1985: 78).
Il serait peut-être plus intéressant de voir dans quelle mesure chaque élément du
processus managérial influe sur la performance de l'organisation. Les variables rattachées aux
pratiques de gestion (planification, organisation, direction, contrôle) se retrouvent dans les
fonctions-clés de l'entreprise à savoir: finance, marketing, production et ressources humaines.
C'est sous cet angle que nous les avons analysées.
4.2.1. Gestion financière
Autant un organisme humain anémié est exposé au risque d’extinction, autant une
entreprise sans ressources financières suffisantes est exposée au risque de faillite. La gestion
financière a toujours été une préoccupation majeure pour les gestionnaires et aujourd’hui, face
aux conditions économiques de plus en plus difficiles, aucune organisation ne peut survivre si
elle n’est dotée d’une gestion et d’une planification financière rigoureuse et adéquate.
Pour ce qui est des problèmes liés à la comptabilité, Bédard (1977: 16) souligne que
plus de la moitié des faillites de PME est causée par une comptabilité et une gestion financière
inadéquates. Il est de constat que l'absence de planification financière entraîne l'improvisation
régulière et le manque d’objectivité qui sont des pratiques périlleuses pour toute organisation.
Clute (1979) au terme de ses recherches menées sur 359 PME de Chicago constate que le
contrôle comptable est essentiel à la survie de la petite entreprise. Ses analyses visant à établir
une relation de cause à effet entre les difficultés financières des PME et la pauvreté de leur

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
33
système de contrôle montrèrent que 40% des entreprises étudiées devaient plus
spécifiquement leurs difficultés financières à de fortes lacunes en matière de contrôle.
Il faut par ailleurs remarquer que la finalité pour toute entreprise est la rentabilisation
du capital, elle doit donc connaître la capacité maximale d'endettement qui engendre
l'enrichissement de ce dernier. En effet, dans leurs études sur l'endettement et les défaillances
d'entreprise en France, Bordes et Mélitz (cités dans Malécot, 1992: 19) constatent une
corrélation positive entre les taux de défaillance et le ratio dettes sur production.
En somme, la littérature mentionne l'absence d'information, de planification et du
contrôle financier concernant notamment le crédit, les coûts, les budgets comme causes
majeures d'échecs des entreprises.
4.2.2. Gestion marketing
Le rôle exercé par le marketing dans le fonctionnement économique de l'entreprise
n'est plus à démontrer. Le monde est en effet caractérisé par des changements importants de
l'environnement sur le plan technologique, économique, concurrentiel, etc. Ces changements
ont des implications sur la gestion des entreprises en général et sur la gestion marketing en
particulier. La démarche marketing se caractérise dans un premier temps par le souci constant
de connaître le marché pour pouvoir mieux s’y adapter mais aussi l’anticipation sur les goûts
et aspiration future du marché c’est pour ça que Peter DRUKER dit qu’il n’y a que deux
fonctions dans l’entreprise : le marketing et l’innovation. Dans cet effort d’adaptation,
l’entreprise fait face à un certain nombre de problèmes et est contrainte de prendre un certain
nombre de décisions. Ces décisions sont entre autres relatives à la modification de
l’emballage, d’un produit, du lancement d’un nouveau produit, lancement d’une campagne de
communication. Pour prendre toutes ces décisions, les dirigeants ont besoin d’informations
concernant les marchés actuels et potentiels, identification des besoins des consommateurs,
connaissance des concurrents et de leurs actions, identification des méthodes d’accroissement
de la vente….
Pour Bédard (1977: 44), la satisfaction de la clientèle est un objectif déterminant de la
performance. Il affirme à cet titre que: « écouter le client, être attentif à ses besoins, à ses
exigences, à ses caprices même et y répondre intelligemment, est la clé du succès ».
Selon Lambin (1991: 1-37), Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les
dirigeants d'entreprises devaient opter pour une démarche marketing dont l'objectif principal

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
34
serait de satisfaire les besoins du client (ou consommateur); il estime en effet, que c'est là le
meilleur moyen pour l’entreprise d'atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité.
Il parait évident que la collecte des informations sur les besoins de la clientèle, les
tendances de marché aussi bien en amont qu’en aval, les forces et faiblesses des concurrents
et de l'entreprise... constituent une activité vitale pour toute entreprise soucieuse de son
développement et de la croissance de ses profits. Le défi de toute entreprise visant un
excellant niveau de performance, est de répondre mieux que les concurrents aux aspirations
de la clientèle, tout en offrant de bons prix sur le marché.
4.2.3. Gestion de production
Tout comme la fonction financière, la production est d’une importance vitale pour
l’entreprise. Elle lui permet principalement d'acquérir, d'emmagasiner et de transporter des
intrants et de les transformer en extrants (biens et/ou services) et de maintenir en bon état de
fonctionnement l'appareil de production (Kélada et al. 1986: 17).
Avec l’industriel américain Frédéric TAYLOR, le monde industriel et scientifique a
connu vers la fin du 19ème siècle les principes de gestion scientifique, portant sur les moyens
d'accroître la productivité par l'amélioration des méthodes d'exécution du travail. Ces
techniques et concepts portent, entre autres, sur le développement des méthodes et outils de
travail et de manutention, des systèmes de rémunération et de l'aménagement rationnel des
usines.
Pour atteindre ses objectifs de production, l'entreprise effectue diverses activités au
nombre des quelles nous pouvons citer principalement: la gestion des approvisionnements, la
gestion des stocks, la gestion de l'équipement et la gestion de la qualité.
4.2.4. Gestion des ressources humaines
Aussi vital que soit le système nerveux pour l’organisme humain, autant les ressources
humaines sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisation. En effet, ce sont
elles qui créent les objectifs, les innovations et les réussites pour lesquelles l’organisation est
destinée.
Pour atteindre ses objectifs, le service des ressources humaines obtient, utilise, évalue
et conserve le bon nombre de personnes, ayant les bonnes compétences et attitudes, pour doter
l'organisation de la main-d’œuvre dont elle a besoin. La difficulté vient du fait que
contrairement aux autres ressources (financières, matérielles...), elles sont des êtres animés

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
35
dotés de raison, de jugement et de sentiment. Ainsi, la façon dont elles sont gérées influence
grandement leur engagement envers l'organisation ; leur volonté à faire plus et mieux, à
innover et à être créatifs, donc, en bout de ligne, envers la productivité de l’organisation. Pour
les fins de notre recherche, nous nous sommes intéressés à l'analyse de cette activité de
gestion dans le secteur BTP.
En effet, le secteur emploie une main-d’œuvre importante. De plus, les contraintes de
variabilité propres à se secteur et les nombreux changements de techniques relatives à la
variabilité de la nature des chantiers conduisent les entreprises à rechercher une flexibilité de
l'organisation qui s'appuie inévitablement sur une gestion efficace et intelligente de la main-
d’œuvre. La gestion des ressources humaines dans le secteur BTP revient principalement à
gérer les interfaces entre les hommes au sein d'une même équipe ; entre celle-ci et le chef
chantier et entre celui-ci ou le conducteur des travaux et les services centraux de l'entreprise.
Du Tertre (1988: 72-81) note trois facteurs de productivité concernant essentiellement la
gestion des interfaces. Il s’agit de l’autorégulation, de la compétence et de la motivation.
Autorégulation
L'autorégulation est la capacité que possède l’ensemble de la main-d’œuvre employée
sur un chantier à faire face aux aléas et/ou dysfonctionnements qui surviennent et menacent
l'avancée des travaux. Pour opérationnaliser cette dimension, trois indicateurs sont mis en
évidence :
La stabilité de l'équipe : elle apparaît comme un facteur qui favorise une certaine entente
entre ouvriers et accroît les capacités d'anticipation face aux aléas ou dysfonctionnements et
d'autorégulation de l’équipe. Elle permet également de favoriser "l'auto - formation". Un ratio
est proposé pour suivre l'état de stabilité des équipes:
Nombre d'ouvriers "volants"5
Nombre total d'ouvriers
� Le "cycle majeur" de travail : sa mise en place apparaît aussi comme un déterminant
essentiel de productivité. Le cycle de type "majeur" est un cycle qui correspond à une
journée de travail (ou à une demi-journée). Il permet une intériorisation des normes de
travail selon l'heure de la journée et l'avancée du travail collectif; favorise l'autorégulation
5 "Méthodes et Construction" (cité dans Du Tertre, 1988) propose une norme de 40%.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
36
de la synchronisation des tâches au sein de l'équipe, en répartissant les charges physiques
et en supprimant la monotonie de travail. Un ratio et une situation type sont proposés:
Nombre de journées - hommes dans les cycles majeurs6
Nombre de journées - hommes au total
� L'indépendance de fonctionnement des équipes qui ont de trois à huit ouvriers est un
problème dans la mesure où elles doivent se partager entre elles différents moyens ou
équipements. C'est pourquoi, l'organisation du chantier doit tendre d'un côté à limiter le
nombre d'équipements devant servir à plusieurs équipes successives et à mettre au point
une étude de simulation qui permet d'optimiser les plannings. L'organisation du travail par
regroupement de tâches, par séquences indépendantes les unes des autres, permet de
renforcer l'indépendance ou la quasi-indépendance des équipes7
4.2.5. Compétences
Dans le secteur de construction, l'évolution des méthodes d’organisation des chantiers
contraint actuellement à rechercher d'une part, des compétences plus variées chez les ouvriers
et d'autre part, à mettre en place un dispositif de gestion des ressources humaines qui permette
aux salariés de voir leurs compétences évoluées.
Du Tertre (1988) identifie quatre facteurs à prendre en compte pour suivre l'évolution
des compétences:
� Le terme qualification est largement débattu dans le secteur de BTP dans la mesure où son
appréciation est difficile à effectuer, chaque entreprise ayant une certaine connaissance des
compétences de ses ouvriers. On peut toute fois considérer qu'un "plancher" de haute
qualification soit nécessaire aujourd'hui dans le domaine de construction. Ainsi la
qualification peut être appréciée par la formule suivante.
Nombre d'ouvriers hautement qualifiés et chefs d'équipes8
Nombre total d'ouvriers
6 "Méthodes et Construction" considère que 50% au moins des ouvriers d'un chantier devraient travailler en cycles
majeurs. 7 : Pour 90% des temps de chantier, l'indépendance ou la quasi-indépendance doit pouvoir être obtenue. 8 : "Méthodes et Construction" propose une norme de 30%.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
37
� La formation ou l'auto - formation : La main-d’œuvre doit être capable de suivre
l’évolution de la complexité et la diversité des techniques de constructions ainsi que les
contraintes de variabilité qui se développent dans les bâtiments et travaux publiques. Un
indicateur de suivi des efforts de formation a été ainsi conçu:
Nombre d'heures de formation pondérées par les coûts moyens9
Nombre d'heures de travail
� Le coût des finitions et reprises : Les retards de livraison des ouvrages apparaissent pour
une part significative liées au niveau de qualification de la main-d’œuvre dans la mesure
où c'est elle qui doit maîtriser les conséquences d'une négligence et/ou remédier au
caractère défectueux d'un équipement. L’évolution du nombre d'heures de reprises est donc
significativement liée à l'évolution des compétences de la main-d’œuvre:
Nombre d'heures de reprises10
Nombre d'heures travaillées
� Concernant le coût des sinistres, certaines études ont révélés que 43% des sinistres dans le
BTP doivent être attribués à des erreurs d'exécution (43% à des erreurs de conception, 6%
à des matériaux défectueux et 8% à des insuffisances d'entretien). On peut donc conclure
que les coûts des sinistres sont à 43% liés au niveau de qualification collective de la main-
d’œuvre du chantier; et donc d'un certain niveau de compétence. Les coûts des sinistres
dépassent souvent 1% du chiffre d'affaires, ils devraient être réduits profondément ou tout
au moins ramenés à 0.5% (Méthodes et Construction).
4.2.6. Motivation
La motivation est l’un des facteurs les plus importants pour toute entreprise en
quête d’une meilleure productivité. Elle conditionne non seulement les réactions de la
main-d’œuvre face aux aléas et/ou dysfonctionnements mais aussi la qualité du travail
9 : "Méthodes et Construction'’ propose une norme de 1%.
10 : Les normes peuvent être différentes en fonction des corps de métiers: 5% pour les travaux en béton armé,
2% pour les autres travaux (électricité, revêtements de sol...) peuvent être considérés comme raisonnables

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
38
exécuté. La motivation semble être activée par une politique salariale judicieuse, mais elle
est surtout la résultante d'un certain type d'organisation de la production celle-ci devant
s'appuyer sur les caractéristiques psychologiques des individus (Werther et al. 1990: 416).
Selon Du Tertre, (1988: 60). La politique la plus motivante est celle qui octroie des
responsabilités bien spécifiées aux équipes, qui favorise une progression possible du
personnel par des phases variées de formation sur le tas permettant aux ouvriers de
compléter leurs connaissances techniques, qui maintient l'équipe régulièrement informée
quant au déroulement du chantier. Quatre facteurs peuvent être ainsi dégagés:
l'information du personnel, la gestion de "carrière" interne à l'entreprise, la prise en
compte des résultats et l'ancienneté dans l'entreprise.
� L'information est un élément qui favorise la motivation. En effet, elle permet aux
ouvriers de se situer par rapport au déroulement du travail et à la dynamique de
l'entreprise dont ils font partir. Le rôle de chaque individu doit être précis, connu et
reconnu; les attributions de tâches doivent se dérouler à temps et dans des formes
reconnues; les résultats du travail doivent en retour être spécifiés et communiqués.
� Les possibilités de promotion interne à l'entreprise représentent un facteur essentiel de
la motivation. Elles ont un effet d’entraînement positif qui pousse chaque individu à se
surpasser. Elles sont liées à la façon dont l’entreprise anime ses plans de formation ;
prend soin de l'élévation des compétences ; des déroulements de chantier et mène sa
politique d'embauché / débauche.
� L'importance du nombre d'années (l'ancienneté) est un instrument qui influence
significativement le degré d'intégration du personnel à l'entreprise.
� L'intéressement aux résultats est aussi un moyen de plus en plus employé pour
influencer positivement la motivation du personnel. Elle peut cependant conduit à
l'individualisation des salaires qui peut influencer négativement le dynamisme collectif
nécessaire pour dégager des gains de productivité

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
39
Paragraphe 2 : Méthodologie de la recherche
Ce paragraphe présente la méthodologie suivie, la nature des données et les outils
d’analyse.
A- Nature et collecte des données
1. Nature des données
Pour l’atteinte des objectifs de cette étude, nous avons eu recours à des variables tant
expliquées qu’explicatives qui sont classées en variables qualitatives et quantitatives.
Définition des variables de l’étude
Les variables retenues sont de deux ordres : les variables expliquées et celles explicatives.
� Les variables expliquées : elles désignent les différentes facettes de la performance
de l’entreprise. Notre étude va particulièrement s’appuyer sur les performances :
économique et financière ; commerciale et organisationnelle.
� Les variables explicatives : Il s’agit des variables qui permettent de donner une
explication aux différentes facettes de la performance de l’entreprise. Les variables
retenues pour les fins de cette étude sont essentiellement : la rentabilité économique et
financière, le cycle d’exploitation, les ratios de structure et la motivation.
2. Méthodes de collecte des données
Ces méthodes varient selon qu’il s’agit de données quantitatives ou qualitatives
a. Méthodes de collecte des données qualitatives
Les données relatives à l’analyse de la performance organisationnelle ont été obtenues
à l’aide de questionnaires anonymes constitués de questions fermées adressés au personnel de
l’entreprise. Ce dernier, composé de 216 personnes, se décompose comme suit : 24 membres
au niveau de l’administration ; 49 au garage (mécanique, soudure, vulcanisation et tournage) ;
122 ouvriers et 21 péagistes. Notre population mère étant de 216 personnes, nous avons
choisir un échantillon représentatif de 44 personnes (20 % de la population mère) constituée
de :
- 4 cadres de la direction ;
- 10 garagistes ;
- 25 ouvriers ;

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
40
- 5 péagistes.
b. Méthodes de collecte de données quantitatives
Les données qui nous ont permis de porter un jugement sur la performance
économique et financière ont été recueillies dans les états financiers, les statistiques de la
direction des ressources humaines sur la période de 2004 à 2008.
c. Recherches documentaire
La recherche documentaire, très déterminante dans notre travail nous a permit de
procéder à la collecte des informations existantes. Ainsi nous avons eu recours à diverses
sources de données secondaires à savoir : l’INSAE, la DGAE, le ministère des TP et divers
sources de documentation telle que la bibliothèque de l’ENAM, de l’EPAC et de la
FASEG ainsi que les sites internet.
B. Les outils d’analyse des données
L’analyse des données est faite au moyen de quelques outils statistiques et des outils
d’analyse de la performance économique et financière.
1. Outils d’analyse de la performance économique et financière
L’analyse de la performance économique et financière est faite à travers l’étude de la
rentabilité et de la productivité.
1.1. Les outils de diagnostique financier
Tout comme le médecin examine son patient dans le but d’identifier son mal afin de
pouvoir lui prescrit une ordonnance, l’analyste financier à travers le diagnostique financier
consulte son patient (l’entreprise) en se basant sur les éléments suivants : l’équilibre financier,
le degré de liquidité, le degré de solvabilité et de rentabilité. Avant de porter son diagnostique,
l’analyste financier doit effectuer un travail préalable sur les états financiers de l’entreprise.
1.1.1. Préalable à l’analyse financière
Le but essentiel des états financiers est de fournir des informations sur la situation
patrimoniale et financière de l’entreprise et sur son évolution. Ces informations issues de la

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
41
comptabilité générale fournissent des informations comptables qui ne rendent pas compte de
la réalité conjoncturelle et donc ne permettent pas directement de faire un diagnostic
financier. Dès lors, ces informations doivent subir des retraitements et des restructurations.
• Restructuration du bilan :
La restructuration du bilan consiste à transformer un bilan comptable en bilan
fonctionnel (dans la perspective d’une continuité d’activité) en éliminant du bilan comptable
les éléments comptables dits de « non valeur », à apprécier les éléments du patrimoine de
l’entreprise à leur juste valeur et à les regrouper afin de dégager des agrégats plus significatifs
indispensables à l’analyse.
• Restructuration du compte de résultat :
Tout comme le bilan, le compte de résultat est restructuré et regroupé afin de dégager
des agrégats plus significatifs sur le plan de l’analyse financière. Ainsi, on a dissocié
clairement trois catégories de comptes de résultat qui sont à l’origine du résultat global de
l’entreprise. Il s’agit de :
- chiffre d’affaires qui regroupe les prestations de service, les recettes de location et les autres
produits d’exploitation déduction faite des subventions d’exploitation car celles-ci
constituent une réduction de charges d’exploitation.
- les charges financières sont dissociées des produits financiers et ne sont donc pas reprises
dans le calcul du résultat financier. Les charges financières résultent des dettes contractées
par l’entreprise pour financer l’ensemble de ses actifs alors que les produits financiers
résultent uniquement des actifs financiers de l’entreprise (immobilisations financières et
actifs circulants).
- les dotations aux amortissements, réduction de valeur et provision pour risques et charges
(dotations et reprises), sont regroupées au sein de chacun des volets (exploitation, financier
et exceptionnel) du compte de résultat car ils constituent des charges non décaissées et des
produits non encaissés.
1.1.2. Les outils d’analyse du bilan et du compte de résultat
L’analyse du bilan est axée sur l’équilibre financier, la détermination et l’interprétation
des ratios de solvabilité et de liquidité de la société NATRAC sur une période de 5ans (2004-
2008). L’analyse du compte de résultat est faite sur la même période à partie de la
détermination de quelques ratios, les plus significatifs.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
42
� Outils d’analyse du bilan
Afin de vérifier que le principe de l’équilibre financier est respecté, notre démarche
consiste à calculer et étudier l’évolution dans le temps des ratios de structure et des trois
agrégats suivants : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie
nette.
� Le fonds de roulement net global
Pour assurer l’équilibre financier, il importe que le BFR compte tenu de son caractère
structurel soit financé par le FRNG. Ce dernier est défini par la différence entre les ressources
stables ou permanentes et les actifs fixes ou stables encore appelés actifs immobilisés.
La formalisation mathématique de FRNG est :
� Le besoin en fonds de roulement
Lorsque le crédit fournisseurs suffit exactement à financer les stocks et à donner des
délais de règlement aux clients l’activité ne montre aucun besoin en fonds de roulement
(BFR=O) et ne dégage aucune ressource financière.
Un besoin en fonds de roulement apparaît lorsque le montant des stocks et des créances est
supérieur aux dettes à court terme (BFR > O) ; dans le cas contraire, l’exploitation génère un
excédent de financement (BFR < O). Le principe est de couvrir les emplois d’exploitation par
les ressources d’exploitation. La formalisation mathématique du BFR est la suivante :
La variation du BFR est provoquée par un nombre important de facteurs qui
intéressent la gestion du cycle d’exploitation de l’entreprise. Au nombre de ces facteurs, Nous
pouvons citer :
- la longueur du cycle d’exploitation et de l’importance des stocks nécessaires ;
- la durée des délais de paiement obtenus des fournisseurs ;
- la durée des délais de paiement accordés aux clients ;
- l’évolution du chiffre d’affaires.
(Par le haut du bilan) : FRNG= RS - AI
(Par le bas du bilan) : FRNG = (AC+TA) – (PC+TP)
BFR = Actifs Circulant (AC) – Passif Circulant (PC)

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
43
� Trésorerie nette (TN)
La trésorerie nette apparaît comme un résidu résultant du fonds de roulement et du
BFR ou la différence entre les valeurs disponibles et les ressources financières à court terme.
Une trésorerie nette positive signifie que le fonds de roulement est supérieur au BFR, plus
précisément l’entreprise dispose d’un excédent de liquidité.
Par contre, une TN négative signifie que le FRNG est inférieur au BFR ; l’entreprise
est obligée de recourir au découvert bancaire (crédit bancaire de courte durée). La TN peut se
calculer de deux manières :
� Les ratios de structure
Pour une analyse approfondie, il est opportun de calculer certains ratios dont les plus
significatifs sont récapitulés dans le tableau ci-après
� Outils d’analyse du compte de résultat
1.2 Les outils d’analyse de la Rentabilité
Pour évaluer la rentabilité de la société NATRAC, nous avons étudié sa rentabilité
économique et financière sur une période de 5 ans.
Ratios Formules
Ratio d’Autonomie financière RAF = CAPRO / dettes
Ratio de liquidité RLG = (AC+TA) / (PC+TP)
Ratio de solvabilité RS = Actif total réel / Capitaux étranglés
Créance client
Rotation créance client (RCC)
RCC = CA TTC / Client et compte rattaché
Délai client =12 / RCC ou 360 / RCC
Ratio
d’exploitation
Dette fournisseur
Rotation dette fournisseur (RDF)
RDF=Achat TTC / fournisseur et compte rattaché
Délai fournisseur = 12 / R DF ou 360 / R DF
TN = TA – TP ; TN = FRNG – BFR

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
44
� Rentabilité économique
Encore appelée rentabilité des capitaux investis (Return On Investment : ROI des
Anglo-saxons), la rentabilité économique a pour but de donner une indication sur la capacité
bénéficiaire de l’entreprise en neutralisant la rémunération du capital investi, qu’il s’agisse de
fonds propres ou fonds de tiers. Elle permet de comparer l’EBIT (résultat d’exploitation)
obtenu pendant une période au montant des biens nécessaires pour obtenir ce résultat. Ainsi,
elle peut être exprimée à l'aide du ratio suivant:
Si l’EBIT se révèle durablement insuffisant pour couvrir le coût du capital, ce
déséquilibre structurel peut à terme mettre l’entreprise en difficulté11.
En termes de contribution au PIB elle permet de comparer la valeur ajoutée à
l’ensemble des valeurs immobilisées. Elle peut être exprimée à l'aide du ratio suivant:
� Rentabilité financière
Encore appelée Return On Equity : (ROE) chez les Anglo-saxon, elle exprime la
rentabilité de la valeur comptable des valeurs propres dont dispose l’entreprise. Elle permet de
comparer le résultat net obtenu pendant une période au montant des capitaux propres investis.
Ainsi, elle peut être exprimée à l'aide du ratio suivant:
Ce ratio permet aux actionnaires de juger si l’entreprise a réalisé un résultat acceptable au
moyen du capital à risque dont elle dispose et s’il est possible de distribuer des dividendes.
On peut aussi déterminer la rentabilité financière par le ratio suivant :
Résultat net de l’exercice / nombre d’actions (Earning Per Share : EPS)
� Les outils d’analyse de la Productivité
• La productivité du travail
11 ‘’Gestion financière’’ théorie et pratique (2006)
ROI brut avant impôt = EBIT /Actif total ;
ROE = bénéfice net / capitaux propres
R = valeur ajoutée / valeurs immobilisées

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
45
Elle est le rapport entre la valeur ajoutée et le coût du travail. Elle met en évidence les
ressources humaines dans la création de la richesse de l’entreprise. Elle est calculée par le
ratio suivant :
• La productivité du capital
� Les outils d’analyse de la couverture des charges d’exploitation
• Coefficient d’exploitation (CE)
Ce coefficient mesure le taux d’exploitation des moyens de l’entreprise
� Les outils d’analyse de l’équilibre de gestion
• Taux de valeur ajoutée
• Petit équilibre
2. Outils d’analyse de la performance organisationnelle
Pour apprécier la performance organisationnelle, nous avons utilisé les effectifs et les
fréquences calculés à partie des réponses obtenues des questionnaires administrées au
personnel.
PT = Valeur ajoutée / coût salarial
CE = Charges d’exploitation / Produits d’exploitation
Tx VA = valeur ajoutée / Production
P Equi = CA / Charges d’exploitation
PC = valeur ajoutée / consommation intermédiaire

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
46
C. Cadre de validation des hypothèses
Après la présentation et l’analyse des variables de notre étude, nous allons procéder à
la vérification des hypothèses de recherche.
Hypothèse 1 : L’absence de motivation du personnel pourrait constituer un frein à la
performance de la NATRAC.
La validation de la première hypothèse est faite sur la base d’une analyse des réponses
obtenues grâce aux questionnaires relatifs à : l’information du personnel, les possibilités de
promotion interne, l’importance du nombre d’année (l’ancienneté) et l’intéressement aux
résultats. Elle est validée par une majorité simple (51%) des réponses allant dans ce sens.
Hypothèse 2: La non-conformité des délais client et fournisseur et le non respect de
l’équilibre financier constitueraient un frein à la performance de la NATRAC.
Elle est validée sur la base de la confrontation des délais client et fournisseur et
l’analyse des ratios d’équilibre. Au cas où les délais client sont inférieurs aux délais
fournisseur, et l’équilibre financier respecté, l’hypothèse est rejetée.
Hypothèse 3 : La richesse créée par la NATRAC ne serait pas suffisante pour couvrir ses
charges d’exploitation.
Elle est validée sur la base de l’analyse des taux de productivité des facteurs travail et
capital et du taux de couverture des charges d’exploitation.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
47
Dans ce chapitre, nous présentons et analysons les variables de notre étude, ensuite la
validation des hypothèses, nous allons également faire des suggestions et tirer une conclusion.
SECTION 1 : Présentation et analyse des résultats de l’enquête
Dans cette section, nous avons présenté et analyser les données relatives aux variables
qualitatives et quantitatives.
Paragraphe1 : Présentation et synthèse des données sur les variables qualitatives
Après dépouillement du questionnaire, les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :
1 : Présentation
Tableau n° 1
Variables expliquées Variables explicatives
variables 1 an 2 ans 3 ans 4 ans Au-delà ancienneté Fréquences Néant 8,33% Néant Néant 91,67%
variables oui non ne sait pas - - Planning d’élaboration des objectifs Fréquences 25% 50% 25% - -
variables oui non ne sait pas - - Programmes de formation Fréquences 8,33% 50% 41,67% - -
variables oui non ne sait pas - - structure de contrôle Fréquences 27,27% 59% 13,64% - -
variables oui non ne sait pas - - efficacité de la structure de contrôle Fréquences 60% 20% 20% - -
variables oui non ne sait pas - - cohésion entre les directions et les services Fréquences 75% Néant 25% - -
variables oui non ne sait pas - - mécanisme de rémunération lié aux performances Fréquences 8,33% 50% 41,67% - -
variables oui non ne sait pas - - Réunions périodiques Fréquences 53,37% 40,91% 5,63% - -
variables mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle ne sait pas Périodicité Fréquences 83,33% Néant Néant Néant 16,27%
variables oui non - - - Permutation Fréquences 16,67% 83,33% - - - souhait du personnel variables A B C - -
CHAPITRE 3 : ANALYSE EMPIRIQUE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
48
Fréquences 75% 91,67% 83,33% - -
A : Améliorer les conditions de vie et de travail
B : Améliorer la motivation du personnel
C : Sensibiliser le personnel sur le lien entre la pérennité de l’emploi et les performances de l’entreprise
2 : Synthèse
Une analyse du tableau n°1 montre qu’en matière de motivation, l’ancienneté joue
favorablement sur la performance de la NATRAC.
En ce qui concerne l’information, on remarque qu’il y a une cohésion entre les
différents directions et services et que des réunions périodiques s’organise dans la société,
mais qu’il n’y a pas un planning d’élaboration des objectifs ni de structure de contrôle. Ce qui
influence négativement son efficacité.
Quant à la promotion, on remarque que le personnel ne connaît pas de permutation de
poste et qu’il n’existe pas de programmes de formation.
En fin quant à l’intéressement au résultat, la NATRAC ne dispose pas d’un mécanisme
de rémunération lié à la performance.
Paragraphe 2 : Présentation et analyse des données sur les variables quantitatives
Dans ce paragraphe, nous présentons et analysons toutes les variables quantitatives.
A. Présentation et analyse des données sur l’équilibre financier et le cycle d’exploitation
Il s’agit ici de présenter et d’analyser les ratios d’équilibre financier et du cycle
d’exploitation.
1. Présentation et analyse des données sur l’équilibre financier
1.1. Présentation
Tableau n° 2
ANNEES
Ratios 2004 2005 2006 2007 2008
Ratio de financement de l'actif 1,2901 1,1855 1,2875 1,2385 1,0006
Ratio d’Autonomie financière 1,6422 5,7714 1,7687 1,1577 1,0045
Ratio de liquidité 1,5609 1,9033 1,4573 1,304 1,0006
Ratio de solvabilité 2,6422 6,7714 2,7687 2,1577 2,0045

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
49
1.2. Commentaires :
D’après la lecture de ce tableau, nous remarquons que les ratios de financement de
l’actif, d’autonomie financière, de liquidité et de solvabilité sont supérieurs à l’unité. Le ratio
de financement de l’actif a connu une baisse en 2005 ; un accroissement en 2006, et sur les
deux dernières années, une baisse pour se fixer à son plus bas niveau (1,0006) en 2008. Les
trois autres ratios (autonomie financière ; liquidité et solvabilité) ont connu une hausse en 2005
mais ont décru de façon continue sur la période de 2006 à 2008, où on observe que l’autonomie
financière et la liquidité sont trop proches de l’unité. Il faut également remarquer que tous les
ratios ont atteint leur plus haut niveau en 2005 et leur plus bas niveau en 2008.
1.3. Analyse
L’évolution du ratio de financement de l’actif nous permet d’affirmer que le principe
de l’équilibre financier est respecté. Cependant, ce ratio dans son évolution s’est trop rapproché
de l’unité en 2008 (1,0006) si cette tendance continue, elle peut mettre l’entreprise dans une
situation très critique.
La tendance générale du ratio d’autonomie financière nous permet de conclure que la
société est financièrement autonome. Elle dispose d’énormes ressources pour financer ses
activités et donc fait très peu appel aux fonds extérieurs et par conséquent supporte très peu
de charges financières. Mais cette tendance révèle une décroissance continue depuis 2006 qui
a atteint son plus faible niveau en 2008 (1,0045) si cette tendance suit son cours, la NATRAC
risque de perdre sous peu son autonomie financière.
Quant à sa liquidité, l’évolution de ce ratio nous permet d’affirmer qu’elle est en
mesure de régler ses dettes à court terme avec ses ressources de courte durée. Mais ce ratio
s’est trop rapproché de l’unité (1,0006) en 2008 après une décroissance continue depuis
2006. Si rien n’est fait, elle risque sous peu de manquer de ressources de courte durée sensées
couvrir ses dettes à court terme.
On remarque enfin que les ratios de solvabilité sont largement supérieurs à l’unité ce
qui lui offre la possibilité de solder l’ensemble de ses dettes exigibles à partir de ses propres
ressources et donc d’être crédible.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
50
2. Présentation et analyse des données sur le cycle d’exploitation
2.1. Présentation
TABLEAU n° 3
ANNEES
Agrégats 2004 2005 2006 2007 2008
Le fonds de roulement net 357756799 228950755 384288273 327626860 841270
le besoin en fonds de roulement 299352031 233265559 491630578 183270668 12754858
la trésorerie nette 58404768 -4314804 -107342305 144356192 -11913588
Créance client 1,1851 0,875 1,0007 0,6511 0,5722
Rotation créance client 10,1257 13,7143 11,9916 18,4303 20,9717 Ratios
d’exploitation Dette fournisseur 0,49 0,2333 1,0767 0,6403 0,3795
Rotation dette fournisseur 24,4898 51,4359 11,1452 18,7412 31,6206
Graphique n° 1
2.2. Commentaires
La lecture de tableau n°3 montre que le fond de roulement net global a évolué en dent
de scie sur toute la période et a atteint son plus bas niveau (841270) en 2008. Le besoin en fond
de roulement a évolué également en dent de scie mais a été supérieur au FRNG en 2005 ; 2006
et 2008. La trésorerie nette a eu la même tendance que le BFR mais négative en 2005 ; 2006 et
-200000000
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
1 2 3 4 5
CA
FRN
BFR
TN

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
51
2008. Les délais de rotation des dettes fournisseur sont supérieurs aux délais de rotation des
créances clients sauf en 2006.
Quant au graphique n°1, on remarque que les agrégats ont évolués en dent de scie sur
toute la période. Le CA est resté supérieur au BFR. On remarque également que pour la
dernière période, le BFR et le FRNG ont baissé plus que proportionnellement par rapport au
CA. La TN quant à elle, a été négative en 2005, 2006 et 2008.
2.3. Analyse
La NATRAC dispose d’une bonne politique commerciale car sur toute la période, on
remarque que le CA est resté supérieur au BFR et que les délais de rotation des créances
client sont inférieurs aux délais de rotation des dettes fournisseurs sauf en 2006. Cela signifie
que ses clients la règlent bien avant qu’elle ne règle ses fournisseurs. Elle a donc la possibilité
d’exploiter momentanément ses fonds pour d’autres activités avant l’échéance des délais
fournisseur.
On remarque aussi que le FRNG est resté positif sur toute la période et supérieur au
BFR sauf en 2005, 2006 et 2008 où le BFR a été supérieur ce qui a induit une trésorerie nette
négative pour ces trois années.
B. Présentation et analyse des données sur la rentabilité économique et financière et la
productivité
Les variables relatives à la rentabilité économique et financière et la productivité sont
présentées ainsi qui suit :
1. Présentation et analyse des données sur la rentabilité économique et financière
1.1. Présentation
TABLEAU n° 4
ANNEES
Agrégats 2004 2005 2006 2007 2008
Marge brute 25,46 % 21,68 % 21,13 % -26,56 % -4,96 %
Marge nette 8,98 % -24,82 % 8,59 % -46,54 % -24,15 %
Ratio de Rent. Ecoq. (ROI) 4,47 % -5,87 % 3,31 % -8,45 % -4,05 %
Ratio de Rent. Finan. (ROE) 4,22 % -7,61 % 3,84 % -16,50 % -12,23 %
Effet de massue -1,8350 0 -0,6407 -1,7581 0

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
52
Graphique° 2
1.2. Commentaires
La lecture du tableau n°4 fait apparaître des taux de marge brute supérieurs à 21 %
pour les trois premières années, mais en 2007 et 2008, on observe des taux inférieur à 0
(respectivement -26,56 % et – 4,96 %). Le taux de marge nette quant à lui a évolué en dent de
scie, mais négatif en 2005, 2007 et 2008 respectivement -24,82 % ; - 46,54 % et - 4,05 %. Les
ratios de rentabilité économique et financière présentent la même tendance. Ils ont évolués en
dent de scie mais négatifs en 2005, 2007 et 2008. Le levier financier quant à lui a été inférieur
à 0 en 2004, 2006 et 2007 mais nul en 2005 et 2008.
Sur le graphique n°2, nous constatons que le CA, le RE et l’EBE ont évolués en dent
de scie et ont eu presque la même tendance. Sauf en 2008, où on remarque un accroissement
de l’EBE et du RE alors que le CA a connu une baisse.
1.3. Analyse
La lecture du tableau n°4 montre que de 2004 – 2006, sur 100 F de CA, la NATRAC
réalise une marge brute respectivement de 25,46 F; 21,68 F et 21,13 F Tandis qu’en 2007 et
2008, ses taux de marge brute ont été inférieurs à 0 respectivement de -26,56 % et - 4,96 %. Si
cette situation perdure, elle peut mettre la société en péril dans un bref délai.
Pour ce qui concerne les taux de marge nette, ils ont été positifs en 2004 et 2006 mais
négatifs en 2005, 2007 et 2008. Cela est dû aux charges d’amortissement trop élevées qui
représentent respectivement environ 16,48 F ; 46,5 F ; 12,54 F; 19,98 F et 19,19 F pour 100 F
de CA réalisé. Ces pourcentages trop importants peuvent s’expliquer par le fait que la
NATRAC réalise de faibles niveaux de chiffre d’affaires et par sa politique d’amortissement
-400000000
-200000000
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
1 2 3 4 5
CA
EBE
RE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
53
qui la contraint à engager les mêmes charges d’amortissement quelle que soit son niveau
d’activité.
Comme le montre le graphique n°2, de 2004 à 2007, l’EBE et le RE ont la même
tendance que le CA sauf en 2008 où on observe une croissance de ces deux agrégats même
s’ils sont restés inférieurs à 0, alors que le CA a baissé. Cela est dû à une restructuration des
charges d’exploitation. Comme le montre le tableau de variation relative des agrégats en
Annexe 7, en 2008, pour une baisse de 7,78 % du CA, le coût de production des produits finis
vendus a baissé de 20,35 % et les autres charges de production ont baissé de 53,02 % ce qui a
induit un accroissement de la VA de 262,91 %. Cependant, les charges de personnel ont
augmentées de 30,38 % donc l’accroissement de l’EBE est dû à la restructuration des charges
de production. Le tableau fait apparaître également une réduction des charges d’amortissement
de 11,43 % donc l’accroissement du RE est dû surtout à la restructuration des charges de
production mais aussi de celle des dotations aux amortissements.
Une lecture du tableau n°4 nous indique des ROI positifs en 2004 et 2006 ; tandis
qu’en 2005, 2007 et 2008, ils sont inférieurs à 0. Or par hypothèse, la décomposition de la
formule du ROI fait apparaître le produit entre le ratio de marge nette et celui de rotation de
l’actif. En 2004 et 2006, les ROI sont inférieurs aux taux de marge nette. Ce qui signifie que le
ratio de rotation de l’actif est inférieur à 1, faisant apparaître un faible degré d’utilisation des
ressources de l’entreprise. Par conte, en 2005, 2007 et 2008, les ROI, même si ils sont négatifs
sont restés supérieurs aux taux de marge nette. Ce qui fait apparaître un accroissement du degré
d’utilisation des ressources de l’entreprise. Les ROE sont positifs et supérieurs au taux
créditeur des banques (3,5) en 2004 et 2006. Il est donc profitable pour l’entreprise d’utiliser
ses ressources à l’interne. Alors qu’en 2005, 2007 et 2008, ces taux sont inférieurs à zéro.
L’entreprise gagnerait en plaçant ces ressources dans des banques.
On remarque que l’effet de levier financier est égal à 0 en 2005 et en 2008 cela est dû
au fait que la NATRAC n’à contracter aucune dette en ces années. Par contre, en 2004, 2006
et 2007, l’effet est inférieur à 0. Ce qui veut dire que le ROI est inférieur au taux d’intérêt
moyen grevant le fonds de tiers. Une augmentation du niveau d’endettement réduirait la
rentabilité des capitaux propres.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
54
2. Présentation et analyse des données sur la couverture des charges et d’équilibre de gestion
2.1. Présentation
TABLEAU n° 5
ANNEES
Agrégats 2004 2005 2006 2007 2008
Productivité du travail 3,7595 2,1475 2,7179 -0,6283 0,785
Productivité du capital 2,2476 0,9299 2,9445 -0,5797 1,0845
Coefficient d'exploitation 0,8997 1,2195 0,9023 1,4423 1,2165
Taux de valeur ajoutée 0,6465 0,5162 0,4273 -0,094 0,1724
Petit équilibre 1,1115 0,82 1,1083 0,6933 0,822
2.2. Commentaires
La productivité du travail est supérieure à l’unité de 2004-2006 mais inférieure à 0 en
2007 et à 1 en 2008.
Quant à la productivité du capital, elle a évoluée en dent de scie et supérieure à l’unité
en 2004, 2006 et 2008. Par contre en 2007, elle est inférieure à 0.
Le coefficient d’exploitation quant à lui est resté proche de 90 % en 2004 et en 2006,
mais supérieur à 100 % en 2005, 2007 et 2008.
Le taux de VA a connu une dégradation continue sur la période de 2004 – 2007 où il
atteint son plus bas niveau (- 9,4 %) pour ce fixer à 17,24 % en 2008.
Le petit équilibre a été supérieur à l’unité en 2004 et 2006 mais inférieur à 1 en 2005 ;
2007 et 2008.
2.3. Analyse
La tendance de la productivité du travail nous permet de conclure que la NATRAC a
créé suffisamment de richesses de 2004 à 2006 pour couvrir ses charges salariales. Mais en
2007 et 2008, sa VA a été insuffisante pour les couvrir.
Quant à la productivité du capital, en 2005, sa VA a été absorbée par les charges
d’amortissement; mais en 2007, sa VA a été quasiment négative.
Par rapport à la structure des charges d’exploitation de la NATRAC, nous pouvons
affirmer qu’elle parait moins saine sur toute la période parce que le coefficient d’exploitation
moyen est de 113,61 %. Ce qui signifie que ses ressources ne sont pas utilisées avec
efficience.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
55
Le taux de VA a connu une dégradation continue sur la période de 2004 à 2007 où il a
atteint son plus bas niveau (-9,4 %) pour se fixer à 17,24 % en 2008. la moyenne de ce taux
sur toute la période est de 33,37 %. Les consommations intermédiaires occupent 66,63 % de
la production. Nous pouvons donc conclure que la société n’utilise pas ses ressources avec
rationalité.
Le ratio du petit équilibre est supérieur à l’unité en 2004 et en 2006 ce qui montre que
la NATRAC a pu couvrir ses charges d’exploitation par ses recettes d’exploitation. Par contre
en 2005, 2007 et 2008, ce ratio est inférieur à un ce qui prouve qu’elle a éprouvé des
difficultés à couvrir ses charges d’exploitation avec ses recettes d’exploitation. La moyenne
sur toute la période (91,10 %) est inférieure à l’unité. Ce qui signifie que le petit équilibre
n’est pas réalisé.
SECTION 2 : VERIFICATION DES HYPOTHESES, DIFFICULTES, LIMI TES DE
L’ETUDE ET SUGGESTIONS
Cette section est consacrée à la vérification des hypothèses de recherche ; elle présente
également les forces et faiblesses de la société NATRAC, les suggestions et la conclusion.
Paragraphe1 : Vérification Des Hypothèses
La vérification des hypothèses se fait sur la base des analyses de la section précédente.
Hypothèse1 : L’absence de motivation du personnel pourrait constituer un frein à la
performance de la NATRAC.
Il ressort de notre étude que la politique de motivation de la NATRAC comporte des
insuffisances qui ne favorisent pas l’amélioration de sa performance. Après dépouillement du
questionnaire et synthèse des résultats, nous avons remarqué que :
- Le personnel de la NATRAC en grande majorité (91,67 %) a une expérience
professionnelle de plus de 5 ans il est donc intégré à ses activités.
- La circulation de l’information, n’existe pas car il n’y a ni planning
d’élaboration des objectifs ni de structure de contrôle.
- Il n’y a pas de promotion interne du personnel
- Il n’y a pas non plus une politique d’intéressement au résultat
De ce qui précède, nous pouvons conclure que l’hypothèse n°1 est vérifiée.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
56
Hypothèse n° 2 : La non-conformité des délais client et fournisseur et le non respect de
l’équilibre financier constitueraient un frein à la performance de la
NATRAC .
Des différentes analyses faites sur le cycle d’exploitation et l’équilibre financier de la
NATRAC, il ressort que l’équilibre financier est respecté et que l’entreprise est crédible.
Quant à son exploitation, elle respecte les principes financiers en matière de délai
clients - fournisseurs. Nous pouvons de ce fait conclure que l’hypothèse n° 2 n’est pas
vérifiée.
Hypothèse n° 3 : La richesse créée par la NATRAC ne serait pas suffisante pour couvrir
ses charges d’exploitation.
D’après l’analyse des tableaux n°5, nous retenons que Les ressources de la société ne
sont pas utilisées avec efficience. Elle ne crée donc pas suffisamment de richesse pour couvrir
ses charges d’exploitation d’où l’hypothèse 3 est vérifiée.
Paragraphe 2 : Les forces et faiblesses de la société NATRAC, les suggestions, Difficultés
et Limites
Dans ce paragraphe, nous présentons les forces et les faiblesses de la société
NATRAC, nos suggestions ; les difficultés rencontrées au cours de cette étude et ses limites.
A. Les forces et faiblesses
Notre étude sur la performance de la NATRAC nous a permis de faire une analyse de
sa structure organisationnelle ; de son patrimoine et de son compte de résultat, nous avons
identifié certains facteurs de force et de faiblesse.
1. Les forces
En ce qui concerne les forces de la NATRAC :
• Nous avons remarqué que 91 % de son personnel ont une ancienneté supérieure à cinq ans.
Elle jouit donc d’une bonne expérience de ses employés.
• 75 % des employés enquêtés affirment qu’il existe une cohésion entre les différentes
directions ou services de la NATRAC. Les informations peuvent donc circuler facilement.
• Pour ce qui est de sa structure financière, les principes de l’équilibre financier sont respectés
et elle dispose d’énormes ressources pour financer ses activités et donc fait très peu appel aux

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
57
fonds extérieurs. Par conséquent elle supporte très peu de charges financières et sa solvabilité
la rend crédible vis-à-vis des ses créanciers.
• Elle dispose enfin d’une bonne politique commerciale en matière de délais de rotation des
créances clients et de délais de rotation des dettes fournisseurs.
2. Les faiblesses
Les faiblesses de la NATRAC sont d’ordres organisationnels que financières. Nous
pouvons donc citer :
• Par rapport à sa structure organisationnelle, on a remarqué qu’elle :
- n’a pas un planning d’élaboration des objectifs ;
- n’a pas non plus un programme de formation des employés et enfin ;
- n’a pas de structure de contrôle en son sein.
• Une autre faiblesse de la NATRAC est qu’elle ne réalise pas suffisamment de CA afin de
pouvoir couvrir ses charges d’exploitation dont les charges fixes (frais de personnel et charges
de dotation) occupent une grande partie (en moyenne 33,05 % des charges d’exploitation) et
les services extérieurs (en moyenne 22,4% des charges d’exploitation). Cette situation peut
trouver une explication partielle dans le fait que la NATRAC ne dispose pas de l’équipement
nécessaire pour la construction des routes bitumées ce qui la limite dans les soumissions aux
appels d’offres et qui la réduire uniquement à la réhabilitation des routes en terre et la
construction des dalots.
B. Suggestions
Au regard de tout ce qui précèdent, il est indispensable qu’on formule quelques
suggestions dans le but d’améliorer la gestion de la NATRAC :
• pour sa structure organisationnelle, nous suggérons qu’elle mette en place un planning
d’élaboration des objectifs et une structure de contrôle en son sein afin de pouvoir mieux fixer
chaque employé dans la réalisation de son objectif global. Il serait également souhaitable
qu’elle organise des programmes de formation afin que le personnel puisse acquérir
d’avantage de compétence à mettre à son service.
• pour la croissance de ses activités, nous lui suggérons d’investir dans les équipements
nécessaires pour la construction des routes bitumées. Elle peut également s’investir dans
l’achat des carrières de sable afin de pouvoir commercialiser le sable de rivière qui constitue
actuellement le marché de sable le plus en vogue dans notre économie.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
58
• mettre en place une comptabilité analytique de gestion.
Difficultés et Limites
Le succès de toute recherche dépend fortement des conditions dans lesquelles elle a
été réalisée. Dans le cadre de notre étude, nous avons été confrontés à des difficultés. Au
nombre de celles-ci, nous pouvons citer :
- la lenteur de l’administration publique ;
- le manque de volonté et la méfiance du personnel de l’administration publique à nous
fournir les informations pouvant nous permettre d’apprécier l’importance des BTP
dans l’économie nationale ;
- La méfiance des dirigeants de la NATRAC à mettre à notre disposition certaines
informations et le manque de disponibilité de certains agents à porter une appréciation
sur le travail fait ;
- Insuffisance de documentation dans les bibliothèques de la place portant sur les BTP,
Ce qui, nous a quasiment réduit à des recherches sur les sites internet ;
- La méfiance des autres entreprises BTP à nous fournir quelques informations sur leurs
états financiers, ce qui, nous a empêché de faire une étude transversale et a réduit nos
analyses aux seules notes de cours et propositions de quelques écrivains analystes ;
- L’indisponibilité des professeurs habiletés à suivre ce travail surtout dans son fond
- Le manque d’information sur la valeur réelle des éléments d’actifs qui nous a contraint
à faire les retraitements et reclassement uniquement sur la base des valeurs comptables.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
59
CONCLUSION
L’objectif principal de toute entreprise est d’assurer sa continuité à travers une gestion
efficace et efficiente de ses activités. Pour y parvenir, il s’avère indispensable pour elle de
mettre en pratique des techniques de gestion adéquates. A cet égard, nombreuses sont les
études qui ont mis en évidence l’influence combien grande qu’exerce la pratique de la gestion
dans le succès ou l’échec d’une entreprise. Bien d’auteurs soutiennent notamment que la
plupart des faillites d’entreprises sont attribuées à une mauvaise gestion. C’est dans ce cadre
que nous avons voulu vérifier cette relation dans le secteur des BTP, étant donné la
particularité de ce secteur. Comme nous l’avons présenté au chapitre 1, celles-ci concernent
essentiellement la gestion de la force de travail, les contraintes de spatialisation,
l’hétérogénéité du produit et du marché, les nombreux évènements aléatoires, les contraintes
de successivité et de simultanéité des travaux, la fusion des intensités directes et connexes du
travail, etc.
Tout au long de notre étude, nous avons constaté une légèreté dans la pratique de la
gestion. En effet, les résultats issus de l’analyse de la situation financière montrent des
charges très élevées notamment les charges fixes. Les dirigeants de la société NATRAC, pour
atteindre un niveau de performance acceptable, doivent veiller sur certains ratios que nous
avons jugé pertinents. Il s’agit de : la part de la mains d’œuvre dans la valeur ajoutée dont la
moyenne est de 79,30 % sur toute la période d’étude et, la part de l’amortissement dans la
valeur ajoutée dont la moyenne est de 90,14 %, les ratios de rentabilité économique et
financière et le ratio de rotation de l’actif. Sur la période d’étude choisie, la société a
enregistré un résultat moyen de -73.428.608,4 FCFA. Nous avons constaté que pour améliorer
sa productivité, deux possibilités s’offrent à elle :
- la première consiste à réduire certaines charges notamment : les services extérieurs, les
charges de personnel et revoir sa politique d’amortissement ;
- la deuxième consiste à réaménager son champ d’action pour avoir accès à des marchés
plus importants (la construction des routes bitumées ; la construction de logements
sociaux et le marché du sable de rivière).
En outre nous proposons aux dirigeants de la société NATRAC en vue d’une
amélioration de sa performance, la mise en place d’une structure d’élaboration des objectifs
individuels et collectifs, d’une structure de contrôle et de suivi de ses activités, d’un plan de
formation et d’un mécanisme de rémunération liée à la performance.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES BTP : CAS DE LA NATRAC SA
Réalisé et soutenu par : BESSAN A. Albertine & ENY S. Paterne
60
De nombreux points restent encore dans l’ombre en ce qui concerne l’amélioration de
la performance de la NATRAC.