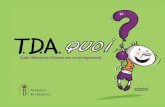01 SOMMAIRE MAG - ICC-FranceFrance 5 L e solde de la balance commer-ciale française a été...
Transcript of 01 SOMMAIRE MAG - ICC-FranceFrance 5 L e solde de la balance commer-ciale française a été...
InternationauxMagazine du Comité Français de la Chambre de Commerce InternationaleInternationaux
Ministre du Commerce extérieur
Nicole BRICQInterview exclusive
Financement du Commerce International
Le Qatar accueille le 8ème Congrèsmondial des chambres de commerce
Deux ans de retourd'expérienceN
°9
7�
© P
. B
ag
ein
D O S S I E R T H É M A T I Q U E
COUV 1_ICC 97.qxd:. 3/05/13 16:19 Page couv1
LE MOT DU PRESIDENT ………………………………………3par Gérard WORMS
INTERVIEW EXCLUSIVE
■ "Je suis au service des entreprises" ………………… 5Interview exclusive de Nicole BRICQ,
Ministre du Commerce extérieur
POLITIQUE GÉNÉRALE
■ Le Qatar accueille le 8e Congrès mondial deschambres de commerce. ………………………………………… 7Peter MIHOK, Président de la Fédération mondiale des chambres de commerce (WCF)
■ Le statut d’opérateur économique agréé :Résultats de l’enquête ICC France ……………………… 9Jean-Marie SALVA, Avocat associé, DS Avocats François MION, Directeur de la Protection duPatrimoine Matériel, Groupe Renault (D2P) et Gwenola BANNIER, Responsable Douane Groupe,Groupe Yves Rocher
■ Entreprises et Droits de l’Homme : les recommandations d'ICC France…………………… 11
AUTORÉGULATION
■ La Communication « Responsible Food andBeverage Marketing »…………………………………………… 12Stéphane MARTIN, Directeur Général de l’Autorité de la régulation professionnelle de la publicité (ARPP)
■ Incoterms® 2010 : les experts d’ICC répondentaux questions des entreprises…………………………… 13Christoph Martin RADTKE, Avocat, Rechtsanwalt,Associé LAMY & ASSOCIES
RÉSOLUTION DES LITIGES
■ La médiation internationale, instrument précieux de résolution des conflits ………………… 15Thierry GARBY, Avocat honoraire, Médiateur et Formateur en négociation et médiation
DOSSIER THÉMATIQUE :FINANCEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL
SOMMAIRE
POINTS DE VUE
■ Une organisation territoriale au service
des entreprises à l’international ………………… 26Philippe GRILLOT, Président de la CCI de Lyon
■ Brevet unitaire et juridiction unifiée :
Comment rendre efficace le nouveau dispositif européen ? ………………………………………… 27Martine KARSENTY-RICARD, Avocat à la Cour, Présidentede la Commission Propriété Intellectuelle d’ICC France
■ Importer dans l'Union Européenne : décaisser
la TVA ou faire jouer la concurrence ?……… 29Odile COURJON, Avocat associée, Taj et Pierre SARTINI, Vice-président de l’Observatoire desRéglementations Douanières et Fiscales
SÉMINAIRES
■ Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ? ………………………………………………………………… 30Philippe RINCAZAUX, Avocat à la Cour - Associé,Orrick Rambaud Martel et Georges CHALOT, Chef du Département «Droit de la concurrence», Total S.A.
■ Sentences arbitrales : Face aux obstacles,quelles solutions pour les entreprises ? … 31Béatrice CASTELLANE, Animatrice des débats,Avocate, AMCO, Cabinet Castellane
■ Le secret des affaires est-il encore protégé ?…………………………………………………………………… 32Jean-Christophe GALLOUX, Professeur agrégé à l'Université Paris II-Panthéon-Assas, Avocat à la Cour
■ Présentation du dossier …………………………………… 17
■ Financement du commerce international :
défis règlementaires pour 2013 …………………… 18Georges AFFAKI, Vice-Président de la Commission
bancaire ICC
■ L’œuvre normative d’ICC : une arme pour
sécuriser le commerce international ………… 20Jean-Pierre MATTOUT, Avocat au barreau de Paris,
Kramer Levin, Président de la Commission Bancaire
d’ICC France
■ Les atouts du nouvel instrument ObligationBancaire de Paiement (OBP) ………………………… 22Martine GRAFF, Directrice d’activités Trade Finance,SYRTALS
■ Nouvelle publication des Règles Uniformesdu Forfaiting (RUF 800) : Comment les utiliser à bon escient? ……………………………………… 24Patrice TOURNUS, Expert bancaire international
■ Les conséquences de la crise bancaire européenne pour le Trade Finance……………… 25Jean-Paul RIOLACCI, Responsable Capital et Crédit -Global Transaction Banking, BNP Paribas
ÉCHANGES INTERNATIONAUXEST LE SEUL MAGAZINE D’INFORMATION
D’ICC FRANCE, COMITÉ NATIONAL FRANÇAISDE LA CHAMBRE DE COMMERCE
INTERNATIONALE
1er semestre 2013N°97
ECHANGES INTERNATIONAUXMagazine du Comité Français de laChambre de Commerce Internationale
Directeur de la publication : Gérard WORMS, Président du ComitéNational Français de la Chambre deCommerce Internationale
Editeur : ICC France 9 rue d’Anjou - 75008 Paris Tél : 01 42 65 12 66 Fax : 01 49 24 06 39www.icc-france.fr
Comité de Rédaction :François GEORGESMarie-Paule VIRARDEve MAGNANT
Régie publicitaire : Editions OPAS 41, rue Saint-Sébastien - 75011 Paris Tél. : 01 49 29 11 00 Fax : 01 49 29 11 46
Editeur conseil : Jean-Pierre KALFON
Conseil éditorial :Sophie SCHNEIDER
Directeur commercial : David ADAM
Dépôt légal 92892
Imprimeur : PRINTCORP
©IC
C
1France
01 SOMMAIRE MAG 3/05/13 17:35 Page 1
La présente livraison d’Echanges Internationaux comporte, autitre du dossier thématique, une série d’articles que je crois utileset intéressants sur le sujet du « trade finance », sujet central pourle développement du commerce international, notamment pour lesentreprises françaises. Elle contient également une importanteinterview de notre Ministre du Commerce Extérieur, MadameNicole Bricq, qui sera d’ailleurs parmi nous lors de l’AssembléeGénérale de notre Comité, le 26 juin.
Cette Assemblée sera la dernière à se tenir au siège de la Chambre,cours Albert 1er, car, dès le mois de juillet, l’ensemble des équipes
du siège déménagera vers des locaux beaucoup plus fonctionnels et refaits à neuf,avenue du Président Wilson, locaux rendus disponibles par la dissolution de leur occupant antérieur, l’Union de l’Europe Occidentale.
Nos lecteurs trouveront par ailleurs dans notre revue un écho précis de plusieurs de nosactivités : ne pouvant toutes les citer, je mentionnerai l’article du président de la CCI deLyon sur le développement international des entreprises de la région de Lyon et notredéclaration sur le rôle des entreprises en matière de droits de l’Homme. Il s’agit d’unsujet, dont cet appel souligne très concrètement les enjeux, qui importe à ceux – dontnous sommes à l’ICC – qui pensent que la responsabilité des entreprises s’y trouvenolens volens (et nous disons plutôt volens) désormais engagée. La ResponsabilitéSociétale des Entreprises (RSE) sera d’ailleurs le thème principal de la prochaine éditionde notre magazine.
Ils y verront aussi en encart sur le lancement par ICC France de la nouvelle publicationbilingue du contrat modèle ICC de vente internationale. Cet outil peut rendre de précieuxservices aux exportateurs français, particulièrement les PME, dans le cadre de leursnégociations commerciales internationales.
Enfin, à l’échelle de l’ensemble de l’ICC mondiale, nous allons vivre, entre avril et septembre, des évènements majeurs que nous préparons activement. Il s’agit tout d’aborddu Business Summit (juste avant le Congrès Mondial des Chambres de Commerce de finavril à Doha), organisé par notre Département WCF. Ce Business Summit va exprimeravec précision mais aussi une certaine solennité nos propositions pour la relance desnégociations commerciales internationales après l’enlisement de décembre 2011. Laseconde série de rendez-vous cruciaux concerne bien sûr le G20 de Saint-Pétersbourgdébut septembre. Celui-ci sera précédé dans cette même ville d’une rencontre de chefsd’entreprises dans la seconde quinzaine de juin afin de mettre la dernière main à l’expression des attentes du secteur privé vis-à-vis des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
N’hésitez pas, même sur ces sujets d’envergure, à partager avec nous vos idées. Ellesseront étudiées avec attention, et renforceront notre proximité.
Le mot du président
ICC FRANCE
3France
Gérard WORMSPrésident d’ICC France et de la Chambre de Commerce internationale,Vice-Président de Rothschild Europe
03 Mot du president 3/05/13 15:00 Page 3
5France
Le solde de la balance commer-ciale française a été large-ment déficitaire en 2012 à 67
milliards d'euros et la comparaisonavec la performance allemande(+188 milliards) est cruelle. Queldiagnostic portez-vous sur les principales faiblesses françaises àl'export ?Le diagnostic est fait depuis long-temps, vous savez. Il y a trop peud’entreprises exportatrices, trop peu,c’est d’ailleurs lié, d’entreprises detaille intermédiaire, des entreprisesqui n’exportent pas assez sur le longterme, une organisation institution-nelle complexe… En France, lesgrands groupes ont pris le virage dela mondialisation et se sont interna-tionalisés, certaines PME innovantesaussi, mais le mouvement de massen’a pas eu lieu.
Le retour de la croissance et lerecul du chômage passent notam-ment par la capacité des entreprisesfrançaises à reconquérir des partsde marché à l'étranger. Quelsobjectifs vous fixez-vous pour les yaider et à quel horizon ? Mon objectif est simple : l’équilibrede la balance commerciale horsénergie. Mon horizon est clair : la findu quinquennat. Comment puis-je yparvenir ? D’abord, en simplifiantautour de trois piliers : un pilierstratégique, l’Etat, qui définit lespriorités d’action et met en œuvrel’accompagnement des entreprises àl’international avec les services économiques et Ubifrance ; un pilierorganisationnel, les Régions, quidéterminent les priorités de leursterritoires, identifient les entreprises
en lien étroit et essentiel avec leschambres consulaires dont le rôle estmajeur ; un pilier financier, la BPI,qui à terme regroupera les activitésde financements export d’Oséo et deCoface autour de produits simplifiés.
La parité de l'euro pénalise lesexportations françaises, notam-ment dans l'industrie, quand denombreux pays actuellement laissentfiler la valeur de leur monnaie.Vous avez récemment pris positionen faveur d'une politique de changepour la zone euro. Est-ce réalisted'espérer voir l'UE adopter unepolitique active du change ? Quelleest, selon vous, pour les entreprisesfrançaises la « bonne » paritéeuro/dollar ? Les économistes peuvent discuter dela parité d'équilibre mais, en réalité,celle-ci n'existe pas car de très nom-breux facteurs influencent la paritémonétaire. Le premier c'est laconfiance dans la monnaie et dansl'économie. Avec les décisions trèsimportantes prises sur la stabilitébudgétaire et l'union bancaire, lesgouvernements de la zone euro ontlargement rétabli cette confiance. L’euro a apporté la stabilité des changes dans une grande partie del'Europe. C'est le marché naturel dela plupart de nos entreprises. Prèsde la moitié de nos exportations sontà destination de la zone euro, et jeme réjouis qu'on ne connaisse plusles variations brutales de change quiprévalaient au temps des anciennesmonnaies nationales en Europe.Imaginez dans la période actuelle si chaque pays avait encore sa monnaie : les variations auraient été
beaucoup plus brutales et dévastatri-ces pour notre tissu économique. On aurait connu des mouvements dela peseta ou de la livre, avec desconséquences terribles pour nosentreprises. Certes, il reste la question importantedes monnaies hors zone euro ; maisil n'existe pas de parité satisfaisantepour tout le monde. Quand l'eurobaisse c'est le prix du pétrole impor-té qui augmente, cela pénalise à lafois les ménages et les entreprises.Ce qui est important c'est bien la stabilité des monnaies pour que les entreprises puissent anticiperleurs coûts et leurs marchés. C'estcet objectif de stabilité qui constituela politique de change de l'Unioneuropéenne. Quand l’environnementmonétaire est instable, le pluscoûteux pour les entreprises reste lacouverture de change. En ce sens,quand les ministres des Finances dela zone euro font ce qu'il faut pourrétablir la confiance, ils mènent aussiune politique de change. Nous avonsbesoin d'une meilleure coordinationau niveau mondial. Le PrésidentHollande a appelé, à Strasbourg, àl’indispensable réforme du systèmemonétaire international.
Quelles initiatives pour offrir auxentreprises tricolores des finance-ments à l'exportation compétitifs ?On estime souvent que nos concur-rents européens disposent d'unepalette plus complète de finance-ment. Y-a-t-il en Europe des dispositifs « modèles » dont nouspourrions nous inspirer ? Nous avons lancé une réforme desfinancements export dès l’été dernier,
INTERVIEW EXCLUSIVE
ICC FRANCE
Stimulée par l'ampleur du défi - rétablir l'équilibre de la balance commerciale horsénergie à la fin du quinquennat - Nicole Bricq, la ministre du Commerce Extérieur,réaffirme ici son credo : jouer offensif. Elle s'explique sur la réforme de l'organisationdu commerce extérieur, sur la simplification de son financement et sur sa volonté deplacer les entreprises françaises dans les meilleures conditions possibles pour gagnerla bataille de l'export.
Interview exclusive de Nicole BRICQ, Ministre du Commerce extérieur
« Je suis au service des entreprises »
©P.
Bag
ein
05-06 Bricq 3/05/13 15:05 Page 5
6 France
ICC FRANCE
Européenne au moment de la négociation ?D’abord, le sujet intéresse. Nousavons reçu beaucoup de réponses,même de particuliers. Ensuite, il y ades inquiétudes, que je comprends.Notamment sur la protection denotre modèle de développement enmatière de normes sanitaires et phytosanitaires. Ce sont d’ailleursdes lignes rouges pour moi dans lanégociation, comme la défense del’exception culturelle. Enfin, et sur-tout, je constate que les industrielssont majoritairement favorables auxnégociations même s’ils sont cons-cients des difficultés à surmonter.Nous avons des intérêts offensifsréels dans l’agriculture, l’agroali-mentaire, les équipements ferroviai-res, l’énergie… Et sur tous les sujetsréglementaires qui seront détermi-nants (normes techniques, facilita-tion des échanges, certifications…).
D'une manière générale, que pen-sez-vous pouvoir apporter aux chefsd'entreprise que vous rencontrez etquelles initiatives attendez-vousd'eux pour que la position de laFrance à l'export se redresse et seconsolide ? Je le dis souvent, je suis au servicedes entreprises. Je dois satisfaireleurs demandes et répondre à leursattentes. Nombre d’entre elles m’accompagnent dans mes voyageset elles gagnent des contrats, elless’implantent. Je dois apporter lesmeilleures conditions possibles. Avec la réforme de l’organisation de l’export depuis les territoires, laréforme des financements et celle de l’accompagnement par Ubifrancedes entreprises, je mets en place des outils. Ce que j’attends desentreprises ? Qu’elles s’en emparentet qu’elles osent.
Pouvez-vous nous confirmer que leComité français de la Chambre decommerce internationale (ICCFrance) a son rôle à jouer dans ledispositif de soutien à l’export quevous êtes en train de mettre enplace pour le rendre plus efficace ?J’ai déjà rencontré ICC France enoctobre 2012. Je les revois bientôt, le26 juin, pour clôturer l’assembléegénérale. Je suis très attachée, et jel’ai dit à Gérard Worms, à ce qu’ICCtrouve sa place dans la stratégie quej’ai définie.
INTERVIEW EXCLUSIVE
elle est à l’œuvre. D’abord, la mise enplace d’un interlocuteur clairementidentifié pour les entreprises, la BPI,qui distribuera les produits Oséo etCoface. J’ai en effet voulu que la BPIdispose d’un volet internationalambitieux. Ensuite une simplification de sesproduits et une amélioration de leurefficacité afin de répondre à troisbesoins de nos entreprises : la prospection, le besoin en fonds deroulement et le financement descontrats conclus. Enfin la mise enœuvre de mécanismes passés fin2012 pour soutenir l’activité des crédits à l’exportation, en facilitantl’accès à des refinancements par lesbanques mettant en place des créditsà l’exportation. Il n’y a pas de modèle.Nous inventons un modèle français.
L'objectif d'un accord sur la facilita-tion des échanges commerciaux,enjeu majeur pour la Chambre decommerce internationale, estconsidéré comme l'un des chantiersprioritaires du prochain directeurgénéral de l'OMC. Outre raviverl'esprit de coopération multilatéra-le, que faut-il en attendre pour l'économie mondiale et quels sontconcrètement les objectifs de laFrance dans cette négociation ?La France est très attachée au multi-latéralisme, seul à même de régulerla mondialisation. La 9ème conférenceministérielle de l’OMC se tiendra àBali du 3 au 6 décembre 2013. Ce seraun moment important, je l’espère,pour relancer le processus commer-cial multilatéral. On peut espérer devraies avancées. Notamment sur la
facilitation du commerce. L’accordpourrait encourager la modernisa-tion des procédures douanières. Les coûts des procédures liés aupassage des frontières sont estimésà 10% du prix de la marchandise.C’est le double des droits de douanemoyens dans le monde. Tous lesimportateurs et exportateurs enbénéficieraient. Les négociations d’un accord plurila-téral sur les services pourraient nouspermettre de faire valoir nos intérêtsoffensifs, en particulier sur les services environnementaux. LaFrance dispose d’un savoir fairereconnu en ce qui concerne le traite-ment des eaux usées, la gestion desdéchets, la protection de l’air, l’assai-nissement des sols, la lutte contre lebruit et protection de la biodiversité.
En matière de marchés publicsinternationaux, on observe le refusde nombreux pays européens delutter contre les pratiques discrimi-natoires qu'ils assimilent à du protectionnisme. Peut-on vraimentespérer trouver des alliés sur cettequestion ? A quelles conditions ? Oui, on peut. Il y a des alliés de laréciprocité. Et le règlement européensur la réciprocité d’accès aux mar-chés devrait nous aider. Simplement,nous devons prendre notre bâton dupèlerin et convaincre. Je me déplacebeaucoup dans l’Union européenne,et certains pays sont sensibles à nosarguments. J’ai déjà obtenu une victoire : l’exi-gence, pour ouvrir des négociationsavec le Japon, de la levée des barriè-res non-tarifaires mise en place parce pays. Le Conseil européen l’a acté.Résultats ? Notre viande bovine peutde nouveau être exportée au Japon,deux de nos entreprises ferroviairesont été sélectionnés pour un marchépublic. Je crois aux petits pas.J’avance.
A l'occasion des futures négocia-tions sur l'accord de libre-échangeentre l'UE et les États-Unis, vousavez lancé une vaste consultationauprès des entreprises et des fédé-rations professionnelles dans le butde préparer la position du gouver-nement français. Que retenez-vousde cette consultation et quels sontles objectifs essentiels que laFrance souhaite voir figurer dans lafeuille de route de la Commission
> En visite au Qatar au mois de mars dernier, Nicole Bricq, ministredu Commerce Extérieur, accompagnée d'une délégation de vingt-cinq entreprises, a défendu les chances de l'offre française en matièrede « ville durable » et de santé, deux axes prioritaires de la stratégietricolore à l'export.
05-06 Bricq 3/05/13 15:05 Page 6
7France
POLITIQUE GÉNÉRALE
ICC FRANCE
C’est la Chambre de commerceet d’industrie du Qatar qui,cette année, accueillera du
22 au 25 avril 2013, le Congrèsm o n d i a l d e s c h a m b re s d e commerce d’ICC WCF, offrant àquelque 12 000 chambres de com-merce quatre jours de sessionsplénières et d’ateliers ainsi que demultiples opportunités de nouerdes contacts. D’où le thème retenupour le congrès : «Des chancespour tous».Depuis sa création, en 1919, ICC,organisation mondiale des entre-prises, croit en l’idée simple maisforte que le commerce entre lesnations apporte paix et prospérité.Le congrès de Doha mettra enlumière comment, dans un mondeà l’économie actuellement fragile,les entreprises, les populations etles économies locales peuvent,partout dans le monde, tirer profitdes bénéfices d’une économie globalisée.«Depuis son lancement en 1999, leCongrès mondial des chambres decommerce est devenu l’endroit oùles dirigeants de chambres de com-merce et d’entreprises se doiventd’être présents pour rencontrerleurs pairs et partager leurs expé-riences ainsi que leurs meilleurespratiques», souligne Peter Mihok,qui, depuis janvier, a pris les rênesd’ICC WCF pour un mandat de troisans, avec pour objectif la consolida-t ion du réseau mondial des
chambres et le renforcement deleur rôle au sein de leurs commu-nautés. Peter Mihok est égalementle président de la Chambre deCommerce et d’ Industrie deSlovaquie, l’ancien vice-présidentd’Eurochambres ainsi que leconseiller du président de son pays.«Dans presque tous les pays dumonde, les chambres de commer-ce sont perçues comme un relaisnaturel et crédible entre les entre-prises, les gouvernements et lasociété», estime Peter Mihok avantd'ajouter : «Dans l’économie globa-lisée telle que nous la connaissonsaujourd’hui, les chambres de commerce savent qu’elles doiventtravailler ensemble si elles veulentrester utiles à l'ensemble de leursmembres. Le congrès, qui a lieutous les deux ans, leur offre la poss ib i l i té de for t i f ier leur communauté au niveau mondial etd'organiser la coopération écono-mique aux niveaux local, régional etinternational».Sur le thème «Des chances pourtous», le congrès comprendra cetteannée des sessions plénières surdes sujets tels que l’éducation etl’emploi, les femmes et le commerce,l’entreprenariat des jeunes, lespetites et moyennes entreprises(PME) et l’économie mondiale. Desateliers seront en outre consacrésaux services rendus quotidienne-ment par les chambres tandis que
des sessions parallèles présente-ront les dernières tendances et lesmeilleures pratiques en s’appuyantsur des études de cas. AndréMarcon, Président de CCI France,sera un des orateurs majeurs de cecongrès.
ICC World Trade Agenda Summit.Le coup d’envoi du congrès seradonné par le ICC World TradeAgenda Summit, point culminantde la première phase du projet deprogramme d’ICC pour favoriser lecommerce mondial. Ce sommetoffrira aux participants l'opportunitéde prendre une part active au dialo-gue entre chefs d’entreprise etdécideurs politiques. Les recom-mandations qui émaneront de ceprocessus contribueront à aiderl’Organisation mondiale du com-merce (OMC) à sortir les négocia-tions commerciales multilatéralesde l’impasse dans laquelle elles setrouvent depuis douze ans et àfranchir le cap de «Doha».Lancé en partenariat avec laChambre de commerce et d’indus-trie du Qatar, l’ICC World TradeAgenda est une initiative globalequi permet aux chefs d’entreprisesde contribuer par des propositionsconcrètes au renforcement du système commercial multilatéralet de confirmer, au plan mondial,l’engagement des entreprises à l’égard de l’OMC.
Le 8e Congrès mondial des chambres de commerce, qui réunit les chambres decommerce de plus de 100 pays, se tiendra pour la première fois de son histoire auMoyen-Orient, à Doha, au Qatar, sous la houlette du nouveau président de la Fédérationmondiale des chambres de commerce (WCF), Peter Mihok, et de la Chambre decommerce internationale (ICC).
Peter MIHOK, Président de la Fédération mondiale des chambres de commerce (WCF)
©D
R
Le Qatar accueille le 8e Congrèsmondial des chambres decommerce.
07-08 mihok peter 3/05/13 15:11 Page 7
8 France
POLITIQUE GÉNÉRALE
ICC FRANCE
Fondée en 1963, la chambre decommerce du Qatar compte plus de33 000 membres, essentiellementdes petites et moyennes entrepri-ses. Ses principaux champs d’action portent sur la parité et lecommerce. Elle aide ses membresà développer leurs entreprises auniveau local et les accompagne àl’exportation. A l'issue de près de trois jours desessions plénières et d’ateliers –
au cours desquels les délégués, lesexposants et les chefs d’entrepriselocaux pourront se rencontrer entête-à-tête à l’occasion de réunionsd’affaires – la cérémonie de remisedes prix du concours mondial deschambres de commerce clôturerale congrès. Ce concours est le seul programme international quirécompense les projets les plusnovateurs des chambres de com-merce à travers le monde. Cette
année, l’accent sera mis, entre autres, sur l’ingéniosité des cham-bres de commerce locales dans desdomaines tels que la responsabilitésociale des entreprises, les projetsdes petites entreprises et l’entre-prenariat des jeunes. Ouvert pendant ces trois jours, le centred’exposition du congrès présenteraégalement les nouveaux produits,services et initiatives des chambresde commerce du monde entier.
«Notre mission : montrer ce quiest possible».«Les chambres de commerce partici-pent à une large gamme d’activitésqui va du partenariat public-privé à la facilitation du commerce mondial, en passant par le dévelop-pement des PME ou l’enregistrementdes noms commerciaux», conclutPeter Mihok. «Notre travail à WCF et la mission du Congrès mondial des chambres de commerce est demontrer aux chambres de commercece qui est possible et de consoliderune culture pérenne de croissance etde développement».
La WCF au service de la coopération et des échanges. La WCF a été créée en 1950 par la Chambre de Commerce Internationale pour fédérer le réseau mondialdes quelque 12 000 Chambres de commerce qui en sont membres, promouvoir et défendre leurs intérêts
communs. La WCF est unique en son genre dans la mesure où non seulement elle aide chacun de ses membresà gagner en efficacité, mais elle œuvre aussi à resserrer les liens entre les chambres, favorisant ainsi la coopé-ration et les échanges. Le prochain congrès mondial d'ICC WCF (tous les deux ans) aura lieu à Doha du 22 au25 avril 2013 (voir ci-contre). Le congrès est l'occasion, pour les chambres de commerce et leurs dirigeants,d'échanger avec leurs pairs et de créer des liens. Depuis dix ans, il s'achève sur un concours destiné à récompenser les projets les plus novateurs des chambres de commerce.
La WCF propose une large palette de produits et services afin d'aider les chambres de commerce à offrir lemeilleur service possible à leurs membres. Elle gère notamment le carnet ATA (le sigle est l'acronyme français et anglais pour AdmissionTemporaire/Temporary Admission), une procédure douanière qui permet de simplifier les opérations douanièreset d'en réduire le coût à l'occasion d'un transit ou d'un séjour temporaire de certaines catégories de produitsdans les 72 pays signataires de la convention qui appliquent cette procédure. En 2011, près de 166 000 carnetsATA ont été émis dans le monde (15 000 en France), couvrant un montant de 20,6 milliards de dollars de marchandises (près de 800 millions de dollars pour la France).
La WCF œuvre à tous les niveaux pour faciliter échanges et partenariats susceptibles de favoriser la paix etla prospérité dans le monde. Elle met une plate-forme à disposition des chambres de commerce pour leur permettre de travailler ensemble sur des sujets d'intérêt mutuel et de nouer des partenariats féconds. Elle fait aussi le lien entre gouvernements et milieux d'affaires et travaille sur les sujets, notamment juridiques et fiscaux, susceptiblesd'aider les entreprises à faire face aux défis et aux opportunités liés à la mondialisation (ouvrages et guidessur l'évolution des règles commerciales et bancaires, réflexions et propositions sur l'évolution du droit et despratiques internationales, organisation de sessions de formation et conférences, etc.). Enfin, elle cultive desliens avec nombre d'organisations internationales, notamment la Banque mondiale, le PNUD et les banquesrégionales de développement, afin de permettre aux chambres de commerce des pays en développement d'accéder dans les meilleures conditions à ses programmes d'assistance et de formation.
�
07-08 mihok peter 3/05/13 15:11 Page 8
9France
ICC FRANCE
Le Comité français de laChambre de commerce inter-nationale a adressé à ses
adhérents un questionnaire enforme de bilan de l'OEA, après cinqans de mise en place de ce nouveaustatut douanier. Les résultats tra-duisent un intérêt quasi unanime :création ou révision de procédures,sensibilisation des équipes à laquestion douanière, visibilité au seinde l'entreprise… Ainsi, la marqueYves Rocher voit dans l'OEA «unereconnaissance de la fonction doua-ne dans l'entreprise et une opportu-nité d'en faire une fonction transver-se, sponsorisée par la directiongénérale car l’OEA doit être menécomme un vrai projet d’entreprise». Si, au départ, les pionniers du sta-tut souhaitaient voir leurs effortsrécompensés par des avantagesconcrets (moins de contrôles doua-niers, des procédures simplifiées,présomption de bonne foi...), grandes et moyennes entrepri-ses, même «non OEA», bénéficient désormais de ces simplifications :
procédure de dédouanement àdomicile (PDD) ou procédure dedomiciliation unique (PDU), cautionde groupe, etc. Aujourd'hui ,l'attente porte sur la promotiond’un label qui serait le socle d’une relation privilégiée entrel'Administration et les opérateurs.En outre, les entreprises souhai-tent voir pérenniser cette certifica-tion afin d'éviter que les effortsconsentis ne puissent être compro-mis. Comment, en effet, structureret fiabiliser dans la durée et sur un pér imètre qui peut être large (multi-sites, multi-systèmes,multi-flux) une telle certificationavec un turn-over dans les équi-pes? Pour être utile et pérenne,l'enquête OEA, dont les 200 ques-tions dessinent une évaluationcomplète de l'entreprise, doit inté-grer ces critères d'auto-évaluationdans une démarche d'audit ou decontrôle interne. Autant la partie «simplificationsdouanières» est le plus souventmaîtrisée par les équipes ad hoc,
Le statut d’opérateur économique agréé (OEA) apparu le 1er janvier 2008 fait son chemin dans lesentreprises françaises (811 certifiées dont 102 au titre de la sécurité et 206 au titre de la facilitation).Un développement qui mérite une réflexion sur l’amélioration du dispositif actuel, sa simplification etses contreparties réelles.
Jean-Marie SALVA, Avocat associé, DS Avocats - Président de la Commission Politique Commerciale et Réglementations Douanièresd'ICC France
François MION, Directeur de la Protection du Patrimoine Matériel, Groupe Renault (D2P) – Vice-Président de la Commission PolitiqueCommerciale et Réglementations Douanières d'ICC France
Gwenola BANNIER, Responsable Douane Groupe, Groupe Yves Rocher
©D
R
©D
R
©D
R
Le statut d’opérateur économique agréé : Résultatsde l’enquête ICC France
Jean-Marie SALVA François MION Gwenola BANNIER
Qui est éligible au statutd'OEA ?Tous les acteurs de la
chaîne logistique internationale- importateurs, exportateurs,transporteurs, logisticiens,structures aéroportuaires encharge de l'acheminement et dustockage temporaire du fret,commissionnaires en douane etde transport – sont éligibles austatut d'Opérateur économiqueagréé (OEA). La certification estaccessible aux PME et si lesentreprises, quelle que soit leurtaille, sont tenues de remplir lescritères OEA, les auditeurs tien-nent compte de la taille pourapprécier leur conformité. Ainsi,pour les PME, l'exigence d'uneformalisation est moindre auregard de certaines procédures(la gestion des absences, parexemple), et celle du «badgea-ge» du personnel peut être exa-minée au cas par cas.
�
Source. Services des Douanes.
Politique générale
09-10 Jean-Marie SALVA + 3/05/13 15:15 Page 9
10 France
POLITIQUE GÉNÉRALE
ICC FRANCE
autant la partie «sécurité» requiertun travail en profondeur pourrépondre à la vision «idéale» desDouanes qui exigent que tous lesmaillons de la supply chain soientirréprochables. Or, sur le terrain,les situations sont diverses entrePME et grands groupes, entre fluxintégrés et flux de sous-traitance,entre les différentes typologies demarchandises dans certainesentreprises. La certification «sûre-
té» peut nécessiter des investisse-ments de remise à niveau coûteuxpour le budget OEA. Comme le soulignent les nouvellesdirectives de la CommissionEuropéenne (janvier 2013), ces enjeuxsont accentués par l'évolution du commerce international : fluxintensifiés, sourcings diversifiés,multiplication des intervenants dansla supply chain et contraintes detemps de plus en plus fortes. LaDirection de la prévention et de laprotection de Renault (D2P), en chargede ces questions dans les échangesentre entités du groupe, là où lesconcepts de sûreté/sécurité prennenttout leur sens, insiste sur ce point.Il s'agit de ne pas se tromper de débat : obtenir des Douanesquelques assouplissements deprocédures est une chose, sécurisersa supply chain tout au long du processus de marchandises(import/export ou industrie) en estune autre... Demain, les acteursnon OEA n'auront plus leur placedans la chaîne internationale, il estdonc important de pérenniser lescertifications.
La nécessité de maîtriser les deuxvolets de la certification douanièreest une évidence pour les entrepri-ses multinationales. Le fonctionne-ment des Douanes qui raisonnentpar entité juridique certifiée estinadapté au mode de fonctionne-ment des groupes qui souventdéploient leurs méthodes, leursprocédures, leurs systèmes d'in-formation dans les différentes entités juridiques alors que lesaudits des services régionaux (SRA)ne prennent pas en compte cesrègles communes. Sans pourautant militer pour un OEA degroupe, les entreprises demandentune prise en considération (for-mation/ Sensibilisation des SRA) du mode de fonctionnement desgroupes avec des méthodes et des outils communs. En toile defond de ces débats nationaux oueuropéens, l’intérêt des entrepri-ses mondialisées pour de nouveauxaccords de reconnaissance mutuel-le subsiste, à l’instar de ceux signéspar l’Europe avec le Japon (24 mai2011) ou avec les Etats-Unis (1er juillet 2012).
Le statut d'OEA fait une percée en Allemagne
Source : Commission européenne
Allemagne 5 154Pays-Bas 1 298France 811Italie 649Pologne 593Espagne 485Suède 314Royaume-Uni 305Belgique 277Hongrie 265
IL Y A TROIS SORTES DE CERTIFICATS OEA.Le certificat OEA est attribué à toute entreprise établie dans l'Union Européenne qui remplit certains critères définis par la réglementation communautaire.
1. Le certificat AEO-C1 (simplifications douanières).Les critères requis :• antécédents douaniers satisfaisants.• existence d'un système efficace de gestion des
écritures.• solvabilité financière vérifiée.Les avantages :• Modulation des taux de contrôles physiques et
documentaires.• Traitement prioritaire des envois en cas de
sélection à un contrôle douanier.• Dispense de garantie financière.• Priorité aux analyses de laboratoire lors des
contrôles de produits soumis à normes.• Renouvellement ou facilité d'octroi de procédures
domiciliées (Procédure de dédouanement à domici-le-PDD, procédure de domiciliation unique-PDU,procédure de domiciliation unique communautaire-PDUC sous réserves de formalités minimales(dépôt de l'annexe 67 des DAC).
• Priorité de traitement et accompagnement person-nalisé lors de l'octroi de facilitations liées audédouanement.
2. Le certificat AEO-S (sécurité et sûreté).Les critères requis :• L'existence de normes appropriées de sécurité et
de sûreté vient s'ajouter aux critères requis pour lecertificat AEO-C.
Les avantages :• Notification préalable des contrôles douaniers.• Réduction des données à fournir pour les déclara-
tions sommaires.• Facilités liées à la signature des accords de recon-
naissance mutuelle entre l'UE et les pays tiers.
3. Le certificat AEO-F (simplifications douanières/sécurité et sûreté).
Il est destiné aux entreprises qui remplissent l'ensemble des critères des deux certificats AEO-C etAEO-S et cumule l'ensemble des avantages.
1 L'acronyme anglais a été retenu pour la dénomination descertificats.
�
Source. Services des Douanes.
09-10 Jean-Marie SALVA + 3/05/13 15:15 Page 10
11France
ICC FRANCE
La question des Droits del’Homme prend une importan-ce grandissante dans le cadre
d’une économie mondialisée. Ellene se limite pas désormais aux normes sociales internes, ni mêmeà la lutte contre la pauvreté ou pourle droit d’expression des travailleursdans les pays en développement.Elle s'étend aussi aux relations avecles fournisseurs et autres partiesprenantes. À ce titre, elle intègre l’émergence de nouveaux droits(accès à l’eau potable, l’énergie,liberté d’accès et d’expression surinternet…), que ce soit sur le planlocal ou international, et l’impactdes activités de l’entreprise sur lasociété en général, notammentdans les pays marqués par la préca-rité des populations concernées.Un certain nombre d’entreprisesmultinationales, dont certainesfrançaises, en ont déjà pris
conscience. Elles en mesurent lesenjeux et les risques et y répondentpar une attitude proactive. Cetteprise de conscience s'accompagnede la mise en place progressive deréférentiels internationaux (ONU,OCDE, ISO, UE …) sur les liensentre droits de l’Homme et entre-prises.Pour toutes ces raisons, auxquellesviennent s'ajouter, dans certainspays, des risques pénaux, la priseen compte de ces droits devientdécisive pour l’image et la réputa-tion des entreprises. D'autant que celles-ci sont de plus en plusamenées à assumer des responsa-bilités normalement dévolues auxÉtats (la protection des droits del’homme) dans un contexte où lasociété civile exerce une influencegrandissante. D'où l'intérêt d’en-gager une démarche volontaire
dans ce domaine, tout en marquantles limites de leurs responsabilités(le respect des droits de l’Hommepar les entreprises).C’est pourquoi ICC France s’attachedésormais à encourager et àamplifier les bonnes pratiques,invite les dirigeants des grandesentreprises françaises à accompa-gner le mouvement de gouvernan-ce internationale qui se dessine enfaveur d’une protection accrue desdroits de l’Homme et propose lestrois recommandations suivantes :
1 – Adopter des codes de conduiteou des bonnes pratiques faisantexplicitement référence à la pro-blématique des droits de l’Hommeet à la Déclaration Universelle desDroits de l’Homme (DUDH).
2 – Procéder à une analyse d’im-pact des activités de l’entreprise(«Due diligence») vis-à-vis desDroi ts de l’Homme sur ses différents territoires d’opération,préalable à une gestion vigilantedes risques spécifiques à leur secteur d’activité.
3 – Associer les fournisseurs del’entreprise, et si possible les autres partenaires, aux engage-ments pris dans le cadre de soncode de conduite et de ses bonnespratiques et les encourager à sous-crire des engagements similaires.Il s’agit de faire œuvre vis-à-visd'eux de toute la pédagogie néces-saire en s’appuyant, le cas échéant,sur des audits externes pour s’assurer du respect effectif deleurs engagements.
Dans une économie mondialisée, la question des droits de l'Homme prend une importance croissanteet les entreprises ne peuvent l'ignorer sans prendre le risque de compromettre leur image et leurréputation. ICC France vient de formuler trois recommandations destinées à les aider à faire prévaloirles bonnes pratiques dans ce domaine.
Entreprises et Droits de l’Homme :Les recommandations d’ICC France
Politique générale
11 entreprises 3/05/13 15:17 Page 11
12 France
AUTORÉGULATION
ICC FRANCE
Les règles déontologiques, qu’elles soient européennes ounationales, visent essentielle-
ment l’application de deux grandsprincipes, le respect des individus etl'exercice de l'esprit de responsabilité.Ces notions revêtent une importancegrandissante dans les études réalisées auprès des consomma-teurs. En ce sens, les dispositionsdéontologiques, qui encadrent lescommunications publicitaires doiventtoujours, quelle que soit leur spécificité,se rattacher à ces notions.L’ICC a publié en septembre dernierune version 2012 mise à jour duFramework (cadre) relatif à la publicitéalimentaire afin de donner les cléspour interpréter et appliquer demanière effective et responsable leCode consolidé ICC pour ce quiconcerne précisément le secteur alimentaire. L'introduction de cedocument comporte de nouvellesdispositions qui soulignent l’impor-tance de garantir des communica-tions commerciales loyales afin d’assurer une saine concurrenceentre les acteurs du marché et unchoix éclairé pour le consommateur.L’article 8 «Justification» est ajoutédans la liste des recommandationsreprises dans le Framework. Il insis-te sur le fait que toute description,assertion ou illustration relative à unfait vérifiable doit pouvoir être justi-fiée. Cette preuve doit être disponiblesans délai et sur simple demande desorganisations d’autorégulation.
L’article 18 sur les «Enfants etAdolescents» est repris de façon pluscomplète que dans la version 2006 eninsistant sur le fait que la communi-cation commerciale ne doit pasremettre en cause les comporte-ments sociaux positifs et une hygiènede vie saine. De plus, elle ne doit pasexagérer les dimensions, la valeur, la nature, la durée d’utilisation et les performances réelles du produitalimentaire présenté. Enfin, la com-munication en direction de ce publicne doit pas promouvoir un produit alimentaire ou une boisson qui ne luiconvient pas ni présenter des enfantsdans des situations dangereuses ouparticipant à un acte antisocial et/ouillicite.Ces dispositions sont, dans leurensemble, assez proches des règlesfrançaises édictées dans la recom-mandation de l’Autorité de la régulation professionnelle de lapublicité intitulée «ComportementsAlimentaires». Pour autant, l’anglede travail choisi en France est sensi-blement différent : il a été décidé,dès le début des travaux en 2003 dedéfinir des règles applicables auxcomportements représentés sanscréer de hiérarchie entre les produits. L’analyse faite par les professionnels et corroborée par lesreprésentants de la société civile,par l’intermédiaire de nos instancesassociées, fut de se concentrer surles comportements à ne pas repro-duire dans la publicité, telles une situation de consommationexcessive ou une scène associant
la consultation d’un écran et la consom-mation de produits alimentaires.La valeur d'exemple nous est apparueprimordiale, participant ainsi auxrègles de vie dispensées par les adultes aux enfants.Dans le texte européen, la reprise del’article 18 contient, à l’état de principe,toutes ces règles et peut se déclinerdans la pratique en règles positives etconcrètes telles que détaillées dansla recommandation de l’ARPP.Cependant, la décision de prendre enconsidération les comportements etnon les produits, a permis aux profes-sionnels français d’élargir le champde leur engagement, qui ne s’arrêtepas aux publicités relatives aux produitsalimentaires mais visent l’ensembledes communications publicitaires,sur quel que produit ou serviceconcerné, pour autant que soit mis enscène un comportement alimentaire.Cette approche a été approuvée parles autorités publiques françaises,qui ont félicité l’ARPP pour la qualitéet la largeur de champ de sa recom-mandation. Chaque année, un bilanayant pour objectif de vérifier labonne application de ces dispositions,leur est communiqué.Un nouveau souhait fut d'ailleurs for-mulé par les autorités publiques lorsde la présentation du dernier bilan :celui de ne pas voir mis en scènedans les publicités, le gaspillage alimentaire. L’esprit de respect et deresponsabilité n’est jamais très loin !Et notre recommandation s’enrichiracertainement bientôt d’un nouveauparagraphe…
La Communication «Responsible Food andBeverage Marketing»
La Chambre de commerce internationale (ICC) a publié une mise à jour du texte quiencadre la publicité alimentaire afin d'aider ses adhérents à interpréter et à appliquerle Code consolidé ICC consacré au secteur alimentaire. De nouvelles dispositionsqui visent à garantir une communication responsable dans l'intérêt des professionnelsdu secteur et des consommateurs.
Stéphane MARTIN, Directeur Général de l’Autorité de la régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
©D
R
12 martin stephane 3/05/13 15:43 Page 12
13France
ICC France a organisé de nombreu-ses sessions de formation pour lesentreprises françaises. Toutefois,
celles-ci posent régulièrement desquestions relatives à l'utilisation desIncoterms 2010. L'ICC a décidé derassembler les questions les plusintéressantes pour la pratique quoti-dienne des entreprises dans unepublication qui paraîtra courant 2013.A l'instar de l'«Incoterm Book» de1998 (ICC publication n°589), l'ouvra-ge comportera une brève introductionaux Incoterms 2010 suivie d'une sériede questions/réponses. Très pratique,il proposera de nombreux exemplesconcrets et aura pour vocation de servir de support à la formation continue. En attendant, voici quelques exemplesde questions posées à l’ICC courant2011 et 2012 par des entreprises dumonde entier et les réponses appor-tées. A noter que celles-ci visent àguider les utilisateurs sans constituerpour autant une opinion officielle etdéfinitive de la Chambre de commerceinternationale.
Si un crédit documentaire mentionneIncoterms® 2010 et que les documentscontractuels font référence aux Incoterms 2010 sans le ®, s’agit-ild’une irrégularité au sens de l’article16 des règles uniformes UCP 600 (ICCPublication n°600) ?L’absence du symbole ® pour lamarque enregistrée «Incoterms» nedevrait pas rendre irrégulier un document dans le cadre d’un crédit
documentaire qui fait référence auxIncoterms 2010 avec le symbole ®.
Qui prend en charge les frais de manu-tention (terminal handling charges)selon les nouvelles règles Incoterms®2010 ?Les articles A6 et B6 de chaqueIncoterm précisent la répartition descoûts entre l'acheteur et le vendeur.Les nouvelles règles font référence àla relation entre le contrat de vente etle contrat de transport. La notion«Terminal Handling Charges» / fraisde manutention recouvre toute unesérie de coûts et il faut analyser aucas par cas si ces coûts concernentune prestation réalisée avant ouaprès la livraison des marchandisestelle que définie dans l’article A4 dechaque Incoterm. Il arrive que les«Terminal Handl ing Charges»incluent des frais liés aux formalitésd’exportation et d’importation desmarchandises, et dans ce cas larépartition est régie par les articlesA2 et B2 de chaque Incoterm.
Qui prend en charge les coûts liés à lasécurité/ sûreté du transport de mar-chandises ? Depuis le 1er janvier 2011,toute arrivée de marchandises dansl’Union Européenne est, par exemple,soumise à des obligations déclarati-ves d’importation qui doivent interve-nir avant le chargement des mar-chandises sur un navire. En fonctiondu pays de départ, les transporteursimputent ces coûts différemment. Ilssont parfois inclus ou ajoutés au fretmaritime, mais d’autres transporteurs,
notamment au départ de l’Asie, les facturent directement au vendeur.Au moment de la préparation desnouvelles règles Incoterms® 2010, lecomité de rédaction a analysé lesréglementations concernant la sécu-rité du transport de marchandises.Toutefois, une pratique établie n’existepas encore sur la question de leurprise en charge. L’ICC s’est limité àindiquer dans les articles A2, B2 etA10, B10 de chaque Incoterm unesolution par défaut. La prise en chargedes coûts relatifs à la sécurité dépenddonc de l’Incoterm choisi et la répartition ne concerne que le contratde vente dans lequel l’Incoterm estutilisé. Supposons qu'un fournisseurjaponais vende à un client français«FCA terminal au départ». Le ven-deur est responsable pour les forma-lités à l’exportation mais ne l'est paspour la déclaration d’importationdans l’Union Européenne. Si le mêmeacteur japonais vend au client fran-çais avec l’Incoterm «DAP locaux del’acheteur» à Lyon, le vendeur n’esttoujours pas responsable, avec DAP,pour les formalités d’importation.Cependant, la déclaration d’importa-tion est établie par le transporteurmaritime. En utilisant DAP, le ven-deur conclut le contrat de transportet le transporteur inclura les frais liésà la déclaration dans la facture.Puisqu’il s’agit d’une obligation àl’importation à la charge de l’ache-teur, celui-ci doit rembourser cescoûts. Précisons que le vendeurcomme l’acheteur ont obligation de fournir l’assistance et les
Incoterms® 2010 : les expertsd’ICC répondent aux questions des entreprises.
Depuis l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des nouvelles règles Incoterms 2010,l’ICC a mis en place, notamment en France, un dispositif destiné à accompagner lesentreprises dans la mise en pratique de ces nouvelles règles.
Christoph Martin RADTKE, Avocat, Rechtsanwalt, Associé LAMY & ASSOCIES,Président de la commission Droit et Pratiques du Commerce International d’ICC France
©D
RICC FRANCE
Autorégulation
13-14 MARTIN radtke 3/05/13 15:47 Page 13
14 France
AUTORÉGULATION
ICC FRANCE
informations nécessaires pour faciliter ces formalités.
Dans les notes-conseil du CPT et duCIP, il est indiqué qu’à défaut de précision, le risque est transféré aumoment où les marchandises sontremises au premier transporteur. Quiest le «premier» transporteur ?Le premier transporteur est le premier transporteur indépendant duvendeur avec lequel celui-ci a concluun contrat de transport.
Comment doit-on comprendre le mot«terminal» dans la nouvelle règle Incoterm 2010 DAT ?Le mot terminal est utilisé dans unsens très large. Il inclut tout endroitcouvert ou pas, comme un quai, unentrepôt, un terminal à container,dans un port ou un aéroport, etc. Le«terminal» doit cependant être unlieu équipé d'une certaine organisa-tion pour accueillir les marchandisesà la différence d’un simple terrain,une place, etc.
Dans la nouvelle règle Incoterm® DAT,le vendeur est-il censé décharger lesmarchandises «au terminal» ou «dansle terminal» ? Peut-il la déposer devantla porte ou doit-il la décharger à l’intérieur ?Le paragraphe A4 de la règle DATindique que la livraison se fait «auterminal». La question de savoir si les marchandises doivent êtredéchargées à l’intérieur dépend descirconstances particulières du lieu etde l’usage du lieu. En pratique, il estencore plus important de savoir àquel endroit le vendeur peut obtenirune preuve de la livraison, à savoir undocument qui permettra à l’acheteurde prendre livraison des marchandi-ses tel que prévu dans l’article A8.Toutefois, et comme le recomman-dent les notes-conseils du DAT, il estpréférable que les parties indiquentprécisément le point de livraison auterminal convenu.
En cas d’utilisation de la nouvelle règleIncoterm® 2010 DAP, que se passe-t-il si l’acheteur ne réceptionne pas lamarchandise livrée au lieu indiquéconformément à DAP. Qui en supporteles coûts ?La règle DAP indique que la livraisona lieu par la mise à disposition desmarchandises au lieu convenu maisnon déchargées. Le vendeur doitinformer l’acheteur de manière
appropriée. Si tel a été le cas, lalivraison a eu lieu et tous les coûts etrisques sont transférés à l’acheteur.Celui-ci supporte aussi tout coûtadditionnel s’il a manqué d’informersuffisamment le vendeur (article B7).Dans la pratique, avec un DAP, letransporteur facturera ses coûts auvendeur qui a signé le contrat detransport, mais dans les relationsentre le vendeur et l’acheteur, c’estl’acheteur qui devra rembourser levendeur.
Les nouvelles règles Incoterms® indi-quent que FOB, CFR et CIF ne peuventplus être utilisées pour des marchan-dises en containers. Est-ce exact ?Les notes-conseil de FOB, CFR et CIFdes Incoterms® 2010 indiquent clairement aux utilisateurs qu’il fautvérifier si le point de livraison prévudans ces règles est approprié pourdes marchandises en containers. Eneffet, des marchandises en containerssont typiquement remises par le vendeur à l’entrée d’un terminal àcontainer ou d’un entrepôt, et ce pointest le lieu de livraison approprié.Dans les Incoterms FOB, CFR et CIF,le vendeur supporte le risque deperte ou d’endommagement de lamarchandise jusqu’au moment deleur mise à bord sans aucune possibi-lité de contrôle pour le vendeur. Dansla mesure où la remise des marchan-dises a en réalité lieu bien avant, àsavoir à l’entrée du terminal, lesIncoterms FCA, CPT ou CIP qui prévoient une livraison à ce lieu, sontbeaucoup plus appropriés.
Les notes-conseil des Nouvelles RèglesIncoterms® 2010 FOB, CFR et CIF indi-quent que ces règles ne sont pas appro-priées pour des marchandises transpor-tées en containers, car celles-ci nesont pas livrées à bord d’un navire.Toutefois, il arrive souvent que lesbanques demandent un connaissementmaritime «Ocean bill of lading» encas d'utilisation d'un crédit-docu-mentaire. Que faut-il en penser ? L’utilisation des Incoterms® FOB,CFR et CIF n’est pas appropriée pourdes marchandises transportées encontainers. La solution serait d’utili-ser FCA, CPT ou CIP, et de convenirdans le contrat de vente que le ven-deur va présenter un connaissement«On-board Bill of Lading» et demanderau transporteur soit l’émission d’unconnaissement soit une annotationindiquant la date de la mise à bord de
la marchandise sur une «Received for Shipment Bill». Il serait encorepréférable que les parties cessentd'utiliser le connaissement maritimedans ce cas.
En ce qui concerne le nouveau pointde livraison maritime dans les règlesFOB, CFR CIF, que signifie «placer à bord les marchandises» ? Est-il nécessaire que celles-ci soient fixéesou arrimées ?L’article A4 des Incoterms FOB, CFRet CIF indique que la livraison doitavoir lieu selon les usages du port.Toutefois, ceux-ci peuvent varier et lamanière de placer la marchandise à bord dépendra aussi du type demarchandise et du type de navire. A défaut de tout usage particulier oude toute précision formulée dans lecontrat, on considère que les mar-chandises sont livrées au moment oùelles sont posées à bord.
13-14 MARTIN radtke 3/05/13 15:47 Page 14
15France
La médiation n’est pas une alternative au contentieux. C’estune négociation assistée. Si les
entreprises ne parviennent pas à négocier une solution satisfaisante,elles auront recours à la médiation,c’est-à-dire qu’elles demanderont àun tiers de les aider à surmonter lesobstacles qu’elles rencontrent.On doute bien souvent que le médiateur puisse apporter quoi quece soit. Comme si, ayant tout tenté,on ne pouvait plus rien espérer.Pourtant, il en va bien autrement. En effet, celui-ci ne se borne passimplement à organiser un marchan-dage entre deux demandes oppo-sées. Les techniques de la médiation,et c’est la raison de leur succès, permettent aux parties en présencede réfléchir à leur différend autre-ment. Einstein disait «qu’un problè-me sans solution est un problèmemal posé». Il disait aussi «qu’un problème créé ne peut être résolu enréfléchissant de la même manièrequ’il a été créé». L'approche s’ap-plique particulièrement aux conflitsdu commerce international. Si unblocage survient dans une négocia-tion, c’est en effet que le problèmeest mal posé. Le rôle du médiateursera d’aider les parties à le reposerdans les bons termes et à imaginerles solutions auxquelles elles nepouvaient pas penser. En voici trois exemples. Après douzeannées de procédure entre treizeparties pour des nuisances causéespar un immeuble à un autre, ledéfendeur rachète l’immeuble du
demandeur pour le dixième du prixdes travaux nécessaires pour mettrefin au trouble occasionné. Le deuxiè-me exemple voit deux parties s’affronter sur la nullité d’un contratinternational pour dol : le défendeurconsent un prêt au demandeur pourl’aider à surmonter le problème rencontré. Le contrat est sauvé à lasatisfaction de tous pour environ, ànouveau, 10% du montant de lademande initiale. Enfin, il faut men-tionner la solution trouvée pourrésoudre le conflit entre Google et lapresse française : ne pouvant semettre d’accord sur une redevance,on a mis en place un fond d’aide aupassage à internet.Je crois que la meilleure raison derecourir à la médiation et d’insérersystématiquement une clause dansles contrats tient à la capacité dumédiateur à amener les parties enprésence à trouver de nouvellesmanières de surmonter la difficulté.Si on ajoute que cet avantage estobtenu dans des délais très brefs(rarement plus de trois mois) et pourun coût très faible (quelques dizainesde milliers d’euros au maximum), oncomprend mal qu’il puisse encore yavoir des réticences à l'insérer dansles contrats et à y avoir recourslorsque le litige est apparu. De plus,la médiation permettra de modifierun contrat mal ficelé alors que lecontentieux ne peut que débouchersur son annulation, donc rompre larelation d'affaires, ou le faire appli-quer mais en en faisant subir lesimperfections aux parties.
La médiation permet aussi de sortirde la confrontation des nationalités.Comme l’arbitrage, elle facilite lerecours à un tiers neutre et indépen-dant, notamment dans le cadre de lamédiation ICC. Certes, celle-ci nefonctionnera que si les parties ont lavolonté de trouver une solution. Dèslors, certaines entreprises s'interro-gent sur l’opportunité d'inscrire desclauses de médiation dans leurcontrat d’autant que le droit euro-péen en fait une cause d’irrecevabili-té de la demande si une médiationn’a pas été tentée. Elles craignent dedevoir aller en médiation alors qu’aumoins une des parties ne souhaitepas trouver une solution. Cette crain-te est infondée car les inconvénientsde la clause dans une telle circons-tance sont infimes. Parce que lamédiation est rapide et bon marché,la perte de temps et d’argent seradérisoire par rapport à l'option ducontentieux. Enfin, la médiation nepeut mener qu’à une solutionconsentie, c'est-à-dire favorable àl’entreprise…Lorsqu'on connaît le coût, lesrisques, les contraintes et la duréedu contentieux international, lors-qu'on connaît le prix que représentela décision de nouer une relationd’affaires à l'international et le coûtde sa rupture, peut-on raisonnable-ment décider de ne pas recourir à lamédiation et opter directement pourl’arbitrage ou le contentieux judiciai-re ? La médiation est vraiment uninstrument précieux de résolutiondes conflits. ■
La médiation internationale,instrument précieux de résolution des conflits.
RÉSOLUTION DES LITIGES
Nouvel instrument dans la panoplie de résolution des conflits, la médiation est unoutil précieux qui permet, grâce à l'aide d'un tiers, de réfléchir autrement à dessolutions auxquelles les deux parties n'avaient pas pensé et d'éviter ainsi le coût,le risque et la durée associés à un contentieux international.
Thierry GARBY, Avocat honoraire, Médiateur et Formateur en négociation et médiation.
©D
RICC FRANCE
15 garby 3/05/13 15:48 Page 15
17France
En 2013, le commerce mondial devrait progresser de quelque 4 % en volume selon les experts del'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s'agit d'une légère embellie par rapport à 2012 mais la crisen'en continue pas moins de peser sur le niveau et le coût des transactions. Elle affecte aussi les conditions
dans lesquelles les institutions financières viennent en soutien des entreprises dans leurs efforts pour conquérirdes parts de marché à l'export. C'est pourquoi Échanges Internationaux consacre son dossier thématique à la question du financement du commerce international, d'autant que de nouvelles règles et solutions ont vu le jourrécemment en matière de financement tandis que les entreprises cherchent à rationaliser leurs coûts, réduire leursbesoins en fonds de roulement et sécuriser leurs opérations tant à l'import qu'à l'export.
Dans ce contexte où les entreprises françaises doivent plus que jamais pouvoir compter sur leurs partenaires pourêtre compétitives dans le grand bain international, ICC France se mobilise pour les accompagner, grâce aux règles uniformes de la Chambre de commerce internationale destinées à faciliter les transactions commerciales inter-nationales. Georges Affaki, vice-président de la Commission bancaire d'ICC, interpelle le régulateur et plaide ici pourune approche plus réaliste de son financement. Jean-Pierre Mattout, président de la Commission bancaire d'ICCFrance revient sur l'importance et le succès de la normalisation universelle des crédits documentaires à travers l'évolution des Règles et Usances Uniformes d’ICC (RUU) avant d'évoquer les nombreuses règles qui couvrent d'autres domaines d'intervention, notamment les dernières nées que sont les Règles Uniformes du Forfaiting (RUF)publiées en janvier 2013 et les Obligations bancaires de paiement (OBP) qui devraient être adoptées dès le mois d'avril.Comment utiliser les RUF à bon escient ? Patrice Tournus, expert bancaire international, explore les possibilités offertes par ces nouvelles règles tandis que Martine Graff, directrice d'activités Trade Finance de Syrtals, société spécialisée dans le traitement des flux financiers, revient en détail sur les atouts des OBP pour les banques commepour les entreprises.
Le commerce mondial a besoin de règles universelles et modernes pour assurer son développement. Il a aussi besoin d'établissements financiers qui jouent pleinement leur rôle dansson financement. Or, les banques doivent affronter aujourd'hui lesconséquences des excès révélés par la crise de 2008 et sont soumises à des contraintes de plus en plus fortes, notamment enmatière d'exigences réglementaires concernant leurs fonds propres (Bâle III). Elles sont aussi invitées à exercer une vigilanceaccrue vis-à-vis de leurs contreparties et à l'élargissement de lanotion d'embargo tel que désormais pratiqué par les Etats. Denouvelles exigences qui pèsent de tout leur poids sur le coût durisque associé au financement des échanges. Georges Affakirevient sur le coût de plus en plus prohibitif des risques associésau financement du commerce international. Jean-Paul Riolacci,Responsable Capital et Crédit chez BNP Paribas, revient sur lesconséquences de la crise bancaire européenne sur le TradeFinance et explique pourquoi l'assouplissement attendu desconditions de son traitement dans la CRD IV, traduction européen-ne des nouvelles normes internationales en matière de fonds propres bancaires adoptées par le G20 (Bâle III), est essentiel. Undossier à suivre.
DOSSIER THÉMATIQUEDOSSIER THÉMATIQUE
Le financement du commerceinternational
■ Les défis réglementaires du commerce internationalGeorges AFFAKI ........................................................ 18
■ L’œuvre normative d’ICC : une arme pour sécuriser le commerce internationalJean-Pierre MATTOUT.......................................... 20
■ Les atouts du nouvel instrument Obligation Bancaire de Paiement (OBP)Martine GRAFF........................................................... 22
■ Nouvelle publication des Règles Uniformes du Forfaiting (RUF 800) : Comment les utiliser à bon escient?Patrice TOURNUS .................................................... 24
■ Les conséquences de la crise bancaire européenne pour le Trade FinanceJean-Paul RIOLACCI .............................................. 25
Le financement du commerceinternational
ICC FRANCE
17 intro 3/05/13 15:50 Page 17
18 France
STRATÉGIES ET MARCHÉS INTERNATIONAUX
DOSSIER THÉMATIQUE
Financement du commerceinternational : défis réglementaires pour 2013
ICC FRANCE
Un redémarrage de l’économie,timide et fragile, semble s’amorcer. Il devra fondamen-
talement reposer sur le commerceinternational. Celui-ci dépendra engrande partie du financement que les banques leur apporteront. Lesattentes sont grandes. Le commerceinternational devrait croître à un tauxsupérieur à celui du PNB mondial. Sile financement est en mesure del’accompagner, il augmentera plusque tout autre type de crédit. La recapitalisation des banques etles refinancements à long terme deleurs engagements (LTRO de la BCE par exemple) devraient a prioriamener les banques à soutenir cette croissance. Toutefois, avec lamultiplication des exigences régle-mentaires en matière de capitalréglementaire, de vigilance sur lescontreparties et d’une conceptionparticulièrement élargie des embar-gos, les risques liés au financementdu commerce international devien-nent prohibitifs. La Commission bancaire d’ICC est lavoix du secteur bancaire sur cesquestions. En s’appuyant sur sonexpérience reconnue dans le finance-ment du commerce international,ainsi que sur des recherches empiriques sans précédent sur lesrisques qui y sont liés, elle interpelleles régulateurs nationaux et supra-nationaux en les incitant à une appro-che plus réaliste des financementsgarantis, à court terme et à risquelimité, du commerce international.
Pour une approche réglementaireréaliste de la capitalisation des opé-rations du commerce international.Les engagements bancaires definancement du commerce interna-tional ont subi les conséquences desexcès des opérations bancaires hors-bilan. Or, un crédit documentaire,une lettre de crédit standby ou unegarantie de paiement sont fonda-mentalement différents, tant dansleur concept que dans leur structura-tion, des opérations de titrisations synthétiques et autres pensionslivrées (repos). Imposer que 100% de la valeur nominale d’un créditdocumentaire soit comptabilisésprudentiellement sur le bilan dès sonémission, alors qu’à peine 25% desdemandes en paiement sont confor-mes et entraînent une obligation depaiement, est irréaliste.Contrairement à ce qu’on a pu entendredans certains forums, Bâle III n’a pas changé le facteur de conversion de crédit (CCF) appliqué au crédit documentaire. Les trois versions successives des accords ont constam-ment appliqué un CCF de 20% aux crédits documentaires garantis par lacargaison expédiée. En revanche, BâleIII a imposé un nouveau levier (levera-ge ratio) de 100% sur les engagementshors-bilan, y compris les crédits docu-mentaires. Comme la garantie bancaire,le crédit documentaire (et sa variantestandby) n’a vocation à figurer sur lebilan de l’émetteur qu’en cas de présentation strictement conforme.Empiriquement, ces présentationssont inférieures à 25%. Si, in fine, unegrande majorité des crédits documen-
taires se dénouent par le paiement,c’est parce que la banque émettrice a volontairement, et discrétionnaire-ment, levé les irrégularités. En géné-ral, elle ne le fera que sur instructionet sous la garantie explicites du don-neur d’ordre. La probabilité de perteest, on le constate, limitée et ne justifiecertainement pas un traitement réglementaire aussi pénalisant.La Commission bancaire d’ICC a crééun registre pour compiler les statis-tiques des banques du commerceinternational quant à leurs pertesavérées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur 11.4 millions d’opéra-tions de financement du commerceinternational, on a enregistré 0.02%de non-paiement dont seulement0.007% de pertes définitives. De nombreuses banques ont adhéréau registre. Il est envisagé d’étendreson champ aux financements exports.Avec les statistiques empiriques quele registre révèle, la Commission bancaire d’ICC milite auprès duComité de Bâle pour un levier plusréaliste qui imposerait un CCF de 20%sur les crédits documentaires garan-tis par l’opération sous-jacente et 50%pour les autres engagements bancai-res du commerce international.
Pour une vigilance pragmatique surles contreparties Les banques sont soumises à uneobl igat ion de vigi lance (CDD) accrue quant à leurs contreparties.Conscientes de leur responsabilitésociétale et de leur rôle pivot dans lescircuits de paiement ainsi que durisque de détournement à des finsillégales, elles se sont dotées des
Le coût des risques associés au financement du commerce international devient deplus en plus prohibitif. Pour soutenir la reprise mondiale, une approche plus réalistede ces modes de financement est indispensable.
Georges AFFAKI, Vice-Président de la Commission bancaire ICC
©D
R
18-19 affaki 3/05/13 15:54 Page 18
19France
ICC FRANCE
effectifs experts et des moyensmatériels nécessaires pour assurercette vigilance, souvent à des coûtssubstantiels. Il serait toutefois irréaliste imposer lemême standard de CDD entre banquescorrespondantes dans leurs opérationsde compensation de paiements liés aucommerce international que celui exigédans les flux de paiement avec desclients directs. La banque de compen-sation n’a généralement aucune relation client directe avec les parties àl’opération sous-jacente ; ceci est duressort de son correspondant. En igno-rant la réalité économique du rôle desbanques intermédiaires dans le com-merce international, on arrive à exigerd’une banque notificatrice d’un créditdocumentaire d’accomplir un CDD surle bénéficiaire non-client, d’une banqueémettrice d’un crédit documentairelibrement négociable d’accomplir unCDD sur une banque négociatricedemandant son remboursement en tantque banque nommée par le bénéficiaire,voire d’une banque qui lève les documents présentés au titre du créditdocumentaire de vérifier que le navirementionné dans le connaissement n’apas navigué dans les eaux territorialesd’un pays placé sous embargo par lepays dont la monnaie est utilisée dans lecrédit documentaire.Les messages de paiement SWIFTpour compte de tiers incluent aujour-d’hui des champs obligatoires dansles paiements pour tiers qui exigentl’indication de l’identité des donneursd’ordre et de l’objet du paiement. Il vade soi que la banque se doit deconfronter ces noms et motifs auxbases de données qu’elle détient. Ilen va de même de tout document lié àl’opération sous-jacente qui passeraitpar ses services. Aller au-delà ris-querait d’aboutir à un coût tellementprohibitif que les banques occidentalessuspendraient purement et simple-ment leurs opérations de compensa-tion avec leurs correspondants despays émergents. Le dommage pources pays et, au-delà, pour la croissancemondiale, serait irréparable. LaCommission bancaire de l’ICC a rédigé un manifeste adressé au GAFIattirant son attention sur ce problème bien réel qui risque delimiter les flux avec les banques correspondantes et ce, à un momentoù la reprise du financement du commerce est encore fragile2.
Pour une approche multilatéraledes embargos. La nouvelle politiqueétatique des embargos, élargissantleur champ et prorogeant leur com-pétence dans une ambition extrater-ritoriale évidente, le tout sans souciparticulier de coordination multilaté-rale, est devenu un véritable obstacleau développement du financementdu commerce international.Depuis 2005, 7 grandes banquesinternationales ont été condamnéesà des amendes substantielles pourdes violations d’embargos dans leursopérations de financement du com-merce international. Il s’agit d’ABNAmro (580m $), Lloyds TSB (350m $),Crédit Suisse (536m $), Barclays(298m $), ING (619m $), StandardChartered (667m $) et HSBC (1.92bn$ - dont une partie se rapportant àd’autres infractions à la législationanti-blanchiment). La multiplication des embargos,multilatéraux ou unilatéraux, témoi-gne de l’instrumentalisation de l’éco-nomie à des fins de politique étran-gère. De mesure d’appui à l’actionmilitaire, l’embargo se transforme ensubstitut bien moins coûteux à cetteaction. Et les banques sont au centredu dispositif de contrôle du respectdes embargos. Les gouvernementsont réalisé que les circuits de paie-ments sont l’essence même de l’effi-cacité de leurs embargos. Contrôlerces circuits ou, plus exactement,charger les banques d’assurer l’étanchéité de leurs circuits à touteopération contrevenant aux embar-gos, c’est assurer une pressionconsidérable sur le pays visé.Le problème est que le champ d’application des embargos n’est pastoujours clair, de sérieux doutesexistent quant à la portée de certainsembargos unilatéraux et certainsEtats peuvent prendre des mesuresde rétorsions prohibant la conformitévolontaire à un embargo étrangerlaissant ainsi les opérateurs du com-merce international face à un conflitde normes impératives. On a pu ainsi penser qu’un embargo,de par sa nature (loi de police), nes’appliquait que sur le territoire del’Etat qui l’a édicté ou, le cas échéant,sur ses citoyens fussent-ils à l’étran-ger. Or, l’expérience des pénalitésrécentes mentionnées ci-dessusdémontre que l’usage de la monnaie
d’un pays entraîne l’application de sesembargos financiers dans la mesureoù une opération à l’étranger ne peutse dénouer sans passer par le circuitde compensation financière du paysdont la monnaie est utilisée. Aumoment de la compensation, lesautorités monétaires du pays concer-né pourraient prétendre asseoir leurjuridiction sur l’ensemble de l’opéra-tion, y compris si la monnaie de paiement est différente mais qu’uneopération forex en vue de la convertirdans la monnaie de compte aboutit àla compensation dans le système dupays de l’embargo. La difficulté de vérifier au moment del’opération si le paiement ultérieur pour-rait être prohibé par un embargo a faitapparaître dans nombre d’instrumentsdu commerce international des clausesde prorogation d’embargo (sanctionclauses). Ne se limitant pas à affirmerque l’émetteur du crédit documentairese réserve le droit de ne pas payer si unembargo le lui interdit (ce qui soulignel’inanité de la clause), certaines clausesvont jusqu’à réserver le droit de ne paspayer si la banque juge le paiementcontraire à sa politique de conformité.On arrive ainsi à remettre en cause l’irrévocabilité des engagements depaiement du commerce internationalpour des motifs purement potestatifs.Consciente de ses limites dans undomaine qui est généralement consi-déré comme relevant de la souverai-neté des Etats, la Commission ban-caire de l’ICC a néanmoins émis unerecommandation soulignant le risquede ce type de clauses sur la confiancedans les engagements bancaires,leur impact sur le commerce interna-tional, et recommandant de ne pas yavoir recours2. Cette recommandationmérite un soutien sans réserve. Dedeux choses l’une : soit l’embargo s’applique de droit au paiement enquestion et primera alors toute dispo-sition contraire, avec ou sans clause,soit ce n’est pas le cas et la rigueur del’engagement irrévocable soutenuepar les UCP doit s’appliquer sans tergiversations.Les embargos, comme les autresdéfis réglementaires au financementdu commerce international, gagne-raient à être conçus et imposés surune base multilatérale pour éviterdes distorsions incompatibles avecl’impératif de prévisibilité, inhérentaux échanges internationaux.
Dossier thématique
(1) Problems encountered by Trade Finance in regards to CDD requirements for counterparties and correspondent banks, ICC Document No. 470/1202 –18 September 2012.
(2) Guidance Paper on the Use of Sanction Clauses for Trade Related Products (e.g. Letters of Credit, Documentary Collections and Guarantees) subjectto ICC Rules, ICC Document No.470/1129 rev – 26 March 2010.
18-19 affaki 3/05/13 15:54 Page 19
20 France
STRATÉGIES ET MARCHÉS INTERNATIONAUX
DOSSIER THÉMATIQUE
L’œuvre normative d’ICC :une arme pour sécuriser lecommerce international
ICC FRANCE
ICC est multiple et diverse. Elleabrite un des plus grands centresd’arbitrage du monde, elle promeut
la liberté des échanges commerciauxpar ses analyses et son action auprèsdes organismes internationaux.Cependant, son œuvre la plus d é t e r m i n a n t e e n f a v e u r d u commerce mondial est de proposerdes règles, de réussir à les faireappliquer de façon quasi uniforme etd’en assurer la constante moderni-sation. Les Incoterms en sont unebelle illustration dans le domaine dela définition abrégée des termes dela vente internationale.Le domaine où cependant elle aréussi à prendre une place détermi-nante est celui des opérations de financement dont se charge saCommission bancaire . A tout seigneur, tout honneur, il convientd’abord d’évoquer son action exem-plaire en matière de crédits docu-mentaires.
Une réussite exceptionnelle : lanormalisation universelle des crédits documentairesLe crédit documentaire est un crédità l’importation ouvert par un ban-quier émetteur à la demande de sonclient, le donneur d’ordre/importa-teur, qui l’engage irrévocablement àpayer une certaine somme d’argentsur présentation de documents enstricte conformité apparente avec lestermes du crédit ouvert. Instrumentde nature contractuelle, il est adaptable aux diverses situationsrencontrées dans le commerce
international, comme au niveau deconfiance que s’accordent mutuelle-ment acheteurs et vendeurs.Très tôt, dans les premières annéesdu XXème siècle, ICC entreprit de rédiger des Règles et UsancesUniformes dans ce domaine. Leurpremière version date de 1933. Leur sixième version, actuellementapplicable, est de 2007, les RUU 600.Au fil des révisions successives, lemonde entier les a reconnues etadoptées. Aujourd’hui, il n’y a pas unseul crédit documentaire ouvert quin’y soit pas expressément soumis !C’est un cas quasi unique d’un texte àportée universelle. Mais un texte universel, s’il constitue un immenseprogrès par rapport à une proliféra-tion de textes nationaux nécessaire-ment différents, n’atteint qu’une partie de l’objectif d’universalité s’iln’est pas appliqué de façon uniforme,tant par ses utilisateurs que par lestribunaux qui ont à l’interpréter. Or, sur ce plan aussi, ICC réussit unvéritable tour de force.En vérité, elle procède en deux temps : - le premier est celui de l’élaboration
des Règles. Elle est large et fonda-mentalement participative. Ungroupe d’experts, choisis au sein desa Commission bancaire, élabore letexte, ou sa nouvelle version, qui estensuite soumis à l’ensemble descomités nationaux d’ICC dans lemonde ; s’organisent deux, trois,voire davantage, allers-retours d’amendements entre le grouped’experts et les comités nationauxjusqu’à ce que le texte fasse l’objet
d’un consensus ; la matière pre-mière nécessaire à la révision estpuisée dans l’expérience accumu-lée depuis la précédente version,par les questions d’interprétationqui se sont posées ou les nouvellespratiques qui sont apparues.
Une fois le texte adopté, son élabora-tion a été tellement partagée, qu’iln’y a aucune difficulté à le faireaccepter, puis appliquer par lesbanques du monde entier ;- intervient alors la deuxième étape :
l’interprétation. La Commissionbancaire reçoit en continu desquestions posées par les diversintervenants du commerce interna-tional sur des cas concrets d’appli-cation contestée de ces Règles etqui lui demandent de donner labonne interprétation. Là encore, la réponse est préparée par unconseiller technique et ensuiteadoptée, après d’éventuels amen-dements, par la Commission ban-caire en séance plénière, deux foisl’an. La réponse est diffusée dans lemonde et un recueil parait réguliè-rement qui regroupe ces réponsesassurant ainsi la diffusion de l’interprétation préconisée par l’auteur même des Règles, l’ICC. Au fil des années, se sont ainsiaccumulées des réponses précieu-ses à même de guider puissam-ment les praticiens.
Les tribunaux eux-mêmes, sont sen-sibles à ces collections de responsaet sont attentifs à assurer une inter-prétation uniforme des Règles, afinde ne pas en diminuer la portée.
Dans le domaine du financement, la Chambre de commerce internationale joue unrôle essentiel dans la définition de règles uniformes susceptibles de faciliter ledéveloppement les échanges. Forte du succès de la normalisation universelle ducrédit documentaire, elle a élargi récemment son domaine d'intervention à d'autresmodes de financement.
Jean-Pierre MATTOUT, Avocat au barreau de Paris, Kramer Levin, Professeur-associé à l’Université deParis II, Panthéon-Assas, Président de la Commission Bancaire d’ICC France.
©D
R
20-21 mattout 3/05/13 15:56 Page 20
21France
ICC FRANCE
Afin de faciliter plus avant le traite-ment de certaines difficultés et de promouvoir l’usage des crédits documentaires, ICC a élaboré lesInternational Standard BankingPractices (n°681, dont une nouvelleversion est en préparation), qui préci-sent dans le détail, les pratiques ban-caires internationales (par oppositionaux pratiques nationales contre lesquelles elle entend lutter) enusage dans le traitement des docu-ments couramment utilisés dans ces crédits. De même, afin de faciliter lerèglement des litiges dans ce domaine(mais aussi en matière d’encaisse-ment ou de garantie), elle a élaboréune procédure de médiation diteDOCDEX (Documentary InstrumentsDispute Resolution Expertise), quipermet, à un coût très bas, derechercher rapidement une solutionauprès d’experts, afin d’éviter derecourir aux tribunaux ; sauf accordcontraire des parties, la décisionDOCDEX, n’oblige pas les parties às’y conformer.
D’autres domaines d’interventionICC, forte de ce précédent, a multiplié la rédaction de Règles etusances dans différents domaines.Certaines sont anciennes, n’ontguère subi de révision récente, maisparaissent toujours adaptées auxbesoins de la pratique. C’est sansdoute le cas des Règles Uniformespour les Encaissements (n° 522) quicouvrent les opérations d’encaisse-ment libre et documentaire de papiercommercial dans le commerce international, ou encore ses Règlessur les Lettres de Crédit Standby de1998 (ISP 98 n° 590). D’autres connaissent le même processus d’évolution que les RUU,comme les Règles Uniformes relati-ves aux garanties sur demande (n° 758), de 2010, révisant et amélio-rant leur première version de 1992(n° 458). Celles-ci sont en passe des’imposer sur le marché interna-tional et les opérateurs y ont de plusen plus recours. Des modèles de garantie sont également proposés,parfaitement adaptés aux RUGD.Forte de ces succès, ICC a élargirécemment son domaine d’interventionà d’autres modes de financement.Elle vient d’adopter en 2012, de nouvelles Règles et Usances sur leforfaiting, entrées en application le1er janvier 2013. Ces nouvelles Règlesvisent à uniformiser les pratiques en
matière d’opérations d’escomptesans recours, tant sur le marché primaire que sur le marché secon-daire de ces opérations.Un autre projet est en cours concer-nant les Bank Payment Obligationsou Obligations Bancaire de Paiement,qui devrait être adopté sous forme denouvelles Règles en avril 2013, et quise veut un nouvel instrument, prochedu crédit documentaire, mais large-ment informatisé. Il se définit commeun engagement bancaire irrévocablede payer à une autre banque une
somme donnée à une date donnée,après vérification électronique deconformité (matching) des donnéeset des conditions spécifiées dans unebase informatisée (baseline). Gageons que la multiplication de cesRègles couvrant les opérations decommerce international continuera àfavoriser son développement en per-mettant de promouvoir des solutionsuniformes aux problématiques pra-tiques les plus souvent rencontrées. C’est l’expression moderne de la lex mercatoria !
Dossier thématique
Formations au Trade Finance :
le programme 2013 d'ICC France
Chambre de commerce internationaleL’organisation mondiale des entreprises
France
• Les nouvelles Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS) :1ère session : Mardi 14 Mai 2013 (Complet)2ème session : Vendredi 28 Juin 2013 (Complet)3ème session : Jeudi 5 Septembre 2013 4ème session : Jeudi 24 Octobre 20135ème session : Jeudi 14 Novembre 2013
• Maîtrise des garanties bancaires internationales :1ère session : Mercredi 22 et Jeudi 23 Mai 2013 2ème session : Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre 2013
• Forfaiting : Mardi 11 Juin 2013
• Formation intensive au traitement des opérations de créditdocumentaire :1ère session : Du Mercredi 29 Mai au Jeudi 6 Juin 2013 (Complet)2ème session : Du Mercredi 9 au Jeudi 17 Octobre 2013
• Encaissements documentaires : Jeudi 26 Septembre 2013
• Initiation aux garanties bancaires internationales : Jeudi 3 Octobre 2013
• Initiation aux crédits documentaires : Mardi 19 et Mercredi 20 Novembre 2013
• La lettre de crédit stand-by commerciale : Lundi 25 Novembre 2013
2 OPTIONS POUR VOUS INSCRIRE :• en ligne : www.icc-france.fr
• en nous contactant : 01 42 65 41 83 ou [email protected]
20-21 mattout 3/05/13 15:56 Page 21
22 France
STRATÉGIES ET MARCHÉS INTERNATIONAUX
DOSSIER THÉMATIQUE
Les atouts du nouvel instrument ObligationBancaire de Paiement (OBP)
ICC FRANCE
Le partenariat entre la Chambrede Commerce Internationale(ICC) et SWIFT signé lors du
SIBOS 2011 pour répondre aux évolu-tions du commerce international et àune demande croissante de finance-ment de la chaîne d'approvisionne-ment «Supply Chain Finance» vaoffrir au secteur bancaire mondialles règles et les grands principesdirecteurs de l’«Obligation Bancairede Paiement» (URBPO - UniformRules for Bank Payment Obligations)d’ICC.
Le contexteSelon l’Organisation mondiale ducommerce, l'augmentation du volu-me des échanges internationauxdevrait atteindre encore 4 % en 2013,dans le droit fil d'une croissance delong terme puisque les échangesmondiaux ont progressé en moyennede 5,4% au cours des vingt dernièresannées. Le commerce mondial est toutefoisconfronté à un nouveau paradigmedû à la globalisation des marchésdont les défis portent sur : • la complexité croissante des
produits,• les contraintes réglementaires
(Bâle III),• l’accroissement des risques (risque
de contrepartie, risque pays, dechange, de paiement) ,
• les évolutions technologiques, ladématérialisation des documents,l’émergence de plate-formes àmultiples acteurs,
• le développement de nouveaux circuits d'échanges (Sud-Sud, Asie-Afrique, Asie-Amérique latine...).
Comment les entreprises occidenta-les pourront elles conserver un avantage concurrentiel dans cettenouvelle donne ? Parviendront- ellesà s'adapter et à trouver leur placedans la réorganisation de la chaînelogistique internationale tout ensécurisant leurs opérations et enréduisant les risques à court termede leur activité commerciale ? Tel est l'enjeu des années à venir.
Une industrie du «trade finance»innovante.De nouveaux modèles de financementdu commerce international ont fait leurapparition. A côté des opérations classiques de Trade Finance (CréditsDocumentaires Import & Export, StandBy LC, Encaissements) et des 80% desopérations de commerce internationaltraitées en comptes ouverts «open
account», c'est-à-dire sans sécurité depaiement, se sont développées destechniques de financement de plus enplus sophistiquées avec notammentl’émergence d’offre de «financementde la chaîne d'approvisionnement»(Supply Chain Financing).Combinées à la technologie et auxinnovations SWIFT, les règles URBPO(Uniform Rules for Bank PaymentObligations) d’ICC à paraître en avril2013 vont permettre aux banques desécuriser les paiements en comptesouverts «Open Account» et rendreles échanges inter-banques plusautomatisés que dans les lettres decrédits classiques. Le schéma comparatif (Fig 1) ci-dessous présente l’OBP "ObligationBancaire de Paiement" comme lacombinaison du meilleur des deuxmondes : une sécurisation de latransaction à 100% de la lettre decrédit associée à la souplesse de«l’Open Account».
Dernière née des instruments de financement du commerce international, l'ObligationBancaire de Paiement (OBP), mise au point par ICC et Swift, permettra aux banquesde proposer à leurs clients des services innovants, flexibles et sécurisés de financementde la chaîne d'approvisionnement (supply chain financing).
Martine GRAFF, Directrice d’activités Trade Finance, SYRTALS
Fig 1 - Comparaison LC, BPO, Open Account (Source ICC -International Chamber Of Commerce- Septembre 2012 )
©D
R
22-23 graff 3/05/13 15:59 Page 22
23France
ICC FRANCE
Présentation de l’Obligation Bancairede Paiement (OBP). L'«Obligation Bancaire de Paiement»est un engagement irrévocable etindépendant donné par une banquel’«Obligor bank» à une autre banque,la «Recipient bank», de payer ou d'initier une obligation de paiementdifféré et de payer à échéance unmontant spécifique dû à la ‘‘Recipientb a n k ’ ’ a p r è s r é c o n c i l i a t i o n (matching) électronique de donnéesou acceptation du mismatch1.L’«OBP» (Obligation Bancaire dePaiement) est une garantie condi-tionnelle donnée par une banque àune autre banque. Elle évolue dansun environnement multi-banques.
de flux qui leur échappaient jusqu’a-lors. Pour répondre aux évolutions dumarché, elles pourront saisir de nouvelles opportunités de businessen proposant à leurs clients des services innovants pour financer leur chaîne d’approvisionnementavec des solutions «End to End» de«Supply Chain Financing». De nom-breuses banques internationales etrégionales (49 selon SWIFT) ont anti-cipé ces opportunités et offrent déjàà leurs clients leurs nouveaux servi-ces de financements basés sur l’OBP.Le partenariat entre la Chambre deCommerce Internationale et SWIFT apermis de montrer que celui-ci estdéjà une réalité en Asie et a confirmé
d’une efficacité opérationnelle surl’ensemble du process de traitement.Avec l’«OBP», l’importateur est enmesure d’offrir un financement sou-ple, flexible, efficace et sécurisé à sesfournisseurs. Il peut ainsi nouer uneréelle relation de partenariat aveceux dans le but d'améliorer sanscesse les performances et de gagneren avantage concurrentiel. Une tellerelation est de nature à instaurer uneconfiance mutuelle entre les acteurstandis que les fournisseurs se senti-ront impliqués dans l’objectif deréussite. Autre avantage pour l’importateur : une chaîne logistiquemoins vulnérable dans la mesure oùle risque d’approvisionnement est
diminué par lamise en place del ’ O B P c o m m ei n s t r u m e n t d e paiement dans lecontrat commer-cial.Côté fournisseur,les avantages del’OBP sont égale-ment multiples :elle diminue lerisque de non-paiement, amélioreles prévisions detrésorerie, permetd'être payé dansl e s d é l a i s e t d'obtenir un finan-c e m e n t d e l a‘’Recipient Bank’’(Pré-expédition oupost-expédition).
En conclusion, on peut dire que l'a-doption des règles d’ICC (qui serapubliée sous l’ICC- URBPO -Uniform Rules for Bank PaymentObligations) au printemps 2013jouera le rôle de catalyseur pouraccélérer l'adoption de l’OBP sur lascène des échanges internationaux.Pour les banques, les entreprises ettoutes les parties prenantes, il s'agitde décider quand et comment sepréparer à l'introduction de ce nouvel instrument financier et aux changements induits pour lesprocessus business. Sauf à prendrele risque d'être désavantagé sur le plan de la compétitivité interna-tionale.
C'est un instrument de technologieindépendante, basé sur des messa-ges standards XML ISO20022 et utilisable sur toute application deréconciliation de données (TMA)comme SWIFT/TSU (Trade ServicesUtility : plate-forme de communica-tion inter-bancaire pour les servicescollaboratifs de la chaîne d'approvi-sionnement).
Les enjeux pour les banques.Pour les banques, l’enjeu est important. Il s’agit de s’approprier lafinance en «Open Account» enréintermédiant une partie des 80%
l’intérêt de la communauté bancaireinternationale pour ce nouvel instru-ment.
Les avantages pour les entreprises.Pour profiter des évolutions du mar-ché international et des opportunitésoffertes, les entreprises doiventnouer des partenariats stratégiqueset proposer des solutions innovantesde financement de bout en bout duprocessus d'importation et/ou d’ex-portation. L’«OBP» est un instrumentde paiement d’avenir pour les entre-prises qui profiteront ainsi d’unerapidité d’exécution à coûts réduits et
Dossier thématique
Fig 2 - BPO Process (Source ICC /Syrtals - International Chamber Of Commerce - Décembre 2012 )
(1) Cf. article 3 des règles ICC - Bank Payment Obligations, URBPO Draft 4.
22-23 graff 3/05/13 15:59 Page 23
24 France
STRATÉGIES ET MARCHÉS INTERNATIONAUX
DOSSIER THÉMATIQUE
Nouvelle publication des RèglesUniformes du Forfaiting (RUF 800) : Comment les utiliser à bon escient?
ICC FRANCE
Le recours au forfaiting permet àun exportateur de sécuriser sescréances et de les transformer
en liquidités immédiates. Or, dans unmonde où l'essentiel des échangesest désormais réalisé en "openaccount", c'est-à-dire sans l'interven-tion préalable des banques desimportateurs (par l'ouverture de cré-dits documentaires), il est importantde proposer la technique de finance-ment et les acteurs capables de satis-faire les besoins de sécurité et definancement des vendeurs/exporta-teurs chaque fois qu'un paiement différé est la condition du succès d'un contrat commercial. Dans denombreux secteurs, les termes depaiement différés constituent mêmeune pratique non négociable, et latechnique de l'escompte sans recours,première définition du forfaiting, serala réponse adaptée à la réduction duposte clients. Le besoin existe partout,il était donc naturel qu'ICC réfléchisseaux moyens de développer l'usage duforfaiting au niveau mondial.Pour de nombreux exportateurs,cette technique financière reste difficile à mettre en œuvre et son rôle dans la panoplie des techniquesde financement du commerce international ambigu (par exemplevis-à-vis de l'affacturage et de latitrisation). Les Régles Uniformes duForfaiting (RUF) ont l'ambition derépondre à ce besoin de clarificationet constituent un véritable vade-mecum de l'exportateur soucieux decéder sans recours des créances sur
sa clientèle dans un cadre prédéfini.Les RUF s'adressent en effet auxvendeurs /exportateurs désireux decéder, sur une base sans recours,des créances commerciales matéria-lisées par toutes sortes d’instru-ments (y compris les crédits documentaires) avec ou sans garan-ties bancaires. La créance sur livreest également éligible même si sa matérialisation se résume à lafacture du vendeur et aux documentsd'expédition afférents. Le champd'application est donc immense etseule la capacité effective d'achatdes forfaiteurs (les banques pour lemoment) vient le limiter.Les RUF ne traitent que de la ques-tion de la cession de la créance,c'est-à-dire de son transfert par levendeur/cédant à son acheteur (lecessionnaire dans le langage juri-dique) et du paiement de ce dernierau cédant. Elles s'appliquent aussibien aux transactions du marché primaire (entre exportateurs et forfaiteurs) que du marché secondai-re (entre forfaiteurs seulement). Le point clef développé par les RUFporte sur le rôle et la responsabilitédes parties à une transaction de forfaiting selon leur position sur l'unou l'autre marché. Le cédant et leforfaiteur primaire, responsables dumontage d'origine de la transaction,doivent assumer de fait des respon-sabilités plus importantes quant àl'existence de la créance (et sa forceexécutoire) que les acteurs du marché secondaire. Pour cette
raison, les deux questions centralesportent sur l'existence légale de lacréance (c'est-à-dire valable et exigi-ble au regard du droit du pays dudébiteur cédé) et sur la validité deson transfert entre le cédant et lecessionnaire (c'est-à-dire opposableaux tiers dans le pays du cédant etdans celui du débiteur cédé). En l'absence d'instruments comme lebillet à ordre et la lettre de changepar nature titres de créance libre-ment négociables, le forfaiteur sefonde sur les déclarations et garan-ties de l'exportateur/cédant pourcouvrir ces deux points (l'article 13 des RUF dresse la liste des situa-tions impliquant la responsabilité ducédant vis-à-vis du cessionnaire).Cependant, il ne faut pas perdre devue que ces règles ne se substitue-ront pas aux différents droits applica-bles à une transaction de forfaiting.Dans tous les cas de figure, le droitapplicable au contrat de forfaitingcomme ceux applicables à la créanceet à sa cession demeurent le seulcadre légal de toute transaction, lesRUF n'apportent que leur architectu-re, laquelle sera la même pour tousles acteurs dans le monde entier. Ilest donc essentiel de les maîtriserpour éviter de se retrouver en situation de non-conformité avec l'undes droits applicables à la transac-tion. A noter qu'ICC France organise-ra deux sessions de formation à lapratique du forfaiting à partir desRUF en avril et en juin prochains.
La Chambre de Commerce Internationale (ICC) a publié en janvier 2013, de toutesnouvelles Règles Uniformes du Forfaiting (RUF 800) car il lui a paru utile de normaliserune technique de financement du commerce international qui répond parfaitementau besoin croissant des exportateurs de mobiliser leurs créances commerciales.
Patrice TOURNUS, Expert bancaire international
©D
R
24 tournus 3/05/13 16:00 Page 24
25France
Les conséquences de la crisebancaire européenne pour leTrade Finance
Depuis la crise des subprimes, les banques européennes traversent une séquence diffi-
cile. Comment continuer à jouer unrôle prédominant dans le financementdes échanges internationaux, le plussouvent en dollars avec des dépôts enEuros, avec en perspective une régle-mentation «bâloise» durcie sur l’effetde levier comme sur la liquidité Actif/Pas-sif ? La situation au début 2013 consa-cre le retour à une forme de normalitédes marchés du Trade et de leur liqui-dité. Mais dans un cycle d’exploitationencore difficile pour les banques euro-péennes, le Trade Finance change denature et le modèle de refinancementest invité à évoluer sous la contrainte.
L'amélioration est réelle. Tout d’abord, on retrouve les volumesd’échanges tandis que les «corridors»du Sud tirent le mouvement. La crisebancaire a surtout touché les PMEexportatrices et les acheteurs despays émergents à risque. Ensuite, la crise souveraine s’estompe etl’Europe bancaire trouve un nouveausocle. La BCE a fait la démonstrationde son savoir-faire…Le dollar estrevenu, mais plus court et plus cher. Par ailleurs, la Capital RequirementsDirective IV (CRDIV), autrement dit la directive européenne destinée àmettre en œuvre les normes interna-tionales en matière de fonds propres(effet de levier et liquidité) au sein del’Union européenne, conformémentaux accords de Bâle III, devrait êtreamendée dans le sens d'une diminu-tion du poids des lettres de crédit et
des garanties internationales dans lecalcul du Leverage Ratio. Dès lors, lecalcul des «outflows», les tirages surcrédits, destinés à être inclus dans leLiquidity Coverage Ratio en situationde stress, se ferait à des conditionsplus engageantes que ce qui avait étéinitialement prévu.
Toutefois, certains problèmes perdurent. La plupart des banques européennesdemeurent toutefois dans un cyclenégatif. Le coût du risque augmente,la ressource (marché interbancaire,obligataire, actions…) est rare etchère. En outre, elles sont exposées àun problème d'image (blanchiment,déontologie, information au client...),justifié ou non, qui les rend sensiblesau risque de réputation, des risquesd'autant plus inhibants que leurscontours sont parfois mal définis. Aplus long terme, l’arrêt durable ou lalimitation de certaines opérations debanque d’investissement suscitentune forte interrogation sur leur renta-bilité future et les profits qu'elles sontsusceptibles de capitaliser. Enfin ledurcissement de la réglementation,conséquence logique des crises deliquidité, est sévère : il faut réduirel'effet de levier, donc distribuer desactifs (Leverage Ratio) et retrouverdes dépôts (Liquidity Coverage Ratioet Net Stable Funding Ratio).
Et des contraintes nouvelles se font jour.Sur les marchés de l’argent, c’est la «relocalisation» qui s’instaure,
devise par devise, pays par pays,régulateur par régulateur. Le risqued’options divergentes dans la miseen œuvre de Bâle III (USA, Europehors Eurozone) est réel. Les banqueseuropéennes devraient aller plus viteque les autres…Le mouvement continu vers l’OpenAccount, le financement de la SupplyChain, ne se fera pas hors bilan. Ilfaudra du «cash», donc davantage dedépôts. Les banques doivent intégrerle Trade Finance et la gestion de laliquidité de leurs clients. C’est leconcept de Transaction Banking, quivise de fait plus d’autofinancement.Plus fondamentalement, les banqueseuropéennes ont comblé le «fundinggap» européen par une transforma-tion massive (11 000 milliards d'eu-ros) de l’excédent d’épargne à courtterme en financement à long terme.La diminution de l’effet de levierimposée par la réglementationimplique de sortir du seul universbancaire pour loger les actifs ailleurset évoluer vers la désintermédiationet les investisseurs : à mi 2012, lesprêts bancaires aux sociétés nonfinancières représentaient 75% deleur dette en Europe contre 13% auxEtats-Unis tandis que le Loan toDeposit ratio s’établit à 1.30 enEurope et à 0.79 aux Etats-Unis.L’ampleur de l’écart donne une idéede l’effort, en intensité comme endurée. Les avancées obtenues pourle traitement du Trade Finance dansla CRD IV doivent s’analyser dans cecontexte global.
Depuis cinq ans, les banques européennes sont malmenées par la crise, avec enperspective les contraintes imposées par la nouvelle réglementation de Bâle III. Leurrôle dans le Trade Finance change de nature et le modèle de refinancement est invitéà évoluer sous la contrainte.
Jean-Paul RIOLACCI, Responsable Capital et Crédit - Global Transaction Banking, BNP Paribas
ICC FRANCEDossier thématique
©D
R
25 riolacci 3/05/13 16:02 Page 25
26 France
POINT DE VUE
ICC FRANCE
Dans un contexte économiquetendu, le levier de l’interna-tional demeure essentiel
pour faire grandir nos PME et leurpermettre d’accéder à de nouveauxmarchés. Cependant, les entrepri-ses sont frileuses pour franchir lepas et peinent à profiter des atoutsofferts par l’export et des aides proposées par les différents opéra-teurs. Les études, pourtant, sontformelles : une PME exportatriceest beaucoup plus résistante et affiche une rentabilité supérieure àcelle de sa voisine non tournée versl’international. L’expérience montreégalement que les entreprises préparées et accompagnées sontcelles qui réussissent le mieux dansleur stratégie commerciale à l'export. L’enjeu consiste donc àidentifier de nouveaux exportateurset à les accompagner sur des marchés adaptés à leurs capacitéset à fort potentiel.
Une porte d’entrée à l’international.Pour être encore plus efficace, laCCI de Lyon a choisi de travailler enréseau avec tous les acteurs dudispositif d’appui à l’international.C’est la mise en synergie de nosénergies et de nos compétences quipermet d’obtenir des résultatsconcrets pour le plus grand bénéficede nos entreprises. Cette nouvelleorganisation a donné naissance àl’Equipe Rhône-Alpes de l’export.Ce partenariat unique des partenai-res des entreprises à l’export vise à simplifier leur approche des marchés étrangers par une offre
formalisée et lisible des produits etservices à leur disposition. Enrégion lyonnaise, la CCI de Lyon estla première porte d’entrée pour lesentreprises souhaitant démarrer ouconsolider une démarche à l’export.Nous sommes en première lignepour les aider à conquérir des partsde marché à l’international.
Un monde de solutions pour toutesles entreprises.La CCI de Lyon propose une gammecomplète de services correspon-dant à toutes les étapes de la miseen œuvre du projet de l’entreprise :l’information, la prospection, lacroissance ou l’implantation. Pource faire, nous menons trois typesd’actions. Tout d’abord, la CCI orga-nise des actions de sensibilisation,notamment en direction des entre-prises n’ayant jamais exporté et desprimo-exportateurs. Ensuite, auplan collectif, nous animons desclubs territoriaux, géographiques et thématiques qui favorisent l’échange d’expériences à l’exportet permettent d’aborder les thèmespratiques liés au développementinternational. Près de 300 entrepri-ses contribuent régulièrement à ces clubs. Outre l’accueil de délégations, l’accompagnementdes entreprises lors de missions oude salons à l’étranger, la CCI deLyon organise aussi chaque annéele Forum de l’international, avecplus de 300 entreprises participan-tes. Enfin, nos experts géogra-phiques et juridiques prodiguentleurs conseils individualisés pour
accompagner les entreprises dansl’élaboration d’une stratégie dedéveloppement ou la constructiond’un plan d’action à l’international.En 2012, 1 500 entreprises ont ainsiprofité des dispositifs mis en placepar la CCI de Lyon.
Faciliter les échanges en partenariatavec la Chambre de CommerceInternationale (ICC).Avec la Chambre de CommerceInternationale, nos missionsconvergent vers un même objectif :faciliter la bonne marche des affaires dans le monde. La CCI, entant que partenaire de proximitédes entreprises, est un excellentrelais des actions qu’ICC met en œuvre pour les aider dans leur développement international.Chaque année, nous co-animonsavec ICC France des réunions d’informations et nous organisonsdes sessions de formation sur desquestions concrètes, notammentsur les codes et règles visant à simplifier le commerce, comme lesIncoterms, l’arbitrage internationalet très récemment le nouveaucontrat modèle de vente interna-tionale. Ces réunions rencontrentbeaucoup de succès et témoignentde l’importance des liens étroits quinous unissent pour faciliter le commerce international pour toutes les entreprises. ■
Avec plus de 11% des exportations françaises, Rhône-Alpes est la deuxième régionexportatrice de France. Le solde commercial de la région reste positif, même sil'excédent a fondu depuis 2007. La CCI de Lyon intervient sur un territoire de fortetradition exportatrice puisque plus de 33% des exportations régionales sont réaliséespar des entreprises du Rhône.
Philippe GRILLOT, Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon
Une organisation territorialeau service des entreprises àl’international
©Je
an-J
acqu
es R
ayna
l
26 grillot 3/05/13 16:07 Page 26
27France
Lorsque le système sera envigueur, sans doute en 2014,tout inventeur pourra déposer
une demande de «brevet unitaire»auprès de l’Office européen desbrevets (OEB) afin d’obtenir uneprotection de son invention sur leterritoire des États-membres parti-cipants. Parce qu’il constitue untitre unique, le brevet unitaire romptavec l’ancrage fortement national etmorcelé du système européen créépar la Convention de Munich de1973. Ce dernier conduit, en effet, à déposer une demande uniqueauprès de l’OEB visant tout ou partie des 38 Etats signataires,sans pour autant dispenser l’inven-teur d’effectuer par la suite les procédures de délivrance et demaintien du titre auprès de chacundes offices nationaux. Ce dispositifa suscité certaines critiques quant àsa complexité et à son coût : alorsqu'un dépôt de brevet coûte 1 850eaux États-Unis, il peut excéder 36 000e pour un brevet européen. L’existence du brevet unitaire setraduira par un allègement sub-stantiel du régime de traduction(bienvenu, notamment pour lesPME). Actuellement, les coûts detraduction peuvent représenter jusqu'à 40% du coût total d’un brevet délivré par l’OEB. En attendant la mise en place d’unoutil de traduction automatique, le dépôt pourra être fait dans n’importe quelle langue de l’Union,
à charge pour le demandeur defournir une traduction dans l’unedes trois langues officielles de l’OEB(anglais, allemand, français). Dansce cas, des remboursements supplémentaires concernant lescoûts de traduction seront attribuésaux demandeurs dont l’établisse-ment principal se situe sur le terri-toire d’un des États-membres.Quant aux frais de renouvellement,les titulaires de brevets verserontune taxe annuelle unique, dont leniveau devrait être fixé de manière àfavoriser l’innovation, notammentpar la mise en place d’une taxeréduite pour les PME.
Une protection uniforme et un effetunitaire.La procédure d’examen et de délivrance auprès de l’OEB sedéroulera selon les règles déjàapplicables au brevet européen.Une fois le brevet unitaire délivré,celui-ci conférera à son titulaireune protection uniforme de soninvention sur le territoire des 25 États-membres participants. Ilassurera une protection uniformeet produira les mêmes effets danstous les États-membres partici-pants. La délivrance du titre, sontransfert, sa limitation, sa révoca-tion ou son extinction vaudront à l’égard de chacun d'entre eux. L’uniformisation du système desbrevets s'accompagne de la décision de créer une nouvelle
institution, la Juridiction Unifiée des Brevets, qui disposera d’une compétence exclusive en matièrede contrefaçon et de nullité. Lasolution est originale, car contraire-ment à ce qui a été mis en placepour les autres titres de propriétéintellectuelle, ce ne sont pas lesjuridictions nationales, appliquantle droit communautaire, qui ont étédésignées, mais une juridictioncréée spécialement à cet effet.L’objectif, exprimé par les règle-ments européens du 17 décembre2012, est de garantir l’uniformité dela jurisprudence et d'assurer auxentreprises une véritable sécuritéjuridique. Il s’agit également, par la centralisation du contentieux, de s’assurer de la spécialisationdes magistrats qui seront plus spécifiquement formés.
Une organisation et des règles deprocédure spécifiques.La future juridiction européenne afait l’objet d’un accord adopté endécembre 2012, accord signé parles États-membres participants enfévrier 2013. Elle devra respecter ledroit de l’Union Européenne eninterrogeant si nécessaire la Courde Justice de Luxembourg. Ellesera composée d’un tribunal de première instance (TPI) et d’une cour d’appel. Résultat d'uncompromis âprement négocié, ladivision centrale du TPI sera installéeà Paris avec deux antennes à
ICC FRANCE
Le Conseil de l’Union Européenne et le Parlement européen ont adopté le 17 décembre2012 deux règlements relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet dans25 des 27 États-membres de l’Union (hors Espagne et Italie), ainsi qu’un projetd’accord relatif à la juridiction unifiée en matière de brevets1.
Martine KARSENTY-RICARD, Avocat à la Cour, Présidente de la Commission Propriété Intellectuelle duComité Français de la Chambre de Commerce Internationale.
Brevet unitaire et juridiction unifiée : Commentrendre efficace le nouveaudispositif européen ?
©D
R
Point de vue
27-28 karsenty ricard 3/05/13 16:11 Page 27
28 France
POINT DE VUE
ICC FRANCE
Munich et à Londres. Il sera aussicomposé de divisions locales(créées dans un État contractant àla demande de celui-ci) et régionales(créées pour deux ou plusieursétats à la demande de ceux-ci). Lestitulaires de brevet auront le choixde porter leur action devant la divi-sion locale du lieu de la contrefaçonprésumée ou devant celle du lieu dedomiciliation du défendeur. A noterque cette option risque toutefois depermettre au demandeur d'attirerl'adversaire dans un État peu familier, notamment en raison de lalangue de procédure qui, en principe, sera celle du pays où sesitue la division locale compétente.Si le présumé contrefacteur soulèveen défense la nullité du brevet quilui est opposé, la division localecompétente aura la possibilité derenvoyer cette question devant ladivision centrale. Dans cette hypothèse, elle pourra choisir desurseoir à statuer dans l’attente dela décision, ou décider de statuerimmédiatement sur l’action encontrefaçon sans attendre la décision de la division centrale surla validité du brevet. Le secondchoix aura l’inconvénient de géné-rer des difficultés si un brevet estannulé alors qu’une condamnationpour contrefaçon a été préalable-ment prononcée et de rallonger la procédure. Ce dispositif envisagédans le cadre des règles de procé-dure est inspiré du droit allemand :il s’agit de la disposition dite de«bifurcation». Dans l'hypothèse où la division cen-trale serait amenée à se prononcersur la validité du brevet, la langueapplicable à la procédure sera celledu brevet et non celle de la divisionlocale. Il n’est donc pas impossibleque les deux contentieux, devant ladivision centrale et devant la division locale, ne se déroulent pasdans la même langue. Si ces diffi-cultés linguistiques ont fait l’objetde critiques, c’est parce qu’impo-ser à un justiciable une procéduredans une langue qu’il ne maîtrisepas est susceptible de nuire aux
droits de la défense. Autre pointimportant à souligner : les déci-sions de cette juridiction produirontleurs effets sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.Une taxe dont le montant varieraselon la valeur du litige devra être acquittée en début de procédure, ce qui rend pour l’instant son coûtrelativement incertain, bien qu’apriori plus élevé que devant unejuridiction nationale.Consulté sur les futures règles deprocédure, le Comité Français de la Chambre de CommerceInternationale a formulé des obser-vations, notamment sur certainesdispositions pouvant porter atteinteau respect du contradictoire et qu'ilsouhaitait voir modifiées. Un projetamendé de ces règles devrait êtreprochainement rendu public. Il estapparu nécessaire que les profes-sionnels de la propriété industrielleassurent d'une seule et même voixla promotion de Paris, choisie pourhéberger le siège de la Divisioncentrale du Tribunal de premièreinstance. Ainsi, le Comité françaisde l'ICC a adhéré, en qualité de membre fondateur, à l'associationUnion pour la juridiction unifiée desbrevets créée en janvier 2013.Celle-ci a pour objet de fédérerassociations et organisations dudomaine de la propriété intellec-tuelle afin d'assurer, en concerta-tion avec les pouvoirs publics, unemise en place de la juridiction européenne unifiée des brevets, en particulier sa division centrale à Paris, la création dans la capitaled'une division locale et son fonctionnement pour les usagers. L’impact réel du brevet unitaire seraévalué en 2017, lorsqu’un premierrapport sera présenté par Bruxelles.Si l’effort de rationalisation écono-mique et l’attractivité de ce systèmedoivent être salués, et si l’harmoni-sation présente indiscutablementdes vertus, notamment celle d’assurer aux entreprises une plusgrande sécurité juridique, il seraintéressant de comparer l’efficacitéde ce système, notamment pour les
PME, par rapport à celui qui existepour les marques et les dessins etmodèles communautaires où les litiges ressortent de la compétencedes juridictions nationales dont lacohérence des décisions est assuréesous l’égide de l’Office d'enregistre-ment des marques et dessins oumodèles de l'Union européenne(OHMI) et de la Cour de Justice del’Union Européenne. ■
(1) Règlement no. 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et règlement no. 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant enœuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.
27-28 karsenty ricard 3/05/13 16:11 Page 28
29France
En matière de TVA, les États-membres de l’Union euro-péenne (UE) ont mis en place
des régimes différents. Les uns exigent le paiement de la TVA dueau titre de l’importation, les autresadmettent la simple inscription surla déclaration de TVA (régime dit del’auto-liquidation). Quant aux textesfrançais, ils reposent sur un dogmefondamental selon lequel, enFrance, la TVA à l’importation doitêtre liquidée (payée) auprès de ladouane lors de l’importation.Certes, au fil des années et face auxdemandes des entreprises, ce dogmea été retouché à plusieurs reprises : • Report de paiement de la TVA, puis
échéance unique de paiement le25 du mois suivant l’importation.
• "Décautionnement" du différé depaiement pour les entreprises quien font la demande à titre excep-tionnel et à condition de présenterun crédit d’enlèvement.
• Enfin, «décautionnement» de prin-cipe pour les entreprises disposantd'un crédit enlèvement avec exten-sion aux taxes assimilées à la TVA.
Mais, au final, la TVA à l’importationdoit toujours être décaissée : seu-les les entreprises qui sont structu-rellement exportatrices (export oulivraison intracommunautaire) onten effet le droit de demander unefranchise de TVA dénommée AI2.Les textes de fin 2012 n’ont en réali-té rien changé pour les opérateurs,lesquels connaissent des situationsfort différentes.
Les PME sont souvent peu infor-mées de toutes ces tracasseries :la TVA n’est pas la préoccupationcentrale de leurs dirigeants. Ellessuivent en général les consignes deleur commissionnaire en douane etpaient la TVA à l’importation, ce quiimpacte leur trésorerie. Quant auxgros opérateurs, ils ont mis en placedes crédits d’enlèvement sous laforme de cautions au bénéfice de ladouane en échange de facilitationsou régimes économiques. Mais,depuis 2006, ils ont souvent oubliéde faire décautionner la TVA d’im-portation de sorte que leurs opéra-tions sont sur-cautionnées, ce quiconstitue un coût pour eux aussi.Après vingt ans de marché unique(1993-2013), les opérateurs quiimportent en France sont nettementdéfavorisés par rapport à ceux quiimportent dans un autre État-mem-bre accordant l’auto-liquidation de laTVA. Les ports d’Anvers, Zeebruggeet Rotterdam ont ainsi solidementaccru leur attractivité et dédouanentaujourd’hui environ 50% des flux deconteneurs destinés à la France,contre environ 20% dans les années1990, ce qui montre que le contour-nement n’a fait que s’accroître aucours de la période.Préoccupée par cette situation, laCommission Européenne a lancéune vaste étude sur le dédouane-ment centralisé en 2011. Elle a comparé les divers régimes depaiement de la TVA d’importation :
• Le paiement immédiat à la douaneest possible dans les 27 États-membres.
• L’option pour le différé de paiementest ouverte dans 21 États-membres(5 octroient un report de paiementspécifique pour la TVA, 21 un délaiidentique pour la TVA et la douaneet 6 un délai spécifique pour ladouane au cas où il n’existe pas dedélai de report pour la TVA).
• L’auto-liquidation de la TVA d’impor-tation est possible dans 16 États-membres et seulement pour lesassujettis. L’auto-liquidation est larègle de principe dans trois d'entreeux, ce qui signifie que pour les 13autres, elle résulte d’une optionoctroyée aux entreprises assujetties.
Bruxelles en a conclu que le dédoua-nement centralisé obligeait à har-moniser les modalités. De son côté,la Cour de Justice a eu à connaîtrede cette épineuse question en 2012(arrêt Véléclair : CJUE C-414/10) etelle en a notamment conclu que, loinde faciliter la fraude, l’auto-liquida-tion était au contraire de nature àéliminer celle-ci ! Nul doute que cedébat refera surface dans le cadredes discussions sur le nouveau Codedes Douanes de l’Union.Si elle veut préserver une certainecompétitivité et un pouvoir d’attrac-tion, la France va devoir utiliser toutesles options offertes par la DirectiveTVA 2006/112, afin que la TVA à l’im-portation en France ne constitue plusun obstacle au développement desports et des aéroports français maiscontribue au contraire à la compétiti-vité de notre économie. ■
ICC FRANCE
Les discussions budgétaires de la fin 2012 ont remis la question de la TVA à l’importation et son impactsur la compétitivité de l'économie au centre des débats parlementaires.
Odile COURJON, Avocat associée, Taj, société d’avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de l’A3F
et
Pierre SARTINI, Vice-président de l’Observatoire
des Réglementations Douanières et Fiscales
Importer dans l'UnionEuropéenne : décaisser la TVAou faire jouer la concurrence ?
©D
R
©D
R
Point de vue
29 courjon et sartini 3/05/13 16:12 Page 29
30 France
SÉMINAIRES
ICC FRANCE
Les entreprises sont conscien-tes de l’importance du droitantitrust pour garantir leur
développement dans un environne-ment économique dynamique et dusérieux de sa mise en œuvre par desautorités dotées de pouvoirs éten-dus. Mais la question du «juste»montant des sanctions est récur-rente, particulièrement en Europeoù les lignes directrices publiées parla Commission ont conduit celle-ci àprononcer des amendes sans com-mune mesure avec celles que lesentreprises peuvent être amenées àsupporter pour d'autres infractionsde nature économique. Cette ques-tion, qui connaît également uneactualité en France avec la publica-tion d’un Communiqué de procédurepar l’Autorité de la concurrence(ADLC) le 16 mai 2011, communiquéqui a déjà été appliqué dans desaffaires significatives, constitue doncpour les entreprises un enjeu écono-mique et juridique majeur. C'est laraison pour laquelle ICC France avoulu aller plus loin qu’une discus-sion sur les textes et pratiques envigueur pour mener une réflexion defond sur ce que doit être le justemontant des sanctions antitrust, auregard des objectifs poursuivis etdes infractions en cause.Après l 'accuei l de FrançoisGeorges, François Brunet, président
de la Commission concurrenced'ICC France et avocat chez ClearyGottlieb, a présenté les réflexionsmenées par ICC France et rappeléquelques éléments de contexte. Il anotamment souligné que Bruxellessanctionne plus fortement les cartels que l'Autorité de la concur-rence puisqu'en Europe -commed'ailleurs aux Etats-Unis - l'amen-de représente environ 20 % du chiffre d'affaires annualisé des produits en relation avec l'infractioncontre environ 10 % en France.Bruno Lasserre, président del'Autorité de la concurrence, aensuite présenté l’activité de l’ADLCet sa pratique en matière de sanctions à partir des sept déci-sions rendues depuis la publicationdu communiqué, décisions quiconcernent 60 entreprises. Il aindiqué que l'ADLC se fixe troispriorités : proportionnalité de l'amende, pragmatisme et dissua-sion. Il a notamment souligné quele montant des sanctions doit eneffet être fixé avec pragmatisme,sachant que dans certains cas laméthode générale définie par leCommuniqué peut se révélerinadaptée. Le Président de l’ADLC aégalement insisté sur la nécessitéde prononcer des sanctions dissua-sives, avec majoration de l'amendeen cas de récidive, et conclu en rappelant que le droit des sanctions
est un droit en construction dansl’attente de la jurisprudence à venirde la Cour d’appel de Paris et de laCour de cassation, notamment.L’intervention de Bruno Lasserre aété suivie par une table ronde de trois économistes : EmmanuelCombe, professeur à Paris I, MarcelBoyer, professeur émérite àl'Université de Montréal et DavidSevy, de Compass Lexecon Europe.Ces experts, réputés pour la qualitéde leur recherche dans ce domaine,ont présenté leurs travaux, notam-ment sur le calcul de l'«amendeoptimale» et de la nécessité de soncaractère dissuasif, sur la prise encompte de son «effet économique»dans la fixation d'une amende et surla question de l'adaptation éventuel-le des sanctions en période de criseéconomique. Il en est résulté unéchange particulièrement stimulantsur la difficulté d’appréhender lemontant optimal des sanctions antitrust, notamment du fait desdonnées disponibles qui peuventconduire à des conclusions discuta-bles. Le colloque s’est poursuivi parune intervention de Bernard Fieldqui a présenté le point de vue del’entreprise lorsque celle-ci estconfrontée à une sanction dont lemontant et les conditions de recou-vrement sont susceptibles de mettreson existence en péril, en s’appuyantsur un cas concret.Gérard Worms a conclu le séminai-re après un débat très riche qui anotamment porté sur la nature dessanctions appropriées, la fiabilitédes informations utilisées pournourrir les études économiquesréalisées sur le sujet et sur la perti-nence du montant des sanctionsprononcées par la Commission etl’ADLC au regard des conclusionsde ces études. ■
Les amendes infligées par les autorités de concurrence européennes et la Commission européennesont sans commune mesure avec celles que les entreprises peuvent supporter pour d’autres infractionsde nature économique, et constituent un enjeu juridique majeur. La question était au centre des débatsdu séminaire organisé le 17 octobre dernier par ICC France.
Philippe RINCAZAUX, Avocat à la Cour - Associé, Orrick Rambaud Martel et Georges CHALOT, Chef du Département «Droit de la concurrence», Total S.A.
Sanctions antitrust : Quel est le juste montant ?
©D
R
30 Rincazaux et chalot 3/05/13 16:16 Page 30
31France
En préambule, François Georges(Délégué Général d ’ ICCFrance) rappelle que les
entreprises ont recours à l’arbitragepour obtenir la reconnaissance et le paiement de ce qui leur est dû. Leséchanges portent sur les solutionsqui s'offrent aux entreprises lorsquecelles-ci sont confrontées à la diffi-culté de voir exécuter la sentence.
Choisir l’institution et le siège del’arbitrage.Pierre Charreton (DirecteurJuridique, Areva) confirme que lechoix d’ICC est stratégique pour lesentreprises. Andrea Carlevaris(Secrétaire général de la CourInternationale d’Arbitrage d’ICC)revient sur l’engagement de la Courde faire en sorte que la sentencesoit exécutée ou exécutable, enga-gement qu'il qualifie de «raisond’être institutionnelle». Pourre s p e c t e r l’ a r t i c le V d e l aConvention de New-York, la Courexamine le projet de sentence etl’approuve préalablement à la déci-sion des arbitres. Ce contrôle dequalité décourage les critiques. LaCour évite aussi toute contestationde la sentence par les ordres juri-diques nationaux (par ex. que lasentence soit rendue hors délai).Elle est disposée à rappeler l’article24-6 du Règlement à la partiedéfaillante qui précise son caractè-re obligatoire, et peut délivrer descopies supplémentaires dûmentcertifiées conformes afin de facili-ter le respect de l’article IV de la Convention de New-York. Parailleurs, pour savoir si le pays du
siège est favorable à l’arbitrage, ilfaut vérifier si le pays a ratifié laConvention de New-York, consulterla loi et la jurisprudence locales.«C’est l’ensemble de ces élémentsqui fait d’un lieu une place d’arbi-trage» résume Laurence Kiffer(Avocate, Teynier, Pic & Associés).
Mettre en place une réflexion stra-tégique des juristes et des conseils.Pierre Charreton souligne que,pour l'entreprise, «la clause derèglement des différends est deve-nue stratégique dans la négociationde contrats internationaux». Celle-ci lui donne l’occasion de préserverses intérêts futurs et de s’assurerde la qualité du cocontractant. Pourassister l’entreprise qui souhaiteanticiper l’exécution de la sentence,les avocats sont les seuls à avoir lescompétences pratiques nécessai-res. Ils connaissent les actes utiles(rédaction, significations), s’infor-ment sur la personne auprès delaquelle on peut saisir et prévoientles mesures conservatoires ulté-rieures (par ex. les garanties ban-caires). Faire appel aux conseilsévite que la sentence ne soit viciéeet fait échec à tout recours abusif.
Institutions publiques : des pra-tiques différentes. Philippe Leboulanger, président duComité Français de l’Arbitrage etavocat chez Leboulanger &Associés, souligne que « l’objectifpremier de la réforme du 13 janvier2011 fut d’assurer l’efficacité del’arbitrage afin notamment d’obtenirune sentence tranchant définitivement
le litige». L’exécution des sentencesest facilitée, avec notamment lasuppression de l’effet suspensif durecours en annulation et de l’appelde l’ordonnance d’exequatur enmatière d’arbitrage international.La réforme a aussi limité les possi-bilités de contestation (notificationsimplifiée, délais de recours réduità 1 mois, possibilité de renoncer aurecours en annulation). En France, la jurisprudence garan-tit l’exécution d’une sentence annu-lée dans le pays du siège, uneexception par rapport à la plupartdes autres pays. Isabelle Michou(Avocate, Herbert Smith) cite leRoyaume-Uni et l’Italie, où l’annula-tion d’une sentence au siège aura apriori un impact défavorable surson exécution, et insiste sur l’utilitéde «la Convention de Genève, pourfaire exécuter la sentence pourtantannulée au siège de l’arbitrage».José Rosell (Avocat, HughesHubbard & Reed) rappelle que de nombreuses sentences sontexécutées par les États «par latransaction, les moyens de saisie,et l’intervention de sociétés derachat de sentences», mais confir-me que l'issue n'est pas toujoursaussi simple. L’arme fatale, conclutCarole Malinvaud (présidente de laCommission Arbitrage d’ICC Franceet avocate chez Gide LoyretteNouel), est la Convention de NewYork, tout en soulignant l’importan-ce de la motivation de l'arbitre,puisqu’«exécuter une sentence,c’est aussi l’accepter». ■
ICC FRANCE
Sentences arbitrales : Face auxobstacles, quelles solutionspour les entreprises ?
La quasi-totalité des sentences sont exécutées spontanément. Mais que fairelorsque l'autre partie refuse d'exécuter la sentence, comment sauver votrearbitrage et aborder l’étape suivant le prononcé de la sentence ? Tel était lethème du séminaire organisé par ICC France le 29 novembre 2012.
Béatrice CASTELLANE, Animatrice des débats, Avocate, AMCO, Cabinet Castellane
Séminaires
31 castellane 3/05/13 16:18 Page 31
32 France
SÉMINAIRES
ICC FRANCE
Quelques réflexions d'ordregénéral pour commencer. Enmatière de secret des affai-
res, une méthodologie apparaîtnécessaire afin de bâtir un cadrejuridique efficace pour le protéger.Celle-ci passe d’abord par larecherche des principes matricielsqui constitueront la base du systè-me, lui donneront sa logique et irrigueront son élaboration. Lesproblèmes actuels résident autantdans le trop grand nombre de textesapplicables que dans l'insuffisance–voire l’absence- de textes perti-nents. Pour autant, il est toutefoisdouteux qu'un texte unique puisseencadrer demain l'ensemble desproblématiques liées au secret desaffaires. Il serait plus raisonnabled'envisager un cadre harmoniséfondé sur l'article 39 de l’accord surles aspects des droits de propriétéintellectuelle qui touchent au com-merce et peut-être, sur l'article 8de la Convention européenne desdroits de l'Homme. Une fois harmo-nisé, ce cadre devra couvrir l'ensemble du processus, depuisl'organisation du secret jusqu'à la sanction de sa violation tout enconservant à l’esprit que le secret,«enfant de la pratique», est un domaine fondamentalement factuel : le droit ne saurait porterremède à tous les maux.
L'organisation du secret des affaires.Une définition précise ne semblepas indispensable. Soyons pragma-tique : définit-on la notion de vie
privée de l'article 9 du Code civil ?Pour autant, cela n'a nullementempêché cette protection de sedévelopper. Toutefois, la recherchede principes matriciels conduit àretenir les trois éléments énoncéspar l'article 39 : les informationsne doivent pas être généralementconnues, elles doivent avoir unevaleur commerciale et faire l’objetde dispositions raisonnables deconfidentialité.Une meilleure approche des straté-gies de protection est en revanchenécessaire. Malgré l'existence de lapanoplie des droits de propriétéintellectuelle, le secret demeure eneffet un mécanisme irremplaçableet l’articulation entre les deux méri-te d’être précisée. La notion de«mesures raisonnables» tirée del’article 39 devrait être égalementdéclinée en fonction des situations.Les acteurs économiques doiventédicter de «bonnes pratiques» deconfidentialité : le secret des affai-res se fonde sur la notion de «tra-vailler ensemble» au sein des entre-prises, des professions et, au-delà,sur les pratiques contractuelles.Sensibiliser à la nécessité d’une pro-tection, recenser les informations àprotéger et le faire grâce à desméthodes ad hoc, doivent relever duréflexe et faire l’objet d’un partaged’expérience. Les textes juridiquesne sauraient pallier l’absence de cesinitiatives. Le secret, moyen factuelde la confidentialité, ne se confond
pas avec son contenu, qu'il s'agisse,ou non, d’informations à caractèretechnique. Ce moyen ne constituepas un droit privatif : malgré lesqualifications parfois différentesretenues en Common Law, il n'estpas souhaitable de remettre encause cette distinction.
Le régime du secret des affaires. Malgré l’absence de caractère priva-tif et absolu, la protection du secretdes affaires constitue un «principegénéral du droit» selon la Cour dejustice, et elle s’attache à desnotions juridiques qui en assurentl’efficacité comme la loyauté et lesusages. Le support physique doitêtre distingué des informations,secrètes ou non, qu’il contient :l’introduction de la notion de «sépa-rabilité» («sécabilité»), dégagée en droit de la concurrence devrait faciliter le tri systématique desdocuments saisis, sous le contrôledu juge. Plus généralement, le droitprocessuel mérite d’être harmonisépour ce qui a trait au maintien dusecret des affaires : les droitsfinancier et de la concurrence cons-tituent ici des sources d’inspiration.Enfin, il convient d’adapter lessanctions appliquées à la violationdu secret des affaires : améliorerle droit de la preuve en l’alignantsur les modes éprouvés pour lacontrefaçon ou en étendant lerecours aux présomptions ; créerde nouvelles incriminations visantla collecte frauduleuse d’informa-tions protégées, la tentative, et l’usage du secret des affaires ;introduire un mécanisme d’indemni-sation assis sur les bénéfices réalisés par le contrevenant ou ses complices. Cette matinée a proposéun excellent cadre de travail pour don-ner une suite au projet Carayon ! ■
Le secret des affaires est-ilencore protégé ?
Le séminaire sur le secret des affaires organisé en janvier 2013 par le Comité français de la Chambrede commerce internationale fut l'occasion d'un échange de grande qualité sur l'organisation du secretdes affaires et son régime. Le professeur Jean-Christophe Galloux éclaire les points essentiels du débat.
Jean-Christophe GALLOUX, Professeur agrégé à l'Université Paris II-Panthéon-Assas, Avocat à la Cour.
32 Galloux 3/05/13 16:21 Page 32












































![Patients immunodéprimés, quel pathogène pour quel déficit ...€¦ · (acquise ou congénitale) et de la fraction déficitaire [27]. Les déficits congénitaux en protéines du](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/607b9ce288e3065302754e5e/patients-immunodprims-quel-pathogne-pour-quel-dficit-acquise-ou-congnitale.jpg)





![Lake-O-Ukers Ukulele Strum October 25, 2019punchdrunkband.com/songpdfs/LakeOOct25-2019.pdf · [G] La la la la la [B7] laaaa la la [Em] la la la la la la [G7] laaaaaa . La la la la](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5fd12b9fd69a5f331475ceba/lake-o-ukers-ukulele-strum-october-25-g-la-la-la-la-la-b7-laaaa-la-la-em.jpg)